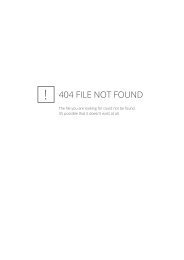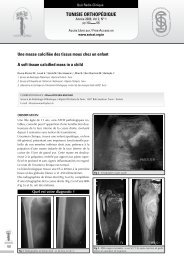Le «coude flottant - sotcot
Le «coude flottant - sotcot
Le «coude flottant - sotcot
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Tun Orthop 2010, Vol 3, N° 1Da S.C. et al.I. INTRODUCTION<strong>Le</strong> «coude <strong>flottant</strong>» ou «floating elbow» introduit pour lapremière fois en 1980 par Stanitski et Micheli, désignaitune association lésionnelle chez l’enfant comportantdes fractures concomitantes supra condyliennes del’humérus et du segment antébrachial du même membrethoracique [1].Chapuis [2] définit le coude <strong>flottant</strong> comme l’associationentre une fracture de la palette humérale (en règlegénérale une fracture supra condylienne) et une fracturede la diaphyse ou de l’épiphyse distale d’un ou des deuxos de l’avant-bras homolatéral.Pour Rogers et al. [3], le terme «coude <strong>flottant</strong>» estapplicable aux fractures concomitantes de la diaphysehumérale ou de la région supra condylienne huméraleassociées aux fractures olécrâniennes, aux fractures desdiaphyses radiale ou ulnaire, aux fractures des deux osantébrachiaux ou fractures apophysaires distales du radiusou des deux os de l’avant-bras. Cette associationlésionnelle au niveau du membre thoracique est rare etgrave en raison des lésions des parties molles engendréespar des traumatismes violents à haute énergie.En Afrique subsaharienne, très peu de publications ontété consacrées au «coude <strong>flottant</strong>» [4].Dans notre contexte, ces lésions sont le plus souvent provoquéespar des accidents de la circulation routière. Eneffet, Sané AD et al [5], dans leur étude prospective deneuf cas de «coude de portière» en deux ans et demi,ont rapporté trois cas de coude <strong>flottant</strong> et ont soulignéque le terme de «coude de portière» est à différentier decelui de «coude <strong>flottant</strong>» qui est une sous-entité du coudede portière. L’objectif de cette étude est de décrire les aspectsanatomo-cliniques et apprécier les résultats thérapeutiquesdu «coude <strong>flottant</strong>».II.malades ET MéTHODESNous avons réalisé une étude rétrospective descriptiveentre le 1 er janvier 2002 et le 31 décembre 2008, dans leService d’Orthopédie Traumatologie de l’Hôpital Aristide<strong>Le</strong> Dantec de Dakar.A- Critères d’exclusionOnt été exclus de l’étude, tous les cas de fractures articulairesisolées du coude, les cas de fractures étagéesd’un même segment du membre thoracique ainsi queles cas de fractures siégeant sur l’humérus d’un côté etsur l’avant-bras controlatéral.dossiers cliniques des patients, des registres de compterenduopératoires et de sortie. <strong>Le</strong>s informations recueilliesont été rédigées sur une fiche de collecte de données.<strong>Le</strong>s résultats anatomo-cliniques des patients suivis ont étéanalysés. Une rééducation fonctionnelle des membrestraumatisés a été débutée dans le service et poursuivieaprès la sortie des patients. Une évaluation fonctionnelleau dernier recul n’a pas pu être effectuée.Nos résultats on été appréciés selon la cotation globale, cliniqueet radiographique du membre thoracique dans laquellesont pris en compte les axes du coude et du poignet selonDaunois et al. [6] (Tableau I). Pour chaque patient, le plusmauvais résultat de l’une des deux fractures, a été retenu.Tableau I: Critères d’appréciation des résultatsAxeMobilitéTrès bon Normal NormaleBon Défaut < 10° défaut < 10°Moyen Défaut < 20° défaut < 20°Mauvais Défaut > 20° défaut > 20°Durant la période de sept ans, 43 618 patients ont étéadmis en urgence, soit une fréquence annuelle de 6231blessés, mensuelle de 519 cas et quotidienne de 17 cas.Parmi ces patients, 22 cas de coude <strong>flottant</strong> ont été pris encharge dans le service, soit une fréquence de 0,05% decas de coude <strong>flottant</strong> et une incidence de 0,35% ; ce quidonne une moyenne annuelle de trois cas de coude <strong>flottant</strong>.L’âge moyen des patients était de 33 ans (extrêmes6 et 70 ans).<strong>Le</strong>s sujets de sexe masculin étaient les plus touchés avec13 cas (59,1%), soit un sex-ratio de 1,4.<strong>Le</strong>s accidents de la circulation représentaient les circonstancesde survenue les plus fréquentes avec 14 cas(63,6%). Ces accidents du trafic routier impliquant souventdes véhicules à quatre roues (8 cas), ont engendrédes traumatismes violents à haute vélocité (Tableau II).TABLEAU II: Répartition des patients selon la profession et les causes des traumatismesAC AT AD Autres Non précisée TotalFemme au foyer 3 - 1 - - 4Elève - - 1 2 - 3Commerçant 2 - - - - 2Maçon - 2 - - - 2Douanier 1 - - - - 1Chauffeur 1 - - - - 162B- Critères d’inclusionOnt été retenus pour cette étude, les dossiers cliniquescomplets des patients reçus en urgence pour fracturesconcomitantes des segments diaphysaires brachial etantébrachial, du coude et/ou du poignet intéressant lemembre thoracique (MT) homolatéral.C- Patients et méthodesLa collecte des données sociodémographiques, anatomo-cliniqueset thérapeutiques, a été faite à partir desCharretier 1 - - - - 1Retraité 1 - - - - 1Sans emploi - - - 1 - 1Non précisée 5 - - 1 1 6Total 14 2 2 4 1 22AC : accident de circulation; AT : accident de travail; AD : accident domestique<strong>Le</strong>s femmes au foyer étaient les plus atteintes, suivies desélèves, des commerçants et des maçons (Tableau II). <strong>Le</strong>délai de prise en charge post-traumatique variait entre 6heures et 8 jours.
III. RéSULTATS<strong>Le</strong> recul moyen dans notre série était de 45,38 mois (extrêmes: 5 et 83 mois). <strong>Le</strong> séjour hospitalier moyen étaitde 13 jours (extrêmes : 1 et 90 jours).Un polytraumatisé avec une fracture de l’humérus et du radiushomolatéral est décédé en réanimation.A- Aspects anatomo-cliniques :<strong>Le</strong> membre thoracique droit était touché 14 fois (63,6%) etdans 13 cas (59,1%), il s’agissait du membre dominant ; lemembre thoracique gauche était atteint 8 fois (36,4%) etdans deux cas le membre dominant était concerné; dans7 cas l’atteinte du membre dominant n’était pas précisée.• <strong>Le</strong>s principales lésions répertoriées sont précisées surle tableau III.Sept fractures ouvertes étaient relevées chez cinq patients;elles siégeaient à la diaphyse humérale (1 cas),aux deux os de l’avant-bras (4 cas), à l’olécrâne (1 cas),à l’épiphyse distale du radius (1 cas) ; seize patientsprésentaient des fractures fermées. <strong>Le</strong>s fractures du segmentsbrachial sont répertoriées sur la figure 1.Fig. 1 : Distribution des fractures du segment brachial<strong>Le</strong>s fractures du segment antébrachial et du poignet sontreprésentées sur la figure 2.Fig. 2: Distribution des fractures du segment antébrachial• <strong>Le</strong>s lésions associées étaient constituées de quatre casde poly traumatismes, un cas de poly fracture, un casde fracture-décollement épiphysaire type II de Salteret Harris du fémur distal, un cas de fracturedu cadre obturateur (fracture du bassin), un cas defracture du condyle tibial médial et un cas de sectiondu tendon long extenseur du pouce.<strong>Le</strong>s complications immédiates étaient représentées par uncas d’ischémie du membre thoracique, sept fractures ouverteschez cinq patients dont une à l’humérus et aux deux<strong>Le</strong> «coude <strong>flottant</strong>» à l’hôpital Aristide <strong>Le</strong> Dantecos de l’avant-bras, trois aux deux os de l’avant-bras, uneà l’olécrâne, une à l’épiphyse distale du radius et une àla houppe du troisième doigt, trois cas d’atteintes du nerfradial dont une paralysie complète et deux conservant lasensibilité, un cas de luxation radio-humérale et radio-ulnaireproximale et un cas de luxation radio-carpienne.L’ischémie du membre thoracique concernait un patientde 44 ans (cas n° 9), référé d’un hôpital régional plus de12 heures après son traumatisme ; il présentait une fracturefermée diaphysaire bifocale déplacée de l’humérus et unefracture fermée déplacées de l’épiphyse distale du radiusavec abolition des pouls distaux et froideur des extrémités.B- Traitement :La prise en charge des 21 cas de coude <strong>flottant</strong> consistaiten un traitement chirurgical des fractures des deuxsegments du membre thoracique dans 18 cas (85,7%),un traitement mixte (chirurgical d’un segment et orthopédiquede l’autre segment homolatéral) dans deux cas(9,5%) et un traitement orthopédique dans un cas (4,8%).1. Méthodes thérapeutiques• Un parage-débridement était réalisé dans les 7 casde fractures ouvertes, suivi de la réduction et de lastabilisation par embrochage dans 6 cas et par fixateurexterne avec contention complémentaire par unMayo Clinic dans un cas.• <strong>Le</strong>s trois fractures du col chirurgical de l’humérusétaient traitées par embrochage «en palmier» à partirdu V deltoïdien dans deux cas et par contention avecun Mayo Clinic dans l’autre cas.• Parmi les 13 cas de fractures diaphysaires humérales,12 fractures étaient réduites et stabilisées parembrochage centromédullaire; la dernière fracturechez un poly traumatisé de 39 ans, était réduite etfixée par une ostéosynthèse stable par plaque.• Un autre polytraumatisé de 35 ans décédé en réanimation,n’avait pas bénéficié d’un traitement chirurgical(cas n° 3).• <strong>Le</strong> traitement des quatre cas de fractures de l’épiphysedistale et de la métaphyse distale de l’humérusétait variable :une ostéosynthèse par plaque vissée chantournéepour la fracture supra condylienne humérale chezle poly traumatisée de 42 ans (cas n° 16) ;une synthèse par embrochage en croix pour lafracture supra condylienne (FSC) humérale dugarçon de 10 ans (cas n° 12) ;une contention orthopédique par méthode deBlount pour la FSC humérale de la fille de 6ans (cas n° 18) ;une synthèse par embrochage pour stabiliser la fracturecomminutive du condyle huméral médial et del’épitrochlée chez la patiente de 49 ans (cas n° 11) ;et une contention orthopédique par plâtre brachio-antébrachio-palmaireen pronation pour lafracture peu déplacée de l’épicondyle médial dela fille de 10 ans (cas n° 15).63Tun Orthop 2010, Vol 3, N° 1
Tun Orthop 2010, Vol 3, N° 1Da S.C. et al.Tableau IV: Résultats des patients suivis selon la cotation globale (n = 18)Très bon Bon Moyen Mauvais Total (n° patients)Fracture du col huméral + Fracture de 2 ou 1 os de l’avant-bras - 1 2 - 3(n° 5, 7, 10)Fracture diaphysaire humérale + Fracture diaphysaire des 2 os de l’avant-bras 1 1 1 1 4(n° 1, 2, 8, 19)Fracture diaphysaire humérale + Fracture diaphysaire du radius ou de l’ulna - - 1 - 1(n° 17)Fracture diaphysaire humérale + Fracture de l’olécrâne - - 1 - 1(n° 20)Fracture diaphysaire humérale + Fracture de l’épiphyse distale du radius et de l’ulna - - 1 - 1(n° 22)Fracture diaphysaire humérale + Fracture de l’épiphyse distale du radius 1 1 - 1 3(n° 6, 13, 21)Fracture supracondylienne de l’humérus + Fracture du quart distal des 2 os de l’avant-bras - 1 1 - 2(n° 16, 18)Fracture supracondylienne de l’humérus + Fracture du condyle huméral médial + Fracture del’épiphyse distale du radius- 1 - - 1(n° 11)Fracture de l’épitrochlée + Fracture du col radial - 1 - - 1(n° 15)Fracture supracondylienne de l’humérus + Fracture décollement épiphyse distale du radius - 1 - 1(n° 12)Total 2 7 7 2 1866IV. DISCUSSIONL’association de fractures concomitances homolatéralesmétaphysaires ou diaphysaires humérales et des deux osde l’avant-bras avec ou sans lésion du coude, constitue lecoude <strong>flottant</strong> [3, 6-10].La rareté de cette combinaison fracturaire est rapportée parplusieurs auteurs [3, 4, 6-11]. Cette association lésionnellegrave, est souvent provoquée chez l’adulte par des traumatismesviolents lors d’accidents de la circulation à hautevélocité [9, 20] ; chez l’enfant les circonstances de survenuede ces lésions sont plutôt une chute d’une hauteur ourarement lors d’accidents ludiques [3, 7, 10]. Par contreYokoyama et al. [11], soulignent une certaine équitédans les circonstances de survenue de ces lésions.Dans notre série, les accidents de la circulation sont incriminésdans 14 cas (63,6%), impliquant souvent desvéhicules à quatre roues dans 8 cas (36,4%).• Aspects anatomo-cliniques :<strong>Le</strong>s principales lésions répertoriées dans le coude <strong>flottant</strong>sont variées selon qu’il s’agit d’enfants ou d’adultes.Chez l’enfant, il s’agit souvent de fractures fermées, voireouvertes supra condyliennes (FSC) humérales déplacées associéesaux fractures déplacées diaphysaires des deux os oud’un os de l’avant-bras (Galeazzi ou Monteggia) [6, 7,9, 10]. Par contre, les lésions du coude <strong>flottant</strong> des trois enfantsde notre série, sont toutes des fractures fermées.Chez l’adulte, les fractures ouvertes diaphysaires de l’humérusassociées aux fractures ouvertes des deux os del’avant-bras ou d’un os antébrachial, ou aux fractures ferméesou ouvertes des épiphyses proximale de l’ulna, distaledu radius ont été décrites par Gogoua et al. [4] etHarrison et al. [8]. Rogers et al. [3] distinguent deuxgroupes de lésions au coude <strong>flottant</strong> dont l’un sans lésionconcomitante du coude et l’autre avec lésion concomitantedu coude. Yokoyama et al. [11] notent des cas defractures ouvertes localisées à la fois sur l’humérus et surl’avant-bras, des cas de fractures ouvertes humérales etdes cas de fractures ouvertes de l’avant-bras.<strong>Le</strong>s lésions du coude <strong>flottant</strong> de notre série sont conformes àcelles de la littérature. A l’instar de Sarup et al. [12], nousavons relevé un cas de luxation postéro-latérale du coude associéeaux lésions du coude <strong>flottant</strong>. En outre, notre travail a révélétrois cas de fractures du col chirurgical de l’humérus (nonrapportées dans la littérature) associées aux fractures des deuxos de l’avant-bras ou de la diaphyse radiale ou de l’olécrâne.<strong>Le</strong> coude <strong>flottant</strong> s’intègre souvent dans le cadre d’un polytraumatismeassociant surtout des fractures ouvertes et deslésions vasculo-nerveuses dans la majorité des cas. En effetRogers et al. [3] précisent que plusieurs lésions des partiesmolles sont présentes dans toutes les fractures ouverteset dans la majorité des fractures fermées. Yokoyama etal. [11] rapportent des cas de lésions du plexus brachialet d’atteintes vasculaires. Dans la série de Ring et al. [9],les lésions associées concernent les nerfs interosseux antérieur,ulnaire et le nerf médian. Harrington et al.[7] rapportent des cas de lésions neurologiques avec ischémiedu membre. Sané et al. [5] rapportent trois casde coude <strong>flottant</strong> dont un cas associe une fracture ouvertecomplexe de la palette humérale et une fracture des deuxos de l’avant-bras. A l’instar des données de la littérature,nous avons répertorié quatre cas de poly traumatismes,un cas de polyfracture, 7 cas de fractures ouvertes, 3 casd’atteintes du nerf radial et un cas d’ischémie du membre; toutes ces lésions associées et/ou complications immédiates,sont survenues chez des patients adultes à l’exceptiond’un cas chez un adolescent de 17 ans.• Choix thérapeutiques :La prise en charge du coude <strong>flottant</strong> diffère selon qu’ils’agit d’enfants ou d’adultes.Si tous les auteurs s’accordent sur l’indication du traitementchirurgical de ces combinaisons fracturaires souventdéplacées, il persiste une certaine controverse quantaux modalités de stabilisation ainsi qu’au choix du segmentdu membre thoracique à réduire et à stabiliser enpremier.Chez l’adulte, des auteurs comme Rogers et al. [3], Yo-
koyama et al. [11] estiment que les fractures diaphysairesconcomitantes de l’humérus et de l’avant-bras sontune indication de la réduction et de la stabilisation interneà foyer ouvert ; en cas de fractures ouvertes, ils préfèrentla stabilisation première du foyer par fixateur externed’Hoffmann pour obtenir une bonne couverturede la plaie avant de réaliser une ostéosynthèse internesecondaire à foyer ouvert. En cas de fractures articulairesdu coude, ils choisissent la réduction à foyer ouvert pourrétablir l’anatomie de l’articulation du coude suivie d’uneostéosynthèse interne stable permettant une rééducationprécoce. Pour Harrison et al. [8], l’ostéosynthèsestable des fractures humérales et antébrachiales reste letraitement de choix du coude <strong>flottant</strong>. L’association d’unelésion nerveuse constitue un des facteurs prédictifs demauvais résultats chez ces patients. Chapuis [2] précisequ’en dehors des fractures désengrenées des deux os del’avant-bras, il faut toujours commencer par le traitementde la lésion humérale. Et en cas de fractures désengrenéesdes deux os de l’avant-bras, il est nécessaire de discuterl’ordre de priorité pour la réduction des foyers de fractureset le mode de stabilisation. Pour Bonnevialle[13], l’association fracturaire brachio-antébrachiale doitfaire l’objet d’une ostéosynthèse pluri focale. À l’huméruset aux deux os de l’avant-bras, la fixation par plaque estla plus utilisée. Pour cet auteur, il est préférable de commencerà stabiliser l’humérus par un enclouage ou unembrochage.Nous estimons qu’il faut commencer par réduire et fixerla lésion la plus instable et/ou comminutive qui risque decompromettre la fonction du membre thoracique avantde traiter la lésion du segment homolatéral.Chez l’enfant, les méthodes thérapeutiques du coude <strong>flottant</strong>soulèvent moins de controverse hormis la méthodeorthopédique d’immobilisation des Fractures supracondylienneshumérales selon la technique de Blount quiété pratiqué chez la fille de 6 ans et dans les six heurespost-traumatiques (cas n° 18).Par contre, Templeton et Graham [10] préconisenten priorité une réduction et une stabilisation des deuxfoyers de fractures par embrochage, pour une rapide rémissiondes douleurs et de l’œdème, ainsi que la priseen charge soigneuse des lésions vasculo-nerveuses. Ilsestiment que le traitement conservateur n’a pas de placedans le traitement du coude <strong>flottant</strong> car les fractures souventdéplacées, évoluent vers la déformation en cubitusvarus. Harrington et al. [8] conseillent la réductionet la stabilisation chirurgicale première de la fracture supracondyliennehumérale du fait du risque potentiel decomplications associées. Une fois la lésion du coudestabilisée, le traitement de la fracture de l’avant-bras estréalisé soit par une réduction à foyer fermée suivie d’unecontention plâtrée, soit par une réduction et stabilisationpar embrochage. Ring et al. [9] considèrent que la stabilisationpar embrochage de la fracture supracondyliennehumérale et de la fracture de l’avant-bras, procure unestabilité suffisante permettant une immobilisation dumembre thoracique par une attelle ou un plâtre brachioantébrachio-palmairebivalvé, réduisant ainsi le risque de<strong>Le</strong> «coude <strong>flottant</strong>» à l’hôpital Aristide <strong>Le</strong> Dantecsyndrome compartimental.Hormis le seul cas du traitement orthopédique appliquéà l’élève de 6 ans, notre attitude thérapeutique resteconforme à celle de la majorité des auteurs occidentaux[2, 7, 9, 10]. En effet dans notre série, 13 fractures (59,1%)de l’humérus et de l’avant-bras ont été réduites et stabiliséespar embrochage au niveau des segments huméral etantébrachial.• évolution-Pronostic :<strong>Le</strong>s délais de consolidation de 12 à 14 semaines chez nospatients adultes, sont comparables à ceux de Gogoua[4] avec une moyenne de quatre mois et de Harrison[8] avec 11,8 semaines en moyenne.Chez l’enfant, très peu d’études rapportent des cas denon consolidation de fractures du coude <strong>flottant</strong>. Ringet al. [9] précisent que le coude <strong>flottant</strong> survenant aprèsun traumatisme violent, associe plusieurs lésions telles lesfractures ouvertes, les complications vasculo-nerveusesavec un risque de déplacement secondaire et de pseudarthrose.Yokoyama et al. [11] soulignent que les lésions ducoude <strong>flottant</strong> sont pourvoyeuses de nombreuses complicationstelles l’infection, la pseudarthrose, surtout en casd’association de lésions du plexus brachial. Rogers etal. [3] notent 7 cas de pseudarthrose humérale et un casde pseudarthrose radiale. Nous avons observé 3 cas depseudarthrose dont une humérale et deux ulnaires avecune pseudarthrose septique de l’olécrâne.à l’instar des séries de Rogers [3] et de Daunois [6], avecrespectivement trois cas d’infection et un cas d’arthriteseptique du coude, nous avons relevé trois cas d’infectionpostopératoire, dont deux superficielles traitées par dessoins locaux et une antibiothérapie adaptée et un cas depseudarthrose septique. Par contre Harrington et al.[7] ne rapportent aucun cas d’infection dans leur série.Nous avons obtenu des résultats satisfaisants avec un tauxde 50%, inférieur à ceux de Daunois et al. [6] avec75% de très bons et bons résultats et de Harrington etal. [7] avec 83 % de bons et excellents résultats.L’amélioration de la réduction des fractures déplacées,une application stricte des techniques d’embrochage(point d’entrée dans le brochage centromédullaire),une réduction du délai de prise en charge de nos patients,pourront contribuer à améliorer nos résultats.La rééducation fonctionnelle reste primordiale après laprise en charge thérapeutique de cette combinaison lésionnelle; cette rééducation intéresse les articulationsde l’épaule et du coude, les articulations radio-ulnairesproximale et distale, l’articulation du poignet ainsi que laforce musculaire dans l’espoir de recouvrer un membrethoracique fonctionnel.V. CONCLUSION<strong>Le</strong> coude <strong>flottant</strong> reste une combinaison fracturaire quis’intègre souvent dans le cadre de polytraumatisme et defracture ouverte. <strong>Le</strong>s accidents de la circulation constituentles circonstances de survenue les plus fréquentes,impliquant souvent des véhicules à quatre roues et provo-67Tun Orthop 2010, Vol 3, N° 1
Tun Orthop 2010, Vol 3, N° 1Da S.C. et al.quant des traumatismes violents à haute vélocité. <strong>Le</strong> traitementchirurgical est la méthode thérapeutique de choixchez les patients adultes. Mais il persiste une controversequant au choix de la lésion à traiter en premier. Notreoption est de réduire et stabiliser la fracture la plus instableet/ou comminutive. Nos résultats restent inférieurs àceux d’autres auteurs. Ces résultats pourraient s’améliorerpar une pratique adéquate des techniques d’embrochagecentromédullaire et un suivi régulier des patients.VI. Références1) Oros W., Walch J.J. Floating Elbow. eMedicine Specialities (OrthopedicSurgery) 2008.2) Chapuis M. <strong>Le</strong> coude <strong>flottant</strong>. Cahiers d’enseignement de la SOFCOT2000; 72:154-6.3) Rogers J.F., Bennet J.B., Tullos H.S. Management of concomitant ipsilateralfractures of humerus and forearm. J Bone Joint Surg 1984; 66A:552-6.4) Gogoua R.D., Kouame K.M., Kone B., Fal A., Guedegbe F., AnoumouM., Kouame M., Traoré M., Varango G.G. Fractures étagées des membressupérieurs. Aspects épidémiologiques, thérapeutiques et évolutifs. MedAfrique Noire 2004; 5106:333-338.5) Sané A.D., Ndaw M., Diémé C., Coulibaly-Ndiaye N.F., Ndiaye A., SyM.H, Mbaye B, Seye S.I.L. <strong>Le</strong> coude de portière. À propos de neuf observations.Chir Main 2007; 26:226-31.6) Daunois O., Blamoutier A., Ducloyer P., Carlios H. Fracture supra-condyliennede l’humérus associée à une fracture homolatérale de l’avant-braschez l’enfant. Rev Chir Orthop 1992; 78:333-9.7) Harrington P., Sharif I., Fogarty E.E., Dowling F.E., Moore D.P. Managementof the floating elbow injury in children. Simultaneous ipsilateral fracturesof the elbow and forearm. Arch Orthop Trauma Surg 2000; 120:205-8.8) Harrison B.S., Mary Z., Andrew E.W. A review of outcomes in 18 patientswith floating elbow. J Orthop Trauma 2003; 17:563-70.9) Ring D., Waters P.M., Hotchtkiss R.N., Kasser J.R. Pediatric floating elbow.J Ped Orthop 2001; 21:456-9.10) Templeton P.A., Graham H.K. The “floating elbow” in children. Simultaneoussupracondylar fractures of the humerus and of the forearm in the sameupper limb. J Bone Joint Surg 1995; 77B:791-6.11) Yokoyama K., Itoman M., Kobayashi A., Shindo M., Futami T. Functionaloutcomes of “floating elbow” injuries in adult patients. J Orthop Trauma1998; 12: 284-90.12) Sarup S.M.S., Bryant P.A. Ipsilateral humerus shaft and Galeazzi fractureswith a posterolateral dislocation of the elbow: a variant of the “floatingdislocated elbow”. J Trauma 1997; 43:349-52.13) Bonnevialle P. Chirurgie de la diaphyse humérale : voies d’abord, techniquesopératoires. Encycl Méd Chir (Elsevier, Paris), Techniques chirurgicales– Orthopédie Traumatologie 44-300, 1998, 12 p.68