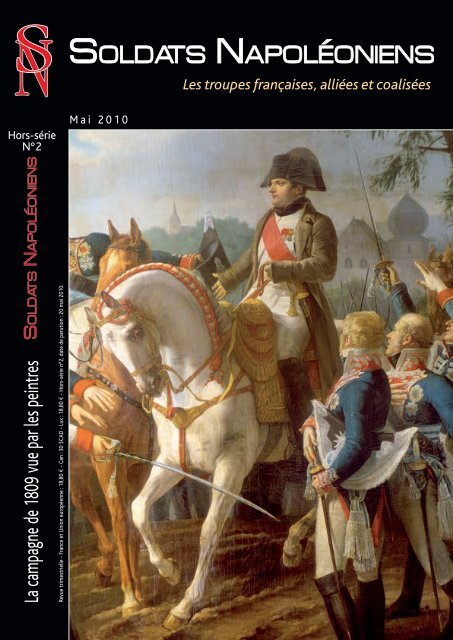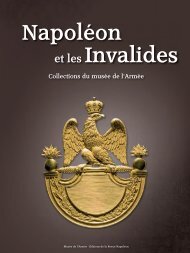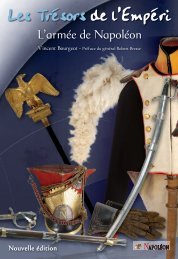SN-HS_WEB_FLO-LEG
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Les troupes françaises, alliées et coalisées<br />
Hors-série<br />
N°2<br />
Mai 2010<br />
La campagne de 1809 vue par les peintres<br />
Revue trimestrielle - France et Union européenne : 18,80 € - Can : 30 $CAD - Lux : 18,80 € - Hors-série n°2, date de parution : 20 mai 2010.
Hors-Série<br />
Les troupes françaises, alliées et coalisées<br />
HORS-SÉRIE N°2<br />
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :<br />
Pierre Burgaleta<br />
RÉDACTEUR EN CHEF :<br />
Yves Martin<br />
ABONNEMENTS FRANCE :<br />
Éditions de la Revue Napoléon<br />
BP 104 - 74941 Annecy-le-Vieux cedex<br />
Contact Rosa Garcia-Johnston.<br />
Tél. +33 (0)4 50 32 63 58<br />
SERVICE DES VENTES :<br />
Vive la presse<br />
Contact : Amandine Fest-Castello - +33 (0)9 61 47 78 48<br />
Numéro de téléphone réservé aux diffuseurs<br />
et aux dépositaires de presse.<br />
DISTRIBUTION FRANCE :<br />
M.L.P.<br />
DISTRIBUTION ÉTRANGER :<br />
Belgique :<br />
Tondeur Diffusion<br />
9, avenue Van Kalken - B 1070 - Bruxelles<br />
Tél. +/322/555 02 20 - Fax +/322/555 02 29<br />
■ Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 2<br />
Yves Martin<br />
■ Abensberg, le 20 avril 1809,<br />
par Jean-Baptiste Debret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 7<br />
Yves Martin<br />
■ La Prise de Landshut, le 21 avril 1809,<br />
par Louis Hersent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 25<br />
Yves Martin<br />
■ Ratisbonne, le 23 avril 1809,<br />
par Pierre Gautherot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 41<br />
Yves Martin<br />
■ Attaque et prise de Ratisbonne<br />
par le Maréchal Lannes, le 23 avril 1809<br />
par Charles Thévenin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 55<br />
Yves Martin<br />
■ La Prise d’Ebersberg, le 3 Mai 1809,<br />
par Nicolas Antoine Taunay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 69<br />
Yves Martin<br />
Italie :<br />
Tuttostoria,<br />
Via G.S. Sonnino, 34 - I 43100 Parma<br />
Tél : (39) 0521 292 733 - Fax : (39) 0521 290 387<br />
■ Le bivouac d’Ebersberg, le 4 mai 1809,<br />
par Antoine Pierre Mongin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 80<br />
Yves Martin<br />
DÉPÔT LÉGAL :<br />
Mai 2010<br />
COMMISSION PARITAIRE :<br />
0611 K85414<br />
I.S.S.N. : 1770-085 X<br />
IMPRESSION :<br />
Imprimerie de Champagne<br />
Rue de l’Étoile de Langres<br />
Z.I. Les Franchises - 52200 LANGRES<br />
DIRECTION :<br />
Pierre Burgaleta<br />
Remerciements<br />
Comme d’habitude ce travail, s’il n’est signé de ma seule main<br />
n’aurait pas pu voir le jour sans les apports lors de sa rédaction<br />
(et aussi tout au long de ces dernières années) de nombre d’amis,<br />
collectionneurs, amateurs. En ordre dispersé (et j’en oublie sans<br />
doute) : Vincent Bourgeot, Ronald Pawly, Paul Meganck, Alfred Umhey,<br />
Michel Hanotaux, Massimo Fiorentino, Natalia Griffon de Pleineville,<br />
Christophe Bourrachot et les « demi-soldes », Markus Gärtner, Markus Stein,<br />
Uwe Wild, Pierre Chauvin, Jean-Pascal Tranié, Charles-Henry Tranié,<br />
Patrice Courcelle, Frédéric Pouvesle, Riccardo Papi, et enfin tous les<br />
membres de l’ACFHCL, plus connue sous le nom de « Le Briquet », société<br />
d’amateurs orléanaise qui mérite vraiment le qualificatif de « savante ».<br />
Yves Martin<br />
SOLDATS NAPOLÉONIENS EST PUBLIÉ PAR :<br />
Éditions de la Revue Napoléon - 14, rue du Pré Paillard - B.P. 104 - 74941 Annecy-le-Vieux cedex - France<br />
Tél : (33) 04 50 32 63 58 - Fax : (33) 04 50 02 38 35 - Email : contact@editions-napoleon.com<br />
www.editions-napoleon.com<br />
Sommaire<br />
Illustration de couverture :<br />
Napoléon I er harangue les troupes bavaroises et wurtembergeoises à Abensberg, 20 avril 1809 par Jean-Baptiste Debret (1768-<br />
1848) - © RMN (Château de Versailles) / Daniel Arnaudet.
2<br />
La campagne de 1809<br />
vue par les peintres<br />
Yves Martin<br />
Alors que l’été 1809 tire à sa<br />
fin, l’Empire français ne peut<br />
réaliser qu’il est à son apogée<br />
et que vient de s’achever la dernière<br />
campagne victorieuse de l’Empereur<br />
et Roi.<br />
Celui-ci, tout comme ses compagnons<br />
et ses sujets aspire à la<br />
paix, et surtout à jouir d’une gloire<br />
bien méritée. Nouveau César, celui-ci<br />
va s’allier à la fille de son dernier<br />
ennemi et peut encore en cette heure<br />
croire en l’alliance et l’amitié russe.<br />
Il n’y a guère plus que l’Angleterre<br />
et la cruelle guerre d’Espagne pour<br />
troubler la quiétude tant espérée qui<br />
s’annonce.<br />
La guerre a été rude. Elle n’a<br />
épargné personne, et surtout pas<br />
l’entourage direct de l’Empereur.<br />
Lannes, Lasalle, Espagne sont morts<br />
pour ne citer que 3 officiers généraux<br />
parmi les plus célèbres, Daumesnil a<br />
laissé une jambe à Wagram et que<br />
dire des blessés ? Masséna, Oudinot,<br />
Bessières, Napoléon lui-même ont<br />
reçu à différents moments des<br />
blessures plus ou moins sérieuses.<br />
Certes, l’art de la guerre selon<br />
Napoléon suppose que les<br />
généraux ne restent pas en arrière<br />
et 1809 abonde en exemples<br />
héroïques donnés par les premiers<br />
d’entre eux : Mouton à Landshut,<br />
Lannes à Ratisbonne, Coehorn et<br />
Claparède à Ebersberg.<br />
Alors que les campagnes de 1805<br />
et 1806-1807 s’étaient essentiellement<br />
concentrées sur l’Allemagne, 1809 a<br />
vu le conflit se dérouler aussi sur des<br />
théâtres d’opérations où l’Empereur<br />
n’est pas présent : l’Italie où le Prince<br />
Eugène, beau-fils de Napoléon a su<br />
redresser une situation initialement<br />
compromise, la Pologne où la petite<br />
armée du Grand Duché de Varsovie<br />
sous le commandement du Prince<br />
Poniatowski a su au final s’imposer<br />
face aux Autrichiens, le Tyrol, où<br />
Bavarois et Français ont du affronter<br />
une insurrection « à l’espagnole »<br />
qui n’est pas non plus par son côté<br />
paysan et réactionnaire, sans rappeler<br />
les guerres de Vendée, et enfin,<br />
l’Allemagne du Nord où les bandes de<br />
Schill et celles du Duc de Brunswick<br />
ont mené la vie dure aux troupes<br />
françaises et à leurs alliés.<br />
Bref, les ressources militaires de<br />
l’Empire et de ses alliés ont été<br />
largement mises à contribution et<br />
1809, par la large participation des<br />
alliés, allemands en particulier est le<br />
prélude la Grande Armée des Nations<br />
qui traversera le Niémen en 1812.<br />
C’est en 1809 que se forgent les<br />
fraternités d’armes qui permettront<br />
à Napoléon d’appeler l’Europe aux<br />
armes lorsque le temps sera venu de<br />
dénoncer l’alliance russe qui n’est<br />
plus et tenter ce qui sera un défi<br />
impossible.<br />
Mais en cette fin d’été, c’est le<br />
Grand Empire victorieux et prospère,<br />
à peine naissant, qui occupe les<br />
esprits de l’Empereur et de son<br />
gouvernement. Il faut donner aux<br />
peuples un témoignage des épisodes<br />
glorieux qui viennent de se dérouler,<br />
particulièrement dans cette vallée du<br />
Danube qui a épongé tant de sang de<br />
braves.<br />
Le Comte Daru, intendant général<br />
de Sa Majesté l’Empereur et Roi<br />
soumet à son souverain le 18 août<br />
1809, le rapport suivant :<br />
« À sa Majesté l’Empereur et Roi,<br />
sur la demande d’un crédit de<br />
120 000 francs pour l’exécution de douze<br />
tableaux Représentant les principaux<br />
événements de la campagne d’Autriche<br />
en 1809, et des bustes en marbre des<br />
généraux morts pendant cette campagne.<br />
Sur ce crédit, 60 000 francs sont<br />
demandés pour cette année et seront<br />
destinés pour donner des acomptes aux<br />
artistes, et les autres 60 000 francs<br />
seront compris dans le projet de budget<br />
pour 1810.<br />
Sire,<br />
M. Denon, directeur du musée<br />
Napoléon, vient de m’annoncer qu’il<br />
avait eu l’honneur de présenter à votre<br />
majesté un projet de tableaux sur les<br />
principaux événements de la campagne<br />
d’Autriche en 1809 et pour les bustes<br />
en marbre des généraux morts pendant<br />
cette campagne, à exécuter pour le salon<br />
de 1810, et il m’a transmis en même<br />
temps l’état par aperçu de la dépense à<br />
faire pour l’exécution par des artistes que<br />
votre majesté a approuvés.<br />
J’ai l’honneur de transcrire ici la copie<br />
que M. Denon m’en a adressée et dont le<br />
montant s’élève à 120 000 francs.<br />
Grands tableaux<br />
1°) Sa Majesté l’empereur harangue<br />
les bavarois avant la bataille<br />
d’Abensberg.<br />
2°) Prise de Ratisbonne.<br />
3°) Vue de l’île Napoléon au moment où<br />
Sa Majesté y rentre après la bataille<br />
d’Essling.<br />
4°) Seconde vue de l’île Napoléon,<br />
l’empereur embrasse le maréchal<br />
Lannes blessé mortellement à la<br />
bataille d’Essling.<br />
5°) Bataille de Wagram.<br />
Ces cinq tableaux auront 15 pieds de<br />
longueur sur 10 de hauteur et coûteront<br />
chacun 12 000 francs ci... 60 000
5 - Attaq<br />
3<br />
4
6 - La campagne de 1809 vue par les peintres<br />
H<br />
À ces œuvres officielles et<br />
contemporaines, voire immédiates<br />
(d’ailleurs l’une d’entre elles<br />
« Napoléon harangue les troupes<br />
bavaroises et wurtembourgeoises à<br />
Abensberg » n’est pas terminée !), vont<br />
s’ajouter d’autres travaux tout aussi<br />
contemporains par Gros, Swebach,<br />
Venuti, Bacler d’Albe, Meynier etc.<br />
Puis, alors que l’Empire a disparu,<br />
des témoins de l’époque comme<br />
Vernet ou Adam (d’ailleurs 1809 est<br />
sa première campagne et il réalise<br />
à Vienne à l’époque des portraits<br />
sur commande) vont y trouver<br />
inspiration.<br />
Enfin, alors que 1814, puis 1815<br />
sont passés, l’Autriche revisite sa<br />
« défaite » de 1809 qui apparaît<br />
désormais comme un premier pas<br />
vers une revanche. Ainsi le coup<br />
d’arrêt d’Aspern-Essling inspire des<br />
peintres comme Krafft ou von Hess.<br />
On l’aura compris à la lecture de<br />
ces premières lignes, la matière est<br />
riche, très riche, voire trop riche !<br />
Cela fait déjà longtemps que nous<br />
envisagions d’analyser les peintures<br />
consacrées à 1809 : l’attaque du pont<br />
de Landshut, la prise de Ratisbonne,<br />
le bivouac d’Ebersberg nous ont<br />
toujours fasciné par la quantité de<br />
détails visibles, particulièrement sur le<br />
plan de l’uniformologie, mais lorsque<br />
nous avons commencé ce travail<br />
nous avons été surpris de découvrir<br />
à quel point d’autres œuvres moins<br />
connues révélaient aussi une foule<br />
d’informations et, surtout, se reliaient<br />
si bien à des témoignages d’époque.<br />
Il nous a donc fallu trancher alors<br />
que notre projet initial supposait<br />
de couvrir aussi le Tyrol, l’Italie, la<br />
Pologne, nous nous sommes limités<br />
à la vallée du Danube qui est à<br />
la fois la partie la plus connue de<br />
la campagne mais aussi celle qui<br />
a inspiré le plus grand nombre<br />
d’œuvres qui se trouvent être aussi<br />
être les plus facilement accessibles.<br />
L’autre décision a été de nous limiter<br />
autant que possible à des œuvres<br />
strictement contemporaines ou<br />
réalisées par des peintres qui avaient<br />
été contemporains de l’Empire. Enfin,<br />
il nous a fallu diviser le travail en<br />
deux temps. C’est cette première<br />
partie que vous avez en main<br />
aujourd’hui.<br />
La division s’est imposée naturellement<br />
selon la répartition habituelle<br />
de la chronologie de 1809. De<br />
l’ouverture de la campagne avec<br />
Abensberg le 20 avril 1809 à la prise<br />
de Vienne le 11 mai 1809. La seconde<br />
partie ira du lancer des ponts sur le<br />
Danube le 19 mai 1809 à Wagram le<br />
6 juillet 1809.<br />
Ce premier volet est déjà très<br />
riche, peut être le plus riche des<br />
deux : 7 peintures strictement<br />
contemporaines qui à part celle de<br />
Bacler d’Albe ont toutes figurées<br />
au Salon de 1810. Cette dernière<br />
peinture, moins évocatrice que<br />
les autres, ne figure pas au final<br />
dans la sélection qui vous est<br />
offerte dans ces pages, mais fera<br />
l’objet d’un article séparé dans un<br />
numéro de « Soldats Napoléoniens ».<br />
Réalisées immédiatement après la<br />
campagne, elles sont en quelque<br />
sorte les « actualités » de l’époque.<br />
Certains des officiers présents ont<br />
accepté de poser (on sait cela à<br />
propos des officiers bavarois pour<br />
Abensberg), des pièces d’uniformes<br />
et d’équipement ont été sans doute<br />
prêtées etc.<br />
Fidèle aux habitudes que nous<br />
avons développées dans des<br />
précédentes analyses de tableau,<br />
nous avons autant que possible<br />
rapproché ces œuvres de témoignages<br />
qui évoquent les mêmes épisodes.<br />
Comme toujours, ceux-ci varient<br />
en qualité, mais souvent les erreurs<br />
patentes que ceux-ci peuvent parfois<br />
transmettre ne sont que l’élaboration<br />
de la légende napoléonienne alors en<br />
marche.<br />
En plus des peintures que nous<br />
allons étudier, il nous a semblé<br />
utile de montrer aussi dans cette<br />
introduction certaines des très belles<br />
gravures publiées à l’époque par<br />
Rugendas et qui sont elles aussi de<br />
très beaux et très exacts témoignages<br />
d’époque. Ces gravures publiées en<br />
Allemagne font évidemment la part<br />
belle aux troupes alliées allemandes<br />
et sont en ce sens très intéressantes.
H<br />
7<br />
Abensberg le 20 avril 1809,<br />
par Jean-Baptiste Debret<br />
Yves Martin<br />
C’est l’Autriche qui prend<br />
l’initiative en envahissant<br />
la Bavière le 10 avril 1809.<br />
L’Empereur estimait, lui, que<br />
l’offensive autrichienne n’aurait pas<br />
lieu avant le 20. L’archiduc Charles<br />
l’a surpris et il frappe alors que la<br />
concentration française n’est pas<br />
encore achevée. Surtout, Napoléon<br />
n’est pas encore présent sur le théâtre<br />
d’opérations.<br />
C’est le Maréchal Berthier qui va<br />
assurer le commandement, plutôt<br />
mal que bien. Alors que l’Archiduc<br />
Jean refoule l’armée du Vice-Roi<br />
Eugène en Italie et que l’Archiduc<br />
Ferdinand pénètre dans le Grand-<br />
Duché de Varsovie, la situation n’est<br />
guère plus brillante en Bavière.<br />
L’incompréhension de Berthier face<br />
aux ordres de l’Empereur a pour<br />
conséquence l’isolement de Davout<br />
à qui il a ordonné de se concentrer<br />
sur Ratisbonne. Celui-ci y risque<br />
l’encerclement alors que les corps<br />
de l’archiduc Louis, de Kienmayer<br />
et de Hiller débouchent plus au sud<br />
en direction d’Abensberg. L’armée<br />
française et ses alliés sont séparés en<br />
deux masses, l’une avec Davout au<br />
Nord autour de Ratisbonne, le reste<br />
dispersé en direction d’Augsbourg.<br />
C’est le 17 avril que l’Empereur<br />
prend, enfin, le commandement<br />
de l’armée. Il va s’atteler de suite<br />
à redresser une situation bien<br />
compromise. Le plan de Napoléon<br />
est simple. Davout va fixer les corps<br />
autrichiens en face de lui (de fait<br />
l’archiduc Charles) pendant que<br />
Masséna et Oudinot débouchant<br />
au sud vont déborder l’aile gauche<br />
autrichienne.<br />
Dans ce schéma, la position centrale<br />
d’Abensberg prend toute son<br />
importance car il s’agit de fixer et<br />
de rejeter en direction de Vienne le<br />
corps de l’archiduc Louis qui est à la<br />
jonction entre la faible aile gauche<br />
autrichienne et le gros de cette armée<br />
concentrée autour de Davout. Ce<br />
dernier fait mouvement en direction<br />
d’Abensberg. Il bat les Autrichiens à<br />
Teugen le 19 avril.<br />
C’est le début de cette étonnante<br />
phase de cinq jours où l’Empereur va<br />
accumuler victoire sur victoire. Ces<br />
« cinq jours de gloire » constituent la<br />
toute première phase de la campagne<br />
de 1809 à laquelle est consacré<br />
ce premier volume d’analyse des<br />
peintures d’époque qui illustrent la<br />
campagne d’Autriche en 1809.<br />
Abensberg ouvre avec éclat cette<br />
chevauchée et offre de plus la<br />
particularité, tout comme Eckmühl<br />
peu après, d’avoir mis en avant,<br />
en toute première ligne, les alliés<br />
allemands de Napoléon.<br />
La cause profonde de la guerre,<br />
c’est l’influence hégémonique de<br />
la France sur les terres allemandes.<br />
L’Autriche n’a eut et n’aura de cesse<br />
tout au long de la guerre d’essayer<br />
de soulever « l’Allemagne » contre la<br />
France.<br />
Au premier rang de ces alliés<br />
allemands, il y a la Bavière. Cette<br />
alliance peut être surprenante, pour<br />
nous qui connaissons ce que vont<br />
être la guerre de 1870 et les conflits<br />
du 20 e siècle où l’ennemi sera le<br />
« Prussien », mais plus généralement<br />
« l’Allemand ». Mais en ce début du<br />
19 e siècle, les allemands de Rhénanie<br />
et du sud de l’Allemagne voient plus<br />
l’ennemi du côté de la Prusse ou de<br />
l’Autriche.<br />
Le Roi de Bavière, Maximilien-<br />
Joseph a été dans sa jeunesse,<br />
le colonel du régiment Royal<br />
Deux-Ponts. C’est un monarque<br />
francophone et francophile. Il doit<br />
à Napoléon son élévation du statut<br />
de simple électeur, à celui de Roi de<br />
Bavière. La victoire de 1805, puis les<br />
campagnes tout aussi victorieuses<br />
de 1806 et 1807 où il a fidèlement<br />
soutenu son allié français lui ont valu<br />
la reconnaissance de Napoléon.<br />
Il a réorganisé en profondeur<br />
son armée depuis 1800. L’époque<br />
des guerres révolutionnaires où le<br />
soldat bavarois faisait preuve de<br />
courage mais aussi de dénuement<br />
total est révolu. Le Roi a abandonné<br />
l’uniforme « à la Rumford »<br />
d’influence anglo-saxonne (le comte<br />
de Rumford, grand organisateur<br />
de l’armée bavaroise était en fait<br />
un émigré loyaliste américain) où<br />
y dominait la couleur blanche et<br />
lui a fait prendre une tenue dont<br />
l’influence va durer jusqu’à la guerre<br />
de 1870.<br />
Alors qu’il est évident que la guerre<br />
va éclater et que la Bavière sera<br />
en première ligne et probablement<br />
envahie, le Roi dispose d’environ<br />
40 000 hommes. Sa composition était<br />
la suivante :<br />
13 régiments d’infanterie de ligne<br />
(numéroté de 1 à 11, 13 et 14 – le<br />
12 e ayant été dissous pour mutinerie<br />
en 1806). Chaque régiment est<br />
composé de deux bataillons de cinq<br />
compagnies.<br />
7 bataillons d’infanterie légère ou<br />
chasseurs.<br />
Chaque bataillon représente environ<br />
700 à 800 hommes. Deux compagnies
8 - Les troupes Françaises de Ligne et étrangères dans l’expédition de Capri<br />
■ Napoléon I er harangue les troupes bavaroises et<br />
wurtembergeoises à Abensberg, 20 avril 1809 par<br />
Jean-Baptiste Debret (1768-1848) - © RMN (Château de<br />
Versailles) / Daniel Arnaudet.
9 - Les troupes Françaises de Ligne et étrangères dans l’expédition de Capri
14 - Abensberg - 20 avril 1809<br />
1<br />
2<br />
superbe et célèbre toile représentant<br />
la première distribution de croix de<br />
la légion d’honneur en l’église des<br />
Invalides (1812).<br />
Ce « Napoléon harangue les troupes<br />
bavaroises et wurtembourgeoises à<br />
Abensberg » figure au salon de 1810<br />
et était destiné à un achat pour le<br />
Prince Royal de Bavière. Comme nous<br />
l’avons vu, ce salon est réellement<br />
l’événement qui célèbre la toute<br />
récente campagne de 1809 et compte<br />
tenu des délais, les réalisations<br />
qui y figurent ont un caractère de<br />
témoignage quasi-immédiat.<br />
C’est une œuvre imposante par sa<br />
taille : 3,68 m x 4,94 m. Debret a<br />
probablement travaillé d’après des<br />
portraits ou rencontré certains des<br />
personnages représentés. Par ailleurs,<br />
le niveau de détail est tel qu’il est<br />
aussi quasiment certain qu’il a du<br />
disposer de tenues et effets. Certes,<br />
Martinet publiait déjà à l’époque<br />
des planches qui concernent l’armée<br />
bavaroise, mais la précision de la<br />
peinture est telle qu’on imagine mal<br />
comment l’artiste aurait pu faire<br />
autrement que d’avoir sous ses yeux<br />
des pièces authentiques. On sait<br />
que ceci était une pratique courante<br />
– ainsi le Baron gros avait reçu<br />
des armes et tenues ayant survécu<br />
à l’expédition d’Egypte pour son<br />
tableau sur le Combat de Nazareth.<br />
Il s’agit d’une de ces scènes où<br />
l’Empereur est magnifié au travers<br />
d’une de ces anecdotes qui créent<br />
d’ores et déjà la légende.<br />
Commençons d’abord par le<br />
terrain et sa représentation. Il est<br />
probablement difficile de retrouver<br />
le lieu exact où cela s’est passé en<br />
ce matin du 20 avril... mais si nous<br />
nous basons sur la description assez<br />
précise d’Albrecht Adam, on peut<br />
estimer que Debret a essayé d’être<br />
fidèle.<br />
La scène est en effet en haut d’une<br />
colline, à la lisière d’une forêt :<br />
Napoléon et les officiers sont à son<br />
sommet. La présence d’un Chevauléger<br />
bavarois à l’arrière-plan à<br />
gauche permet de suite de ce rendre<br />
compte de la dénivellation avec au<br />
loin la plaine où se trouve une armée<br />
disposée en bataille. [1]<br />
Par contre, le temps quoique<br />
nuageux est évidemment plus beau<br />
qu’il ne le fut ce jour-là si on se fie<br />
à Albrecht Adam. Les lourds nuages<br />
gris, la brume qui recouvre le sol...<br />
tout cela a disparu pour laisser place<br />
à une vive luminosité qui est attisée<br />
par le cheval blanc de l’Empereur et<br />
son pendant chromatique, le colonel<br />
de Dragons bavarois, avec son<br />
uniforme blanc. [2]<br />
Passons-donc à l’Empereur. C’est<br />
un portrait sans surprise, fidèle à la<br />
légende et à l’iconographie officielle.<br />
Il est sur un cheval blanc – grâce à<br />
Albrecht Adam nous savons qu’il<br />
montait ce jour là l’Aly (Adam<br />
mentionne cela plus loin dans sa<br />
narration).<br />
Le cheval est richement harnaché,<br />
l’empereur possédait un « parc »<br />
de 108 selles (vers 1804) ; les selles<br />
classiques « à la française », coûtaient<br />
820 francs et les modèles richement<br />
brodés (il y en avait 3) coûtaient<br />
4 400, 8 500 et jusqu’à 16 400 francs<br />
pour la plus chère, on peut penser<br />
que c’est ce modèle qui est représenté<br />
sur le tableau. [3]<br />
Ce qui contraste avec la mise assez<br />
simple de l’Empereur, conforme au<br />
texte d’Adam. Pour autant, la pose<br />
« en Majesté » de l’Empereur ne<br />
correspond guère à la mise plutôt<br />
relâchée mentionnée par le tout<br />
jeune peintre. Napoléon vient de finir<br />
son discours, le Prince Royal termine<br />
à son tour de traduire les paroles<br />
de l’Empereur et les officiers alliés<br />
l’acclament. Le large geste du bras<br />
droit avec la main ouverte est signe<br />
à la fois de la fin de son discours<br />
mais aussi de ses intentions amicales<br />
envers ses alliés. La redingote qu’il<br />
porte est d’un gris tirant sur le brun<br />
– cette « couleur de poussière » dont<br />
parle Adam.<br />
Il arbore et la légion d’honneur<br />
et l’ordre de la couronne de fer.<br />
On peut aussi remarquer le léger<br />
liseré écarlate qui apparaît et qui<br />
correspond à la continuité du grand<br />
cordon. [4]
15 - Abensberg - 20 avril 1809<br />
3
16 - Abensberg - 20 avril 1809<br />
4 6<br />
Derrière l’Empereur, à cheval, un<br />
maréchal qui par son faciès semble<br />
être Berthier, ombre fidèle de son<br />
maître. [7]<br />
Il porte ici l’habit de grand<br />
uniforme à cheval, mais ses parements<br />
de manche, ne correspondent pas<br />
au règlement, ils sont ici ouverts sur<br />
l’extérieur de la manche. L’habit<br />
ferme grâce à seulement deux<br />
boutons, il devrait en avoir 3 disposés<br />
en travers sur la partie haute du<br />
parement. Là aussi la tenue du<br />
Prince de Neuchâtel n’appelle guère<br />
de commentaires. Il est probable<br />
que ce jour-là il n’avait peut-être<br />
pas une tenue aussi brillante, mais<br />
comme Adam indique bien que la<br />
tenue de Napoléon contraste par sa<br />
simplicité avec celle de sa suite, c’est<br />
tout à fait possible. Berthier a lui<br />
aussi et la légion d’honneur et l’ordre<br />
de la couronne de fer, ainsi que la<br />
plaque de grand croix de la légion<br />
d’honneur.<br />
5<br />
On aperçoit sous la redingote et<br />
sous un des revers, la Grand croix<br />
de la légion d’honneur. Le ceinturon<br />
est inhabituel, il a l’air coloré<br />
(légèrement bleuté) et de plus brodé,<br />
nous savons qu’habituellement<br />
il était en simple buffle blanc,<br />
alors qu’il semble là peut-être en<br />
velours. [4]<br />
La dragonne de l’épée est aussi<br />
peu commune, modèle plat à gros<br />
bouillons, modèle des officiers<br />
supérieurs. [4]<br />
L’Empereur porte son habit d’officier<br />
de grenadier, curieusement apparaît<br />
une doublure ou un passepoil écarlate<br />
au col de l’habit. [4]<br />
Détail relativement unique, la<br />
ganse du chapeau est fixée par<br />
l’intermédiaire d’un bouton plat<br />
d’uniforme. Habituellement il est<br />
recouvert de soie noire. [5]<br />
On aperçoit au sommet de la botte<br />
une espèce de bordure ou de renfort ?<br />
Qui apparaît d’une nuance différente<br />
de la couleur de fond. [6]<br />
Enfin, à peine visible, on devine<br />
la tête de Roustan, Mameluck de<br />
l’Empereur et aussi le harnachement<br />
à l’orientale de son cheval blanc. On<br />
devine à peine sa tenue qui semble<br />
être un fermelet vert et or sur un<br />
yaleck pourpre galonné d’or. [8]<br />
Derrière on entrevoit le reste de<br />
la suite impériale : des cavaliers,<br />
peut-être coiffés de bonnets à poil<br />
avec plumets rouges et cordons et<br />
raquettes écarlate pendant sur la<br />
gauche : il s’agit des carabiniers qui<br />
effectuaient alors le service auprès de<br />
l’Empereur en l’absence de la Garde.<br />
On entrevoit enfin quelques plumets<br />
verts… [9]<br />
Voilà pour les Français figurant<br />
sur cette œuvre – tous les autres<br />
personnages, les plus visibles sont<br />
tous des alliés allemands. Si le titre<br />
est « Napoléon harangue les troupes<br />
bavaroises et wurtembergeoises… », la<br />
mention des wurtembergeois n’est là<br />
que pour rappeler leur participation<br />
effective et efficace au combat<br />
d’Abensberg, pas leur présence dans<br />
le tableau !<br />
Il n’y a là, conformément à ce qui<br />
se passa ce matin là que des officiers<br />
bavarois... et pour être même plus
17 - Abensberg - 20 avril 1809<br />
7 8<br />
9<br />
précis pratiquement uniquement des<br />
officiers supérieurs avec comme seule<br />
exception visible le chevau-léger<br />
figurant à l’arrière plan en bas à<br />
gauche.<br />
Commençons par le plus important<br />
de tous : le Prince hériter, ou Prince<br />
Royal Louis (Kronprinz Ludwig),<br />
le seul à être à cheval à droite de<br />
l’Empereur et en train de terminer de<br />
traduire les paroles de Napoléon. [10]<br />
Le Prince Louis porte l’uniforme de<br />
Lieutenant-général (équivalent du<br />
général de division).<br />
Depuis le 24 avril 1800, l’armée<br />
bavaroise a repris comme couleur<br />
de fond d’habit pour l’infanterie<br />
et les officiers supérieurs le bleu<br />
barbeau – c’est-à-dire un bleu clair<br />
assez vif, avec une pointe de vert.<br />
Ce bleu peut cependant varier en<br />
nuance. Ainsi l’habit du Prince Louis<br />
semble légèrement plus sombre que<br />
celui des deux autres Lieutenant-<br />
Généraux présents. Est-ce un effet<br />
de peinture ou une réelle nuance,<br />
difficile de conclure. Les revers,<br />
collets, parements et retroussis sont<br />
eux en drap de nuance rouge décrite<br />
comme étant « ponceau » c’est à<br />
dire un rouge soutenu, tirant très<br />
légèrement vers le lie de vin et moins<br />
vif que l’écarlate qui est le rouge<br />
habituel utilisé dans les uniformes<br />
français. Des riches broderies argent<br />
« en palmes » ornent collet, revers<br />
et parements. Les boutons sont aussi<br />
argent. Le prince porte l’écharpe de<br />
commandement des officiers qui est<br />
argent et bleu ciel rappelant le blanc
20 - Abensberg - 20 avril 1809<br />
La deuxième plaque portée est<br />
celle de grand-croix de l’ordre de<br />
Saint-Michel. Ordre dont le Roi est<br />
chef et dont le but est de secourir les<br />
militaires pauvres et dans le besoin.<br />
17<br />
À Gauche de l’Empereur, l’un<br />
à côté de l’autre, les deux autres<br />
divisionnaires du 7 e corps. On<br />
peut aisément supposer vu la<br />
différence d’âge que le premier à<br />
gauche est von Wrede et à sa droite,<br />
von Deroy. [13]<br />
Il n’est d’ailleurs pas évident,<br />
comme nous l’avons vu selon les<br />
témoignages que von Deroy ait<br />
été présent. Mais, allié fidèle de la<br />
France, celui-ci doit être représenté<br />
sur cette peinture. Tous deux portent<br />
le même uniforme que le prince<br />
Louis.<br />
On remarquera donc la nuance<br />
légèrement plus claire. Nous pouvons<br />
par ailleurs admirer les détails des<br />
deux imposants chapeaux d’officier<br />
général avec la cocarde bleue et<br />
blanche de Bavière. Von Wrede est<br />
chaussé de bottes demi-fortes, alors<br />
que von Deroy porte des bottes à tige<br />
simple. On remarquera aussi les très<br />
belles épées portées, en particulier<br />
celle de von Deroy dont la poignée<br />
est de nacre et d’or. [14]<br />
Tous deux sont décorés de la<br />
légion d’honneur et ont la plaque<br />
de grand croix de l’ordre militaire de<br />
Maximilien-Joseph (à centre bleu).<br />
Von Deroy a de plus l’écharpe de<br />
grand-croix du même ordre et ce<br />
qui semble être la plaque de l’ordre<br />
prussien de l’aigle rouge. [15] [16]<br />
À leur droite se tiennent deux<br />
officiers d’état-major. [17]<br />
Tout d’abord : un colonel officier<br />
d’ordonnance (flügel-adjudant) de<br />
Sa Majesté le Roi issu de l’infanterie.<br />
Il est reconnaissable à son habit<br />
bleu-barbeau avec collet, revers,<br />
parements et retroussis ponceau.<br />
Son grade de colonel est identifiable<br />
par les trois galons horizontaux au<br />
collet plus le large galon en pourtour<br />
du collet. La couleur jaune des<br />
galons et boutons signifie qu’il vient<br />
de l’infanterie (argent sinon pour<br />
la cavalerie). Il porte par ailleurs<br />
l’aiguillette et il a l’écharpe de<br />
grand-croix de l’ordre de Maximilien-<br />
Joseph. On peut d’ailleurs remarquer<br />
la croix suspendue en bas de<br />
l’écharpe. [17]<br />
À sa droite, un colonel officier<br />
d’état-major. Il porte une tenue<br />
identique à celle de son voisin de<br />
gauche sauf que le « simple » officier<br />
d’état-major se distingue par un<br />
collet, revers, parements, retroussis<br />
de drap violet passepoilé de ponceau.
23 - Abensberg - 20 avril 1809<br />
22
24 - Abensberg - 20 avril 1809<br />
23<br />
24<br />
nous permet d’admirer cependant le<br />
très distinctif uniforme des dragons<br />
bavarois, entièrement blanc distingué<br />
de ponceau ! Les formes imposantes<br />
de cet officier tranchent avec<br />
l’aspect habituellement athlétique<br />
des jeunes hommes de l’époque<br />
(cet officier n’a guère plus d’une<br />
trentaine d’années). Cela correspond<br />
cependant aux autres images que<br />
nous connaissons des dragons<br />
bavarois tels que représentés par<br />
Martinet ou la série contemporaine<br />
publiée à Augsbourg. Les dragons<br />
étaient véritablement la cavalerie<br />
« lourde » de la Bavière ! On notera<br />
enfin son très beau sabre à lame<br />
bleuie qui est représenté avec finesse<br />
et détail. [23]<br />
H<br />
Enfin, et ce sera notre dernier<br />
personnage un lieutenant d’artillerie.<br />
[24]<br />
Son grade est à peine visible<br />
car on distingue vaguement deux<br />
galons au collet rouge. L’habit<br />
de l’artillerie est bleu avec collet,<br />
retroussis, doublure et parements<br />
rouge, revers noirs passepoilés de<br />
rouge, culotte de drap bleue. Il porte<br />
lui aussi un très beau sabre à lame<br />
bleuie. Ce lieutenant est décoré à<br />
la fois de la légion d’honneur et de<br />
l’ordre de Maximilien-Joseph mais<br />
il est aussi... chevalier de Malte.<br />
Il porte en effet au col une croix<br />
de Malte en émail probablement<br />
ornée entre ses branches de lions<br />
bavarois. Perrot dans son ouvrage<br />
sur les ordres de chevalerie daté<br />
de 1820 signale en effet que « par<br />
abus » les chevaliers de Malte ont<br />
pris l’habitude de remplacer le port<br />
de la grande croix blanche de Malte<br />
sur leur manteau par une croix en<br />
émail qui se porte donc, souvent au<br />
cou.<br />
Les Bavarois vont donc, avec<br />
les Français s’élancer à l’attaque<br />
des Autrichiens, et si l’on en<br />
croit Chlapowski, sans grand<br />
enthousiasme. Les différents combats<br />
qui vont se dérouler en ce 20 avril<br />
vont prendre le nom de « bataille<br />
(ou combat) d’Abensberg » et se<br />
traduire par la quasi destruction<br />
comme nous l’avons vu des troupes<br />
de Thierry.
H<br />
La Prise de Landshut<br />
le 21 avril 1809, par Louis Hersent<br />
Yves Martin<br />
25<br />
L’ensemble des combats du<br />
20 avril, rassemblés sous le<br />
nom de « bataille d’Abensberg »<br />
ont eu pour effet de couper l’aile<br />
gauche autrichienne du gros des<br />
forces de l’Archiduc Charles. Les<br />
troupes de Hiller refluent en désordre<br />
vers Landshut.<br />
Pour Napoléon, il importe de les<br />
poursuivre, car il est, à ce moment<br />
persuadé que l’armée autrichienne,<br />
sous la conduite de l’Archiduc<br />
Charles va se porter au secours de<br />
Hiller et il compte donc le forcer à la<br />
bataille sur les rives de l’Isar.<br />
Davout, de plus en plus isolé au<br />
nord, sent au contraire qu’il fait<br />
face au gros de l’armée ennemie<br />
et, en effet, les autrichiens se sont<br />
portés en masse vers Eckhmühl<br />
et Ratisbonne. Ce sont autour des<br />
ces deux villes qu’auront lieu les<br />
combats des 22 et 23 avril. Pour<br />
l’heure, le gros des forces françaises<br />
se rue à la poursuite de Hiller. Le<br />
4 e corps de Masséna poursuit au<br />
sud-ouest de Landshut les autrichiens<br />
de Nordmann. Son avant-garde<br />
composée de la cavalerie de Marulaz<br />
et des fantassins de Claparède arrive<br />
en vue de Landshut. Claparède<br />
va malheureusement temporiser,<br />
attendant l’arrivée du gros des forces<br />
de Masséna. L’occasion est ratée, car<br />
les 5 e et 6 e corps autrichiens vont<br />
s’engager dans Landshut et continuer<br />
leur route vers Vienne, se repliant en<br />
désordre.<br />
L’Empereur va arriver à la<br />
mi-journée en vue de Landshut et<br />
juge de suite l’urgence de la situation<br />
s’il veut anéantir Hiller. Il ordonne<br />
à Bessières avec la cavalerie de<br />
Nansouty et de Jacquinot de culbuter<br />
l’ennemi et à Morand du corps<br />
provisoire de Lannes d’enlever la ville<br />
avec ce qu’il a à sa disposition.<br />
Morand a, en pointe le 17 e de ligne<br />
et le 13 e d’infanterie légère. La ville<br />
de Landshut est en partie construite<br />
sur l’Isar. Deux ponts conduisent<br />
d’une rive à l’autre, passant par<br />
une île sur laquelle est construite,<br />
en fait, l’entrée de la ville. Ces ponts<br />
et ces constructions, constituent<br />
d’excellentes positions pour les<br />
autrichiens qui les ont adroitement<br />
mises en défense. La fusillade est<br />
rude dès l’abord du premier pont<br />
et les hommes du 17 e de ligne<br />
hésitent à le franchir Impatient,<br />
Napoléon a sous sa main, l’homme<br />
qu’il faut. Le général Mouton,<br />
aide-de-camp de l’Empereur vient<br />
de revenir d’une reconnaissance.<br />
Les généraux aide-de-camp de<br />
l’Empereur, tout comme les officiers<br />
d’ordonnance sont aussi là pour<br />
cela : se substituer au souverain et<br />
mener, au premier rang de la troupe,<br />
une attaque. Napoléon envoie<br />
Mouton avec l’ordre de prendre les<br />
ponts et enlever Landshut. Celui-ci<br />
s’empare du premier pont, puis de<br />
l’île et enfin, malgré le feu mis par<br />
les autrichiens au second pont, il<br />
pénètre dans Landshut et capture la<br />
ville. Cet acte de bravoure marque<br />
les témoins présents sur la scène et<br />
aussi les contemporains. Nombreux<br />
sont les mémoires qui évoquent ce<br />
fait d’armes avec plus ou moins<br />
de précisions, et, probablement<br />
d’exactitude.<br />
Selon Marbot, l’Empereur n’aurait<br />
alors même pas relevé l’action de<br />
son aide-de-camp (ce n’est qu’après<br />
Essling qu’il aurait déclaré « Mon<br />
Mouton est un lion ! » et décerné le<br />
titre de Comte de Lobau). En tous les<br />
cas, Mouton fait partie des officiers<br />
qui vont se distinguer à de multiples<br />
reprises lors de cette campagne.<br />
Les premiers témoignages officiels<br />
de cette action sont au nombre de<br />
trois :<br />
Tout d’abord le rapport du Général<br />
Morand à Davout rédigé le jour<br />
même. Celui-ci insiste sur le rôle du<br />
3 e bataillon du 17 e de ligne et de<br />
deux bataillons du 13 e d’infanterie<br />
légère et ne mentionne pas le rôle<br />
joué par Mouton.<br />
« Le Général Morand au Duc<br />
d’Auerstaedt<br />
Au bivouac près de Landshut, le<br />
21 avril 1809 à minuit.<br />
Aujourd’hui, 21 avril, à la pointe du<br />
jour, j’ai reçu l’ordre de M. Le Maréchal<br />
duc de Montebello de continuer ma<br />
marche par Rottenburg sur la route de<br />
Landshut.<br />
En débouchant dans la plaine, à une<br />
lieue de cette ville, on aperçut sur les<br />
routes qui y aboutissent d’immenses<br />
convois de bagages et d’artillerie.<br />
SM L’Empereur et Roi les fit attaquer par<br />
sa cavalerie que deux bataillons du 13 e<br />
eurent ordre de suivre et de soutenir ;<br />
le reste de la division secondait ce<br />
mouvement.<br />
Les convois, le faubourg et les deux<br />
premiers ponts, qui sont établis sur des<br />
canaux de l’Isar, furent enlevés par la<br />
cavalerie et les deux bataillons du 13 e<br />
dont l’un était conduit par le Duc de<br />
Rovigo, et l’autre par le général Lacour.<br />
L’ennemi sorti en foule de la ville pour<br />
couvrir le grand pont de l’Isar arrêta<br />
ce mouvement. La division arrivait à<br />
la tête du faubourg. L’Empereur me<br />
donna l’ordre d’enlever la ville ; le<br />
3 e bataillon du 17 e se précipita sur le<br />
pont en flammes, il fut suivi du reste
Présentation - XXXX<br />
■ Prise d’assaut du pont et de la ville<br />
de Landshut par les grenadiers du<br />
17 e régiment de ligne, commandés par<br />
le général Mouton, le 21 avril 1809 par<br />
Louis Hersent (1777-1860) - © RMN (Château<br />
de Versailles) / Gérard Blot.
XXX - Présentation
36 - La Prise de Landshut - 21 avril 1809<br />
11<br />
position et le fait que la giberne<br />
soit rejetée sur la gauche dégage<br />
le côté droit des retroussis de<br />
droite et nous permet de distinguer<br />
l’ornement de retroussis : un cor de<br />
chasse rouge.<br />
qui reste encore en dotation compte<br />
tenu des stock existants. À gauche<br />
de ce groupe, un soldat portant une<br />
imposante capote grise s’effondre et<br />
devant lui un chasseur avec shako à<br />
cordon et raquette portant sa culotte<br />
par dessus ses guêtres.<br />
Voici maintenant le groupe le plus<br />
important [14] :<br />
6 hommes tiraillent par devant par<br />
dessus un mur. Ils sont supportés par<br />
un deuxième rang de quatre hommes<br />
à qui ils passent leurs armes pour<br />
être rechargées. Commençons par ce<br />
deuxième rang.<br />
Un chasseur en capote tout d’abord<br />
La capote est droite, ample et longue.<br />
Il porte ses épaulettes par dessus<br />
celle-ci (contrairement au précédent<br />
soldat en capote qui tombait<br />
blessé). Il a aussi son havresac. Il<br />
mord dans la cartouche afin de la<br />
déchirer – dernier détail, il porte sa<br />
culotte bleue par dessus ses guêtres.<br />
À sa droite un sergent (galon argent<br />
visible sur sa manche droite), avec<br />
un chevron de vétérance de 10 ans<br />
sur le bras gauche a lui sa capote<br />
grise roulée rapidement et fixée à son<br />
havresac. Il est en train de recharger<br />
une arme et on distingue à peine la<br />
baguette du fusil entre les doigts de<br />
sa main droite. Son shako a cordon et<br />
raquette.<br />
Juste à sa droite et légèrement<br />
devant, un chasseur tend son bras<br />
gauche pour récupérer l’arme d’un<br />
de ses camarades du premier rang. Il<br />
a dans sa main droite le fusil chargé<br />
qu’il va lui passer. À sa droite un<br />
chasseur cherche une cartouche dans<br />
sa giberne pour recharger soit l’arme<br />
qu’il tient avec sa main gauche<br />
soit celle qu’on est en train de lui<br />
passer. On note, au passage que cette<br />
homme a visiblement une couverture<br />
imperméable noire sur son shako.<br />
Passons au premier rang, de<br />
gauche à droite :<br />
- Un chasseur tire (on voit nettement<br />
l’explosion de l’amorce de la<br />
batterie du fusil). Il est en habit<br />
bleu et pantalon blanc. Cette vue<br />
de côté nous permet de bien voir le<br />
passepoil le long du retroussis. Il a<br />
sa capote grise roulée au dessus de<br />
son havresac.<br />
- À sa droite un carabinier.<br />
Son shako a une couverture<br />
imperméabilisée noire et un<br />
pompon rouge. Il a des épaulettes<br />
intégralement écarlates.<br />
- Puis un chasseur qui tend son arme<br />
à recharger. Sa capote ou une toile<br />
de tente est portée en travers de sa<br />
poitrine. Il a un pantalon blanc.<br />
- Un autre chasseur tire. Il semble ne<br />
pas avoir d’havresac<br />
- Le cinquième soldat, un chasseur<br />
offre d’intéressantes variantes :<br />
shako recouvert de sa couverture<br />
imperméable noire, mais surtout<br />
ce qui semble être une culotte<br />
moulante de couleur ocre. Il ne<br />
porte par ailleurs pas de gilet.<br />
- Le dernier tireur semble être<br />
plus conforme au « règlement »<br />
intégralement en bleu, culotte<br />
portée par dessus les guêtres. Sa<br />
Un groupe de quatre tireurs se<br />
trouve à l’extrême droite du tableau :<br />
3 chasseurs et un carabinier (en<br />
pantalon blanc). Le soldat le plus à<br />
droite est de nouveau avec un shako<br />
à couverture imperméabilisée. On voit<br />
aussi de nouveau les ornements de<br />
retroussis : cor de chasse écarlate [15].<br />
Au premier plan et dans une<br />
semi-pénombre, les blessés sont<br />
apportés vers un poste de secours<br />
« improvisé » [16]. Un sergent de<br />
chasseurs qui marche en s’aidant de<br />
son sabre briquet est soutenu par un<br />
de ses camarades.<br />
Au premier plan à droite, un jeune<br />
officier est soutenu par un chasseur<br />
et un voltigeur [17]. Son habit a<br />
été dégrafé et sa chemise ouverte.<br />
On voit nettement l’épaulette et la<br />
contre épaulette argent. Il porte une<br />
culotte de couleur ocre et des bottes à<br />
la hongroise. Au sol à sa droite, son<br />
sabre courbe à poignée argent. Qui<br />
est-il ? Selon Martinien deux officiers<br />
du 13 e d’infanterie légère sont touchés<br />
lors du combat de Landshut. L’un est<br />
tué : le sous-lieutenant Belard qui<br />
selon les mémoires de Béniton tombe<br />
à la sortie de Landshut et donc pas<br />
au niveau des ponts. Il ne peut donc<br />
s’agir ici que du lieutenant Bonneval.<br />
Derrière lui, un carabinier et un<br />
chasseur transportent un chasseur en<br />
capote blessé [18]. Celui-ci porte des<br />
guêtres hautes blanches inhabituelles<br />
pour l’infanterie légère.<br />
Derrière eux, un chirurgien en<br />
bicorne reconnaissable à son collet<br />
cramoisi s’affaire auprès des blessés.<br />
Dernier personnage à étudier, le<br />
chirurgien qui vole au secours du<br />
sous-lieutenant Bonneval. Celui-ci est<br />
en bicorne probablement recouvert<br />
d’un étui imperméabilisé noir dont<br />
on distingue à peine des attaches. Il<br />
porte ce qui semble être un habit-frac<br />
à collet et parements cramoisis,
37 - La Prise de Landshut - 21 avril 1809<br />
12<br />
13
40 - La Prise de Landshut - 21 avril 1809<br />
18<br />
lorsqu’elles ne sont pas revêtues sont<br />
portées soit roulées plus ou moins<br />
bien sur le havresac, soit en travers<br />
de la poitrine.<br />
broderies d’or au collet. Il a une cape<br />
portée en rotonde et un pantalon<br />
de cheval à boutonnage latéral qui<br />
semble de couleur bleue foncé. Il<br />
tient dans son bras droit une sacoche<br />
marron contenant ses instruments<br />
avec peut être des attaches de tissu<br />
blanc.<br />
Au final cette remarquable peinture<br />
nous permet de donner en résumé<br />
l’habillement du 13 e régiment<br />
d’infanterie légère au cours de la<br />
campagne de 1809 :<br />
Shako du type 1806 ou légèrement<br />
plus grand à plaque en losange<br />
de métal blanc avec pompons de<br />
forme sphérique : jaune chamois<br />
pour les voltigeurs, écarlate pour les<br />
carabiniers, vert pour les chasseurs.<br />
Port éventuel d’un cordon blanc sur<br />
le devant du shako avec à gauche<br />
un petit gland blanc et parfois à<br />
droite une seule raquette et gland<br />
blanc. Port éventuel de couverture<br />
imperméabilisée noire très serrée<br />
contre le shako laissant apparaître la<br />
visière et le pompon.<br />
Habit du modèle de l’infanterie<br />
légère, bleu foncé à revers en pointe<br />
passepoilés de blanc. Poches en long<br />
en accolades passepoilés de blanc.<br />
Parements carrés bleu passepoilés<br />
de blancs avec pattes de parements<br />
écarlates. Retroussis bleu passepoilés<br />
de blanc. Les ornements de retroussis<br />
sont des cors de chasse écarlate pour<br />
les chasseurs. On peut supposer, mais<br />
rien ne le montre dans la peinture,<br />
que les carabiniers avaient comme<br />
ornement de retroussis des grenades<br />
écarlates. Pour les voltigeurs on<br />
peut supposer des cors de chasse de<br />
couleur chamois, ou bien écarlate.<br />
Le gilet bleu foncé de l’infanterie<br />
légère semble être porté sauf dans un<br />
cas.<br />
Les chasseurs ont des épaulettes<br />
à frange intégralement vertes, y<br />
compris la tournante. Les carabiniers<br />
des épaulettes intégralement<br />
écarlates, y compris la tournante. Les<br />
voltigeurs ont des épaulettes vertes à<br />
tournante jaune.<br />
Certains des hommes sont équipés<br />
de capotes grises qui sont amples<br />
et assez longues. Elles semblent être<br />
de fourniture récente. Ces capotes<br />
En matière de petit équipement :<br />
baudriers de sabre et de giberne en<br />
buffle blanc. La giberne est en cuir<br />
noir sans aucun ornement. Le sabre<br />
briquet est du modèle de 1767 à<br />
poignée de laiton (et non le modèle<br />
an IX habituel). On ne constate<br />
aucune dragonne à ce briquet. Les<br />
baïonnettes sont portées dans des<br />
fourreaux de cuir marron.<br />
Le havresac est en peau de vache<br />
à courroies de buffle blanc. Les<br />
havresacs sont parfois bien remplis !<br />
Les hommes ont par ailleurs des<br />
bisacs, des miches de pain etc.<br />
C’est dans l’habillement des jambes<br />
que l’on constate la plus grande<br />
diversité.<br />
La culotte « réglementaire » de<br />
couleur bleu foncé est portée le plus<br />
souvent par dessus les guêtres.<br />
Les soldats portent par ailleurs des<br />
pantalons blancs assez amples et des<br />
pantalons brun-rougeâtres. Ces effets<br />
de campagne sont probablement<br />
revêtus au dessus de la culotte bleue<br />
afin de la protéger. Les guêtres<br />
semblent être celles de l’infanterie<br />
légère : gris-noire à découpe frontale<br />
en pointe. On observe cependant le<br />
port de guêtres blanches hautes du<br />
type de l’infanterie de ligne ! Enfin,<br />
un soldat semble porter une culotte<br />
ou pantalon de couleur crème. Ce<br />
même soldat ne porte pas le gilet et<br />
la culotte couvre donc jusqu’au revers<br />
de l’habit.<br />
Les officiers semblent porter l’habit<br />
long à revers en pointe, culotte<br />
chamois, bottes à la hongroise,<br />
épaulettes argent et sabre à poignée<br />
noire, monture argent.<br />
C’est grâce à cette peinture que<br />
nous pouvons avoir une vue aussi<br />
précise de l’habillement et de<br />
l’équipement de ce régiment en<br />
campagne mais aussi un reportage<br />
fidèle de ce qu’était le combat « en<br />
tirailleurs » de l’infanterie sous<br />
l’Empire.
41<br />
Ratisbonne le 23 avril 1809,<br />
par Pierre Gautherot<br />
Yves Martin<br />
Au soir du 21 avril, le général Hiller, défait, fuit en direction de Vienne. L’Empereur lance à ses trousses Bessières et<br />
sa cavalerie. Il se rend compte désormais qu’alors qu’il croyait affronter le gros de l’armée autrichienne, il n’a fait<br />
qu’étriller la (faible) aile gauche de celle-ci.<br />
Il comprend, un peu tard,<br />
que l’Archiduc Charles se<br />
trouve au Nord concentré<br />
autour d’Eckmühl avec le gros<br />
de son armée. Certes, sa ligne de<br />
communication vers Vienne est<br />
désormais coupée, mais il peut<br />
s’appuyer sur la ville de Ratisbonne<br />
qu’il a capturée le 21 avril faisant<br />
d’ailleurs prisonnier au passage le<br />
65 e de ligne français. Surtout, il peut<br />
désormais menacer le 3 e corps de<br />
Davout qui est isolé. Davout, qui ne<br />
s’est pas privé d’alerter Napoléon qui<br />
découvre ainsi qu’une fois encore<br />
un de ses plus brillants subordonnés<br />
avait raison…<br />
Il lui demande donc de tenir en se<br />
renforçant, lui confiant le 7 e corps<br />
de Lefebvre, et deux divisions, celles<br />
de Tharreau et Boudet en soutien.<br />
Lui-même lance vers le nord les<br />
divisions Vandamme, Saint-Sulpice,<br />
Gudin et Morand. Vers midi le<br />
22 avril, les combats s’entament<br />
autour d’Eckmühl. La manœuvre<br />
d’encerclement de l’Archiduc Charles<br />
échoue ; couronnée par de brillantes<br />
charges de cavalerie, l’avancée<br />
française est irrésistible.<br />
Au soir du 22 avril, l’armée<br />
autrichienne est battue et reflue vers<br />
Ratisbonne, porte de sortie pour elle<br />
vers la Bohème.<br />
Davout a pratiquement réédité, en<br />
ce 22 avril, son exploit d’Auerstaedt.<br />
La lourde bévue de Napoléon si<br />
elle n’a finalement pas porté à<br />
conséquence a retardé et empêché<br />
la totale destruction de l’adversaire.<br />
Eckmühl est en ce sens une terne<br />
victoire aux yeux de Napoléon.<br />
Si Auerstaedt a fait de Davout un<br />
duc, Eckmühl en fait un prince<br />
– reconnaissance impériale…<br />
Est-ce ce sentiment d’évidence<br />
mitigé qui explique la pauvreté de<br />
l’iconographie « officielle » française<br />
sur cette bataille ? Où bien est-ce<br />
la part (trop) importante jouée par<br />
les alliés allemands du 7 e corps ?<br />
Toujours est-il qu’Eckmühl n’a<br />
point tenté les peintres français,<br />
contrairement à un combat plus<br />
mineur comme Landshut ou, nous<br />
allons le voir, Ratisbonne.<br />
Ratisbonne : c’est une ancienne<br />
ville libre du Saint-Empire romain<br />
germanique. Elle a même accueilli<br />
le siège de la diète impériale de 1803<br />
à 1806. C’est depuis 1803 le siège<br />
de la principauté de Ratisbonne,<br />
détenu par Carl von Dalberg,<br />
ancien archevêque de Mayence.<br />
Mayence devenue française, on la<br />
lui a échangé pour Ratisbonne (ou<br />
Regensburg en allemand). La ville<br />
de par son passé était déjà opulente<br />
mais avait déjà subi les dommages<br />
de la guerre en 1805. Dalberg l’a<br />
embellie, modernisée. En ce 23 avril<br />
1809, le sort de la vieille ville libre<br />
allait basculer.<br />
À la mi-journée du 23 avril,<br />
la cavalerie autrichienne oppose<br />
une forte résistance aux français.<br />
De féroces combats de cavalerie<br />
se déroulent sous les murs de la<br />
ville. Aux créneaux des imposants<br />
remparts, les fantassins autrichiens<br />
font feu. La défense de la ville est<br />
primordiale pour l’archiduc Charles<br />
s’il veut sauver ce qui reste de son<br />
armée et passer en Bohème.<br />
La journée de Ratisbonne va être<br />
un des plus importants symboles de<br />
la campagne de 1809 en matière<br />
de peinture et d’iconographie. En<br />
effet, deux événements vont retenir<br />
l’attention des contemporains.<br />
Le premier est la blessure de<br />
l’Empereur, le second l’assaut donné<br />
à la ville par le Maréchal Lannes en<br />
personne.<br />
C’est vers midi ou un peu après,<br />
alors que les combats de cavalerie<br />
ont fait rage et que l’Empereur<br />
venait de déjeuner que celui-ci<br />
est blessé au pied par une balle<br />
morte. Tout au plus s’agit-il d’une<br />
contusion, sans autre gravité que de<br />
rendre la monte de cheval et tout<br />
déplacement pénible pour quelques<br />
jours. Mais voilà, l’événement revêt<br />
une importance toute particulière<br />
puisqu’il est arrivé à l’Empereur, chef<br />
charismatique de l’armée qui n’a<br />
quasiment jamais été blessé (qui se<br />
souvient alors du coup de baïonnette<br />
reçu à la cuisse lors du siège de<br />
Toulon ?). La panique risquant de<br />
s’emparer de l’armée alors que la<br />
rumeur de la blessure de l’Empereur<br />
se répand, celui-ci doit galoper<br />
devant le front de ses troupes afin de<br />
les rassurer.
■ Napoléon I er , blessé au pied<br />
devant Ratisbonne, est soigné par<br />
le chirurgien Yvan, 23 avril 1809<br />
par Pierre Gautherot (1765/1769-1825) -<br />
© RMN (Château de Versailles) / Gérard<br />
Blot.
44 - Ratisbonne - 23 avril 1809<br />
1<br />
malgré cela lui fit une blessure fort<br />
douloureuse, en ce qu’elle était sur le<br />
nerf, qui était enflé par la chaleur de<br />
ses bottes, qu’il n’avait pas quittées<br />
depuis plusieurs jours.<br />
Bien entendu, l’épisode a été<br />
largement rapporté par les mémorialistes...<br />
qu’ils aient été présents ou non.<br />
Commençons par citer un des<br />
personnages les plus proches de<br />
l’Empereur ; Savary, Duc de Rovigo<br />
qui tient une place particulière<br />
dans cette campagne. Savary a la<br />
charge de la police et des espions.<br />
Il se tient quasiment constamment<br />
aux côtés de l’Empereur en 1809 et<br />
son témoignage est donc des plus<br />
importants :<br />
« L’empereur était impatient d’entrer<br />
dans Ratisbonne ; il se leva de dessus<br />
le manteau sur lequel il était étendu,<br />
pour ordonner l’attaque ; il était à pied<br />
à côté du maréchal Lannes – il appelait<br />
le prince de Neuchâtel, lorsqu’une balle<br />
tirée de la muraille de la ville vint lui<br />
frapper au gros orteil du pied gauche ;<br />
elle ne perça point sa botte, mais<br />
J’étais présent lorsque cela est<br />
arrivé. On appela de suite M. Yvan,<br />
son chirurgien, qui le pansa devant<br />
nous et tous les soldats qui étaient<br />
aussi présents. On leur disait bien<br />
de s’éloigner ; mais ils approchaient<br />
encore davantage. Cet accident<br />
passa de bouche en bouche ; tous les<br />
soldats accoururent depuis la première<br />
ligne jusqu’à la troisième. Il y eut un<br />
moment de trouble, qui n’était que<br />
la conséquence du dévouement des<br />
troupes à sa personne ; il fut obligé<br />
aussitôt qu’il fut pansé de monter à<br />
cheval pour se montrer aux troupes.<br />
Il souffrait assez pour être obligé d’y<br />
monter du côté hors montoir, étant<br />
soutenu par dessous les bras. Si la<br />
balle eut donné sur le coup de pied, au<br />
lieu de donner sur l’orteil, elle l’aurait<br />
infailliblement traversé ; l’heureuse<br />
étoile fit encore son devoir cette<br />
fois-ci. »<br />
Cadet de Gassicourt lui n’est pas<br />
présent, mais il donne une version<br />
légèrement différente avec des<br />
précisions dignes de son état médical<br />
comme pharmacien impérial :<br />
« L’affaire était presque terminée.<br />
Napoléon, hors de portée, s’était assis<br />
sur un tertre couvert de gazon, et il<br />
causait avec le grand maréchal Duroc,<br />
lorsqu’une balle amortie vint le frapper<br />
au-dessous de la malléole externe<br />
du pied droit, et lui faire une forte<br />
contusion. »<br />
« Ce ne peut être dit-il froidement,<br />
qu’un tyrolien qui m’ait ajusté de si<br />
loin. Ces gens sont très adroits ».<br />
M. Yvan était près de lui. Il le<br />
pansa. Mais l’Empereur était si<br />
impatient qu’il monta à cheval<br />
pendant que son pied était encore<br />
entre les mains de son chirurgien.<br />
Cet accident engagea plusieurs<br />
généraux à faire à Napoléon des<br />
remontrances sur la témérité avec<br />
laquelle il s’expose dans toutes les<br />
affaires : « que voulez-vous, mes amis,<br />
a-t-il répondu, il faut bien que je<br />
voie. »
45 - Ratisbonne - 23 avril 1809<br />
Enfin, il y a les autres proches de<br />
l’Empereur, Constant son valet :<br />
« À celle de Ratisbonne le 23 avril,<br />
l’empereur reçut au pied droit une<br />
balle morte qui lui fit une assez forte<br />
contusion. J’étais avec le service quand<br />
plusieurs grenadiers de la garde<br />
accoururent me dire que Sa Majesté<br />
était blessée. Je courus en toute hâte,<br />
et j’arrivais au moment où M. Yvan<br />
faisait le pansement . On coupa et laça<br />
la botte de l’empereur, qui remonta sur<br />
le champ à cheval : plusieurs généraux<br />
l’engageaient à prendre du repos, mais<br />
il répondit : « mes amis, ne faut-il pas<br />
que je voie tout ? » Rien ne pourrait<br />
exprimer l’enthousiasme des soldats,<br />
en apprenant que leur chef avait été<br />
blessé, mais que sa blessure n’offrait<br />
aucun danger. « L’empereur est exposé<br />
comme nous, dirent-ils ; ce n’est pas<br />
un poltron celui-là ! » »<br />
Mémoires de Constant<br />
Et quoique en faisant pas partie<br />
de la maison civile, le Baron Lejeune<br />
qui, en tant qu’aide de camp de<br />
Berthier ne devait pas être trop loin.<br />
« Sur ces entrefaites, l’Empereur, qui<br />
était à cheval prêt de la ville, reçut une<br />
balle au talon. Soit que la douleur ne<br />
fût point vive, ou qu’il eut la force de<br />
la dissimuler, il se borna à demander<br />
Yvan, son chirurgien, et ne nous permit<br />
pas à même de le conduire plus loin<br />
pour l’éloigner d’une place ou tombaient<br />
les balles. L’empereur s’assit sur un<br />
tambour, et Yvan pansa la blessure, qui<br />
était une simple contusion. L’empereur<br />
remonta de suite à cheval, et ce ne fut<br />
que quelques heures après que l’armée<br />
connut le danger que son chef venait de<br />
courir. Ces soldats accouraient de toute<br />
part autour de lui, et l’empereur pour<br />
les tranquilliser, parcourut les rangs au<br />
galop, et reçut, au milieu des plus vives<br />
acclamations, les touchantes expressions<br />
de leur dévouement. »<br />
Mémoires de Lejeune<br />
Enfin, la narration du Général<br />
Pelet reprend, bien entendu, cet<br />
épisode de manière très conforme à<br />
tous ces témoignages, s’en inspirant<br />
probablement.<br />
« Au milieu de ses triomphes et<br />
des plus brillants exploits de la vie<br />
de Napoléon, lorsque la victoire le<br />
couronnait de ses plus beaux lauriers<br />
une balle de carabine vint le frapper,<br />
comme pour nous avertir tous, de<br />
l’instabilité des choses humaines.<br />
Que de destinées cette balle pouvait<br />
bouleverser ! Napoléon s’était arrêté<br />
sur un plateau découvert, en face des<br />
maisons de Kirchhof ; il venait du<br />
déjeuner gaiement, il avait invité ceux<br />
qui l’environnaient. Se trouvant pour le<br />
moment seul avec le maréchal Lannes,<br />
il se sentit touché au pied droit. Aussitôt<br />
on l’entoure, la botte est enlevée, et on<br />
aperçoit une forte contusion de balle. Le<br />
bruit se répand rapidement et au loin,<br />
que l’empereur est blessé. Les soldats<br />
accourent de toutes parts ; le fantassin<br />
abandonne ses faisceaux, le cavalier son<br />
cheval ; en un instant 15 000 hommes<br />
entourent leur père, malgré le canon<br />
ennemi qui réunit ses boulets sur<br />
cet immense groupe. Le premier<br />
besoin de Napoléon est de répondre<br />
à tant d’amour, et d’aller tranquilliser<br />
l’inquiétude de l’armée. Il monte à<br />
cheval ; des roulements de tambours<br />
prolongés sur la ligne, rappellent le<br />
soldat dans les rangs. Il les parcourt, il<br />
reçoit partout les expressions de la plus<br />
vive joie, du plus ardent dévouement. »<br />
Si cet épisode n’a guère<br />
d’importance militaire, il est d’une<br />
grande symbolique comme on<br />
peut le lire dans les témoignages<br />
ci-dessus : la réaction passionnée du<br />
soldat, le partage du danger avec<br />
la troupe par L’Empereur etc. La<br />
blessure, ou plutôt « l’égratignure »<br />
reçue à Ratisbonne se devait<br />
d’être commémorée et fournir un<br />
splendide sujet pour un peintre.<br />
C’est Pierre-Claude Gautherot né<br />
en 1769 et élève de David qui<br />
réalise ce sujet et l’expose au salon<br />
de 1810. La scène correspond<br />
« globalement » aux témoignages<br />
et plus particulièrement à celui<br />
de Cadet de Gassicourt qui avoue<br />
d’ailleurs que ceci avait été reproduit<br />
en peinture ! De là à penser que<br />
Cadet de Gassicourt a vu l’œuvre au<br />
salon de 1810…<br />
La peinture est suffisamment<br />
détaillée pour que les portraits soient<br />
fidèles et que Gautherot ait put les<br />
peindre d’après nature.<br />
L’Empereur tout d’abord : il est<br />
revêtu de son habituel frac de<br />
colonel des chasseurs à cheval de<br />
la Garde [1]. On voit nettement<br />
le grand cordon, la croix et la<br />
plaque de la légion d’honneur. On<br />
notera évidemment les épaulettes<br />
à gros bouillons. On remarquera la<br />
fermeture de la culotte moulante<br />
au niveau des chevilles par trois<br />
boutons. Son chapeau est tenu par<br />
Roustam qui s’apprête à lui remettre<br />
dès qu’il sera en selle. Le chapeau est<br />
très simple la cocarde étant retenue<br />
par une ganse de soie noire. Le<br />
cheval de Napoléon a été identifié<br />
par Philippe Osché, grand spécialiste<br />
des montures de l’Empereur comme<br />
étant le Fayoum 1 . Son harnachement<br />
quoique très riche l’est nettement<br />
moins que celui que nous avons pu<br />
admirer sur la peinture consacré<br />
à Abensberg. Il est probable qu’il<br />
s’agit d’une selle « classique » ou du<br />
premier modèle brodé. Cela est aussi<br />
plus logique « en campagne ». On<br />
notera aussi que la botte à forte tige<br />
droite a été découpée. Elle est tenue<br />
par le Major de Chasseurs à Cheval<br />
de la Garde Impériale qui la tend<br />
au chirurgien Yvan. Cette découpe<br />
nous permet de voir que la botte<br />
était visiblement doublée avec une<br />
légère fourrure blanche (laine de<br />
mouton) afin d’en rendre le port plus<br />
confortable.<br />
Le chirurgien Yvan est le prochain<br />
personnage [2].<br />
Yvan, premier chirurgien de<br />
l’Empereur n’a pas laissé dans<br />
l’histoire médicale une notoriété<br />
aussi grande que celle d’un Larrey<br />
ou d’un Percy. C’est que l’homme,<br />
de l’avis unanime, fut plus courtisan<br />
que médecin.<br />
Il est né en 1765, un an avant<br />
Larrey, onze après Percy. Né à<br />
Toulon, il a la chance de rejoindre<br />
l’armée d’Italie sous les ordres du<br />
jeune général Bonaparte... et il<br />
est 6 ans après chirurgien en chef<br />
adjoint des Invalides ! En 1804, il est<br />
désormais attaché personnellement à
46 - Ratisbonne - 23 avril 1809<br />
2<br />
3<br />
la personne du nouveau souverain.<br />
Il sera dès lors, comme l’indique le<br />
Baron Fain dans ses mémoires, dans<br />
l’ombre permanente de l’Empereur.<br />
La troupe le compare, sans élégance,<br />
au domestique Roustan.<br />
Sa rapide promotion et surtout<br />
son évident manque d’envergure<br />
aux yeux de ses collègues font<br />
des envieux. Percy, en particulier<br />
ne tarit pas de reproches à son<br />
endroit.<br />
Comme on le sait, Yvan n’eut<br />
guère à œuvrer sauf en ce<br />
23 avril 1809... de fait, il inspecte les<br />
hôpitaux de campagne, rend compte<br />
à l’Empereur de ce qu’il voit et de<br />
l’état des blessés dont Napoléon se
47 - Ratisbonne - 23 avril 1809<br />
5<br />
4<br />
soucie. Il est aussi appelé en renfort<br />
en certains cas graves. C’est ainsi<br />
qu’il sera appelé au chevet de Lannes<br />
dans quelques semaines à venir, mais<br />
n’anticipons pas !<br />
Chirurgien personnel de l’Empereur,<br />
il relève de la maison civile, mais<br />
son uniforme doit aussi refléter sa<br />
fonction. La tenue qu’il porte est<br />
d’une grande logique... mais est<br />
exceptionnelle et... unique puisqu’il<br />
est le seul à détenir cette fonction.<br />
Il porte un habit très simple de<br />
drap bleu foncé orné d’une broderie<br />
à entrelacs or, semblable au modèle<br />
porté par d’autres membres de<br />
la maison civile. Il a collet et<br />
parements écarlates, distinctive des<br />
chirurgiens. Son habit est donc bien<br />
celui d’un chirurgien, mais différent<br />
de ce qui est porté dans l’armée,<br />
Garde ou Ligne ! Il porte des bottes<br />
à revers fauves assez classiques. On<br />
notera devant lui non seulement<br />
les bandages, mais aussi un bol en<br />
métal rempli d’eau de Cologne avec<br />
une éponge qui a servi aux soins [3].<br />
En effet, la simple contusion<br />
soufferte par Napoléon n’amenait<br />
pas d’autres soins à l’époque... au<br />
moins l’eau de Cologne assurait,<br />
bien involontairement un niveau<br />
d’antisepsie ! Remarquons aussi<br />
l’éperon droit très simple, en acier<br />
qui a été retiré à la botte droite.<br />
Légèrement derrière et à droite<br />
d’Yvan, un officier général tient le<br />
flacon d’eau de Cologne dans sa<br />
main droite [4]. L’homme est d’âge<br />
mur avec les cheveux peut être<br />
légèrement grisonnants. Dans sa<br />
main gauche son bicorne à plumetis<br />
blanc. Il s’agit donc d’un maréchal.<br />
Or, le seul présent sur les lieux lors<br />
de la blessure de l’Empereur et donc<br />
celui qui logiquement se devait de<br />
l’aider lors des soins est Lannes.<br />
Il n’a évidemment pas pu servir<br />
de modèle à Gautherot puisque<br />
décédé. La peinture rappelle donc<br />
aussi probablement l’amitié entre<br />
les deux hommes. On distingue<br />
peu les détails de son habit en<br />
dehors du grand cordon et de la<br />
croix de la légion d’honneur portée<br />
proche du collet.<br />
Autre Maréchal présent dans<br />
le tableau et qui se trouve lui<br />
aussi toujours dans l’ombre de<br />
l’Empereur : Berthier, Major-général<br />
de la Grande Armée [5]. Ce portrait<br />
de profil est assez inhabituel et, il<br />
faut le reconnaître, peu flatteur.<br />
Il tient son bicorne dans la main<br />
droite. On voit là aussi le grand<br />
cordon et proche du collet la légion<br />
d’honneur et une autre décoration<br />
en réduction. Berthier porte par<br />
ailleurs de fins gants de peau de<br />
couleur brun verdâtre. À côté de<br />
Berthier, à sa droite, on distingue<br />
nettement un de ses aides de camp<br />
revêtu du célèbre uniforme dessiné<br />
par le Baron Lejeune [6]. S’agit-il<br />
d’ailleurs du célèbre peintre ? C’est<br />
possible mais non certain. En tous<br />
les cas on voit nettement la pelisse<br />
noire brillamment galonnée d’or et<br />
à laquelle est accrochée une légion<br />
d’honneur, le dolman blanc à collet<br />
et parements écarlate. Notre homme<br />
se trouvant légèrement dans l’ombre,<br />
Gautherot a donné au blanc une
Napoléon I er , blessé au pied devant Ratisbonne, est soigné par le chirurgien Yvan, 23 avril 1809<br />
par Pierre Gautherot (1765/1769-1825) - © RMN (Château de Versailles) / Gérard Blot.<br />
Voir article page 41.<br />
Ouvrage publié avec le soutien du :<br />
L 18498 - 2 H - F: 18,80 € - RD