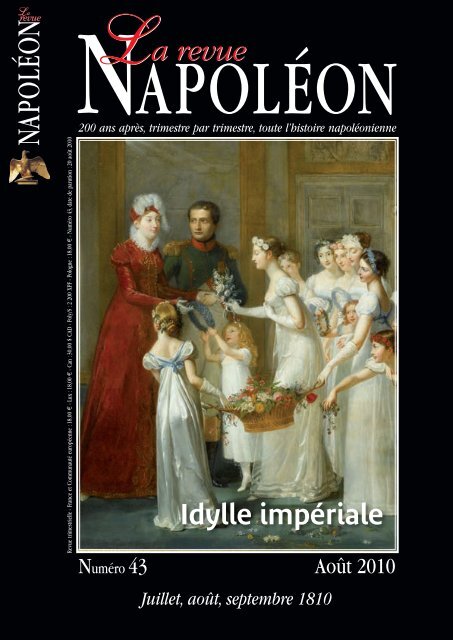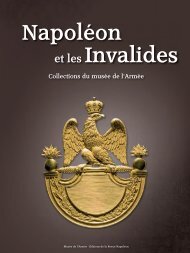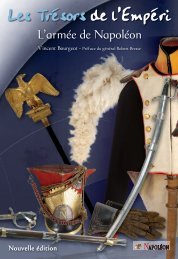You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
200 ans après, trimestre par trimestre, toute l’histoire napoléonienne<br />
Revue trimestrielle - France et Communauté européenne : 18,00 € - Lux : 18,00 € - Can : 30,00 $ CAD - Poly/S : 2 200 XPF - Pologne : 18,00 € - Numéro 43, date de parution : 20 août 2010<br />
Idylle impériale<br />
Numéro 43 Août 2010<br />
Juillet, août, septembre 1810
SOMMAIRE<br />
N° 43<br />
Juillet, août, septembre 1810<br />
Juillet, août, septembre 2010<br />
LA REVUE NAPOLÉON<br />
PRÉSIDENT D’HONNEUR :<br />
Comte Charles-André Walewski<br />
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :<br />
Pierre Burgaleta<br />
COMITÉ DE RÉDACTION :<br />
Michel Kerautret, André Palluel-Guillard<br />
ICONOGRAPHIE :<br />
Éric Pautrel<br />
ABONNEMENT FRANCE :<br />
Éditions de la Revue Napoléon - BP 104<br />
74941 Annecy-le-Vieux Cedex<br />
Contact : Rosa Garcia-Johnston<br />
Tél. +33 (0) 4 50 32 63 58<br />
SERVICE DES VENTES :<br />
Vive la presse<br />
Contact : Amandine Fest-Castello - +33 (0)9 61 47 78 48<br />
Numéro de téléphone réservé aux diffuseurs<br />
et aux dépositaires de presse.<br />
DISTRIBUTION EN FRANCE ET EXPORT :<br />
M. L. P.<br />
DISTRIBUTION EN BELGIQUE :<br />
Tondeur Diffusion<br />
9, avenue Van Kalken – B 1070 – Bruxelles<br />
Tél. +/322/555 02 20 - Fax +/322/555 02 29<br />
DISTRIBUTION EN ITALIE :<br />
Tuttostoria, Ermanno Albertelli editore<br />
Via G.S. Sonnino, 34 – 43 100 Parma – Italie<br />
DÉPÔT LÉGAL :<br />
3 e trimestre 2010<br />
COMMISSION PARITAIRE :<br />
N° 0502 K 79 571<br />
I.S.S.N. :<br />
1622 – 4 248<br />
IMPRESSION :<br />
Imprimerie de Champagne<br />
Rue de l'Étoile de Langres<br />
Z.I. Les Franchises - 52200 Langres<br />
LA REVUE NAPOLÉON EST PUBLIÉE PAR :<br />
Éditions de la Revue Napoléon<br />
14, rue du Pré Paillard - Parc des Glaisins<br />
74940 Annecy-le-Vieux<br />
Tél. +33 (0) 4 50 32 63 58<br />
Fax +33 (0) 4 50 02 38 35<br />
www.editions–napoleon. com<br />
contact@editions-napoleon.com<br />
FONDATEUR :<br />
Guy Lecomte<br />
DIRECTION :<br />
Pierre Burgaleta<br />
Tél. : +33 (0) 4 50 32 63 58<br />
■ Le contexte historique ................................................................... p. 3<br />
Michel Kerautret<br />
■ La guerre russo-turque : Les opérations de l’été 1810 .. p. 4<br />
Pierre Juhel<br />
■ Flammes et feux, le drame des incendies ........................... p. 17<br />
Chantal Lheureux-Prévot<br />
■ 1 er Juillet 1810 : tragédie à l'ambassade d'Autriche ...... p. 23<br />
Pierre Burgaleta<br />
■ Le petit Louis, lapin de Hollande .......................................... p. 28<br />
Ronald Pawly<br />
■ La mort de la reine Louise de Prusse<br />
(19 juillet 1810) .............................................................................. p. 41<br />
Michel Kerautret<br />
■ La visite Impériale à Anvers en 1810 ................................... p. 46<br />
Ronald Pawly<br />
■ Fastes monarchiques à l’heure d’une idylle :<br />
de la rencontre à la lune de miel<br />
sous les ors de Compiègne......................................................... p. 51<br />
Hélène Meyer<br />
■ La troisième invasion du Portugal ........................................ p. 57<br />
Frédéric Bey<br />
■ Le sort des prisonniers français .............................................. p. 66<br />
Vincent Rolin<br />
■ La vie quotidienne d’une bourgeoise sous l’Empire :<br />
madame Moitte (1747-1807) .................................................. p. 72<br />
Claudette Joannis<br />
■ La correspondance de Napoléon ............................................ p. 75<br />
Sélection Michel Kerautret<br />
■ Le journal des modes ................................................................... p. 77<br />
Claudette Joannis<br />
Couverture : Arrivée de Marie-Louise à Compiègne le 28 mars 1810, recevant les compliments<br />
et les fleurs d'un groupe de jeunes filles dans la Galerie du Chartrain à Compiègne.<br />
Huile sur toile de Pauline Auzou (1775-1835), 1810. Collection Châteaux de Versailles et de Trianon,<br />
Versailles, © RMN / Gérard Blot.<br />
1
Tableau chronologique<br />
Tableau chronologique des principaux<br />
événements durant le 3 e trimestre 1810<br />
(Du 1 er juillet au 30 septembre 1810)<br />
1 er juillet Incendie de l'hôtel Schwartzenberg.<br />
3 juillet Louis abdique le trône de Hollande et se réfugie en Autriche.<br />
Décret de Saint Cloud officialisant le régime des licences.<br />
9 juillet Réunion de la Hollande à l'Empire.<br />
10 juillet Masséna fait capituler Ciudad Rodrigo.<br />
13 juillet Échec définitif de la négociation franco-russe sur la Pologne.<br />
18 juillet La douane française s'installe à Dantzig.<br />
19 juillet Mort de la reine Louise de Prusse.<br />
24 juillet Au Portugal, début du siège d'Almeida.<br />
25 juillet Décret complétant celui du 3 juillet.<br />
5 août Décret de Trianon aggravant la taxation des denrées coloniales.<br />
7 août En Italie, Lucien s'embarque pour les États-Unis.<br />
10 août Ordre de réunir à Paris les archives de tous les pays réunis à la France.<br />
15 août Inauguration de la colonne Vendôme.<br />
16 août Dalberg introduit les réformes napoléoniennes à Francfort.<br />
18 août Ordre d'occuper toutes les côtes allemandes pour combattre la contrebande.<br />
21 août Bernadotte est élu prince héritier de Suède.<br />
28 août Masséna fait capituler Almeida.<br />
3 septembre Échec d'une attaque russe devant Roustchouk.<br />
4 septembre Fesch refuse le siège archi-épiscopal de Paris.<br />
5 septembre Victoire de Macdonald à Cervera en Espagne.<br />
7 septembre Victoire russe décisive à Batynia.<br />
15 septembre Talleyrand écrit à Alexandre pour lui demander un million.<br />
17 septembre Échec d'un débarquement de Murat en Sicile.<br />
24 septembre Ouverture des Cortès extraordinaires à Cadix.<br />
27 septembre Combat de Bussaco entre Masséna et Wellington.<br />
2
Contexte historique<br />
Michel KERAUTRET<br />
À<br />
l’échelle de l’histoire<br />
napoléonienne, l’été 1810<br />
n’a pas laissé de grands<br />
souvenirs. L’empereur ne livre pas de<br />
bataille, nul événement fondateur n’est<br />
à commémorer dans l’ordre intérieur, si<br />
ce n’est peut-être, le 15 août, l’érection<br />
de la colonne Vendôme. Mais les choses<br />
vont leur train, les ressorts continuent de<br />
jouer, des tensions s’accumulent, l’avenir<br />
se met en place.<br />
La guerre se poursuit plus que<br />
jamais avec l’Angleterre, sur le terrain<br />
militaire comme dans le domaine<br />
économique. En Espagne et au Portugal,<br />
Napoléon attendait beaucoup de<br />
Masséna, chargé de refouler Wellington<br />
jusqu’à ses vaisseaux. Après des débuts<br />
prometteurs, la campagne du prince<br />
d’Essling marque cependant le pas dès<br />
la fi n de septembre : lors du combat<br />
frontal et meurtrier de Bussaco, victoire<br />
chèrement acquise, on ne retrouve pas le<br />
génie de l’ex-enfant chéri de la victoire.<br />
Les querelles entre les généraux français<br />
n’en prospèrent que mieux, d’autant plus<br />
que l’éloignement interdit à Napoléon<br />
et à Berthier, demeurés à Paris, d’avoir<br />
vraiment prise sur la conduite de<br />
la guerre. Rien n’est donc réglé, et<br />
l’insurrection commence à s’organiser<br />
politiquement dans Cadix qui résiste<br />
toujours.<br />
La guerre économique ne fait pas<br />
non plus relâche, mais elle ne cesse<br />
d’évoluer. Après l’instauration d’un<br />
système de licences, peu cohérent avec<br />
la ligne générale du blocus continental,<br />
voici le décret de Trianon du 5 août, qui<br />
institue un tarif sur les importations de<br />
produits coloniaux anglais, applicable<br />
à toute l’Europe. À défaut de prohiber,<br />
on peut tirer des rentrées fiscales de<br />
l’appétit des populations pour le sucre et<br />
le café, ainsi que Napoléon le fait valoir<br />
à ses alliés. Les questions douanières<br />
continuent cependant de compliquer la<br />
vie quotidienne de nombreux habitants<br />
du grand Empire.<br />
Elles détériorent aussi le climat au<br />
sein de la famille impériale. Depuis des<br />
mois, elles ont contribué à envenimer<br />
les relations entre l’empereur et son<br />
frère Louis, roi de Hollande. La tension<br />
n’avait cessé de monter jusqu’à ce<br />
qu’au début de juillet, Louis se résolve<br />
à abdiquer et à s’enfuir en territoire<br />
autrichien. Fâcheux exemple ! Un<br />
mois plus tard, c’est un autre frère de<br />
l’empereur qui s’efforce d’échapper à son<br />
tour à son emprise : Lucien veut quitter<br />
l’Italie pour les États-Unis. Napoléon ne<br />
paraît pas ébranlé néanmoins par ces<br />
soubresauts familiaux : dès le 9 juillet,<br />
il a annexé la Hollande à l’Empire, et il<br />
ne prend pas de gants, en septembre,<br />
pour reprendre à Jérôme une partie<br />
des territoires formant son royaume de<br />
Westphalie, en vue de mieux contrôler<br />
la côte de l’Allemagne du nord. Quant<br />
à Murat, qui se sent délaissé depuis<br />
que le mariage autrichien a fait de<br />
sa rivale Marie-Caroline une parente<br />
de Napoléon, il s’irrite de n’être pas<br />
soutenu dans sa dernière tentative<br />
pour s’emparer de la Sicile. Partout, la<br />
famille récrimine. On peut s’étonner<br />
qu’à la lumière de ces premiers déboires,<br />
l’empereur laisse désigner son (quasi)<br />
beau-frère Bernadotte comme prince<br />
héritier de Suède, et qu’il espère même<br />
y trouver un avantage – tout en se<br />
défendant d’avoir pesé en rien sur<br />
l’élection.<br />
En dehors de la péninsule ibérique,<br />
le continent reste pacifique. Mais<br />
la puissance intacte de la Russie<br />
demeure un recours, et beaucoup y<br />
songent, d’autant plus qu’il existe des<br />
sujets de contentieux entre Paris et<br />
Saint-Pétersbourg, que ce soit la question<br />
de Pologne ou l’application du blocus<br />
– Alexandre n’ayant guère apprécié<br />
que Napoléon transgresse son propre<br />
système pour son seul profit, au moyen<br />
des licences. Pour l’heure, le tsar se<br />
contente de marquer des points sur<br />
le front turc et d’organiser son réseau<br />
d’espionnage à Paris. Talleyrand lui offre<br />
justement ses services pour un million.<br />
Tout cela ne prendra sens qu’à la<br />
lumière des événements ultérieurs.<br />
Sur le moment, ce sont sans doute les<br />
faits divers qui auront le plus frappé les<br />
contemporains. À commencer par le<br />
bal tragique de l’ambassade d’Autriche,<br />
le 1 er juillet, qui voit périr plusieurs<br />
dames de haut parage et démontre la<br />
nécessité de réformer l’organisation<br />
des pompiers de Paris. Quelques jours<br />
plus tard, non loin de Berlin, c’est la<br />
reine Louise de Prusse qui disparaît<br />
soudain, au terme d’une brève maladie.<br />
Napoléon perd sa meilleure ennemie,<br />
mais elle sera plus grande encore morte<br />
que vivante, et le jour viendra où le<br />
ressentiment prussien lui imputera cette<br />
mort prématurée pour mieux demander<br />
vengeance.<br />
■<br />
3
La guerre russo-turque :<br />
Les opérations<br />
de l’été 1810<br />
Pierre JUHEL<br />
Une nouvelle guerre entre la Russie et la Porte avait débuté<br />
en 1806. Mais à l’époque de Tilsit, par l’entremise de Napoléon,<br />
un armistice avait été signé en les deux puissances. Fin 1808,<br />
les armées russes, alors engagées contre l’autre « ennemi<br />
héréditaire », la Suède, avaient conquis l’ensemble<br />
de la Finlande 1 . Le Tsar, ayant ici atteint ses objectifs<br />
et ayant là assuré ses arrières par les accords passés à Erfurt<br />
avec Napoléon 2 , pouvait de nouveau tourner ses regards<br />
vers le Danube. L’armistice fut donc dénoncé en mars 1809.<br />
La campagne qui s’ensuivit, difficile, s’acheva finalement<br />
pour les Russes par un échec. Il leur avait fallu lever le siège<br />
de Silistrie et s’en retourner sur leurs bases en pratiquant,<br />
déjà, la politique de la terre brûlée.<br />
Ville et rade de Varna.<br />
Extrait de F. KANITZ, La Bulgarie danubienne et le Balkan. Étude de voyages (1860-1880),<br />
Paris, 1882, p. 461. Avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque patrimoniale de l’École<br />
militaire.<br />
4
L'ouverture de la<br />
Campagne de 1810<br />
Le plan d’opération russe<br />
A<br />
lexandre I er ne se le tint<br />
pas pour dit. Le précédent<br />
commandant en chef,<br />
Bagration, fut destitué et remplacé par<br />
le comte Nikolaï Kamenski, alors tout<br />
auréolé de gloire car il avait été l’artisan<br />
majeur des succès obtenus l’année<br />
précédente dans le Nord (il avait été à<br />
l’origine du plan d’invasion de la Suède).<br />
Des renforts de troupes aguerries furent<br />
dirigés vers Hirşova, tête de pont russe<br />
sur le Danube.<br />
Étonnement quand on se rappelle<br />
que les Turcs étaient à l’origine un<br />
peuple nomade, l’armée ottomane de<br />
l’époque avait, pour différentes raisons<br />
que nous exposerons ci-dessous, une<br />
stratégie entièrement fondée non sur<br />
la guerre de mouvement mais sur<br />
celle de positions. Les forces du Sultan<br />
s’appuyaient ainsi, sur le Danube, sur<br />
diverses places fortes où l’on espérait<br />
que les Russes viendraient, comme<br />
l’année passée, se casser les dents. Pour<br />
ceux-ci, la stratégie était donc dictée par<br />
celle de l’adversaire : il faudrait aller le<br />
débusquer et lui enlever une à une toutes<br />
ses forteresses. Le plan d’opérations<br />
des Russes était ainsi conçu : le gros<br />
de l’armée, environ 25 000 hommes,<br />
sous la férule du commandant en<br />
chef, devait se porter sur Silistrie ; un<br />
deuxième corps de 15 000 hommes,<br />
commandé par le frère aîné du général<br />
en chef, Serge Kaminski, si dirigereait<br />
sur Bazardjik (en bulgare, Dobritch),<br />
emporter la place et marcher ensuite<br />
sur Varna ; enfi n un corps auxiliaire<br />
(général Zass – orthographié Sass par<br />
VON VALENTINI), devait, se détachant<br />
du gros, passer le Danube de la rive<br />
gauche à la droite à Tourtoukaï (ou<br />
Turtukaïa), c’est-à-dire entre Silistrie<br />
et Roustchouk (aujourd’hui la bulgare<br />
Ruse, francisée en Rousse), au confluent<br />
de l’Argeş de façon à aller attaquer cette<br />
place de Roustchouk par la rive droite du<br />
fleuve. La principale difficulté qu’avaient<br />
toujours connue les armées russes sur ce<br />
théâtre d’opérations avait été celle des<br />
approvisionnements : aussi pourvu-t-on<br />
l’armée de Kamenski de quarante jours<br />
de vivres pendant que, en parallèle, une<br />
véritable pensée logistique visait à doter<br />
Nikolaï Kamenski, commandant en chef de forces russes lors de la Campagne de 1810 sur<br />
le Danube.<br />
L’officier prussien G. W. VON VALENTINI en avait dressé le portrait suivant : « Jeune général,<br />
il avait marqué dans la guerre de 1806 et 1807 et l’année suivante, lorsqu’il commandait en<br />
chef en Finlande, il en avait fait la conquête avec autant de bonheur que d’audace. Étant à<br />
la fleur de l’âge, et à la tête d’une grande armée, on croyait voir en lui le digne antagoniste<br />
de Napoléon. […] Mais il lui manquait plusieurs qualités essentielles pour remplir [le rôle]<br />
auquel il était appelé. N’étant pas à temps opportun hardi à entreprendre, ne sachant pas<br />
céder à l’occasion dans les négociations, mais surtout manquant de persévérance à vaincre<br />
des difficultés, il se montra peu propre à terminer une guerre, plus fastidieuse il est vrai que<br />
tout autre, mais dans laquelle le succès est infaillible pourvu qu’on ne se fatigue de battre et<br />
de tenir la campagne. » (VON VALENTINI, pp. 92-93).<br />
© Musée de l’Ermitage.<br />
chaque place conquise des ressources les<br />
plus conséquentes, tant en provisions de<br />
bouche qu’en munitions de toutes sortes.<br />
La position de la Porte<br />
Qu’elle était la situation des Turcs ?<br />
La Sublime Porte avait été terriblement<br />
affaiblie par les révolutions de palais<br />
de 1807 et de 1808. La déposition du<br />
sultan réformateur Sélim III le 31 mai<br />
1807 avait arrêté la modernisation de<br />
l’armée ottomane 3 ; le règne de celui-là<br />
même qui l’avait déposé, Moustapha IV,<br />
affaiblit l’État lui-même : l’abolition de<br />
toutes les réformes n’empêcha<br />
point les révoltes. Aux quatre coins de<br />
l’empire des pachas (gouverneurs) se<br />
rendaient indépendants et ce fut ainsi<br />
le Pacha de Roustchouk, Moustapha-<br />
Baïraktar, qui provoqua sa chute<br />
en marchant sur Constantinople<br />
(juillet 1808). Cette faiblesse du<br />
pouvoir central explique que, en cette<br />
année 1810, le commandant en chef<br />
5
8<br />
La guerre russo-turque : Les opérations de l’été 1810
En haut et en bas : Famille bulgare des<br />
environs de Varna et types humains<br />
(grecs et turcs) de Roumélie.<br />
Extrait de l’ouvrage de X. R. DE HELL,<br />
Voyage en Turquie et en Perse exécuté<br />
pendant les années 1846, 1847 et 1848,<br />
illustrations de J. LAURENS, Paris, 1859,<br />
respectivement pl. XIII et VIII.<br />
Avec l’aimable autorisation de la<br />
Bibliothèque patrimoniale de l’École<br />
militaire.<br />
Le général Voïnov (vers 1770-1832).<br />
Il amena à Nikolaï Kamenski un<br />
dernier renfort de 5 000 hommes que le<br />
commandant en chef russe avait jugé<br />
indispensable pour attaquer les Ottomans<br />
dans leurs positions de Battin.<br />
Lithographie de Pesotsky d’après un<br />
tableau de Klyoukvin. Circa 1840.<br />
Extrait d’A. C. KORCH [KOPX],<br />
Mikhail Kutuzov [en russe, rés. en<br />
anglais], s. l. [Musée d’histoire d’État de<br />
l’Ordre de Lénine], 1989, p. 34. D.R.<br />
8 000 hommes « dont la plus grande<br />
partie se trouvait morte et blessée<br />
dans le fossé et sur le rempart » (Id.,<br />
p. 104). Nikolaï Kamenski n’avait pas su<br />
arrêter à temps une affaire mal engagée.<br />
Quant au chef du génie russe, il s’attira<br />
des sarcasmes amers d’un général<br />
russe qui fini par lui lâcher : « Vous ne<br />
craignez pas la poudre [c’était en effet<br />
un officier courageux], mais vous ne<br />
l’avez pas inventée (sic !) » (Id., p. 100).<br />
Si Bosniak-Aga avait alors tenté une<br />
sortie, l’armée russe, fort affaiblie, aurait<br />
couru les plus grands dangers. Mais le<br />
pacha pensait plus à préserver ses forces,<br />
garantes de son autonomie, qu’à défaire<br />
l’ennemi. Car, dans un tel affrontement,<br />
il risquait de laisser sur le carreau une<br />
partie de ses troupes... Ainsi en allait-il<br />
de la Porte et de ses « défenseurs ». Sur<br />
le Danube, deux mois de sanglants<br />
combats n’avaient pas permis aux Russes<br />
d’atteindre leurs objectifs principaux.<br />
Vers la bataille décisive<br />
C’est du côté de Choumla, où le<br />
général en chef russe avait laissé son<br />
frère avec un corps de couverture, que<br />
vinrent, peu de temps après l’échec<br />
du grand assaut sur Routschouk, de<br />
bonnes nouvelles pour la cause du<br />
Tsar. À la vue du départ du gros de<br />
l’armée russe, le Grand-Vizir, jouant de<br />
sa large supériorité numérique, était<br />
sorti du grand retranché pour attaquer<br />
Serge Kaminski avec 30 000 hommes.<br />
Mais celui-ci l’avait repoussé avec<br />
force pertes le 22 juillet/3 août. Les<br />
38 drapeaux pris à cette occasion furent<br />
envoyés à Routschouk où ils arrivèrent<br />
le 26 juillet/7 août, fort à propos pour<br />
relever le moral ébranlé d’une armée<br />
qui avait subi un échec cuisant quelques<br />
jours plus tôt. La victoire de Kamenski<br />
l’aîné était d’autant plus importante<br />
qu’elle écartait le danger de voir l’armée<br />
de siège prise en tenaille par le sud-est<br />
alors qu’au même moment paraissait une<br />
autre menace, celle-ci surgit de l’ouest :<br />
Kushanz Ali, celui-là même qui avait tenu<br />
en échec Bagration dans la campagne<br />
précédente, réunissait sous sa bannière<br />
(ou plutôt, en l’espèce, sous sa queue de<br />
cheval, l’emblème du commandement<br />
suprême chez les Turcs), les contingents<br />
de différents pachas des environs du<br />
Danube ainsi qu’un renfort hors de<br />
pair envoyé par le fameux Pacha de<br />
Ioaninna, Ali. Celui-ci avait dépêché<br />
son fi ls Muktar, Pacha de Macédoine,<br />
vers Routschouk avec un puissant corps<br />
essentiellement composé de guerriers<br />
albanais. Ce groupement réuni par<br />
un séraskier (Commandant en chef)<br />
expérimenté formait donc une menace<br />
majeure pour les Russes, d’autant que<br />
les Albanais formaient « de toutes les<br />
troupes turques la plus disciplinée,<br />
la plus obéissante, la plus apte à la<br />
guerre. » (Id., p. 112).<br />
Pour aller reconnaître cet adversaire<br />
redoutable, Nikolaï Kamenski envoya<br />
le célèbre Koulniev, brave parmi<br />
les braves dans l’armée russe et qui<br />
devait trouver la mort en 1812 contre<br />
les Français. Fidèles à leur méthode,<br />
les Turcs avaient établi à quelques<br />
kilomètres en amont de Routschouk, au<br />
village de Battin, un camp retranché.<br />
Ils y attendaient le corps de Muktar,<br />
dont l’arrivée était annoncée pour le<br />
6/19 août. Koulniev eut l’intelligence,<br />
peu de temps après l’échec du grand<br />
assaut de Routschouk du 3, de ne pas<br />
9
La guerre russo-turque : Les opérations de l’été 1810<br />
et qui était aussi le plus vaste. Les<br />
premières attaques russes connurent<br />
des succès variés. Du côté du Danube,<br />
avec l’appui de navires qui eurent bon<br />
compte de la flottille turque, tous les<br />
retranchements ottomans, dont le camp<br />
de Kushanz Ali, tombèrent. Ils furent<br />
emportés par la colonne formée des<br />
troupes de Kamenski l’ainé, décidément<br />
irrésistible dans cette campagne. Mais<br />
ce fut au prix de lourdes pertes, ce dont<br />
ses soldats tirèrent vengeance en passant<br />
la majorité de la garnison du camp de<br />
Kushanz Ali au fi l de l’épée. Si deux<br />
derniers camps, dont celui de Muktar,<br />
repoussèrent les attaques, les Russes les<br />
tenaient à présent directement sous leur<br />
feu. Nikolaï Kamenski décida un assaut<br />
général des positions où se dressaient<br />
encore les emblèmes mahométans. Sa<br />
décision fut accueillie par quelques<br />
murmures des généraux qui craignaient<br />
de donner tête baissée sur dans troupes<br />
animées de la rage du désespoir et qui<br />
n’étaient jamais plus difficiles à vaincre<br />
que dans leurs fortifications improvisées.<br />
Koulniev, qui avait été un peu trop vif,<br />
fut même mis aux arrêts !<br />
Ce moment fut vraiment l’instant<br />
critique de la bataille. Car alors un<br />
ouragan de cavalerie sortit du camp de<br />
Muktar ! Ayant peur de se retrouver pris<br />
comme dans une nasse, le fils d’Ali avait<br />
décidé de s’ouvrir la voie en traversant<br />
les lignes russes avec toute sa cavalerie.<br />
Celle-ci fut suivie par l’infanterie<br />
albanaise qui, au pas de course, chercha<br />
elle aussi son salut dans une course<br />
éperdue. Mais si la cavalerie, passant<br />
à travers les carrés russes, essuyant<br />
le feu de l’infanterie et la mitraille de<br />
l’artillerie, subit de lourdes pertes,<br />
l’infanterie albanaise ne put échapper<br />
aux sabres des Hussards d’Alexandrinsk<br />
et aux coups de Pallaschen (les lattes<br />
russes) des Dragons de Livonie. Quant<br />
à ceux qui étaient restés dans le camp,<br />
ils furent presque tous massacrés.<br />
Quelques survivants furent attelés à un<br />
canon pour amener la pièce au général<br />
en chef des troupes du Tsar, dans une<br />
mise en scène digne des triomphes<br />
de la Rome antique ! Au soir, seul un<br />
camp turc résistait encore, celui qui<br />
était le plus au centre de leur dispositif.<br />
Totalement coupé, ses troupes mourant<br />
de soif, son commandant, le bras droit<br />
de Kushanz Ali (car ce dernier avait été<br />
tué – vraisemblablement dans l’assaut de<br />
Serge Kamenski évoqué ci-dessus), se<br />
rendit à la discrétion de l’ennemi.<br />
Victoire écrasante, Battin ne fut<br />
néanmoins pas l’Enstcheidungsschlacht,<br />
la « bataille décisive » qui devait décider<br />
du sort de la guerre. En effet si à<br />
Routschouk, Bosniak-Aga, totalement<br />
isolé, se vit contraint de négocier une<br />
capitulation, celle-ci, de fait, ressembla<br />
plutôt à un armistice. Différentes<br />
circonstances avaient fait que cette<br />
négociation avait tourné à l’avantage de<br />
l’opiniâtre pacha. D’une part, le général<br />
en chef russe avait pris connaissance<br />
d’évènements internationaux peu<br />
Fantassins albanais, l’élite de l’infanterie<br />
ottomane de l’époque.<br />
Le guerrier représenté de dos porte un<br />
costume traditionnel dont certains éléments<br />
remontent à la plus haute Antiquité -<br />
cf. R. ZOJZI, "Traces archaïques dans les<br />
costumes traditionnels du peuple albanais",<br />
Iliria, V, (1976), pp. 225-232. Planche en<br />
encart entre les pages 106 et 107 du<br />
volume V de l’ouvrage d’A. L. CASTELLAN.<br />
Avec l’aimable autorisation de la<br />
Bibliothèque patrimoniale de l’École<br />
militaire.<br />
Vue de Choumla.<br />
Extrait de l’ouvrage de F. KANITZ,<br />
o. c., p. 377. « Sjoumla a […] une situation<br />
favorable à la défense. C’est une ville<br />
considérable de 30 mille habitants,<br />
entourée par un promontoire du Balcan,<br />
en forme de fer à cheval, dont les<br />
pentes escarpées couvertes d’épaisses<br />
broussailles d’épines, forment une position<br />
des plus avantageuses pour le soldat<br />
turc bien armé, qui aime à tenir tête à son<br />
ennemi derrière des couverts naturels ou<br />
des retranchements. Toute la place longue<br />
d’un demi mille sur un quart de mille de<br />
large, est entourée d’un fossé et d’une<br />
espèce de rempart ou large muraille de<br />
briques que flanquent de petites tours<br />
massives ou corps de garde pour cinq<br />
ou six fusiliers. Tel est le noyau du camp<br />
retranché que la crête des montagnes<br />
environnantes a tracé naturellement à<br />
l’entour. Sa grande étendue, les vallées<br />
qui le traversent, les pentes roides dont<br />
nous avons parlé, rendent un blocus aussi<br />
difficile qu’une attaque dans les règles.<br />
Parfaitement à l’abri d’un bombardement,<br />
la ville offre tout l’espace nécessaire pour<br />
les magasins d’une armée, et elle embrasse<br />
même des vignobles et des jardins. Un<br />
ruisseau, qui y serpente en plusieurs<br />
bras, offre au camp une des choses<br />
les plus nécessaires pour les Turcs. »<br />
(VON VALENTINI, p. 49).<br />
12
Flammes et feux,<br />
le drame des<br />
incendies<br />
Chantal LHEUREUX-PRÉVOT<br />
Fondation Napoléon<br />
L’incendie.<br />
Gravure colorisée de Philibert-Louis<br />
Debucourt (1755-1832), Collection Musée<br />
Carnavalet, Paris, © Roger Viollet.<br />
17
Flammes et feux, le drame des incendies<br />
« Un incendie terrible s'est manifesté, le 21 germinal dernier,<br />
à Valneux, près de Sémur : de 28 maisons qui composaient ce<br />
malheureux village, quatre seulement ont été épargnées par<br />
les flammes. L'imprudence est encore la cause<br />
de cet accident qui ruine un si grand nombre de familles ».<br />
Cet événement qui jetait vingt-cinq familles dans le désarroi<br />
était malheureusement banal au Premier Empire<br />
et n'était traité que par quelques lignes dans l'almanach<br />
annuel de Troyes, région du sinistre. 1<br />
L<br />
es incendies étaient presque<br />
exclusivement d'origine<br />
accidentelle, sauf bien sûr<br />
lorsque les temps étaient aux troubles<br />
sociaux ou aux guerres, mais ces<br />
derniers relèvent d'une nomenclature<br />
que nous n'examinerons pas dans<br />
cet article. Un feu mal éteint, qu'il<br />
soit pour le chauffage de l'habitat ou<br />
pour la cuisson des aliments, pouvait<br />
déclencher un cataclysme à l'échelle<br />
d'un hameau ou d'un village. Un exemple<br />
parmi tant d'autres, à Cayeux sur Mer<br />
dans la Somme, en août 1811 : comme<br />
à l'accoutumée une femme préparait<br />
la pâtée de sa vache dans la grande<br />
marmite. Puis elle jeta les cendres encore<br />
chaudes sur un fumier trop sec. Le temps<br />
était venteux. Les flammes gagnèrent<br />
rapidement le toit et se propagèrent en<br />
moins de deux heures, aux 22 maisons<br />
du village, malgré l'emploi d'une pompe<br />
à eau pour tenter d'éteindre l'incendie et<br />
de préserver quelques fermes. 2<br />
Les jours et les semaines qui suivaient<br />
de tels incendies étaient dramatiques.<br />
Nous conservons le témoignage d'un<br />
envoyé de la préfecture de l'Oise<br />
quelques jours après qu'un violent<br />
incendie ait ravagé un village entier.<br />
Chargé de distribuer de l'argent de la<br />
part du département comme premier<br />
secours, le citoyen Cambry ne pouvait<br />
que constater : « Nul incendie n'offrit<br />
une destruction plus entière; au milieu<br />
d'une forêt d'arbres noirs ou de couleur<br />
rousse, on n'apercevait plus que<br />
quelques cheminées, quelques pignons<br />
à moitié renversés : l'église même était<br />
détruite. Les habitants sans vêtements<br />
et sans souliers, réunis, agglomérés sur<br />
un tertre, cherchaient en s'approchant<br />
une chaleur qui leur manquait. Point<br />
d'abri contre les injures du temps, point<br />
d'espérance pour l'avenir ; ils voyaient<br />
leurs jardins entièrement brûlés, toutes<br />
leurs jouissances d'habitudes perdues ;<br />
leurs bestiaux erraient épars dans la<br />
campagne : on n'apercevait que des<br />
femmes échevelées suivies de leurs<br />
enfants tout nus ; les chiens hurlaient<br />
près de l'emplacement où fut jadis la<br />
porte de leur maître : jamais tableau<br />
n'offrit un spectacle plus vrai du<br />
malheur et du désespoir ». 3<br />
Les incendies en milieu urbain étaient<br />
tout aussi tragiques car s'ils touchaient<br />
moins de constructions, les immeubles<br />
abritaient plusieurs familles. En l'An V, le<br />
29 pluviôse [17 février 1797], le feu prit<br />
dans une maison de la rue Saint-Honoré<br />
à Paris. Des grenadiers en casernement<br />
dans la capitale se précipitèrent pour<br />
sauver des familles entières « Ces<br />
guerriers accoutumés à des feux<br />
plus meurtriers, où il ne s'agit que de<br />
détruire pour se défendre, ont appliqué<br />
leur courage à braver un feu plus<br />
affreux, plus imposant peut-être, et à<br />
sauver les victimes qu'il allait dévorer.<br />
[…] Des femmes au désespoir sont à<br />
tous les étages de la maison ; il n'est<br />
pour elles d'autre issue que des fenêtres<br />
élevées ; c'est dans ce moment que les<br />
grenadiers parviennent dans les étages<br />
embrasés. Il ne s'agit pas de conserver<br />
des meubles, des effets précieux :<br />
ils sont dévoués aux flammes ;<br />
abandonnons-les. Mais sauvez les<br />
enfants ! Sauvez les femmes ! Sauvez<br />
les vieillards ! » Les témoins virent<br />
accourir un homme âgé. Il s'agissait d'un<br />
lieutenant en retraite, Charles Lauron<br />
qui venait sauver sa fille aînée qui tenait<br />
dans cet immeuble un atelier de lingerie.<br />
Cinq ouvrières étaient avec elle. Laissons<br />
encore la parole aux témoins : « Muni de<br />
cordes, il court à l'appartement occupé<br />
par sa fille. Il arrive à la chambre où<br />
sa fille attendait la mort avec deux<br />
personnes de son sexe. Au moment<br />
où l'incendie éclata, il y en avait trois<br />
de plus : c'étaient une nièce et deux<br />
jeunes filles. Aux premiers cris, elles<br />
veulent descendre par l'escalier, on ne<br />
les a plus revues ». Les deux ouvrières<br />
furent descendues grâce aux cordes et<br />
sauvées. C'est au tour de M elle Lauron :<br />
« Elle consent à grande peine à ce que<br />
son père l'attache à son tour pour<br />
la descendre par la fenêtre. Mais<br />
les cordes, attaquées par le feu, se<br />
rompent au milieu de cette périlleuse<br />
descente et la malheureuse jeune fille<br />
se fait, en tombant, des blessures dont<br />
elle se ressentit pendant le reste de sa<br />
vie ». La fin fut tragique pour le brave<br />
grenadier. « Quant à l'infortuné Lauron,<br />
entouré par les flammes, il n'eut d'autre<br />
ressource que de se précipiter dans le<br />
vide, et se tua raide dans sa chute ! » 4<br />
La propagation rapide des feux était<br />
facilitée par les matériaux utilisés<br />
pour les constructions « populaires ».<br />
Dans bien des régions le bois ou le pisé<br />
servaient à bâtir les murs et le chaume<br />
tapissait les toits. Les planchers et les<br />
toitures étaient entièrement en bois et<br />
s'effondraient lorsque le feu était trop<br />
violent. Le préfet des Hautes-Alpes<br />
soulignait l'emploi négatif de tels<br />
matériaux dans un rapport au ministre<br />
de l'Intérieur pour expliquer son<br />
impuissance à réduire les sinistres :<br />
« J'ai sur les incendies, des relevés<br />
véritablement effrayants : on compte<br />
des villages qui ont brûlé six fois,<br />
dans le courant du siècle qui vient de<br />
s'écouler. Les couvertures en chaume<br />
dans les campagnes, les bois résineux<br />
qui servent à la construction et<br />
beaucoup de négligence de la part des<br />
paysans occasionnent des désastres qui<br />
se renouvellent sans cesse. » 5<br />
Les constructions en pierre étaient<br />
plus fréquentes dans les plaines et dans<br />
les régions à l'agriculture suffisamment<br />
riche pour permettre aux laboureurs<br />
ou aux paysans aisés d'investir dans<br />
une maison au coût élevé. Le préfet de<br />
Moselle notait le changement positif<br />
opéré dans son département depuis une<br />
dizaine d'années : « Les maisons sont<br />
en maçonnerie, et presque partout la<br />
tuile y remplace le chaume. L'intérieur<br />
de leurs maisons est meublé avec plus<br />
de goût et de propreté » 6 . Certes les<br />
propriétaires pouvaient choisir entre<br />
les ardoises (mais que le vent enlevait<br />
facilement), les tuiles (au coût élevé,<br />
et qui couvraient imparfaitement), ou<br />
18
Sapeur-pompier, 1 er Empire.<br />
Gravure d’après Job, fin 19 e ,<br />
Coll. Part., DR.<br />
encore les tablettes de bois (mais qui<br />
restaient dangereuses en cas d'incendie).<br />
Quant aux pierres de laves, ignifugées,<br />
résistantes au vent, bien couvrantes,<br />
elles étaient hélas trop lourdes pour bien<br />
des constructions. Elles ne pouvaient<br />
être posées que sur des murs en pierre<br />
bien solides. On avait fait également des<br />
essais avec des plaques en tôles de fer.<br />
Les écarts de température arrêtèrent là<br />
le projet : en été, les tôles s'allongeaient<br />
et faisaient bouger la structure, et en<br />
hiver, les tôles rétrécissaient et la pluie<br />
s'engouffrait dans les brèches du toit,<br />
mouillant le grain et les provisions<br />
déposés au grenier.<br />
Les toits de chaumes restaient<br />
donc largement utilisés, bien que<br />
leur couverture végétale hautement<br />
inflammable était sujet à un autre<br />
danger venu non du sol, mais bien du<br />
ciel, à savoir la foudre des orages. Les<br />
paratonnerres étaient déjà connus mais<br />
restreints au cercle des savants, ils ne<br />
faisaient pas encore partie des paysages<br />
ruraux et urbains. Et c'est ainsi que le<br />
14 prairial de l'An XI (3 juin 1803), à<br />
Paris « le tonnerre [c'est ainsi que l'on<br />
nommait de manière générique toutes<br />
activités d'un orage] est tombé hier, à<br />
une heure après-midi, sur le dôme de<br />
la Salpêtrière. Une heure ensuite une<br />
flamme violente s'est manifestée, le<br />
globe de plomb a été fondu. La terreur<br />
s'est répandue parmi les nombreux<br />
habitants de ce vaste édifice ; mais<br />
l'ordre a été maintenu. Il n'y a eu<br />
aucun incident fâcheux ». 7<br />
Autre facteur aggravant, les cheminées<br />
étaient souvent trop grandes, mal<br />
conçues, et mal entretenues. Elles étaient<br />
à l'origine de nombreux départs de feux.<br />
Dans le département du Mont-Blanc, le<br />
préfet nouvellement nommé découvre<br />
l'habitat de ses administrés : « Les<br />
bâtiments ruraux sont généralement<br />
petits et mesquins, excepté ceux de<br />
quelques grandes fermes. La plupart<br />
sont couverts de chaume. Les tuyaux<br />
des cheminées, d'ailleurs trop bas,<br />
sortent vers le milieu du toit, au lieu<br />
d'être élevés jusqu'au faîte. De là sans<br />
doute le grand nombre d'incendies<br />
qui surviennent presque tous les<br />
ans, et dont les ravages sont d'autant<br />
19
XXXXXXXXXXXXXX<br />
Sapeur pompier du 1 er Empire en<br />
intervention.<br />
Gravure anonyme, début 19 e , Coll. Part.,<br />
DR.<br />
plus rapides, que les charpentes sont<br />
toutes de bois résineux. » 8 À Paris, le<br />
nombre de feux de cheminée était bien<br />
supérieur aux incendies dus à d'autres<br />
facteurs. En 1804, on comptait 314 feux<br />
de cheminée et 89 incendies. Les<br />
embrasements de conduits d'évacuation<br />
encombrés par les suies ne cessèrent<br />
d'augmenter au fil des ans, la ville<br />
devenant de plus en plus peuplée.<br />
En 1815, il y eut 470 feux de cheminée et<br />
66 incendies. 9<br />
Face à ces dangers multiples, des<br />
précautions matérielles et des politiques<br />
communales de lutte contre les incendies<br />
se mettaient en place. Depuis le début<br />
du 18 e siècle dans les villes relativement<br />
grandes (grosso modo à partir de<br />
30 000 habitants), des ordonnances<br />
avaient organisé le rassemblement<br />
des « pompiers » lorsque les cloches<br />
sonnaient un sinistre, et l'emploi de<br />
pompes à eau pour alimenter des tuyaux<br />
qui y étaient raccordés. Par exemple, la<br />
ville de Nantes, consciente du nombre<br />
important de maisons en bois que<br />
comportait la cité, acquit en Hollande<br />
des pompes pour aspirer de l'eau<br />
depuis une borne-fontaine ou un puits,<br />
et forma un corps de pompiers d'une<br />
quarantaine d'individus, tous volontaires.<br />
La majorité de ces pompiers faisaient<br />
partie des métiers du bâtiment, ayant la<br />
force physique pour utiliser la pompe<br />
et tenir la lance, et connaissant de par<br />
leurs métiers les différents types de<br />
construction. Il était également demandé<br />
aux architectes, maçons, charpentiers,<br />
couvreurs et ramoneurs qui le pouvaient,<br />
de se porter sur le lieu de l'incendie pour<br />
se mettre à la disposition des autorités. 10<br />
À Paris, avant la création du corps des<br />
Sapeurs-pompiers en 1811, différentes<br />
ordonnances de la préfecture de<br />
police du régime impérial avaient pris<br />
des dispositions pour faciliter la lutte<br />
contre les incendies, certaines de ces<br />
dispositions étant des rappels d'arrêté<br />
de l'Ancien Régime. Les porteurs<br />
d'eau disposant de tonneaux et pas<br />
seulement de seaux « étaient tenus<br />
en cas d'incendie de se porter au lieu<br />
de l'incendie, avec leurs tonneaux,<br />
pour fournir les secours nécessaires ;<br />
20
1 er Juillet 1810 :<br />
tragédie à<br />
l'ambassade<br />
d'Autriche<br />
Pierre BURGALETA<br />
Incendie de l’ambassade d’Autriche lors du bal donné par l’ambassadeur<br />
Charles de Schwarzenberg pour le mariage de Napoléon et Marie-Louise le 2 juillet 1810.<br />
Lithographie de Charles Motte (1785-1836) d’après un dessin de Wattier (1793-1871),<br />
Collection Bibliothèque Nationale, Paris, © AKG-Images.<br />
23
XXXXXXXXXXXXXX<br />
Sapeur-pompier 1 er Empire en grande<br />
tenue.<br />
Gravure début 19 e , Coll. Part., DR.<br />
L<br />
e 1 er juillet 1810, le prince de<br />
Schwarzenberg, ambassadeur<br />
d'Autriche, organise un bal en<br />
l'honneur du mariage de Napoléon<br />
avec Marie-Louise, la fille de l'empereur<br />
d'Autriche François I er . Après les fastes<br />
de la cérémonie religieuse voulue<br />
par l’Empereur dans le salon Carré<br />
du Louvre le 2 avril, l’ambassadeur<br />
d’Autriche souhaite lui aussi marquer<br />
les esprits : conçues par l'architecte<br />
Bénard, une salle de bal et plusieurs<br />
galeries provisoires sont construites<br />
dans les jardins de l'ambassade, rue du<br />
Mont-Blanc à Paris, pour permettre la<br />
réception de plus de 1 500 personnes.<br />
Richement décorées, ces constructions<br />
de bois et de toile sont garnies de<br />
nombreuses tentures, de gazes, la toiture<br />
est de toile bitumée, un plancher a été<br />
installé pour les nombreux danseurs.<br />
Réalisées dans un délai très court,<br />
on a pour leur décoration, utilisé des<br />
peintures contenant de l’alcool, qui<br />
sèchent plus vite, pour gagner du temps<br />
et être prêts pour l’événement, qui<br />
s’annonce fastueux. L’éclairage se fait<br />
évidemment avec des bougies, et pas<br />
moins de 73 lustres en bronze donnent<br />
un éclat somptueux à la fête.<br />
Laissons la parole au général Lejeune,<br />
témoin et acteur héroïque de cette soirée<br />
qui commence joyeusement mais qui très<br />
vite, se transforme en véritable tragédie.<br />
« Enfin arriva [dimanche 1 er juillet<br />
1810] la fête préparée par le prince de<br />
Schwarzenberg [ambassadeur d'Autriche<br />
en France], pour célébrer l'auguste<br />
mariage, auquel il avait puissamment<br />
contribué. Son hôtel, situé dans la rue<br />
du Mont-Blanc [aujourd'hui rue de la<br />
Chaussée-d'Antin], était au milieu d'un<br />
fort beau jardin ; dans lequel on avait<br />
imité plusieurs des sites où la jeune<br />
Impératrice avait passé son enfance.<br />
Tous les artistes-danseurs de l'Opéra,<br />
dans les costumes autrichiens de ces<br />
localités, représentaient des scènes de<br />
ses premières années. Cette attention<br />
délicate rendit la première partie de la<br />
fête délicieuse pour l'Impératrice, qui<br />
en fut touchée.<br />
Pour recevoir les douze à<br />
quinze cents invités, le prince avait<br />
fait construire une grande salle en<br />
24
Officier de sapeur-pompier, 1 er Empire.<br />
Gravure début 19 e , Coll. Part., DR.<br />
planches, richement décorée de glaces,<br />
de fleurs, de peintures, de draperies,<br />
et d'un luminaire immense. Depuis<br />
plus d'une heure, le bal était en<br />
grande activité, et l'on dansait une<br />
écossaise, quoique la chaleur fût<br />
étouffante. L'lmpératrice, la reine<br />
de Naples, la reine de Westphalie,<br />
la princesse Borghèse, la princesse<br />
de Schwarzenberg, belle-soeur de<br />
l'ambassadeur, ses filles et cent autres<br />
dames, étaient très occupées de figurer<br />
à cette danse animée, lorsqu'une<br />
bougie d'un des lustres près de la porte<br />
du jardin vint à couler et mit le feu à<br />
la draperie. M. le colonel de Tropbriant<br />
s'élança d'un bond pour l'arracher. Ce<br />
mouvement brusque de la draperie<br />
étendit la flamme, et en moins de<br />
trois secondes, dans cette salle peinte<br />
à l'alcool pour la faire sécher plus<br />
promptement, et fort échauffée par<br />
le soleil de juillet, mais bien plus<br />
encore par la quantité considérable de<br />
bougies, la flamme s'étendit d'un bout<br />
à l'autre du plafond avec la rapidité<br />
de l'éclair et le bruit d'un roulement de<br />
tonnerre. Tous les assistants furent à<br />
l'instant même sous une voûte de feu.<br />
Dès que l'Empereur eut jugé<br />
l'impossibilité de l'éteindre, il prit<br />
avec calme la main de l'Impératrice<br />
et la conduisit hors du jardin. Chacun<br />
imita son sang-froid, et personne<br />
ne jeta un cri ; plusieurs danseurs<br />
même ne savaient encore à quoi<br />
attribuer l'augmentation de lumière<br />
et de chaleur, et chacun d'abord se<br />
dirigeait, sans courir, vers l'issue<br />
du jardin, croyant avoir le temps<br />
d'éviter le danger. Cependant, en<br />
quelques secondes, la chaleur devint<br />
insupportable ; on pressa le pas et<br />
l'on marcha sur les robes, ce qui<br />
occasionna un encombrement de<br />
personnes renversées sur les marches<br />
du jardin. Des lambeaux enflammés,<br />
tombés en même temps du plafond,<br />
brûlaient les épaules et la coiffure des<br />
dames ; les hommes, même les plus<br />
forts, étaient entraînés dans la chute, et<br />
leurs vêtements prenaient feu.<br />
Cette réunion de personnes<br />
embrasées était affreuse à voir. J'avais<br />
pu sortir facilement des premiers, en<br />
25
Le petit Louis,<br />
lapin de Hollande<br />
Ronald PAWLY<br />
« La terre et les eaux de la Hollande sont à vous. »<br />
Ainsi le lieutenant-général Lebrun annonce-t-il à l’Empereur,<br />
le 23 juillet 1810, l’annexion de la Hollande à l’Empire.<br />
28
Pyramide élevée à l’auguste Empereur<br />
des Français Napoléon I er , par les troupes<br />
campées dans la plaine de Zeist, faisant<br />
partie de l’armée Française et Batave,<br />
commandée par le général en chef<br />
Marmont.<br />
La hauteur totale est de 36 mètres environ,<br />
celle de l’obélisque prise séparément avec le<br />
socle est de 13 mètres environ, la pyramide<br />
prise à sa base à 48 mètres de côtés.<br />
Les inscriptions furent :<br />
2 e face : Batailles de Montenotte, de Dego,<br />
et Millesimo, de Mondovi, Passage du Pô,<br />
Bataille de Lodi, Combat de Borguetto,<br />
Passage du Mincio, Batailles de Lonato,<br />
de Castiglione, de la Brenta, de S t Georges,<br />
d’Arcole, de la Favorite, de Chebreïs, de<br />
Sediman, de Montabor, d’Aboukir, de<br />
Marengo. Partout où il combattit il fixa la<br />
victoire. Par lui le territoire Français fut<br />
agrandi d’un tiers. Il remplit le monde de sa<br />
gloire.<br />
3 e face : Il termina la guerre civile, détruisit<br />
tous les partis, fit succéder à l’anarchie une<br />
sage liberté, rétablit le Culte, releva le crédit,<br />
enrichit le Trésor public, fit reconstruire les<br />
routes, en ouvrit de nouvelles, fit creuser des<br />
ports et des canaux, prospérer les Sciences<br />
et les Arts, améliore le sort du soldat, honora<br />
le métier des Armes : La Paix générale fut<br />
son ouvrage. La Mauvaise foi de l’Angleterre<br />
renouvelle la Guerre, Il faura l’en Punir.<br />
4 e face : Les troupes campées dans la<br />
plaine de Zeyst, faisant partie de l’armée<br />
Française et Batave, commandées par<br />
le général en chef Marmont, et sous ses<br />
ordres par les généraux de division Grouchy,<br />
Boudet, Vignolle, le lieutenant-général<br />
Batave Dumonceau, les généraux de<br />
brigade Soyez, Cassagne, Delzons, Lacroix,<br />
Guerin d’Etoquigny, Tirlet, Lery, Rousseau,<br />
Dessaix, les généraux-majors Quayta et<br />
Heldring, les colonels Balleydier, Vabre,<br />
Breissand, Sancey, Chalbos, Gruardet,<br />
Pajol, Somis, Foy, Aboville, Desvaux, Delort,<br />
Cerize, Massabeau et Dugommier, les<br />
Colonels Batave Carteret, Colaert et Usslar.<br />
Aubernon Ord. en chef. et composées, du<br />
18 e Régiment d’Infanterie légère, des 11 e ,<br />
35 e , 84 e et 92 e d’Infanterie de Ligne, des<br />
10 e , 17 e , 18 e et 19 e Bataillons Bataves, de<br />
2 Bataillons de Waldeck, et 2 Bataillons<br />
de Grenadiers du 6 e Rég t d’Hussards et du<br />
8 e de Chasseurs à cheval Français, d’un<br />
Régiment d’Hussards et de Dragons bataves,<br />
de 4 Compagnies du 8 e Régiment du Corps<br />
Impérial d’Artillerie, de 4 Compagnies<br />
d’Artillerie à pied Bataves, d’une Compagnie<br />
d’Artillerie à cheval Batave, du 7 e Bataillon<br />
bis du Train d’Artillerie Français, de<br />
4 Compagnies du Train d’Artillerie Batave, de<br />
la 4 e Compagnie de Mineurs Français, de la<br />
7 e C ie du 4 e B on de Sapeurs Français et d’une<br />
C ie de Gendarmerie, ont élevé ce Monument<br />
à la Gloire de l’Empereur des Français<br />
Napoléon I er à l’époque de son avènement<br />
au Trône, et en témoignage d’admiration et<br />
d’amour, généraux, officiers, et soldats, tous<br />
y ont travaillé avec une égale ardeur. Il fut<br />
commencé le 24 Fructidor An 12 et terminé<br />
en 32 Jours.<br />
Atlas Van Stolk, Rotterdam<br />
Caricature anglaise montrant Napoléon qui offre son frère Louis, la cigogne,<br />
aux « grenouilles » hollandaises.<br />
Atlas Van Stolk, Rotterdam<br />
A<br />
près plus de deux siècles,<br />
l’indépendance de la Hollande<br />
vient de cesser. Une seule fois,<br />
les Provinces-Unies 1 se sont trouvées<br />
parmi les grandes puissances du monde<br />
occidental. Ses flottes, commandées<br />
par des amiraux comme De Ruyter et<br />
Tromp, naviguaient sur tous les océans<br />
afin de protéger ses colonies et routes<br />
commerciales.<br />
Peu à peu, sa suprématie sur les mers<br />
diminua et vers la fin du 18 e Siècle, une<br />
guerre contre l’Angleterre, accompagné<br />
d’une crise économique, se révèle<br />
désastreuse. Le mécontentement parmi<br />
les nobles, la bourgeoisie libérale, les<br />
commençants et artisans aboutit à une<br />
révolte de patriotes bataves contre les<br />
Orangistes du Stadhouder Guillaume V<br />
qui se voit supporté par la Prusse. Les<br />
Orangistes en sortent vainqueurs. La<br />
répression qui suit conduit en prison des<br />
centaines de patriotes et 400 000 fuient<br />
la République, la plupart vers la France.<br />
Mais le succès du Stadhouder sera<br />
de courte durée. Fin 1794, les troupes<br />
révolutionnaires françaises du général<br />
29
Le petit Louis, lapin de Hollande<br />
Pichegru franchissent les frontières<br />
de la République des Provinces-<br />
Unies. Les patriotes bataves suivent les<br />
forces républicaines et le Stadhouder<br />
Guillaume V doit s’exiler en Angleterre.<br />
La République Batave est proclamé le<br />
19 janvier 1795.<br />
Gouvernée par un directoire exécutif<br />
de cinq membres, la République va<br />
essayer de garder son indépendance<br />
et de rester neutre dans ces années<br />
turbulentes en Europe. Mais les<br />
garnisons et les exigences françaises<br />
pèsent sur le moral.<br />
Les nouvelles du coup d’état du<br />
18 Brumaire, sont en général bien<br />
reçues et une nouvelle convention 2<br />
entre les deux états, réduit sensiblement<br />
le nombre des troupes françaises à<br />
la solde de la république. L’espoir<br />
de créer un gouvernement stable et<br />
indépendant reste actuel mais vain,<br />
car le 30 septembre 1801, l’ancien<br />
ambassadeur à Paris, Gerard Brantsen,<br />
écrit au ministre des affaires étrangères<br />
Van der Goes : « Nous sommes sous la<br />
férule française. »<br />
Même si le Premier Consul ne<br />
montre pas beaucoup d’intérêt pour<br />
ses voisins du Nord, il reconnaît leur<br />
importance stratégique à cause de leurs<br />
ports et rivières. Pour protéger Anvers,<br />
son « pistolet braqué sur le cœur<br />
de l’Angleterre », le général Monnet<br />
occupe, en avril 1803, Middelbourg<br />
et Veere, puis met Flessingue en état<br />
de siège. Les troupes bataves doivent<br />
évacuer ces positions. À peu près en<br />
même temps, d’autres troupes françaises<br />
entrent dans le Brabant hollandais et s’y<br />
établissent dans les principales places.<br />
Une opération d’annexion de parties du<br />
territoire hollandais que les Français vont<br />
répéter plusieurs fois jusqu’à 1810.<br />
C’est seulement en 1805, que<br />
Napoléon commence vraiment à se<br />
mêler des affaires du gouvernement de<br />
la République Batave. Favorisant un chef<br />
direct au lieu d’un directoire exécutif,<br />
il y installe le 1 er mai de la même année<br />
l’ancien représentant batave à Paris,<br />
Rutger Jan Schimmelpenninck, comme<br />
grand-pensionnaire de la République<br />
batave. Sympathisant des idées politiques<br />
de l’Empereur, Schimmelpenninck<br />
doit occuper son poste tant que dure la<br />
guerre contre l’Angleterre, et rester en<br />
poste pour cinq ans encore après une<br />
signature de paix. Mais à Paris, dans<br />
les salons et les cercles diplomatiques<br />
on sait que Schimmelpenninck n’est<br />
« destiné qu’à faire la planche pour un<br />
prince français, il n’est qu’un doge de<br />
six mois. »<br />
Le 6 février 1806, le ministre des<br />
Affaires étrangères, Talleyrand, écrit<br />
au grand-pensionnaire que l’Empereur<br />
veut remédier à l’instabilité qui règne en<br />
Hollande. Un mois plus tard, il annonce<br />
déjà au même son intention d’y établir<br />
une monarchie héréditaire. Et Napoléon,<br />
de son côté, écrit le 8 mars à son frère<br />
Joseph « Il est possible que je fisse Louis<br />
roi de Hollande ».<br />
Sa décision prise, les autorités<br />
hollandaises durent prier l’Empereur<br />
de bien vouloir leur accorder son frère<br />
Louis comme roi ! Par un message à<br />
Leurs Hautes Puissances, représentant<br />
la République Batave, lu en séance<br />
extraordinaire du 5 juin 1806, le Grand-<br />
Pensionnaire annonce qu’il abandonne<br />
le pouvoir qu’il confie provisoirement<br />
Entrée du roi Louis à Amsterdam le 20 avril 1808.<br />
Atlas Van Stolk, Rotterdam<br />
30
au président du Corps Législatif, le<br />
Baron C. de Vos van Steenwijk tot den<br />
Hogenhof.<br />
Louis Bonaparte, troisième frère de<br />
Napoléon Bonaparte, est né à Ajaccio<br />
(Corse) le 2 septembre 1778 et entre<br />
en 1793 dans la vie active, à peine au<br />
sortir de l’enfance. Poussé par Napoléon<br />
dans une carrière militaire, cette<br />
perspective parait sans attrait pour Louis<br />
qui aspire déjà à une vie paisible. Son<br />
caractère, rempli de contrastes, invite<br />
Napoléon à dire que Louis « a de l’esprit,<br />
il n’est point méchant, mais avec ces<br />
qualités un homme peut faire bien des<br />
sottises et causer bien du mal. »<br />
Le 10 juin 1806, le vice-amiral<br />
VerHuell 3 instruit les autorités du traité<br />
conclu le 24 mai à Paris avec l’Empereur<br />
et dont le premier article stipule que<br />
Napoléon déclare, pour lui, ses héritiers<br />
et ses successeurs, garantir à jamais les<br />
lois constitutionnelles et l’indépendance<br />
de la Hollande, ainsi que l’intégrité de<br />
son territoire et de celui de ses colonies<br />
et ses libertés politiques, civiles et<br />
religieuses.<br />
Le second article stipule que<br />
l’Empereur répondant au désir exprimé<br />
par la représentation nationale autorise<br />
son frère, le Prince Louis Napoléon, à<br />
accepter la couronne de la Hollande<br />
pour lui et ses successeurs mâles ; les<br />
couronnes de France et de la Hollande ne<br />
seront jamais réunies sur la même tête.<br />
Ce traité n’est qu’un leurre, car<br />
l’Empereur entend de faire de Louis<br />
une sorte de roi-préfet qui « règne » en<br />
fonction des volontés de son frère et<br />
dans les intérêts de la France. Louis, de<br />
son côté, veut, lui, être un roi-souverain.<br />
Mais qui est ce Louis ? En fait il est<br />
avant tout un malade. À l’âge de 20 ans<br />
environ, il attrape une infection que<br />
certains disent même vénérienne. Et<br />
même s’il connaît des moments où sa<br />
santé s’améliore, il ne sera jamais guéri.<br />
Ces maux, ces douleurs le mettent<br />
souvent de mauvaise humeur. Il joue<br />
souvent son propre médecin, cherchant<br />
des remèdes dans les traitements les plus<br />
bizarres.<br />
Et c’est ce même jeune prince que<br />
l’Impératrice Joséphine a poussé dans<br />
les bras de sa fi lle Hortense, afi n de<br />
s’attacher plus encore à Napoléon. Et<br />
l’Empereur, lui, espère que Louis peut lui<br />
donner un successeur. Mais le mariage se<br />
montre très vite un désastre.<br />
Pourtant, avec l’Empire, la dignité<br />
de Louis grandi. Il devient, pour citer<br />
les plus importants : Altesse Impériale,<br />
Grand Connétable, colonel-général des<br />
Carabiniers, Sénateur et puis roi de<br />
Hollande.<br />
Le 11 juin au matin, des unités de la<br />
Garde hollandaise à pied et à cheval<br />
partent pour Breda afin de recevoir et<br />
d’escorter le nouveau Roi, lequel du reste<br />
se fait précéder par le général Michaud 4<br />
avec un Corps de troupes françaises 5 .<br />
Le 15 juin, l’ambassadeur français<br />
en Hollande, le général Dupont-<br />
Chaumont 6 écrit au Duc de Cadore<br />
« L’esprit public, un peu étonné d’abord<br />
de la promptitude des événements,<br />
commence à revenir, la population<br />
vit en bonne intelligence avec le<br />
soldat français. Une garde d’honneur<br />
s’organise pour recevoir Leurs<br />
Majestés. »<br />
Deux jours plus tard, le Roi, la Reine<br />
et leurs deux fils venant d’Anvers,<br />
Blason du roi, montrant l’aigle impérial<br />
et le lion hollandais, le collier de la<br />
Légion d’honneur ainsi que celui de<br />
l’Ordre Royal de l’Union et, au-dessus,<br />
la devise « Eendracht maakt macht »<br />
(l’Union fait la force).<br />
Atlas Van Stolk, Rotterdam<br />
franchissent la frontière du royaume<br />
près du village de Groot-Zundert, où<br />
ils sont complimentés par les autorités.<br />
Un détachement de la Garde à cheval<br />
s’y trouve, et les régiments de cavalerie<br />
sont échelonnés le long de la route par<br />
Breda et Moerdijk, où la famille royale<br />
s’embarque sur un yacht qui la conduit<br />
à Rotterdam. Elle arrive le 18 au soir<br />
par Voorburg en contournant La Haye,<br />
où le canon, le carillon et les musiques<br />
se font entendre. Une députation de<br />
la magistrature de La Haye, placée à<br />
l’entrée du Bois près de l’allée de Nieuw-<br />
Oostindië présente le vin d’honneur.<br />
Le général Collaert 7 a pris position à ce<br />
carrefour, avec la cavalerie de la Garde et<br />
les premiers régiments de Dragons et de<br />
Hussards de la Ligne, qui tous escortent<br />
ensuite la famille royale jusqu’au palais<br />
par les allées illuminées du Bois.<br />
Elle y fut reçue au pied du grand<br />
31
Le petit Louis, lapin de Hollande<br />
et le 20 e de Chasseurs à cheval.<br />
6 - Pierre Antoine Dupont-Chaumont (1759-<br />
1838), frère du général Dupont, vaincu à<br />
Bailén en 1808 ; ministre plénipotentiaire<br />
auprès du grand-pensionnaire Rutger Jan<br />
Schimmelpenninck, puis auprès du roi<br />
Louis. En 1806, il accompagne le roi en<br />
Prusse. Inspecteur général de l’Infanterie<br />
en mars 1809, il reçoit le commandement<br />
du camp de Boulogne, passe en Italie et sera<br />
retraité le 25 juin 1812.<br />
7 - Jean Antoine Collaert (1761-1816), entre au<br />
service de l’Autriche en 1778 ; passe au service<br />
des Provinces Unies en 1786 ; lieutenantcolonel<br />
en 1795 ; colonel en 1803 puis majorgénéral<br />
en 1806. Colonel-général de la Garde<br />
royale et Grand Officier de la Couronne en<br />
mai 1807 ; il passe au service de la France et<br />
sert en Illyrie et l’Italie, puis en Allemagne<br />
(1813). Démissionne en 1814 et entre au<br />
service des Pays-Bas. Blessé à Waterloo.<br />
8 - André Ernest Modeste Grétry (1741-1813),<br />
compositeur liégeois puis français.<br />
9 - Armand Louis de Broc (1772-1810), colonel et<br />
adjudant du prince Louis en 1804 ; généralmajor<br />
au service de la Hollande en juin 1806 ;<br />
Grand Maréchal du Palais et Grand Officier<br />
de la Couronne de juillet 1806 à février 1809 ;<br />
sert en Espagne et passe au service de la<br />
France en octobre 1808 ; général de brigade<br />
en 1809 ; sert en Italie comme commandant<br />
de la 2 e Division de Dragons.<br />
10 - Auguste Jean Gabriel de Caulaincourt (1777-<br />
1812), frère cadet d’Armand Augustin Louis<br />
de Caulaincourt Grand écuyer de l’Empereur.<br />
Colonel du 19 e Dragons, il devient aide de<br />
camp du prince Louis Bonaparte et sert à la<br />
tête de son régiment pendant les campagnes<br />
de 1805 et 1806. Il suit le roi Louis comme<br />
aide de camp et fut nommé général de brigade<br />
en août 1806. Rentré au service de France, il<br />
sert en Espagne pour rentrer en France où il<br />
sera nommé Gouverneur des Pages. Nommé<br />
commandant du grand quartier général en<br />
juillet 1812, il sert en Russie où il sera tué à la<br />
bataille de la Moskowa.<br />
11 - Jean François Xavier Noguès (1769-1808),<br />
premier adjudant du prince Louis en 1804 ;<br />
général de division en 1805 ; entre au<br />
service de la Hollande en 1806 ; adjudantgénéral<br />
du roi et gouverneur de La Haye et<br />
du Palais en juin 1806 ; chef d’état-major de<br />
l’Armée du Nord en juin 1806 ; prend congé<br />
de convalescence et retourne en France en<br />
juillet 1806. Il ne retourne plus en Hollande.<br />
12 - Voir : Soldats Napoléoniens N°21<br />
13 - Le roi Louis, avant de partir pour Paris, laisse<br />
son fils aîné au pavillon d’Haarlem et a confié<br />
la Régence provisoire aux ministres. Le<br />
13 juillet, arrive le général Lauriston, aide de<br />
camp de l’Empereur, qui après de nombreuses<br />
conférences au château du Pavillon, repart à<br />
la nuit tombée, emmenant dans une voiture<br />
de poste le Prince royal à Amsterdam, puis à<br />
Paris, conformément aux ordres de l’Empereur<br />
en date du 10.<br />
14 - Adrien François de Bruno (1771-1861), chef<br />
d’escadron au 12 e de Hussards en 1801, puis<br />
major au 10 e Chasseurs à cheval. Il sera<br />
nommé aide de camp du roi Louis, puis Grand<br />
écuyer. Après l’abdication, il repasse dans les<br />
cadres de l’armée française comme général<br />
de brigade.<br />
15 - Alexander Wilhelmus Josephus Joannes van<br />
Hugenpoth tot Aert (1780-1859), catholique,<br />
fut nommé ministre de la Justice et de la<br />
Police parce que le roi voulait avoir un<br />
ministre catholique dans son gouvernement.<br />
À l’âge de 29 ans, il fut le plus jeune ministre<br />
hollandais. Il gardera sa fonction jusqu’au<br />
1 er janvier 1811.<br />
16 - Jacob Anthony Twent, seigneur de<br />
Kortenbosch (1776-1815), intendant des<br />
domaines royaux en 1806 ; intendantgénéral<br />
des domaines de la Couronne<br />
en 1807 ; trésorier-général de la Couronne<br />
en novembre 1807 ; intendant-général de la<br />
Maison royale en décembre 1808.<br />
17 - Etienne Jacques Travers, baron de Jever (1765-<br />
1827), officier de cavalerie dans l’armée<br />
française. Il passe comme chef d’escadron<br />
dans l’armée hollandaise en juin 1806 ;<br />
colonel du régiment Garde Cavalerie en<br />
septembre 1806 ; nommé général-major et<br />
aide de camp du roi en mars 1808 ; colonelgénéral<br />
de la cavalerie et gendarmerie<br />
ainsi que grand officier de la Couronne en<br />
août 1808 ; premier aide de camp du roi de<br />
août 1808 jusqu’en juin 1809 ; naturalisé<br />
en mars 1809, il devient commandant de la<br />
défense des côtes en août 1809. Retourne<br />
comme général de brigade au service de la<br />
France en 1810.<br />
18 - Willem Otto Bloys van Treslong (1765-<br />
1837), entre au service de la marine en 1780.<br />
Gouverneur de Surinam de 1801 à 1804 ;<br />
premier aide de camp du roi, grand officier<br />
de la Couronne et Grand Maréchal du Palais<br />
de 1808 à 1810. Fidèle au roi, il refuse d’entrer<br />
en service dans la marine française.<br />
19 - Carel Adam van Bylandt (1773-1857), officier<br />
d’ordonnance du roi, 1806 ; écuyer du roi,<br />
novembre 1806 ; lieutenant-colonel au<br />
2 e Hussards en juin 1808 ; passe avec son<br />
grade dans l’état-major général et sera nommé<br />
aide de camp du roi en août 1809 ; colonel<br />
en septembre 1809 ; nommé adjudantcommandant<br />
en 1812.<br />
20 - Cornelis Felix van Maanen (1769-1846),<br />
ministre de la Justice et de la Police de<br />
décembre 1807 jusqu’en avril 1809 ; premier<br />
président de la Cour impériale à La Haye en<br />
octobre 1810.<br />
21 - Isaac Jan Alexander Gogel (1765-1821),<br />
secrétaire d’état en 1805 ; ministre des<br />
Finances de 1806 à 1809 ; intendant-général<br />
des finances et de la trésorerie de Hollande<br />
en 1810 ; membre du Conseil d’état en 1810.<br />
22 - Les départements des Bouches-du-Rhin<br />
(Bois-le-Duc) et des Bouches-de-l’Escaut<br />
(Middelbourg) furent créé en avril et mai 1810<br />
après l’annexion des territoires du Brabant et<br />
Gueldre et de Zélande.<br />
23 - À Paris, la Hollande sera représentée par<br />
six sénateurs, six députés au Conseil d’Etat,<br />
vingt-cinq députés au Corps législatif et<br />
deux juges à la Cour de cassation.<br />
Bibliographie<br />
Catalogue, Exposition, Lodewijk<br />
Napoleon en het Koninkrijk Holland,<br />
Rijksmuseum, Amsterdam, 1959. de<br />
Caumont-Laforce : Lebrun lieutenantgénéral<br />
en Hollande (juillet-septembre<br />
1810). 15 mars 1907.<br />
Du Casse, A., Les Rois frères de<br />
Napoléon I er , 1883.<br />
Homan, Gerlof D., Nederland in<br />
de Napoleontische Tijd 1795-1815,<br />
Fibula-Van Dishoeck, Haarlem, 1978.<br />
Kikkert, J.G., Louis Bonaparte –<br />
1778-1846, AD. Donker, Rotterdam,<br />
1981.<br />
Lebrun, Anne-Charles (duc de<br />
Plaisance, Gal), Une statue du<br />
duc de Plaisance sera inaugurée le<br />
10 octobre 1847 à Coutances... [Notice<br />
biographique sur Charles-François<br />
Lebrun, écrite à cette occasion par son<br />
fi ls. 1847.<br />
Legrand, Louis Désiré, La révolution<br />
française en Hollande : la République<br />
batave, 1894.<br />
Presser, J. Prof. Dr., Napoleon,<br />
Elsevier, Amsterdam/Brussel. 1974.<br />
Rocquain, Félix, Napoléon I er et le Roi<br />
Louis, Firmin-Didot, Paris. 1875.<br />
Schutte, Otto Mr., De Orde van de<br />
Unie, De Walburg Pers, Zutphen, 1985.<br />
40
La mort de la reine<br />
Louise de Prusse<br />
(19 juillet 1810)<br />
Michel KERAUTRET<br />
Au cœur de l’été 1810, la nouvelle de la mort inattendue<br />
de la reine Louise, à peine âgée de 34 ans, frappa de stupeur<br />
sa famille et son peuple, mais aussi l’Europe entière.<br />
Cette tragédie allait faire de l’ennemie de Napoléon,<br />
enlevée en pleine jeunesse, une sorte d’icône.<br />
Napoléon reçoit la reine Louise de Prusse à Tilsitt le 6 juillet 1807.<br />
Huile sur toile de Jean-Charles Tardieu (1765-1830), Collection Musées des Châteaux<br />
de Versailles et de Trianon, © RMN / Gérard Blot - Jean Schormans.<br />
41
La mort de la reine Louise de Prusse<br />
« La reine des cœurs »<br />
Louise, née le 14 mars 1776 à<br />
Hanovre, était issue d’une de ces familles<br />
souveraines allemandes qui tenaient<br />
le haut du pavé dans le Saint Empire<br />
romain germanique, s’alliaient entre<br />
elles et conservaient un sentiment très<br />
fort de leur supériorité sociale. Elles<br />
étaient réputées régnantes, de sorte que<br />
sa naissance plaçait Louise au niveau<br />
de tous les souverains d’Europe et lui<br />
donnait le droit de faire un mariage<br />
royal. Dans la pratique, néanmoins, un<br />
tel destin était peu probable, car elle<br />
était issue de deux branches cadettes de<br />
deux lignées de second rang. Son père,<br />
le prince Charles de Mecklembourg-<br />
Strelitz, n’était pas destiné à régner,<br />
et avait pris du service auprès du roi<br />
d’Angleterre, électeur de Hanovre.<br />
Seule la mort de son frère aîné fit de<br />
lui, en 1794, un duc souverain. Quant<br />
à la mère de Louise, Frédérique de<br />
Hesse-Darmstadt, nièce du landgrave<br />
Louis IX, elle décéda en 1782, laissant<br />
l’enfant orpheline à l’âge de 6 ans, avec<br />
ses sœurs Charlotte (née en 1769),<br />
Thérèse (1773) et Frédérique (1778), et<br />
le petit Georges (1779), futur grand-duc<br />
de Mecklembourg-Strelitz. Les enfants<br />
furent élevés d’abord par une tante à<br />
Hanovre, puis à la mort de celle-ci par<br />
leur grand-mère maternelle Marie-Louise<br />
(dite « princesse Georges », du nom<br />
de feu son mari). Louise partagea<br />
dès lors son temps entre la ville de<br />
Darmstadt, d’autant plus provinciale<br />
que le landgrave n’y résidait pas, et<br />
divers châteaux des environs. Enfance et<br />
adolescence joyeuses, éducation éclairée<br />
sous la direction d’une gouvernante<br />
originaire de Neuchâtel et adepte de<br />
Rousseau, Salomé de Gélieu. La princesse<br />
apprit le français, le chant, le clavecin et<br />
la danse, ainsi bien sûr que la religion<br />
protestante.<br />
Les petits duchés de Mecklembourg<br />
occupaient au nord de l’Allemagne<br />
une position médiane entre deux<br />
grands États, l’électorat de Hanovre,<br />
propriété du roi Georges III d’Angleterre,<br />
et le royaume de Prusse, mais ils<br />
entretenaient des liens privilégiés<br />
avec Londres. C’est peut-être pour<br />
contrebalancer cette liaison que le roi de<br />
Prusse Frédéric-Guillaume II rechercha<br />
leur alliance lorsqu’il voulut marier ses<br />
fils, le prince héritier et son frère Louis.<br />
En tout cas, l’on se mit d’accord en avril<br />
1793, tandis que les princes et leur père<br />
séjournaient à Francfort lors de la guerre<br />
contre les révolutionnaires français.<br />
Les jeunes gens furent mis en présence<br />
lors d’un bal, ils ne se déplurent pas.<br />
L’aîné, âgé de 23 ans, choisit Louise, le<br />
cadet Frédérique. Néanmoins, en dépit<br />
de la légende, cela n’eut rien d’un coup<br />
de foudre et l’amour resta toujours<br />
raisonnable, même si des liens étroits<br />
se créèrent peu à peu entre le futur roi<br />
et son épouse. Le mariage fut célébré à<br />
Berlin le 24 décembre 1793. Quatre ans<br />
plus tard, Louise était reine de Prusse<br />
aux côtés de Frédéric-Guillaume III.<br />
Ses premières années à Berlin, comme<br />
épouse du Kronprinz puis comme<br />
reine, se caractérisent par un mélange<br />
de légèreté et d’application. La jeune<br />
provinciale s’étourdit des plaisirs que<br />
lui prodigue la capitale, elle danse<br />
des nuits entières, y compris la valse<br />
encore un peu choquante à l’époque,<br />
se laisse courtiser par son beau cousin<br />
Louis-Ferdinand, pose un peu dévêtue<br />
pour le sculpteur Schadow, s’irrite des<br />
réprimandes de la grande-maîtresse,<br />
M me de Voss. Mais elle se donne aussi<br />
beaucoup de peine pour apprendre<br />
les usages de cette cour étrangère et<br />
donne à la Prusse les héritiers qu’elle<br />
attend. Trois naissances se succèdent<br />
rapidement, Frédéric-Guillaume (le futur<br />
roi Frédéric-Guillaume IV) en 1795,<br />
Guillaume (le futur empereur) en 1797,<br />
Charlotte en 1798. Louise adore ses<br />
trois aînés, son « trèfle trilobé », et veille<br />
de près à leur éducation.<br />
Enfi n, Louise, en plein accord avec<br />
son mari, crée un nouveau style : le<br />
couple vit de façon assez simple, tant à<br />
la ville qu’à la campagne, l’étiquette est<br />
réduite au minimum. L’abbé Georgel,<br />
qui passe alors par Berlin, ne sait s’il<br />
doit admirer ou s’offusquer : « Pour<br />
s’éviter l’ennui et la dépense d’une<br />
représentation digne de la majesté<br />
du trône, le petit-neveu du grand<br />
Frédéric a quitté à Berlin le palais de<br />
ses prédécesseurs pour se loger avec la<br />
reine et ses enfants dans une maison<br />
bourgeoise, sur la rue qui conduit à<br />
la belle promenade des tilleuls. Il y vit<br />
bourgeoisement, sans aucune pompe.<br />
Deux sentinelles, placées au-dessus<br />
d’une rampe double, composent toute<br />
sa garde. Quand il paraît, ou à pied ou<br />
à cheval ou en voiture, dans les rues de<br />
Berlin, il n’a ni suite ni gardes : un seul<br />
valet de pied ou un seul palefrenier<br />
l’accompagne. J’ai vu le roi passer<br />
dans les rues sans qu’on s’arrêtât par<br />
respect ; je l’ai vu sortant de la comédie,<br />
donnant la main à la reine pour la<br />
conduire à son carrosse, sans qu’on se<br />
dérangeât pour les laisser passer : le roi<br />
remonta ensuite à cheval suivi de son<br />
palefrenier, sans qu’aucun de la foule<br />
ôtât son chapeau ». L’été, on réside non<br />
à Potsdam, trop pompeux, mais le plus<br />
souvent dans la maison de Paretz, ou<br />
dans la fausse ruine de l’île des Paons :<br />
on y mène une vie de seigneurs de<br />
villages, entre l’idylle et l’agronomie.<br />
Quant à l’intérieur, il est tout aussi<br />
simple, quelques pièces à vivre, pas<br />
de cour, un service de table frugal, des<br />
loisirs ordinaires – on se couche tôt.<br />
« Pas de luxe », s’est donné comme<br />
devise le roi, soucieux de rompre avec la<br />
prodigalité paternelle et de restaurer les<br />
finances publiques. Louise s’habille avec<br />
élégance, mais sobrement. La mousseline<br />
légère sied bien à sa taille, comme<br />
l’écharpe ou le ruban dont elle pare son<br />
long cou, mais elle ne se poudre ni ne<br />
se farde, et doit borner ses dépenses de<br />
poche aux mille thalers mensuels qui lui<br />
sont alloués. Il n’est d’ailleurs pas rare de<br />
la croiser dans les rues de Berlin avec ses<br />
enfants, faisant elle-même ses emplettes.<br />
De là à parler d’un ménage bourgeois,<br />
comme on l’a fait parfois, il y a certes<br />
encore loin. Mais Louise plaît, sa beauté<br />
et son aménité lui valent le surnom de<br />
« reine des cœurs », forgé par August<br />
Wilhelm Schlegel. « Le charme de<br />
son céleste visage, écrit M me Vigée-<br />
Lebrun, qui l’a rencontrée, exprimait<br />
la bienveillance, la bonté ; les traits<br />
étaient réguliers et fins ; la beauté<br />
de sa taille, de son cou, de ses bras,<br />
l’éblouissante fraîcheur de son teint,<br />
tout enfin surpassait en elle ce qu’on<br />
peut imaginer de plus ravissant ».<br />
Philippe de Ségur, qui vint en mission à<br />
Berlin, est lui aussi sous le charme, ainsi<br />
qu’il le rapporte dans ses Mémoires : « Il<br />
me semble voir encore cette princesse,<br />
à demi couchée sur un riche sofa ; un<br />
trépied d’or était près d’elle ; un voile de<br />
pourpre oriental recouvrait légèrement<br />
Portrait de la Reine Louise de Prusse.<br />
Pastel par Elisabeth-Louise Vigée-Lebrun<br />
(1755-1842), début 19 e , Collection Privée,<br />
© Christie’s Images / Bridgeman<br />
Giraudon.<br />
42
et laissait apercevoir sa taille élégante<br />
et gracieuse. Il y avait dans le son de sa<br />
voix une douceur si harmonieuse, dans<br />
ses paroles une séduction si aimable<br />
et si touchante, dans son attitude tant<br />
de charme et de majesté que, interdit<br />
pendant quelques instants, je me crus<br />
en présence de l’une de ces apparitions<br />
dont les récits fabuleux des temps<br />
antiques nous ont retracé l’image<br />
enchanteresse ».<br />
La vie régulière des souverains<br />
convient à l’opinion, elle paraît<br />
l’expression idéale du nouvel âge d’or<br />
où s’alanguit la Prusse, demeurée neutre<br />
depuis le traité de paix de Bâle (1795) :<br />
îlot de paix et asile des muses dans une<br />
Europe déchirée, le royaume prospère,<br />
et il s’agrandit même par la grâce de<br />
Bonaparte, lors du Recès de 1803. Ce<br />
tableau va changer en quelques années,<br />
et la reine Louise y aura sa part.<br />
L’ennemie de Napoléon<br />
Louise s’était longtemps tenue à<br />
distance de la politique, et nul n’aurait<br />
d’ailleurs attendu qu’elle s’en mêlât. Le<br />
futur premier ministre Stein ne voyait<br />
en elle qu’une femme superficielle et<br />
dépourvue de jugement. Mais Frédéric-<br />
Guillaume, qui était d’un naturel<br />
hésitant, prit l’habitude de lui faire<br />
confidence de ses tergiversations, puis<br />
de la consulter régulièrement. Il ne fait<br />
pas de doute que son influence contribua<br />
à faire pencher la balance du côté de la<br />
guerre contre la France. On a souvent<br />
attribué l’animosité anti-française de<br />
la reine à l’influence de l’empereur<br />
Alexandre de Russie. Il est vrai que, lors<br />
de la rencontre qui eut lieu à Memel, en<br />
juin 1802, entre le tsar et le couple royal<br />
de Prusse, une vive sympathie était née<br />
entre Louise et Alexandre, et qu’une<br />
correspondance chaleureuse s’en était<br />
suivie. Mais des motifs plus puissants ont<br />
évidemment joué leur rôle.<br />
La tension montait peu à peu,<br />
depuis 1803, entre la France et la Prusse.<br />
Il y avait eu l’occupation française du<br />
Hanovre, aux confins des États prussiens,<br />
l’enlèvement de l’agent anglais Rumbold<br />
à Hambourg, en 1804. Même si Berlin<br />
reconnut sans difficulté la proclamation<br />
de l’empire, on cherchait des garanties<br />
du côté de la Russie, un accord de<br />
juin 1804 stipulant même une action<br />
commune contre Napoléon s’il dépassait<br />
la ligne du Weser. La Prusse résista<br />
cependant, au cours de l’été 1805, aux<br />
sollicitations des instigateurs de la<br />
troisième coalition, Russie, Angleterre<br />
et Autriche. La guerre commença sans<br />
elle en septembre. Alexandre, désireux<br />
d’obtenir un droit de passage pour<br />
ses troupes, en vint un instant aux<br />
menaces. Mais l’incident que suscita<br />
bientôt à Ansbach la violation d’un<br />
territoire prussien par des éléments<br />
du corps de Bernadotte, délivra le roi<br />
de ses scrupules. Louise semble avoir<br />
montré à cette occasion une indignation<br />
particulière.<br />
L’empereur de Russie s’invita alors<br />
à Berlin, et se fit assez persuasif pour<br />
entraîner le roi de Prusse dans la<br />
coalition, virtuellement du moins. Leur<br />
entente se trouva scellée lors d’une<br />
scène restée célèbre, celle du serment<br />
nocturne prêté par Alexandre et<br />
Frédéric-Guillaume, en présence de la<br />
reine, sur la tombe de Frédéric-le-Grand,<br />
dans la crypte de l’église de la Garnison<br />
de Potsdam (5 novembre). Cet épisode,<br />
aussitôt diffusé par l’iconographie, ne<br />
suffit pas néanmoins à précipiter les<br />
armements de la Prusse. Le ministre<br />
Haugwitz porta certes un ultimatum à<br />
Napoléon, mais ne l’ayant trouvé qu’à la<br />
veille d’Austerlitz, il différa jusqu’à l’issue<br />
de la bataille… et revint à Berlin avec un<br />
traité d’alliance.<br />
L’animosité ne cessa de monter en<br />
Prusse au cours des mois suivants, et la<br />
reine Louise devint très ouvertement<br />
la championne du parti de la guerre. Il<br />
est vrai que Napoléon, exaspéré du jeu<br />
trouble de la Prusse, ne prenait plus de<br />
ménagements avec elle. Non seulement<br />
il lui enlevait Clèves, Neuchâtel et<br />
Ansbach en échange du Hanovre, mais<br />
il obligeait la Prusse à rompre avec<br />
Londres, approuvait en sous-main les<br />
empiètements de Murat en Westphalie,<br />
créait en juillet la Confédération du<br />
Rhin, puis négociait avec l’Angleterre<br />
sur le Hanovre. C’est alors que l’on<br />
vit la reine Louise prendre l’uniforme<br />
des dragons d’Ansbach et soutenir au<br />
conseil, où elle entrait désormais, la<br />
position pro-russe. Selon Gentz, elle<br />
discutait et conseillait avec intelligence,<br />
précision et fermeté, mais aussi avec<br />
une « profondeur de sentiment » toute<br />
féminine.<br />
Lorsque l’on en vint en septembre<br />
1806 à la rupture ouverte, le roi parut<br />
fataliste, mais la reine était confiante,<br />
heureuse de livrer ce combat aux côtés<br />
de son ami Alexandre : « Je n’ai pas<br />
peur, lui écrit-elle, car il est impossible<br />
de voir une armée animée d’un<br />
meilleur zèle que la nôtre. Je crois en<br />
vous comme en Dieu, et mon amitié<br />
pour vous ne pourra finir qu’avec<br />
mon bonheur ». Le 21 septembre, elle<br />
partit pour la guerre avec son époux,<br />
et demeura à ses côtés. Les Français se<br />
rapprochant dangereusement, le duc de<br />
Brunswick, général en chef, obtint enfin<br />
son départ le 13 octobre. Il était temps :<br />
le lendemain vit la déroute complète<br />
des deux armées prussiennes à Iéna<br />
et Auerstaedt, et le début d’une fuite<br />
éperdue. Louise parvient à s’échapper<br />
vers le nord, sous la protection de<br />
quelques cuirassiers. Elle apprend à<br />
Berlin, quatre jours plus tard, que tout<br />
est perdu, et fuit jusqu’à l’Oder puis la<br />
Vistule : les places de Schwedt, Stettin,<br />
Küstrin, Graudenz n’offrent que des<br />
pauses éphémères. Elle a tout de même<br />
retrouvé son époux, mais il est effondré,<br />
et elle se sent coupable. Et voilà qu’elle<br />
découvre les sarcasmes et les « infâmes<br />
mensonges » dont Napoléon l’accable<br />
dans ses bulletins. « Il semble voir<br />
Armide, dans son égarement, mettant<br />
le feu à son propre palais », écrivait-il le<br />
8 octobre. Puis le 17 : « C’est une femme<br />
d’une jolie figure, mais de peu d’esprit,<br />
incapable de présager les conséquences<br />
de ce qu’elle faisait. Il faut aujourd’hui,<br />
au lieu de l’accuser, la plaindre, car<br />
elle doit avoir bien des remords des<br />
maux qu’elle a faits à sa patrie ».<br />
Pire encore, dans le bulletin du 27,<br />
daté de Berlin : « On a trouvé dans<br />
l’appartement qu’occupait la reine, à<br />
Potsdam, le portrait de l’empereur de<br />
Russie. On a trouvé à Charlottenbourg<br />
sa correspondance avec le roi et des<br />
mémoires rédigés par des écrivains<br />
anglais. Ces pièces démontreraient,<br />
si cela était besoin, combien sont<br />
malheureux les princes qui laissent<br />
prendre aux femmes de l’influence<br />
sur les affaires politiques. Les notes,<br />
les rapports, les papiers d’Etat étaient<br />
musqués et se trouvaient mêlés avec<br />
des chiffons et d’autres objets de toilette<br />
de la reine ».<br />
Le 10 décembre, la reine et sa famille<br />
arrivent épuisés à Königsberg, où ils<br />
43
La visite Impériale<br />
à Anvers en 1810<br />
Ronald PAWLY<br />
«<br />
N<br />
ous sommes informés que<br />
Leurs Majestés Impériales<br />
et Royales honoreront notre<br />
ville de leur présence et que le jour de<br />
leur arrivée est fixé au 29 courant.<br />
Il y a quelques années que nous<br />
avons eu le bonheur d’avoir le<br />
Grand Napoléon en nos murs et de<br />
lui démontrer notre amour et notre<br />
reconnaissance à son égard.<br />
Dans les circonstances présentes,<br />
il va de soi que les manifestations<br />
que nous allons témoigner envers ces<br />
augustes personnages doivent dépasser<br />
en splendeur celles de l’An XI.<br />
Leurs Majestés seront escortées<br />
d’une assez grande suite qui ne pourra<br />
être logée qu’uniquement chez les<br />
habitants.<br />
Néanmoins, le Maire de la Ville<br />
d’Anvers a confiance dans le dévouement<br />
et l’hospitalité de ses concitoyens. »<br />
Ainsi, le Maire d’Anvers, Jean-Etienne<br />
Werbrouck, annonce dans le Antwerpsche<br />
Gazet du 26 avril 1810, la visite prochaine<br />
L'Empereur et l'Impératrice visitant l'escadre mouillée dans l'Escaut devant Anvers<br />
et montant à bord du vaisseau amiral « le Charlemagne », le 1 er mai 1810.<br />
Par Van Brée Matthieu Ignace (1773-1839). RMN.<br />
46
de Napoléon et Marie-Louise aux<br />
anversois.<br />
Depuis la première visite en l’An XI, le<br />
monde politique et le visage de l’Europe<br />
ont bien changé. En ces 7 ans, le Premier<br />
Consul est devenu Empereur des<br />
Français, Roi d’Italie, Protecteur de la<br />
Confédération du Rhin et Médiateur de<br />
la Confédération Suisse ; des frontières<br />
ont été redessinées, des royaumes créés,<br />
d’autres ont disparu… et la ville dont<br />
Bonaparte a dit « j’ai cru me trouver<br />
ce matin dans une ville d’Afrique »<br />
est devenue le plus vaste chantier de<br />
l’Empire.<br />
Après la campagne de Walcheren<br />
(1809), Napoléon s’occupe encore<br />
plus de son « pistolet braqué sur le<br />
cœur de l'Angleterre ». Des bassins<br />
sont creusés, les quais sont rectifiés,<br />
des cales érigées et une flotte créée, les<br />
fortifications modernisées et agrandies et<br />
une nouvelle ville sur la rive gauche est<br />
prévue. Même pour les anversois la ville<br />
devient méconnaissable.<br />
Certes, le décret pour creuser<br />
les bassins fut signé en 1803, mais<br />
on ne commence avec les travaux<br />
qu’en 1807 ! Avec les installations<br />
maritimes de Flessingue détruites par<br />
les Anglais en 1809, la flotte a besoin<br />
de bassins pour s’armer, doubler les<br />
vaisseaux et pour y hiverner. On est<br />
en 1810 et le premier bassin n’est<br />
toujours pas prêt pour recevoir les<br />
frégates de l’escadre. Maintenant, marié<br />
en seconde noce à Marie-Louise, fi lle<br />
de l’Empereur d’Autriche, Napoléon va<br />
inspecter en personne les progrès de<br />
tous ces travaux.<br />
Les souverains ne voyagent pas léger,<br />
car la cour suit. Avec eux, le Prince de<br />
Neuchâtel et de Wagram, le Ministre de<br />
la Marine Decrès, le Duc de Bassano,<br />
le colonel général de la Garde le Duc<br />
d’Istrie, le Grand maréchal du Palais<br />
Duroc, le Duc de Reggio, le Ministre<br />
de l’Intérieur et le général Guyot,<br />
responsable pour les escortes et la<br />
sécurité des souverains. 1<br />
Même les princes Metternich et<br />
Schwartzenberg sont présents comme<br />
envoyés extraordinaires, ainsi que son<br />
frère le roi de Westphalie avec son<br />
épouse Catherine, fille du roi de Bavière<br />
qui rejoignent l’Empereur à Bruxelles.<br />
Et puis il y a Eugène, vice roi d’Italie<br />
qui fut plus ou moins convoqué par<br />
Napoléon en écrivant : « Mon fils, je<br />
désirerais que vous vinssiez à Anvers<br />
de votre personne pour voir l’escadre<br />
et les localités, qu’il est bon à votre<br />
âge de connaître. Je ne sais pas si vous<br />
avez vu Boulogne depuis que j’y ai fait<br />
construire une flottille. Je compte être à<br />
Anvers le 1 er mai. Tâchez d’y être du 3<br />
au 4. Cependant, comme ce voyage<br />
n’est que pour votre instruction, faites<br />
là-dessus ce qui vous conviendra. »<br />
Le 27 avril 1810, à 7 heures du<br />
matin, Napoléon quitte Compiègne<br />
avec l’Impératrice pour se rendre à<br />
Saint-Quentin où ils arrivent à 13 h. Là,<br />
l’Empereur visite le port du canal, des<br />
fabriques et donne des audiences. Le<br />
soir, le couple impérial assiste à un bal<br />
donné en son honneur.<br />
De Caters, commandant de la Garde<br />
d'honneur d'Anvers 1811.<br />
Par van Bree. RMN.<br />
Le 28, à 8 heures du matin, Napoléon<br />
visite le tunnel du canal du Tronquay ;<br />
déjeune à Belticour et visite le canal<br />
souterrain de Réqueval. À 15 heures,<br />
il entre à Cambrai, en gondole. Le<br />
lendemain après la messe, on part pour<br />
Valenciennes où l'on s’arrête. Pas pour<br />
longtemps car à 7 heures du soir on<br />
arrive par la porte d’Anderlecht à<br />
Bruxelles où les souverains seront logés<br />
au palais de Laeken.<br />
À Anvers, une fois mises au courant<br />
de la visite impériale, les autorités civiles<br />
et militaires prennent leurs dispositions<br />
et poussent les travaux. Les quais, les<br />
bassins, les fortifications... rien est oublié<br />
et heureusement on a fait son devoir car<br />
le 31 octobre 1809, l’architecte de la ville<br />
Verly avait déjà décrit les décorations à<br />
47
La visite Impériale à Anvers en 1810<br />
tendues des guirlandes d’illumination.<br />
À chaque extrémité de la ligne droite<br />
se trouvera un portique avec l’initiale N<br />
supportée par l’aigle impérial. On<br />
espère même qu’on puisse décorer les<br />
quais ainsi jusqu’aux travaux du bassin<br />
en côtoyant le fleuve. Pour compléter<br />
le tout, il faudra que tous les bâtiments<br />
soient pavoisés et illuminés le soir.<br />
Pour les hospices et hôpitaux : de<br />
l’hôtel de l’Empereur jusqu’aux hôpitaux<br />
une avenue d’illumination de deux<br />
rangs réguliers, exprimant les faits de<br />
commisération exercés par l’Empereur et<br />
notamment son respect pour le malheur<br />
vertueux, sera prévue.<br />
La Bourse sera illuminée en verre de<br />
couleur, avec des colonnes mauresques<br />
et des arcades, on suspendra au centre<br />
une immense couronne impériale<br />
protectrice, « Emblème du bonheur<br />
qui doit procurer la paix glorieuse qui<br />
sera l’issue des travaux héroïques de<br />
Napoléon. »<br />
À l’extrémité de la Place de Meir, en<br />
face de l’hôpital de la Marine, sera placée<br />
une aiguille à l’Egyptienne d’une haute<br />
proportion portant une inscription qui<br />
exprimera les vœux du peuple, entre<br />
autres la paix. Et sur la Place S t Georges,<br />
au bout de la rue de l’Hôpital et des<br />
Peignes, se trouvera la bonne étoile de<br />
l’Empereur avec au centre le signe du<br />
zodiaque « sous lequel il revient visiter<br />
sa bonne ville d’Anvers ».<br />
Verly avait même prévu un spectacle<br />
avec une décoration extérieure<br />
représentant le « Temple de Mémoire »<br />
où on y lirait les inscriptions nombreuses<br />
des faits qui sont la gloire du monarque.<br />
Lettre d'avis des logis préparés et probablement rédigée par le maréchal des logis du<br />
Palais Canouville.<br />
Archives Municipales d'Anvers.<br />
Et puis il y aura la promenade des<br />
Géants illuminés avec chars etc.,<br />
une parade connue sous le nom<br />
d’Ommegang.<br />
prévoir pour une visite éventuelle des<br />
souverains.<br />
Tout le pourtour de la Place Bonaparte<br />
sera illuminé avec au centre un « Temple<br />
de la Gloire » et un camp d’honneur<br />
environnera la dite place. Une fête<br />
militaire est également prévue.<br />
La Cathédrale sera décorée avec des<br />
tentures en draperies autour du chœur,<br />
enrichies de guirlandes de laurier,<br />
couronnes, girandoles, dais et trône.<br />
Toute l’église et sa tour seront illuminées<br />
pendant la visite.<br />
Au Quai Napoléon, on y plantera<br />
régulièrement 2 rangs de sapins de<br />
moyenne grandeur entre lesquels seront<br />
Le voyage connaît un tel succès<br />
qu’on retarde l’arrivée à Anvers jusqu'au<br />
lendemain du jour prévu. Là, on travaille<br />
sans relâche en attendant l'arrivée de<br />
l’Empereur en voiture. On nettoie et<br />
décore d’une manière élégante le chemin<br />
venant de Berchem vers la porte de la<br />
ville ainsi que les rues menant vers la<br />
préfecture où seront logés les augustes<br />
48
visiteurs. Seulement, Napoléon change<br />
d’avis et veut arriver en bateau, comme il<br />
a fait en 1803.<br />
Le 30 avril à midi, le couple impérial<br />
s’embarque donc sur un yacht très orné<br />
et gagne Willebroeck, puis Anvers. Dans<br />
la ville, les autorités sont informées<br />
de ce changement dans l’itinéraire de<br />
l’Empereur. C’est la panique. On enlève<br />
toutes les décorations prévues du côté de<br />
Berchem et les apporte vers les bords de<br />
l’Escaut et les rues que l’Empereur doit<br />
emprunter pour arriver au « Palais ».<br />
À environ six heures et demie,<br />
les cloches sonnent à toute volée et<br />
l’artillerie des forts et l’escadre entrent<br />
en action. Les maisons et même les<br />
chantiers se vident pour remplir les<br />
quais et les rues menant vers le logis des<br />
souverains.<br />
Après avoir visité l’amiral Missiessy<br />
à bord du Charlemagne, l’Empereur et<br />
l’Impératrice arrivent devant la ville.<br />
Pour la première fois depuis au<br />
moins deux siècles, la ville accueille<br />
de nouveau un souverain et sa cour<br />
composée de princes, ducs et autres<br />
nobles.<br />
Le spectacle est impressionnant. Le<br />
maire de la ville, offre sur un plateau<br />
d’argent les clés de la cité. Précédés par<br />
la garde d’honneur sous les ordres du<br />
chef d’escadron de Caters, les souverains<br />
et leur suite se rendent au « Palais ».<br />
Sur leur chemin, tous les yeux sont<br />
dirigés sur la nouvelle mariée qui est<br />
accueillie par des cris réitérés de « Vive<br />
Marie-Louise d’Autriche ». Le souvenir<br />
des règnes de Marie-Thérèse et de<br />
Jozef II d’Autriche était encore frais dans<br />
les mémoires.<br />
Le 1 er mai à partir de 7 heures du<br />
matin, l’Empereur visite le port et les<br />
fortifications. Dans l’après-midi, il y a<br />
une revue de la flottille de l’Escaut et le<br />
soir il donne audience aux autorités et au<br />
clergé.<br />
Le 2 mai, ils assistent au lancement<br />
du vaisseau Friedland. Les souverains<br />
reçoivent l’eau bénie par l’archevêque<br />
de Malines, qui ensuite bénit le vaisseau.<br />
Peu après, les ouvriers coupent les<br />
câbles et le vaisseau descend avec un<br />
bruit épouvantable, accompagné d’une<br />
musique et des cris des spectateurs<br />
dans l’Escaut. Le soir, Eugène arrive de<br />
Bruxelles et rejoint l’Empereur.<br />
Arrivée de Napoléon I er et de Marie-Louise<br />
à Anvers, le 1 er mai 1810.<br />
Par Crépin.<br />
Cliché de l'auteur.<br />
Le 3 mai, Napoléon visite l’arsenal<br />
et l’emplacement de la nouvelle ville<br />
projetée au delà de l’Escaut. On assiste<br />
au défilé du Géant et de ses suivants, le<br />
Ommegang.<br />
Le 4 mai, le soir, Napoléon,<br />
Marie-Louise et la cour assistent à la fête<br />
offerte par la ville à l’hôtel de ville.<br />
Pour recevoir l’Empereur, on a<br />
transformé le bâtiment en enlevant<br />
des murs et des cheminés. La cour<br />
ouverte au milieu de l’hôtel de ville est<br />
transformée en salle bal et reçoit un<br />
plancher et un toit. La grande salle de<br />
l’hôtel forme la salle du trône, le cabinet<br />
du secrétaire et celui du Maire servent de<br />
petit appartement à Sa Majesté.<br />
Le soir, le règlement intérieur de la<br />
fête se déroule comme l’étiquette exige.<br />
Après huit heures du soir, la porte<br />
d’entrée de l’hôtel de ville sera fermée.<br />
Les personnes invitées remettent leurs<br />
49
La visite Impériale à Anvers en 1810<br />
billets d’entrée à deux commissaires<br />
qui se trouvent dans la première salle.<br />
De là, deux commissaires conduisent<br />
les dames, qui se font remarquer par la<br />
quantité des diamants dont elles sont<br />
couvertes, jusqu’au salon de danse ou<br />
six autres personnes les conduiront et<br />
indiqueront leurs places aux invitées.<br />
Personne ne peut quitter le lieu où<br />
il a été placé tant que Leurs Majestés<br />
honorent la fête de leur présence.<br />
Deux commissaires veillent à<br />
empêcher toute circulation dans la salle<br />
de réception et deux autres veillent<br />
également au bon ordre dans les<br />
deux salles où sont placés les buffets.<br />
À l’arrivée de Leurs Majestés<br />
Impériales et Royales, le Maire, ses deux<br />
adjoints, deux conseillers municipaux<br />
et deux commissaires vont recevoir<br />
l’Empereur au bas de l’escalier, destiné<br />
uniquement à son entrée. Douze Dames<br />
vont également recevoir l’Impératrice<br />
au bas de l’escalier.<br />
À l’entrée de Leurs Majestés, toutes<br />
les personnes invitées doivent se lever<br />
en silence.<br />
Le Maire prend les ordres du Grand<br />
maréchal du Palais Duroc pour faire<br />
commencer la cantate. Après la<br />
cantate, il prend ses ordres pour faire<br />
commencer la danse.<br />
Pendant que Leurs Majestés sont<br />
présentes, on ne danse que trois<br />
quadrilles à la fois, aux places indiquées<br />
par les commissaires, qui choisissent les<br />
partenaires, tant pour les contre-danses<br />
que pour les valses.<br />
À la sortie de Leurs Majestés, on<br />
leur rendra les mêmes devoirs qu’à<br />
leur entrée. Toutes les personnes<br />
invitées seront debout. Le Maire, deux<br />
membres du conseil, deux commissaires<br />
et les douze Dames reconduiront<br />
Leurs Majestés jusqu’au bas de l’escalier.<br />
Le 5 mai, le roi de Hollande arrive<br />
pour voir son frère l’Empereur afi n<br />
de sauver son trône. Dans la journée,<br />
Napoléon visite le vaisseau Dalmatie.<br />
Le lendemain matin à 6 heures,<br />
l’Empereur et l’Impératrice, suivis par<br />
la cour, partent d’Anvers pour aller<br />
à Breda, puis Bois-le-Duc, Bergen op<br />
Zoom, l’Isle de Walcheren pour revenir<br />
le 13 vers minuit à Anvers. De là, ils<br />
repartiront pour aller à Bruxelles, Gand,<br />
Bruges, Ostende, Dunkerque, Lille,<br />
Calais, Boulogne, Dieppe, le Havre,<br />
Rouen et S t Cloud où elles vont arriver<br />
le 1 er Juin 1810.<br />
Le résultat de cette visite est très<br />
positif. Un grand nombre de décrets<br />
vont encore améliorer la situation<br />
de la ville, augmentant encore son<br />
importance.<br />
Jusqu’à présent, les habitants les<br />
reçoivent avec ferveur et beaucoup<br />
d’enthousiasme. Pas pour longtemps,<br />
car pendant la visite suivante de 1811 la<br />
situation aura bien changé.<br />
Quand même, les travaux avancent<br />
et de plus en plus de bâtiments sont<br />
lancés dans l’Escaut et la flotte gagne<br />
d’importance. En 1812, les deux<br />
bassins peuvent contenir presque<br />
soixante vaisseaux. La même année,<br />
le secrétaire du Duc de Padoue,<br />
Jean-Baptiste Fournier, décrit Anvers<br />
comme : « Les gigantesques travaux<br />
entrepris à Anvers, la rapidité avec<br />
laquelle ils s’exécutaient, tout enfin<br />
était marqué au sceau du génie de<br />
l’homme qui les avait conçus. De<br />
la ville commerciale qu’elle était,<br />
Anvers devenait tout à coup et<br />
comme par un coup de baguette,<br />
port militaire de premier ordre.<br />
Des bassins immenses, et pouvant<br />
contenir quarante vaisseaux de<br />
guerre, se creusaient comme par<br />
enchantement sur un emplacement<br />
où, naguère encore, on voyait une<br />
grande promenade garnie d’arbres<br />
et une église. Huit mille ouvriers<br />
et quatorze mille prisonniers de<br />
guerre espagnols, fort gais et gagnant<br />
beaucoup d’argent, fourmillaient,<br />
même la nuit, éclairés par des<br />
torches, dans les terrassements de ces<br />
importants ouvrages. Des chantiers<br />
de construction sur une vaste<br />
échelle étaient créés depuis peu, et je<br />
trouvai en vaisseaux de haut bord<br />
sur les cales, quand je les visitai : le<br />
Superbe, le Neptune, l’Atlas, l’Hymen,<br />
l’Alexandre, le Terrible, l’Impétueux,<br />
l’Aigle, le Tibre, le Mars, le Belliqueux,<br />
l’Alcide, et le Conquérant, total treize<br />
non compris les frégates et les bricks.<br />
Il faut grimper comme je l’ai fait dans<br />
ces immenses squelettes quoique<br />
dépourvus encore de ce qui doit leur<br />
donner la vie, pour admirer le génie<br />
de l’homme et sa hardiesse ! Que de<br />
bras pour ces treize colosses, de fer, de<br />
bois ! Et quand un de ces vaisseaux<br />
sera gréé et armé, quelle merveille<br />
entre toutes les merveilles peut se<br />
comparer à ce roi des mers toutes<br />
voiles déployées, faisant mugir l’air de<br />
ses cent bouches à feu ou pavoisé des<br />
mille couleurs de tous ses pavillons !<br />
Voulant embrasser d’un seul coup<br />
d’œil tous les travaux de ces immenses<br />
chantiers, je montai sur le clocher<br />
de la cathédrale qui les domine à<br />
quelques pas de là, et de ce point, je<br />
pus jouir agréablement d’un coup<br />
d’œil ravissant. J’admirai en même<br />
temps, outre la ville et la citadelle, les<br />
larges sinuosités de l’Escaut se rendant<br />
à la mer et déployant ses vastes<br />
rubans dans les directions de Batz et<br />
de Flessingue. » 2<br />
Deux ans plus tard, les Anglais sont<br />
de nouveau devant les portes de la ville.<br />
■<br />
1 - Les autres personnages qui font parti du<br />
voyage sont : le 1er écuyer ; les aides de<br />
camp de l’Empereur : le duc de Rovigo, le<br />
comte Bertrand et le comte Lauriston ; les<br />
chambellans : les comtes d’Arberg et Ghilini ;<br />
le maréchal de logis du Palais le baron<br />
Canouville ; les écuyers : le baron Canisy et<br />
MM d’Héricy et Montaran ; la duchesse de<br />
Montebello, dame d’honneur ; la comtesse de<br />
Luçay, dame d’autours ; les dames du Palais :<br />
les comtesses du Châtel, Bouillé et Poro ; le<br />
chevalier d’honneur le comte de Beauharnais ;<br />
le 1er écuyer le prince Aldobrandini ; les<br />
chambellans les comtes Bondi et Bearn ; les<br />
écuyers les barons d’Audenarde et St Aignan ;<br />
les officiers d’ordonnance : l’Epinay, Talhouet,<br />
Watteville et La Bourdonnays ; les fourriers du<br />
Palais Baillon et Picot ; six pages ; le personnel<br />
du bureau de l’Empereur MM. Meneval, Fain et<br />
de Ponthon ; les officiers de santé : Bourdier<br />
(médecin de l’Impératrice), Yvan (chirurgien<br />
de l’Empereur) et Vareliaud (chirurgien de<br />
la Maison) ; et les généraux Chambarlhac et<br />
Putaux.<br />
2 - Souvenirs de Fournier, aide de camp d’Arrighi<br />
de Casanova, duc de Padoue. La Vouivre, 2009.<br />
50
Fastes monarchiques<br />
à l’heure d’une idylle :<br />
de la rencontre<br />
à la lune de miel<br />
sous les ors de Compiègne<br />
Hélène MEYER<br />
Conservateur du patrimoine, Palais de Compiègne,<br />
chargée des Grands appartements<br />
Arrivée de l’Empereur Napoléon et de<br />
l’Impératrice Marie-Louise au palais<br />
impérial de Compiègne le 27 mars 1810.<br />
Gravure anonyme, époque 1 er Empire,<br />
Collection B.N.F., Paris, © Roger Viollet.<br />
51
XXXXXXXXXXXXXX<br />
Arrivée de Marie-Louise à Compiègne le<br />
28 mars 1810, recevant les compliments<br />
et les fleurs d'un groupe de jeunes<br />
filles dans la Galerie du Chartrain à<br />
Compiègne.<br />
Huile sur toile de Pauline Auzou (1775-<br />
1835), 1810. Collection Châteaux de<br />
Versailles et de Trianon, Versailles,<br />
© RMN / Gérard Blot.<br />
E<br />
n choisissant Compiègne pour<br />
recevoir la nouvelle Impératrice<br />
en 1810, Napoléon marque<br />
le palais du sceau de l’histoire. Il<br />
renouvelait ainsi, quarante ans plus<br />
tard, le geste souverain de l’accueil<br />
de Marie-Antoinette par Louis XV et<br />
le Dauphin. En s’alliant avec la plus<br />
vieille famille régnante d’Europe et<br />
avec la petite-nièce de la dernière<br />
reine de France, l’Empereur souhaitait<br />
inscrire son épopée dans la continuité<br />
monarchique et enraciner sa nouvelle<br />
dynastie sur des fondements ancestraux :<br />
un nouveau mariage pour que le vaste<br />
Empire, alors à son apogée, puisse<br />
perdurer sous l'égide d'un héritier de<br />
sang tant espéré.<br />
Compiègne se devait d'évidence<br />
d'évoquer cet événement historique<br />
et l'exposition présentée du 27 mars<br />
au 19 juillet 2010 1 s'est fi xé de relater<br />
la pittoresque rencontre du couple<br />
impérial, les mariages parisiens et la<br />
lune de miel compiégnoise d'avril 1810.<br />
Car rien ne laissait présager que, de ce<br />
mariage politique et dynastique, naîtrait<br />
une improbable idylle impériale. Ce fut<br />
donc aujourd'hui pour ce bicentenaire<br />
l'occasion de réunir l'iconographie<br />
incontournable de l'événement, dans la<br />
limite des contraintes techniques qui ont<br />
dû faire renoncer à certains très grands<br />
formats. On peut dire que l'essentiel a<br />
pu être montré, ponctué de nouvelles<br />
découvertes.<br />
Marie-Louise, on le sait, a souffert, dès<br />
son arrivée, d'un déficit de popularité<br />
qui ne cessera de s'attacher à son image.<br />
Cette nouvelle Autrichienne, quoique<br />
assez séduisante sur l'étude qu'en a<br />
laissée Gérard, n'avait certes pas le<br />
52
charisme de Joséphine, incarnation de<br />
la grâce et de la volupté, la bien-aimée<br />
des Grognards qui y voyaient le portebonheur<br />
de l'Empereur. C'est dire que<br />
cette impératrice oubliée dans l'ombre<br />
de Joséphine, au règne on ne peut plus<br />
éphémère, n'a pas suscité d'abondante<br />
littérature. Si l'on doit à Frédéric Masson<br />
(1902) 2 la monographie de référence<br />
ou à Geneviève de Chastenet (1972) 3<br />
la biographie encore disponible, sans<br />
omettre les nombreuses sources au<br />
premier rang desquelles les Souvenirs<br />
historiques de Méneval (1844) 4 , force est<br />
de constater que le sujet reste encore à<br />
exploiter.<br />
L'une des récompenses de l'exposition,<br />
au départ de laquelle on pouvait<br />
s'interroger sur sa viabilité, fut<br />
l'émergence d'un grand nombre d'œuvres<br />
ou d'objets inédits. Le Salon de 1810,<br />
inauguré par le couple impérial en<br />
novembre, et voulu par Napoléon<br />
comme l'événement artistique majeur<br />
de l'année, a largement servi de creuset<br />
à ces découvertes, puisque les artistes<br />
se sont fait bien entendu l'écho de<br />
l'événement.<br />
Ce fut également l'occasion de se<br />
réintéresser au Compiègne du Premier<br />
Empire et à plusieurs de ses aspects,<br />
méconnus ou inédits : l'exposition a<br />
ainsi permis de redécouvrir ce qu'était<br />
la Galerie des ministres qui ornait<br />
l'ancienne Salle des gardes ainsi que la<br />
Galerie des tableaux de l'Impératrice,<br />
tout en révélant un grand nombre<br />
d'objets d'art livrés pour Marie-Louise à<br />
l'occasion de ce séjour.<br />
Nous n'aurions pu évidemment<br />
œuvrer sans l'aide de ceux dont la<br />
contribution fut essentielle, et en<br />
particulier M me Chantal Gastinel-<br />
Coural, M. Jean-Pierre Samoyault et<br />
Bernard Chevallier, ainsi qu'Anne Dion-<br />
Tennebaum et David Mandrella, associés<br />
au commissariat de l'exposition.<br />
Le remariage était dans l'air depuis<br />
1807 si l'on croit les premières<br />
négociations de Napoléon avec<br />
Alexandre I er à Tilsit. Mais les sœurs du<br />
tsar sont alors trop jeunes et l'Empereur<br />
encore hésitant. C'est la grossesse de<br />
Marie Walweska, dont la moralité ne<br />
pouvait faire aucun doute, qui sera<br />
décisive. Elle le rejoint d'ailleurs à<br />
Schonbrünn en août 1809 et, à son<br />
retour en France, en octobre, Napoléon<br />
demande, qu'à Fontainebleau, la porte<br />
de ses appartements communiquant<br />
avec ceux de Joséphine soit murée :<br />
un symbole de l'inéluctable divorce<br />
entériné par la famille impériale le<br />
15 décembre. De peur de l'échec<br />
diplomatique face à la Russie, peu<br />
zélée à livrer la grande duchesse<br />
Anne à l'ogre de l'Europe, Napoléon<br />
choisit la fille aînée de l'Empereur<br />
d'Autriche, le vaincu d'Austerlitz<br />
puis de Wagram. Le calendrier est<br />
dès lors resserré à la mesure de<br />
l'impatience légendaire de l'Empereur :<br />
le 14 janvier, l'Officialité diocésaine<br />
de Paris prononce l'annulation du<br />
mariage d'avec Joséphine ; le 6 février,<br />
Eugène de Beauharnais négocie le<br />
contrat de mariage avec le prince de<br />
Schwarzenberg, ambassadeur d'Autriche<br />
à Paris ; le 16, François I er , père de<br />
Marie-Louise, ratifie la convention de<br />
mariage ; le 17, le général Berthier,<br />
l'homme de confi ance, est envoyé à<br />
Vienne sous son titre de prince de<br />
Neufchâtel – laissant de côté celui<br />
de Wagram par diplomatie – pour<br />
formuler la demande officielle de<br />
mariage le 8 mars, assister au mariage<br />
par procuration le 11 en l'église des<br />
Augustins, puis escorter Marie-Louise<br />
de Vienne, dont ils partent le 13, jusqu'à<br />
Compiègne.<br />
Si peu de pièces permettaient<br />
d'évoquer ces préambules, on a choisit<br />
ainsi, à partir des tableaux du Salon et<br />
de plusieurs dessins inédits, d'évoquer<br />
le contexte de ces négociations, en<br />
rappelant notamment la campagne<br />
d'Autriche de 1809 conclue par la Paix de<br />
Vienne du mois d'octobre. Pour incarner<br />
cette épopée, le tableau d'Adolphe<br />
Roehn, montrant Napoléon soucieux à la<br />
veille de l'issue de la bataille de Wagram,<br />
fait partie de ceux qui ont directement<br />
participé à la légende napoléonienne<br />
du vivant même de l'Empereur : l'œuvre<br />
inspirée par un dessin de Benjamin Zix<br />
connut en effet grand succès au Salon<br />
et fut largement diffusée par la gravure.<br />
C'est encore à Zix, en collaboration avec<br />
Constant Bourgeois, que l'on doit deux<br />
dessins de cette période autrichienne :<br />
l'emballage sur la terrasse du Belvédère<br />
de tableaux prélevés dans les collections<br />
impériales au profit du Musée Napoléon<br />
au titre de butin de guerre ou Napoléon<br />
se promenant dans les fausses ruines<br />
romaines des jardins de Schonbrünn,<br />
site qui a suscité une enthousiaste<br />
description de Constant dans ses<br />
mémoires (collection particulière) 5 .<br />
Pour le voyage notamment, les rites de<br />
l’Ancien régime servirent de référence<br />
et le protocole élaboré pour celui de<br />
Marie-Antoinette sera repris. Ainsi l’on<br />
sait combien l’épisode romanesque<br />
de la rencontre, incognito et « à la<br />
hussarde », eut de quoi en surprendre<br />
plus d’un. Car l’on doit s’imaginer, ce<br />
27 mars 1810, en forêt de Soissons et<br />
sous une pluie torrentielle, l'Empereur<br />
pressant et ruisselant, se précipitant<br />
sans préavis dans le carrosse de<br />
l'archiduchesse pour se jeter à son<br />
53
Fastes monarchiques à l’heure d’une idylle<br />
Cortège du mariage de Napoléon et<br />
Marie-Louise dans la grande Galerie du<br />
Louvre le 2 avril 1810.<br />
Dessin à l’encre de Benjamin Zix (1772-<br />
1811), Collection Musée du Louvre,<br />
Paris © RMN / Thierry Le Mage.<br />
billard, aimait peindre et dessiner, ayant<br />
bénéficié pendant ces années françaises<br />
de l'enseignement de Prud'hon, d'Isabey<br />
et de Joseph Redouté.<br />
Ce séjour compiégnois et celui de<br />
l'été 1811, avec le Roi de Rome âgé<br />
de cinq mois, restent dans l’histoire<br />
napoléonienne les rares parenthèses<br />
paisibles et heureuses de la vie<br />
trépidante de l’Empereur. Celui de 1810<br />
prend fi n le dimanche 27 avril, avec<br />
le voyage de noces du couple, leur<br />
premier voyage officiel, en Belgique.<br />
Napoléon voulait « se montrer » avec<br />
la nouvelle Impératrice, dans ces<br />
nouvelles provinces conquises sur la<br />
maison d’Autriche, comme l'illustrent<br />
les tableaux de Crépin (Paris, Fondation<br />
Thiers) ou de Van Brée (Paris,<br />
Chancellerie de la Légion d'honneur).<br />
Si l'exposition a pu apporter quelques<br />
nouveaux éléments de connaissance<br />
sur l'événement, il n'en reste pas<br />
moins à poursuivre ces recherches<br />
pour éclairer ces dernières années de<br />
l'Empire, sous l'angle spécifique du<br />
règne de Marie-Louise. Que reste-t-il<br />
de la richesse de son trousseau, que<br />
connaît-on de son goût en matière<br />
artistique alors qu'elle fait acheter<br />
au Salon et qu'elle aurait constitué<br />
une collection d'estampes, que sont<br />
devenues ses lettres à Napoléon encore<br />
connues à la fi n du XIX e siècle ? Nous<br />
avons modestement tenté de rétablir la<br />
vérité de son image altérée par l'histoire,<br />
frappée du mépris que sa personnalité a<br />
suscité en France, alors qu'elle demeure<br />
adulée à Parme, dont elle devint<br />
duchesse par le Congrès de Vienne, et<br />
qu'elle sut faire administrer, non sans<br />
intelligence, par ses amants et maris, les<br />
comtes de Neipperg et de Bombelles.<br />
■<br />
1 - 1810, la politique de l'amour. Napoléon I er<br />
et Marie-Louise à Compiègne, Compiègne,<br />
Musée national du palais, 27 mars - 19 juillet<br />
2010, catalogue 208 p., édition RMN<br />
2 - Frédéric Masson, L'impératrice Marie-Louise,<br />
Paris, Goupil, 1902<br />
3 - Geneviève Chastenet, Marie-Louise, l'otage<br />
de Napoléon, Paris, 1972<br />
4 - Baron de Méneval, Napoléon et Marie-Louise,<br />
souvenirs historiques, Paris, 1844<br />
5 - Constant, Mémoires intimes de Napoléon I er ,<br />
Paris, Mercure de France, 1967, 2 vols., vol. II,<br />
p. 39-40<br />
6 - Prince de Clary et Aldringen, Trois mois<br />
à Paris lors du mariage de l'Empereur<br />
Napoléon I er et de l'archiduchesse<br />
Marie-Louise, Paris, Plon, 1914, p. 16<br />
7 - Constant, II, p. 120<br />
8 - Clary, p. 20<br />
9 - Clary p. 45<br />
10 - Clary, p. 47<br />
11 - Clary, p. 44 et 47<br />
12 - Constant, II, p. 125<br />
13 - Constant, II, p. 127<br />
14 - Constant, II, p. 125<br />
15 - Clary, p. 48<br />
16 - Ferdinand Paër (1771-1839), originaire<br />
de Parme, fut le maître de musique de<br />
Marie-Louise à Vienne. Il fut nommé par<br />
Napoléon, qui avait entendu son opéra<br />
Achille à Dresde, directeur de la musique<br />
des concerts et du théâtre de la cour en<br />
décembre 1806, puis maître de chant de<br />
l’Impératrice.<br />
17 - Clary, p. 48<br />
18 - Constant, II, p. 125<br />
56
La troisième invasion<br />
du Portugal<br />
Frédéric BEY<br />
Portrait du duc de Wellington.<br />
Aquarelle sur papier cartonné<br />
par William Derby (1786-1847),<br />
d’après sir thomas Lawrence (1769-1830),<br />
Collection Wallace Collection, Londres,<br />
© The Wallace Collection / Distr. RMN.<br />
57
La troisième invasion du Portugal<br />
Les Français peuvent alors découvrir les<br />
six divisions anglaises déployées soit<br />
sur une ou deux lignes, en formations<br />
serrées et s’abritant derrière chacun<br />
des accidents du terrain. La 4 e division<br />
(général Cole) se trouve à l’extrême<br />
gauche de la ligne anglaise, couvrant le<br />
chemin menant à Milheada. À sa droite<br />
se trouve la division légère du général<br />
Crawford, renforcée par la brigade<br />
allemande (King German Légion) placée<br />
en réserve, puis la brigade portugaise<br />
du brigadier-général Pack qui forme<br />
l’avant-garde de la première division<br />
du lieutenant-général Spencer. Cette<br />
dernière est déployée sur la partie la<br />
plus haute de la crête, avec à sa gauche<br />
le couvent et à sa droite la 3 e division<br />
(major-général Picton). À la droite de<br />
Picton on trouve enfin la 5 e division du<br />
major-général Leith, puis la 2 e division<br />
du général Hill. La brigade portugaise<br />
d’Hamilton occupe l’extrême droite<br />
de la ligne anglaise et les hauteurs qui<br />
viennent s’appuyer sur les rives du<br />
Mondego. La cavalerie est placée loin en<br />
arrière de la crête, derrière la 4 e division.<br />
Seul le 4 e régiment de dragons légers<br />
est placé en position de combat, sur<br />
le sommet de la sierra. Toute la ligne<br />
anglaise est couverte par de nombreux<br />
tirailleurs. Enfi n, 50 pièces d’artillerie<br />
sont déployées en batteries sur les<br />
meilleures positions de tir. Masséna<br />
a de son côté disposé ses forces de la<br />
manière suivante : Ney forme l’aile droite<br />
française avec le VI e corps, Reynier<br />
l’aile gauche avec le II e corps. Junot et<br />
le VIII e corps sont déployés en réserve,<br />
derrière les troupes du maréchal Ney.<br />
La cavalerie, inutilisable sur un terrain<br />
aussi accidenté est conservée en réserve,<br />
elle aussi en arrière du VI e corps, avec<br />
la possibilité d’éclairer le flanc droit de<br />
l’armée. Quelques pièces d’artillerie sont<br />
mises en position sans grande possibilité<br />
de tir vers les hauteurs. L’artillerie légère<br />
est alignée derrières les troupes de Ney<br />
et de Reynier, prête à suivre l’infanterie<br />
si elle parvenait à conquérir les crêtes.<br />
Masséna, installé sur un mamelon<br />
bordant la route allant de Viseu à<br />
Coïmbre dispose d’une bonne vue sur le<br />
champ de bataille. Il lance, dès 7 heures<br />
du matin, Ney à l’assaut du couvent<br />
de Bussaco, face à Pack et Crawford.<br />
Reynier est chargé d’attaquer par<br />
Bataille de Bussaco.<br />
Gravure de T. Fielding, 1819, extraite<br />
de l’ouvrage « Les victoires du duc de<br />
Wellington » publié en 1819, Collection<br />
Particulière, © Bridgeman Giraudon.<br />
62
Sacerda et San Antonio de Cantaro, face à<br />
Spencer, Picton et Leith. Les deux corps<br />
d’armée doivent attaquer simultanément<br />
pour mieux ébranler les défenseurs.<br />
L’attaque et l’échec<br />
du II e corps<br />
Les troupes de Reynier entrent<br />
néanmoins en action en premier. La<br />
division Merle marche en tête sur la<br />
route de San Antonio, suivie par la<br />
division Heudelet. Les français sont<br />
d’abord protégés par le brouillard.<br />
Bientôt, la division Merle se jette sur la<br />
droite de la route. Les soldats doivent<br />
gravir la pente, au milieu des arbres et<br />
des broussailles. La division Heudelet<br />
poursuit son avance sur la route qui<br />
serpente en direction de la crête. La<br />
progression des Français est énergique<br />
mais épuisante. Lorsque la division<br />
Merle atteint le sommet, elle se heurte<br />
au 8 e régiment portugais. Malgré leur<br />
fatigue, après une marche d’approche<br />
de plusieurs heures, les soldats de Merle<br />
culbutent les Portugais et s’emparent<br />
de leur artillerie. La division française<br />
essaye alors de se déployer sous le feu<br />
des soldats ennemis. La réaction des<br />
Britanniques est très rapide. Les troupes<br />
de Picton se lancent à la rencontre des<br />
Français pour parer au plus pressé. Ils<br />
sont appuyés sur leur droite par les<br />
soldats de Leith et sur leur gauche par<br />
la mitraille de l’artillerie de la division<br />
Spencer. À leur habitude, les fantassins<br />
anglais déclenchent leurs salves de<br />
mousqueterie à 15 pas. Ils font des<br />
ravages dans les lignes françaises et<br />
notamment parmi les officiers. En<br />
quelques instants, le général de division<br />
Merle, le général de brigade Graindorge,<br />
le colonel Merle (2 e léger) et le colonel<br />
Desgraviers (4 e léger) sont mortellement<br />
blessés. Profitant de la désorganisation<br />
qui gagne les rangs français, Picton<br />
lance une contre-attaque avec les 45 e et<br />
88 e régiments. Les Anglais chargent à<br />
la baïonnette et repoussent les Français<br />
jusqu’à l’extrémité du plateau. L’arrivée<br />
par la route du 31 e léger (division<br />
Heudelet), qui se porte immédiatement<br />
au soutien des soldats en retraite de<br />
la division Merle, ranime l’espoir des<br />
Français. Mais, à son tour, le 31 e est pris<br />
sous le feu très efficace des anglais.<br />
Avant d’être déployé, le régiment a déjà<br />
perdu son chef, le colonel Desmeuniers.<br />
Le corps du maréchal Reynier dans<br />
son ensemble est désormais contraint<br />
à la retraite. Celle-ci est conduite<br />
intelligemment, sans panique. Les<br />
fantassins s’abritent derrière chaque<br />
obstacle d’où ils peuvent faire feu sur<br />
les Anglais. Alors que la progression<br />
de Picton est finalement arrêtée,<br />
Wellington lance une partie des troupes<br />
de Leith et Spencer sur les flancs des<br />
Français. Au total, ce sont maintenant<br />
15 000 Anglo-Portugais, appuyés par<br />
une forte artillerie, qui assaillent moins<br />
de 8 000 français dépourvus d’artillerie<br />
de soutien. Le reflux des troupes du<br />
II e corps est désormais inévitable.<br />
Reynier, conscient des pertes déjà subies<br />
décide de ne pas engager le reste de la<br />
division Heudelet. Le général Foy est à<br />
son tour tombé au combat, grièvement<br />
blessé. Ses hommes le portent et le<br />
ramènent en arrière. L’attaque menée<br />
par Reynier est pour l’instant terminée.<br />
Le général ne peut espérer lancer un<br />
nouvel assaut qu’en fonction des résultats<br />
qu’aura obtenu le maréchal Ney de son<br />
côté.<br />
L’assaut sans issue<br />
du VI e corps<br />
L’attaque des troupes du maréchal<br />
Ney a été lancée par la division Loison,<br />
suivie à distance des divisions Marchand<br />
puis Mermet. La brigade Ferey s’empare<br />
des bois et escalade les versants à pic<br />
de la position anglaise. Pendant ce<br />
temps, sur sa droite, la brigade Simon<br />
progresse avec une détermination<br />
sans faille, malgré l’intensité des tirs<br />
– mousquèterie et mitraille – déclenchés<br />
par les Anglais. Les soldats s’emparent<br />
du hameau de Moira puis avancent, sans<br />
jamais ralentir leur marche, jusqu’à la<br />
ligne ennemie. Les soldats du général<br />
Simon se retrouvent face à une batterie<br />
ennemie, en avant du village de Sula,<br />
qu’elle se dispose à enlever au pas de<br />
charge. Le 26 e de ligne et la légion du<br />
Midi lancent la charge. Les Français<br />
atteignent les canons et les canonniers.<br />
Le général Simon dirige personnellement<br />
les combats et encourage ses hommes<br />
qui continuent à repousser l’ennemi.<br />
Mais il est alors blessé par des coups<br />
feu. Sur la droite de la brigade Simon,<br />
la brigade Ferey est parvenue, après de<br />
terribles efforts, à atteindre le sommet<br />
de la crête et à s’établir sur des positions<br />
précaires. C’est le moment choisi par<br />
les Anglais pour contre-attaquer. Le<br />
général Crawford harangue ses soldats :<br />
« Maintenant 52 e , vengez Moore ! » 4 .<br />
Les autres unités de la division légère<br />
et la brigade portugaise Coleman,<br />
jusqu’alors dissimulés au revers de la<br />
crête, s’avancent au pas de charge avec<br />
le 52 e . Abordant la brigade Simon de<br />
flanc, ils n’ouvrent le feu qu’une fois à<br />
10 pas des Français. Foudroyés par cette<br />
salve les Français sont contraints à se<br />
replier précipitamment dans le village<br />
de Sula, en abandonnant leurs blessés.<br />
Le général Simon, blessé, et 300 de ses<br />
hommes sont faits prisonniers. L’artillerie<br />
anglaise, depuis ses bonnes positions<br />
de tir, fait maintenant des ravages dans<br />
les rangs des Français. La brigade Ferey<br />
est également repoussée. Ne trouvant<br />
pas de points d’appuis pour résister<br />
efficacement, elle est ramenée sur ses<br />
positions de départ.<br />
La division Marchand qui forme<br />
le deuxième échelon des troupes du<br />
maréchal Ney, ne parvient à entrer en<br />
action qu’au moment où la division<br />
Loison rétrograde. L’objectif de la<br />
division Marchand est de suivre la route<br />
pour s’emparer du col. Il s’agit sans doute<br />
d’une mission particulièrement difficile,<br />
car c'est le point le mieux défendu de<br />
la ligne anglaise. À la hauteur du village<br />
de Sula, les soldats de Marchand se<br />
retrouvent pris sous le feu de l’ennemi.<br />
Son front et son fl anc gauche sont<br />
battus par les tirs de l’artillerie et<br />
de l’infanterie anglo-portugaise. Les<br />
Français hésitent, devant la puissance<br />
de feu ennemie. La division continue<br />
néanmoins à progresser sur la route,<br />
les boulets adverses lui enlevant parfois<br />
des compagnies entières. La progression<br />
devenant trop couteuse en hommes, les<br />
soldats de Marchand renoncent à leur<br />
objectif. Ils n’avaient plus alors que le<br />
choix entre charger au pas de course<br />
vers le col ou trouver un abri. C’est cette<br />
deuxième solution qui est retenue. Les<br />
Français se précipitent sur la gauche de<br />
la route, dans des rochers, des bruyères<br />
et des bouquets d’arbres qui fourmillent<br />
malheureusement de tirailleurs ennemis.<br />
63
XXXXXXXXXXXXXX<br />
Bataille de Bussaco.<br />
Gravure de Richard Simkin (1840-1926),<br />
1900, Collection National Army Museum,<br />
Londres, © Bridgeman Giraudon.<br />
La division se retrouve bloquée par des<br />
escarpements qu’elle ne peut franchir.<br />
Les troupes anglo-portugaises qui<br />
surplombent les Français continuent<br />
leurs tirs. Marchand et ses hommes<br />
sont maintenant dans une impasse, car<br />
ils ne peuvent ni regagner la route, ni<br />
poursuivre leur avance. Des voltigeurs<br />
sont envoyés en avant, mais ils sont<br />
rapidement tués ou blessés. Marchand<br />
organise alors plusieurs colonnes<br />
d’assaut, pour tenter de se frayer un<br />
passage vers le haut. Ces attaques<br />
rencontrent toutes une forte résistance<br />
sans jamais ouvrir la moindre brèche<br />
dans la ligne défensive de l’ennemi.<br />
Ney, lucide, a compris qu’il n’y avait<br />
désormais plus d’espoir de victoire, avec<br />
déjà 2 000 hommes hors de combat.<br />
Masséna, à son tour, se décide à arrêter la<br />
bataille, sans engager le corps de réserve<br />
du général Junot. La journée a été longue<br />
et rude. La bataille dure depuis le matin,<br />
et la journée est beaucoup trop avancée<br />
pour envoyer de nouvelles brigades<br />
à l’escalade de la Sierra d’Alcoba. Les<br />
Français ont perdu au total 1 800 tués<br />
et plus de 3 000 blessés. Le duc de<br />
Wellington ne déplore que 1 600 tués<br />
ou blessés. Certaines sources proposent<br />
des chiffres de pertes légèrement<br />
différentes, mais aucune ne donne moins<br />
de 4 000 Français ni plus de 2 000 Anglo-<br />
Portugais hors de combat. Le bilan est<br />
nettement défavorable aux Français<br />
qui ont également perdu un général<br />
et 4 colonels. L’échec de Masséna est<br />
évident. Ce n’est pas l’ardeur de ses<br />
troupes, même si le prince d’Essling<br />
peut reprocher à Ney d’avoir attaqué un<br />
peu tard et sans autant d’énergie qu’à<br />
l’habitude, qui est en cause : c’est bien la<br />
position anglaise qui était trop puissante.<br />
Le maréchal Masséna, en engageant<br />
le combat dans une bataille au cours<br />
de laquelle il ne pourrait pas utiliser sa<br />
cavalerie ni son artillerie, s’est mis de<br />
lui-même dans une situation défavorable.<br />
On ne voit d’ailleurs pas, au regard de<br />
la difficulté du terrain, comment les<br />
Français auraient pu engager plus de<br />
troupes en même temps pour tenter de<br />
déloger les Anglo-Portugais avec plus de<br />
réussite. Wellington a gagné la bataille de<br />
Bussaco la veille des combats, lorsqu’il<br />
64
a choisi cette excellente position pour<br />
y établir son armée et ses canons. Il a<br />
bien anticipé le fait que Masséna, à la<br />
tête d’une armée française convaincue<br />
de sa supériorité et toujours portée<br />
vers l’offensive, penserait pouvoir l’en<br />
déloger. Mais pour les Français, si la<br />
bataille a été perdue tactiquement avant<br />
d’être livrée, ce qui a été confirmé par<br />
les combats sanglants du 27 septembre,<br />
la suite va montrer qu’elle peut encore<br />
être gagnée le lendemain.<br />
La suite de la bataille<br />
Dans la soirée du 27 septembre, un<br />
prêtre français, ancien réfractaire réfugié<br />
dans le pays depuis la Révolution, se<br />
présente auprès des avant-postes français<br />
pour indiquer à ses compatriotes le<br />
chemin permettant de contourner la<br />
position de Wellington. Dès le lendemain<br />
matin, Masséna envoie le général<br />
Montbrun et le colonel Sainte-Croix,<br />
à la tête de la cavalerie du VIII e corps<br />
d’armée, reconnaître ce chemin, situé<br />
sur la droite des positions françaises.<br />
Masséna maintient par ailleurs une<br />
certaine activité dans son armée sur<br />
place afin de tromper l’ennemi sur<br />
ses intentions. Bientôt les dragons de<br />
Sainte-Croix découvrent les chemins<br />
dont on leur avait indiqué l’existence.<br />
Le passage se révèle qui plus est<br />
praticable pour l’artillerie. Une fois<br />
arrivé sur les sommets, les Français<br />
peuvent apercevoir la grande plaine<br />
de Coïmbre. Un paysan leur confi rme<br />
par ailleurs que les chemins rejoignent<br />
plus loin la grande route qui mène à<br />
cette ville. Montbrun et Sainte-Croix<br />
établissent un régiment de dragons et<br />
leur artillerie dans le village de Boïalva.<br />
Ils échelonnent les trois autres en<br />
arrière avant d’envoyer des messagers<br />
à Masséna. Masséna, averti de la bonne<br />
nouvelle vers midi ordonne à Junot<br />
et à son corps d’armée de prendre la<br />
direction de Boïalva. Ney doit ensuite<br />
suivre Junot. Reynier est chargé de<br />
fermer la marche. Le départ des troupes<br />
françaises s’effectue dans la soirée du<br />
28 septembre, alors que la nuit est déjà<br />
tombée. Pendant tout ce temps, le duc de<br />
Wellington est resté deux jours immobile<br />
avec ses troupes victorieuses. Dès qu’il<br />
comprend le mouvement engagé par<br />
les troupes de Masséna et qu’il les voit<br />
s’engager sur ce passage, il s’empresse,<br />
dans la soirée du 29, d’ordonner à son<br />
armée de lever le camp et de prendre<br />
la direction de Coïmbre. Une fois dans<br />
la ville Wellington oblige les habitants à<br />
quitter les lieux et à détruire tout ce qui<br />
pourrait servir à ravitailler les Français.<br />
Montbrun et Sainte-Croix, lancés à la<br />
poursuite de l’arrière-garde anglaise, lui<br />
livrent un combat 1 er octobre dans la<br />
plaine située entre Coïmbre et le village<br />
de Fornos. Les dragons français sabrent,<br />
refoulent et mettent en déroute les<br />
troupes anglo-portugaises, notamment<br />
les quatre régiments de cavalerie<br />
déployés par Crawford. Stratégiquement,<br />
Masséna a désormais rétabli la situation :<br />
les Anglais se replient au plus vite vers<br />
Lisbonne et les lignes de défense que<br />
Wellington a préparé à Torres Védras,<br />
tout en pratiquant la terre brûlée<br />
derrière lui. Les Français s’installent à<br />
Coïmbre à partir du 2 octobre pour se<br />
préparer à les poursuivre. La défaite de<br />
Bussaco, qui aurait sans doute pu être<br />
évitée, n’a donc pas arrêté l’invasion du<br />
Portugal par les Français. Son impact<br />
moral et militaire est par contre très<br />
palpable. L’armée de Masséna a souffert<br />
et s’est affaibli inutilement dans cette<br />
affaire. Pour chasser les Anglais du<br />
Portugal, il faudra les vaincre un jour<br />
ou l’autre. Masséna a certes montré sa<br />
détermination, mais Wellington a offert<br />
la démonstration de sa maîtrise du<br />
terrain et de son habileté tactique.<br />
■<br />
1 - Adolphe Thiers, Histoire du Consulat et de<br />
l’Empire<br />
2 - Auteur quelques années plus tard d’une<br />
Histoire des guerres dans la Péninsule<br />
3 - Frédéric Hulot, Le maréchal Ney<br />
4 - En référence au général Moore, tué lors de la<br />
bataille de la Corogne<br />
Bibliographie<br />
André de la Grave, Campagne de<br />
l’armée du Portugal, J.G. Dentu, 1815<br />
Philip J. Haythornthwaite, The<br />
Napoleonic Source Book, Arms and<br />
Armour, 1995<br />
Frédéric Hulot, Le maréchal Masséna,<br />
Pygmalion, 2005<br />
William Francis Patrick Napier,<br />
History of the War in the Peninsula<br />
and the South of France, J.S. Redfield<br />
1841<br />
Général Koch, Mémoires de Masséna,<br />
Paulin et Lechevalier, 1850<br />
Adolphe Thiers, Histoire du Consulat<br />
et de l’Empire, Tome douzième, Paulin<br />
Editeurs 1855<br />
Collectif, sous la direction de Jean<br />
Tulard, Dictionnaire Napoléon,<br />
Fayard 1995<br />
Jean Tranié et J.C. Carmigniani,<br />
Napoléon, la campagne d’Espagne,<br />
Pygmalion Gérard Watelet 1998<br />
65
La vie quotidienne d’une bourgeoise sous l’Empire<br />
personnelles et de charmants<br />
néologismes que relève Paul Cottin :<br />
« les marges contiennent parfois<br />
des petits croquis de circonstance ;<br />
est-elle triste ? Elle y trace une croix de<br />
grandeur différente selon le degré de<br />
tristesse. Rapporte-t-elle un événement<br />
heureux, c’est une étoile qu’elle<br />
dessine. L’accordeur est-il venu ? C’est<br />
un piano ; A-t-on moulu le café ? Un<br />
moulin à café ; reçu des ramoneurs ?<br />
Un manteau de cheminée. Remonté<br />
une pendule ? Un cadran. Appris la<br />
naissance d’un enfant ? Un berceau. »<br />
Ce journal est aussi une façon<br />
d’entrer dans l’intimité d’un couple.<br />
Lui, est prompt à la colère, artiste, il ne<br />
sait pas toujours monayer le prix de ses<br />
œuvres. Elle, fait souvent des reproches<br />
à Moitte de boire trop de tilleul, de se<br />
tenir trop près du feu, de pas ranger<br />
ses vêtements… petites querelles<br />
domestiques qui n’empêchent pas leur<br />
mutuel attachement.<br />
Malgré tout la santé de son mari<br />
n’est pas bonne. Des hémorroïdes<br />
persistantes le font souffrir ce qui le<br />
rend détestable. Madame Moitte utilise<br />
un terme pour noter sa mauvaise<br />
humeur : « il est "Miou miou" », dit-elle.<br />
Cependant il est aussi des moments<br />
de détente quand les Moitte recoivent<br />
leurs amis artistes, peintres, musiciens,<br />
sculpteurs, comme Van Loo, Houdon, le<br />
ménage voisin des Vien. Les diners sont<br />
abondants. En voici un exemple : soupe<br />
grasse, radis beurre cornichons, bouilli,<br />
deux poulets, petits pâtés côtelettes,<br />
poularde aux truffes, deux perdreaux,<br />
salade, choux-fleurs, charlotte, biscuit<br />
de Savoie et tartelettes, fromage et<br />
confiture, café et liqueurs, meringues,<br />
macarons, petits biscuits à la cuiller,<br />
bonbons et conserves, pêches.<br />
Comment imaginer aujourd’hui une<br />
telle quantité de mets pour un seul<br />
repas livré probablement par un<br />
traiteur ? Précisons que se joignent<br />
aussi à l’assemblée, les pensionnaires<br />
de la maison qui sont traités comme<br />
la famille. Ils participent aux jeux, à<br />
la musique. Leur logeuse les emmène<br />
au théâtre, aux marionnettes, voir les<br />
fantasmagories alors très à la mode. Il<br />
se rendent également au Panoramas<br />
un spectacle tout nouveau qui permet<br />
de voir défi ler des vues panoramiques.<br />
Parmi les cinq pensionnaires dont<br />
trois sont très jeunes, Louise a une<br />
place à part. Cette jeune fi lle dont<br />
le prénom apparaît souvent dans le<br />
journal, est à la fois une femme de<br />
chambre, une institutrice et une amie.<br />
Elle accompagne Madame Moitte<br />
dans ses courses et ses promenades.<br />
Toutes deux vont faire des emplettes<br />
de couture et de broderie : « j’ai<br />
été avec Louise d’abord rue des<br />
Bons Enfants chez un marchand<br />
d’étoffes sati-drap sati-vigogne que<br />
j’ai vu annoncer dans le Journal de<br />
l’Empire. On m’y a fait honnêteté et<br />
l’on m’a montré des étoffes de laine<br />
superbe et de beaux schalls ». À La<br />
vielleuse, magasin renommé, elle achète<br />
pour le jour de l’an quatre cravates à<br />
12 F chacune. Parmi les comptes sont<br />
en effet donnés les prix des achats<br />
vestimentaires ; robe de taffetas :<br />
65,50 F, Palatine : 48 et 30 F, fichu brodé<br />
laine et or 30 F, chapeau de taffetas :<br />
15 F, robe de toile anglaise : 26 F, châle<br />
croisé : 17 F. Ce sont des notations<br />
précieuses qui sont à mettre en parallèle<br />
avec les factures de Joséphine à qui l’on<br />
fait payer plus du double pour une robe<br />
en mousseline et vingt fois plus pour un<br />
châle !<br />
Coquette donc, malgré ses<br />
cinquante neuf ans, Madame Moitte<br />
soigne ses tenues. Elle détaille les<br />
vêtements qu’elle porte pour faire le<br />
« tracas du matin » (le ménage), les<br />
visites, aller à la campagne ou recevoir.<br />
Cependant toujours économe elle se<br />
prive de « gentillesses » renonçant<br />
par exemple aux chapeaux de chez<br />
Madame Colliau au Palais royal. La<br />
couturière est plus abordable qui<br />
transforme et confectionne. Pour<br />
le nouvel an la couturière apporte<br />
« une redingote blanche à collet de<br />
mousseline bouffante ; elle a emporté<br />
ma robe à palmettes pour la remonter<br />
sur un corsage qu’elle fera avec<br />
les manches pareilles ». Pour plus<br />
d’économie encore Madame Moitte est<br />
aussi capable de couper des chemises<br />
et des fichus, des jupons, des redingotes<br />
et elle raccomode son linge tandis<br />
que Louise brode avec ses cheveux.<br />
C’est notons-le ce qui se pratique<br />
dans la maison de l’impératrice, qui<br />
compte des teinturiers, dégraisseurs,<br />
raccomodeuses, blanchisseuses et<br />
couturières.<br />
Surmenée par ses tâches domestiques<br />
et tourmentée par des problèmes<br />
d’argent, Madame Moitte se sent de<br />
plus en plus fatiguée. Dès le début de<br />
l’année 1807, elle fait de longs séjours<br />
dans son lit, souffre de douleurs que<br />
les médecins ne diagnostiquent pas,<br />
pourtant elle est atteinte d’un cancer<br />
comme le sera la reine Hortense<br />
quelques trente ans plus tard, sans<br />
plus de chance de guérison. Elle se<br />
montre admirable de courage, toujours<br />
soucieuse de ses devoirs et continue<br />
jusqu’au bout à conduire sa maison<br />
avec l’aide de la fidèle Louise. La malade<br />
absorbe force tisanes, eau de cannelle,<br />
poudres contenant du quinquina ou de<br />
la rhubarbe. Cependant ni les omelettes<br />
à l’huile ni les sangsues, pauvres<br />
remèdes dérisoires, ne font reculer le<br />
mal de Madame Moitte dont le ventre<br />
ne cesse d’enfler. Elle s’éteint après<br />
beaucoup de souffrances à l’âge de<br />
soixante ans.<br />
Son mari Jean-Guillaume Moitte lui<br />
survivra trois ans.<br />
Exemple assez unique dans la<br />
production autobiographique, ce<br />
journal nous fait entrer de plain-pied<br />
dans une maison bourgeoise parisienne<br />
de l’Empire prenant le contre-pied<br />
des livres de souvenirs de la période<br />
napoléonienne. Curieusement il est<br />
fort peu question dans ces pages de<br />
l’Empereur et de la cour impériale.<br />
Madame Moitte a, nous l’avons vu<br />
d’autres soucis ; tout au plus est-il fait<br />
allusion à Napoléon quand celui-ci<br />
s’interesse à une statue de Desaix<br />
commandée au statuaire et nous<br />
apprenons incidemment que parmi les<br />
cadeaux achetés en étrennes il y a une<br />
boite dont le couvercle reproduit le<br />
portrait de Bonaparte.<br />
Tout dans ce texte montre que<br />
les préoccupations domestiques<br />
l’emportent sur celle de la patrie, une<br />
fois n’est pas coutume !<br />
■<br />
1 - Un ménage d’artistes sous le Premier Empire.<br />
Journal inédit de Madame Moitte, femme de<br />
Jean-Guillaume Moitte statuaire membre de<br />
l’Académie des Beaux Arts 1805-1807 ; publié<br />
avec des notes des dessins et un index par<br />
Paul Cottin, Paris 1932.<br />
74
La correspondance<br />
de Napoléon<br />
Juillet, août, septembre 1810<br />
Sélection Michel KERAUTRET<br />
Paris, 1 er juillet 1810. À Decrès,<br />
ministre de la Marine.<br />
Je désire envoyer cette année 1 500<br />
hommes à l’île de France. Il faudrait<br />
préparer pour cela trois expéditions,<br />
l’une à Brest, la seconde à Rochefort et<br />
une troisième à Cherbourg. Une fois<br />
qu’une de ces expéditions serait partie,<br />
on contremanderait les deux autres ou<br />
on leur donnerait une autre direction.<br />
Saint-Cloud, 4 juillet 1810.<br />
À Champagny, ministre des<br />
Relations extérieures.<br />
Ecrivez à mon ministre à Berlin et<br />
parlez au ministre de Prusse à Paris<br />
pour porter plainte et demander<br />
pourquoi on laisse entrer à Memel<br />
et à Stettin les marchandises<br />
sous pavillon américain qu’on a<br />
refusé de recevoir à Stralsund.<br />
Rambouillet, 8 juillet 1810. À<br />
Decrès, ministre de la Marine.<br />
Je viens de signer l’acte de réunion<br />
de la Hollande à la France. Il est<br />
indispensable que vous envoyiez<br />
quelqu’un pour reconnaître au vrai<br />
l’état de la marine hollandaise, et que<br />
vous me proposiez sa réorganisation,<br />
mon intention étant que tous<br />
les officiers civils et militaires<br />
soient employés à mon service.<br />
Rambouillet, 8 juillet 1810. À<br />
Lebrun, architrésorier de l’Empire.<br />
J’ai besoin de vos services en<br />
Hollande. Faites préparer vos<br />
équipages de voyage, et rendez-vous<br />
le plus tôt possible à Rambouillet<br />
pour y prendre vos instructions.<br />
Il est indispensable que vous<br />
partiez de Paris demain soir pour<br />
vous rendre à Amsterdam.<br />
Rambouillet, 10 juillet 1810. À<br />
Clarke, ministre de la Guerre.<br />
Je désire que vous preniez<br />
secrètement des informations sur la<br />
situation des armes dans le duché<br />
de Varsovie. Vous pouvez employer<br />
le sieur Serra, en lui recommandant<br />
toute la circonspection possible.<br />
Mon intention est d’avoir toujours<br />
dans ce pays une grande quantité<br />
d’armes, afin qu’en cas de besoin<br />
la population puisse s’en armer.<br />
Rambouillet, 11 juillet 1810. À Régnier,<br />
Grand Juge, ministre de la Justice.<br />
La cour criminelle de Foix<br />
a acquitté les assassins qui<br />
ont tué le maire de Mercenac,<br />
département de l’Ariège.<br />
Faites-moi un rapport là-dessus.<br />
Rambouillet, 12 juillet 1810. À Bigot<br />
de Préameneu, ministre des Cultes.<br />
Renouvelez aux préfets vos<br />
instructions sur la société de<br />
charité maternelle. Recommandezleur<br />
de vous envoyer la liste des<br />
personnes qui se font inscrire, pour<br />
la mettre sous mes yeux. Ne leur<br />
laissez point négliger cette affaire.<br />
Rambouillet, 13 juillet<br />
1810. À Hortense, reine de<br />
Hollande, à Plombières.<br />
Je vois que les lettres de Hollande<br />
vous sont enfin arrivées. On n’a<br />
point de nouvelles du roi ; on ne<br />
sait pas où il s’est retiré et l’on<br />
ne conçoit rien à cette lubie.<br />
75
Rambouillet, 14 juillet 1810.<br />
À Defermon, intendant général<br />
du Domaine extraordinaire.<br />
Il est nécessaire que vous occupiez<br />
sérieusement de mon domaine<br />
extraordinaire. Jusqu’ici, vous n’avez<br />
rien fait ; les affaires en souffrent,<br />
les particuliers en souffrent. Cela<br />
n’est conforme ni à votre réputation<br />
ni au bien de mon service.<br />
Saint-Cloud, 20 juillet 1810.<br />
À Madame Mère.<br />
Je m’empresse de vous apprendre<br />
que le roi de Hollande est aux eaux de<br />
Teplitz, en Bohême. Comme vous avez<br />
dû éprouver beaucoup d’inquiétude<br />
sur sa disparition, je ne perds pas<br />
un moment à vous donner cette<br />
nouvelle pour votre tranquillité. Sa<br />
conduite est telle qu’elle ne peut être<br />
expliquée que par son état de maladie.<br />
Paris, 21 juillet 1810. À Champagny.<br />
Je vous envoie des porcelaines<br />
que l’Impératrice désire envoyer<br />
à Vienne. Faites-les partir avec<br />
les lettres ci-jointes par un<br />
courrier, en lui recommandant<br />
de ne pas les casser en route.<br />
Saint-Cloud, 25 juillet<br />
1810. À Champagny.<br />
Les circonstances où se trouvent<br />
le Valais m’imposent l’obligation de<br />
prendre un parti sur ce petit pays,<br />
et j’ai résolu de le réunir à la France.<br />
Préparez un rapport dans lequel vous<br />
retracerez la mauvaise organisation du<br />
Valais, qui a donné lieu à sa conduite<br />
équivoque pendant la guerre, les<br />
ridicules prétentions du haut Valais,<br />
qui veut subjuguer le bas […]. Vous<br />
me ferez connaître à quel département<br />
il faudrait réunir le Valais.<br />
Saint-Cloud, 25 juillet 1810. À<br />
Montalivet, ministre de l’Intérieur.<br />
Ayant supprimé la plus grande<br />
partie des couvents à Rome, et<br />
voulant, autant que possible,<br />
maintenir le rang et l’importance de<br />
la population de cette grande ville, je<br />
désire y établir des manufactures et<br />
encourager la culture des cotons. On<br />
m’assure que les terres de Rome sont<br />
propres à cette culture, et qu’il y a une<br />
grande quantité de courants d’eau,<br />
dans les emplacements où étaient<br />
situés les couvents, qui peuvent servir<br />
comme moteurs des machines.<br />
Saint-Cloud, 18 août 1810. À<br />
Jérôme, roi de Westphalie.<br />
Je viens d’ordonner que mes<br />
troupes occupent tout le pays depuis<br />
le Holstein jusqu’à la Hollande, et dans<br />
cette mesure se trouve compris le pays<br />
situé entre Bremen et Vulhenburg. Je<br />
vous prie d’en retirer vos troupes.<br />
Saint-Cloud, 9 septembre<br />
1810. À Champagny.<br />
Il est nécessaire de faire une<br />
circulaire à mes ministres et agents<br />
à l’étranger sur l’élection du prince<br />
de Ponte-Corvo, pour qu’ils fassent<br />
sentir que je n’y suis pour rien, que<br />
c’est la volonté de la nation qui a<br />
tout fait, et qu’ils démentent tous ces<br />
bruits d’argent que j’aurais donné.<br />
Saint-Cloud, 11 septembre<br />
1810. À Champagny.<br />
Ecrivez au sieur Bourrienne que<br />
je suis étonné de l’explication qu’il<br />
donne sur le visa qu’il a mis au bas<br />
des ridicules certificats du sénat de<br />
Hambourg ; qu’il ne doit mettre sa<br />
signature nulle part ; que depuis<br />
longtemps on me porte plainte des<br />
opérations peu régulières qui auraient<br />
lieu à Hambourg ; qu’il doit éviter<br />
de s’attirer mon mécontentement.<br />
Saint-Cloud, 12 septembre 1810. À<br />
Joséphine, aux eaux d’Aix en Savoie.<br />
Mon amie, je reçois ta lettre du<br />
9 septembre. J’apprends avec plaisir<br />
que tu te portes bien. L’impératrice<br />
est effectivement grosse de quatre<br />
mois ; elle se porte bien et m’est fort<br />
attachée. Ma santé est assez bonne. Je<br />
désire te savoir heureuse et contente.<br />
On dit qu’une personne chez toi<br />
s’est cassé la jambe en allant à la<br />
glacière. Adieu, mon amie, ne doute<br />
pas de l’intérêt que je prends à toi<br />
et des sentiments que je te porte.<br />
Saint-Cloud, 16 septembre 1810.<br />
À Berthier, major général de<br />
l’armée d’Espagne (à Paris).<br />
Je suis instruit qu’un grand nombre<br />
d’Espagnols envoient leurs mérinos<br />
en France, et qu’un troupeau de<br />
10 000 moutons est en route pour<br />
s’y rendre. Donnez des ordres à tous<br />
mes généraux et autres autorités<br />
pour qu’on protège le mouvement<br />
de ces animaux sur la France.<br />
Saint-Cloud, 17 septembre<br />
1810. À Berthier.<br />
Le bruit d’un prétendu mariage du<br />
prince Ferdinand [d’Espagne] avec<br />
une princesse d’Autriche s’accrédite<br />
beaucoup. Il est important que vous<br />
écriviez à tous les commandants des<br />
corps d’armée en Espagne pour les<br />
prévenir que ce bruit est un enfant<br />
de l’oisiveté de Paris et un bavardage<br />
qui occupe les Parisiens ; qu’il n’a<br />
jamais été question de rien de pareil.<br />
Saint-Cloud, 20 septembre<br />
1810. À Champagny.<br />
Ecrivez en Prusse pour faire<br />
connaître que je désirerais que le<br />
gouvernement prussien mît à la<br />
sortie des grains des ports de Memel,<br />
Königsberg, Stettin et Kolberg, le<br />
même droit qu’à Danzig. L’Angleterre<br />
ayant besoin de blé, c’est une<br />
imposition qu’il sera utile et agréable<br />
à la Prusse de lever sur l’Angleterre.<br />
Expliquez cette théorie à mon<br />
chargé d’affaires et à mes consuls.<br />
76
Claudette JOANNIS<br />
Pierre de La Mésangère (1761-1831).<br />
Costume de Bal en Lévantine Garni de Martre.<br />
Planche 1035 des Costumes parisiens, 1810.<br />
Eau forte coloriée.<br />
Musée national de Malmaison et Bois-Préau.<br />
D<br />
eux mots peuvent nous interpeler dans cette<br />
description : lévantine et martre.<br />
La levantine est une étoffe de soie légère et unie<br />
originaire du Levant utilisée ici comme robe de bal. Quant à<br />
la martre, c’est un petit animal carnivore de la famille de la<br />
zibeline. Elle possède une fourrure soyeuse de teinte fauve<br />
qui fut toujours appréciée (pour les pinceaux entre autre). À<br />
défaut des luxueuses peaux de zibeline provenant de Russie,<br />
la marte était utilisée pour les manteaux ou en garniture<br />
comme ici sur les manches et sur le bas de la robe. On<br />
trouve dans l’inventaire après décès de l’impératrice<br />
Joséphine plusieurs mentions de manchon, tocque et<br />
garniture en « marthe » d’Éthiopie, du Canada et de<br />
Prusse.<br />
La jeune femme représentée sur cette gravure<br />
et dont la robe est largement décolletée, esquisse<br />
un pas de danse. Notre éditeur-promeneur<br />
La Mésangère a tout loisir d’observer les bals<br />
car, depuis le Directoire, la danse fait fureur<br />
dans les salons et les lieux publics. Avec les<br />
nouveaux codes du savoir vivre instaurés à la<br />
cour par Napoléon, les soirées sont souvent<br />
longues et ennuyeuses, aussi les bals sont-ils une<br />
distraction très prisée par les dames qui peuvent ainsi<br />
montrer leurs riches atours et leurs précieuses parures<br />
à commencer par l’Impératrice.<br />
Les principales danses en vogue sont alors la<br />
contre-danse, la gavotte, une survivance de l’ancien<br />
régime, la valse récemment introduite mais sous<br />
une forme différente de celle que nous connaissons. Il faut<br />
ajouter le bal masqué apprécié par l’empereur qui n’hésite pas<br />
pour passer (pense-t-il) inaperçu à revêtir un domino et un<br />
« loup », masque de tissu fourni par son parfumeur Teissier<br />
(il en subsite un en taffetas et à volants au musée de<br />
Provins).<br />
Dans les bals, les quadrilles sont les plus spectaculaires.<br />
Ils sont à thème, mimés par plusieurs figurants. C’est aussi<br />
un spectacle, attendu à la Cour pour la concurrence<br />
qui règne entre la reine Hortense et Caroline Murat.<br />
En 1812, la première organise le quadrille des incas<br />
dont tous les protagonistes sont habillés de costumes<br />
de fantaisie de péruviens et péruviennes, Hortense<br />
apparaissant en prêtresse du soleil. La même année,<br />
c’est Caroline qui met en scène le quadrille des<br />
étoiles et des constellations. Elle y apparaît avec sa<br />
sœur Pauline revêtue d’or, de pierres précieuses…<br />
L’impératrice Marie-Louise n’est pas la dernière à<br />
s’amuser de ces bals où elle se montre dans un<br />
costume de cauchoise (habitante du pays de Caux<br />
en normandie), loin de la réalité car sa jupe et son<br />
corset sont en velours boutonné d’or, garnis d’un<br />
fichu en mousseline bordé de dentelle de Malines…<br />
Déjà en 1801, le journal Le bon genre signalait :<br />
« Dans un bal masqué de société on ne voit plus<br />
aucun Arlequin ni Colombine ni Pierrot. Les<br />
costumes à la mode sont ceux de la Suisse et de<br />
notre ancienne province de Normandie. »<br />
■<br />
77
Trompette d’artillerie à cheval en tenue pendant la campagne d’Espagne en 1810.<br />
D’après une gravure milieu 19 e , anonyme, Coll. Part., D.R.<br />
L 18887 - 43 - F: 18,00 € - RD