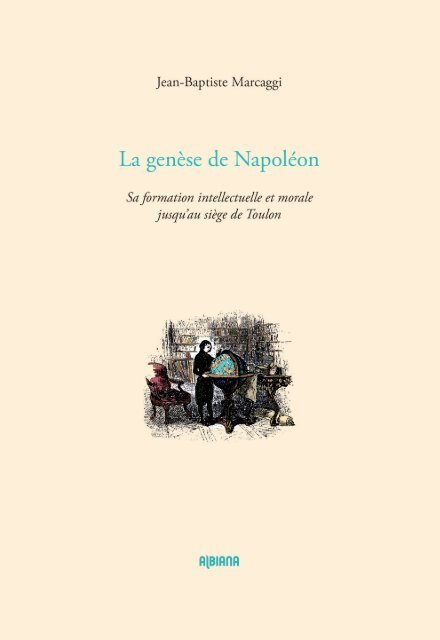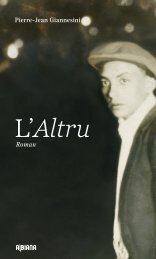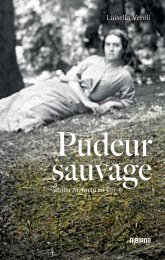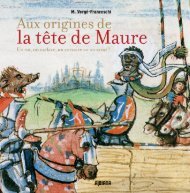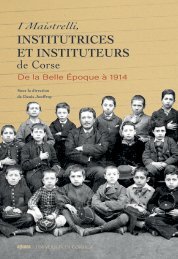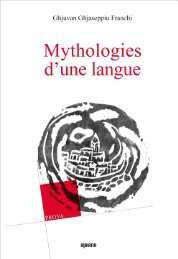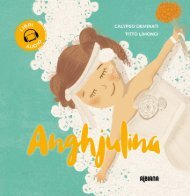You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Le présent ouvrage reprend intégralement l’édition originale publiée en 1902<br />
auprès <strong>de</strong> la Librairie académique Didier Perrin et C ie , libraires-éditeurs à Paris.
vv<br />
PRÉSENTATION<br />
<strong>La</strong> genèse <strong>de</strong> Napoléon, <strong>de</strong> Jean-Baptiste Marcaggi,<br />
entre exigence historique et passions ajacciennes<br />
Ils sont courageux ces Corses qui, ayant décidé <strong>de</strong> se consacrer à l’histoire <strong>de</strong> leur île, ont choisi<br />
d’y séjourner toute leur vie durant : Jean-Baptiste Marcaggi est <strong>de</strong> ceux-là.<br />
Sa Génèse <strong>de</strong> Napoléon est un ouvrage unanimement loué, non seulement pour ses<br />
qualités historiques, mais également parce que l’auteur maîtrise parfaitement l’environnement<br />
social <strong>de</strong>s Bonaparte et les particularités <strong>de</strong> la Corse du jeune Napoléon, l’ensemble<br />
dans un ouvrage ambitieux qui inscrit l’histoire particulière <strong>de</strong> cette famille corse dans les<br />
événements qui vont marquer l’île pendant le xviii e siècle : son siècle d’or.<br />
Certes, les recherches <strong>de</strong> Xavier Versini dans les archives <strong>de</strong>s procès qui éclairent les<br />
combats <strong>de</strong> l’archidiacre Lucien et <strong>de</strong> Charles Bonaparte pour s’imposer dans la notabilité<br />
ajaccienne, les travaux <strong>de</strong> Dorothy Carrington sur l’itinéraire personnel <strong>de</strong> Charles, les archives<br />
découvertes par Michel Vergé-Franceschi et enfin la reconstitution par Antoine-Marie Graziani<br />
<strong>de</strong> la société et <strong>de</strong> l’économie ajacciennes <strong>de</strong> la fin du xv e au milieu du xviii e siècles, tellement<br />
déterminantes pour l’ascension <strong>de</strong> la famille du futur empereur ; <strong>de</strong> tout cela, Jean-Baptiste<br />
Marcaggi ne disposait pas. Mais sa genèse reste unique par son parti-pris symphonique : toutes<br />
les sources et toutes les disciplines historiques, toutes les biographies <strong>de</strong>s personnalités du<br />
temps, toutes les gran<strong>de</strong>s dates <strong>de</strong> l’histoire du xviii e siècle corse confluent vers un récit unique<br />
qui donne toute sa singularité à l’extraordinaire aventure <strong>de</strong> Napoléon et <strong>de</strong>s Bonaparte. Une<br />
seule œuvre peut lui être comparée : le Napoléon d’Abel Gance ! Elle lui doit beaucoup : par<br />
exemple, nul doute que Pierre Bonardi, l’un <strong>de</strong>s conseillers <strong>de</strong> Gance, a puisé dans la Genèse<br />
l’importance donnée au personnage <strong>de</strong> Santo Ricci.<br />
Et pourtant Marcaggi connaît les écueils dangereux qui auraient pu entacher son travail<br />
d’historien : le parti-pris politique et la folklorisation <strong>de</strong> l’objet <strong>de</strong> sa recherche. Toute sa vie,<br />
il va chercher à s’en préserver. Comme beaucoup <strong>de</strong> Corses <strong>de</strong> sa génération, il aura à cœur<br />
<strong>de</strong> rechercher l’excellence afin <strong>de</strong> ne pas être réduit au triste qualificatif d’érudit local, quête<br />
d’autant plus ardue que la Corse du temps ne compte pas d’université.<br />
5
<strong>La</strong> genèse <strong>de</strong> Napoléon<br />
Cette absence, Jean-Baptiste Marcaggi va tenter d’y pallier par l’articulation dialectique<br />
entre la bibliothèque comme centre <strong>de</strong> recherche, et les confrontations d’articles publiés dans<br />
<strong>de</strong>s revues insulaires et parfois <strong>de</strong>s journaux parisiens. Le système a ses limites, bien sûr, parce<br />
que son activité n’est pas organisée à l’avance et fonctionne par opportunités plutôt que par<br />
programme, et que l’on n’archive pas le résultat <strong>de</strong> cours magistraux, <strong>de</strong> séminaires et <strong>de</strong><br />
thèses d’étudiants qui permettent <strong>de</strong> capitaliser un savoir et <strong>de</strong> le remettre perpétuellement<br />
en question.<br />
Mais Marcaggi a néanmoins trois atouts :<br />
D’abord il va être conservateur <strong>de</strong> la Bibliothèque patrimoniale d’Ajaccio, (<strong>de</strong> 1897 à 1909<br />
puis <strong>de</strong> 1929 à 1933) et il en connait parfaitement les fonds, ce qui lui permet d’appréhen<strong>de</strong>r<br />
parfaitement toute la bibliographie <strong>de</strong>s sujets auxquels il s’attelle, ce qui est le préalable<br />
impératif à toute recherche sérieuse.<br />
Ensuite il a accès à <strong>de</strong>s fonds qui ne sont pas accessibles à tous, comme le fonds<br />
Braccini-Frassetto, longtemps à la maison Bonaparte, dont il avait dépouillé <strong>de</strong>s documents<br />
qui éclairent les différentes phases d’aménagements ordonnés <strong>de</strong>puis le continent par les<br />
Bonaparte, ou programmés par leurs chargés d’affaires en Corse, dont l’un <strong>de</strong>s plus importants<br />
fut précisément Braccini-Frassetto. Dans la mesure où nombre <strong>de</strong> ses documents ont disparu,<br />
certaines références <strong>de</strong> Marcaggi n’en prennent que plus d’importance.<br />
Par exemple, c’est grâce à lui que l’on connait la provenance du mobilier du Salon <strong>de</strong><br />
Letizia, dans les aménagements fondamentaux menés à la Maison Bonaparte par la mère <strong>de</strong><br />
Napoléon lors du retour d’exil, en 1797, après la chute du royaume anglo-corse.<br />
Il s’agit plus précisément <strong>de</strong> l’acquisition du mobilier du salon chez le marchand <strong>La</strong>plane<br />
<strong>de</strong> Marseille : huit fauteuils, six chaises avec garnitures, douze sans garniture, une chaiselongue,<br />
un bois <strong>de</strong> lit avec son « palanquin », le tout pour 1 600 livres, le 22 septembre 1797.<br />
(J-B Marcaggi : Le souvenir <strong>de</strong> Napoléon à Ajaccio, Ajaccio, Rombaldi, 1921, P. 8).<br />
<strong>La</strong> maîtrise <strong>de</strong>s fonds d’archives difficiles d’accès a toujours fait la qualité <strong>de</strong>s travaux<br />
historiques, par exemple, Dorothy Carrington a donné un visage nouveau <strong>de</strong> Charles Bonaparte<br />
dans ses travaux sur les parents <strong>de</strong> Napoléon : les documents <strong>de</strong>s princes Napoléon n’étaient<br />
pas encore déposés aux archives nationales.<br />
Enfin, cet Ajaccien né à Bocognano le 12 décembre 1866 sous le Second Empire, chantre<br />
<strong>de</strong> la cité impériale et du plus illustre <strong>de</strong> ses fils, maniait (on l’a vu) une connaissance documentée<br />
et méthodique <strong>de</strong> l’histoire napoléonienne avec une connaissance quasi instinctive<br />
<strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vie et <strong>de</strong>s manières <strong>de</strong> voir le mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Corse traditionnelle qu’il ressourçait<br />
chaque été dans son village : Bocognano, le même que Napoléon se plaisait à évoquer<br />
à Sainte-Hélène :<br />
« Ce furent les Bocognanais qui firent capituler le général Eliott. C’était un village terrible.<br />
Ils étaient tous mes cousins. Les Anglais comprirent, quand dix-sept <strong>de</strong> ces gens, s’étant retranchés<br />
dans une embusca<strong>de</strong>, leur tuèrent cinquante-quatre <strong>de</strong>s leurs. Le général ordonna la<br />
retraite. Dans ce village, on pouvait, sur les cinquante cousins du général Bonaparte, pendre<br />
6
Présentation<br />
le premier venu, on était sûr qu’il l’avait mérité. C’étaient <strong>de</strong> terribles gens, une gran<strong>de</strong> puissance<br />
dans l’île que cette parenté du côté <strong>de</strong> Madame. »<br />
Marcaggi a grandi dans une société corse qui avait alors très peu évolué <strong>de</strong>puis le<br />
Second Empire et même <strong>de</strong>puis le dix-huitième siècle. Les changements les plus importants<br />
auront lieu avec la guerre <strong>de</strong> 14, puis dans ce temps qui va <strong>de</strong> 1945 aux années soixante, avec<br />
une accélération dans les années 2000.<br />
L’auteur confronte ainsi constamment cette Corse traditionnelle à celle qu’il voit évoluer<br />
sous ses yeux, mais jamais il n’évoque la Corse ancienne comme un passé idéal. Il cherche<br />
plutôt à y trouver ce qui conditionne la société insulaire <strong>de</strong> son temps. Son activité <strong>de</strong> journaliste<br />
y puise sa source, et il développe ses thématiques dans ses articles <strong>de</strong> A Tramuntana,<br />
<strong>de</strong> Santu Casanova, dont il fut le secrétaire général, <strong>de</strong> L’Écho <strong>de</strong> la Corse, L’Écho d’Ajaccio,<br />
L’Éveil, <strong>La</strong> Nouvelle Corse, L’Union… et dans ses récits d’écrivain, Il traite non seulement <strong>de</strong> la<br />
situation politique en Corse, mais également <strong>de</strong>s grands thèmes « anthropologiques » insulaires,<br />
quasi <strong>de</strong>s « invariants » historiques : <strong>La</strong> violence et la ven<strong>de</strong>tta, les bandits, l’opposition<br />
entre pastoralisme et agriculture : le manque d’exploitation <strong>de</strong>s forêts, les transports, la vaine<br />
pâture, le rôle <strong>de</strong>s bergers, les ravages <strong>de</strong>s chèvres… et l’on voit bien qu’à plus d’un siècle<br />
<strong>de</strong> distance, les sujets dont parle Marcaggi dans ses articles sur la Corse sont les mêmes que<br />
ceux dont parle Napoléon à Sainte-Hélène.<br />
« Son oncle l’archidiacre… il regrettait ses chèvres, les Génois, tout ce qu’il n’avait plus.<br />
Et plus loin :<br />
Par un sentiment contraire, Napoléon, dans ses premières années, déclamait souvent<br />
contre les chèvres qui sont nombreuses dans l’île, et causent <strong>de</strong> grands dégâts aux arbres.<br />
Il voulait qu’on les extirpât entièrement. … Il avait à ce sujet <strong>de</strong>s prises terribles avec le vieil<br />
archidiacre son oncle, qui en possédait <strong>de</strong> nombreux troupeaux et les défendait en patriarche.<br />
Dans sa fureur, il reprochait à son neveu d’être un novateur, et il accusait les idées philosophiques<br />
du péril <strong>de</strong> ses chèvres. »<br />
Dans son roman, Sabella, il démonte les rouages <strong>de</strong> la Corse traditionnelle tout en abordant<br />
les thèmes très contemporains <strong>de</strong> l’exil, <strong>de</strong> la recherche d’un mo<strong>de</strong> vie plus confortable,<br />
du renoncement <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntité…<br />
Autre source qui donne aux travaux <strong>de</strong> Marcaggi sa saveur toute particulière : <strong>de</strong>s anecdotes<br />
circulaient encore à Ajaccio, notamment dans les vieilles familles ajacciennes qui furent<br />
alliées aux Bonaparte, permettant <strong>de</strong> donner plus encore d’épaisseur aux années <strong>de</strong> formation<br />
du jeune Bonaparte. Un autre témoignage <strong>de</strong> ces survivances apparait dans la lecture <strong>de</strong>s<br />
articles du Docteur Barbaud sur la maison Bonaparte, lui qui fait parler corse Letizia Bonaparte<br />
dans un texte <strong>de</strong> 1924, en se référant aux souvenirs <strong>de</strong> la famille Paravisini.<br />
Le cercle <strong>de</strong> J.-B. Marcaggi et <strong>de</strong> ses amis, Lorenzo Vero, Henri Omessa, Jean Maki, Pierre<br />
Bonardi (le conseiller du tournage d’Abel Gance) ne négligent pas cette histoire parallèle et<br />
savent en tirer eux aussi les fruits, j’écrivais la saveur.<br />
7
<strong>La</strong> genèse <strong>de</strong> Napoléon<br />
Rien ne les agace plus que ceux qui, ne respectant pas le berceau <strong>de</strong> l’Empereur : la ville<br />
d’Ajaccio et plus largement la Corse, lancent <strong>de</strong>puis Paris ou le Continent en général un regard<br />
con<strong>de</strong>scendant sur ceux qui maintiennent le flambeau impérial dans la Cité qui a vu naitre<br />
Napoléon. Dès lors, Marcaggi se <strong>de</strong>man<strong>de</strong> comment Frédéric Masson peut être aussi enragé<br />
dans ses sentiments anti corses, et pourquoi il n’applique pas son excellente métho<strong>de</strong> historique<br />
qui lui a permis d’écrire <strong>de</strong>s lignes si pertinentes sur le grand Ajaccien, à l’histoire et à<br />
l’économie <strong>de</strong> la Corse contemporaine, au lieu <strong>de</strong> reprendre <strong>de</strong>s textes déjà anciens <strong>de</strong> Volney<br />
ou <strong>de</strong> Bour<strong>de</strong> pour accabler les insulaires. Il y aurait gagné en retenue et perdu ses partis-pris.<br />
<strong>La</strong> genèse <strong>de</strong> Napoléon Bonaparte se divise en quatre livres : le premier composé <strong>de</strong> trois<br />
chapitres est celui consacré à la Corse, à l’expérience démocratique <strong>de</strong> Paoli et à la famille<br />
<strong>de</strong> Napoléon, jusqu’à son départ pour Autun. Le <strong>de</strong>uxième est consacré à la formation du<br />
jeune officier à Autun, à Brienne et à l’école militaire <strong>de</strong> Paris, trois lieux : trois chapitres. Le<br />
troisième livre montre le jeune officier qui d’élève est en train <strong>de</strong> <strong>de</strong>venir un homme et se pose<br />
<strong>de</strong>s questions politiques, se cherche <strong>de</strong>s références, s’interroge sur l’avenir <strong>de</strong> la Corse et sur<br />
celui <strong>de</strong> sa famille, connait ses premières aventures sentimentales et s’essaie aux étu<strong>de</strong>s, aux<br />
nouvelles et aux « lettres sur » selon l’usage du temps. Le quatrième et <strong>de</strong>rnier livre est aussi<br />
le plus long : c’est celui consacré à la Révolution, il comprend dix chapitres : la Corse, « cette<br />
école primaire <strong>de</strong>s Révolutions » y est très présente. On y part <strong>de</strong> l’intégration à la France le<br />
30 novembre 1789 à la fuite <strong>de</strong>s Bonaparte <strong>de</strong> leur maison, pour s’attar<strong>de</strong>r sur le sujet central<br />
<strong>de</strong> l’ouvrage : la genèse et le développement <strong>de</strong> Napoléon. Le retour <strong>de</strong> Paoli en Corse est<br />
l’un <strong>de</strong>s moteurs <strong>de</strong> l’action.<br />
Le style <strong>de</strong> l’ouvrage est dicté par le parti-pris adopté par l’auteur : construit en une suite<br />
<strong>de</strong> séquences courtes et synthétiques, le récit ne veut pas outrepasser ce que les sources ont<br />
confirmé. Marcaggi est donc bref et ne s’étend guère sur les événements dont le film passe<br />
rapi<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>vant nos yeux. Mais toutes les séquences nous apportent un lot conséquent<br />
d’informations et peu à peu, les personnages s’étoffent et l’époque forme un décor <strong>de</strong> plus<br />
en plus précis. Notons au passage que ce style concis et direct correspond parfaitement à<br />
un courant majeur <strong>de</strong> la littérature française du temps qui succè<strong>de</strong> aux complications du<br />
xviii e siècle s’essayant à l’explication psychologique, et aux effusions romantiques du xix e siècle<br />
chères à Châteaubriand ; c’est le style <strong>de</strong> Balzac et <strong>de</strong> Maupassant, plus encore celui <strong>de</strong> Flaubert,<br />
<strong>de</strong> Renan ou <strong>de</strong> Barrès.<br />
Marcaggi, par son implication dans la gestion d’Ajaccio en tant que secrétaire général <strong>de</strong><br />
la Ville, par le rôle central qu’il assume en animant le cercle <strong>de</strong>s érudits locaux et historiens <strong>de</strong> la<br />
Corse <strong>de</strong>puis la bibliothèque municipale, par sa production personnelle qu’elle soit historique,<br />
ethnologique, littéraire ou politique, sait que si son engagement est constant et profond, il a<br />
pu être aussi diversement interprété : car lui qui s’est toujours tenu pour Républicain s’étonnera<br />
d’être taxé <strong>de</strong> Bonapartiste en raison <strong>de</strong> son activité.<br />
Historien compétent <strong>de</strong> l’émergence <strong>de</strong>s Bonaparte et fervent admirateur <strong>de</strong> Napoléon,<br />
sa place n’est pas évi<strong>de</strong>nte dans l’Ajaccio du temps.<br />
8
Présentation<br />
Se positionner comme républicain dans la cité impériale re<strong>de</strong>venue bonapartiste en<br />
1884 n’était pas chose facile, et à ce problème Marcaggi en rajoute un autre en entrant en<br />
conflit avec Emmanuel Arène, pourtant député républicain <strong>de</strong> 1886 à 1902. Mais une mutation<br />
profon<strong>de</strong> qui va influer longtemps sur la vie ajaccienne va se produire alors : ainsi que l’a<br />
étudié Charles Renucci, les Bonapartistes réactualisent la notion <strong>de</strong> Bonapartisme entre 1880<br />
et 1900, notamment autour du maire François-Xavier Pugliesi-Conti qui va organiser en 1899<br />
les célébrations du centenaire du Consulat. De politique, leur mouvement <strong>de</strong>vient plus culturel<br />
en valorisant l’i<strong>de</strong>ntité napoléonienne d’Ajaccio. Pour beaucoup, Marcaggi, <strong>de</strong> par ses travaux<br />
<strong>de</strong> premier plan sur le sujet, apparait alors comme un militant bonapartiste, il en rit :<br />
« Je suis républicain, parce que telles sont mes idées, tels sont mes sentiments, mais<br />
il m’est parfaitement égal qu’à la préfecture ou à L’Union on me considère comme un<br />
Bonapartiste échevelé. » <strong>La</strong> République, 24 décembre 1896.<br />
<strong>La</strong> réédition <strong>de</strong> <strong>La</strong> Genèse <strong>de</strong> Napoléon n’est pas seulement l’occasion <strong>de</strong> remettre à<br />
l’attention <strong>de</strong>s lecteurs un document exceptionnel par son souffle littéraire et son ambition<br />
historique, et qui plus est relatif à une pério<strong>de</strong> souvent sacrifiée <strong>de</strong> la vie <strong>de</strong> Napoléon<br />
Bonaparte ; c’est aussi une occasion <strong>de</strong> rendre hommage à la personnalité hors du commun <strong>de</strong><br />
Jean-Baptiste Marcaggi qui a réussi à conjuguer sa probité historique avec son engagement<br />
pour la Corse et pour Ajaccio.<br />
Jean-Marc Olivesi<br />
Conservateur général du patrimoine<br />
Musée national <strong>de</strong> la Maison Bonaparte
J.-B. Marcaggi<br />
<strong>La</strong> genèse <strong>de</strong> Napoléon<br />
Sa formation intellectuelle<br />
Et morale<br />
Jusqu’au siège <strong>de</strong> Toulon<br />
L’énergie est la vie <strong>de</strong> l’âme comme<br />
le principal ressort <strong>de</strong> la raison.<br />
Bonaparte, Discours sur le Bonheur.
vv<br />
livre premier<br />
L’ENFANT<br />
•<br />
CHAPITRE I er<br />
LES CORSES<br />
À travers les siècles, les Corses ont conservé une âme semblable à celle <strong>de</strong> ces barbares,<br />
dont parlent Diodore <strong>de</strong> Sicile et Strabon, qui, emmenés prisonniers à Rome, ne supportaient<br />
point <strong>de</strong> vivre dans l’esclavage.<br />
Divers peuples envahissent leur île, et ils persistent à défendre leur indépendance<br />
avec opiniâtreté, ils <strong>de</strong>meurent impatients <strong>de</strong> tout joug, irréductibles.<br />
Ce sentiment absolu <strong>de</strong> l’indépendance, exclusif même, avec celui <strong>de</strong> la famille,<br />
chez les Corses, s’est développé, fortifié, exaspéré en eux sous l’action <strong>de</strong> leur double<br />
qualité d’insulaires et <strong>de</strong> montagnards.<br />
<strong>La</strong> Corse est une île dont la côte est articulée en une multitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> golfes et <strong>de</strong> fjords ;<br />
le sol y est granitique, montagneux, âpre, tourmenté ; une chaîne <strong>de</strong> montagnes traverse<br />
l’île du nord au sud et <strong>de</strong> cette arête centrale se détachent <strong>de</strong> nombreux chaînons aux<br />
pentes abruptes, rapi<strong>de</strong>s, qui <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nt jusqu’à la mer, partagent l’île en une série <strong>de</strong><br />
vallées longues, étroites, aux gorges sauvages, inaccessibles.<br />
À cause <strong>de</strong> la sûreté <strong>de</strong> ses mouillages, <strong>de</strong> la profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> ses forêts, la Corse <strong>de</strong>vait<br />
subir l’attraction <strong>de</strong>s puissances continentales qui l’avoisinaient.<br />
Or, les Corses, par leur isolement, se trouvaient situés en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s grands mouvements<br />
historiques <strong>de</strong>s peuples européens. Ils avaient, partant, le particularisme <strong>de</strong>s insulaires,<br />
et, en outre, l’endurance, l’énergie, l’agilité <strong>de</strong> peupla<strong>de</strong>s primitives placées dans<br />
<strong>de</strong>s conditions d’existence difficiles, habituées à défendre chaque jour leur vie contre<br />
les fauves qui peuplaient leurs forêts. Ils déployèrent donc contre leurs envahisseurs<br />
l’énergie <strong>de</strong> races viriles, trempées pour la lutte, et, s’ils ne furent pas assez en nombre<br />
pour assurer leur complète indépendance, ils purent, du moins, se soustraire pendant<br />
longtemps à toute domination étrangère.<br />
13
L’ENFANT<br />
<strong>La</strong> disposition du sol les y aida. Refoulés <strong>de</strong>s plaines douces du littoral, ils formèrent<br />
<strong>de</strong>s agglomérations tout au bout <strong>de</strong> leurs vallées escarpées, d’étroites cuvettes où la<br />
guerre <strong>de</strong>venait impossible, où eux et leurs troupeaux se nourrissaient <strong>de</strong>s produits<br />
spontanés du sol et <strong>de</strong>s forêts. D’insulaires, les Corses <strong>de</strong>vinrent ainsi <strong>de</strong>s montagnards.<br />
Et, comme les communications d’une vallée à l’autre étaient, par suite <strong>de</strong> l’absence <strong>de</strong><br />
routes, presque impraticables, leur particularisme d’insulaires se trouva renforcé par<br />
leur particularisme <strong>de</strong> montagnards.<br />
Enserrés dans d’étroites vallées, les Corses ne formaient, dans leurs divers groupements,<br />
que <strong>de</strong>s tribus, et ils s’attachèrent avec d’autant plus <strong>de</strong> force à leurs familles que,<br />
privés <strong>de</strong> toute relation avec le mon<strong>de</strong> extérieur, elles bornaient leur horizon moral.<br />
Ainsi, la mer isola les Corses du mon<strong>de</strong> entier ; la montagne resserra les liens <strong>de</strong> la<br />
famille et ajouta à leur isolement 1 De cette façon, la race put se préserver pure <strong>de</strong> tout<br />
mélange, conserver intactes ses coutumes et ses mœurs. Diodore <strong>de</strong> Sicile observa que<br />
les Corses « vivaient ensemble et pratiquaient les principes <strong>de</strong> la justice et <strong>de</strong> l’humanité<br />
». Ils étaient sobres, tempérants, se nourrissaient <strong>de</strong> lait, <strong>de</strong> miel, <strong>de</strong> racines, ne<br />
connaissaient que l’art pastoral.<br />
Or, pendant les ru<strong>de</strong>s saisons d’hiver, ils étaient contraints <strong>de</strong> <strong>de</strong>scendre aux plaines<br />
du bord <strong>de</strong> la mer, aux marines, pour y trouver <strong>de</strong>s pâturages. C’est là que, <strong>de</strong> cette même<br />
mer qui les isolait, <strong>de</strong>s peuples étrangers, montés sur <strong>de</strong>s vaisseaux, Étrusques, Phocéens,<br />
Carthaginois, Romains, puis Vandales, Goths, Lombards, et surtout Sarrasins, venaient<br />
les assaillir, s’emparer <strong>de</strong> leurs troupeaux, saccager leurs cabanes et les emmener euxmêmes<br />
en esclavage. Ces bergers noma<strong>de</strong>s, au lieu d’être <strong>de</strong>s contemplatifs, vivaient<br />
donc sur un pied <strong>de</strong> guerre. Pour déjouer les ruses, les coups <strong>de</strong> main brusques d’un<br />
ennemi redoutable, ils avaient constamment l’esprit alerte. Pour mieux résister à ses<br />
assauts, ils liguaient leurs forces.<br />
Des feux allumés d’une colline à l’autre signalaient l’apparition <strong>de</strong>s flottes à l’horizon.<br />
Ce sentiment commun, impérieux, <strong>de</strong> la défense du sol était le seul lien national.<br />
Cet état <strong>de</strong> guerre se prolongea jusqu’au x e siècle ; il ne laissa se développer chez<br />
les Corses que l’instinct guerrier. Leur groupement social n’était qu’une formation <strong>de</strong><br />
combat ; la famille d’abord, placée sous la toute-puissance paternelle, et la fédération<br />
<strong>de</strong>s familles d’une même vallée, c’est-à-dire le clan, ayant pour chef l’homme doué<br />
d’une trempe d’âme supérieure à celle <strong>de</strong> ses compagnons. Dans chaque région, il y<br />
avait donc une espèce d’État autonome.<br />
1. Cf. Ratzel, Étu<strong>de</strong> anthropogéographique sur la Corse.<br />
14
LES CORSES<br />
Mais les Corses n’étant adonnés qu’à l’art pastoral, n’étant pas courbés vers les<br />
ru<strong>de</strong>s labeurs <strong>de</strong> la terre, n’étant pas soumis au joug <strong>de</strong>s lois, à une discipline sociale,<br />
avaient l’esprit inquiet, remuant, et ils étaient d’autant plus travaillés par les passions<br />
que leurs âmes, dominées par l’anxiété <strong>de</strong> la mort, subissaient les émotions avec la<br />
violence, la fougue <strong>de</strong> tempéraments intacts, chez qui la sensibilité, comprimée par la<br />
pression du <strong>de</strong>hors, éclatait d’un jet.<br />
Aussi bien, quand, au x e siècle, les dangers extérieurs cessèrent, les Corses, qui<br />
ne connaissaient d’autre activité que la guerre, furent-ils en proie à la guerre civile.<br />
L’autorité <strong>de</strong> quelques chefs <strong>de</strong> clan s’était, en effet, étendue avec le temps, et ils<br />
avaient acquis la toute-puissance <strong>de</strong> barons féodaux. Ayant été trempés pour les<br />
luttes violentes, ces guerriers ne pouvaient se résoudre à l’inaction, au repos, et encore<br />
moins aux paisibles travaux <strong>de</strong>s champs. Leur esprit, n’ayant jamais connu <strong>de</strong> frein,<br />
était remuant, leur volonté impétueuse, et ils étaient exclusivement avi<strong>de</strong>s <strong>de</strong> pouvoir<br />
et <strong>de</strong> domination. Ils luttèrent donc d’influence pour établir leur suprématie dans<br />
l’île. Ces luttes <strong>de</strong> factions s’exaspérèrent au conflit <strong>de</strong>s puissances continentales,<br />
Pise, Gènes, l’Espagne, le Saint-Siège, qui les entretenaient à <strong>de</strong>ssein afin d’asseoir<br />
leur domination en Corse. Mais, <strong>de</strong> temps à autre, un chef belliqueux surgissait, qui<br />
faisait taire les haines locales dans une assemblée populaire, une Consulte, et liguait<br />
une partie <strong>de</strong>s forces nationales contre les pouvoirs étrangers. Trop divisés pour<br />
s’affranchir complètement <strong>de</strong> leurs oppresseurs, les Corses, néanmoins, purent leur<br />
résister en déployant une énergie indomptable.<br />
Ayant échappé à l’influence <strong>de</strong> civilisations avancées, au xvi e siècle l’état primitif<br />
<strong>de</strong>s Corses s’était maintenu invariable. Ils étaient exclusivement bergers et pratiquaient<br />
le libre pacage sur <strong>de</strong> vastes étendues <strong>de</strong> terrains communaux ; la propriété dans l’île était<br />
incertaine ; il n’y avait pas <strong>de</strong> routes, pas <strong>de</strong> commerce, pas d’industrie ; les habitants<br />
échangeaient leurs produits, fabriquaient eux-mêmes leur drap en poils <strong>de</strong> chèvre. Leurs<br />
mœurs étaient patriarcales, simples, égalitaires ; ils étaient sobres, hospitaliers, mâles,<br />
graves, ar<strong>de</strong>nts, comme les natures concentrées, dans leurs haines et leurs affections ; leur<br />
vie libre, sans la contrainte <strong>de</strong>s lois, dans la permanence du danger, avait entretenu en<br />
eux le corps souple, l’intelligence alerte, et leur esprit s’était encore aiguisé au choc <strong>de</strong>s<br />
factions, s’était délié dans la ruse, avait acquis le goût <strong>de</strong> l’intrigue. Mais ces insulaires<br />
étant perpétuellement secoués par les angoisses <strong>de</strong> la vie à défendre, le fond <strong>de</strong> leur<br />
tempérament restait emporté et violent. Avec la spontanéité <strong>de</strong>s natures primitives,<br />
leurs émotions se traduisaient instantanément en actes, le geste suivant la pensée, et ils<br />
passaient soudainement d’un extrême à l’autre.<br />
15
L’ENFANT<br />
Ainsi, au moment où se produisait en Europe la Renaissance artistique et littéraire,<br />
la Corse se débattait encore dans les affres <strong>de</strong> la guerre civile et étrangère ; pas un<br />
instant elle n’avait joui d’une paix stable ; pas un instant elle n’avait pu apprécier les<br />
bienfaits d’une justice exacte. Les Corses ne connaissaient que le droit du plus fort, du<br />
plus belliqueux ; par suite, ils ne pouvaient concevoir aucun idéal supérieur d’art ou <strong>de</strong><br />
littérature ; leur seul idéal était l’idéal militaire ; leur seule littérature, <strong>de</strong>s improvisations<br />
sur <strong>de</strong>s parents morts. Étreints par les réalités tragiques <strong>de</strong> la vie, leurs idées ne pouvaient<br />
point être spéculatives, mais étaient plutôt <strong>de</strong>s actes. Deux sentiments simples emplissaient<br />
leur âme : la famille et l’indépendance. Une seule vertu était nécessaire pour<br />
les protéger : le courage guerrier. Leur particularisme <strong>de</strong> montagnards les empêchant<br />
d’avoir <strong>de</strong>s points <strong>de</strong> comparaison avec d’autres peuples et d’autres civilisations, la<br />
dure nécessité ne leur permettait d’apprécier que la virilité et l’énergie ; par-<strong>de</strong>ssus tout,<br />
ils s’enthousiasmaient pour les énergies guerrières puissantes. Et, comme, dans leurs<br />
rencontres avec d’autres peuples, ils s’étaient montrés souvent supérieurs en énergie,<br />
ils avaient l’exaltation <strong>de</strong> soi, un orgueil indicible d’hommes libres. Deux chroniqueurs<br />
corses contemporains nous ont laissé <strong>de</strong>s indications sur la tendance exclusive <strong>de</strong> leur<br />
esprit : « Ils se battent, a dit Filippini, parce qu’ils viennent au mon<strong>de</strong> avec un esprit<br />
ru<strong>de</strong> et batailleur et surtout parce que les combats et les armes sont le glorieux apanage<br />
<strong>de</strong>s hommes libres et <strong>de</strong>s braves. » Pietro Cyrneo a écrit, d’autre part : « Ils préfèrent<br />
la guerre au repos, et, si l’ennemi leur manque au <strong>de</strong>hors, ils le cherchent au <strong>de</strong>dans. Ils<br />
ont le corps agile et l’esprit remuant. Presque tous suivent la carrière militaire et n’estiment<br />
rien tant que leurs coursiers et leurs armes. » Pourquoi, avec leur vie rustique,<br />
auraient-ils aspiré au gain ? Pourquoi, au milieu <strong>de</strong>s anxiétés mortelles qui les agitaient,<br />
qui tendaient leur volonté à l’extrême, auraient-ils pu s’absorber dans les hautes spéculations<br />
ou les fines nuances <strong>de</strong> la pensée ?<br />
C’est ainsi que, lorsque la république <strong>de</strong> Gênes eût anéanti le pouvoir féodal<br />
dans l’île, les Corses, dans leur expansion à l’étranger, ne furent exclusivement que <strong>de</strong>s<br />
soldats. Leur trempe d’âme spéciale les fit distinguer parmi les milices <strong>de</strong> l’époque 2 .<br />
Quelques-uns même y acquirent la célébrité. On en rencontrait à Venise, à Naples, à<br />
Rome, dans le royaume d’Aragon, à Alger, et ils formaient la majeure partie <strong>de</strong>s fameuses<br />
Ban<strong>de</strong>s Noires <strong>de</strong> Jean <strong>de</strong> Médicis. Vieilleville, du Bellay, <strong>de</strong> Thou, d’Aubigné, ont eu<br />
<strong>de</strong>s mentions spéciales pour la bravoure <strong>de</strong>s Corses, « <strong>de</strong>s hommes vaillants, impétueux,<br />
nés pour les combats, ennemis du repos », ainsi qu’on l’a noté au xvi e siècle, dans une<br />
inscription murale du Vatican. Et Brantôme, un fin connaisseur en courage, a pu écrire :<br />
2. Cf. X. Poli. Histoire militaire <strong>de</strong>s Corses au service <strong>de</strong> la France, t. I.<br />
16
LES CORSES<br />
« Ils ne se retirent jamais <strong>de</strong> la lutte que couverts <strong>de</strong> plaies, après avoir combattu en<br />
braves soldats quasi enragés et vrais Corses, laquelle nation a <strong>de</strong>s plus courageux <strong>de</strong> toute<br />
l’Italie. » Leur tempérament <strong>de</strong> Corses inquiets, impatients du joug était si marqué<br />
qu’Henri IV écrivant à Sully se plaignait que le maréchal d’Ornano « fît le Corse à<br />
toute outrance 3 ».<br />
Les Génois renforcèrent cette direction d’esprit <strong>de</strong>s Corses. Maîtres <strong>de</strong>s places<br />
fortes du littoral, au lieu <strong>de</strong> canaliser vers l’agriculture, l’industrie, le commerce,<br />
l’énergie fougueuse <strong>de</strong> ce peuple altier, indocile, ils prétendirent le soumettre par la<br />
force en l’accablant sous <strong>de</strong>s mesures coercitives ; ils lui refusèrent le droit d’enseigner, le<br />
droit <strong>de</strong> défense, l’admission aux emplois, l’exaspérèrent enfin par la honteuse injustice<br />
<strong>de</strong> la justice. Le montagnard corse resta ainsi un homme <strong>de</strong> guerre, un oisif. Les lois ne<br />
protégeant point le citoyen, chacun, dans l’orgueil <strong>de</strong> sa virilité, <strong>de</strong>manda à ses propres<br />
armes le droit <strong>de</strong> se faire justice soi-même, et la Ven<strong>de</strong>tta exerça ses ravages. Le sentiment<br />
<strong>de</strong> la conservation personnelle était l’unique moteur <strong>de</strong>s Corses. Pour mieux se<br />
défendre contre l’anarchie ambiante, favorisée à <strong>de</strong>ssein par les Génois, ils resserrèrent<br />
les liens du sang jusqu’à <strong>de</strong>s <strong>de</strong>grés inconnus, dans une pensée <strong>de</strong> protection mutuelle.<br />
Leurs mœurs se maintinrent ainsi sanguinaires, l’inquiétu<strong>de</strong> <strong>de</strong> leur esprit très vive,<br />
accrue par le danger <strong>de</strong> la mort qui les guettait, à la première impulsion d’un adversaire<br />
à la sensibilité frémissante. Leurs âmes oscillaient entre <strong>de</strong>ux passions contraires :<br />
l’affection <strong>de</strong>s siens, la haine <strong>de</strong>s adversaires, passions forcenées allant jusqu’à la mort,<br />
et, chez tous, il y avait la haine du Génois, source <strong>de</strong> tous les maux.<br />
Au début du xviii e siècle, cette haine du Génois absorba toutes les divisions individuelles.<br />
Durant ces <strong>de</strong>ux siècles d’oppression, <strong>de</strong>s contacts permanents avaient été<br />
entretenus, en effet, par suite <strong>de</strong> l’expansion <strong>de</strong>s soldats corses à l’étranger, entre les<br />
insulaires et les peuples continentaux. À cette époque, il y avait dans l’île une jeunesse<br />
instruite, qui avait passé par les universités d’Italie, un noyau d’anciens officiers ayant<br />
guerroyé à travers le mon<strong>de</strong>, et surtout un clergé éclairé. Cette classe supérieure <strong>de</strong> l’île<br />
accusait les <strong>de</strong>ux traits prépondérants <strong>de</strong> la race : le culte <strong>de</strong> la famille, le sentiment<br />
absolu <strong>de</strong> l’indépendance. Comme pour le <strong>de</strong>rnier montagnard, leur philosophie à tous<br />
se résumait dans la passion <strong>de</strong> la liberté, la haine <strong>de</strong> toute domination.<br />
Ce furent ces Corses éclairés, cette jeunesse ar<strong>de</strong>nte, ce clergé patriote qui provoquèrent<br />
contre les Génois le mouvement insurrectionnel, épique, qui dura quarante<br />
ans, et fut appelé Guerre <strong>de</strong> l’Indépendance. Ils se signalèrent à l’attention <strong>de</strong> l’Europe<br />
par leur mâle amour <strong>de</strong> la liberté, leur patriotisme fougueux et tenace, leurs manifestes<br />
3. Henri IV, Lettres missives, t. VI.<br />
17
L’ENFANT<br />
véhéments, leur intrépidité dans les combats. <strong>La</strong> Corse était <strong>de</strong>venue une nation, et<br />
tous ces défenseurs du sol natal s’appelaient eux-mêmes <strong>de</strong>s patriotes.<br />
En Europe, ils étaient considérés comme <strong>de</strong>s héros, <strong>de</strong> farouches soutiens <strong>de</strong> la<br />
liberté. Pour les peuples appelés à les combattre, ils étaient soit <strong>de</strong>s soldats d’élite, animés<br />
du plus pur patriotisme, soit <strong>de</strong>s brigands. C’est ainsi que les Français les jugeaient diversement4.<br />
L’impression générale était plutôt favorable aux Corses ; ils reconnaissaient<br />
en eux la trempe <strong>de</strong> soldats énergiques et audacieux ; une fermeté d’âme extraordinaire<br />
qui leur faisait affronter la mort froi<strong>de</strong>ment ; un orgueil immense, ingénu, les conduisant<br />
à traiter d’égal à égal avec les personnages les plus éminents ; un esprit alerte, rusé,<br />
perspicace, se plaisant dans les intrigues ; une ambition démesurée pour le pouvoir et<br />
les honneurs ; une passion exclusive pour la politique qui les faisait s’intéresser aux<br />
intérêts <strong>de</strong> la nation comme aux leurs propres ; un don <strong>de</strong> parole si naturel qu’il allait<br />
souvent jusqu’à l’éloquence ; une paresse invincible pour les travaux serviles ; un dédain<br />
pour l’agriculture, les arts, l’industrie ; une mobilité déconcertante, sous l’influence <strong>de</strong>s<br />
passions actives qui les agitaient, qui les rendaient vindicatifs à l’excès et les jetaient<br />
soudainement dans <strong>de</strong>s résolutions extrêmes. En un mot, un peuple primitif, sobre,<br />
hospitalier, à l’esprit inculte, mais souple, vif, au caractère violent, à l’âme inquiète.<br />
•<br />
4. « Lors <strong>de</strong> la guerre <strong>de</strong> Corse, a dit Napoléon dans le Mémorial (édit. <strong>de</strong> 1823, t. III, p. 408), aucun <strong>de</strong>s<br />
Français qui étaient venus dans l’île n’en sortait tiè<strong>de</strong> sur le caractère <strong>de</strong>s montagnards ; les uns en étaient<br />
pleins d’enthousiasme, les autres ne voulaient y voir que <strong>de</strong>s brigands. »
vv<br />
CHAPITRE III<br />
LA CONQUÊTE DE LA CORSE<br />
ET L’ENFANCE DE NAPOLÉON<br />
Conquête <strong>de</strong> la Corse. – M. <strong>de</strong> Vaux. – Naissance <strong>de</strong> Napoléon. –<br />
<strong>La</strong> famille Bonaparte. – M. <strong>de</strong> Marbeuf. – Les États <strong>de</strong> Corse. –<br />
Rivalité <strong>de</strong> Narbonne et <strong>de</strong> Marbeuf. – Rôle <strong>de</strong> Charles Bonaparte. –<br />
Premières années <strong>de</strong> Napoléon. – Charles Bonaparte nommé<br />
député <strong>de</strong> la noblesse. – Départ <strong>de</strong> Napoléon pour Autun.<br />
Sous l’habile gouvernement <strong>de</strong> Paoli, la Sérénissime République, bloquée dans ses<br />
places fortes du littoral et réduite à l’impuissance, avait intercédé l’appui <strong>de</strong> la France,<br />
qui, par le traité <strong>de</strong> Compiègne (7 août 1764), s’était engagée à maintenir pendant<br />
quatre ans la possession <strong>de</strong> Gênes, moyennant la renonciation <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux millions qu’elle<br />
lui avait prêtés. Aussitôt après, M. <strong>de</strong> Marbeuf était venu en Corse, avec six bataillons,<br />
occuper les places fortes d’Ajaccio, Bastia, Calvi, Saint-Florent et Algajola.<br />
Corses et Français vivaienwt dans d’excellents rapports. Comme Choiseul caressait<br />
le projet d’annexer la Corse pour dédommager la France <strong>de</strong> la perte du Canada et lui<br />
assurer la suprématie dans la Méditerranée et le Levant, le chef du corps d’occupation,<br />
M. <strong>de</strong> Marbeuf, avait reçu, sans aucun doute, <strong>de</strong> son gouvernement <strong>de</strong>s instructions<br />
précises pour gagner la confiance <strong>de</strong>s insulaires, mais <strong>de</strong>s affinités réelles existaient<br />
entre les Français et les Corses ; elles remontaient à cette pério<strong>de</strong> du règne <strong>de</strong> Henri II, à<br />
laquelle s’attachait le souvenir du héros national, Sampiero, où ils avaient lutté ensemble,<br />
où même, pendant <strong>de</strong>ux ans, l’île avait été française, et elles s’étaient réveillées quelques<br />
années auparavant, sous la bienfaisante administration <strong>de</strong> M. <strong>de</strong> Cursay.<br />
23
L’ENFANT<br />
Or, tandis que les Français stationnés en Corse faisaient montre d’intentions pacifiques.<br />
M. <strong>de</strong> Choiseul poursuivait avec ténacité son projet d’annexion <strong>de</strong> ce pays. Une<br />
correspondance diplomatique 1 très active était engagée entre le cabinet <strong>de</strong> Versailles<br />
et celui <strong>de</strong> Corté. M. <strong>de</strong> Choiseul avait offert à Paoli <strong>de</strong>s honneurs et <strong>de</strong>s avantages<br />
personnels considérables au cas où il aurait voulu favoriser ses <strong>de</strong>sseins. Le patriote<br />
corse éluda poliment les offres, s’opposa avec fermeté à tout empiétement sur l’indépendance<br />
<strong>de</strong> son pays. M. <strong>de</strong> Choiseul, alors, ne prit même pas la peine <strong>de</strong> déguiser<br />
qu’il avait pour lui la force. Il employa avec Paoli ce ton hautain qui faisait le propre <strong>de</strong><br />
son caractère et dont il se servait même à l’occasion avec ses collègues du cabinet. Les<br />
négociations se prolongèrent ainsi jusqu’au mois <strong>de</strong> juillet 1767 sans pouvoir aboutir à<br />
un modus vivendi. Sur ces entrefaites, un événement imprévu vint brusquer la situation.<br />
Les Jésuites ayant été chassés d’Espagne, la république <strong>de</strong> Gênes, sans égard pour le roi<br />
qui les avait expulsés <strong>de</strong> France en 1763, à l’instigation <strong>de</strong> M. <strong>de</strong> Choiseul, leur donna<br />
la Corse comme asile et dans <strong>de</strong>s postes occupés par <strong>de</strong>s Français. À la Cour, il y eut un<br />
mécontentement très vif. Le 25 juillet, M. <strong>de</strong> Choiseul écrivit à M. <strong>de</strong> Marbeuf d’avoir à<br />
évacuer la Corse. Les Français n’avaient pas plus tôt quitté Ajaccio et Algajola que Paoli<br />
s’en était rendu maître. Les négociations entre Paoli et M. <strong>de</strong> Choiseul <strong>de</strong>vinrent alors,<br />
par l’intermédiaire <strong>de</strong> M. <strong>de</strong> Buttafoco, officier corse au Royal-Italien, très pressantes.<br />
Paoli resta inflexible sur le point décisif <strong>de</strong> la question : la prétention <strong>de</strong>s Français à<br />
opérer une mainmise sur la Corse. Aussitôt M. <strong>de</strong> Choiseul se ravisa. Il donna avis que<br />
le traité <strong>de</strong> Compiègne n’expirait qu’au mois d’août 1768 et que, jusque-là, les troupes<br />
françaises <strong>de</strong>vaient occuper, au nom <strong>de</strong> Gênes, les villes maritimes <strong>de</strong> la Corse. Puis il<br />
engagea, en sous-main, <strong>de</strong>s pour parlers avec la république ligurienne, tout en faisant<br />
traîner en longueur les négociations avec Paoli, pour l’empêcher <strong>de</strong> recourir à une<br />
puissance étrangère. Gênes, qui avait été effrayée <strong>de</strong> la perte d’Ajaccio et d’Algajola,<br />
se rendait parfaitement compte qu’à l’expiration du traité <strong>de</strong> Compiègne elle n’aurait<br />
pas été <strong>de</strong> force à lutter contre les nationaux corses. Elle accepta donc un arrangement<br />
avec la France. Le 15 mai 1768, M. <strong>de</strong> Choiseul et Dominique Sorba, ambassa<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> la<br />
Sérénissime République, signaient à Versailles un traité aux termes duquel Gênes cédait<br />
à la France ses droits sur la Corse, moyennant l’acquit <strong>de</strong> sa <strong>de</strong>tte et une subvention <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ux millions <strong>de</strong> livres, sous réserves, cependant, que cette possession ne pourrait être<br />
cédée par la France à aucune autre puissance sans le consentement <strong>de</strong> Gênes, et que, au<br />
contraire, elle serait remise à la République lorsque celle-ci serait en état <strong>de</strong> rembourser<br />
1. Cf. Bulletin <strong>de</strong>s Sciences historiques <strong>de</strong> la Corse, année 1884.<br />
24
TABLE DES MATIÈRES<br />
LIVRE I<br />
L’ENFANT<br />
I. – Les Corses .............................................................................................................................................................. 13<br />
II. – Paoli .................................................................................................................................................................... 19<br />
III. – <strong>La</strong> conquête <strong>de</strong> la Corse et l’enfance <strong>de</strong> Napoléon :<br />
Conquête <strong>de</strong> la Corse. – M. <strong>de</strong> Vaux. – Naissance <strong>de</strong> Napoléon. – <strong>La</strong> famille Bonaparte.<br />
– M. <strong>de</strong> Marbeuf. – Les États <strong>de</strong> Corse. – Rivalité <strong>de</strong> Narbonne et <strong>de</strong> Marbeuf. –<br />
Rôle <strong>de</strong> Charles Bonaparte. – Premières années <strong>de</strong> Napoléon. – Charles Bonaparte<br />
nommé député <strong>de</strong> la noblesse. – Départ <strong>de</strong> Napoléon pour Autun ...................................................... 23<br />
LIVRE II<br />
L’ÉLÈVE<br />
I. – Au collège d’Autun ......................................................................................................................................... 55<br />
II. – À l’école royale <strong>de</strong> Brienne ..................................................................................................................... 59<br />
III. – À l’école militaire <strong>de</strong> Paris ................................................................................................................... 77<br />
LIVRE III<br />
L’OFFICIER D’ARTILLERIE<br />
I. – Bonaparte lieutenant en second au régiment <strong>de</strong> la Fère :<br />
Méditation sur la Corse. – Admiration pour Rousseau. – Écrit sur le suici<strong>de</strong>.<br />
– Défense du Contrat social ..................................................................................................................... 85<br />
II. – En Corse :<br />
Influence du milieu. – Sollicitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> Napoléon pour sa famille.<br />
– L’affaire <strong>de</strong> la pépinière <strong>de</strong> mûriers .................................................................................................. 95<br />
III. – À Paris :<br />
Rencontre amoureuse au Palais-Royal. – L’amour <strong>de</strong> la patrie est supérieur<br />
à l’amour <strong>de</strong> la gloire .................................................................................................................................. 101<br />
IV. – En Corse :<br />
Soucis <strong>de</strong> famille. – Voyage à Bastia ..................................................................................................... 105<br />
293
LA RÉVOLUTION EN CORSE<br />
V. – À Auxonne :<br />
Étu<strong>de</strong>s sur l’artillerie. – Règlement <strong>de</strong> la Calotte. –<br />
<strong>Extrait</strong>s d’histoire et <strong>de</strong> géographie. – Le Comte d’Essex, nouvelle. –<br />
À Seurre. – Le Masque prophète, nouvelle. – Lettre à Paoli. – Lettres sur la Corse.<br />
– Lettre à Giubega ....................................................................................................................................... 109<br />
LIVRE IV<br />
LA RÉVOLUTION EN CORSE<br />
I. – En Corse :<br />
Mouvement révolutionnaire. – <strong>La</strong> Corse déclarée partie intégrante <strong>de</strong> la France :<br />
séance du 30 novembre 1789. – <strong>La</strong> question Corse à l’Assemblée nationale :<br />
séance du 21 janvier 1790. – Le 3 avril, arrivée <strong>de</strong> Paoli à Paris. – Le Congrès d’Orezza.<br />
– Lettres sur la Corse <strong>de</strong> Bonaparte. – Troubles à Ajaccio et à Bastia. – Arrivée <strong>de</strong> Paoli en Corse.<br />
– Débat sur la Corse : séance du 6 novembre 1790. – Lettre <strong>de</strong> Bonaparte à Matteo Buttafoco .............. 129<br />
II. – À Auxonne :<br />
Publication <strong>de</strong> la lettre à Buttafoco. – Lectures. – Excursion à Nuits.<br />
– Dialogue sur l’amour ................................................................................................................................... 159<br />
III. – Bonaparte lieutenant en premier au 4 e d’artillerie à Valence :<br />
Sur la République. – Réfutation <strong>de</strong> Rousseau.<br />
– Discours sur le bonheur .............................................................................................................................. 169<br />
IV. – En Corse :<br />
Mort <strong>de</strong> l’archidiacre Lucien. – Les réalités <strong>de</strong> la vie.<br />
– Napoléon lieutenant-colonel en second du 2 e bataillon <strong>de</strong>s gar<strong>de</strong>s nationales .............................. 181<br />
V. – Les troubles <strong>de</strong> Pâques à Ajaccio :<br />
Antagonisme <strong>de</strong>s Ajacciens et <strong>de</strong>s Montagnards.<br />
– Troubles à Ajaccio les 8, 9, 10 et 12 avril 1792. – Napoléon homme d’action.<br />
– Mémoire <strong>de</strong> Napoléon. – Départ pour Paris ........................................................................................... 195<br />
VI. – À Paris :<br />
Napoléon et les députés corses. – Journée du 20 juin.<br />
– Napoléon nommé capitaine d’artillerie. – Journée du 10 août .......................................................... 213<br />
VII. – Expédition <strong>de</strong> Sardaigne :<br />
Sentiments <strong>de</strong> Paoli. – Expédition <strong>de</strong> Sardaigne. – Contre-attaque <strong>de</strong> la Maddalena.<br />
– Projet d’une attaque <strong>de</strong> la Maddalena par Napoléon ............................................................................ 235<br />
VIII. – En Corse :<br />
Calomnies contre Paoli. – Arrivée en Corse <strong>de</strong>s commissaires <strong>de</strong> la Convention.<br />
– Rupture <strong>de</strong> Paoli et <strong>de</strong>s Bonaparte. – Napoléon arrêté à Bocognano.<br />
– <strong>La</strong> Corse se sépare <strong>de</strong> la France. – Pillage <strong>de</strong> la maison Bonaparte.<br />
– <strong>La</strong> famille Bonaparte quitte la Corse ....................................................................................................... 255<br />
IX. – <strong>La</strong> genèse <strong>de</strong> Napoléon ........................................................................................................................... 289<br />
X. – Développement <strong>de</strong> Napoléon .............................................................................................................. 291<br />
294