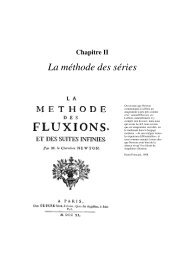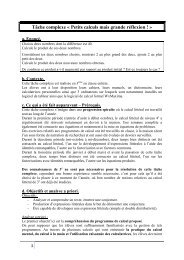apprécier le théâtre contemporain, texte et mise en scène
apprécier le théâtre contemporain, texte et mise en scène
apprécier le théâtre contemporain, texte et mise en scène
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
76<br />
Mireil<strong>le</strong> Habert<br />
apartés, dialogues <strong>et</strong> voix off. Michel Vinaver définit « <strong>le</strong> <strong>théâtre</strong> du quotidi<strong>en</strong><br />
» comme un <strong>théâtre</strong> qui part de la matière même de la vie quotidi<strong>en</strong>ne,<br />
bruits de pas, paro<strong>le</strong>s, obj<strong>et</strong>s, mouvem<strong>en</strong>ts, d’abord insignifiants, sans li<strong>en</strong>s<br />
particuliers <strong>en</strong>tre eux, puis dans <strong>le</strong>quel des relations s’établiss<strong>en</strong>t, des significations<br />
se dégag<strong>en</strong>t pour <strong>le</strong>s personnages aux prises <strong>le</strong>s uns avec <strong>le</strong>s autres.<br />
Le spectateur est invité à dégager ses propres significations. À la R<strong>en</strong>verse<br />
(1977), pièce <strong>contemporain</strong>e du mom<strong>en</strong>t où Michel Vinaver cherche à quitter<br />
Gil<strong>le</strong>tte dont il est <strong>le</strong> PDG, t<strong>en</strong>te ainsi un r<strong>en</strong>ouvel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t de l’écriture dramatique<br />
<strong>en</strong> plaçant des personnages simultaném<strong>en</strong>t sur la <strong>scène</strong>, alors qu’ils<br />
relèv<strong>en</strong>t d’espaces dramatiques différ<strong>en</strong>ts, ce qui a pour eff<strong>et</strong> de produire un<br />
système ironique de contrepoint à la jointure <strong>en</strong>tre <strong>le</strong>s deux discours. Le<br />
monde de l’<strong>en</strong>treprise <strong>et</strong> celui de l’individu s’<strong>en</strong>trechoqu<strong>en</strong>t avec Bénédicte,<br />
atteinte d’un cancer de la peau, invitée par une chaîne de télévision à v<strong>en</strong>ir<br />
t<strong>en</strong>ir <strong>en</strong> direct sur l’ant<strong>en</strong>ne <strong>le</strong> journal de sa maladie, <strong>et</strong> l’<strong>en</strong>treprise Bronzex,<br />
qui fabrique des produits pour <strong>le</strong> bronzage de la peau, dont <strong>le</strong>s cadres sont<br />
surpris <strong>en</strong> p<strong>le</strong>ine préparation de <strong>le</strong>ur prochaine campagne publicitaire.<br />
L’<strong>en</strong>trelacem<strong>en</strong>t des deux zones de dialogue crée des surprises, <strong>en</strong> même<br />
temps que <strong>le</strong>s tons s’<strong>en</strong>tremê<strong>le</strong>nt, féroce <strong>et</strong> joyeux. Pas de ponctuation, peu<br />
de didascalies, l’écriture est matière sonore. Il <strong>en</strong> va de même dans La Demande<br />
d’emploi (1971), « pièce <strong>en</strong> tr<strong>en</strong>te morceaux », dans laquel<strong>le</strong> la dramaturgie<br />
de Vinaver poursuit sa recherche des li<strong>en</strong>s <strong>en</strong>tre des situations différ<strong>en</strong>tes,<br />
ordinairem<strong>en</strong>t séparées, mais prés<strong>en</strong>tées sur la <strong>scène</strong> <strong>en</strong> simultané,<br />
dans <strong>le</strong> prisme d’un dialogue <strong>en</strong> éclats : <strong>le</strong>s eff<strong>et</strong>s liés au montage des propos<br />
t<strong>en</strong>us par Wallace, <strong>le</strong> recruteur, Farge, <strong>le</strong> personnage principal <strong>en</strong> quête<br />
d’emploi, sa femme Louise <strong>et</strong> sa fil<strong>le</strong> Nathalie r<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t <strong>le</strong> dialogue <strong>et</strong> <strong>le</strong>s situations<br />
à la fois tragiques <strong>et</strong> cocasses.<br />
Le refus de la psychologie, de l’intrigue, du dialogue, conduit parfois <strong>le</strong>s<br />
personnages à des dialogues ludiques, qui semb<strong>le</strong>nt sans queue ni tête, régis<br />
par <strong>le</strong> hasard. Une partie de l’héritage des surréalistes <strong>et</strong> de Ionesco se r<strong>et</strong>rouve<br />
dans des productions proches du cabar<strong>et</strong>, voire du music-hall, où se<br />
r<strong>en</strong>ouvel<strong>le</strong>nt <strong>le</strong>s jeux oulipi<strong>en</strong>s. Ainsi chez Jean Tardieu : « Chère, très chère<br />
peluche, depuis combi<strong>en</strong> de trous, depuis combi<strong>en</strong> de ga<strong>le</strong>ts, n’avais-je pas eu<br />
<strong>le</strong> temps de vous sucrer ! – Hélas, chère, j’étais moi-même très, très vitreuse<br />
! » Chez Valère Novarina (Vous qui habitez <strong>le</strong> temps, 1989), la dynamique<br />
de déconstruction de la langue, <strong>le</strong> morcel<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t de la paro<strong>le</strong> dans <strong>le</strong><br />
soliloque, par exemp<strong>le</strong> <strong>le</strong> discours, devant Autrui, du Gardi<strong>en</strong> de caillou, ne<br />
r<strong>en</strong>voi<strong>en</strong>t plus au monde mais seu<strong>le</strong>m<strong>en</strong>t à l’énigme du langage.<br />
On l’aura compris, <strong>le</strong>s écritures théâtra<strong>le</strong>s <strong>contemporain</strong>es ne sont plus<br />
sou<strong>mise</strong>s aux anci<strong>en</strong>nes catégories aristotélici<strong>en</strong>nes. L’ori<strong>en</strong>tation politique<br />
est souv<strong>en</strong>t l’occasion d’un métalangage, comm<strong>en</strong>taire de l’action par <strong>le</strong>