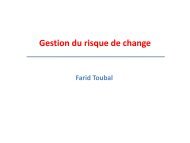Evaluation d'une politique publique et mise au point d'une ...
Evaluation d'une politique publique et mise au point d'une ...
Evaluation d'une politique publique et mise au point d'une ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne<br />
Ecole Doctorale Economie Panthéon-Sorbonne EPS 465<br />
Séminaire SEI « Doctorants 18 mois »<br />
27 mars 2013<br />
<strong>Evaluation</strong> d’une <strong>politique</strong> <strong>publique</strong> <strong>et</strong> <strong>mise</strong> <strong>au</strong> <strong>point</strong> d’une<br />
méthodologie supplémentant le calcul du « N<strong>et</strong> Social Benefit » :<br />
cas de la définition <strong>et</strong> du pilotage de l’expérimentation de la Ville de Paris dans la<br />
<strong>mise</strong> en place d’une Zone d'Actions Prioritaires pour l'Air (ZAPA).<br />
Satya-Lekh PROAG 1<br />
Sous la direction de Roland LANTNER <strong>et</strong> Richard LE GOFF<br />
I) Obj<strong>et</strong> de la thèse <strong>et</strong> questions de recherche<br />
Sous l’impulsion des directives européennes 2004/107/CE <strong>et</strong> 2008/50/CE, concernant<br />
l’amélioration de la qualité de l’air extérieur en région urbaine (Journal Officiel de l’Union<br />
Européenne, 2004, 2008), de nombreuses agglomérations de l’Union Européenne ont mis en<br />
place des zones urbaines environnementales (« Low Emission Zones »), <strong>au</strong> sein desquelles les<br />
véhicules qui ne sont pas considérés comme respectueux de l’environnement ne sont plus<br />
<strong>au</strong>torisés à circuler. Devant la menace de l’Union Européenne d’assigner la France devant la<br />
Cour européenne de justice pour ne pas avoir pris de mesures efficaces pour remédier <strong>au</strong><br />
problème des émissions excessives <strong>et</strong> de non-respect des normes de particules fines en<br />
suspension dans seize des régions du pays (c<strong>et</strong>te action est maintenant en cours d’instruction<br />
depuis avril 2011), la transposition de ces directives en France est réalisée en juill<strong>et</strong> 2010, <strong>au</strong><br />
cours de la loi du Grenelle 2. L’article 182 donne alors naissance <strong>au</strong>x ZAPA, lorsqu’elle<br />
affirme qu’« une [Z]one d’[A]ctions [P]rioritaires pour l’[A]ir, dont l’accès est interdit <strong>au</strong>x<br />
véhicules contribuant le plus à la pollution atmosphérique, peut être instituée, à titre<br />
expérimental, afin de lutter contre c<strong>et</strong>te pollution <strong>et</strong> notamment réduire les émissions de<br />
particules <strong>et</strong> d’oxydes d’azote » (Journal Officiel de la Ré<strong>publique</strong> Française, 2010). Huit<br />
communes <strong>et</strong> groupements de communes, dont la Ville de Paris en septembre 2010, se portent<br />
alors candidates pour étudier la faisabilité de la <strong>mise</strong> en place d’une « Zone d’Actions<br />
Prioritaires pour l’Air (ZAPA) sur son territoire. La Ville de Paris délibère alors du<br />
financement de c<strong>et</strong>te étude de faisabilité en mars 2011 (Conseil de Paris, 2011), le but étant de<br />
diminuer la concentration atmosphérique urbaine de deux polluants loc<strong>au</strong>x : les particules<br />
fines (PM10) <strong>et</strong> le dioxyde d’azote (NO2) . Après les manifestations d’intérêt européennes,<br />
nationales <strong>et</strong> parisiennes, c’est le Centre International de Recherche sur le Cancer, (CIRC),<br />
agence de l’Organisation Mondiale de la Santé qui publie, en juin 2012, un rapport énonçant<br />
tous les risques cancérogènes liés à la m<strong>au</strong>vaise qualité de l'air dans les zones urbaines,<br />
essentiellement due <strong>au</strong>x émanations des particules en provenance des moteurs diesel<br />
1 satya-lekh.proag@ensta.org<br />
1
(Benbrahim-Tallaa <strong>et</strong> al., 2012), donnant une justification scientifique supplémentaire à la<br />
lutte contre la pollution atmosphérique en agissant sur le secteur des transports routiers.<br />
Les conséquences sur les <strong>politique</strong>s <strong>publique</strong>s françaises sont mitigées. D’un côté, à<br />
l’échelle nationale, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable <strong>et</strong> de l’Energie<br />
(MEDDE) présente en février 2013 <strong>au</strong> Comité Interministériel de la Qualité de l’Air (CIQA)<br />
son « Plan d’urgence pour la qualité de l’air » (Ministère de l’Ecologie, du Développement<br />
Durable <strong>et</strong> de l’Energie, 2013), dans lequel la ministre acte « l’échec [du] dispositif [ZAPA],<br />
jugé socialement injuste <strong>et</strong> économiquement inefficace » tout en dressant un total de 38<br />
mesures à être débattues <strong>et</strong> éventuellement intégrées par les zones actuellement sou<strong>mise</strong>s <strong>au</strong><br />
contentieux européen dans leur Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA). D’un <strong>au</strong>tre côté, à<br />
l’échelle locale, le Maire de Paris présente quelques mois plus tôt sa communication <strong>au</strong><br />
Conseil de Paris de novembre 2012 sur la lutte contre la pollution (Conseil de Paris, 2012), en<br />
m<strong>et</strong>tant notamment l’accent sur l’interdiction progressive des véhicules les plus polluants. La<br />
thèse se place donc dans le cadre de la définition <strong>et</strong> de l’étude de faisabilité de ce plan de lutte<br />
contre la pollution atmosphérique – une déclinaison parisienne du dispositif national ZAPA –<br />
mais surtout <strong>au</strong>ssi des eff<strong>et</strong>s des mesures qui sont proposées <strong>et</strong> qui seront étudiées. Les<br />
résultats de la thèse perm<strong>et</strong>tront également de proposer un outil d’aide à la décision <strong>publique</strong><br />
<strong>au</strong>x deux co-financeurs : l’Agence De l’Environnement <strong>et</strong> de la Maîtrise de l’Energie<br />
(ADEME) <strong>et</strong> la Mairie de Paris.<br />
Bien que les eff<strong>et</strong>s sur l'environnement des mesures proposées précédemment semblent<br />
aller de soi (cependant, de nombreux <strong>au</strong>tres facteurs influencent la qualité de l’air, <strong>et</strong> il est<br />
<strong>au</strong>jourd’hui difficile de faire la part des choses), nous devons encore travailler sur<br />
l’identification des impacts économiques <strong>et</strong> sociét<strong>au</strong>x de la <strong>mise</strong> en œuvre de telles <strong>politique</strong>s.<br />
Et lorsque des démarches d’évaluation socioéconomique sont menées dans le cadre de ces<br />
expérimentations, elles consistent rarement en une analyse coûts-bénéfices systématique 2 .<br />
Celle-ci procède idéalement en deux temps : établissement d’un scénario d’évolution sans<br />
expérimentation, appelé « scénario de référence », ou « scénario <strong>au</strong> fil de l’e<strong>au</strong> », puis suivi<br />
longitudinal des variables socioéconomiques pertinentes pendant l’expérimentation. L’impact<br />
immédiat attendu en est la réduction de l’émission ou de la concentration de gaz <strong>et</strong> particules<br />
nocifs, conduisant à une meilleure qualité de l’air en milieu urbain.<br />
Enfin, lorsqu’elles sont menées à terme, ces démarches d’évaluation basée sur le calcul du<br />
« N<strong>et</strong> Social Benefit » (Boardman, Greenberg, Vining, & Weimer, 2006) ne garantissent pas<br />
toujours l’exh<strong>au</strong>stivité du recensement des facteurs impactants <strong>et</strong> impactés. C’est précisément<br />
ce qui nous conduit à proposer une transposition de méthodes fondées sur des calculs de<br />
« rente collective », réalisées notamment pour l’ARCEP en 2008 (Le Goff, Lantner, & alii,<br />
2008) <strong>et</strong> le Département de la Manche en 2000 (Le Goff, 2000) dans le domaine de<br />
l’Economie Numérique.<br />
2 Une analyse menée lors d’un stage de recherche à l’Université TU Delft, <strong>au</strong>x Pays-Bas (Proag, 2010), a montré<br />
que le développement des zones à faibles émissions polluantes <strong>au</strong>x Pays-Bas a engendré des bénéfices n<strong>et</strong>s<br />
positifs. De nombreuses <strong>au</strong>tres variables économiques <strong>et</strong> sociétales mériteraient cependant d’être inclues dans<br />
ce type de démarche, pour affiner c<strong>et</strong>te conclusion <strong>et</strong> en élargir la portée.<br />
2
II) Démarche de recherche<br />
L’objectif de c<strong>et</strong>te thèse est de supplémenter les trav<strong>au</strong>x précédents en matière<br />
d’évaluation des <strong>politique</strong>s <strong>publique</strong>s, plus particulièrement en sciences économiques, <strong>et</strong> ce en<br />
vue de fournir un outil d’aide à la décision de <strong>politique</strong>s <strong>publique</strong>s. Pour réaliser ce travail,<br />
nous proposons une démarche en quatre étapes.<br />
A. Evaluer des <strong>politique</strong>s <strong>publique</strong>s – approche suivant l’analyse coûts-bénéfices<br />
« L’évaluation des <strong>politique</strong>s <strong>publique</strong>s » a be<strong>au</strong> être écrit <strong>au</strong> singulier, il s’agit pourtant<br />
bien là d’une démarche d’évaluation plurielle, recoupant des disciplines diverses : sociologie,<br />
géographie, politologie, économie. Sans forcément vouloir être exh<strong>au</strong>stif, c<strong>et</strong>te partie de la<br />
thèse a pour but d’identifier les méthodes utilisées actuellement pour mener une évaluation de<br />
<strong>politique</strong>s <strong>publique</strong>s, tant <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> académique qu’opérationnel. Le questionnement initial<br />
concerne en eff<strong>et</strong> la pertinence des méthodes utilisées actuellement pour réaliser une<br />
évaluation. Parmi les nombreuses disciplines qui peuvent effectivement être mobilisées pour<br />
ce travail, il convient de s’intéresser <strong>au</strong>x différentes méthodes <strong>au</strong>jourd’hui <strong>mise</strong>s en œuvre <strong>et</strong> à<br />
en définir le contexte dans lequel elles sont adéquates. Quand est-il plus efficace de recourir à<br />
une méthode plutôt qu’une <strong>au</strong>tre ? Dans quels cas privilégie-t-on une démarche plutôt qu’une<br />
<strong>au</strong>tre ? Y a-t-il complémentarité entre les méthodes ? Le but de c<strong>et</strong>te partie est également de<br />
déterminer les limites de chaque méthode d’évaluation, dans le but de pouvoir choisir la<br />
méthode qui nous paraît optimale <strong>au</strong> regard des critères liés à l’obj<strong>et</strong> à évaluer <strong>et</strong> à ceux qui<br />
souhaitent bénéficier de la méthode d’évaluation. Sans négliger les attraits théoriques de ce<br />
travail, la thèse n’a pas pour but de comparer les méthodes d’évaluation de <strong>politique</strong>s<br />
<strong>publique</strong>s, mais plutôt de justifier le choix d’une d’entre elles, d’en définir les potentialités <strong>et</strong><br />
les limites <strong>et</strong>, le cas échéant, de tenter de proposer une méthode qui supplémente cesdernières.<br />
Parmi les méthodes étudiées, notre choix s’est porté sur un processus d’évaluation<br />
socio-économique en particulier : l’analyse coûts-bénéfices.<br />
Une fois ce choix effectué, notre démarche consiste en deux étapes. Dans un premier<br />
temps, il a fallu identifier les intérêts <strong>et</strong> les limites de recourir à c<strong>et</strong>te méthode d’évaluation.<br />
Par la suite, cela nous a permis de proposer des concepts pouvant supplémenter quelques-unes<br />
des limites identifiées (partie B). L’analyse coûts-bénéfices a une méthodologie bien rôdée<br />
puisqu’il s’agit d’un ensemble de méthodes <strong>et</strong> de règles qui perm<strong>et</strong>tent d’évaluer les coûts <strong>et</strong><br />
les bénéfices soci<strong>au</strong>x de <strong>politique</strong>s <strong>publique</strong>s alternatives, c’est-à-dire un ensemble d’outils<br />
qui perm<strong>et</strong>tent d’aider à la décision (Snell, 1997). Cela perm<strong>et</strong> de promouvoir l’efficacité en<br />
identifiant un ensemble de scénarios possibles qui aboutiraient à la plus grande valeur des<br />
bénéfices n<strong>et</strong>s pour la société (Weimer, 2008). C’est d’ailleurs en s’intéressant à la<br />
méthodologie, que ce soit par l’étude académique de la méthode d’analyse elle-même, ou par<br />
l’analyse des évaluations menées par des praticiens, qu’il nous a été possible de recenser<br />
certaines limites qu’on peut distinguer en deux sections : celles qui interviennent en amont de<br />
la valorisation monétaire, lors de l’évaluation même des eff<strong>et</strong>s de la <strong>politique</strong>, <strong>et</strong> celles qui<br />
découlent des méthodes utilisées pour effectuer c<strong>et</strong>te valorisation. Concernant la première<br />
section se trouvent, parmi d’<strong>au</strong>tres, l’impossibilité de garantir un ordonnancement social<br />
cohérent des <strong>politique</strong>s sur lesquelles doit porter le choix (Blackorby & Donaldson, 1990), ni<br />
un ordonnancement social transitif (Arrow, 1963), la difficulté d’identifier la population<br />
concernée (Zerbe, 1999) <strong>et</strong> les groupes de personnes qui bénéficient ou pâtissent de la<br />
3
<strong>politique</strong> (Dorfman & Rothkopf, 1996). D’<strong>au</strong>tres limites relatives à la méthode même de<br />
valorisation existent, dont par exemple la définition du t<strong>au</strong>x d’actualisation adéquat (Moore,<br />
Boardman, Vining, Weimer, & Greenberg, 2004), <strong>et</strong> la difficulté de réduire toutes les<br />
comparaisons à une seule dimension (Dorfman & Rothkopf, 1996). L’identification de ces<br />
limites n’est pas exh<strong>au</strong>stive, mais c<strong>et</strong>te démarche a été utile pour se rendre compte des<br />
difficultés « en amont » <strong>et</strong> « en aval » de la méthode d’analyse elle-même.<br />
La partie A est réalisée, mais est susceptible de renforcements <strong>au</strong> cours des lectures en cours.<br />
B. Proposition d’un concept supplémentant quelques limites endogènes à la méthode<br />
d’analyse coûts-bénéfices actuelle<br />
Les limites « en aval », qui découlent des méthodes de valorisation monétaire,<br />
s’expliquent en grande partie par l’absence de fonctions d’utilité des différents agents<br />
concernés : il est alors nécessaire d’avoir recours à des méthodes de révélation de préférences,<br />
directes par le recours <strong>au</strong>x consentements à payer ou à recevoir (Stavins, 2008), ou indirectes<br />
grâce <strong>au</strong>x méthodes de coûts de déplacement (Clawson & Kn<strong>et</strong>sch, 1966) ou de prix<br />
hédonistes (Smith & Huang, 1995), par exemple. C<strong>et</strong>te littérature est déjà bien fournie,<br />
notamment en économie de l’environnement <strong>et</strong>, à moins d’avoir recours à des enquêtes<br />
approfondies, il n’<strong>au</strong>rait pas été pertinent de travailler sur ces limites. Dans le but de proposer<br />
un outil d’évaluation qui supplémenterait l’analyse coûts-bénéfices, nous avons donc choisi<br />
de nous intéresser uniquement <strong>au</strong>x limites « en amont » – c’est-à-dire celles qui découlent de<br />
la méthode d’évaluation des eff<strong>et</strong>s de la <strong>politique</strong>, avant même toute démarche de<br />
transcription monétaire – <strong>et</strong> c’est en s’intéressant <strong>au</strong>x analyses coûts-bénéfices menées<br />
actuellement par des praticiens que nous avons choisi de traiter deux d’entre elles en<br />
particulier : d’une part la prise en compte de la situation d’incertitude dans laquelle se place le<br />
décideur <strong>politique</strong> <strong>au</strong> moment de faire son choix <strong>et</strong> d’<strong>au</strong>tre part l’intégration de<br />
l’interdépendance des <strong>politique</strong>s <strong>publique</strong>s <strong>et</strong> des stratégies privées dans la démarche<br />
d’évaluation.<br />
Nous partons de l’hypothèse où l’individu qui prend une décision est en situation de<br />
rationalité limitée, ou de « rationalité procédurale » (Simon, 1947) : l’analyse coûts-bénéfices<br />
étant alors vue comme une procédure lui perm<strong>et</strong>tant d’obtenir une information avant de faire<br />
son choix. Toutefois, en menant c<strong>et</strong>te analyse, les évaluateurs font comme si chaque agent<br />
était en situation de « rationalité parfaite », alors que les choix pris par le décideur <strong>politique</strong>,<br />
tout comme ceux pris par chaque agent concerné par la <strong>politique</strong> qui serait <strong>mise</strong> en place, sont<br />
incertains, <strong>au</strong> sens où ils relèvent du caractère humain de l’individu. Nous n’essayons donc<br />
pas dans c<strong>et</strong>te partie de traiter de la prise de risque, vue par certains <strong>au</strong>teurs comme une<br />
incertitude probabiliste, mais bien de l’incertitude, parfois <strong>au</strong>ssi appelée incertitude radicale<br />
(Knight, 1921). En particulier, la durée d’évaluation de la <strong>politique</strong> <strong>publique</strong> doit-elle –<br />
comme c’est le cas actuellement – être choisie de façon exogène, c’est-à-dire arbitrairement<br />
(Cabanne, 2010) ou en fonction des caractéristiques financières <strong>et</strong> techniques de l’obj<strong>et</strong> à<br />
étudier (Boîteux & Commissariat Général du Plan (CGP), 2001), ou bien c<strong>et</strong>te durée<br />
d’évaluation doit-elle, <strong>au</strong> contraire, être endogène à la <strong>politique</strong> à évaluer elle-même, c’est-àdire<br />
fondée sur un calendrier des eff<strong>et</strong>s ? Ne devrait-elle pas être limitée par des critères<br />
inhérents <strong>au</strong> caractère humain, donc incertain des décideurs ? Un des apports de la thèse<br />
consiste donc à identifier l’horizon temporel <strong>au</strong>-delà duquel il devient déraisonnable de<br />
poursuivre l’évaluation.<br />
4
Le deuxième concept que nous souhaitons proposer <strong>au</strong> travers de c<strong>et</strong>te thèse est la prise en<br />
compte de l’interdépendance des <strong>politique</strong>s <strong>publique</strong>s <strong>et</strong> des stratégies privées dans<br />
l’évaluation même de la <strong>politique</strong> <strong>publique</strong>. En eff<strong>et</strong>, les analyses coûts-bénéfices pratiquées<br />
actuellement se limitent souvent à l’évaluation des eff<strong>et</strong>s directs de la <strong>politique</strong>, entendus<br />
comme les eff<strong>et</strong>s liés <strong>au</strong>x actions qui se sont déroulées, ou qui ont été <strong>mise</strong>s en place sans<br />
<strong>au</strong>tre intervention <strong>publique</strong>. Il est rare de voir les analystes prendre en compte les eff<strong>et</strong>s<br />
indirects, même si certains le font, c’est-à-dire ceux liés <strong>au</strong>x actions qui ont été <strong>mise</strong>s en place<br />
alors qu’elles n’étaient pas visées, toujours sans <strong>au</strong>tre intervention <strong>publique</strong> (Atkinson, 2007).<br />
La prise en compte de ces eff<strong>et</strong>s est-elle suffisante pour conduire une évaluation ? A partir du<br />
moment où la <strong>politique</strong> <strong>publique</strong> que l’on souhaite évaluer engendre des eff<strong>et</strong>s sur d’<strong>au</strong>tres<br />
<strong>politique</strong>s <strong>publique</strong>s <strong>et</strong> des stratégies privées, qui ne seraient pas apparus sans la <strong>politique</strong><br />
initiale, pourquoi ne pas les prendre en compte dans l’évaluation ? Un <strong>au</strong>tre apport de la thèse<br />
consiste donc à proposer une typologie d’eff<strong>et</strong>s directs, indirects <strong>et</strong> induits, tenant compte des<br />
remarques précédentes, <strong>et</strong> qui pourra être utilisée dans n’importe quelle évaluation de<br />
<strong>politique</strong> <strong>publique</strong>. C<strong>et</strong>te typologie sera proposée, pour avis <strong>et</strong> commentaires, à différents<br />
partenaires académiques <strong>et</strong> praticiens, en vue de son amélioration <strong>et</strong> de garantir – si possible –<br />
son efficacité <strong>et</strong> son exh<strong>au</strong>stivité. Même si l’outil est de portée générale, son application <strong>au</strong><br />
cours de la thèse est toutefois restreinte à des scénarios de réduction de la pollution<br />
atmosphérique en ville, comme le présente la partie suivante.<br />
La partie B fait, entre <strong>au</strong>tres, l’obj<strong>et</strong> d’un article de recherche en cours de rédaction (finition).<br />
C. Un nouvel outil d’évaluation socio-économique : application à la ville de Paris sur<br />
des scénarios d’amélioration de la qualité de l’air<br />
C<strong>et</strong>te partie vise à donner une application opérationnelle <strong>au</strong>x concepts théoriques<br />
développés précédemment. En eff<strong>et</strong>, dans le cadre du plan de lutte contre la pollution<br />
atmosphérique, pour lequel les élus parisiens ont lancé une commande municipale en<br />
novembre 2012, quelques scénarios de prospective de mobilité sont envisagés par les services<br />
techniques de la mairie. L’évaluation complète de ces scénarios n’est toutefois pas encore<br />
réalisée, <strong>et</strong> ils pourront consister en une application directe de l’outil proposé. Pour cela, un<br />
atelier de travail, regroupant des experts – académiques <strong>et</strong> praticiens – d’horizons divers, tant<br />
disciplinaires que géographiques, sera organisé en juin 2013 à la Mairie de Paris, dix-huit<br />
mois exactement après le début de la thèse. L’atelier <strong>au</strong>ra pour but d’une part de tester l’outil<br />
proposé sur des scénarios concr<strong>et</strong>s <strong>et</strong> territorialisés <strong>et</strong> d’<strong>au</strong>tre part, les avis des experts<br />
présents perm<strong>et</strong>tront d’améliorer l’outil, voire de lui donner une validation scientifique. A<br />
l’issue de ce travail, il sera alors possible de comparer les scénarios proposés par les services<br />
techniques de la mairie, ce qui contribuera à rendre à notre proposition le caractère d’outil<br />
d’aide à la décision <strong>publique</strong>.<br />
Le travail de la partie C est en cours, en même temps que l’organisation de l’atelier.<br />
5
D. Joindre la théorie <strong>au</strong>x données du terrain<br />
Les démarches d’évaluation proposées précédemment sont des évaluations ex-ante ou a<br />
priori : elles interviennent avant la prise de décision. Afin de calibrer l’outil proposé, il serait<br />
utile de le confronter à d’<strong>au</strong>tres scénarios, ou à des valeurs issues de données de terrain. Pour<br />
cela, si le temps <strong>politique</strong> le perm<strong>et</strong>, nous souhaiterions confronter les évaluations ex-ante<br />
issues de nos propositions avec une analyse concomitante, sur le même terrain. Si cela n’est<br />
pas possible, il f<strong>au</strong>drait alors essayer de calibrer nos paramètres avec des données issues d’un<br />
<strong>au</strong>tre territoire, en essayant de limiter <strong>au</strong> maximum les limites dues à la transposition de<br />
territoire. Enfin, une fois ces trav<strong>au</strong>x réalisés, une analyse de sensibilité nous semble<br />
nécessaire pour identifier les paramètres déterminants dans l’outil proposé : une de ses<br />
recommandations sera alors d’encourager les recherches de données (<strong>au</strong> moyen d’enquêtes<br />
par exemple) qui perm<strong>et</strong>tront de réduire l’incertitude sur ces paramètres ainsi déterminés.<br />
La partie D n’a pas encore été traitée.<br />
Au moyen d’une lecture analytique des méthodes d’évaluation basées sur le « N<strong>et</strong> Social<br />
Benefit », l’objectif de la thèse est donc double : d’une part, il s’agit de proposer une méthode<br />
perm<strong>et</strong>tant de supplémenter les analyses coûts-bénéfices actuelles en prenant en compte la<br />
situation d’incertitude dans laquelle se trouve le décideur <strong>politique</strong>, mais <strong>au</strong>ssi<br />
l’interdépendance des <strong>politique</strong>s <strong>publique</strong>s <strong>et</strong> stratégies privées. D’<strong>au</strong>tre part, dans une visée<br />
opérationnelle pour les services techniques de la Mairie de Paris, l’<strong>au</strong>tre objectif de la thèse<br />
est de tester c<strong>et</strong>te méthode <strong>au</strong>x données du terrain, en vue de proposer un outil d’aide à la<br />
décision <strong>publique</strong>.<br />
6
III) Difficultés rencontrées <strong>et</strong> à prévoir<br />
Dans ce travail de recherche, nous avons été confrontés à plusieurs difficultés, <strong>et</strong> nous en<br />
anticipons déjà quelques <strong>au</strong>tres.<br />
Parmi les difficultés rencontrées, il n’a pas été facile d’être exh<strong>au</strong>stif sur l’identification<br />
des méthodes d’évaluation de <strong>politique</strong>s <strong>publique</strong>s menées actuellement, ainsi que sur leurs<br />
théories sous-jacentes, <strong>et</strong> encore moins facile d’en définir une typologie. Des renforcements<br />
seront attendus en fonction des lectures en cours, <strong>et</strong> sans doute grâce à l’atelier de travail en<br />
juin.<br />
Une méthode théorique a bien été proposée pour trouver l’horizon temporel <strong>au</strong>-delà<br />
duquel nous pensons que continuer à effectuer l’évaluation devient déraisonnable, mais sa<br />
traduction « opérationnelle » doit encore être affinée, <strong>et</strong> il est peut-être question d’introduire<br />
l’aversion <strong>au</strong> risque du décideur, ou des probabilités d’occurrence d’événements.<br />
Une difficulté à également surgi en ce qui concerne l’utilisation des méthodes de<br />
valorisation monétaire <strong>et</strong> du choix du t<strong>au</strong>x d’actualisation actuelles. Ne pouvant recourir <strong>au</strong>x<br />
fonctions d’utilité des agents économiques concernés, les méthodes d’obtention de données<br />
présentent des limites qui introduisent une incertitude sur la mesure elle-même : c<strong>et</strong>te<br />
incertitude gommerait-elle la prise en compte des eff<strong>et</strong>s dus à l’interdépendance des <strong>politique</strong>s<br />
<strong>publique</strong>s <strong>et</strong> des stratégies privées dans la démarche d’évaluation ?<br />
Travailler de concert avec des praticiens en collectivité territoriale a ses avantages <strong>et</strong> ses<br />
inconvénients, ses bénéfices <strong>et</strong> ses coûts. Il est parfois difficile de s’inscrire dans le temps<br />
<strong>politique</strong>, voire électoral. De surcroît, les orientations « <strong>politique</strong>s » du suj<strong>et</strong> de la thèse<br />
doivent être séparées de son contenu, <strong>et</strong> ce travail n’est pas aisé en contexte électoral<br />
(présidentiel ou municipal), que ce soit en première année de thèse en 2012, ou en troisième<br />
année en 2014.<br />
Des difficultés sont également à prévoir, notamment en ce qui concerne la recherche<br />
d’indicateurs nécessaires pour l’évaluation des eff<strong>et</strong>s de la <strong>politique</strong> <strong>publique</strong>. Certains<br />
indicateurs sont disponibles via des enquêtes nationales (Enquête Nationale Transport – ENT)<br />
ou régionales (Enquête Globale Transport – EGT) : ces indicateurs sont évidemment<br />
sectorisés, <strong>et</strong> leur méthode d’obtention ne correspond pas toujours à nos attentes. Il est donc<br />
parfois nécessaire de créer des « proxy » afin de pouvoir obtenir une valeur d’évaluation, en<br />
prenant bien soin de détailler les hypothèses prises. Une recherche de données sur des<br />
territoires différents de la ville de Paris nécessitera <strong>au</strong>ssi une <strong>mise</strong> en forme, de façon à avoir<br />
des données harmonisées avec celles des différents territoires considérés.<br />
7
IV) Bibliographie indicative<br />
Arrow, K. J. (1963). Social Choice And Individual Values. Yale University Press.<br />
Atkinson, R. D. (2007). Framing a national broadband policy. CommLaw Conspectus, 16, 145.<br />
Benbrahim-Tallaa, L., Baan, R. A., Grosse, Y., L<strong>au</strong>by-Secr<strong>et</strong>an, B., El Ghissassi, F., Bouvard, V., … Straif, K.<br />
(2012). Carcinogenicity of diesel-engine and gasoline-engine exh<strong>au</strong>sts and some nitroarenes. The<br />
Lanc<strong>et</strong> Oncology, 13(7), 663–664. doi:10.1016/S1470-2045(12)70280-2<br />
Blackorby, C., & Donaldson, D. (1990). A review article: The case against the use of the sum of compensating<br />
variations in cost-benefit analysis. Canadian Journal of Economics, 471–494.<br />
Boardman, A., Greenberg, D., Vining, A., & Weimer, D. (2006). Cost Benefit Analysis: Concepts and Practice<br />
(3rd ed.). Pearson.<br />
Boîteux, M., & Commissariat Général du Plan (CGP). (2001). Transport: choix des investissements <strong>et</strong> coûts des<br />
nuisances.<br />
Cabanne, I. (2010). Le <strong>point</strong> sur les coûts <strong>et</strong> les avantages des vélos en libre-service (note pour le Commissariat<br />
Général <strong>au</strong> développement Durable (CGDD) No. n° 50).<br />
Clawson, M., & Kn<strong>et</strong>sch, J. L. (1966). Economics of outdoor recreation. R<strong>et</strong>rieved from<br />
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/recordD<strong>et</strong>ail?accno=ED022616<br />
Conseil de Paris. Délibération 2011 DEVE 28 du Conseil de Paris pour la signature d’une convention avec<br />
l’Agence de l’environnement <strong>et</strong> de la Maîtrise de l’energie (ADEME) relative <strong>au</strong> finnacement de l’étude<br />
de faisabilité pour l’expérimentation d’une Zone d’Actions Prioritaires pour l’Air (ZAPA). ,<br />
Délibération 2011 DEVE 28 (2011).<br />
Conseil de Paris. Communication 2012 DEVE 170 du Maire de Paris <strong>au</strong> conseil municipal sur la lutte contre la<br />
pollution, <strong>et</strong> adoptée le 13 novembre 2012 (2012). Hôtel de Ville, Paris.<br />
Dorfman, R., & Rothkopf, M. H. (1996). Why benefit-cost analysis is widely disregarded and what to do about<br />
it. Interfaces, 26(5), 1–6.<br />
Journal Officiel de l’Union Européenne. Directive 2004/107/CE du Parlement Européen <strong>et</strong> du Conseil du 15<br />
décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel <strong>et</strong> les hydrocarbures aromatiques<br />
polycycliques dans l’air ambiant. , 2004/107/CE (2004).<br />
Journal Officiel de l’Union Européenne. Directive 2008/50/CE du parlement européen <strong>et</strong> du Conseil du 21 mai<br />
2008 concernant la qualité de l’air ambiant <strong>et</strong> un air pur pour l’Europe. , 2008/50/CE (2008).<br />
Journal Officiel de la Ré<strong>publique</strong> Française. Loi n° 2010-788 du 12 juill<strong>et</strong> 2010 portant engagement national<br />
pour l’environnement. , 2010-788 (2010).<br />
Knight, F. (1921). Risk, uncertainty and profit. Boston, MA: Hart, Schaffner & Marx; Houghton Mifflin Co.<br />
Le Goff, R. (2000). Mutation informationnelle <strong>et</strong> <strong>politique</strong> territoriale - Eléments de théorie des marchés <strong>et</strong> des<br />
organisations appliqués <strong>au</strong> Département de la Manche (France) (Thèse de Doctorat en Sciences<br />
Economiques). Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris.<br />
Le Goff, R., Lantner, R., & alii. (2008). Impact économique de l’intervention des collectivités territoriales dans<br />
le domaine des communications électroniques (p. 93). Rapport remis à l’ARCEP pour préparer le<br />
rapport public présentant un premier bilan de l’application de l’article L. 1425-1 du CGCT.<br />
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable <strong>et</strong> de l’Energie. (2013, February 6). Dossier de presse: Plan<br />
d’urgence pour la qualité de l’air.<br />
Moore, M. A., Boardman, A. E., Vining, A. R., Weimer, D. L., & Greenberg, D. H. (2004). “Just give me a<br />
number!” Practical values for the social discount rate. Journal of Policy Analysis and Management,<br />
23(4), 789–812.<br />
Proag, S.-L. (2010). Cost-Benefit analysis of the Dutch urban environmental zones (Mémoire de Master de<br />
Recherche dnas le cadre d’un stage de recherche). ENSTA ParisTech - TU Delft, Paris.<br />
Simon, H. A. (1947). Administrative Behavior: a Study of Decision-Making Processes in Administrative<br />
Organization. New York: The Macmillan Company.<br />
Smith, V. K., & Huang, J.-C. (1995). Can mark<strong>et</strong>s value air quality? A m<strong>et</strong>a-analysis of hedonic property value<br />
models. Journal of political economy, 209–227.<br />
Snell, M. (1997). Cost-benefit analysis for engineers and planners. T. Telford.<br />
Stavins, R. (2008). Environmental Economics. In The New Palgrave Dictionary of Economics. Steven N.<br />
Durl<strong>au</strong>f and Lawrence E. Blume, Palgrave, Macmillan.<br />
Weimer, D. L. (2008). Cost-Benefit Analysis. In The New Palgrave Dictionary of Economics. Steven N. Durl<strong>au</strong>f<br />
and Lawrence E. Blume, Palgrave, Macmillan.<br />
Zerbe, R. O. (1999). Is cost-benefit analysis legal? Three rules. Journal of Policy Analysis and Management,<br />
17(3), 419–456.<br />
8