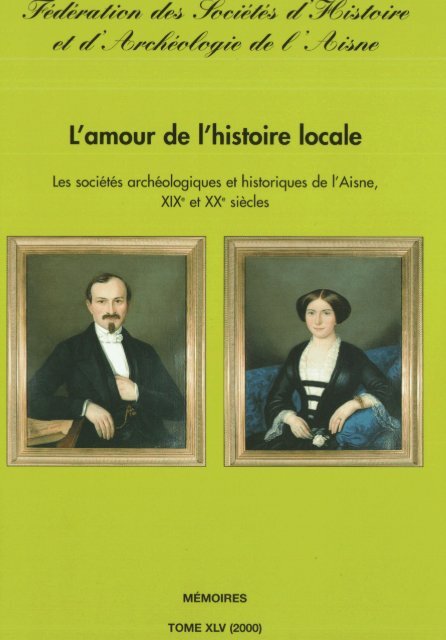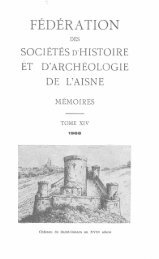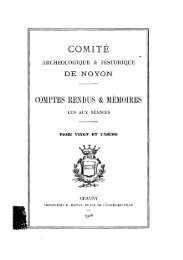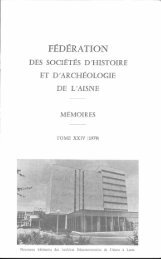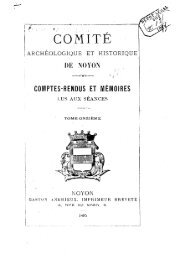L'amour de l'histoire locale
L'amour de l'histoire locale
L'amour de l'histoire locale
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>L'amour</strong> <strong>de</strong> <strong>l'histoire</strong> <strong>locale</strong><br />
Les sociétés archéologiques et historiques <strong>de</strong> l'Aisne,<br />
XIX" et xx" siècles<br />
MEMOIRES<br />
TOME XLV (2OOO)
TABLE DES MATIÈRES<br />
Avant-propos : L‘amour <strong>de</strong> l’histoire <strong>locale</strong><br />
Cl~rudine VIDAL ........................................... 5<br />
La Société académique <strong>de</strong> Saint-Quentin<br />
Monipe S~VEKIN, Aiidrr‘ TRIOU ............................... 7<br />
Jean Héré (1796-1 865), un érudit saint-quentinois d’adoption<br />
Moniqiie S~VERIN. ......................................... Il<br />
Bernard Ancien, soixante ans <strong>de</strong> recherches<br />
Deiiis ROLLAND ........................................... 25<br />
Saint-Marc Girardin, portrait d’un notable du XIX‘ siècle<br />
Jiilieii SAPORI. ...........................................<br />
Regard historiographique sur I’ceuvre <strong>de</strong> Jehan <strong>de</strong> Hennezel ( 1876- 1956)<br />
BriiiioMAEs .............................................<br />
Madame Martinet. Suzanne Goulard-Martinet ( 19 10- 1998)<br />
J a y e liil e DAN Ysz ........................................<br />
La Société historique et archéologique <strong>de</strong> Chilteau-Thierry<br />
Toil?. LLGENDRE ..........................................<br />
Historiographie <strong>de</strong> l’archéologie à Chilteau-Thierry ou naissance<br />
d’une archéologie urbaine <strong>de</strong> 1864 à 2000 : le r<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Société<br />
Frciripis BUKY ..........................................<br />
Les historiens du dimanche en Thiérache. Milieu érudit et société savante.<br />
1837- 1973<br />
Cltriiciiiie VIDAL, Alcriri BRUNET ...............................<br />
De l’imaginaire <strong>de</strong>s historiens locaux à l’imaginaire <strong>de</strong> François I”<br />
et <strong>de</strong> Henri II : les sculptures scandaleuses du ch2teau <strong>de</strong> Villers-Cotterêts<br />
ÉricTHlERRY ............................................. 167<br />
VIE DES SOCIÉTBS<br />
XLIII’ Congrès <strong>de</strong> la Fidiration <strong>de</strong>s Sociétds d’histoire et d’archéologie <strong>de</strong><br />
l’Aisne, à Soissons ........................................................................................... 191<br />
Féddration <strong>de</strong>s sociétés d’histoire et d’archéologie <strong>de</strong> l’Aisne ....................... 193<br />
37<br />
79<br />
93<br />
117<br />
121<br />
137
Société historique et archéologique <strong>de</strong> Chiìteau-Thierry .................................<br />
Socikté académique d’histoire. d’archéologie. <strong>de</strong>s arts et <strong>de</strong>s lettres<br />
I95<br />
<strong>de</strong> Chauny et <strong>de</strong> sa région ................................................................................ 199<br />
Société historique <strong>de</strong> Haute Picardie ............................................................... 203<br />
Société académique <strong>de</strong> Saint-Quentin ............................................................. 213<br />
Société archéologique. historique et scientifique <strong>de</strong> Soissons ........................ 219<br />
Société archéologique et historique <strong>de</strong> Vervins et <strong>de</strong> la Thiérache ................. 223<br />
Société historique régionale <strong>de</strong> Villers-Cottterêts ........................................... 225<br />
Contacts ................................................ .................................................<br />
Note à l‘attention <strong>de</strong>s auteurs ...................... ........................................... 23 1
L’amour <strong>de</strong> l’histoire <strong>locale</strong><br />
Les sociétés archéologiques et historiques <strong>de</strong> l’Aisne,<br />
XIX‘ et XX‘ siècles<br />
Avant-propos<br />
Au tournant du siècle et du millénaire, la FédCration a voulu se pencher sur<br />
le passé <strong>de</strong>s sociétés archéologiques et historiques <strong>de</strong> l’Aisne dont elle maintient<br />
la tradition vivante I. Certes la création <strong>de</strong> nos sociétés fait partie d’un mouve-<br />
ment national, niais ce mouvement a été mis en oeuvre dans chaque ville, dans<br />
chaque région, par <strong>de</strong>s personnalités qui travaillèrent h constituer la connaissan-<br />
ce du passé : érudits
spécialisées. La Société archéologique, historique et scientifique <strong>de</strong> Soissons fut<br />
créée en 1847. La Révolution <strong>de</strong> 1848 et la secon<strong>de</strong> République ne brisèrent pas<br />
ce mouvement ascendant qui s’amplifia encore sous le Second Empire. Le dépar-<br />
tement <strong>de</strong> l’Aisne ne resta pas à I’écart <strong>de</strong>s tendances nationales : 1850, Société<br />
académique <strong>de</strong> Laon, 1860, Société acadkmique <strong>de</strong> la région <strong>de</strong> Chauny, 1864,<br />
Société historique et archéologique <strong>de</strong> Chrileau-Thierry. Sur le plan national, les<br />
créations reprirent après la guerre <strong>de</strong> 1870 avec une rapidité inconnue jusque là.<br />
La Société archéologique <strong>de</strong> Vervins (1 873) s’inscrivit dans cette reprise qui cul-<br />
mina dans les premières années <strong>de</strong> la Troisième République. Enfin, la Société <strong>de</strong><br />
Villers-Cotterêts fut fondée en 1904 ?.<br />
Portraits d’érudits >, moments <strong>de</strong> fondation et<br />
vie <strong>de</strong>s milieux savants, recherches archéologiques menées en longue durée,<br />
visions historiques marquées par l’anachronisme mais combien romanesques . . .<br />
forment la matière <strong>de</strong> ces Mkmoiws. Dans un espace plus large, bien d’autres<br />
thèmes auraient pu être abordés : le domaine vaut d’être exploré puisqu’il tient à<br />
l’histoire intellectuelle du département. Aussi bref soit-il, nous espérons que ce<br />
volume en montre l’intérêt.<br />
2. La table <strong>de</strong>s matières <strong>de</strong> ce volume wit l’ordre <strong>de</strong> cltiltion <strong>de</strong>s société\.<br />
Claudine VIDAL
Soc i& acarlhiiqiw di> Siiin-Queiitiii<br />
La Société académique <strong>de</strong> Saint-Quentin<br />
Les origines, <strong>de</strong> 1825 a 1850 environ<br />
En 1825, une douzaine <strong>de</strong> Saint-Quentinois réunis chez M. Heré, profes-<br />
seur au collège <strong>de</strong>s Bons-Enfants, jetèrent les bases <strong>de</strong> notre Société ; dès 1826,<br />
elle se réunissait régulièrement. Selon la législation en vigueur, elle ne comptait<br />
alors que vingt membres résidants I et fut reconnue officiellement sous Louis-<br />
Philippe, en 183 I. Elle porta d’abord le nom <strong>de</strong> >, auquel on ajouta bient8t le nom <strong>de</strong> société<br />
d’agriculture. Elle ne <strong>de</strong>vint > que vers 1840.<br />
Elle eut très vite <strong>de</strong> nombreux membres correspondants : 69 en 1837, I04<br />
en 1842, la plupart propriétaires terriens : l’agriculture tenait donc une gran<strong>de</strong><br />
place dans les > et les articles publiés. Dans le tome <strong>de</strong> Me‘moires <strong>de</strong><br />
1829, les sciences physiques et morales, l’histoire, l’archéologie et la jurispru-<br />
<strong>de</strong>nce occupent 3 pages, l’agriculture, l’industrie et le commerce, 21 pages, la lit-<br />
térature et la poésie 41 pages. L‘histoire <strong>locale</strong> apparaît comme la parente<br />
pauvre : la gran<strong>de</strong> question, débattue pendant plusieurs années, consistait 2 sou-<br />
tenir que l’antique Samarobriva est à l’origine <strong>de</strong> Saint-Quentin et non d’Amiens.<br />
Ce fut naturellement, mais à la longue, une cause perdue.<br />
L‘activité <strong>de</strong> la Société académique était alors multiforme : elle fut 2 l’ori-<br />
gine <strong>de</strong> la création d’une caisse d’épargne ; elle fonda un jardin botanique à I’in-<br />
térieur <strong>de</strong> l’ancien couvent <strong>de</strong> Fervaques ; elle ouvrit un musée <strong>de</strong> peinture et<br />
d’archéologie, elle créa une section horticole, <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong> botanique, d’arbori-<br />
culture, etc. Les AIiiimles agricoles du <strong>de</strong>‘prtement <strong>de</strong> I’Ai,me étaient publiées<br />
sous son égi<strong>de</strong>. Pendant une bonne partie du siècle, les concours <strong>de</strong> poésie connu-<br />
rent un essor considérable, disputant, dans les publications, la première place à<br />
l’agriculture.<br />
Enfin, elle correspondait avec <strong>de</strong> nombreuses sociétés
La belle époque <strong>de</strong> la Société, <strong>de</strong>s années 1850 à 1914<br />
Sans se détourner <strong>de</strong> l’agriculture et <strong>de</strong> la poésie, la Société se souciait <strong>de</strong><br />
plus en plus <strong>de</strong> la recherche <strong>de</strong>s origines el <strong>de</strong> l’illustration <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> la<br />
ville, suivant en cela les préoccupations <strong>de</strong>s historiens <strong>de</strong> l’époque, notamment<br />
d’Henri Martin. Quelques membres éminents consacrèrent une gran<strong>de</strong> part <strong>de</strong><br />
leur temps, profitant <strong>de</strong> la gran<strong>de</strong> liberté qui touchait les recherches et les fouilles<br />
archéologiques, pour réaliser <strong>de</strong>s travaux remarquables.<br />
Ainsi, Charles Gomart publia <strong>de</strong>s éditions d’auvres d’historiens anciens,<br />
assorties <strong>de</strong> commentaires et <strong>de</strong> plans - qui sont bien souvent les seuls dont nous<br />
disposons aujourd’hui - à propos <strong>de</strong> la situation <strong>de</strong> la ville du Moyen Age, au<br />
XVI siècle, sans oublier le siège <strong>de</strong> 1557, et pendant l’époque classique. I1 étu-<br />
dia les archives <strong>de</strong> la ville et les comptes <strong>de</strong>s argentiers dont il tira <strong>de</strong>s récits pit-<br />
toresques, soigneusement référencés.<br />
Théophile Eck et Jules Pilloy, tout en sacrifiant à la chronique <strong>locale</strong>, se<br />
spécialisèrent dans l’archéologie, en ville et dans les environs ; ils procédèrent à<br />
<strong>de</strong>s fouilles <strong>de</strong> sites gallo-romains et, surtout, mérovingiens et consignèrent le<br />
détail <strong>de</strong> leurs découvertes, assorti <strong>de</strong> gravures <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> qualité. Nous disposons<br />
également d’une partie <strong>de</strong>s objets ainsi mis àjour, qui figurent dans les vitrines<br />
<strong>de</strong> notre musée.<br />
Des étu<strong>de</strong>s approfondies furent également menées par Emmanuel<br />
Lemaire : le Livre rouge rassemble les textes essentiels <strong>de</strong> notre commune. Les<br />
différents textes manuscrits <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> médiévale furent transcrits, traduits et<br />
présentés <strong>de</strong> façon exemplaire. Le Mystère <strong>de</strong> Suirit-Queritin, manuscrit <strong>de</strong> Jean<br />
Molinier datant <strong>de</strong> 1482, traduit et commenté par Henri Chatelain, fut édité par la<br />
Société. De 1869 à 1872, <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssins <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> qualité furent réalisés par<br />
Joachim Malézieux, en particulier pour le bel album Moriirrnents du Saint-<br />
Quentinois. Jusqu’en 1914 furent publiés régulièrement - souvent chaque année<br />
- <strong>de</strong>s recueils <strong>de</strong> textes, conférences, étu<strong>de</strong>s concernant le patrimoine local, qui<br />
servent <strong>de</strong> base soli<strong>de</strong> 2 notre information ’.<br />
C’est pendant cette pério<strong>de</strong> brillante que la Socidté €it construire l’hôtel<br />
qui l’abrite actuellement ; il fut conçu par l’architecte Jules Hachet et bBti sur<br />
l’emplacement <strong>de</strong> la chapelle <strong>de</strong> l’abbaye d’Isle. Le sculpteur Gustave Coin en<br />
décora la faça<strong>de</strong> ainsi que les motifs <strong>de</strong> la salle <strong>de</strong>s sdances, où étaient représen-<br />
tés les douze blasons <strong>de</strong>s villes du Vermandois.<br />
Mais la Gran<strong>de</strong> Guerre brisa I’aclivilé <strong>de</strong> la Société : l’hôtel fut occupé par<br />
<strong>de</strong>s officiers allemands, les collections dispersées et perdues. Les principaux<br />
chercheurs moururent. Tout était à reprendre.<br />
3. 11 est interessant. au su.jet <strong>de</strong> la contribution <strong>de</strong> ces érudits i l’histoire <strong>de</strong> Saint-Quentin, <strong>de</strong> lire la<br />
monopphie <strong>de</strong> M. Jean-Luc COLLART dan5 le numéro spCcial <strong>de</strong> la Kr\~re d’trrdi6ologie <strong>de</strong><br />
Pic,nrdie, novembre 1999. p. 67- 128.
Les temps difficiles : 1919-1945<br />
La Sociétk académique <strong>de</strong> Saint-Quentin 9<br />
Il fallut reconstruire. Pour les membres <strong>de</strong> la Société, cela consistait à<br />
reconstituer les collections, reprendre les étu<strong>de</strong>s, redonner aux Saint-Quentinois<br />
le goat <strong>de</strong> l’histoire <strong>locale</strong>. Cela prit du temps. Les dommages <strong>de</strong> guerre permi-<br />
rent <strong>de</strong> rendre l’hôtel à sa <strong>de</strong>stination après 1925, mais l’activité resta bien<br />
mo<strong>de</strong>ste : les tomes <strong>de</strong> Mémoires datent <strong>de</strong> 1929, 1935 et ... 1948. Une nouvelle<br />
génération d’historiens locaux comme Charles Journel, Maurice Leleu, Augustin<br />
Bacquet stimulhrent l’activité <strong>de</strong> la Société. Elie Fleury écrivit Sous la botte,<br />
Les murs <strong>de</strong> Saint-Quentin, Les 64 séances du conseil municipal, retraçant les<br />
souffrances <strong>de</strong>s habitants pendant l’occupation et lors <strong>de</strong> l’exo<strong>de</strong> <strong>de</strong> mars 1917.<br />
La reconstruction <strong>de</strong> la basilique fut soutenue et suivie avec fidélité, mais les<br />
activités <strong>de</strong> fouilles <strong>de</strong>meurèrent limitées à ce que la guerre avait mis à jour, avec<br />
cependant un grand intérêt pour les souterrains et caves <strong>de</strong> la ville.<br />
La secon<strong>de</strong> guerre mondiale limita les travaux <strong>de</strong> la Société ; la prési<strong>de</strong>n-<br />
ce <strong>de</strong> Pierre Cassine en maintint l’existence.
Le temps <strong>de</strong>s changements, <strong>de</strong>puis 1945<br />
La direction <strong>de</strong> la société a été naturellement renouvelée. Pamii les prési-<br />
<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> cette dcmière pério<strong>de</strong>, il faut citer Georges Gorisse, Jean Agombart,<br />
Théodule Collart et, surtout, Jacques Ducastelle, prési<strong>de</strong>nt dès 1947 puis à quatre<br />
autres reprises ; sa <strong>de</strong>rnière prési<strong>de</strong>nce date <strong>de</strong> 1972, cette fois4 pour trois ans,<br />
ce qui est <strong>de</strong>venu la règle statutaire : ainsi a-t-on garanti au prési<strong>de</strong>nt une durée<br />
suffisante pour mener à bien ses projets, mais en limitant son inandat pour assu-<br />
rer un changement nécessaire.<br />
En 1952, la Société est entrée dans la nouvelle fédération <strong>de</strong>s sociétés<br />
> <strong>de</strong> l’Aisne. Elle a alors cessé <strong>de</strong> publier ses propres tomes <strong>de</strong><br />
Mr‘nioires - environ 30 000 pages en 125 ans - et contribue pour sa part aux<br />
publications <strong>de</strong> la Fédération.<br />
Maître Ducastelle - également prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Fédération <strong>de</strong> 1979 2 1986<br />
- a donné un grand Clan à nos activités : il a mis en place le classement <strong>de</strong> nos<br />
archives et <strong>de</strong> notre bibliothèque ; il a conçu et organisé, en 1980, le colloque<br />
national sur les chartes et le mouvement communal ; en 1989, une semaine <strong>de</strong><br />
conférences et autres activités, accompagnées <strong>de</strong> publications d’histoire <strong>locale</strong>, a<br />
célébré l’anniversaire <strong>de</strong> la Révolution française. Notre Société a publié sous sa<br />
direction <strong>de</strong>s recueils et dossiers <strong>de</strong> documents historiques commentés.<br />
Le recrutement <strong>de</strong> la Société évolue : <strong>de</strong>s femmes, <strong>de</strong> plus en plus nom-<br />
breuses, <strong>de</strong>viennent membres à part entière ; <strong>de</strong>s jeunes gens, <strong>de</strong>s étudiants,<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt leur admission, en même temps qu’ils poursuivent <strong>de</strong>s sujets <strong>de</strong> maî-<br />
trise. Le grand public, très sensibilisé par le patrimoine local, cherche à en savoir<br />
davantage, même s’il ne participe gu?rc à la recherche. Notre siège dispose d’un<br />
confort satisfaisant, d’un équipement audiovisuel et a été récemment informatisé.<br />
La Société s’ouvre à la vie urbaine, sortant du cadre <strong>de</strong> son hôtel. Elle est<br />
présente lors <strong>de</strong>s fêtes du patrimoine, elle participe aux visites guidées avec I’of-<br />
fice du tourisme. Elle met en place, dans le cadre <strong>de</strong> sa bibliothèque, un ensemble<br />
<strong>de</strong> dossiers thématiques pour tout le Saint-Quentinois. Elle collabore <strong>de</strong> plus en<br />
plus avec les sociétés <strong>locale</strong>s, qui sont souvent ses filles et viennent rechercher<br />
auprès d’elle <strong>de</strong>s documents et <strong>de</strong>s conseils.<br />
Elle a eu 175 ans en l’an 2000.<br />
Moniyue SEVERIN et André TRIOU
Avant-propos<br />
Jean Héré (1796 - 1865),<br />
un érudit Saint-Quentinois d’adoption<br />
La Société académique <strong>de</strong> Saint-Quentin fut fondée en 1825, quelques<br />
bases étant jetées en octobre et renforcées en 1826. L‘autorisation du pouvoir<br />
s’étant fait attendre, elle ne fut oftïcielle que le 15 avril 1827. Elle était en exa-<br />
men <strong>de</strong>puis un an.<br />
Très vite, ses buts furent Clargis et son appellation, conforme au désir <strong>de</strong>s<br />
fondateurs, <strong>de</strong> > s’étendit, en 1829, à la<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> du préfet, en . Ce titre <strong>de</strong>meura inchangé jusqu’à la <strong>de</strong>rnière <strong>de</strong>s publications <strong>de</strong> la<br />
Société. en 1940.<br />
Depuis l’élaboration <strong>de</strong>s nouveaux statuts, approuvés en 1973, le titre plus<br />
sobre <strong>de</strong> Société académique <strong>de</strong> Saint-Quentin a été adopté.<br />
Mais nous voyons une grave lacune dans les premiers titres : le mot his-<br />
toire n’y était même pas inscrit ! Et nous pouvons constater, à la lccture <strong>de</strong> nos<br />
Mémoires que, sauf à <strong>de</strong> très rares exceptions, elle n’y est pas retracée, tout au<br />
moins sur le plan local. L‘histoire antique, parfois la guerre <strong>de</strong> 1557, y figurent<br />
comme objet d’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> certains chercheurs et > <strong>de</strong> nombreux<br />
poètes, mais guère d’histoire <strong>locale</strong> avant Gomart et Lemaire, à partir <strong>de</strong> 1860. Ils<br />
seront suivis au XX‘ siècle <strong>de</strong> Jules Hachet, Charles Journel, Georges Gorisse,<br />
Jean Agombart, Jacques Ducastelle et autres, que nous n’oublierons pas.<br />
On ne peut qu’admirer la puissance <strong>de</strong> travail <strong>de</strong>s fondateurs et <strong>de</strong> leurs<br />
successeurs, mais Dieu ! que leurs euvres nous semblent parfois ennuyeuses !<br />
Bien que leur style ne soit pas toujours anipoulé comme celui <strong>de</strong> leur époque, il
y manque une touche <strong>de</strong> vie, indispensable <strong>de</strong> nos jours. On y relève pourtant <strong>de</strong>s<br />
remarques pertinentes, qui n’ont pas pris une ri<strong>de</strong>. On peut admirer, d’autre part,<br />
la virtuosité <strong>de</strong> nos érudits, à passer d’une dissertation philosophique aux sujets<br />
agricoles ou scientifiques.<br />
L‘exposé qui va suivre est un hommage à nos fondateurs. Depuis près <strong>de</strong><br />
175 ans, la Société académique s’efforce d’être digne d’eux.<br />
La fondation <strong>de</strong> la Société académique<br />
L‘historique <strong>de</strong> la Société académique <strong>de</strong> Saint-Quentin a été minutieuse-<br />
ment rédigé en 1975, dans l’ouvrage spécial que cette <strong>de</strong>rnière édita à cette occa-<br />
sion I. e Une douzaine <strong>de</strong> personnes, y est-il mentionné, se réunissaient en 1825<br />
chez M. Héré, professeur <strong>de</strong> mathématiques au collège <strong>de</strong> Saint-Quentin >>. C’est<br />
tout et c’est trop peu pour Jean Héré, un érudit qui a passé en notre ville presque<br />
toute sa vie : il y arriva à l’lige <strong>de</strong> 26 ans et y termina ses jours. Daniel Raffard<br />
<strong>de</strong> Brienne, qui <strong>de</strong>scend en droite ligne <strong>de</strong> Jean Héré, Albert Martin <strong>de</strong> Méreuil,<br />
son parent, Charles Daudville et Théodule Collart, <strong>de</strong>ux prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> la Société<br />
académique, nous ont laissé <strong>de</strong> quoi satisfaire notre curiosité en éclairant la per-<br />
sonnalité <strong>de</strong> celui qui dirigea à dix reprises notre Société. Notons que. jusqu’en<br />
1967, la prési<strong>de</strong>nce en était renouvelée chaque année. Les comptes rendus et les<br />
articles publiés dans nos Mkmoires enrichissent ces témoignages.<br />
Dans son essai généalogique ’, Albert Martin <strong>de</strong> Méreuil évoque une<br />
parenté avec le célèbre architecte <strong>de</strong> Nancy, Emmanuel Héré <strong>de</strong> Corny, ou une<br />
ascendance nivernaise (originaire du Bourbonnais) avec particule et blason : <strong>de</strong><br />
gueules au hérisson d’argent, au chef d’argent, ascendance aristocratique dont<br />
Jean Héré n’était pas convaincu. Toutefois, le généalogiste remonte au XVIII‘<br />
siècle, avec cinq générations <strong>de</strong> laboureurs ou vignerons du Loiret (cantons <strong>de</strong><br />
Gien et <strong>de</strong> Chltillon-Coligny), où tous les aînés portent le prénom <strong>de</strong> Jean.<br />
Le père <strong>de</strong> notre Jean Héré naquit en 1758 h Sainte-Geneviève-<strong>de</strong>s-Bois<br />
(Loiret) où il se trouva orphelin à trois ans. C’est lui qui <strong>de</strong>vint vigneron 2<br />
Chatillon-sur-Loing ’. Marié une première fois et <strong>de</strong>venu veuf, il épousa en 1791<br />
Colombe Harrault, dont le père était
Les débuts <strong>de</strong> son instruction furent assurés par le prêtre qui avait bénéfi-<br />
cié <strong>de</strong> la protection <strong>de</strong> son père. Par reconnaissance, le curé fit entrer son jeune<br />
élève au séminaire d’Orléans, d’oir il put poursuivre brillamment ses étu<strong>de</strong>s au<br />
lycée <strong>de</strong> la ville. I1 y excellait déjà dans la composition <strong>de</strong>s vers latins.<br />
I1 fallait vivre et ai<strong>de</strong>r la famille. Le jeune Héri entra comme précepteur<br />
dans une lamille aisée. I1 enseigna à l’institution Morin, à Paris, puis en qualité<br />
<strong>de</strong> maître <strong>de</strong> mathématiques à I’Ecole militaire préparatoire <strong>de</strong>s Boulayes, près <strong>de</strong><br />
Tournans, dans le Doubs. En 1822, à 26 ans, il fut nommé à la chaire <strong>de</strong> mathé-<br />
matiques du collège <strong>de</strong>s Bons-Enfants, B Saint-Quentin. Après huit années, il<br />
avait enfin trouvé la stabilité et sa carrière allait désormais se dérouler dans cet<br />
établissement.<br />
Le collège <strong>de</strong>s Bons-Enfants<br />
L‘ancienne maison <strong>de</strong>s Capets, ainsi appelée en raison du vêtement ’ <strong>de</strong>s<br />
élèves, a assuré les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> brillants savants, voyageurs, jurisconsultes, histo-<br />
riens et artistes <strong>de</strong> notre cité et <strong>de</strong> ses environs. Fondée par I’évêque Alomer, elle<br />
jouissait d’une bonne réputation. Notre bon saint Médard en fut l’élève et, plus<br />
tard, <strong>de</strong>venu évêque <strong>de</strong> Saint-Quentin puis <strong>de</strong> Noyon et Tournai, le proteceur.<br />
Les temps difficiles qui régnèrent ensuite firent perdre au collège <strong>de</strong>s<br />
Bons-Enfants son existence même et sa renommée. I1 ne la retrouva qu’à la fin du<br />
XII’ siècle et au début du XIIP, sous la houlette <strong>de</strong> Pierre Waudès et <strong>de</strong>s cha-<br />
noines <strong>de</strong> l’église royale <strong>de</strong> Saint-Quentin, auxquels il servait <strong>de</strong> séminaire, et<br />
sous la protection <strong>de</strong> Raoul I”, comte du Vermandois, mort en 1151. En 1254, le<br />
roi Saint Louis fonda en l’église une chapelle dite
1660 et 1750. Tous ces vénérables britiments abritèrent les étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Pierre<br />
Ramus. <strong>de</strong> Clau<strong>de</strong> Emmeré, <strong>de</strong>s <strong>de</strong> La Fons, <strong>de</strong> Jacques Lescot, d’Omer Talon,<br />
<strong>de</strong>s Dorigny, <strong>de</strong>s Papillon, <strong>de</strong> Xavier <strong>de</strong> Charlevoix, sans compter nos brillants<br />
compatriotes <strong>de</strong>s XVIII‘ et XIX‘ siècles. Jusqu’en 1746, le collège <strong>de</strong>s Bons-<br />
Enfants resta le seul établissement d’instruction <strong>de</strong> Saint-Quentin (en 1764 : 140<br />
élèves ; en 1813 : 171).<br />
Après une brillante pério<strong>de</strong>, la Révolution survint. Le chapitre <strong>de</strong> Saint-<br />
Quentin fut dissous et le collège fernié. Réouvert en 1791, il fut à nouveau fermé<br />
en 1793, pour dix années.<br />
A la suite <strong>de</strong> la réorganisation <strong>de</strong> l’Instruction publique, due au Premier<br />
Consul, en 1804, c’est la municipalité qui fut chargée <strong>de</strong> gérer le collège, par I’in-<br />
termédiaire d’un bureau composé du sous-préfet, du maire et <strong>de</strong>s > citoyens <strong>de</strong> la ville, dont l’archidiacre. Ce ne fut d’abord qu’une école<br />
secondaire communale. De nouveaux blitiments furent construits en 1807, 1823<br />
et 1840.<br />
Dès 1812, le maire, Joly aîné, sollicitait la transformation du collège en<br />
lycée. Mais il fallut attendre le IO août 1853 pour obtenir ce titre tellement<br />
convoité. Dès lors, le collège fonctionna en lycée jusqu’h l’achèvement <strong>de</strong>s nou-<br />
veaux britiments, construits au Champ-<strong>de</strong>-Mars, sur un hectare <strong>de</strong> terrain <strong>de</strong>s for-<br />
tifications, qui ouvrirent leurs portes en 1857.<br />
Nous pouvons constater, à la lecture <strong>de</strong>s listes d’anciens membres <strong>de</strong> la<br />
Société académique, combien <strong>de</strong> professeurs du collège y adhérèrent et combien<br />
<strong>de</strong> membres se louaient d’avoir reçu leur instruction au collège.<br />
Jean Héré a Saint-Quentin<br />
Peu après son arrivée, en 1822, pour tenir un poste d’enseignement au col-<br />
lège, Jean Héré fut Cgalement chargé du nouveau cours d’adultes. En 1825, le<br />
professeur se lia aux érudits <strong>de</strong> la ville, parmi lesquels Fouquier-Cholet, Mangon<br />
<strong>de</strong> la Lan<strong>de</strong>, Bucelly d’Estrées, Charles Daudville, Durand et Sinionin, ses col-<br />
lègues. ><br />
En 1925, le docteur Leconte, alors prési<strong>de</strong>nt, écrivait, en relatant la séance<br />
du > : > Le<br />
28 octobre 1825, ce petit groupe jeta les bases <strong>de</strong> la Société académique et en éla-
ora les statuts 8. L‘autorisation officielle, toutefois, tarda. Elle ne fut obtenue que<br />
le 15 avril 1827. Parmi les douze fondateurs, certains avaient dû se retirer, mais<br />
vingt membres, nombre limite imposé par le gouvernement, se mirent à I’ccuvre ...<br />
Jean Héré présida la docte assemblée dès 183 1. I1 fut ensuite choisi à neuf autres<br />
reprises par ses collègues, pour la <strong>de</strong>rnière fois en 186 I . II fut égalenient trésorier<br />
en 1846, 1847, 1853 et 1860.<br />
Le 1 I avril 183 I , Jean Héré se fixa définitivement dans sa ville d’adoption<br />
en épousant Célina Déalle, nCe à Saint-Quentin le 5 novembre 18 IO. Elle avait été<br />
son élève au pensionnat <strong>de</strong> Madanie <strong>de</strong> Bucelly ”. Le beau-père <strong>de</strong> Jean Héré,<br />
Victor Déalle, avait fondé en ville la première étu<strong>de</strong> d’avoué en 1808. II fut<br />
adjoint, puis maire <strong>de</strong> Saint-Quentin, <strong>de</strong> 1837 i 1841. Madame Héré donnera à<br />
son époux <strong>de</strong>ux enfants : Emilienne, née en 1832, qui épousa en 1853 Auguste<br />
Raffard <strong>de</strong> Brienne, et Alfred, né en 1835, marié à Anna Dumont en 1869.<br />
En 1822, quand Jean Héré vint occuper i Saint-Quentin sa chaire <strong>de</strong><br />
mathématiques. le principal du collège était M. Maupérin, venu <strong>de</strong> Laon en 182 I<br />
et promu en novembre <strong>de</strong> la même année. Héré ne l’avait pas attendu pour parti-<br />
ciper à la mise en place, au collège, <strong>de</strong> cours du soir. Par la suite, il organisa <strong>de</strong>s<br />
cours <strong>de</strong> géométrie et <strong>de</strong> mécanique appliquées aux arts, professés dès 1827 par<br />
lui-même et <strong>de</strong>ux <strong>de</strong> ses collègues. 11 donna également <strong>de</strong>s cours aux pensionnats<br />
<strong>de</strong> jeunes filles <strong>de</strong> Madame <strong>de</strong> Bucelly, rue du Gouvernement, et <strong>de</strong> Madame<br />
Maydieu, rue du Petit-Origny.<br />
Jules Moureau I’’ a retracé brièvement la carrière <strong>de</strong> Héré. Mauperin ayant<br />
démissionné <strong>de</strong> sa direction en 1832, Héré fut nommé principal du collège, tout<br />
en conservant sa chaire <strong>de</strong> mathématiques. Peu <strong>de</strong> temps après, il obtint la nonii-<br />
nation <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux régents supplémentaires <strong>de</strong> philosophie, <strong>de</strong> physique et chimie,<br />
puis celle d’un aumônier. Grke à lui, son collège fut déclaré <strong>de</strong> plein exercice et<br />
sortit victorieux <strong>de</strong> la concurrence avec les premières institutions privées qui se<br />
créaient i Saint-Quentin. Rappelons d’ailleurs que les maîtres <strong>de</strong> ces pensions<br />
envoyaient leurs élèves suivre les cours du collège ...<br />
Jean Héré fut promu officier <strong>de</strong> l’Université en I836 II et, l’année suivan-<br />
te, son collège obtient la première place dans les concours organisés par le rec-<br />
teur, ouverts i tous les collèges <strong>de</strong> l’académie d’Amiens. Tout en veillant ri la<br />
bonne direction <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s et à leurs progrès, Héré s’occupait aussi <strong>de</strong>s installa-<br />
tions <strong>de</strong> son établissement. I1 obtient <strong>de</strong> l’administration municipale la restaura-<br />
tion <strong>de</strong>s biìtiments qui serviront encore, en 1856, <strong>de</strong> cuisine, <strong>de</strong> parloir et d’infir-<br />
merie, dans un collège qui comptait alors un peu plus <strong>de</strong> cent élèves. Mais <strong>de</strong>s
aisons <strong>de</strong> santé obligèrent le principal à donner sa démission à la fin <strong>de</strong> l’année<br />
scolaire 1837- 1838. Charles Daudville laisse entendre que cette fonction, insépa-<br />
rable d’un certain rigorisme indispensable à la discipline, était incompatible avec<br />
son caractère porté iì l’indulgence I’. Remplacé iì la direction par son collègue<br />
Simonin en octobre 1838, Héré continua d’exercer son enseignement jusqu’en<br />
1853.<br />
> note encore Charles Daudville, qui<br />
ajoute : )<br />
C’est Jean Héré qui avait sollicité la présence d’un aumônier au sein du<br />
collège. Une vieille et respectueuse amitié l’avait lié à l’abbé Guillon. traducteur<br />
<strong>de</strong>s auteurs grecs, <strong>de</strong>venu <strong>de</strong>puis aumônier <strong>de</strong> la reine Marie-Amélie. Deux<br />
pièces <strong>de</strong> vers, L’Iininortdité et Pourquoi Dieu N créé I’hornnie iinpriufcrit, laissent<br />
apparaître la nature <strong>de</strong> ses convictions religieuses. Son entourage témoigne <strong>de</strong> sa<br />
bienveillance, son affabilité, son indulgence, son dévouement aux siens, à ses<br />
amis, à sa patrie. C’est probablement cet état d’esprit qui le porta à accepter <strong>de</strong><br />
figurer sur la liste <strong>de</strong>s candidats aux élections municipales (1 8 août 1846) condui-<br />
te par Charles Lemaire, philosophe et humaniste bien connu <strong>de</strong>s Saint-<br />
Quentinois. Mais, re<strong>de</strong>venu régent <strong>de</strong> mathématiques au collège, Jean Héré, élu<br />
dans la 2 section, vit sa nomination <strong>de</strong> conseiller refusée, en tant que salarié <strong>de</strong><br />
la ville, et I’élection est annulée. I1 présenta une requête au roi. Entendu le<br />
Conseil d’Etat, il fut finalement admis que le professeur était fonctionnaire <strong>de</strong><br />
l’Université, nommé par le ministre <strong>de</strong> l’Instruction publique, et ne <strong>de</strong>vait donc<br />
pas être considéré comme agent salarié <strong>de</strong> la ville. Ainsi, l’arrêté du 18 avril 1846<br />
du conseil <strong>de</strong> la préfecture fut annulé et I’élection <strong>de</strong> Jean Héré déclarée bonne et<br />
valable. ) Le professeur fut élu aux elections<br />
municipales suivantes, toujours au moins dans les douze premiers <strong>de</strong> la liste. I1<br />
fut aux côtés du docteur Bourbier lors <strong>de</strong> la proclamation <strong>de</strong> la Deuxième<br />
République.<br />
Le coup d’Etat du 2 décembre I85 1 provoqua la démission du maire et <strong>de</strong><br />
son conseil et la mise en place d’une commission municipale, dirigée par Auguste<br />
Foy, neveu du général, doyen d’âge, puis par Charles Naniuroy, qui sera ensuite<br />
maire <strong>de</strong> Saint-Quentin. Le 27 décembre, le sous-préfet Symphor Boitelle réunit<br />
les membres <strong>de</strong>s tribunaux, <strong>de</strong>s prud’hommes, <strong>de</strong> la commission municipale, <strong>de</strong>s<br />
hospices et bureaux <strong>de</strong> bienfaisance, les professeurs du collège, les officiers <strong>de</strong> la<br />
12. Ihitl.<br />
I 3. Ihid.<br />
14. Archives cc”unales <strong>de</strong> Saint-Quentin, I K 37.
Gar<strong>de</strong> Nationale. > Aux élections <strong>de</strong> septembre<br />
1852, Jean Héré resta avec Charles Namuroy. II fut réélu en août 1860. Dans les<br />
municipalités présidées ensuite par Charles Picard et Huet-Jacquemin, l’ancien<br />
professeur - à la retraite <strong>de</strong>puis I853 - apporta toute sa participation, jusqu’à sa<br />
mort. en 1865.<br />
La Société académique et Jean Héré<br />
Dès 1827, le préfet <strong>de</strong> l’Aisne, le comte <strong>de</strong> Floirac, avait souhaité que la<br />
société porte <strong>de</strong> nom <strong>de</strong> > et intègre dans ses travaux l’amélioration et la défense <strong>de</strong>s intérêts<br />
<strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière branche, non encore représentée dans le département <strong>de</strong><br />
l’Aisne. Ce r61e fut par la suite dévolu aux les comices agricoles ; celui <strong>de</strong> l’arrondissement<br />
<strong>de</strong> Saint-Quentin fut fondé en 1852.<br />
Déclarée le 15 août I831
18 Moniqrie SPverin<br />
fable, petite comédie en raccourci, con<strong>de</strong>nsée en une situation et en quelques<br />
vers, et oÙ la moralité doit se détacher nettement <strong>de</strong> la fiction I*. >><br />
En effet, le 2 1 octobre 1830, lors <strong>de</strong> sa première prési<strong>de</strong>nce, Jean Héré<br />
montra l'intérêt qu'il portait à la littérature. Par la suite, presque tous les volumes<br />
<strong>de</strong> Mémoires <strong>de</strong> la Société académique publièrent <strong>de</strong>s poèmes et, entre autres, <strong>de</strong>s<br />
fables <strong>de</strong> Jean Héré. On peut citer >, I":<br />
Mes bons parents, je vous rirlore<br />
Je suis bien heureuse par vous !<br />
Pourquoi cepencltint je 1 'ignore.<br />
Pourquoi dans uti état si doLr.u,<br />
Mon cvur d&sire-t-il encore ?<br />
Héré quittait parfois le genre élégiaque et contait les efforts <strong>de</strong> Parmentier<br />
pour propager la consommation <strong>de</strong> la pomme <strong>de</strong> terre, > :<br />
[les sentinelles qui siiiiirleiit la gcrr<strong>de</strong> <strong>de</strong>s ck(iniys .se rerirrrnt]<br />
011 entre clans le ch or ni^. on emporte en ccicliette :<br />
Cette habile nim(nivre cririsi se continue.<br />
Qircind. cle,foiriIler le chriiiip, l'heure est enfin venue<br />
On recorinriît (lu 'il est récolté tout entier:<br />
Encore quelques titres : (< L'arbre greffé >>, >, > :<br />
Sur safifi~ure bl¿?ine ir 1 'lrir trop iiip?ii~i<br />
Le tnalheureux, benié pur chacun à Irr ron<strong>de</strong><br />
Repit <strong>de</strong> grmids souflets pour ciniuser le mon<strong>de</strong>.<br />
>, ><br />
II n'est piis yoe les ciloirettes<br />
Que l'on prenne ciinsi p r 1e.s yeux :<br />
On prend <strong>de</strong> ni¿?rne 1i.s coqrrettrs<br />
Et Im hornmes anibitiiwx.<br />
Son attrait pour la fable et les > conduira Jean Héré à mettre à<br />
l'honneur, en 1851, le talent <strong>de</strong> notre compatriote Charles Desains, parent <strong>de</strong>s<br />
18. Journal <strong>de</strong> Sciint-Quentin, 23 .iiiin 1865.<br />
19. (( La jeune fille n, IC'< strophe, t. I, p. 260.<br />
20.
Jetin Her& 19<br />
<strong>de</strong>ux savants frères Edouard et Paul, plus connus <strong>de</strong>s Saint-Quentinois. Charles<br />
Desains, né en 1789 à Lille, pratiquait plusieurs arts, la poésie et la peinture.<br />
Elève <strong>de</strong> David, auteur <strong>de</strong> belles toiles, il était professeur <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssin à I’école nor-<br />
inale et membre <strong>de</strong> la Société philotechnique. Un gros recueil <strong>de</strong> ses Fcihles,<br />
ariecdotes et contes fut publié en 186 1 (secon<strong>de</strong> édition), orné <strong>de</strong> la statue du bon<br />
La Fontaine <strong>de</strong>ssinée par l’auteur. Au décès <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier, en 1863, Jean Héré lui<br />
rendra un nouvel hommage iì la Société académique ”.<br />
Fréqueniment rapporteur du concours <strong>de</strong> poésie, Jean Héré publia lui-<br />
même <strong>de</strong>ux recueils <strong>de</strong> fables, en 1830 et en 1860, au protit <strong>de</strong>s indigents. I1 pra-<br />
tiqua toute sa vie l’art <strong>de</strong> la fable, dont certaines figuraient encore dans le volu-<br />
me <strong>de</strong> MPt?ioire..s <strong>de</strong> 1864, un an avant le décès <strong>de</strong> notre poète-mathématicien.<br />
Une petite pièce en vers remporta un tel succès, que celle-ci se trouva <strong>de</strong>ux fois<br />
transcrite dans ce même ouvrage. II s’agit <strong>de</strong>
a <strong>de</strong>stiné à ses élèves <strong>de</strong>s pensionnats <strong>de</strong> jeunes filles ’g. I1 se défend d’aucune<br />
prétention : I1 existe tant <strong>de</strong> rhétoriques françaises que l’on est en droit <strong>de</strong> me<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>r pourquoi j’ai pris la peine <strong>de</strong> composer celle-ci. N’ai-je pu en trouver<br />
une seule qui me convînt ? Ai-je eu la prétention <strong>de</strong> faire plus ou mieux que ceux<br />
qui se sont occupés <strong>de</strong> cette matière ‘? Je ferai d’abord observer que celui qui<br />
enseigne a besoin d’approprier son enseignement à ses élèves ; qu’il n’enseigne<br />
jamais mieux que d’après ses idées et sa métho<strong>de</strong> ; que cette métho<strong>de</strong>, ne fut-elle<br />
pas absolument la meilleure, elle l’est toujours, relativement à lui. Cela posé, je<br />
dirai que, loin <strong>de</strong> vouloir faire plus que ce qui s’est fait jusqu’à présent, j’ai peut-<br />
être voulu faire moins, j’ai voulu faire différemment . >> Et Charles Daudville sou-<br />
ligne que, dans ce traité, contrairement aux usages <strong>de</strong> l’époque, Héré cite volon-<br />
tiers <strong>de</strong>s auteurs contemporains. Ajoutons que le maître dédiait cet ouvrage (( à<br />
son élève préférée >>, sa propre fille<br />
De nombreux extraits <strong>de</strong>s discours et rapports conservés montrent la<br />
mo<strong>de</strong>rnité <strong>de</strong> ses idées. Lors <strong>de</strong> l’inauguration <strong>de</strong> son cours <strong>de</strong> géométrie et <strong>de</strong><br />
mécanique, en 1826, Héré démontre la nécessité <strong>de</strong> rendre populaires les sciences<br />
et l’imperfection notoire <strong>de</strong> l’industrie sans leur secours. (< I1 faut en convenir, dit-<br />
il, si la France connaît les meilleurs auteurs, chez lesquels l’Angleterre elle-même<br />
vient s’instruire ; si elle a un génie plus inventif, puisque la plupart <strong>de</strong>s décou-<br />
vertes <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rniers temps nous appartiennent, l’Angleterre sait, mieux que nous,<br />
profiter <strong>de</strong> nos connaissances et employer nos propres découvertes ’“. D<br />
> Lors <strong>de</strong> ses communi-<br />
cations, Jean Héré présenta <strong>de</strong>s exposés sur les puits artésiens, les aérolithes, les<br />
variations <strong>de</strong> la température. I1 étudia le mémoire d’un savant allemand sur la<br />
<strong>de</strong>nsité du lait <strong>de</strong> vache. Le texte d’une importante recherche, citée en 1828, sur<br />
(c L‘astronomie <strong>de</strong>s peuples anciens, <strong>de</strong> sa naissance à nos jours D. qui remonte à<br />
2000 ans avant Jésus-Christ, n’est pas arrivé jusqu’à nous.<br />
Lors <strong>de</strong> la séance publique du 2 1 octobre 1830, Jean Héré déclarait : (< Au<br />
milieu <strong>de</strong>s événements mémorables qui se passent autour <strong>de</strong> nous, dans un<br />
moment où la politique seule absorbe toute l’attention publique, il est difficile <strong>de</strong><br />
détourner les esprits d’un aussi grand spectacle pour les arrCter sur les travaux<br />
d’une mo<strong>de</strong>ste académie I’. D Et, après avoir mentionné les recherches <strong>de</strong>s<br />
diverses sections, il rappelait aux membres :
Jem H&é 21<br />
duites dans nos campagnes ! Les jachères ont presque partout disparu, le maïs<br />
(dans le Soissonnais) et le chou-arbre <strong>de</strong> Laponie sont cultivés, l’extirpateur 13<br />
se répand, les charrues se perfectionnent. Plusieurs constructeurs avisés <strong>de</strong> l’ar-<br />
rondissement sont l’objet <strong>de</strong> rapports favorables. >><br />
Le 9 mars 184 I , en l’absence du prési<strong>de</strong>nt Raison, Jean Héré présida la<br />
séance trimestrielle d’agriculturc. On y traita <strong>de</strong> houblon, <strong>de</strong> vicinalité, <strong>de</strong> graines<br />
<strong>de</strong> poireaux et du mûrier. I1 disait : ><br />
L’inauguration <strong>de</strong> la gare<br />
Nous voici le I) juin 1850. La ligne <strong>de</strong>s c Chemins <strong>de</strong> fer du Nord >> est par-<br />
venue <strong>de</strong> Paris - par Creil - à Saint-Quentin. C’est un jour à marquer d’une pier-<br />
re blanche, pour la ville et la Société académique. Le Prince-Prési<strong>de</strong>nt Louis<br />
Napoléon Bonaparte, en personne, vient en notre ville inaugurer la gare et la<br />
ligne. Le docteur Bourbier, maire, et son conseil municipal, ont tenu à associer la<br />
Société académique et son prési<strong>de</strong>nt, Jean Héré, à la réception préparée pour le<br />
chef <strong>de</strong> 1’Etat. Le Prince-Prési<strong>de</strong>nt arrive à cinq heures et <strong>de</strong>mie au palais <strong>de</strong> jus-<br />
tice, dans l’ancienne abbaye <strong>de</strong> Fervaques, accompagné <strong>de</strong> quatre ministres et <strong>de</strong><br />
nombreuses personnalités. C’est Jean Héré, entouré <strong>de</strong> Charles Goniart et <strong>de</strong>s<br />
membres du bureau <strong>de</strong> la Société académique, qui le reqoit au bas du perron <strong>de</strong><br />
la salle <strong>de</strong>s Pas-Perdus.<br />
On lui présente successivement trois expositions : dans la cour, sous une<br />
tente, les productions horticoles, puis, dans les galeries du premier étage, les pro-<br />
ductions industrielles, enfin, une galerie d’art où figurent les pastels <strong>de</strong> Delatour.<br />
Elles attirent toutes les trois le plus vif intérêt du prési<strong>de</strong>nt. Celui-ci fait ensuite<br />
son entrée dans la gran<strong>de</strong> salle <strong>de</strong>s cérémonies, où se trouvent réunis la plupart<br />
<strong>de</strong>s membres rési<strong>de</strong>nts et correspondants <strong>de</strong> la Société académique, au nombre<br />
d’environ 400, les lauréats <strong>de</strong> l’agriculture, <strong>de</strong> l’industrie, <strong>de</strong> l’horticulture et <strong>de</strong><br />
nombreuses notabilités <strong>de</strong> la région, soit une assemblée composée au total d’en-<br />
viron 900 personnes. Accueilli par les plus vives acclamations, le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la<br />
République va se placer sur l’estra<strong>de</strong>, au milieu <strong>de</strong>s personnes <strong>de</strong> sa suite et <strong>de</strong>s<br />
membres du bureau <strong>de</strong> la Société académique.<br />
Le chef <strong>de</strong> I’Etat est venu là surtout pour prési<strong>de</strong>r la remise <strong>de</strong>s récompenses.<br />
Jean Héré présente avec ces mots :
jusqu’à celui qui dirige la ferme ou l’atelier, ou conclut les transactions. Vous-<br />
même, Monsieur le Prési<strong>de</strong>nt, vous, le Chef du Gouvernement, n’êtes-vous pas le<br />
premier <strong>de</strong>s travailleurs et celui dont la tlche est la plus difficile ? >><br />
(< Je suis heureux <strong>de</strong> me trouver parmi vous, répond le chef <strong>de</strong> 1’Etat. Car,<br />
voyez-vous, mes amis les plus sincères et les plus dévoués ne sont pas dans les<br />
palais. Ils sont sous le chaume ; ils ne sont pas sous les lambris dorés, ils sont dans<br />
les ateliers, sur les places publiques, dans les campagnes ... >) Henri Souplet pré-<br />
sente le palmarès <strong>de</strong> l’exposition industrielle, Charles Gomart celui <strong>de</strong> l’agricul-<br />
ture et Louis-Napoléon tient à remettre <strong>de</strong> sa main les prix et les récompenses.<br />
On lui présente plus spécialement Jean-Baptiste Pruvost, dit >, charretier <strong>de</strong>puis 58 ans à Aubencheul-au-Bois, dans la même famille. En<br />
1830, la ferme fut presque entièrement détruite par un incendie. Pruvost voulut<br />
venir en ai<strong>de</strong> à Madame veuve Lefranc, > Le jury <strong>de</strong> moralité avait offert, par acclamation, une médaille d’or,<br />
hors ligne, au brave homme. Le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la République la lui remet avec ces<br />
mots : (< Je suis heureux <strong>de</strong> remettre 2 cet excellent serviteur le prix décerné par<br />
la Société académique. Mais c’est trop peu pour une si belle action. Je lui accor-<br />
<strong>de</strong> la décoration <strong>de</strong> la Légion d’honneur >>. Faisant alors asseoir près <strong>de</strong> lui le<br />
vénérable vieillard, le prési<strong>de</strong>nt attache lui-même sur sa blouse l’étoile d’hon-<br />
neur. Des acclamations prolongées saluent son geste. Le chroniqueur ajoute naï-<br />
vement : (( Ce moment a du être pour le Prési<strong>de</strong>nt le plus beau <strong>de</strong> ceux qu’il a pas-<br />
sés dans notre cité ! >> I1 décerne aussi une médaille d’honneur <strong>de</strong> la Société aca-<br />
démique à l’infirmière Marie-Catherine Lefèvre qui a passé sa vie à I’HCitel-Dieu,<br />
notainment pendant I’épidémie <strong>de</strong> choléra, avec le plus grand dévouement.<br />
Avant son départ, le prési<strong>de</strong>nt remet au maire une somme <strong>de</strong> 3 O00 francs<br />
que la Société académique est chargée <strong>de</strong> répartir parmi les agents primés <strong>de</strong><br />
l’agriculture et <strong>de</strong> l’industrie. Lors <strong>de</strong> la réunion suivante, le 7 juillet 1850, le pré-<br />
si<strong>de</strong>nt Héré assure, avec ses collègues, la répartition équitable <strong>de</strong> cette somme. I1<br />
rappelle que, treize ans auparavant, la Société académique a innové en décernant<br />
<strong>de</strong>s récompenses aux agents <strong>de</strong> l’agriculture et que cette année, pour la première<br />
fois, la même pratique est appliquée aux agents <strong>de</strong> l’industrie I‘.<br />
Le 28 mai 1852, Jean Héré fait sa (< lecture >>, comme on dit alors iì la<br />
Société. Celle-ci a pour titre :
En septembre <strong>de</strong> la même année, Jean Héré, en présidant le concours agri-<br />
cole, fdicite les auteurs d’innovations.
qu’h traverser cette place, la rue <strong>de</strong> l’Officia1 et la rue <strong>de</strong> Morlaincourt - aujour-<br />
d’hui <strong>de</strong> Vesoul.<br />
Charles Daudville nous a brossé son portait :
Bernard Ancien,<br />
soixante ans <strong>de</strong> recherches<br />
Plus d’une décennie après sa mort, Bernard Ancien ‘ bénéficie toujours<br />
dans le Soissonnais d’une gran<strong>de</strong> notoriété. Les cultivateurs, les propriétaires se<br />
souviennent encore <strong>de</strong> ses visites, seul ou à la tête d’un groupe <strong>de</strong> passionnés.<br />
Certains rapportent, <strong>de</strong> façon plus ou moins déformée, tel détail <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong><br />
la propriété ou telle particularité <strong>de</strong> la construction. D’autres dévoilent comme<br />
<strong>de</strong>s reliques les notes manuscrites laissées lors <strong>de</strong> son passage. Ceux qui l’ont<br />
connu s’étonnent encore <strong>de</strong> la profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> ses connaissances. Chaque village<br />
traversé, chaque ferme visitée, chaque calvaire admiré suscitait <strong>de</strong> sa part d’inta-<br />
rissables commentaires, anecdotes, légen<strong>de</strong>s. Ses familiers se souviennent <strong>de</strong> ses<br />
talents d’artiste qui lui permettaient, en quelques coups <strong>de</strong> crayon, <strong>de</strong> croquer un<br />
monument sur un minuscule carré <strong>de</strong> papier pour le remettre ensuite au net. Enfin,<br />
peu <strong>de</strong> gens savent qu’il était aussi musicien et que, pendant <strong>de</strong>s années, il a joué<br />
<strong>de</strong> la clarinette dans un orchestre.<br />
Ses publications sont relativement mo<strong>de</strong>stes. 11 y a bien une quarantaine<br />
d’articles publiés dans les Billletins <strong>de</strong> lu Société arcliéoologique, historique et<br />
scieritijìyue <strong>de</strong> Soissons ’ et les Mémoires <strong>de</strong> In Fédércrtion <strong>de</strong>s Sociétks histo-<br />
riques et archéologiques <strong>de</strong> l’Aime ’, mais près d’un tiers ne dépasse pas cinq<br />
pages et seulement six quinze pages. Une seule étu<strong>de</strong> approfondie a été publiée,<br />
grlce d’ailleurs à la pression amicale qu’a su exercer sur lui Geneviève<br />
Cordonnier, > 4. En revanche, toutes ses publications ont<br />
porté sur <strong>de</strong>s sujets inédits et témoignent <strong>de</strong> recherches personnelles approfon-<br />
dies. C’est probablement pour cette raison que Bernard Ancien est souvent consi-<br />
déré comme une référence en soi. Pourtant, comme tous les précurseurs, il a pu<br />
commettre <strong>de</strong>s erreurs ou <strong>de</strong>s omissions.<br />
Les conférences données à la Société historique <strong>de</strong> Soissons ou les visites<br />
<strong>de</strong> monuments représentent environ <strong>de</strong>ux cents sujets traités. La première inter-<br />
vention <strong>de</strong> Bernard Ancien semble être sa conférence sur les armoiries <strong>de</strong>s<br />
I, Bernard Ancien, né à Soissons le 4 inai 1906, décè<strong>de</strong> dans cette ville le 3 février 1987. Entré h la<br />
Société historique <strong>de</strong> Soissons en 1938, il en était <strong>de</strong>venu secrétaire gCnCral en 1949 puis prksi<strong>de</strong>nt<br />
en 1962.<br />
2. Tables alphabtciques <strong>de</strong>s Bul1erin.s cle la Socic;iP urchc;ologique, historique et scicritljìqur tle<br />
Soi.ssoi?.T, 3? et 4 séries, 189 1 - 1998.<br />
3. Table <strong>de</strong>s Bdletins <strong>de</strong> la Fédércifion <strong>de</strong>s SociCt6.s hisrnriqrres et archéulogiques <strong>de</strong> l’Aisne, 1988,<br />
t. 33, p. 49.<br />
4. Bernard Ancien, >, RuII. <strong>de</strong> /(I SociPté hist., circh. et scie17r. <strong>de</strong> Soi.s.ror~.s,<br />
t. 16, 4 +rie, 1977-79, p. 33 à 154.
26 Du1i.v Rolland<br />
évêques <strong>de</strong> Soissons, le 4 mai 1939. Le rythme <strong>de</strong>s conférences ou visites est peu<br />
élevé jusqu’aux années soixante puis <strong>de</strong>vient très important dans les années<br />
soixante-dix. La variété <strong>de</strong>s thèmes abordés rend compte <strong>de</strong> la diversité <strong>de</strong>s<br />
recherches entreprises par Bernard Ancien et <strong>de</strong> la documentation qu’il a réunie.<br />
Toutes ses conférences et visites mettaient en ve<strong>de</strong>tte <strong>de</strong>s villages ou <strong>de</strong>s person-<br />
nages du Soissonnais.<br />
On peut regretter que ces travaux n’aient pas fait l’objet <strong>de</strong> publications<br />
plus nombreuses et surtout plus développées. Pour quelle raison ? Dans un texte<br />
écrit à la troisième personne et <strong>de</strong>stiné à être lu après sa mort, Bernard Ancien en<br />
a donné une explication désabusée : (< A peine les Cléments pour la rédaction d’un<br />
sujet étaient-ils réunis, qu’il s’était déjà lancé sur un autre sujet qui finalement<br />
<strong>de</strong>vait connaître le même dénouement (travaux trop vastes, trop éparpillés, trop<br />
diversifiés) ’. D C’est probablement vrai mais, pour ma part, je pense aussi que,<br />
trop mo<strong>de</strong>ste et trop perfectionniste, il considirait que ses étu<strong>de</strong>s n’étaient pas<br />
suffisamment fouillées pour mériter d’être publiées. II reste que, plusieurs fois<br />
travaillées et complétées durant <strong>de</strong>s décennies, elles constituent une incompa-<br />
rable documentation régionale.<br />
Avant <strong>de</strong> passer en revue ce qui subsiste <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> soixante années <strong>de</strong><br />
recherches consacrées à l’histoire et au patrimoine <strong>de</strong> notre région, il me semble<br />
utile <strong>de</strong> donner une appréciation - toute personnelle il est vrai - <strong>de</strong>s recherches<br />
entreprises par Bernard Ancien en distinguant les diflérents domaines où s’est<br />
porté son intérêt.<br />
L’o rchéolog ie<br />
Pour l’époque antique, Bernard Ancien a réalisé surtout un travail d’in-<br />
ventaire en relevant systématiquement tout ce qui était trouvé dans les fouilles<br />
effectuées à Soissons.<br />
L’histoire<br />
Bernard Ancien a essentiellement travaillé sur les archives <strong>locale</strong>s. 11 n’a<br />
pas ou peu consulté les archives extérieures au département. Limitées aux sources<br />
imprimées, donc <strong>de</strong> secon<strong>de</strong> main, ses recherches couvrant la pério<strong>de</strong> du Moyen<br />
Âge sont <strong>de</strong> ce fait d’un intérêt relativement secondaire. En fait, il s’agit davan-<br />
tage <strong>de</strong> synthèses rigoureuses et exhaustives d’étu<strong>de</strong>s ayant déjà paru que <strong>de</strong><br />
recherches inédites.<br />
Pour ce qui est <strong>de</strong>s autres sikcles, ses travaux prkscntent un intérêt certain<br />
car Bernard Ancien a exploité au maximum les minutes notariales en les croisant<br />
avec toutes les autres sources qu’il a pu avoir B sa disposition.<br />
5. Geneviève Cordonnier. Hommage i ßcrnard Ancicn k), Bull. <strong>de</strong> /o SocicjrP hLt., orch. et .scirnt.<br />
<strong>de</strong> Soi,s.ton.s, t. 18, 4 séric, 1985-88, p. XXI.
Bemard Ancien (dans IQ smit6 atchiologique, historique er scientifique <strong>de</strong> Sobom. d l’origine du Mus6e.<br />
1847-1997, Soissons, 1997. CI. J.-L. Gimni)<br />
La généalogie<br />
C’est peut-être la partie la plus importante du travail <strong>de</strong> Bernard Ancien.<br />
Elle est d’une gran<strong>de</strong> fiabilité pour ce qui concerne la mise en évi<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s rela-<br />
tions entre les familles<br />
Peu <strong>de</strong> temps avant sa mort, Bernard Ancien avait envisagé la cession <strong>de</strong><br />
l’ensemble <strong>de</strong> ses archives et collections h la municipalité <strong>de</strong> Soissons, à charge<br />
pour celle-ci <strong>de</strong> créer un poste d’archiviste afin d’en faire l’inventaire et d’en<br />
contrôler l’accès. Elles auraient ainsi constitué un fonds complémentaire à celui<br />
<strong>de</strong> Charles Périn, autre prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Société historique, qui avait cédé ses<br />
archives à la ville en 1882 6. Le poste d’archiviste fut créé mais, à la suite d’une<br />
maladresse <strong>de</strong> la municipalité, Bernard Ancien ne régularisa pas le legs prévu. A<br />
sa mort, en accord avec la famille, Geneviève Cordonnier, alors prési<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la<br />
Société historique <strong>de</strong> Soissons, fut chargée d’organiser la cession <strong>de</strong>s archives<br />
conformément aux souhaits du défunt formulés au cours d’une réunion h la mai-<br />
rie <strong>de</strong> Soissons ?. C’est dans ce contexte que les archives, la bibliothque et les<br />
6. Denis Defente, (< La Sociéte historique >>, La Société archéologique, historique ef scientifique <strong>de</strong><br />
Soissons d l’origine du musée, 1847-1997, p. 19.<br />
7. C‘est au cours <strong>de</strong> la réunion du 23 janvier 1986 qui avait pour objet la création d‘un fonds Bemard<br />
Ancien que celui ci avait exposé ses souhaits.<br />
27
28 Drriis Rollmtl<br />
collections <strong>de</strong> Bernard Ancien échurent aux Archives municipales, aux Archives<br />
départementales <strong>de</strong> l’Aisne, au musée <strong>de</strong> Soissons et à la société historique <strong>de</strong><br />
Soissons, tandis que M. Ancien tils conservait une partie <strong>de</strong> la bibliothèque et <strong>de</strong>s<br />
collections archéologiques.<br />
Face à une masse considérable d’archives, <strong>de</strong> livres et d’objets, et en l’ab-<br />
sence d’inventaire, il ne peut être question ici d’en donner une <strong>de</strong>scription<br />
exhaustive. Je me limiterai donc à en livrer un aperçu qui, accompagné <strong>de</strong> coin-<br />
mentaires, n’a d’autre but que <strong>de</strong> faire mieux connaître l’importance <strong>de</strong>s<br />
recherches entreprises par Bernard Ancien et ce qu’il en reste aujourd’hui.<br />
Les Archives municipales <strong>de</strong> Soissons<br />
L‘essentiel <strong>de</strong>s dossiers <strong>de</strong> recherche <strong>de</strong> Bernard Ancien et une partie <strong>de</strong> sa<br />
bibliothèque ont été déposés aux Archives municipales <strong>de</strong> Soissons. En fait, faute<br />
<strong>de</strong> place disponible à la mairie, ces archives ont été entreposées dans les locaux<br />
<strong>de</strong> la Bibliothèque municipale, mais elles sont gérées par l’archiviste municipal.<br />
Un inventaire a été établi au fur et à mesure <strong>de</strong>s dépôts qui se sont étalés sur<br />
quatre années. I1 s’agit plus d’une liste détaillée que d’un véritable instrument <strong>de</strong><br />
recherche : il n’y a ni table alphabétique, ni classement thématique.<br />
Tous ces dossiers comportaient <strong>de</strong> nombreux <strong>de</strong>ssins, souvent en couleur.<br />
Lors du dépôt <strong>de</strong>s archives, le fils <strong>de</strong> Bernard Ancien a souhaité les conserver. Ils<br />
ont donc été retirés <strong>de</strong>s dossiers, ce qui leur ôte un peu d’attrait. Tous ces <strong>de</strong>ssins,<br />
<strong>de</strong> même que les notes ou articles, étaient faits au dos <strong>de</strong> prospectus ou imprimés<br />
divers et même, quelquefois, d’emballages <strong>de</strong> paquets <strong>de</strong> tabac ou d’étiquettes <strong>de</strong><br />
bouteilles <strong>de</strong> vin ! Jamais Bernard Ancien n’a utilisé <strong>de</strong> feuilles vicrges et son<br />
principal pourvoyeur <strong>de</strong> papier fut tout naturelleinent son employeur, la Société<br />
Générale.<br />
Les livres et dossiers correspon<strong>de</strong>nt aux thkmes <strong>de</strong> recherche chers à<br />
Bernard Ancien : archéologie, architectures médiévale, rurale, classique, généa-<br />
logie <strong>de</strong>s familles <strong>de</strong> fermiers seigneurs ou notables, héraldique, légen<strong>de</strong>s, cou-<br />
tumes, etc. I1 faut noter aussi l’intérêt que portait Bernard Ancien aux femmes <strong>de</strong><br />
l‘Histoire, au sujet <strong>de</strong>squelles il avait réuni <strong>de</strong> nombreux livres, notices ou étu<strong>de</strong>s.<br />
Du fait <strong>de</strong> l’absence <strong>de</strong> véritable inventaire, les recherches dans ce fonds<br />
ne sont pas simples. Des notes concernant un même sujet peuvent se trouver dans<br />
plusieurs dossiers. Cela tient au fait qu’une première étu<strong>de</strong>, sommaire, a été faite,<br />
puis une secon<strong>de</strong>, plus étoffée, ultérieurement complétée s. Les dossiers <strong>de</strong> vil-<br />
lages sont les plus nombreux. Ils comportent <strong>de</strong>s notes sur les monuments <strong>de</strong> la<br />
8. Les notes concernant la Thiérache. par exemple. doivent être recherchées p. 6 et 2.5 du dépBt <strong>de</strong><br />
1988. p. 6, 12, 16 et I7 du dépal <strong>de</strong> I99 I el dans le dossier 1990-32.
commune, <strong>de</strong>s généalogies <strong>de</strong> fermiers et <strong>de</strong> seigneurs, <strong>de</strong>s légen<strong>de</strong>s, etc. Des<br />
sujets généraux ont fait l’objet <strong>de</strong> dossiers ou recueils <strong>de</strong> notes particuliers : la<br />
fortification rurale, les cloches, l’agriculture soissonnaise, la maison soissonnai-<br />
se, le département <strong>de</strong> l’Aisne et le Canada, Victor Hugo et IC Soissonnais, les<br />
sociétés musicales soissonnaises, etc.<br />
Uintérêt du contenu et l’importance <strong>de</strong>s dossiers sont variables. Certains<br />
contiennent <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s entikrement rédigées, prêtes à être publiées ’. Mais, le plus<br />
souvent, ce sont <strong>de</strong>s notes manuscrites, <strong>de</strong>s croquis, <strong>de</strong>s calques <strong>de</strong> plans, <strong>de</strong>s<br />
coupures <strong>de</strong> presse, etc. Beaucoup comprennent <strong>de</strong>s copies <strong>de</strong> documents d’ar-<br />
chives <strong>locale</strong>s dont la provenance est généralement mentionnée.<br />
Certains villages ou fermes forment <strong>de</strong> volumineux dossiers : Berzy-le-<br />
Sec, Bucy-le-Long, Droizy, Hautefontaine, Mont-Notre-Dame, Mortefontaine,<br />
Plessis-aux-Bois, Septmonts, VeL, Vic-sur-Aisne, Vierzy, etc. Beaucoup d’autres<br />
font l’objet <strong>de</strong> nombreuses feuilles <strong>de</strong> notes, tandis que certains ne sont traités<br />
qu’en quelques feuillets. La plupart <strong>de</strong>s villages du Soissonnais, du Valois, du<br />
Tar<strong>de</strong>nois et du sud du Laonnois figurent dans ces archives.<br />
La contribution <strong>de</strong> Bernard Ancien consacrée à Soissons même est évi-<br />
<strong>de</strong>mment très importante. On trouve <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s ou notices archéologiques et his-<br />
toriques sur les gran<strong>de</strong>s abbayes <strong>de</strong> la ville (Saint-Jean-<strong>de</strong>s-Vignes, Saint-<br />
Médard, Saint-Crépin, etc.), sur ses principaux quartiers, ses rues, ses nionu-<br />
ments, ses ponts, au sujet <strong>de</strong> la navigation sur l’Aisne, etc. Des notices archéolo-<br />
giques manuscrites concernent différentes fouilles ou trouvailles fortuites faites à<br />
soissons.<br />
De nombreuses coupures <strong>de</strong> presse sont conservées sous forme <strong>de</strong> cahiers<br />
ou dans <strong>de</strong>s chemises. Les sujets sont divers : le cardinal Binet, la bibliothèque et<br />
le musée, les combats et les monuments <strong>de</strong> la guerre <strong>de</strong> 14- 18.<br />
Les notables du Soissonnais ont souvent hit l’objet <strong>de</strong> dossiers, cahiers <strong>de</strong><br />
notes complétés d’articles <strong>de</strong> journaux : les évêques, les comtes <strong>de</strong> Soissons, la<br />
famille Fossé d’ Arcosse, Fernand Marquigny, Saint-Just, les sous-préfets, Raoul<br />
<strong>de</strong> Bourgogne, le général Bonnaire, etc. Les femmes célèbres ne sont pas oubliées<br />
avec <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s telles que le Soissonnais féminin, Marie Cappel, etc.<br />
I1 faut signaler un dossier <strong>de</strong> tracts et d’affiches <strong>de</strong> propagan<strong>de</strong> alleman<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> la <strong>de</strong>uxième guerre mondiale. Un carton contient une série <strong>de</strong> plans : servitu-<br />
<strong>de</strong> du Génie, (1822), reconstruction du quartier Saint-Vaast, etc.<br />
La bibliothèque<br />
Les 1500 livres et brochures environ qui ont été déposés aux Archives<br />
municipales ne constituent qu’une partie <strong>de</strong> la bibliothèque <strong>de</strong> Bernard Ancien<br />
qui, à l’origine, représentait I 01,30 mètres linéaires (l’autre partie ayant été<br />
9. C’est ainsi que nous avonb ptiblit une écii<strong>de</strong> sur les leriniers <strong>de</strong> Mortclontaine dans nos<br />
e MCinoires du Soissonnais D (Hu//. dc /ti Soc,ic;tP /ii.s1., arch. et sciewr. <strong>de</strong> Soissons, 5‘ série, t. I,<br />
p. 27-3 1 ).
conservée par la famille). I1 s’agit essentiellement <strong>de</strong> livres, fascicules et gui<strong>de</strong>s<br />
touristiques. Les principaux châteaux, abbayes, villes et régions <strong>de</strong> France sont<br />
représentés. L‘histoire <strong>de</strong> France à toutes les époques, avec <strong>de</strong>s ouvrages géné-<br />
raux ou traitant <strong>de</strong> sujets particuliers, y tient une gran<strong>de</strong> place, <strong>de</strong> même que les<br />
femmes célèbres, à travers <strong>de</strong>s ouvrages tels que Fcivorites royales, Les Grcin<strong>de</strong>s<br />
Amoureuses, Gabrielle d ‘Estrkes, Mine du Barry Melle <strong>de</strong> LA KilliPre, Milie <strong>de</strong><br />
LCI Fuyette, Mme Récarnier, etc., auxquels s’ajoutent une dizaine <strong>de</strong> livres consa-<br />
crés à Mme Tallien et une trentaine à Jeanne d’Arc.<br />
Quelques livres régionaux semblent isolés dans cette partie <strong>de</strong> la biblio-<br />
thèque <strong>de</strong> Bernard Ancien consacrée à l’histoire et à l’architecture françaises,<br />
parmi lesquels Saiwt-Pierre-Aigle, Couvrelles et le v d <strong>de</strong> Morsain <strong>de</strong> Maxime <strong>de</strong><br />
Sars, un volume <strong>de</strong>s Voyages en France <strong>de</strong> Ardouin Dumazet, plusieurs mono-<br />
graphies <strong>de</strong> Longpont, un bulletin du centenaire <strong>de</strong> la société académique <strong>de</strong><br />
Saint-Quentin, etc. On note aussi la présence d’une liasse <strong>de</strong> L’Argus du<br />
Soissonrrciìs ( 1852-60) et d’une série <strong>de</strong> Bidletins clr lu Société arcliéologiqiie <strong>de</strong><br />
Creil. Bernard Ancien avait aussi conservé, <strong>de</strong>puis 1940, la totalité <strong>de</strong>s journaux<br />
locaux ; ils ont été remis à la bibliothèque <strong>de</strong> Soissons.<br />
Les Archives départementales <strong>de</strong> l’Aisne<br />
Bernard Ancien avait recueilli <strong>de</strong>s fragments importants (7 mètres<br />
linéaires) <strong>de</strong>s minutes notariales <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s Bureau (1578-1 822) et Dulong ( 1 601-<br />
1687) <strong>de</strong> Soissons. Ils furent remis aux Archives départementales <strong>de</strong> l’Aisne afin<br />
<strong>de</strong> réintégrer les minutiers dont ils provenaient et que les notaires concernés<br />
venaient <strong>de</strong> déposer. I1 faut y ajouter 1,5 mètres d’archives notariales diverses,<br />
provenant <strong>de</strong> recherches personnelles qui n’ont pas été encore inventoriées, ainsi<br />
qu’une étu<strong>de</strong> concernant la famille Charié aux XVII‘, XVIII’ et XIX‘ siècles et<br />
<strong>de</strong>ux volumes reliés <strong>de</strong> L’Argus clLi Soissonnais, correspondant à l’année 19 12,<br />
qui ont comblé une lacune <strong>de</strong> la collection que possédait les Archives départe-<br />
mentales.<br />
Le musée <strong>de</strong> Soissons<br />
Bien que n’étant pas archiologue, Bernard Ancien avait recueilli une gran-<br />
<strong>de</strong> quantité d’objets provenant <strong>de</strong> fouilles ou <strong>de</strong> découvertes fortuites dans le<br />
Soissonnais. Une partie <strong>de</strong> ces objets a été confiée au inusée <strong>de</strong> Soissons en <strong>de</strong>ux<br />
dépôts effectués en 1990 et 1992.<br />
Le premier portait sur 5.3 objets divers : une amphore, <strong>de</strong>s bijoux gaulois,<br />
une urne funéraire, une francisque, <strong>de</strong>s pavés médiévaux, etc. Figuraient égale-<br />
ment une plaque-boucle <strong>de</strong> ceinturon mérovingien et une plaque du sarcophage<br />
<strong>de</strong> saint Voué I”. A cette occasion furent restitués au musée une dimine d’objets
Br riici rcl A I I c.ic)ri 31<br />
provenant <strong>de</strong> ses collections et qui avaient disparu <strong>de</strong>puis la première guerre<br />
mondiale (vases gaulois et gallo-romains, un objet égyptien, etc.)<br />
Le second dép6t portait sur 199 objets divers, parini lesquels <strong>de</strong>s monnaies<br />
romaines, <strong>de</strong>s pavés émaillés, <strong>de</strong>s poteries gauloises provenant <strong>de</strong> la nécropole <strong>de</strong><br />
Pernant, <strong>de</strong>s pierres taillées, dcs vasa et céramiques gallo-romains, etc. Un<br />
tableau <strong>de</strong> V. Salingre, peintre soissonnais, représentant l’abbaye <strong>de</strong> Saint-Jean-<br />
<strong>de</strong>s-Vignes et l’ancien couvent <strong>de</strong>s Capucins en 1906, fut aussi remis au musée.<br />
Des Cléments <strong>de</strong> pavage provenant du chlteau <strong>de</strong> Fère-en-Tar<strong>de</strong>nois et qui figu-<br />
raient dans les collections du musée furent également restitués à cette occasion I’.<br />
La société historique <strong>de</strong> Soissons<br />
Les notices <strong>de</strong> villages<br />
Les textes <strong>de</strong>s conférences et les notes <strong>de</strong> visite <strong>de</strong> Bernard Ancien n’ont<br />
pas tous été conservés Les premières conférences ont été généralement<br />
publiées dans les Bir1letiri.s <strong>de</strong> lu SociPtP historique <strong>de</strong> Soissons. D’autres sont res-<br />
tées dans les dossiers <strong>de</strong> villages mais une partie a été déposée à la Société histo-<br />
rique <strong>de</strong> Soissons par Geneviève Cordonnier qui avait pris soin <strong>de</strong> les rassembler<br />
au fur et à mesure. Cela représente <strong>de</strong>ux gros classeurs dans lesquels les notes<br />
sont rangées par ordre alphabétique <strong>de</strong>s lieux auxquels elles se rapportent. Ces<br />
documents concernent les conférences et visites <strong>de</strong>s années soixante-dix et<br />
quatre-vingt. Très souvent, les textes comportent <strong>de</strong>s références et notes <strong>de</strong> bas <strong>de</strong><br />
page qui permettraient <strong>de</strong> les publier sans modification. Certaines notices <strong>de</strong> vil-<br />
lages sont accompagnées <strong>de</strong> plans, calques, copies <strong>de</strong> pièces d’archives, etc.<br />
Parmi les étu<strong>de</strong>s les plus remarquables, signalons Courtieux ; les seigneurs <strong>de</strong> la<br />
Tour ; le moulin <strong>de</strong> Largny ; Septmonts ; le chliteau <strong>de</strong> Vez pendant la guerre <strong>de</strong><br />
Cent Ans ; Saint Louis et le Soissonnais ; le Soissonnais et les guerres <strong>de</strong> reli-<br />
gion ; le général Drouet d’Erlon ; Gérard <strong>de</strong> Nerval ; Thumery ; le blason <strong>de</strong>s trois<br />
pucelles ; une histoire <strong>de</strong> bouteille vi<strong>de</strong> ; la succession du duc d’Aumale, etc.<br />
Un troisième classeur rassemble 49 notices historiques <strong>de</strong> villages consti-<br />
tuées à partir <strong>de</strong> documents divers complétés <strong>de</strong> notes <strong>de</strong> Bernard Ancien. Elles<br />
lui avaient été données par une personne <strong>de</strong> Berzy-le-Sec dans les années cin-<br />
quante. Parmi elles, figurent 21 notices manuscrites, écrites en 1884-85 par <strong>de</strong>s<br />
instituteurs <strong>de</strong> l’Aisne, dont 10 sont <strong>de</strong>s originaux signés <strong>de</strong> la main <strong>de</strong> I’institu-<br />
teur et Il <strong>de</strong>s copies anciennes. Les autres notice3 <strong>de</strong> villages sont constituées<br />
d’extraits imprimés provenant du Dictionnuire <strong>de</strong> Melleville, <strong>de</strong> l’ouvrage <strong>de</strong><br />
I I. Denis Defente, (( Le musée <strong>de</strong> Soissons : bilans et perspectives D, MPiiioires (/II Soi.\.soniicri.s, Bit//.<br />
(/e /ti SociPfc; /iist., arch. el .rcient. <strong>de</strong> Soi.\.wiis, t. I, 5‘ série, 1993- 1998. p. 1 17.<br />
12. Pa<strong>de</strong>lle Billet, M Inventaire <strong>de</strong>s communications et exposés fait en SociCtC historique <strong>de</strong> Soiwms<br />
par Bernard Ancien D, Bdl. cle Itr Soc.ic?P kisr., urch. et scieiit. c/c so is son.^, 4 série, t. 18, 1985- 1988,
32 Divis Rollund<br />
Moreau-Nélaton, Les Eglises <strong>de</strong> chez nous, ou <strong>de</strong> Bulletins <strong>de</strong> LLI Société lzìsto-<br />
rique <strong>de</strong> Soissons. A noter que la notice sur Logny-les-Aubenton comporte <strong>de</strong>ux<br />
<strong>de</strong>ssins originaux d’Amédée Piette ; celle sur Oulchy-le-Château, un plan <strong>de</strong> la<br />
ville daté <strong>de</strong> 18 12 ; celle sur Attichy, une <strong>de</strong>scription archéologique <strong>de</strong> I’église <strong>de</strong><br />
la main <strong>de</strong> A. Robert.<br />
Les doss ìers g kr i ka log iqu es<br />
Les étu<strong>de</strong>s généalogiques <strong>de</strong> Bernard Ancien ont été déposées à la Société<br />
historique <strong>de</strong> Soissons afin d’en limiter l’accès. Elles concernent à peu près toutes<br />
les familles seigneuriales du Soissonnais (Noue, Flavy, Dupleix, Brion, Louvain,<br />
Estrées, Miremont, Roucy, Lignière, La Personne, etc.), <strong>de</strong>s familles <strong>de</strong> fermiers<br />
(Danré, Desboves, Ferté, Flobert, Lemoine, Leroux, Tassart, etc.), <strong>de</strong>s familles <strong>de</strong><br />
notaires (Decamp, Desèvre, Lamy, Moreau, Rigaux, etc.), <strong>de</strong>s généraux<br />
(Charpentier, Ronsin), <strong>de</strong>s grands bourgeois (Morand, Quinquet, Quinette, etc.)<br />
ou même <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s familles du royaume (Bernis, Genlis, Joinville, La Hire<br />
Mayenne, Rothe, etc.). Quelques dossiers se réfèrent directement à <strong>de</strong>s lieux (sei-<br />
gneurs <strong>de</strong> Bitry, d’Emeville, fermiers <strong>de</strong> Coiifrécourt, etc.). Certains ont été<br />
constitués à partir <strong>de</strong> recherches systématiques (Louvain, Estrées, etc.). La plu-<br />
part regroupe <strong>de</strong>s informations provenant <strong>de</strong> recherches sur les villages ou autres<br />
sujets plus généraux. L‘intérêt <strong>de</strong> ces généalogies rési<strong>de</strong> dans le fait que Bernard<br />
Ancien a toujours cherché iì croiser <strong>de</strong>s informations <strong>de</strong> provenances diverses et<br />
ne s’est pas contenté <strong>de</strong> dresser <strong>de</strong>s listes d’ascendance : il a recherché systéma-<br />
tiquement les liens entre les familles, leurs relations avec les gran<strong>de</strong>s propriétés<br />
et les inscriptions qui pouvaient figurer dans les églises. Les armoiries <strong>de</strong>s<br />
familles nobles ont aussi été recherchées et étudiées, celles figurant sur les monu-<br />
ments ont été interprétées.<br />
Chez le fils <strong>de</strong> Bernard Ancien<br />
Les archives et objets conservés par M. Ancien n’ont pas fait l’objet d’un<br />
inventaire. Par suite <strong>de</strong>s travaux effectués dans la maison, ils ne sont que som-<br />
mairement classés, ce qui n’en a pas facilité l’analyse.<br />
Bihlioth Pqiie<br />
M. Ancien a conservé plusieurs centaines <strong>de</strong> livres formant une partie <strong>de</strong><br />
la bibliothèque <strong>de</strong> son père (l’autre a été remise aux Archives municipales). Elle<br />
comprend les colleclions <strong>de</strong>s Bulletins <strong>de</strong> la Socidté historique <strong>de</strong> Sois.vons et <strong>de</strong>s<br />
Bulletins <strong>de</strong> la Fécldrution <strong>de</strong>s Sociktks historiques <strong>de</strong> l’Aisne, les ouvrages régio-<br />
naux, ceux concernant les premier et second conflits mondiaux et quelques<br />
ouvrages généraux.<br />
Parmi les ouvrages régionaux on trouve quelques grands classiques : Les<br />
Anna/e.v du dioc2se <strong>de</strong> Soissons, les ditfLrentes histoires <strong>de</strong> Soissons (Dorniay,
Leroux, Martin), La Conzniurze <strong>de</strong> Soissons, Le Murtyre <strong>de</strong> Soissoizs, etc., mais<br />
aussi <strong>de</strong> nombreuses monographies <strong>de</strong> villages, notamment celles <strong>de</strong> Maxime <strong>de</strong><br />
Sars, ainsi que quelques exemplaires <strong>de</strong> I’AIniuriucl~ Matot-Bmine <strong>de</strong>s années<br />
vingt et Serzlis ic travers les &es. Certains <strong>de</strong> ces livres sont <strong>de</strong> véritables dossiers<br />
car ils sont complétés <strong>de</strong> nombreuses notes, coupures <strong>de</strong> presse, etc. C’est le cas<br />
par exemple <strong>de</strong> la monographie du 67e RI.<br />
Les livres portant sur le premier conflit mondial comportent <strong>de</strong>s romans<br />
(Les Croix <strong>de</strong> bois, Le Cuharet <strong>de</strong> In belle jenime, etc.) et <strong>de</strong>s magazines :<br />
L’Illustration, La Guerre documentée. Les livres traitant <strong>de</strong> sujets généraux sont<br />
assez peu nombreux. Parmi eux, se trouvent le Dictioririaire d’architecture <strong>de</strong><br />
Viollet-le-Duc, une série importante du Mcignsin pittoresque, Lu Fravzce illustrée,<br />
une histoire <strong>de</strong> France en cinq volumes du père G. Danier (1722), etc.<br />
Archives<br />
Quelques dossiers restent à ddposer aux Archives municipales (environ un<br />
mètre linéaire). I1 s’agit essentiellement <strong>de</strong> fragments d’étu<strong>de</strong>s qui avaient été<br />
retirés <strong>de</strong>s dossiers principaux par Bernard Ancien et qui, à sa mort, n’avaient pas<br />
réintégré leur place (archerie soissonnaise, Confi-écourt, Villers-Helon, Braine,<br />
adduction d’eau <strong>de</strong> Saint-Jean-<strong>de</strong>s-Vignes, etc.). Quelques liasses abîmées <strong>de</strong><br />
minutes <strong>de</strong> notaires restent également à remettre aux Archives départementales.<br />
Dessins<br />
Comme je l’ai dit, plusieurs centaines <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssins <strong>de</strong> Bernard Ancien ont été<br />
retirés <strong>de</strong>s dossiers déposés aux Archives municipales. I1 était prévu qu’ils soient<br />
remplacés par <strong>de</strong>s photocopies dès que le classement aurait eu lieu. Ces <strong>de</strong>ssins<br />
sont parfois les esquisses d’autres, plus élaborés, fails à la plume et souvent en<br />
couleur. Une cinquantaine <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ssins représentent différents monuments et<br />
rues <strong>de</strong> Soissons ainsi que <strong>de</strong>s églises, rerlnes et chriteaux <strong>de</strong>s environs. Beaucoup<br />
d’autres sont également conservés par M. Ancien, parmi lesquels les plombs <strong>de</strong><br />
la série a Légen<strong>de</strong>s du Soissonnais v ayant paru dans le journal L’Union en 1970-<br />
7 1, les originaux <strong>de</strong>s cartes postales <strong>de</strong>s journées du timbre <strong>de</strong>s années soixante,<br />
une série humoristique, etc.<br />
Cartes postules<br />
La collection comporte plusieurs milliers <strong>de</strong> cartes postales anciennes <strong>de</strong><br />
la ville <strong>de</strong> Soissons, <strong>de</strong>s environs et <strong>de</strong> différentes régions <strong>de</strong> France.<br />
Collection d’objets<br />
M. Ancien a conservé un échantillonnage important d’objets <strong>de</strong> la collec-<br />
tion réunie par son père : silex taillés, poteries gauloises et gallo-romaines, céra-<br />
miques romaines, objets mérovingiens, une hallebar<strong>de</strong> (venant <strong>de</strong> Cramaille), un
34<br />
crucifix en os, une importante collection <strong>de</strong> monnaies anciennes. La collection<br />
comprend aussi <strong>de</strong>s armes, casques et baïonnettes <strong>de</strong> la première guerre<br />
mondiale.<br />
Conclusion<br />
En définitive, ce n’est qu’au travers <strong>de</strong> ces difíérents dépôts que l’on peut<br />
mesurer aujourd’hui l’importance <strong>de</strong>s recherches entreprises par Bernard Ancien<br />
et <strong>de</strong> la documentation qu’il a réunie. Mais la dispersion <strong>de</strong> ses archives est très<br />
discutable d’un point <strong>de</strong> vue documentaire. I1 aurait sans doute été préférable que<br />
l’ensemble restit groupé et fût conservé en un même lieu. Ce dépôt aurait conser-<br />
vé toute sa cohérence car beaucoup d’étu<strong>de</strong>s se réfèrent à <strong>de</strong>s ouvrages répartis<br />
entre les Archives municipales et M. Ancien. Or ces ouvrages sont souvent<br />
accompagnés <strong>de</strong> nombreuses notes inscrites en marge ou sur <strong>de</strong>s feuillets inter-<br />
calaires. Quoi qu’il en soit, quelques échanges entre les dépôts <strong>de</strong>s Archives<br />
municipales et <strong>de</strong> la Société historique <strong>de</strong> Soissons seraient souhaitables. Ils per-<br />
mettraient <strong>de</strong> rectifier <strong>de</strong>s erreurs ou <strong>de</strong>s mélanges lors <strong>de</strong> la répartition entre les<br />
<strong>de</strong>ux dépôts.<br />
Ces différents fonds d’archives ou <strong>de</strong> livres pet-mettent <strong>de</strong> cerner l’apport<br />
<strong>de</strong> Bernard Ancien h l’histoire <strong>de</strong> notre région. Pour cela, je distinguerai les dif-<br />
férents domaines dans lesquels il a mené ses recherches.<br />
On peut dire que Bernard Ancien a rédigé <strong>de</strong>s notes d’observations archéo-<br />
logiques sur la totalité <strong>de</strong>s édifices anciens du Soissonnais : églises, ch;teaux,<br />
fermes, manoirs, moulins, etc. Ses observations sont la plupart du temps très judi-<br />
cieuses et précieuses pour l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> ces monuments. Toutefois, elles sont quel-<br />
quefois hypothéquées par le fait que leur auteur n’utilisait pas la photographie et<br />
ne se fiait qu’A sa mémoire et à ses croquis. Des détails lui ont donc parfois échap-<br />
pé et ses étu<strong>de</strong>s trouvent leurs limites dans les comparaisons entre édifices.<br />
Malgré cela, il savait détecter les infinis détails qui caractérisent une architecture<br />
et ses jugements <strong>de</strong> datation <strong>de</strong>s monuments étaient très sûrs.<br />
Pour ce qui concerne la pério<strong>de</strong> antique, Bernard Ancien s’est contenté <strong>de</strong><br />
constituer <strong>de</strong>s dossiers ou <strong>de</strong>s notices sur les découvertes archéologiques. Ils ont<br />
le mérite d’être détaillés et en grand nombre, présentant donc un vaste panorama<br />
<strong>de</strong>s trouvailles archéologiques dans notre région. Le plus important <strong>de</strong> ces dos-<br />
siers est évi<strong>de</strong>mment celui concernant la ville <strong>de</strong> Soissons.<br />
L‘histoire régionale du Moyen Age à nos jours a été l’un <strong>de</strong>s grands thèmes<br />
<strong>de</strong> recherche <strong>de</strong> Bernard Ancien. Mais il a été avant tout un chercheur régional<br />
qui, pour <strong>de</strong>s raisons matérielles liées h son époque, a centré ses travaux sur les<br />
sources disponibles <strong>locale</strong>ment. I1 n’a donc pas ou peu utilisé <strong>de</strong>s sources impor-<br />
tantes disponibles aux Archives nationales ou la Bibliothèque nationale. N’ayant<br />
pas une formation <strong>de</strong> médiéviste, il n’a pas travaillé sur les documents originaux<br />
du Moyen Age comme a pu le faire Carolus-Barré pour la région <strong>de</strong> Compiègne.<br />
De ce fait, ses étu<strong>de</strong>s couvrant cette époque sont <strong>de</strong>s synthèses <strong>de</strong> publications<br />
existantes.
I1 en est tout autrement pour l’histoire régionale <strong>de</strong>puis le XVI‘ siècle.<br />
L‘utilisation <strong>de</strong>s minutiers <strong>de</strong>s notaires et <strong>de</strong>s arpenteurs royaux, <strong>de</strong>s registres<br />
d’état civil, <strong>de</strong>s archives <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s abbayes a permis <strong>de</strong> constituer <strong>de</strong>s dossiers<br />
soli<strong>de</strong>s sur toutes sortes <strong>de</strong> sujets, à l’exemple <strong>de</strong> celui consacré au chsteau du<br />
Plessis-aux-Bois (Oise) qui est tout à fait complet.<br />
Mais c’est probablement en matière <strong>de</strong> généalogie que ses recherches ont<br />
ité les plus poussées, bien que ce soit aussi le domaine où ses travaux sont le<br />
moins connus. Pourtant, Bernard Ancien a constitué <strong>de</strong> nombreux dossiers <strong>de</strong><br />
familles qui sont d’une gran<strong>de</strong> richesse.<br />
Pour terminer j’exprimerai le souhait que les conditions <strong>de</strong> la cession <strong>de</strong>s<br />
archives <strong>de</strong> Bernard Ancien soient enfin respectées par la ville <strong>de</strong> Soissons. Celle-<br />
ci <strong>de</strong>vait en effet organiser le classement <strong>de</strong> ces archives et en permettre l’accès<br />
au public dans une salle spécialement aménagée.<br />
D’une vie consacrée à l’histoire el au patrimoine <strong>de</strong> notre région, il reste-<br />
rait alors une masse considérable <strong>de</strong> notes et documents qui, conservés aux<br />
Archives municipales et soigneusement inventoriés, constitueraient un outil <strong>de</strong><br />
premier ordre pour les chercheurs. Mais se poserait alors, avec plus d’acuité<br />
encore qu’aujourd’hui, le problème <strong>de</strong> leur protection intellectuelle. De nom-<br />
breuses investigations sont en effet prêtes à être publiées ou rédigées niais elles<br />
risqueraient alors d’être utilisées par <strong>de</strong>s chercheurs peu scrupuleux, sans qu’ils<br />
fassent référence à leur auteur.<br />
Denis ROLLAND
Saint-Marc Girardin,<br />
portrait d’un notable du XIX siècle<br />
La bibliothèque d’un académicien<br />
En 1945, un tombereau conduit par un paysan déposait à la Société archéo-<br />
logique, historique et scientifique <strong>de</strong> Soissons la biblioth2que <strong>de</strong> M. Saint-Marc<br />
Girardin, journaliste, littérateur, conseiller d’Etat, pédagogue, professeur d’uni-<br />
versité, député et académicien, décidé en 1873. I1 s’agissait <strong>de</strong> 4 O00 à 5 O00<br />
ouvrages, consacrés essentiellement B l’histoire ct à la littérature, mais également<br />
à la poésie, à la philosophie et à la géographie, parmi lesquels 800 environ en<br />
latin, 336 en italien, 177 en allemand, 170 en grec, 165 en anglais et une vingtai-<br />
ne en langues diverses, ainsi que trente-sept dossiers personnels organisés par<br />
sujets contenant brochures, articles, lettres, affiches etc.<br />
Ce don était le fait <strong>de</strong> M. André Cosset (1878-1956), vice-prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la<br />
Société historique <strong>de</strong> Soissons, et <strong>de</strong> sa feinnie Amélie (1880-1962), née Saint-<br />
Marc Girardin, petite-fille <strong>de</strong> l’érudit. Ces livres, jusque-là conservés dans la mai-<br />
son <strong>de</strong>s époux Cosset, située à Acy dans l’Aisne, constituent aujourd’hui encore<br />
la base <strong>de</strong> la documentation <strong>de</strong> notre Société historique.<br />
De nos jours, Saint-Marc Girardin est B peu près oublié. Les quelques<br />
écrits qui lui ont été consacrés datent tous <strong>de</strong> son époque et sont <strong>de</strong> plus très suc-<br />
cincts l. En essayant <strong>de</strong> le faire sortir <strong>de</strong> l’ombre, nous avons découvert une per-<br />
sonnalité très représentative <strong>de</strong> ces notables qui ont joué un rôle clé dans la vie<br />
publique <strong>de</strong> la France du XIX‘ sikcle.<br />
Ses premiers pas vers la célébrité<br />
Le 21 février 1801, 2 Paris, Mine Thérèse-Julie Reverard, épouse<br />
d’ Antoine-Barthélémy Girardin, un marchand <strong>de</strong> draps prospère, niellait au<br />
mon<strong>de</strong> un petit garçon qui sera prénommé François, Auguste, Marc. Inutile <strong>de</strong> le<br />
chercher dans les dictionnaires : il y íigure sous le nom <strong>de</strong>
38 Jirlien Strpori<br />
Girardin >> car, une fois adulte, il se canonisera >> en transformant son nom<br />
patronymique, qu’il considérait certainement comme trop commun >.<br />
La famille Girardin représentait un échantillon parfait <strong>de</strong> cette bourgeoisie<br />
parisienne qui, après avoir vu se succé<strong>de</strong>r plusieurs générations d’artisans labo-<br />
rieux et économes, était parvenue à amasser une fortune assez considérable la<br />
mettant non seulement à l’abri du besoin, mais même en mesure <strong>de</strong> ne plus exer-<br />
cer ou presque d’activité professionnelle, vivant <strong>de</strong> ses rentes. Ces bourgeois<br />
inactifs, qualifiés souvent, tout simplement, <strong>de</strong> >, représentaient<br />
un peu moins <strong>de</strong> 10 % <strong>de</strong> la population parisienne iì la fin du XVIII‘ siècle, mais<br />
jouissaient d’une place <strong>de</strong> premier choix dans la vie <strong>de</strong> la capitale et du pays tout<br />
entier. Saint-Simon ne trouvait pas <strong>de</strong> mots assez durs pour fustiger ces >,<br />
ces >, ces > qui tendaient, par leur<br />
mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> vie, iì se confondre avec l’aristocratie et qui s’appropriaient une gran<strong>de</strong><br />
partie <strong>de</strong>s charges officielles.<br />
Saint-Marc Girardin, lui, n’avait pas d’états d’:me. Selon le portrait élo-<br />
gieux qu’en fera Alfred Mézières ’, il et faisant <strong>de</strong> lui un esprit >, définitivement ins-<br />
piré par le >, ce qui le préservera ; il se lanp donc dans les étu<strong>de</strong>s.<br />
Placé d’abord à la pension Hallays-Dabot, un établissement libre situé rue<br />
<strong>de</strong>s Fossés-Saint-Jacques iì Paris, celui qui <strong>de</strong>viendra un jour Saint-Marc Girardin<br />
poursuivit <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s brillantes au lycée Napoléon, actuel lycée Henri-IV, où il<br />
s’illustra plus particulièrement dans les concours <strong>de</strong> rhétorique. Y connut-il le duc<br />
<strong>de</strong> Chartres, le fils aîné du futur roi Louis-Philippe, élève <strong>de</strong> sixième <strong>de</strong> cet éta-<br />
blissement à partir <strong>de</strong> novembre I8 19 ? L‘histoire ne le dit pas : toutefois, on peut<br />
imaginer que la très forte sympathie qu’il manifesta sa vie durant pour la famille<br />
<strong>de</strong>s Orléans s’explique au moins en partie par cette solidarité d’anciens élèves. En<br />
tout cas, il est certain que l’opinion publique fut impressionnée par cette décision<br />
très symbolique qui rapprochait clairement la famille princière du Palais-Royal et<br />
la bourgeoisie parisienne :
SaintMarc Girardin 39<br />
Fig. 1 : €”it <strong>de</strong>. Saint-Maw Gimrdio<br />
Sur atte- image d’Epinal, que n’a-t-on pas fantaad, en croyant<br />
&ait perdu das<br />
: il n’&ait pas <strong>de</strong><br />
4. Guy Antonetti, Louis-Philippe, Paris, Fayard, 1994, p. 490 et 491. A l’époque (septembre 1819)<br />
le jeune duc <strong>de</strong> Chartres était encore l’héritier virtuel <strong>de</strong> la couronne puisque la duchesse <strong>de</strong> Berry<br />
venait d‘accoucher d’une fille. Louis Xvm s’opposa en vain B cette dkision.<br />
5. Alexis <strong>de</strong> Jussieu (1802-1865) : avocat, journaliste au Courrier français, sous-préfet <strong>de</strong> Sceaux en<br />
1830 puis @fet <strong>de</strong> l’Ain et <strong>de</strong> la Vienne, directeur <strong>de</strong> la police au ministère <strong>de</strong> l’Intérieur en 1837,<br />
d6puté <strong>de</strong> la Vendée jusqu’en 1839, encore préfet <strong>de</strong> l’Ain jusqu’il sa démission en 1841 ; maître <strong>de</strong>s<br />
requêtes au Conseil #Etat ; enseignant <strong>de</strong> litt6rature dans la <strong>de</strong>mière partie <strong>de</strong> sa vie.<br />
6. Silvestre <strong>de</strong> Sacy (1801-1879) : conservateur <strong>de</strong> la Bibliothtque Mazarine, sénateur en 1865, élu<br />
a l’Acad6mie française en 1854, journaliste au Journal <strong>de</strong>s débuts.<br />
7. Ximénès Doudan (1800-1872) : r6pktiteur au colkge Henri-IV, précepteur du fils <strong>de</strong> Mme <strong>de</strong><br />
Stdl, chef <strong>de</strong> cabinet du duc <strong>de</strong> Broglie (ministre <strong>de</strong> l’Instruction publique puis <strong>de</strong>s Affaires étran-<br />
gères <strong>de</strong> 1830 B 1835), maître <strong>de</strong>s requêtes au Conseil &Etat, journaliste au Journal <strong>de</strong>s débats, lit-<br />
térateur.
40 J~ilirii Supori<br />
chambre louée par ce <strong>de</strong>rnier rue <strong>de</strong>s Sept-Voies, à Paris. Tous les membres <strong>de</strong> ce<br />
cénacle <strong>de</strong>viendront un jour plus ou moins célèbres : nous verrons par ailleurs que<br />
leurs futures carrières présentent <strong>de</strong> telles similitu<strong>de</strong>s qu’on peut facilement pen-<br />
ser que l’amitié qu’ils nouèrent à cette époque constituera l’embryon d’un véri-<br />
table réseau <strong>de</strong> relations qui leur permettra d’entrer au Journul <strong>de</strong>s cfkbats, à<br />
l’université, dans l’Administration, dans la carrière politique ou encore à<br />
l’Académie française.<br />
Son baccalauréat obtenu, ses parents lui imposèrent <strong>de</strong> poursuivre <strong>de</strong>s<br />
étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> droit et, en 1822, il obtint I’avocature. A l’époque, l’inscription au bar-<br />
reau ne constituait pas toujours un projet professionnel, mais plutôt un moyen <strong>de</strong><br />
s’assurer une certaine considération sociale ; et, en effet, la véritable vocation <strong>de</strong><br />
Saint-Marc Girardin étant l’enseignement, il ne plaida en tout et pour tout que<br />
trois causes, dont celle, qu’il gagna, d’un marchand bonnetier opposé aux dames<br />
<strong>de</strong> la Halle.<br />
En 1823, il obtint l’agrégation et donc un traitement ouvrant le droit,<br />
comme on le prétendait à l’époque, M <strong>de</strong> dire qu’on mourait <strong>de</strong> faim aux frais <strong>de</strong><br />
]’Etat ! M Toutefois, suspecté <strong>de</strong> sympathies libérales, il se vit écarté <strong>de</strong> I’ensei-<br />
gnement. Sans protester contre cette mesure vexatoire, il se résigna à passer ses<br />
journées paisiblement, en famille, dans l’attente <strong>de</strong> jours meilleurs ; sa patience<br />
fut bient8t récompensée car, en 1826, on lui offrit la chaire <strong>de</strong> secon<strong>de</strong>, puis <strong>de</strong><br />
rhétorique, au collège Louis-le-Grand.<br />
Son maigre traitement d’enseignant, complété toutefois par <strong>de</strong>s cours par-<br />
ticuliers et, surtout, par l’ai<strong>de</strong> financière <strong>de</strong> ses parents, lui permettait chaque été,<br />
dès que sonnait l’heure <strong>de</strong>s vacances scolaires, <strong>de</strong> partir en voyage et <strong>de</strong> visiter<br />
ainsi la plupart <strong>de</strong>s pays d‘Europe et, plus tard, du Moyen-Orient. C’est ainsi<br />
qu’en 1827 il se rendit pendant trois mois à Berlin oÙ il fit la connaissance<br />
d’Hegel et se lia avec Edouard Gans, professeur <strong>de</strong> droit à l’université <strong>de</strong> Berlin;<br />
en 1845, il préfacera d’ailleurs l’ouvrage <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier, une Histoire du droit <strong>de</strong><br />
siiccession en France au Moyen Age.<br />
Ces voyages firent <strong>de</strong> lui un grand admirateur <strong>de</strong> l’Allemagne, et pas seu-<br />
lement <strong>de</strong> ses arts et <strong>de</strong> ses lettres. L‘esprit conservateur <strong>de</strong> Saint-Marc Girardin<br />
appréciait le genre <strong>de</strong> vie rangé et casanier <strong>de</strong> ce peuple, mais également la force<br />
<strong>de</strong> ses traditions à peine secouées par Bonaparte :
en <strong>de</strong>venant alleman<strong>de</strong>, montait d’un <strong>de</strong>gré dans I’échelle <strong>de</strong> la civilisation D et,<br />
<strong>de</strong> ce fait, ).<br />
Avec un cynisme indéniable, notre voyageur cautionnait ainsi non seulement<br />
l’impérialisme allemand du XIX“ siècle, inais Cgalement les thCories raciales <strong>de</strong><br />
son quasi-contemporain Arthur <strong>de</strong> Gobineau ( I8 16- 1882) qui plapit le concept<br />
d’inégalité <strong>de</strong>s races au centre <strong>de</strong> ses réflexions Io. Bien <strong>de</strong>s années plus tard, sous<br />
le Second Empire, Saint-Marc Girardin se retrouva pourtant vice-prési<strong>de</strong>nt du<br />
42<br />
Sa carrière <strong>de</strong> journaliste<br />
Dès 182 1, il entama sa carrière <strong>de</strong> journaliste en rédigeant <strong>de</strong>s comptes<br />
rendus <strong>de</strong> l’Opéra pour I’Eclio du soir. En 1827, il débuta dans Le Journal <strong>de</strong>s<br />
dkbats : il y restera un collaborateur assidu durant quarante-cinq ans, partageant<br />
les opinions politiques <strong>de</strong> ce prestigieux quotidien conservateur et s’imposant<br />
rapi<strong>de</strong>ment comme un <strong>de</strong>s plus célèbres polémistes français ; il y sera rejoint par<br />
ses amis <strong>de</strong> jeunesse, Silvestre <strong>de</strong> Sacy et Ximénès Doudan. En <strong>de</strong>hors du Journal<br />
<strong>de</strong>s débiits, il collabora également, plus ou moins épisodiquement, avec plusieurs<br />
autres journaux, notamment avec La Revue <strong>de</strong>s Deux Mon~ks, une autre célèbre<br />
institution orléaniste qui publiera entre 1838 et 1856 vingt-<strong>de</strong>ux <strong>de</strong> ses articles.<br />
Le Journal <strong>de</strong>s dkb~its avait été fondé en 1789 par Gaultier <strong>de</strong> Biauzat,<br />
oncle du professeur <strong>de</strong> droit <strong>de</strong> Louis-Philippe, pour rendre compte <strong>de</strong>s débats à<br />
l’Assemblée constituante. Ce quotidien, qui comptait sous la Restauration environ<br />
13 O00 abonnements (chiffre considérable pour l’époque), fut dirigé par Louis<br />
François Bertin dit l’Aîné >> jusqu’en 1841 puis, successivement, par ses fils<br />
Louis et François. Sous les règnes <strong>de</strong> Louis XVIII et <strong>de</strong> Charles X, le journal, traditionnellement<br />
favorable à une monarchie tempérée, put compter parmi ses collaborateurs<br />
<strong>de</strong>s signatures aussi illustres que celles <strong>de</strong> Chateaubriand, Geoffroy et<br />
Nodier, et combattit le gouvernement <strong>de</strong>s Ultras. Après la révolution <strong>de</strong> 1830, il<br />
se discrédita, <strong>de</strong>venant une sorte <strong>de</strong> du régime orléaniste, largement<br />
subventionné sur les fonds secrets du gouvernement ; puis, sous le<br />
Second Empire, il fut le principal organe <strong>de</strong> l’opposition libérale, évoluant par la<br />
suite vers <strong>de</strong>s positions républicaines conservatrices. II cessa <strong>de</strong> paraître en 1944.<br />
Dans son premier article, non signé, Saint-Marc Girardin commentait les<br />
troubles qui venaient d’avoir lieu, en novembre 1827, rue Saint-Denis, à Paris ; à<br />
cette occasion, la troupe avait tiré sur une foule inoffensive qui manifestait<br />
bruyamment à la suite d’élections défavorables au gouvernement <strong>de</strong> Joseph <strong>de</strong><br />
Villèle. Avec verve, le jeune journaliste apostrophait les ministres, leur <strong>de</strong>man-<br />
dant c si les bulletins <strong>de</strong> la Gran<strong>de</strong> Armée allaient maintenant s’afficher à la<br />
Morgue ! >> Saint-Marc Girardin dut finalement avouer être l’auteur <strong>de</strong> l’article<br />
mais, fervent partisan <strong>de</strong> l’idée monarchiste, il ne fut guère inquiété par le gou-<br />
vernement et put donc poursuivre à la fois sa carrière dans l’enseignement et ses<br />
activités <strong>de</strong> journaliste, fustigeant dans la presse le ministère Villèle et les<br />
jésuites ; ce qui ne l’empêcha pas, en décembre 1827, <strong>de</strong> louer ce même Villèle<br />
qui venait <strong>de</strong> quitter le gouvernement ...<br />
Ces prises <strong>de</strong> positions pouvaient apparaître contradictoires et, à cette<br />
époque, on pouvait elfectivement s’interroger sur la personnalité <strong>de</strong> Saint-Marc<br />
Girardin, qui, dans ses articles, se posait en jeune homme fougueux et enthou-<br />
siaste, ridiculisant les esprits bornés qui entouraient Charles X. Nombreux étaient<br />
ceux qui se <strong>de</strong>mandaient si le jeune journaliste ne dcviendrait pas, un jour, le chef<br />
<strong>de</strong> íïle du >. Nous verrons qu’il n’en sera rien et que, même<br />
si le ton était souvent sarcastique et parfois très vif, notre brillant écrivain militait
Suiiii Marc Girurdiii 43<br />
déji pour ces opinions qui feront <strong>de</strong> lui, quelques décennies plus tard, un <strong>de</strong>s<br />
champions du parti conservateur, adversaire acharné du suffrage universel.<br />
Qu’est-ce que Saint-Marc Girardin, lui-même monarchiste et conserva-<br />
teur, reprochait au régime <strong>de</strong> Charles X ? Notre polémiste s’inscrivait dans une<br />
fortc tradition française, cellc <strong>de</strong>s
44 Julien Supori<br />
Rappelons qu’a cette époque, les jésuites <strong>de</strong>meuraient très impopulaires et étaient<br />
attaqués même par certains légitimistes, tel le vieux comte <strong>de</strong> Montlosier, parti-<br />
san du gallicanisme.<br />
II <strong>de</strong>vient un zélateur <strong>de</strong> la monarchie <strong>de</strong> Juillet<br />
Après avoir pris la défense du ministère Martignac ( 1828- 1829) qu’il qua-<br />
lifiera <strong>de</strong> >, Saint-Marc Girardin<br />
s’éloigna définitivement du roi Charles X lorsque ce <strong>de</strong>rnier chargea le prince <strong>de</strong><br />
Polignac <strong>de</strong> conduire la politique gouvernementale. Ce faisant, il suivait la ten-<br />
dance générale en vigueur au Journal <strong>de</strong>s dk’brits, dont un autre illustre collabo-<br />
rateur, Chateaubriand, s’était également insurgé contre la nouvelle orientation<br />
politique <strong>de</strong> la monarchie en démissionnant <strong>de</strong> son poste d’ambassa<strong>de</strong>urà Rome.<br />
La presse quasi unanime se déchaîna contre Polignac et Saint-Marc<br />
Girardin participa B cette campagne avec <strong>de</strong>s mots très forts, publiés le IO août<br />
1829 dans Le Journal <strong>de</strong>s dkbats : . Les ordonnances libertici<strong>de</strong>s du 26 juillet 1830 provoquèrent l’insurrection<br />
<strong>de</strong> Paris et Saint-Marc Girardin, qui revenait d’un voyage <strong>de</strong> quatre mois à Berlin,<br />
put assister en direct à la révolution. D’emblée, il se situa comme un incondi-<br />
tionnel <strong>de</strong> ce nouveau régime I’. L‘orléanisme n’hésitait pas à prendre appui sur<br />
les principes <strong>de</strong> 1789 et proposait une monarchie revigorée par la force du contrat<br />
entre la nation et le roi <strong>de</strong>s Français, mais toutefois éprise d’ordre et soucieuse <strong>de</strong><br />
préserver les privilèges politiques et économiques <strong>de</strong>s notables. Enthousiaste, il<br />
écrivit dans Le Journal <strong>de</strong>s déhm : (( Cette révolulion, aussi bien, changea ma<br />
vocation <strong>de</strong> journaliste : d’un écrivain d’opposition, elle fit <strong>de</strong> moi, presque dès<br />
le len<strong>de</strong>main, un défenseur du pouvoir et je l’en remercie D. Dès lors, ses enne-<br />
mis furent clairement désignés : ><br />
Le fils du marchand <strong>de</strong> drap, défenseur acharné <strong>de</strong>s vertus et <strong>de</strong>s privilèges<br />
12. Lr Joirnia/ t k s tKbats eut un r61e déterminant dims la crise du règne <strong>de</strong> Charles x. Son directeur,<br />
M. Bertin, fut même condamné h six mois <strong>de</strong> prison pour un <strong>de</strong> ses articles. mais acquitté en appel.<br />
Contrariée par cette décision. le I“ janvier 18.70, la duchesse d’Angoulême, rei‘usant d‘écouter les<br />
compliments du prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la cotir d’appel lors <strong>de</strong> la visite d’usage. l’interrompit sèchement en lui<br />
disant : (< Passez, messieurs. x La populariti <strong>de</strong> la dtichessc (l’ancienne *< orpheline du Temple n) et<br />
<strong>de</strong> l’ensemble du parri légitiinistc qu’elle incarnait. souffrira <strong>de</strong> celte maladrcsse.<br />
13. II en fut <strong>de</strong> même pour ses trois amis <strong>de</strong> jetincssc, Silveswe dc Sacy, Alexis <strong>de</strong> Jussieu et Ximénès<br />
Doudan, qui adhéri.rent tous avec enthousiasme h la inonarchie <strong>de</strong> Juillet.<br />
1 4. Saint - M arc Girard in , Sort wzir.s et r&.flrxn-iorz.v d ’Lin ,jot I rm 1858, p. 76.<br />
li.ste. Paris, éd. Miche I - Lé v y Frères,<br />
D
<strong>de</strong> la bourgeoisie parée <strong>de</strong> toutes les vertus (politiques, économiques, morales et<br />
même artistiques), ne pouvait qu’être à l’aise avec ce régime orléaniste. Pour lui,<br />
la monarchie <strong>de</strong> Juillet incarne >. Position pourtant paradoxale, si l’on songe qu’une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong><br />
cette bourgeoisie continuera à être exclue du fonctionnement <strong>de</strong>s institutions, en<br />
raison notamment <strong>de</strong>s dispositions électorales.<br />
Dans son éloge funèbre, prononcé en 1874 à l’Académie française,<br />
M. Alfred Mézières décrivit les opinions politiques <strong>de</strong> son prédécesseur, précisant<br />
que Saint-Marc Girardin avait déiendu toute sa vie la politique >.<br />
Désormais définitivement rangé dans les rangs <strong>de</strong> I’orléanisnie, les idées<br />
<strong>de</strong> Saint-Marc Girardin ne varicront plus jusqu’à la fin <strong>de</strong> ses jours. Devenu un<br />
soutien dévoué du roi Louis-Philippe, il s’opposa fermement aux idées républi-<br />
caines dont se revendiquaient, disait-il, a les esprits factieux >>. Sa critique <strong>de</strong> la<br />
république était fondée non seulement sur les souvenirs <strong>de</strong> la Terreur, mais éga-<br />
lement sur <strong>de</strong>s considérations d’ordre économique. I1 affirmait qu’un régime<br />
républicain conduirait à la banqueroute et aboutirait inévitablement à une dicta-<br />
ture, en raison <strong>de</strong> l’existence <strong>de</strong> multiples intérêts divergents dans la société fran-<br />
çaise.<br />
Dans son esprit, république et démocratie s’i<strong>de</strong>ntifiant, il fallait àtout prix<br />
barrer la route au suffrage universel. I1 annonçait que la société mo<strong>de</strong>rne péri-<br />
ra [...] si elle fait l’erreur <strong>de</strong> faire <strong>de</strong>s citoyens actifs avant d’en faire <strong>de</strong>s proprié-<br />
taires >>. Le message était donc clair : e Point <strong>de</strong> droits politiques hors <strong>de</strong> la pro-<br />
priété et <strong>de</strong> l’industrie; mais que tout le mon<strong>de</strong> puisse aisément arriver à la pro-<br />
priété et à l’industrie >>, écrira-t-il dans un article publié en 1831 par Le Joirrml<br />
<strong>de</strong>s débats et intitulé très clairement (< Les Barbares >>. D’après Sain-Marc<br />
Girardin, ces > Si le gouvernement se doit <strong>de</strong> faire en sorte qu’un<br />
sort trop désespéré ne les pousse pas à se révolter, il n’est absolument pas ques-<br />
15. François Furet, La Ke‘volurion 1770-IKX0, Paris, Hachette, coll. Pluriel, 10x8, p. 348.<br />
16. A. MéLières, Discours <strong>de</strong> re‘ceptiot~ ir I’Ai~atle‘itiie,~r~r,ri(.ai.se, 01’. cif., p. 2 I.<br />
45
tion qu’il leur accor<strong>de</strong> la possibilité d’accé<strong>de</strong>r aux droits politiques, réservés à<br />
une petite élite <strong>de</strong> notables sélectionnée sur <strong>de</strong>s critères économiques. ><br />
Le régime orléaniste fut très généreux avec ses zdateurs. Dès son arrivée<br />
au pouvoir, Louis-Philippe avait alloué la somme <strong>de</strong> 200 O00 francs à Benjamin<br />
Constant pour lui permettre <strong>de</strong> payer ses innombrables <strong>de</strong>ttes <strong>de</strong> jeu, peu avant <strong>de</strong><br />
le nommer prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> section au Conseil d’Etat. Pierre-Louis Bertin, frère du<br />
directeur du Joui.ntrl <strong>de</strong>s déhars, fut nommé ambassa<strong>de</strong>ur aux Pays-Bas.<br />
Salvandy, journaliste dans le même journal, élu député en 1833, fut nommé<br />
ministre avant d’entrer à l’Académie française. De même, les quatre amis,<br />
anciens élèves du lycée Henri IV, furent tous largement récompensés, Saint-Marc<br />
Girardin étant plus particulièrement chargé <strong>de</strong> remplacer François Guizot à la<br />
faculté <strong>de</strong>s lettres <strong>de</strong> la Sorbonne. En 1833, il quittera cette chaire pour celle <strong>de</strong><br />
poésie française dans la même faculté, en remplacement <strong>de</strong> M. Laïa.<br />
La monarchie <strong>de</strong> Juillet ayant renouvelé en quelques mois la moitié <strong>de</strong>s<br />
membres du Conseil d’Etat, Saint-Marc Girardin y fut nommé maître <strong>de</strong>s<br />
requêtes dès 1830, fonction qu’il occupera jusqu’en 1837. Sa contribution aux<br />
travaux <strong>de</strong> cette institution reste difficile à cerner, les archives du Conseil d’Etat<br />
ayant été entièrement détruites en 1871, lors <strong>de</strong>s combats <strong>de</strong> la Commune. I1<br />
semble toutefois qu’elle ait été minime, car il assista tout au plus à huit séances<br />
en l’espace <strong>de</strong> dix-huit mois. Le nouveau régime nomma également au Conseil<br />
d’Etat ses amis <strong>de</strong> jeunesse Alexis <strong>de</strong> Jussieu et Ximénès Doudan.<br />
Après les rentes, les honneurs. En 1839, Saint-Marc Girardin reçut la croix<br />
<strong>de</strong> la Légion d’honneur <strong>de</strong>s mains du roi Louis-Philippe en personne. Désormais,<br />
cet esprit laïque, voltairien et railleur voua un véritable culte au monarque au<br />
parapluie qu’il para <strong>de</strong> toutes les vertus ... même mystiques ! Car il paraissait évi-<br />
<strong>de</strong>nt à notre polémiste <strong>de</strong> bon aloi que si le roi échappait avec une telle aisance<br />
aux nombreux attentats dont il était l’objet, c’élait grke à une miraculeuse et<br />
constante protection divine. ><br />
Toutefois, très pru<strong>de</strong>mment, le gouvernement <strong>de</strong> Louis-Philippe décida<br />
qu’il était trop aléatoire <strong>de</strong> compter uniquement sur la provi<strong>de</strong>nce divine pour la<br />
défense du régime. A la suite <strong>de</strong> l’attentat <strong>de</strong> Fieschi, le 28 juillet 1835, <strong>de</strong> nou-
Suint-Mtirc Girtirtliii 47<br />
velles lois sur la presse furent promulguées le 9 septembre. Le système ainsi mis<br />
en place était encore plus sévère que celui qu’avait connu la Restauration, et <strong>de</strong><br />
nombreux journaux d’opposition, frappés <strong>de</strong> lour<strong>de</strong>s amen<strong>de</strong>s (Lu Curicnture, Lu<br />
Triburie, Le Réjorinuteur ...), durent cesser leur parution. Saint-Marc Girardin ne<br />
réagit guère contre ces lois d’exception qui frappaient ses confrères <strong>de</strong> la presse.<br />
Le Journal <strong>de</strong>s débuts ne s’en porta pourtant pas mieux : discrédité et boudé par<br />
les lecteurs, ses abonnements tombèrent à 9 O00 exemplaires en 1846 I’.<br />
Désormais <strong>de</strong>venu un homme <strong>de</strong> pouvoir, Saint-Marc Girardin réserva sa<br />
plume acérée à <strong>de</strong>s sujets inoffensifs ou pittoresques. C’est ainsi qu’en juillet<br />
1830, il écrivit dans Le Journal <strong>de</strong>s débuts un article ridiculisant <br />
En 1842, il débuta à la faculté <strong>de</strong>s lettres <strong>de</strong> Paris le Cours <strong>de</strong> litte‘ruture<br />
drurnatiqiie ou <strong>de</strong> l’usage <strong>de</strong>s pussions duns le draine qui restera sa principale<br />
œuvre littéraire et sera publié <strong>de</strong> 1843 à 1846 sous ce titre, en cinq volumes. I1<br />
s’agissait d’un véritable réquisitoire contre le romantisme qui, après avoir débu-<br />
té dans le culte tout à fait > du Moyen Age, <strong>de</strong> la chevalerie et donc<br />
<strong>de</strong> la royauté, avait évolué vers <strong>de</strong>s idéaux démocratiques et séduisait <strong>de</strong> plus en<br />
plus une jeunesse lasse d’écrits trop conventionnels. Le débat débordait le cadre<br />
strictement littéraire pour connaître <strong>de</strong>s retombées politiques évi<strong>de</strong>ntes : le gou-<br />
vernement <strong>de</strong> Martignac n’avait-il pas frappé <strong>de</strong>s foudres <strong>de</strong> la censure la pièce<br />
18. Dans Lircim Lcwvc/i <strong>de</strong> Stendhal (Paris. Flammarion, 1992, t. 1, p. 173). le protagoniste, sous-<br />
lieutenant <strong>de</strong> cavalerie, est convoqué et réprimandé par son colonel chef <strong>de</strong> corps qui lui reproche<br />
d’être un séditieux républicain. pour s’être attardé dans un cabinet <strong>de</strong> lecture sans feuilleter l’exem-<br />
plaire bien en vue du Jourmil <strong>de</strong>s clihat.\ !<br />
19. A. Mézières, Discoirt:\ ,firtitlire siir Srritif-Mon Gircirdin, op. cif., p. 2.
48 Jirlirrz Strpori<br />
<strong>de</strong> Victor Hugo MLiriori Delorme, soupçonnée <strong>de</strong> vouloir atteindre sournoisement<br />
Charles X par sa crilique <strong>de</strong> Louis XII1 ?<br />
Dans son ouvrage, Saint-Marc Girardin afiïrmait que la moralité étant<br />
indissociable <strong>de</strong> la beauté, la IittCrature avait tort <strong>de</strong> s’intéresser à certaines pas-<br />
sions excessives relevant <strong>de</strong>s > et, prônant en faveur <strong>de</strong> la<br />
mesure, essayait <strong>de</strong> ranimer une littérature classique désormais moribon<strong>de</strong> 20.<br />
Partisan du parti <strong>de</strong> l’ordre même lorsqu’il se consacrait à la critique littéraire, il<br />
dénonçait la rhétorique romantique, coupable, d’après lui, <strong>de</strong> mettre en valeur <strong>de</strong>s<br />
dérèglements d’émotions dignes <strong>de</strong>s grands criminels et qui, un jour, pourraient<br />
inspirer à <strong>de</strong>s agitateurs <strong>de</strong>s idées dangereuses, susceptibles <strong>de</strong> menacer l’ordre<br />
social. Ses sentiments farouchement anti-romantiques étaient partagés par<br />
d’autres célèbres orléanistes <strong>de</strong> l’époque, tel Salvandy. Ils préconisaient la haine<br />
que l’Action française vouera, quelques décennies plus tard, à ces grands roman-<br />
ciers du XIX‘ siècle coupables, d’après Barrès, <strong>de</strong> >.<br />
La critique n’était pas seulement littéraire mais se voulait également psy-<br />
chologique : s’érigeant en chantre du style <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s >, Saint-<br />
Marc Girardin essayait <strong>de</strong> ridiculiser les héros mélancoliques et ténébreux <strong>de</strong>s<br />
romantiques, se disant silr que, dans quelques années, ils seraient tous rangés et<br />
pères <strong>de</strong> famille.<br />
Aujourd’hui, l’ouvrage <strong>de</strong> Saint-Marc Girardin est oublié : il faut recon-<br />
naître qu’il mena un combat d’arrière-gar<strong>de</strong>, le mouvement romantique voyant sa<br />
victoire contre > du classicisme difinitivement couronnée<br />
en 1841 par l’entrée <strong>de</strong> Victor Hugo 2 l’Académie franyaise. Avec le recul, les<br />
leçons <strong>de</strong> style que le professeur Saint-Marc Girardin prétendait donner à > Victor Hugo, sa cible préférée, mais également à Alexandre Dumas, dont il<br />
se moquait du haut <strong>de</strong> sa chaire universitaire, paraissent aujourd’hui aussi ridi-<br />
cules qu’indigestes : incapable <strong>de</strong> comprendre la sensibilité <strong>de</strong> son siècle, il est<br />
certain que notre homme <strong>de</strong> lettres >.<br />
Toutefois, à défaut d’être un génie <strong>de</strong> la littérature, Saint-Marc Girardin<br />
maîtrisait parfaitement ce qu’on appellerait aujourd’hui >. En effet, Le Jourilal <strong>de</strong>s dibats rendait compte régulike-<br />
ment <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong> son chroniqueur qui, par la suite, étaient édilés sous forme <strong>de</strong><br />
recueils. A ce titre, ils avaient droit à une nouvelle critique, flatteuse, <strong>de</strong> la part<br />
du même journal. Ce système s’était généralisé sous la monarchie <strong>de</strong> Juillet jus-<br />
qu’à <strong>de</strong>venir un véritable monopole <strong>de</strong> fait <strong>de</strong>s auteurs > sur l’en-<br />
20. Victor Hugo réagit avcc ironie i ces critiques drin\ son ouvrage Cluircle Cirrrrs (Paris, Le Livre<br />
<strong>de</strong> Poche, 1095. p. 77) : G II est utile <strong>de</strong> déclarer que c’est le drame mo<strong>de</strong>rne qui a inventé l’inceste,<br />
I’ndultPre, le parrici<strong>de</strong>, l’infantici<strong>de</strong> et l’empoisonnement. et <strong>de</strong> prouver par 121 qu’on ne connaît ni<br />
Phèdre. ni Jacoste, ni (Edipe, ni Médée, ni Rodogtinc. n II est B noter que Louis-Philippe rebta sa vie<br />
durant fermement étrangcr au romantisme.<br />
21. “.wemi Lnrousse i//i/sfri en 7 vo/iruie.v, rubrique M Saint Marc Girardin >>.
Saint-Marc Girardin<br />
semble <strong>de</strong> la production littéraire. I1 fut notamment dénoncé par Balzac qui eut à<br />
en souffrir =.<br />
La récompense gouvemementale ne tarda guère. Le 8 février 1844, notre<br />
littérateur entra à l’Académie française à la place <strong>de</strong> M. Campenon, occupant le<br />
fauteuil no 23. I1 avait reçu dix-huit voix, l’emportant contre <strong>de</strong>ux partisans du<br />
mouvement romantique, les poètes Em<strong>de</strong> Deschamps (qui eut huit voix) et Alfred<br />
<strong>de</strong> Vigny (sept voix seulement). Le hasard désigna Victor Hugo pour répondre au<br />
nouvel élu ; il le fit sans aucune tendresse : ><br />
22. La dénonciation <strong>de</strong> ce u systkme B est au centre du roman <strong>de</strong> Balzac Illusions perdues, paru en<br />
1843, qui décrit les vicissitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Lucien <strong>de</strong> Rubempré, jeune héros dont la vocation littéraire est<br />
brisée par la presse officielle disposant d’un droit <strong>de</strong> vie ou <strong>de</strong> mort sur n’importe quel auteur : u Un<br />
livre <strong>de</strong> M. <strong>de</strong> Chateaubriand sur le <strong>de</strong>rnier <strong>de</strong>s Stuarts &ait dans un magasin à 1’6tat <strong>de</strong> rossignol.<br />
Un seul article &rit par un jeune homme dans Le Journal <strong>de</strong>s Dkbars fit vendre ce livre en une<br />
semaine. B (op. cit., p. 369)<br />
23. E. <strong>de</strong> Mirecourt, Les contemporains : Saint-Marc Girardin, op. cit., p. 56-57.
50 Julien Sciporì<br />
La même année, le 14 mars, Charles Sainte-Beuve fut également élu parmi<br />
les Immortels. Faisant partie <strong>de</strong> la troupe <strong>de</strong>s romantiques, il n’appréciait guère<br />
Saint-Marc Girardin dont il avait écrit :
Sairit Mtrrc Giianlirt 51<br />
, se disait celui-ci. >><br />
Finalement, M. <strong>de</strong>s Ramiers parvient à obtenir un ren<strong>de</strong>z-vous auprès <strong>de</strong><br />
Lucien Leuwen :<br />
<br />
C’est en vain que M. <strong>de</strong>s Ramiers implore Lucien Leuwen <strong>de</strong> bien vouloir<br />
se charger lui même <strong>de</strong> cette basse besogne : ce <strong>de</strong>rnier refuse.<br />
26. Les passages suivants sont extraits du roman Lucien Leuweri <strong>de</strong> Stendhal, op. cit., t. II, p. 343-<br />
347. Notons qu’il n’y a aucun doute possible concernant la véritable ¡<strong>de</strong>ntilé <strong>de</strong> M. <strong>de</strong>s Ramiers,<br />
Stendhal lui-même ayant écrit dans la marge <strong>de</strong> son manuscrit :
52 Julien Sripori<br />
>, se dit Lucien Leuwen. >><br />
Dès lors, commence un véritable vau<strong>de</strong>ville. M. <strong>de</strong>s Ramiers s’acharne sur<br />
le pauvre M. Tourte, entamant toutes sortes <strong>de</strong> démarches administratives pour<br />
obtenir sa <strong>de</strong>stitution. Lucien Leuwen les contrarie, en faisant preuve d’une ima-<br />
gination bureaucratique exceptionnelle - Stendhal, qui était à l’époque consul <strong>de</strong><br />
France à Civitavecchia, s’inspirait certainement <strong>de</strong> son expérience personnelle.<br />
M. <strong>de</strong>s Ramiers, qui . Toutefois, le député doit en payer le prix : désormais discré-<br />
dité auprès <strong>de</strong> la femme du ministre, son nom est effacé <strong>de</strong> la liste <strong>de</strong>s personna-<br />
lités invitées au ministère. > et, lors <strong>de</strong><br />
sa présentation à l’ambassa<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> Russie, ce <strong>de</strong>rnier clame tout haut en le rece-<br />
vant: (< Ah ! le <strong>de</strong>s Ramiers <strong>de</strong> Tourte ! >> Sur quoi, le Fénelon mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong>vint<br />
pourpre, et le len<strong>de</strong>main M. Leuwen père mit l’anecdote en circulation dans tout<br />
Paris. >><br />
Mais le plus extraordinaire est que cette histoire ridicule est pourtant par-<br />
faitement véridique ! Elle fut rapportée par <strong>de</strong> nombreux journaux <strong>de</strong> l’époque,<br />
dont La Gazette <strong>de</strong> France <strong>de</strong>s 9 et 1 O décembre 1834 et surtout Le Clicirivrtri du<br />
12 décembre 1834, cité par Stendhal dans son récit. Ce journal avait publié un<br />
article intitulé très explicitement : >. Stendhal s’était permis <strong>de</strong> simples aménagements : la véritable<br />
victime ne se nommait pas Tourte, niais Maugrageas, et était vérificateur <strong>de</strong>s<br />
poids et mesures <strong>de</strong> son état. Le pauvre homme s’était rendu coupable d’avoir un<br />
frère qui avait mal voté ; dès lors, >. Ce que Stendhal<br />
n’avait pas raconté, c’est que la vengeance <strong>de</strong> Saint-Marc Girardin ne s’arrêta pas<br />
iì ce père <strong>de</strong> famille sans fortune, chargé <strong>de</strong> trois enfants : elle s’étendit également<br />
à son frère ainsi qu’au frère d’un candidat <strong>de</strong> l’opposition. Car, circonstance<br />
aggravante, ils étaient tous également coupables d’occuper <strong>de</strong>s postes à la pré-<br />
fecture, subalternes certes, mais qui pourraient se révéler utiles pour récompen-<br />
27. Journal L’Eclio <strong>de</strong> V&.tone, cité en note <strong>de</strong>ns Lucien Leuwen, op. cit., p. 5 17.
Stiirit-Mtirc Girurtlin 53<br />
ser certains supporters du nouveau député, soucieux <strong>de</strong> se constituer une ) aux frais du contribuable. Tous furent renvoyés, victimes d’une véritable<br />
54 Julien Sapori<br />
C’est sous cette orientation conservatrice qu’il faut comprendre le combat<br />
que Saint-Marc Girardin mena sa vie durant contre >, pour la<br />
défense <strong>de</strong> l’université laïque et également en faveur d’une instruction primaire<br />
généralisée. Ses principes éducatifs ne visaient pas I’épanouissement <strong>de</strong> l’enfant,<br />
mais l’embriga<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> la jeunesse dans un souci d’ordre, à l’exemple du sys-<br />
tème scolaire créé en Prusse par Frédéric II, qui n’avait pas hésité B étatiser les<br />
écoles dès 1763 et B décréter l’obligation scolaire jusqu’à I’âge <strong>de</strong> 13 ans.<br />
Le 20 août 1833, Saint-Marc Girardin fut chargé <strong>de</strong> parcourir l’Allemagne<br />
méridionale afin d’y étudier les > (nous dirions aujour-<br />
d’hui les collèges). Encore une fois, cette nomination avait été possible grâce à<br />
son réseau <strong>de</strong> relations : non seulement le ministre <strong>de</strong> l’Instruction publique qui<br />
l’avait désigné était Guizot (qu’il connaissait très bien, lui ayant succédé dans sa<br />
chaire à la Sorbonne), inais son ami <strong>de</strong> jeunesse Ximénès Doudan exerçait B<br />
l’époque les fonctions <strong>de</strong> chef <strong>de</strong> cabinet du duc <strong>de</strong> Broglie, ancien ministre <strong>de</strong><br />
l’Instruction publique.<br />
A son retour d’Allemagne, il rédigea un rapport en <strong>de</strong>ux volumes intitulé<br />
De 1 ’instruction iiiterr&dicrire et <strong>de</strong> son htnt cluns le Midi clr I’Allernngne. Dans<br />
cette œuvre volumineuse, il critiquait le système français, trop marqué par l’en-<br />
seignement classique, conçu pour une élite littéraire mais inadapté à la formation<br />
<strong>de</strong>s nouvelles couches sociales. Voici ce qu’il écrivait à ce sujet avec son bon sens<br />
habituel : > Pour pallier ces carences, Saint-Marc Girardin préco-<br />
nisait la création <strong>de</strong> collèges dispensant un enseignement pratique, se singulari-<br />
sant notamment par l’apprentissage d’une langue étrangère contemporaine à la<br />
place du grec et du latin.<br />
Ce projet, incontestablement innovateur, était toutefois <strong>de</strong>vait avoir un but uniquement uti-<br />
litaire, et en aucun cas constituer un apprentissage <strong>de</strong> la liberté. Au contraire, il<br />
préconisait pour ces écoles > (c’est ainsi qu’il les appelait) le renfor-<br />
cement <strong>de</strong> l’enseignement religieux car >. Ses soucis rejoignaient ceux <strong>de</strong> toute une par-<br />
30. Propos <strong>de</strong> Saint-Marc Girardin cités par le journal L’Ecltrirdu 6 septembre 1898 : B cette époque,<br />
ce journal les considCrait encore d’une extrême actualité.<br />
3 I. T. Froment, Sainf-Mrrrc Girardin pL:tkigogue, op. cit., p. 2 I.
Srr it1 t-Mtr rc Girrr /dir1 55<br />
tie <strong>de</strong> l’élite incroyante <strong>de</strong> l’époque, se tournant >.<br />
L‘intérit qu’il manifestait pour les questions pédagogiques le fit nommer<br />
en 1838 au Conseil royal <strong>de</strong> l’Instruction publique. I1 y défendit les principes du<br />
monopole <strong>de</strong> l’université et <strong>de</strong> l’instruction primaire obligatoire, ce qui <strong>de</strong>vait le<br />
préparer à ses futures fonctions parlementaires.<br />
Le député<br />
C’est dans le domaine politique que Saint-Marc Girardin jouera le rôle le<br />
plus important. La monarchie <strong>de</strong> Juillet, avec la loi du 15 avril 1831, en abaissant<br />
le cens requis pour I’éligibilité <strong>de</strong> 1 O00 à 500 francs et le droit <strong>de</strong> vote <strong>de</strong> 300 à<br />
200 francs, avait aménagé, sans véritablement le bouleverser, le suffrage censi-<br />
taire en vigueur sous la Restauration.<br />
Mais peut-on vraiment parler d’élections avec un corps électoral si res-<br />
treint et un système <strong>de</strong> corruption généralisé au profit <strong>de</strong>s candidats officiels ‘?<br />
Stendhal dira <strong>de</strong> Saint-Marc Girardin qu’il avait été > grâce,<br />
notamment, à l’appui du gouvernement. Afin <strong>de</strong> limiter encore les risques, le lit-<br />
térateur porta son choix sur le Limousin, une région rurale oÙ il n’avait guère<br />
d’attaches, mais qui semblait pouvoir lui assurer plus facilement son élection que<br />
la région parisienne où, traditionnellement, les électeurs votaient
56 Jitlien Stipori<br />
du préfet <strong>de</strong> la Haute-Vienne adressé au ministre <strong>de</strong> l’Intérieur. Rendant compte<br />
<strong>de</strong>s résultats et <strong>de</strong> l’ambiance lors <strong>de</strong>s élections du 9 juillet 1842, ce haut fonc-<br />
tionnaire écrivait : >, avec notam-<br />
ment Odilon Barrot, réclamait <strong>de</strong>s réformes et plus particulièrement l’abaisse-<br />
ment du cens ; son journal était Le Sitcle. Mais la gran<strong>de</strong> majorité <strong>de</strong>s députés<br />
constituait ce que nous définirions aujourd’hui comme étant le >, lui-<br />
même divisé en trois groupes. Le centre-gauche, dirigé par Thiers, et dont l’or-<br />
gane était Le Temps, se revendiquait <strong>de</strong>s principes <strong>de</strong> la monarchie constitution-<br />
nelle à l’anglaise, tandis que le >, fluctuant en fonction <strong>de</strong>s circonstances<br />
politiques, se regroupait autour du journal Le Constitutionnel. Le principal chef<br />
<strong>de</strong> file du centre-droit était Guizot, qui réclamait pour le roi un rôle prioritaire<br />
dans le gouvernement du pays et le choix <strong>de</strong>s ministres : ses idées inspiraient Le<br />
Journal <strong>de</strong>s débuts. Pour terminer, les légitimistes, avec Lu Gazette cle France,<br />
étaient politiquement marginalisés.<br />
Saint-Marc Girardin se situait donc dans les rangs du centre-droit, parmi<br />
les partisans <strong>de</strong> ceux qui affirmaient que >.<br />
D’une façon générale, la monarchie <strong>de</strong> Juillet laissera B la postérité le souvenir<br />
d’une Chambre <strong>de</strong>s députés dominée par le pouvoir exécutiF, avec <strong>de</strong>s élus<br />
> parmi lesquels on comptait une masse <strong>de</strong> députés-fonctionnaires<br />
soucieux uniquement <strong>de</strong> ne pas compromettre leur carrière administrative par <strong>de</strong>s<br />
votes susceptibles <strong>de</strong> contrarier la politique gouvernementale.<br />
Sur la question essentielle <strong>de</strong> I’élargissement du corps électoral, qui pro-<br />
voquera en 1848 la chute du régime, la plupart <strong>de</strong>s sensibilités politiques s’ac-<br />
cordaient sur la nécessité <strong>de</strong> prévoir une augmentation du nombre d’électeurs, y<br />
compris les légitimistes : les ultras <strong>de</strong> 18 16 n’avaient-ils pas proposé l’abaisse-<br />
ment du cens a cinquante francs ? Seuls, les amis <strong>de</strong> Saint-Marc Girardin, très<br />
puissants à la Chambre <strong>de</strong>s députés, y étaient radicalement opposés et apportaient<br />
comme unique réponse à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> plus en plus pressante <strong>de</strong> l’opinion<br />
publique les mots célèbres <strong>de</strong> Guizot : >, et vous <strong>de</strong>viendrez<br />
électeurs. Les orléanistes avaient peur qu’une augmentation du nombre <strong>de</strong>s élec-<br />
36. Rapport confi<strong>de</strong>ntiel adressé le I9 juillet I842 par le préfet <strong>de</strong> la Haute-Vienne au ministre <strong>de</strong><br />
I‘lntérieur au sujet <strong>de</strong>s Clections du 9juillet 1842. Arch. dép. Haute-Vienne, 3 M 131.
Suitit-Murt Gimrdin 57<br />
teurs ne favorise l’opposition. Guizot y était farouchement opposé et avait coutu-<br />
me <strong>de</strong> dire que soit la réforme électorale n’aurait pas <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> conséquence, et<br />
dans ce cas elle serait inutile, soit elle bouleverserait la composition <strong>de</strong> la<br />
Chambre <strong>de</strong>s députés ... ce qu’il fallait éviter ! Toutefois, si les électeurs passèrent<br />
effectivement, avec l’enrichissement du pays, <strong>de</strong> 168 000 au début <strong>de</strong>s années<br />
1830 ” à 240 000 à la veille <strong>de</strong> 1848, cela représentait peu <strong>de</strong> chose sur une popu-<br />
lation <strong>de</strong> 32 millions d’habitants désormais largement scolarisée et consciente <strong>de</strong><br />
ses droits. Ce nianque <strong>de</strong> ICgitimité sera fatal au régime.<br />
En attendant, les joutes parlementaires se poursuivaient, mais Saint-Marc<br />
Girardin,
58 Julien Sapori<br />
l’hémicycle en raison <strong>de</strong> son talent oratoire. I1 produisit une activité parlementai-<br />
re variée et soutenue pouvant se classer en quelques grands domaines ?<br />
1836, 1838 et 1839 ; <strong>de</strong>s crédits extraordinaires en 1837 et I844 ; <strong>de</strong>s Caisses<br />
d’épagne en 1835 et 1845, etc.) ;<br />
- les problèmes liés à la colonisation <strong>de</strong> l’Algérie (interventions au sujet<br />
<strong>de</strong>s troupes arabes irrégulières en 1837 ; <strong>de</strong> l’expédition en Kabylie en 1845 ; <strong>de</strong>s<br />
besoins religieux <strong>de</strong> l’armée d’Afrique en 1838 ; <strong>de</strong> l’administration civile en<br />
Algérie en 1845, etc.) ;<br />
- la question d’Orient (interventions au sujet <strong>de</strong> l’emprunt grec en 1837,<br />
1842, 1844, I847 ; du palais <strong>de</strong> France à Constantinople en 1843 ; du consulat à<br />
Belgra<strong>de</strong> en I837 ; <strong>de</strong>s affaires <strong>de</strong> la Grèce en 1846 ; <strong>de</strong>s persécutions contre les<br />
chrétiens d’Albanie en 1846, etc.) ;<br />
- la réforme <strong>de</strong> l’administration (interventions au sujet <strong>de</strong>s attributions <strong>de</strong>s<br />
conseils généraux et <strong>de</strong>s conseils d’arrondissement en 1837 ; <strong>de</strong>s conditions<br />
d’admission et d’avancement dans les emplois <strong>de</strong>s services publics en 1844 ; du<br />
projet <strong>de</strong> loi d’organisation du Conseil d’Etat en 1845, etc.) ;<br />
- l’instruction publique (interventions au sujet du projet <strong>de</strong> loi concernant<br />
l’instruction secondaire en 1837 ; du budget <strong>de</strong> l’Instruction publique en 1838 ;<br />
du traitement <strong>de</strong>s professeurs suppléés par <strong>de</strong>s agrégés en 1832 ; <strong>de</strong> la rétribution<br />
payée pour frais d’étu<strong>de</strong>s dans les collèges royaux en 1846 ; encore un projet <strong>de</strong><br />
loi sur la réforme <strong>de</strong> l’instruction secondaire en 1848, etc.).<br />
Son cursus personnel le préparait plus particulièrement à s’intéresser à ce<br />
<strong>de</strong>rnier domaine. Soucieux d’améliorer le niveau scolaire du pays et <strong>de</strong> dégager<br />
l’école <strong>de</strong> l’emprise ecclésiastique, le ministère <strong>de</strong> François Guizot parvint à<br />
accomplir une œuvre remarquable et injustement méconnue en matière d’ins-<br />
truction publique. En ce qui concerne plus particulièrement l’enseignement pri-<br />
maire, il obligea chaque commune, dès 1833, à entretenir une école primaire gra-<br />
tuite. Le résultat fut qu’en 1848, les <strong>de</strong>ux tiers <strong>de</strong>s conscrits franqais savaient lire,<br />
écrire et compter.<br />
Après ce premier chantier, GuiLot voulu s’attaquer à l’enseignement<br />
secondaire, déposant en janvier 1836 un projet <strong>de</strong> loi favorable à la liberté <strong>de</strong><br />
l’enseignement qui donnait satisfaction aux revendications du clergé tout en<br />
maintenant un droit <strong>de</strong> regard <strong>de</strong> 1’Etat sur le fonctionnement <strong>de</strong>s établissements<br />
scolaires tenus par <strong>de</strong>s religieux. Saint-Marc Girardin fut nommé rapporteur <strong>de</strong> la<br />
commission et il lut son rapport à la Chambre lors <strong>de</strong> la séance du 14 juin 1836.<br />
Gouvernement et commission se trouvaient d’accord sur la majorité <strong>de</strong>s points,<br />
sauf au sujet du statut <strong>de</strong>s petits séminaires : pour le gouvernement, ces établis-<br />
sements <strong>de</strong>vaient rester publics, pour Saint-Marc Girardin et la commission, ils<br />
<strong>de</strong>vaient <strong>de</strong>venir privés. La discussion occupa douze séances, du 14 au 29 mars<br />
1837, avec un rôle particulièrement actif <strong>de</strong> Saint-Marc Girardin.<br />
40. Tables nominatives pour les pCriodcs 1834- 1839, 1842- I848 et I87 1-1 873, Arch. Ass. nat
Mais le rapporteur connut son plus grand succès <strong>de</strong> tribune en défendant<br />
avec force le principe du maintien <strong>de</strong>s bourses dans les collèges communaux, que<br />
certains députds, M. Salverte et M. Prunelle en tete, voulaient supprimer au nom<br />
d’un certain libéralisme économique. Notons que la charge financière pour I’Etat<br />
était <strong>de</strong>s plus légères, le nombre <strong>de</strong>s boursiers concernés, sur tout le territoire<br />
national, étant à l’époque seulement <strong>de</strong> 117. Toutefois, ne nous y trompons pas,<br />
il ne s’agissait pas <strong>de</strong> ddfendre une politique <strong>de</strong> promotion sociale qui n’existait<br />
point, mais bel et bien d’un réflexe <strong>de</strong> solidarité <strong>de</strong> classe, comme Saint-Marc<br />
Girardin le déclarait lui-même tr2s clairement : > Sensible à cet argument, l’Assemblée maintint le système<br />
<strong>de</strong>s bourses.<br />
La loi fut finalement votée le 29 mars 1837, 2 une majorité <strong>de</strong> 29 voix seu-<br />
lement ; peine perdue, car le texte ne survécut guère au cabinet et, ne pouvant <strong>de</strong><br />
ce fait être examiné par la Chambre <strong>de</strong>s pairs, n’entra jamais en vigueur. Saint-<br />
Marc Girardin partagea donc avec le régime philippiste I’échec <strong>de</strong> ce vaste pro-<br />
jet <strong>de</strong> réforme <strong>de</strong> l’instruction publique secondaire qui <strong>de</strong>vint plus tard l’un <strong>de</strong>s<br />
chantiers les plus remarquables <strong>de</strong> la III‘ République.<br />
La monarchie <strong>de</strong> Juillet apparaissait comme un régime soli<strong>de</strong>. En réalité,<br />
il était miné par <strong>de</strong> graves dissensions internes opposant les <strong>de</strong>ux gran<strong>de</strong>s familles<br />
monarchistes, les légitimistes et les orléanistes. La crise se manifesta au grand<br />
jour en 1843, 2 l’occasion <strong>de</strong> ce qu’on appela (< l’affaire <strong>de</strong>s pèlerins <strong>de</strong> Belgrave-<br />
Square >>. Le duc <strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux, essayant <strong>de</strong> ranimer le parti légitimiste après la<br />
mort <strong>de</strong> Charles X, s’était rendu en visite li Londres, où un millier <strong>de</strong> manifestants<br />
français, conduits par Chateaubriand, l’avait acclamé du nom <strong>de</strong> roi <strong>de</strong>vant sa<br />
rési<strong>de</strong>nce, l’hBtel Belgrave-Square. Contrariée par ces débor<strong>de</strong>ments, la majorité<br />
orléaniste <strong>de</strong> la Chambre avait voulu voter la motion suivante : par (< réprouver >>, nioins infamant ;<br />
niais, finalement, cette gran<strong>de</strong> affaire se termina par le niainlien du premier<br />
terme. Saint-Marc Girardin fut <strong>de</strong>s députés qui avaient volé d’emblée en ce sens.<br />
Ce fut un régime usé par un immobilisme borné qui sombra soudainement<br />
en février 1848. Saint-Marc Girardin figura en qualité <strong>de</strong> ministre <strong>de</strong> l’Instruction<br />
publique dans le <strong>de</strong>rnier gouvernement projeté par le roi Louis-Philippe dans la<br />
41 . Disxx~ra <strong>de</strong> Saint-Marc Girardin i l’Assemblée, cité par T. Froment, Stririt-Mtirc Girtrrdiri pédagogire,<br />
p. cit., p. 32. Cet apologiste <strong>de</strong> Saint-Marc Girardin prend néanmoins IC soin <strong>de</strong> préciser<br />
dans soli commentaire : >
60 Jirlieri Sapori<br />
vaine tentative <strong>de</strong> faire face iì l’émeute“’. On écrira à son sujet qu’ayant été<br />
ministre durant vingt-quatre heures, il > ; car, N en France, c’est sur le pouvoir monarchique qu’il<br />
faut s’appuyer pour contenir et pour diriger la démocratie ““ D. Saint-Marc<br />
Girardin restait donc totalement imperméable aux gran<strong>de</strong>s aspirations démocra-<br />
tiques manifestées par le pays. On peut dire que, dès cette époque, il cessa d’être<br />
un conservateur pour <strong>de</strong>venir un réactionnaire, envisageant anachroniquement,<br />
comme seul aménagement institutionnel souhaitable, le renforcement <strong>de</strong>s pou-<br />
voirs dévolus au roi.<br />
En attendant la chute <strong>de</strong> la II‘ République, puis du Second Empire, Saint-<br />
Marc Girardin s’éloigna <strong>de</strong> la vie politique. Son ancien adversaire aux élections<br />
<strong>de</strong> 1839 et 1842, M. Jean-Charles Coralli, revint le 23 avril 1848 au Palais-<br />
Bourbon comme représentant <strong>de</strong> la Haute-Vienne et fut encore réélu à<br />
l’Assemblée législative le 13 mai 1849, prenant place parini les rCpublicains<br />
modérés.<br />
Lors du coup d’Etat du 2 décembre I85 1, Thiers, chef <strong>de</strong> file <strong>de</strong>s orléa-<br />
nistes, fut arrêté au petit matin dans sa maison puis conduit à la frontière. Au total,<br />
5 représentants <strong>de</strong> l’Assemblée furent condamnés à la déportation, 65 expulsés du<br />
pays et 18 éloignés <strong>de</strong> France, sans compter le Dr Baudin, tué sur une barrica<strong>de</strong>.<br />
Le nouveau régime ne fit pas preuve <strong>de</strong> tolérance avec les opposants ; mais Saint-<br />
Marc Girardin ne fut guère inquiété, car la police impériale savait qu’il n’y avait<br />
rien h craindre <strong>de</strong> ce notable qui, à 25 ans déjh, clamait : (< En politique, soyez<br />
42. A cette occasion, Saint-Marc Girardin aurait-il repu le titre <strong>de</strong> cointe ? C’est ce que déclare le<br />
Dic.tioiirirrire /?io
ourgeois, car vous n’aurez ni déclamations révolutionnaires ni superstitions<br />
royalistes 45! >> Et, en effet, après l’instauration du régime impérial, Saint-Marc<br />
Girardin persista certes dans sa fidélité à la monarchie philippiste, mais sans pour<br />
autant s’cngager dans une opposition résolue et dangereuse à la manière d’un<br />
autre Immortel qu’il avait croisé et mkprisé quai <strong>de</strong> Conti, Victor Hugo. C’est<br />
ainsi qu’il poursuivit sans difficultés particulières sa collaboration avec Le<br />
Journal <strong>de</strong>s <strong>de</strong>‘bats. ><br />
Une fois seulement, Saint-Marc Girardin connut <strong>de</strong>s difficultés avec la<br />
censure impériale, pour <strong>de</strong>s propos au <strong>de</strong>meurant assez anodins. >, prési<strong>de</strong>nt du Sénat, >, écrivait-il dans Le Journal <strong>de</strong>s débats ;<br />
Avec ces propos ampoulés et circonspects, Saint-<br />
Marc Girardin était allé au bout <strong>de</strong> ce que la pru<strong>de</strong>nce et les convenances pou-<br />
vaient lui permettre. Le Jour-r~al <strong>de</strong>s cke‘1xif.s fit l’objet d’un avertissement et notre<br />
pamphlétaire ne renouvellera plus son ). Dès lors, les ministres du<br />
Second Empire, inoins bienveillants que ceux <strong>de</strong> Charles X, n’auront plus à se<br />
plaindre <strong>de</strong> lui.<br />
Cette attitu<strong>de</strong> précautionneuse lui permit <strong>de</strong> conserver la plupart <strong>de</strong>s avan-<br />
tages obtenus sous le régime précé<strong>de</strong>nt. Ainsi, non seulement il resta membre du<br />
conseil <strong>de</strong> l’instruction publique, mais il poursuivit également ses cours à la<br />
faculté <strong>de</strong> lettres, contrairement à d’autres professeurs <strong>de</strong> l’Université, tels<br />
Guizot, Michelet et Victor Cousin qui, certainement moins (< souples >>, furent<br />
révoqués. Rappelons que le régime impérial avait véritablement ><br />
l’université, contraignant les enseignants à assister 2 la messe du Saint-Esprit le<br />
jour <strong>de</strong> la rentrée et interdisant le port <strong>de</strong> la barbe, considéré comme le . Ces faits furent
62 Julien Strpori<br />
portés à la connaissance du ministre <strong>de</strong> l’Instruction publique qui somma Saint-<br />
Marc Girardin <strong>de</strong> s’expliquer. Le professeur répondit par une lettre compliquée et<br />
bavar<strong>de</strong>, dans laquelle il concluait que >. Le gouvernement impérial fut rassuré par la lâcheté <strong>de</strong><br />
la réponse et ne sanctionna pas le professeur pour cette peccadille.<br />
Du reste, dans le cadre <strong>de</strong> son enseignement, Saint-Marc Girardin <strong>de</strong>meurait<br />
un ferme partisan du parti <strong>de</strong> l’ordre >>. S’il se trouvait en désaccord avec le<br />
Second Empire, ce n’était pas en raison <strong>de</strong> sa politique autoritaire, mais bien<br />
davantage a cause <strong>de</strong> certains aspects > <strong>de</strong> ce régime qui, en recou-<br />
rant au plébiscite, donnait la parole aux couches populaires - les ,<br />
<strong>de</strong>venant le défenseur <strong>de</strong>s chrétiens d’Europe orientale et d’Asie Mineure persé-<br />
cutés par les Turcs. I1 effectua ainsi plusieurs voyages sur les lieux, entretenant<br />
par la suite <strong>de</strong>s contacts épistolaires avec certains ressortissants <strong>de</strong> ccs pays, et<br />
publia ses réflexions dans plusieurs ouvrages parus entre I852 et 1862. La solu-<br />
tion qu’il préconisait était très pru<strong>de</strong>nte et refusait pour ces peuples I’indépen-<br />
dance complète, mais également l’égalité <strong>de</strong> droits politiques et civils dans le<br />
cadre d’un Empire ottoman rénové. Saint-Marc Girardin envisageait une solution<br />
plus conforme à ce qu’il appelait >, à savoir la recon-<br />
naissance légale <strong>de</strong>s diverses nationalités composant cet empire, avec <strong>de</strong>s statuts<br />
et privilèges particuliers pour chacune, garantis par <strong>de</strong>s traités signés avec les<br />
puissances étrangères. Ces idées étaient incontestablement généreuses, mais dans<br />
ce domaine comme dans tous les autres, Saint-Marc Girardin se montrait inca-<br />
pable d’être ) et d’envisager la création <strong>de</strong>s futurs Etats indépen-<br />
dants <strong>de</strong> Bulgarie, Serbie, Albanie et, plus tard, du Moyen-Orient.<br />
Toujours partiellement désœuvré, il entama également, à partir <strong>de</strong> 1869,<br />
une collaboration avec Le Jour-iinl <strong>de</strong>s s~ivmrzfs<br />
oh il remplaça Sainte-Beuve.<br />
Le 1” juin 1863, il essaya un retour en politique, mais échoua conime can-<br />
didat indépendant au Corps législatif dans la 2“ circonscription <strong>de</strong> la Haute-<br />
Vienne, réunissant seulement 3 255 voix contre les 25 41 1 du candidat officiel,<br />
M. Adrien Calley-Saint-Paul ”. La comparaison avec les élections <strong>de</strong> l’époque <strong>de</strong><br />
47. Sirir7t-Morc~ Girrri.rlirr pc;rltr,yofiire, op. cif., p. 41-43.<br />
48. Adrien Calley-Saint-Paul (1808-1 873). banquier, gendre du physicien Gay-Lussac, joua un rAle<br />
assez important dans la vie politique du Second Empire ; caractkre indépendant, il fut un dcs rares<br />
dépoté5 qui ne vota pas la déclaration <strong>de</strong> guerre <strong>de</strong> 1870.
Srrint-Mtrrc Ginrrtliri 63<br />
la monarchie <strong>de</strong> Juillet était édifiante : le corps électoral avait été multiplié par<br />
100/150, et on imagine facilement notre académicien mal à l’aise au contact <strong>de</strong><br />
ces nouveaux électeurs à qui il déniait le droit <strong>de</strong> vote quelques années aupara-<br />
vant.<br />
Faute <strong>de</strong> pouvoir relancer sa carrière politique, il participa avec Ernest<br />
Legouvé, Odilon Barrot, Edgar Laboulaye, Frédéric <strong>de</strong> Lesseps et d’autres à la<br />
tenue <strong>de</strong> conférences littéraires à la salle Barthélémy sur les Champs-Elysées. Le<br />
but officiel était <strong>de</strong> manifester la solidarité <strong>de</strong> l’opinion publique française avec<br />
les patriotes polonais, opprimés par le régime tsariste ; mais, en réalité, ces oppo-<br />
sants, réduits jusque-là au silence, souhaitaient contourner les interdictions du<br />
régime impérial et, en se donnant l’occasion <strong>de</strong> se compter, exprimer leurs opi-<br />
nions dissi<strong>de</strong>ntes.<br />
Saint-Marc Girardin fut notamment chargé du discours d’ouverture, véri-<br />
table performance <strong>de</strong> pru<strong>de</strong>nce rhétorique. Ecoutons-le : I1 termi-<br />
nait par une pique très discrète au régime impérial : > Toujours satisfait <strong>de</strong> lui-même, Saint-Marc Girardin<br />
<strong>de</strong>meurait incapable <strong>de</strong> comprendre que l’opinion publique <strong>de</strong>mandait désormais<br />
aux hommes politiques <strong>de</strong>s idées et <strong>de</strong>s engagements, et pas seulement <strong>de</strong>s<br />
finesses oratoires.<br />
Son retour aux affaires<br />
><br />
Après la défaite militaire <strong>de</strong> 1870, les débats, lors <strong>de</strong>s élections départe-<br />
mentales <strong>de</strong>s députés à l’Assemblée nationale, ne portaient que sur un seul point :<br />
doit-on, oui ou non, traiter avec la Prusse ? La population française, dans sa gran-<br />
<strong>de</strong> majorité, était lasse <strong>de</strong> la guerre et, les républicains incarnant la résistance à<br />
49. Discours <strong>de</strong> Saint-Marc Girardin dans Co/?firerrces liuéroires <strong>de</strong> /o stille Barrhé/Pm.v, Paris,<br />
Librairie académique, 1864, p. 2-9.<br />
50. Karl Marx, Le 18 Brumaire <strong>de</strong> Lork Bori~~pt~r/e, Paris, Editions SocialeslMéssidor, 1984, p. 69.
64 Julien Snpori<br />
l’ennemi, les électeurs firent un triomphe aux candidats royalistes. Orléanistes et<br />
légitimistes revinrent donc en force à l’Assemblée, convaincus que la restauration<br />
du roi était désormais imminente.<br />
C’est dans ce contexte que Saint-Marc Girardin fut élu B l’Assemblée<br />
nationale, le 2 février 1871, en qualité <strong>de</strong> représentant <strong>de</strong> la Haute-Vienne, pre-<br />
mier sur une liste comportant sept candidats
Mêlant sa voix iì celles <strong>de</strong> la droite la plus extrême, il vota successivement<br />
et <strong>de</strong> faqon très significative :<br />
- pour la paix avec l’Allemagne victorieuse ;<br />
- pour les prières publiques en > <strong>de</strong> la défaite ;<br />
- pour l’abrogation <strong>de</strong>s lois d’exil visant la Maison <strong>de</strong> France, afin <strong>de</strong> permettre<br />
aux candidats au trhe <strong>de</strong> rentrer en France ;<br />
- pour le pouvoir constituant <strong>de</strong> l’Assemblée, contre la dissolution et<br />
I’élection d’une assemblée constituante.<br />
Inquiets <strong>de</strong> la montée en puissance <strong>de</strong>s <br />
Les membres <strong>de</strong> la délégation tirent connaître leur déception dès le len<strong>de</strong>-<br />
main par un communiqué solennel qui n’obtint pas l’effet escompté, l’opinion<br />
publique trouvant la réponse <strong>de</strong> Thiers particulièrement amusante. De nombreux<br />
pamphlétaires se souvinrent d’une délégation similaire, datant <strong>de</strong> 1848, qui avait<br />
dijh sombré dans la risée : à l’époque, ces personnages compassés avaient été<br />
traités <strong>de</strong> > ou encore <strong>de</strong> >, en référence aux couvre-<br />
chefs <strong>de</strong> la gar<strong>de</strong> nationale. Car, à la veille d’une insurrection, Charles X s’était<br />
exclamé: ; la suite est connue ... Cette <strong>de</strong>rnière appellation eut<br />
un succès particulier et, dès lors, les membres <strong>de</strong> la délégation reque par Thiers<br />
<strong>de</strong>vinrent <strong>de</strong>s >. Comble <strong>de</strong> la honte, Le Jourtztrl <strong>de</strong>s tlklxits, qui<br />
<strong>de</strong>puis peu avait échappé à la direction <strong>de</strong> la dynastie Bertin, évoluait désormais<br />
vers <strong>de</strong>s positions moins archaïques et s’associa iì l’hallali, poussant Saint-Marc<br />
Girardin, dès le 28 juin, à mettre fin h quarante-cinq ans <strong>de</strong> collaboration. I1 entra<br />
aussitôt au Jourtiti1 <strong>de</strong> Prrris, beaucoup plus conservateur.<br />
Désormais, un grand nombre d’orléanistes était prêt à accepter le principe<br />
que la restauration monarchique ne se ferait pas tout <strong>de</strong> suite ; et, en attendant le<br />
décès du comte <strong>de</strong> Chambord, qui débloquerait la situation, il fallait bien > le nouveau régime, car la nature a horreur du vi<strong>de</strong>. Mais les radicaux,<br />
encouragés par I’évolution <strong>de</strong> l’opinion publique, <strong>de</strong>venaient exigeants et se<br />
méfiaient à présent <strong>de</strong> ces > Pour sa part, le quotidien<br />
La Rkpubliqrie Fratipise s’en réjouit :
effet, comme cela est possible, <strong>de</strong> mettre en déroute M. <strong>de</strong> Broglie et M. Saint-<br />
Marc Girardin, et tous les meneurs <strong>de</strong> la droite et du centre droit qui allaient se<br />
rallier à la République et même la proclamer et la constituer à leur façon en ren-<br />
trant à Versailles le mois prochain [...I, le discours <strong>de</strong> Grenoble est un coup <strong>de</strong><br />
maître ! >><br />
Toutefois, les débats politiques restaient dominés par le problème <strong>de</strong> la<br />
défaite et <strong>de</strong> ses conséquences pour le pays. En février 1873, Saint-Marc Girardin<br />
remit un rapport, considéré comme très partial, sur le fonctionnement du gouver-<br />
nement <strong>de</strong> la Défense nationale, qu’il accusait d’avoir mal dirigé les opérations<br />
militaires. Le principal mis en cause, le général Trochu, se défendit en publiant<br />
un ouvrage dans lequel il récusait les griefs et accusait <strong>de</strong> partialité la commis-<br />
sion d’enquête 52.<br />
La même année, le <strong>de</strong>rnier soldat prussien quitta le territoire français.<br />
Fallait-il adresser <strong>de</strong>s félicitations solennelles à M. Thiers pour I’œuvre accom-<br />
plie ? La droite hésitait, car cet homme était en train <strong>de</strong> bitir la république ...<br />
Saint-Marc-Girardin monta à la tribune et proposa le texte suivant :<br />
(c L‘Assemblée [...I heureuse d’avoir ainsi accompli une part essentielle <strong>de</strong> sa<br />
tiche [...I vote <strong>de</strong>s remerciements solennels à M. Thiers, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la<br />
République, et au gouvernement 57. >> Ce fut l’une <strong>de</strong> ses <strong>de</strong>rnières interventions<br />
politiques, que Daniel Halévy commente ainsi : Saint-Marc Girardin proposa ce<br />
texte c< sans adresse, en une conjoncture oÙ il en fallait beaucoup >> ; il n’accueillit<br />
que cc murmures et rires à gauche : l’Assemblée se félicitant elle-même, belle<br />
trouvaille ”! >> Finalement, Thiers fut acclamé, conformément à la motion, mais<br />
la droite conservatrice fut discréditée une fois <strong>de</strong> plus.<br />
Saint-Marc Girardin présidait la Chambre le jour où M. Buffet fut élu pré-<br />
si<strong>de</strong>nt en remplacement <strong>de</strong> M. Grévy, prélu<strong>de</strong> au renversement <strong>de</strong> Thiers.<br />
Toutefois, il ne put guère goûter sa victoire, car il mourut d’une attaque d’apo-<br />
plexie le 11 avril 1873, pendant les vacances parlementaires. Voici le récit <strong>de</strong> sa<br />
mort fait par la presse <strong>locale</strong> 55:<br />
Kc+iihliqiie, Paris, La Librairie Contemporaine,<br />
sins date, p. 6 1 1.<br />
54. Daniel Halévy, Lnfiii <strong>de</strong>s nofaDle.s, Paris, Bernard Grasset. coll. Livre <strong>de</strong> Poche, 1972, p. 21 2 et<br />
213.<br />
55. Le Voleur du 25 avril 1873, article signé A. <strong>de</strong> B.
il était heureux <strong>de</strong> se réfugier pour se délasser <strong>de</strong> ses fatigues et <strong>de</strong> ses tra-<br />
vaux. Jeudi matin, après une promena<strong>de</strong> dans son parc, il était rentré fati-<br />
gué, et on avait dû le porter jusque duns sa chambre. I1 venait <strong>de</strong> se mettre<br />
au lit, et on avait dit au jardinier qu’il se sentait frappé à mort, lorsque<br />
Madame Saint-Marc Girardin, arrivant <strong>de</strong> Paris, le trouva déjà atteint <strong>de</strong> ce<br />
mal terrible, l’apoplexie. n<br />
Sa famille et son fils, Barthélemy Saint-Marc-Girardin<br />
La première femme <strong>de</strong> Saint-Marc Girardin, nCe Thierret, se noya dans la<br />
Seine en août 1836 ou 1837, à l’âge <strong>de</strong> 21 ans. Elle lui laissa une petite fille <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ux ans, qui mourut bient6t. L‘acadCmicicn se remaria en secon<strong>de</strong> noces avec sa<br />
belle-sœur, Lucile Caroline Thierret ( 18 16- 1874). Ces <strong>de</strong>ux mariages lui appor-<br />
tèrent non seulement la magnifique propriété <strong>de</strong> Morsang-sur-Seine ”, qui avait<br />
appartenu au grand-phre <strong>de</strong> sa femme, mais également <strong>de</strong> nouvelles et soli<strong>de</strong>s<br />
alliances dans le mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> la politique et <strong>de</strong> l’administration ”. Le couple eut<br />
trois enfants : Charles, l’aîné, qui à son tour se noya dans I’Yères en septembre<br />
1859, iì 1’2ge <strong>de</strong> 2 1 ans, Louise, qui <strong>de</strong>viendra Madame Barbier (1843- 1922), et<br />
un garçon, Barthélémy, né iì Paris le 1 O janvier 1847.<br />
Ce <strong>de</strong>rnier peut être considéré coniine le véritable héritier spirituel <strong>de</strong> son<br />
pitre : il partageait ses opinions politiques, et nous allons voir que son échec aux<br />
élections consacrera en quelques sorte la mort <strong>de</strong>s idéaux orléanistes <strong>de</strong> l’acadé-<br />
micien. Barthélémy hérita Cgalemenl <strong>de</strong> la volumineuse bibliothèque qui rem-<br />
plissait cinq pièces au <strong>de</strong>uxième érage <strong>de</strong> la villa <strong>de</strong> Morsang-sur-Seine et qui,<br />
actuellement, se trouve déposée à la Société historique <strong>de</strong> Soissons, suite au don<br />
fait par sa fille Amelie, épouse André Cosset ; il la conserva sa vie durant et,<br />
comme l’attestent <strong>de</strong> nombreuses dédicaces, l’augmenta.<br />
Luc-Barthélémy Saint-Marc Girardin, licencié en droit, simple gar<strong>de</strong> mobi-<br />
le durant la guerre <strong>de</strong> 1870, fut attaché a par faveur D à l’étal-major <strong>de</strong> l’Empereur<br />
au camp <strong>de</strong> Châlons, puis à celui du maréchal Bazaine, ce qui prouve au moins<br />
que son père savait entretenir <strong>de</strong>s relations fort utiles avec ses adversaires poli-<br />
tiques. Prisonnier <strong>de</strong>s Allemands à Bonn, il ne fut libéré qu’A l’armistice.<br />
56. Une <strong>de</strong>s sœurs <strong>de</strong> Mme Lucile Saint-Marc Girardin s’étail mariée avec M. Marchand-Dubreuil,<br />
sous-préfet : le jour du mariage, a la rortie <strong>de</strong> la mairie. lors <strong>de</strong> I‘inwrrection <strong>de</strong> Barbès <strong>de</strong> mai 183-9.<br />
l‘époux prit son fusil et marcha contre les éineutiers ; par la suite, il oublia <strong>de</strong> décharger son arme et<br />
le len<strong>de</strong>main. au moment <strong>de</strong> s’habiller pour la c6rémonie B I’église. il se tua acci<strong>de</strong>ntellement d‘une<br />
mauvaise manipulation.<br />
57. La propriété, constituée d‘une vaste miiisoii entourée d’un parc magnifique. existe encore <strong>de</strong> nos<br />
jours.<br />
58. M. Thierret, le grand-père <strong>de</strong> Mme Sain-Marc Girardin, avait un íils avoué et maire du lo‘<br />
arrondissement <strong>de</strong> Paris sous la monarchie <strong>de</strong> Juillet. La famille Thierret, fervente orléaniste, conil)tait<br />
plusieurs membres au Conseil d’Etat.
Nous avons vu qu’après I’écroulement du Second Empire, Saint-Marc<br />
Girardin renoua rapi<strong>de</strong>ment avec les plaisirs et les avantages du pouvoir. Qu’il<br />
était loin le bel esprit >> qui, en 1830, ironisait sur les quéman<strong>de</strong>urs, les > soucieux <strong>de</strong> profiter <strong>de</strong>s places offertes par le nouveau régime ! Car c’est<br />
grâce à l’intervention <strong>de</strong> son père que Barthélémy fut nommé sous-préfet le<br />
25 avril 187 1 ; et, pour lui éviter les désagréments d’un déménagement, le dépu-<br />
té, nouvellement élu et disposant dc soli<strong>de</strong>s relations, s’arrangea pour que son<br />
enfant soit nommé Corbeil, dans le département oÙ <strong>de</strong>meurait la famille Saint-<br />
Marc Girardin. Toutefois, reconnaissons qu’il ne s’agissait pas d’une sinécure,<br />
car au même moment la capitale toute proche vivait les heures les plus terribles<br />
<strong>de</strong> la Commune.<br />
En 1873, Barthélémy Saint-Marc Girardin démissionna <strong>de</strong> son poste <strong>de</strong><br />
sous-préfet et essaya <strong>de</strong> briguer le siège précé<strong>de</strong>mment occupé par son père à<br />
l’Assemblée nationale. L‘affaire se présentait favorablement : rappelons qu’en<br />
187 1, Saint-Marc Girardin avait gagné les élections avec une avance confortable,<br />
réunissant environ le triple <strong>de</strong>s voix <strong>de</strong> son adversaire, le républicain Georges<br />
Périn.<br />
La campagne mobilisa les électeurs sur <strong>de</strong>s thèmes <strong>de</strong> portée nationale et<br />
illustra parfaitement l’évolution <strong>de</strong> l’opinion publique à cette époque. C’est ainsi<br />
que, dans une première affiche électorale, le > écri-<br />
vait : (( La candidature <strong>de</strong> M. Saint-Marc Girardin signifie : plus <strong>de</strong> révolutions<br />
désastreuses, maintien d’un gouvernement honnête et fort [...I ; la candidature <strong>de</strong><br />
M. Périn signifie : République Progressive et Radicale >>. Voilà <strong>de</strong>s mots d’ordre<br />
clairs ! Mais la situation se brouilla et, rapi<strong>de</strong>ment, les > chan-<br />
gèrent d’avis, prenant acte <strong>de</strong> l’affermissement <strong>de</strong>s institutions républicaines,<br />
désormais crédibles et efficaces. Paradoxalement, les conservateurs étaient à pré-<br />
sent perçus comme <strong>de</strong>s personnes dangereuses, voulant une fois <strong>de</strong> plus contes-<br />
ter la légitimité <strong>de</strong>s institutions en place afin <strong>de</strong> pouvoir lancer le pays dans une<br />
restauration royaliste aussi aventureuse qu’aléatoire. Le Comité libkral conserva-<br />
teur, sentant l’approche du danger, fit paraître une nouvelle affiche, qui sonnait<br />
comme un véritable appel au secours :
essuyé plusieurs condamnations. Inscrit ii l’Union républicaine, il siégea à I’ex-<br />
trême gauche ; il rompit radicalement avec la politique <strong>de</strong> son prédécesseur,<br />
votant très symboliquement contre l’admission à titre définitif <strong>de</strong>s princes<br />
d’Orléans dans l’armée.<br />
Après cet échec électoral, Barthélémy Saint-Marc Girardin <strong>de</strong>vint chef du<br />
cabinet <strong>de</strong> M. le général baron <strong>de</strong> Chabaud La Tour, ministre <strong>de</strong> l’Intérieur, jus-<br />
qu’en 1874, puis chef <strong>de</strong> cabinet du duc d' Audifii-et-Pasquier, prési<strong>de</strong>nt du Sénat.<br />
11 fut également élu au conseil général <strong>de</strong> la Haute-Vienne pour le canton <strong>de</strong><br />
Saint-Geriiiain-les-Belles. En 1880, il perdit toutes ses fonctions administratives<br />
et politiques. Désormais mis à I’écart <strong>de</strong> la vie publique, il <strong>de</strong>meura l’un <strong>de</strong>s prin-<br />
cipaux collaborateurs du journal Le Soleil dirigé par Edouard Hervé, et <strong>de</strong>vint<br />
également prési<strong>de</strong>nt du Comice agricole. Par le biais <strong>de</strong> la famille <strong>de</strong> sa femme,<br />
O<strong>de</strong>tte Gueneau <strong>de</strong> Mussy (1854-1933), fille du mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong> la Maison <strong>de</strong><br />
France h”, il put approcher le comte <strong>de</strong> Paris avec lequel il entretint <strong>de</strong>s contacts<br />
épistolaires. Après avoir échoué une <strong>de</strong>uxième fois aux élections <strong>de</strong> 1889, il ven-<br />
dit la maison du Picq et acheta le chliteau <strong>de</strong> Douilhac à Saint-Yrieix-la-Perche<br />
(Haute-Vienne), que ses héritiers conserveront longtemps. I1 décéda dans la mai-<br />
son <strong>de</strong> sa belle-famille, à Valesuire dans le Var, le 20 mars 1891, atteint <strong>de</strong> la<br />
tuberculose, laissant sa veuve seule avec cinq enfants.<br />
Marginalisé au plan politique, Barthélemy avait évolué du monarchisme<br />
libéral/autoritaire <strong>de</strong> son père vers une conception <strong>de</strong> la royauté à la fois plus<br />
intransigeante et religieuse. C’est ainsi que, le 29 janvier 1888, il avait tenu une<br />
conférence à Limoges dans laquelle il avait attaqué très sévèrement la République<br />
qu’il rendait responsable <strong>de</strong> tous les maux dont souffrait le pays. A cette occasion,<br />
tout en prétendant assumer l’héritage politique <strong>de</strong> son père, il n’avait pas hésité à<br />
se déclarer fermement hostile 2 l’école publique, que l’académicien avait pour-<br />
tant défendue sa vie durant. Voici le tableau idyllique qu’il dressait <strong>de</strong>s écoles pri-<br />
maires d’autrefois, celles d’avant la loi GuiLot <strong>de</strong> 1833 :
7 o Jidicvi Sapori<br />
chantier par Jules Ferry entre I879 et I88 I , étaient en totale contradiction avec<br />
les principes énoncés par le candidat Barthélemy Saint-Marc Girardin dans sa<br />
déclaration <strong>de</strong> foi publiée lors <strong>de</strong>s élections du 11 mai 1874, qui annonçait sa<br />
volonté <strong>de</strong> I1 présageait que sa fortune, ses propriété\, ses relations et son<br />
Saint-Marc Girardin 71<br />
Fig. 3 : Famille <strong>de</strong> Saint-Marc Girardin.<br />
Cette photographie prise en 1883, aimablement mise à notre disposition par M. Dominique Ballif, représente la famille<br />
Saint-Marc Girardin. De gauche a droite : Barthklt5my Saint-Marc Girardin avec son enfant, Louise, dans les bras ;<br />
Madame Clhence Gdneau <strong>de</strong> Mussy, helle-mbre <strong>de</strong> Barth6ldmy ; le docteur Guéneau <strong>de</strong> Mussy ;<br />
Lucile, première fille <strong>de</strong> Barth6Kmy ; O<strong>de</strong>tte Guheau <strong>de</strong> Mussy, 6pouse <strong>de</strong> Barth6lemy : son enfant Henri ;<br />
assise sur les marches, la <strong>de</strong>uxibme fille <strong>de</strong> Barth6Mmy. Amklie, qui <strong>de</strong>viendra Madame Gosset et qui fera don<br />
<strong>de</strong> la bihliotkque <strong>de</strong> son grand-@= à la SociW historique <strong>de</strong> Soissons.<br />
Bilan d’une vie<br />
Illustration parfaite d’une certaine > pré-capitaliste,<br />
Saint-Marc Girardin en avait suivi toutes les étapes, <strong>de</strong>puis son émancipation<br />
avec la révolution <strong>de</strong> 1789, sa marginalisation relative pendant la Restauration, et<br />
finalement son apothéose lors <strong>de</strong> la monarchie <strong>de</strong> Juillet, suivie d’une lente<br />
extinction à l’avènement <strong>de</strong> la III’ République. Trop souvent décrit comme un<br />
, Louis-Philippe avait en réalité fondé son pouvoir sur les<br />
>, ceux que Daniel Halévy appellera les
72 Julien Siipori<br />
Si certains orléanistes, et en premier lieu ><br />
A vrai dire, il ne semble pas avoir marqué davantage ses contemporains :<br />
><br />
Toutefois, en dépit d’une médiocrité avérée, cet homme a incontestable-<br />
ment connu <strong>de</strong> son vivant une certaine réussite qui, à défaut d’être glorieuse, a<br />
certainement été confortable. En l’absence <strong>de</strong> tout talent, quelle a été la clé <strong>de</strong> son<br />
succès ? I1 était certainement travailleur et opiniiìtre, ce que nous confirme le Dr<br />
Véron : <br />
nous semble se situer dans un domaine où il montra incontestablement <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s<br />
capacités, à savoir la maîtrise <strong>de</strong>s relations. A chaque tournant <strong>de</strong> sa carrière lit-<br />
téraire, journalistique, administrative ou politique, Saint-Marc Girardin sut utili-<br />
ser habilement ses appuis pour obtenir satisfaction : Ià, résidait son véritable<br />
génie. I1 avait mis en place les prémisses <strong>de</strong> ce réseau redoutable alors qu’il était<br />
encore un jeune élève au lycée Henri-IV, constituant avec ses amis <strong>de</strong> Sacy, <strong>de</strong><br />
Jussieu et Doudan une sorte <strong>de</strong> vouée à la conquête <strong>de</strong>s places, fonc-<br />
tions et honneurs. Puis, il sut étoffer son réseau grâce à ses <strong>de</strong>ux mariages suc-<br />
cessifs avec <strong>de</strong>s jeunes filles d‘une famille riche et influente, les Thierret, et le<br />
compléter par son allégeance à <strong>de</strong>s personnages clé <strong>de</strong> la monarchie <strong>de</strong> Juillet,<br />
François Guizot et le duc <strong>de</strong> Broglie. Lui et ses amis <strong>de</strong> lycée auraient pu figurer<br />
parmi les acteurs <strong>de</strong> la pièce La Foire crirxplaces, jouée dans les théâtres parisiens<br />
vers 1830, chantant tous en chœur: ><br />
61. Joseph Esintnard (1769-1 8 1 I). Ce pokte s’élai1 fuit connaître non seulelnent pour ses vers particulièrement<br />
manitrds et creux, mais égalenient par son opporlunisnie politique : après avoir soutenu<br />
lea Bourbons, il tcrivit <strong>de</strong> nombrcux ouvrages (( <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> )> en l’honneur <strong>de</strong> Napolton, qui<br />
lui valurent <strong>de</strong>s places très lucratives dans l’Administration<br />
64. Stendhal. Lircien Leir~~i, op. ci/., fragment <strong>de</strong> l’auteur cite dans l’appendice <strong>de</strong> l’ouvrage. p.<br />
518.<br />
65. E. <strong>de</strong> Mirecourt, Les c~J//~~,/~//J~Jr[/i/?.\ : &riiit-Mi/rc Gireirditi, (I/). c.;!.. p. 30. Notons que ce conimentaire<br />
date <strong>de</strong> 1857 : Lr.s DPhtir.s était IC ternie courant h l’époque pour désigner Le Jorir/iti/ <strong>de</strong>s<br />
riélms.<br />
66. Dr Louis Véron. M&oire.s d’un horo-geoi., <strong>de</strong> krri,s, Paris, Librairie Nouvelle, 1856. t. 111, p. 53.
Striiir-Mtrrc Gircir-din 73<br />
Si son œuvre littéraire, au <strong>de</strong>meurant médiocre et limitée, a été rapi<strong>de</strong>ment<br />
oubliée, c’est l’homme politique qui a été remarqué. Mais reconnaissons qu’il<br />
n’est pas très flatteur <strong>de</strong> retenir l’attention <strong>de</strong> l’opinion publique pour avoir été<br />
l’un <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rniers opposant aux idéaux démocratiques, un >, un<br />
votre vie bouillira doucement comme un pot-au-feu ! 7’ >> Ce faisant, il s’est i<strong>de</strong>n-<br />
tifïé jusqu’au risible avec ce régime philippiste, égoïste et étriqué, que<br />
Chateaubriand appelait c le pot-au-feu d’une monarchie domestique 72 >> !<br />
Julien SAPORI
BIBLIOGRAPHIE DE M. SAINT-MARC GIRARDIN<br />
Eloge <strong>de</strong> Leserge, 1822.<br />
Eloge <strong>de</strong> Bossilet, 1827.<br />
fiil<strong>de</strong>cru <strong>de</strong> Ici li~téreitirre fruiiGwise crir XVI' siMe, suivi <strong>de</strong> Etu<strong>de</strong>s .siir le Moyeii<br />
Age, 1 vol., Paris, Firmin-Didot Père et Fils, 1829.<br />
Notices politiques et littéruires sur 1 'Allemigiie, Paris, Prévost-Crocius, 1835.<br />
SoirLwiirs <strong>de</strong> i~yciges et d'étiules, Paris, Aymot, 1852.<br />
Rcipprts sur I 'instruction iiiterinédiciire erz Alleniqiie, 1835- I 838, 2 parties.<br />
Coiirs <strong>de</strong> littr'rcitiire drcrmcitiyiie, 011 <strong>de</strong> I 'usrige <strong>de</strong>s pLr.s.sion.s dciiis le tlrcrine, 4 vol.,<br />
Paris, Charpentier, 1843 et suiv.<br />
Eloge fuiit.ln-e <strong>de</strong> M. Ccrmpenon, discours prononcé le 16 janvier 1845 2<br />
l'Académie française.<br />
Préface <strong>de</strong> l'ouvrage d'Edoiiard Gans, Histoire dir rltriit <strong>de</strong> .succession et] Frmce<br />
au Moyen Age, traduction franqaise <strong>de</strong> L. <strong>de</strong> Lonienie, Paris, Moquet, 1845.<br />
Essciis <strong>de</strong> littérciture et <strong>de</strong> niorcile, 1845.<br />
De I 'instrirctioii interinédierire et <strong>de</strong> ses rtrpports trvec l'iiistrirc~tioii secoiidaire,<br />
Paris, Imprimerie et librairie classique <strong>de</strong> Jules Delalain, 1847.<br />
Souvenirs et réj1eJ-ions d'im Jouriirrliste, recueil d'arlicles, suivi d'une étu<strong>de</strong> politique<br />
datée <strong>de</strong> 185 1 intitulée Mird7e~iii. Loiris XVI. Meir-ie-Antoiriette, ou <strong>de</strong>s origiries<br />
et (les o1xtiicIcJs dir goirivriienieiit r-eprr'seiitcit[f eri Frtiric.e oii 1789, Paris,<br />
Michel-Lévy Frères, 1858.<br />
Du dkret du 24 noivnihre 1860 oci <strong>de</strong> lei r@")riiie <strong>de</strong> lu Coiistitirtioii <strong>de</strong> 1852,<br />
Paris, Lévy, 1860.<br />
Des tiwitc;s <strong>de</strong> coiiiiiieire d'cipr2.y Ici Coiistitirtioii <strong>de</strong> 1852, Paris, Charpentier,<br />
1860.<br />
De Ici sitiicitioii cle ILI Pqxiiitr' (ILI premier jmvier 1860, Paris, Charpentier, 1860.<br />
Lcr Sj,rie en 1861, Paris, Librairie académique Didier et Cie, 1862.<br />
De l'cipologite et <strong>de</strong> Itr pLriubole tkii1.r I'trritiquit&, discours prononcé le 3 août<br />
1865 à l'Académie franpise.<br />
Lei Foiifairie et le.sfiihirlis~e.s, 1867.<br />
De Inforiiirrtiori du piihlic~ en Fi", Paris, Degorce-Cadot, 1869.<br />
Eiivres cotiipl2te.y tle J. Rciciiie mvc iriie vie <strong>de</strong> 1 'autc~iir, Paris, Garnier Fr&re,<br />
1869.<br />
Ln chute ~ l Second ~ i Eiiipir-e, 1874.<br />
Jeau-J~icyires R~ii.~.~eriii, sa \Ve ef ses oiii~r-qes, 2 vol., Paris, Charpentier, 1875.<br />
Notice si4r le g éiir'm I <strong>de</strong> divisiori Bon - Chcrhaud- La- Toic r, Paris , Soc ié t 6 anon y me<br />
<strong>de</strong> publications périodiques, 1885, 33 p.<br />
Condition <strong>de</strong>s chrétirris en Orient, 1 vol. in- 18.<br />
- Articles dans Le JoiiniuI cles cl~berts.<br />
- Articles dans La Revue cles Deux-Mon<strong>de</strong>s.<br />
- Articles dans Le Joiirrzal <strong>de</strong> Ptrris.<br />
- Articles dans Le Jourmil <strong>de</strong>s Sciveints.<br />
- Articles dans Le Mercure <strong>de</strong> France.<br />
- Articles dans Lu Revue Frcrnqaise.
76<br />
ANNEXE 1<br />
RECAPITULATIF DES DOSSIERS DE M. SAINT-MARC GIRARDIN<br />
DEPOSES A LA SOCIETE HISTORIQUE DE SOISSONS<br />
01. Littérature médicale - secours aux blessés.<br />
02. Cicéron (en latin).<br />
03. Biographies - notices - discours funèbres.<br />
04. Publications religieuses.<br />
05. Questions touchant à l’instruction et a la culture.<br />
06. Questions éconoiniques et financières.<br />
07. Question d’Orient (Grèce - Turquie).<br />
08. Littérature franpise.<br />
09. Histoire religieuse - Pères <strong>de</strong> 1’Eglise (la plitpmrt <strong>de</strong>es oiivrages eri latin).<br />
10. Publications relatives à l’Italie et 2 Dante (la pliipart en italien).<br />
1 1. Question d’Orient (es.serzfiellenirtif LIU sujef <strong>de</strong> la Roumanie).<br />
12. Publications juridiques.<br />
13. Questions relatives à l’Amérique.<br />
14. Poèmes - musique.<br />
15. Poèmes - pièces <strong>de</strong> théâtre,<br />
16. Journaux <strong>de</strong> 1867 et 1868 - la question d’Orient - Le Moriiteiir universel.<br />
17. La question d’orient.<br />
18. Questions catholiques.<br />
19. Questions relatives aux Iles ioniennes.<br />
20. Littérature latine - documents divers.<br />
2 1. Publications philosophiques, économiques et sociales.<br />
22. Sur la Russie.<br />
23. Questions d’histoire.<br />
24. Biographies.<br />
25. Politique contemporaine.<br />
26. La question polonaise.<br />
27. La question d’Orient : la Crète.<br />
28. Littérature (XIIc, XVII, XVIII‘, XIX‘ siècles).<br />
29. Discours et écrits <strong>de</strong> membres <strong>de</strong> l’Institut et <strong>de</strong> la Comédie française.<br />
30. Affaires en Pologne.<br />
3 I. Tragédie et divers.<br />
32. La question d’Orient : Serbie et Monténégro.<br />
33. Sur Nancy.<br />
34. Sur la défaite <strong>de</strong> 1870 (mvc les intrrrogatoires íle MM. Pelletmi, Míignien,<br />
Gíi ri1 ie r- Pag ès, Ai I re lles <strong>de</strong> Pu lndit i es, Dr&lle, Piéti-i, A rrrg o, ílu géí iéríi I Troch II et ~lii mtrréchtrl Mac Mcihori).<br />
35. Journaux (essentiellemerit siir la question d’0rieiit).<br />
36. La question d’orient.<br />
37. Sur l’Orient méditerranéen.<br />
38. La conquête <strong>de</strong> l’Algérie (mw notcunmerit it11 nihimire ii~ariitscrit sur les<br />
moj~ens d’afiriner et d’utiliser Ili coiiqur^te tie l’Algérie, par le maréchal<br />
Bugeaiid, janvier 1844).
ANNEXE 2<br />
LA BIBLIOTHEQUE SAINT-MARC GIRARDIN<br />
A LA SOCIETE HISTORIQUE DE SOISSONS<br />
Cette bibliothèque contient environ IO O00 livres dont :<br />
- Des pr'riodiqires :<br />
Le Jolinicil clos dkhcits, 1827 à 1869 ; La Retzie <strong>de</strong>s Deux-Moncles, 1838- 189 1 ;<br />
les journaux satiriques Le Grelot 1873- 1895 et L'EcIipse 1872- 1876 etc.<br />
- Des ~ ii
Des biographies : Lu g<strong>de</strong>rie <strong>de</strong>s feiiziiies fiIrtes du père Le Moyne (1668) ;<br />
Histoire du prince E~ig21ie<br />
<strong>de</strong> Stivoie par Eléazar Mauvillon (1750).<br />
- Des miivres gréco-ltitines et PtruiigPres (800 vol.) :<br />
Parmi les livres latins, les éditions anciennes d’auteurs classiques (Cicéron,<br />
César, Lucain, Lucrèce, Ovi<strong>de</strong>, Plaute, Pline le Jeune, Quintilien, Salluste,<br />
Sénèque, Stace, Tacite, Térence, Tite-Live, Virgile.. .).<br />
Mais ce qui fait l’intérêt et la valeur <strong>de</strong> ces ouvrages, c’est un bon nombre <strong>de</strong>s<br />
plus grands auteurs <strong>de</strong> la Renaissance, dont plusieurs dans <strong>de</strong>s éditions princeps.<br />
Parmi les humanistes <strong>de</strong> renom, citons Corneille Agrippa (153 I), Charles<br />
Borromée (1587), Du Bartas ( 1584), Erasme, Juste Lipse, Mdanchthon, Ange<br />
Politien, Scaliger, Jean Trithème ( I5 18). . .<br />
La langue italienne est représentée par 336 ouvrages dont certains datent <strong>de</strong> la fin<br />
du XVI siècle. La plupart <strong>de</strong>s livres allemands sont du XVIIIc siècle et du XIX‘<br />
siècle et traitent surtout d’histoire (Gieseler, Grimm, Leibnitz, Rabener, Schiller<br />
etc.). I1 n’y a que 165 livres en anglais, tous <strong>de</strong>s XVIII‘ et XIX siècles. On y trou-<br />
ve 8 volumes du Specturor d’Addison et Steele ( 1 753), une traduction <strong>de</strong> I’IIirr<strong>de</strong><br />
par Alexan<strong>de</strong>r Pope et, bien silr, 14 volumes du théiìtre <strong>de</strong> Shakespeare.<br />
Enfin, une vingtaine <strong>de</strong> livres en langues diverses complètent ce fonds. parmi les-<br />
quels une grammaire valaque <strong>de</strong> 1826 et un traité <strong>de</strong> grammaire syriaque <strong>de</strong> 188 I.<br />
ARCHIVES CONSULTEES<br />
- Bibliothèque <strong>de</strong> la Société historique <strong>de</strong> Soissons.<br />
- Archives <strong>de</strong> l’Assemblée nationale (Paris).<br />
-Archives <strong>de</strong> l’lnstitut <strong>de</strong> France (Paris).<br />
- Archives départementales <strong>de</strong> la Haute-Vienne (Limoges).<br />
REMERCIEMENTS<br />
- M. Pierre Meyssirel, bibliothécaire <strong>de</strong> la Société historique <strong>de</strong> Soissons.<br />
- M. Clau<strong>de</strong> Bérard -i-, membre dc la Socibté historique <strong>de</strong> Soissons.<br />
- Mme Myriam Raimbault, au service <strong>de</strong>s archives <strong>de</strong> I’Assemblke nationale.<br />
- Mme Mireille Lamarque, conservateur <strong>de</strong>s archives <strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong> France.<br />
- M. Jean Saint-Marc Girardin, Paris.<br />
- M. Jacques Roquemorel, Saint- Yrieix- la- Perche.<br />
- M. Lionel Knepper, Paris.
Regard historiographique sur l’oeuvre <strong>de</strong><br />
Jehan <strong>de</strong> Hennezel(lS76-1956)<br />
La Fédération <strong>de</strong>s Sociétés d’histoire <strong>de</strong> l’Aisne est entrée dans la <strong>de</strong>rniè-<br />
re année du X X siècle en faisant un état <strong>de</strong> ses activités. Comme certaines socié-<br />
tés savantes nationales ’, elle dresse un tableau <strong>de</strong>s progrès <strong>de</strong> la recherche et du<br />
travail <strong>de</strong> ses membres, et consacre le volume <strong>de</strong> l’année 2000 <strong>de</strong> ses MCmoires<br />
à un bilan historiographique <strong>de</strong> leurs publications, pour en tirer <strong>de</strong>s perspectives<br />
d’avenir.<br />
Le comte Jehan <strong>de</strong> HenneLel d’Ormois, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Société historique<br />
<strong>de</strong> Haute-Picardie durant un quart <strong>de</strong> siècle, est <strong>de</strong> ces chercheurs actifs qui ont<br />
fait progresser la connaissance du passé <strong>de</strong> l’Aisne. Avec près <strong>de</strong> trente publica-<br />
tions - dont plusieurs ouvrages importants - qui s’échelonnent <strong>de</strong> 1902 à la veille<br />
du <strong>de</strong>uxième conflit mondial, il tient une place importante dans la recherche his-<br />
torique <strong>de</strong> cette région.<br />
L‘œuvre d’un chercheur local, prési<strong>de</strong>nt d’une société savante d’arrondis-<br />
sement, est un observatoire privilégié pour connaître les objets d’étu<strong>de</strong> et les<br />
métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s nombreux acteurs qui écrivent l’histoire en marge <strong>de</strong>s institutions<br />
universitaires. Étudier les travaux <strong>de</strong> Jehan <strong>de</strong> Hennezel <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> s’interroger<br />
sur les courants et les écoles historiques auxquels, consciemment ou inconsciem-<br />
ment, il se rattache : dans quelle niesure la société historique <strong>de</strong> Haute-Picardie<br />
a-t-elle diffusé, par les travaux <strong>de</strong> son prési<strong>de</strong>nt, les nouvelles tendances <strong>de</strong> la<br />
recherche en histoire apparues pendant la première moitié du XX‘ siècle ‘? La pré-<br />
sentation <strong>de</strong>s publications, <strong>de</strong> la personnalité et <strong>de</strong>s conceptions <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong><br />
J. <strong>de</strong> Heiinezel permettra <strong>de</strong> répondre à cette interrogation.<br />
Une production historique considérable<br />
Jehan <strong>de</strong> Hennezel fut, tout d’abord, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Société historique <strong>de</strong><br />
1. À litre d’exemple, la Société d’hisloire <strong>de</strong> l’Église <strong>de</strong> France a organisé, h l’université <strong>de</strong> Rennes,<br />
un colloque sur Un siècle d’histoire du christianisme en France. Bilan histol-iographique et pcrspec-<br />
tives (Rennes, 15, 16 et 17 septembre 1999).<br />
2. La seule étu<strong>de</strong> que nous ayons rencontrée. qui fasse le bilan <strong>de</strong> I’cruvre <strong>de</strong> J. <strong>de</strong> Hennczel. est la<br />
courte notice nécrologique <strong>de</strong> celui-ci, rédigée par Maxime <strong>de</strong> Sars :
Haute-Picardie dont il avait été l’un <strong>de</strong>s fondateurs, le 25 juin 1914 ; le but <strong>de</strong><br />
cette association était <strong>de</strong> remédier B l’isolement <strong>de</strong>s sociétés savantes <strong>de</strong> l’Aisne<br />
en tissant entre elles un lien fécond. Ancien secrétaire <strong>de</strong> la société académique<br />
<strong>de</strong> Laon, jeune érudit connu par la solidité <strong>de</strong> ses travaux, il <strong>de</strong>vint en 1914 secré-<br />
taire <strong>de</strong> la Société historique <strong>de</strong> Haute-Picardie, puis son prési<strong>de</strong>nt en 1920. Son<br />
ami, Maxime <strong>de</strong> Sars, témoigne <strong>de</strong>s qualités avec lesquelles il remplit cette fonc-<br />
tion : J. <strong>de</strong> Hennezel savait susciter les candidatures, encourager les communica-<br />
tions et organiser les excursions ; l’assemblée générale d’été se tenait habituelle-<br />
ment chez lui, à Bourguignon. En 1944, il donna son accord 5 la fusion <strong>de</strong> cette<br />
association avec la société académique <strong>de</strong> Laon. En 1945, le comité directeur <strong>de</strong><br />
la Société historique <strong>de</strong> Haute-Picardie accepta enfin sa démission <strong>de</strong>s fonctions<br />
<strong>de</strong> prési<strong>de</strong>nt qu’il lui proposait <strong>de</strong>puis longtemps. pour raisons <strong>de</strong> santé. Les<br />
comptes rendus <strong>de</strong>s réunions qui eurent lieu sous sa prési<strong>de</strong>nce montrent que<br />
cette association correspondait bien à ce qu’étaient les sociétés savantes à cette<br />
époque : Clément ancien et original du paysage scientifique français, réunissant<br />
<strong>de</strong>s chercheurs motivés, mais pouvant aussi servir <strong>de</strong> lieu <strong>de</strong> sociabilité d’une cer-<br />
taine élite <strong>locale</strong>, cette association diffusait <strong>de</strong>s savoirs historiques concernant un<br />
cadre géographique particulier ’. Mais J. <strong>de</strong> Hennezel ne fut pas seulement un<br />
directeur <strong>de</strong> société savante ; il fut aussi un chercheur rigoureux, auteur d’ou-<br />
vrages importants. Maxime <strong>de</strong> Sars a donné la liste <strong>de</strong> vingt-six <strong>de</strong> ses publica-<br />
tions ‘, sans en préciser l’importance matérielle ni faire figurer le nom <strong>de</strong>s revues<br />
dans lesquelles certaines ont été éditées, et qu’il ne nous a pas toujours été pos-<br />
sible d’i<strong>de</strong>ntifier. Ce catalogue n’est pas complet - nous y avons ajouté l’impor-<br />
tante contribution au volume du III‘ Congrès marial national <strong>de</strong> I934 - et certains<br />
articles <strong>de</strong>meurent vraisemblablement dans l’oubli. Mais son importance<br />
témoigne <strong>de</strong> I’activitC <strong>de</strong> ce chercheur :<br />
Liste <strong>de</strong>s publications <strong>de</strong> J. <strong>de</strong> Hennezel (classement chronologique)<br />
PI. Géiikdogie <strong>de</strong> lu niciisoii <strong>de</strong> Heririezel (l392-1902), Laon, Impr. du Joirrriul<br />
<strong>de</strong> l’Aisne, 1902, 158 p.<br />
P2. Les e‘pittrphes <strong>de</strong> I’ciizcieii cimetiPre di( Mont-Vclr‘ririi, Paris, Champion,<br />
1905.<br />
P3. Trois ghie‘rrrtioiis <strong>de</strong> bihliophiles clmis la fiiinille Monincl <strong>de</strong> Joiiffrey, Mdcon,<br />
Protat, 1906.<br />
P4. DPMY ex-lihris lcroiiiiois : ,firiniIles Dciiiye et Drrgiierru, Mdcon, Protat, 1906.<br />
P5. Esscii sur lirrqirebu.se <strong>de</strong> Lcioii, Laon, Impr. du Journal <strong>de</strong> l’Aisne, 1908, 9 1 p.<br />
P6. Note siir iiiz ,jeton cle I’arqirebuse <strong>de</strong> L~ioti, Laon, Westercamp, 19 1 O, 5 p.<br />
P7. Une pierre giin.stiyire trouvc~e i Corbeny, Saint-Quentin, 19 1 O, 7 p.<br />
P8. Quelques hiblioplziles dir pciys laonilois rt Ieirrs ex-libris, Saint-Quentin,<br />
19lO,42 p.
L’œuvre <strong>de</strong> Jehan <strong>de</strong> Hennezel<br />
Le comte <strong>de</strong> Hennezel d’Ormois (I 876- 1956)<br />
(dans les Mémoires <strong>de</strong> la Fédémtion <strong>de</strong>s Sociétés d’histoire et d’archéologie <strong>de</strong> l’Aisne, t. 11, 1955. CI. J.-L. Girard)<br />
P9. (en collaboration avec Lucien Broche), Inventaire du mobilier d’un évêque <strong>de</strong><br />
Laon au XN” s., Saint-Quentin, 1910.<br />
P10. Les anciens imprimeurs <strong>de</strong> Laon, Laon, Westercamp, 1910, 14 p.<br />
P11. Une taque àfeu aux armes d’Étampes, Paris, Heraldica, 191 1,5 p.<br />
P12. Les adieux du Roy <strong>de</strong> France avec le Roy d’Espagne, Paris, Heraldica, 191 1,<br />
3 P-<br />
P13. Le 14 octobre 1793 à Saint-Denis, récit d’un Laonnois, Saint-Quentin, 1912,<br />
22 p.<br />
P14. LÆ carnaval à Laon en 1807, récit du préfet Méchin, Saint-Quentin, 1912,<br />
14 p.<br />
P15. Souvenirs du maréchal Sérurier et sa famille, Saint-Quentin, 1912,28 p.<br />
P16. Notes sur le général comte Pille (1749-1828), Laon, Impr. du Journal <strong>de</strong><br />
Z%isne, 1912, 15 p.<br />
P17. Am am’es <strong>de</strong> Napoléon, le capitaine Ponssin (1 772-1810), Laon, Impr. du<br />
Journal <strong>de</strong> l’Aisne, et Paris, Chapelot, 1913.<br />
P18. Les bibliophiles du pays laonnois, leurs ex-libris et fers <strong>de</strong> reliure, Saint-<br />
Amand, Clerc, 1914-1931,3 vol.<br />
P19. Les Carpentier <strong>de</strong> Juvigny et leurs ex-libris, Paris, Impr. <strong>de</strong> l’Argus, 1930.<br />
P20. Souvenirs <strong>de</strong> l’occupation alleman<strong>de</strong> h Bruyères-et-Montbtmult, Reims,<br />
Matot-Braine, 1931.
P2 I . Les arnioiries c~ninii~i~~les <strong>de</strong> Dizjl-leGros, Soissons, Impr. <strong>de</strong> l’Argus,<br />
1932, 16 p.<br />
P22. La coininilne <strong>de</strong> ColliSis-Crcrnclehin, ses cirmoiries et les soiivenirs militaires<br />
<strong>de</strong> soiz histoire, Soissons, Impr. <strong>de</strong> l’Argus, 37 p.<br />
P23.
elle avait été déposée en 1950 à la suite d’un don <strong>de</strong>s Archives départementales<br />
du Pas-<strong>de</strong>-Calais, auxquelles Roger Rodière, ami <strong>de</strong> Hennezel 9, l’avait léguée I”.<br />
Ce dossier, composé iì la fois <strong>de</strong> cahiers et <strong>de</strong> feuilles manuscrites ou dac-<br />
tylographiées. es1 lrès volumineux. Son plan est le suivant :<br />
Plan <strong>de</strong> l’ouvrage inédit <strong>de</strong> J. <strong>de</strong> Hennezel sur le pélerinage <strong>de</strong> Liesse<br />
(Arch. dép. Aisne, J 1004)<br />
LIASSE 1<br />
- Iconographie (cahier, 96 p. mss)<br />
(p. 1 iì 28) Iconographie el souvenirs du pèlerinage<br />
1. Plombs et enseignes <strong>de</strong> pèlerinage<br />
2. Croix fleur<strong>de</strong>lisées à huit pointes<br />
3. Crucifix à Vierge<br />
4. Médailles<br />
(p. 29 à 51)<br />
1. Notre-Dame <strong>de</strong> Liesse seule<br />
2. Médailles à souvenirs historiques<br />
3. Notre-Dame <strong>de</strong> Liesse et la Sainte Face<br />
4. Notre-Dame <strong>de</strong> Liesse et le Saint Sacrement<br />
5. Notre-Dame <strong>de</strong> Liesse et le Sauveur<br />
6. Notre-Dame <strong>de</strong> Liesse, la Sainte-Famille et les saints<br />
7. Médailles récentes<br />
8. Objets divers<br />
(p. 52 à 926) Imagerie<br />
1. Planches gravées <strong>de</strong>s ouvrages consacrés à Notre-Dame <strong>de</strong> Liesse<br />
2. Images-souvenirs du pèlerinage<br />
3. Gravures relatives iì <strong>de</strong>s événements historiques<br />
4. Vues <strong>de</strong> l’église et du bourg <strong>de</strong> Liesse<br />
5. Gravures <strong>de</strong> confréries et sanctuaires divers<br />
- Confréries, sanctuaires, dévotions et chapelles annexes (cahier, 91 p. mss)<br />
1. Paris<br />
2. France<br />
3. À l’étranger (Belgique, Malte, Suisse, Canada, Guyane, Madagascar,<br />
Afrique française, Ceylan, Chine, Japon).<br />
Y. Cf J. <strong>de</strong> Hennezel (en collaboration avec Roger Rodière), , exlrait du Bfr//eriti <strong>de</strong> /ci socii’/é hisfwipe <strong>de</strong> Hoffre-Picnrdie, t. XIII,<br />
IY35,44 p.<br />
10. Arch. dép. Aisne. J 1004. Le texte <strong>de</strong> la fiche <strong>de</strong>scriptive <strong>de</strong> la série J est peu explicite : )
84<br />
LIASSE 2 (165 p. mss)<br />
- Avant-propos<br />
- 165 illustrations [clichés faits et restant à faire]<br />
LIASSE 3<br />
- texte du plus ancien récit connu <strong>de</strong> la légen<strong>de</strong> <strong>de</strong> Liesse, publié par <strong>de</strong><br />
Hennezel en 1934 (39 p. mss)<br />
- texte <strong>de</strong> la légen<strong>de</strong> <strong>de</strong> Liesse d'après Bosio (1594) et traduction par <strong>de</strong><br />
Hennezel (24 p. mss)<br />
- introduction au texte <strong>de</strong> 1490 et commentaires <strong>de</strong>s images publiées en<br />
1934 (29 p. mss)<br />
LIASSE 4<br />
- L'église <strong>de</strong> Liesse [en cours <strong>de</strong> rédaction ]<br />
- Le bourg <strong>de</strong> Liesse (74 p. mss)<br />
A. Les monuments<br />
1. L'h6tel-Dieu<br />
2. Le séminaire<br />
3. La fontaine et la Santa Casa<br />
4. La chapelle <strong>de</strong>s arbres<br />
5. Le presbytère<br />
6. La halle et la mairie<br />
7. Maisons diverses, fortifications, etc.<br />
8. Les armoiries du bourg <strong>de</strong> Liesse<br />
B. La population<br />
I. Les artisans<br />
a. Les maîtres orfèvres et imagiers<br />
b. Les maîtres fon<strong>de</strong>urs en cuivre<br />
c. Autres artisans<br />
d. Les h6teliers<br />
2. La vie cominunale<br />
3. Les meurs<br />
Neuvaines<br />
Rixes, vols et scènes diverses<br />
4. La route du pklerinage B travers les siècles<br />
5. Lie5se pendant la Révolution<br />
FEUILLES VOLANTES (dactylographiées)<br />
- avant-propos du chap. I (9 p.)<br />
- chap. I : Les documents (28 p.)<br />
- chap. II : La confrérie (7 p.)<br />
- chap. III : Fondations, testaments, legs, dons (I 7 p.)<br />
- chap. IV : Les pèlerins (150 p.)<br />
A. Pèlerinages individuels<br />
I. Notre-Dame <strong>de</strong> Liesse, pèlerinage <strong>de</strong>s rois
2. Princes, grands personnages (XVP s., XVII‘ s., XVIII‘ s., XIX et<br />
xx s.)<br />
3. Princes, grands personnages, bannis, peuple ...<br />
B. Pèlerinages collectifs, vœux. processions<br />
C. Certificats <strong>de</strong> pèlerinages et certificats <strong>de</strong> confrérie<br />
- chap. V : Le congrès niarial <strong>de</strong> 1934<br />
- bibliographie (20 p. mss)<br />
L‘ouvrage, inédit - à l’exception du texte du légendaire <strong>de</strong> Liesse <strong>de</strong> la fin<br />
du Moyen Age II - correspond donc à la présentation que J. <strong>de</strong> Hennezel en avait<br />
faite en 1934 I’, et sa rédaction était plus avancée que ne le pensait Maxime <strong>de</strong><br />
Sars. I1 fut élaboré pendant la préparation du IIIe Congrès marial national qui se<br />
tint à Liesse en 1934, après celui <strong>de</strong> Lour<strong>de</strong>s et celui <strong>de</strong> Chartres, et qui coïnci-<br />
dait avec le huitième centenaire du début du pèlerinage <strong>de</strong> Liesse (I 134-1934),<br />
C’est à la fois un résumé <strong>de</strong> l’histoire du pèlerinage et une importante édition<br />
d’images, <strong>de</strong> médailles et <strong>de</strong> croix. Cette œuvre c16t la liste <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> Jehan<br />
<strong>de</strong> Hcnnezcl d’Ormois, qu’il faut maintenant tenter d’expliquer et <strong>de</strong> comprendre,<br />
dans un premier temps par sa personnalité.<br />
La personnalité <strong>de</strong> J. <strong>de</strong> Hennezel<br />
Jehan <strong>de</strong> Hennezel naquit en 1876. Retiré pendant la Secon<strong>de</strong> Guerre mon-<br />
diale en Bretagne, il mourut au chliteau <strong>de</strong> Kervilio, près d’Auray, dans la pro-<br />
priété <strong>de</strong> son gendre, le vicomte <strong>de</strong> Noiie, le 5 mars 1956, à l’&e <strong>de</strong> soixante-dix-<br />
neuf ans I’. La génération à laquelle il appartient est donc celle <strong>de</strong> la <strong>de</strong>uxième<br />
vague <strong>de</strong> fondation <strong>de</strong>s sociétés d’histoire : après l’époque romantique, qui avait<br />
vu la prise <strong>de</strong> conscience <strong>de</strong> la notion <strong>de</strong> patrimoine, les années 1880- 19 I4 assis-<br />
tèrent à la multiplication <strong>de</strong> ce type d’associations - dont celle <strong>de</strong> Haute-Picardie<br />
- qui traversèrent ensuite une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> crise avant <strong>de</strong> se développer à nouveau<br />
à partir <strong>de</strong>s années 1970 ‘-I, signe d’un temps en quête <strong>de</strong> racines et d’i<strong>de</strong>ntité.<br />
De Hennezel grandit à une époque <strong>de</strong> transformations importantes et<br />
rapi<strong>de</strong>s sur le plan tant éconoinique que social, politique et religieux. I1 connut<br />
I’échec <strong>de</strong> la tentative <strong>de</strong> restauration monarchique <strong>de</strong>s années 1870, les tensions<br />
entre I’État laïque et l’Église catholique <strong>de</strong> 1879 à 1914, les bouleversements dus<br />
au premier conflit mondial, l’inexorable déclin <strong>de</strong> l’ancienne France rurale et pro-<br />
vinciale et les vifs affrontements <strong>de</strong>s années 1930 entre partis politiques <strong>de</strong><br />
gauche et mouvements d’extrême-droite, qui marquèrent sa production intellec-<br />
tuelle.<br />
I I. Cf J. <strong>de</strong> Henneiel d’Ormois, Notrdkrrrie <strong>de</strong> Lic..s.se, .so / i;~mle<br />
..., op. cif.<br />
12. \/it/., p. 93-94.<br />
13. M. <strong>de</strong> San, c Le conite <strong>de</strong> HenlieLe1 d’Ormois ... D. /oc. cif., p. 59.<br />
14. J. Jacquert, (( Les societCs savantes ... >>, /oc. cir.. p. 119.
J. <strong>de</strong> Hennczel était attaché au >, avec lequel il avait un rapport<br />
aflectif. Ce passé semble immobile et idéalisé, une sorte ><br />
qu’il abordait par le biais <strong>de</strong>s antiques médailles et images <strong>de</strong> Liesse qu’il col-<br />
lectionnait. I1 ne le situait pas toujours précisément dans la chronologie, et se<br />
contentait d’opposer le 2 > 15. I1 mani-<br />
festait sa volonté <strong>de</strong> maintenir en vie une civilisation en train <strong>de</strong> disparaître en<br />
gardant les prononciations anciennes <strong>de</strong>s noms <strong>de</strong> lieux, accentuant par exemple<br />
systématiquement le > <strong>de</strong> > I”.<br />
En fait, Jehan <strong>de</strong> Hennezel fut profondément marqué par sa scolarité au<br />
petit séminaire <strong>de</strong> Liesse : (< En formant ce mo<strong>de</strong>ste recueil, nous avons voulu<br />
aussi témoigner personnellement notre reconnaissance à la Vierge <strong>de</strong> Liesse, nous<br />
souvenant que, dans notre enfance, c’est à l’ombre <strong>de</strong> son sanctuaire que nous<br />
avons reçu <strong>de</strong> prêtres vénérés la foi et les enseignements qui sont restés le flam-<br />
beau <strong>de</strong> notre vie I’. >> II évoqua ces souvenirs liessois quand il dédia l’un <strong>de</strong> ses<br />
ouvrages à I’évêque <strong>de</strong> Soissons, Mgr Mennechet I’, ou préfaça l’Histoire <strong>de</strong><br />
Vervins du chanoine Méra I”, tous <strong>de</strong>ux ses anciens condisciples. Par ses travaux<br />
siir Liesse - qui avaient pour lui la saveur <strong>de</strong> la ma<strong>de</strong>leine <strong>de</strong> Proust - il revivait<br />
assurément ses souvenirs d’enfance, mais il recherchait aussi un temps perdu et<br />
révolu, car, selon lui, (< Liesse fut pendant six cents ans le pèlerinage officiel <strong>de</strong><br />
nos Rois ”’ D.<br />
De cette formation initiale, J. <strong>de</strong> Henne~el garda un catholicisme très<br />
orthodoxe. I1 lui arrivait d’exprimer dans son œuvre <strong>de</strong>s sentiments nettement<br />
antijansénistes et il resta très déférent vis-à-vis <strong>de</strong> toute autorité relie’ oieuse,<br />
allant même jusqu’à <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r l’imprimatur pour un ouvrage historique I’.<br />
De Hennezel élait très discret sur ses opinions politiques. Du reste, l’es-<br />
sentiel <strong>de</strong> ses travaux, consacré à <strong>de</strong>s monographies, ne laisse filtrer aucune infor-<br />
mation sur ce sujet. Pourtant, le ton <strong>de</strong> son ouvrage inédit sur Liesse est plus<br />
explicite ; à plusieurs reprises il y condamne sans ambiguïté le régime républi-<br />
IS. Arch. dép. Aisne, J 1004, , e la foi était si vive dans le cwir <strong>de</strong>s Frangais d’autrelois<br />
N. Afin d’alléger notre texte. nous nous contenterons dCwrmais <strong>de</strong> citer la cote <strong>de</strong><br />
I’rpuvre inédite <strong>de</strong> Henne7el sur Liesse, sans rappelcr qu’elle est conservée ~ LIX Arch. dCp. Aisne.<br />
16. Par exemple. dans J 1004. G Iconographie >), p. 14.<br />
17. J 1004, e Avant-propos >). p. 4.<br />
18. J. d‘Hennezl d’Ormois, Norrc. Dtrrire (le Lic,.~, .st! /6,qer7dc,..., op. cit.<br />
19. Chan. G. Méra, Ven1iri.s .S~L/J /tr Rdvo/utio/i, /‘Er~rpiw, It/ Kr.vtoir,rrtiorr. Hirson. Impr. dc la Gucttc<br />
<strong>de</strong> la Thiérache, 1935.<br />
20. J. <strong>de</strong> Hennelel d‘Ormois, Notre-Dtrriw t/e Liesse, \ti /c;,qtwdc..., op. cit., p. Y- I O.<br />
21, J 1004. chap. IV Lev pèlerins. A. Pèlerinages individuels. 2. Princes, grandu personnages,<br />
XVIII‘ s., p. 1 :
cain. I1 est vrai que cette <strong>de</strong>rnière ceuvre porte sur un sujet d’ampleur nationale,<br />
ce qui permet <strong>de</strong>s considérations générales, et qu’elle est rédigée dans ces années<br />
1930 qui ont vu les événemenls du 6 février 1934, la guerre civile en Espagne, le<br />
Front populaire en France, les afi‘ronteinents entre les ligues et les partis <strong>de</strong><br />
gauche, à une époque où le magistère intellectuel <strong>de</strong> Charles Maurras sur les<br />
élites provinciales était encore puissant. M. <strong>de</strong> Hennezel souligne à plusieurs<br />
reprises les liens existant entre Liesse et plusieurs mouvements royalistes Iégitimistes<br />
; il décrit avec force détails le grand pèlerinage du 17 août 1873 <strong>de</strong>s<br />
Cercles catholiques ouvriers auquel <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> sa famille, Maurice et Paul<br />
<strong>de</strong> Hennexl d’Ormois, participèrent : > Par ailleurs, il souligne qu’en 1883, le colonel <strong>de</strong> La Tour du Pin, char-<br />
gé <strong>de</strong> la direction du mouvement royaliste dans le département <strong>de</strong> l’Aisne, tint sa<br />
première réunion à Liesse, pour mettre son organisation sous la protection <strong>de</strong> la<br />
Sainte Vierge pour laquelle il avait une particulière dévotion ?-I >>. II écrit systé-<br />
matiquement le mot > avec un ; il impute en<br />
partie le déclin <strong>de</strong> Liesse, h la fin du XIX’ siècle, à > ; enfin, après avoir décrit la confiscation du petit séminaire <strong>de</strong> Liesse par<br />
l’ÉLat en 1905, il conclut : Pourtant, malgré son opposition au régime républicain qui accepte la pluralité<br />
<strong>de</strong>s opinions, il condamne les guerres <strong>de</strong> Religion et parle <strong>de</strong> . p. 3.<br />
27. J 1004. lime 4. Le bourg <strong>de</strong> Lie\\e. A. Le\ monuments. 2. Le v2ininaire.<br />
28. J 1004. chap. IV Les pèlerins, B. Pèlerinage\ collectif\. p. I.
XX Bruno Mcic“s<br />
Un représentant <strong>de</strong> I’école méthodique<br />
Cependant, la personnalité du comte <strong>de</strong> Hennezel n’explique pas à elle<br />
seule ses travaux d’historien. L‘homme est aussi un chercheur traversé par <strong>de</strong>s<br />
courants <strong>de</strong> pensée ; I’érudit <strong>de</strong>s années 1920 et 1930 est le fruit d’écoles histo-<br />
riques du XIX’ siècle et annonce en même temps les tendances qui s’épanouis-<br />
sent quelques décennies plus tard. Les objets d’étu<strong>de</strong> qu’il choisit, les métho<strong>de</strong>s<br />
d’exploitation <strong>de</strong>s sources qu’il met en ceuvre, sa conception <strong>de</strong> I’écriture <strong>de</strong><br />
l’histoire, sont le retlet <strong>de</strong> tendances profon<strong>de</strong>s qu’on retrouve au plan national<br />
dans les universités <strong>de</strong> l’époque.<br />
Objets historiques<br />
Les sujets choisis par J. <strong>de</strong> Hennezel reflètent tout d’abord les préoccupa-<br />
tions <strong>de</strong> son milieu familial. Ainsi, il commença ses activités <strong>de</strong> chercheur en<br />
publiant, en 1902, une généalogie <strong>de</strong> sa famille ?‘’, et une part importante <strong>de</strong> ses<br />
travaux ultérieurs consista à i<strong>de</strong>ntifier <strong>de</strong>s individus auxquels il consacrait une<br />
notice biographique “’. De même, le collectionneur portait un grand intérêt à la<br />
bibliophilie, aux imprimeurs locaux, aux ex-libris. Enfin, un troisième centre<br />
d’intérêt, pour ce représentant <strong>de</strong> la noblesse secon<strong>de</strong>, bien enracinée dans sa<br />
région, fut l’histoire <strong>locale</strong>, qui fournit la matière <strong>de</strong> bon nombre <strong>de</strong> ses publica-<br />
tions. Du reste, un <strong>de</strong> ses livres, l’important ouvrage sur Les bibliophiles du pays<br />
ltroiziiois ’I, porte sur un thème qui est au carrefour <strong>de</strong> ces trois sujets.<br />
Mais les objets d’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> J. <strong>de</strong> Hennezel étaient aussi le reflet <strong>de</strong>s préoc-<br />
cupations <strong>de</strong> son époque, en particulier celles <strong>de</strong>s historiens et <strong>de</strong>s ethnologues<br />
folkloristes comme Arnold van Gennep lz, qui rassemblèrent et publièrent <strong>de</strong><br />
riches matériaux concernant une culture populaire en train <strong>de</strong> disparaître, à la fin<br />
du XIX‘ et au début du X X siècle :<br />
, Saint-Ainaiid, 19 14- 193 l.<br />
3 vol. Cet ouvrage est coinposé en partic d’arlicleh parus dans les Archiiws <strong>de</strong> Irr Soc.icté,frun~.ni.c.e<br />
<strong>de</strong> ~~,//ccfi~~/it~er~r.s d’e~r-libris <strong>de</strong> 1 908 à I9 13.<br />
32. A. Van Gennep. Ltr,formcrtion c/c.s /~,yetitlc.s, Paris, 19 10, 326 p. ; id., Le.s rires [le pa.s.srrge, Paris.<br />
1909, 288 p. ; id, Mmturrl rle,fi,lXlorc.~r~itil.ai.s conreriipor-trin. Paris, 1937- 1958, 9 vol. ; id.. Le.fo/l-<br />
/ore,frtruGcris, Paris, 1998. 1200 p. ( éd. 1937- 1958).
périodiquement les témoignages <strong>de</strong> dévotion donnés par les fidèles,<br />
comme cela s'est fail trop facilement <strong>de</strong>puis un <strong>de</strong>mi-siècle surtout, et <strong>de</strong><br />
les voir remplacer par <strong>de</strong>s marques <strong>de</strong> piété plus récentes. Imagine-t-on<br />
quel édifiant et curieux spectacle présenterait la basilique <strong>de</strong> Liesse si l'on<br />
y retrouvait seulement les ex-voto offerts à la Vierge miraculeuse <strong>de</strong>puis<br />
<strong>de</strong>ux cents ans ? Après les savants abbés Duployé qui écrivirent le plus<br />
important ouvrage publié sur notre pèlerinage, nous <strong>de</strong>mandons qu'on<br />
recueille ces souvenirs, qu'on les mette en honneur, qu'on les fasse<br />
connaître, qu'on montre aux pèlerins d'aujourd'hui ces preuves <strong>de</strong> la piété<br />
et <strong>de</strong> la reconnaissance <strong>de</strong>s pèlerins <strong>de</strong> jadis 37. D<br />
L'intérêt <strong>de</strong>s historiens folkloristes pour un mon<strong>de</strong> et pour une culture en<br />
train <strong>de</strong> mourir, leur admiration pour la c beauté du mort '-I D, se trouvaient ren-<br />
forcés chez <strong>de</strong> Hennezel par son goût pour les collections d'objets religieux popu-<br />
laires I', souvent fabriqués sous l'Ancien Régime. Du reste, cet attrait pour les<br />
images religieuses populaires du XVIII' siècle " ou pour les médailles<br />
anciennes " était partagé par bon nombre <strong>de</strong> ses contemporains. Ce goût explique<br />
encore la notice qu'il consacra en 1933 au <strong>de</strong>ssin énigmatique laissé par un insti-<br />
tuteur du Laonnois du XIX' siècle ".<br />
Les riiétho<strong>de</strong>s d'un érirciit<br />
Par les métho<strong>de</strong>s qu'il met en ceuvre pour ressusciter la vie du passé, Jehan<br />
<strong>de</strong> Hennezel se montre un représentant <strong>de</strong> I'école méthodique et érudite <strong>de</strong> la fin<br />
du XIX siècle. I1 utilise les instruments <strong>de</strong> recherche <strong>de</strong>s bibliophiles "'et connaît<br />
les publications les plus confi<strong>de</strong>ntielles consacrées au sujet qui l'intéresse<br />
33. J 1004, Avant-propos n, p. 2.<br />
34. Cf M. <strong>de</strong> Certeau. D. Julia, J. Revel. (* La beauté du mort : le concept <strong>de</strong> culture populaire n.<br />
Politique ur/jounl'hrri, déc. 1970. p. 3-23.<br />
35. J 1004,
90 Bruno MtrP.5<br />
Sa conception du document, restrictive, est aussi celle <strong>de</strong> I’école métho-<br />
dique : sur les 28 pages du chapitre I <strong>de</strong> l’ouvrage inédit sur Liesse qui présen-<br />
tent les > <strong>de</strong> l’histoire du pèlerinage, 25 sont consacrées aux actes<br />
pontilicaux et épiscopaux qui concernent la gestion du sanctuaire aux XIV‘ et<br />
XV‘ siècles. Le document est donc pour lui un texte, <strong>de</strong> préférence ancien. Les<br />
images et les médailles ne sont que <strong>de</strong>s illustrations, <strong>de</strong>stinées à divertir le lec-<br />
teur ; il n’y a aucune réflexion sur l’exploitation <strong>de</strong> celles-ci en vue d’en tirer <strong>de</strong>s<br />
informations <strong>de</strong> manière systématique ; la présentation qu’il en fait est la même<br />
que celle <strong>de</strong>s catalogues <strong>de</strong>s collectionneurs, où elles sont reproduites et accom-<br />
pagnées d’une courte notice <strong>de</strong>scriptive. Mais l’attachement <strong>de</strong> M. <strong>de</strong> Hennezel<br />
au document écrit a aussi un versant positif : l’histoire s’écrit vraiment, pour lui,<br />
iì partir <strong>de</strong> documents manuscrits et, à <strong>de</strong> nombreuses reprises, il cite <strong>de</strong>s liasses<br />
qu’il a effectivement et minutieusement dépouillées. C intérêt qu’il porte aux<br />
fabricants <strong>de</strong> médailles et aux orfèvres <strong>de</strong> Liesse l’amène même à découvrir et à<br />
exploiter un nouveau fonds d’archives, celui <strong>de</strong> la Monnaie <strong>de</strong> Reims, que les<br />
frères Duployé n’avaient pas songé à utiliser sous le Second Empire ‘I.<br />
Par ailleurs, la quête <strong>de</strong> documents ou d’objets menée par Jehan <strong>de</strong><br />
HenneLel est facilitée par le fait qu’il est bien introduit dans les réseaux d’archi-<br />
vistes, d’érudits et <strong>de</strong> collectionneurs <strong>de</strong> la moitié nord <strong>de</strong> la France, en particu-<br />
lier grice à sa double rési<strong>de</strong>nce laonnoise et parisienne, rue Mozart, dans le XVI<br />
arrondissement. Ces milieux sont informés <strong>de</strong> la préparation <strong>de</strong> son ouvrage sur<br />
Liesse ; nombreux sont ceux qui lui ouvrent leurs collections ’I ou lui fournissent<br />
<strong>de</strong> précieuses références <strong>de</strong> documents ”. Lui-même possè<strong>de</strong> une riche collection<br />
personnelle d’objets et <strong>de</strong> manuscrits “.<br />
Urie histoire- tLi hleciu<br />
Les objets d’étu<strong>de</strong> et les métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> recherche du comte <strong>de</strong> Hennezel<br />
d’Ormois sont naturellement prolongés par une conception <strong>de</strong> I’écriture <strong>de</strong> I’his-<br />
toire. Là encore, il s’inscrit dans la ligne <strong>de</strong> nombreux érudits du XIX‘ siècle.<br />
41, 8. et A. Duployé, Notre-Dtirne <strong>de</strong> Lir.s.te. Lc;Srri<strong>de</strong> et /?>/eriuci,qc>,<br />
Laon. 1862, 2 vol.<br />
42. J 1004. chap. IV Les pèlerins, C. Certificats <strong>de</strong> pèlerinages, p. 6 : (( Mgr Gaston, le savant éru-<br />
dit du diocèse <strong>de</strong> Paris. qui s’est spécialisé dans I’Ctu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’imagerie religieuse. pohsè<strong>de</strong> dans sa col-<br />
lection <strong>de</strong>ux autres spécimcns <strong>de</strong> certificats <strong>de</strong> pèlerinages <strong>de</strong> Liesse. >> ; J 1004, (< Iconographie >>,<br />
p. 19 : (( Trouvée en terre à Ch;iinpmarin par Aubigné-Racan (Sarthe). Communication <strong>de</strong> M. Louis<br />
Arnould, Professeur honoraire <strong>de</strong> l’Université <strong>de</strong> Poitiers. ))<br />
43. J 1004, chap. IV Les pèlerins. C. Certificats <strong>de</strong> pi-lerinages. p. 5 : (( Ce certificat <strong>de</strong> pèlerinage a<br />
été découvert dans les Archives <strong>de</strong>s Ar<strong>de</strong>nnes par M. Massiet du Bieht, archiviste dbpartemental. qui<br />
a bien voulu nous le communiquer. >> ; J 1004, chap. IV Les pklerins, B. Pèlerinages collectifs. p. 8 :<br />
(< En dépouillant les minutes d’un ancien notaire <strong>de</strong> Laon, M. l’abbé Rocoulct. curé <strong>de</strong> Besny-Loisy,<br />
a trouvé une lettre d’un Stuart <strong>de</strong>mandant une fondation <strong>de</strong> me\se dans la chapelle <strong>de</strong> Liesse. >)<br />
44. En particulicr l’important manuscrit <strong>de</strong> Bourbier, percepteur A Liesse en 1839, qui recouvre une<br />
centaine <strong>de</strong> piges.
Sa lecture <strong>de</strong>s sources est d’une gran<strong>de</strong> rigueur critique. 11 consacre plu-<br />
sieurs pages ‘’ <strong>de</strong> son ouvrage inédit sur Liesse à l’explication <strong>de</strong> l’origine <strong>de</strong>s<br />
documents. Son style est toujours clair, élégant, agréable à lire, et les termes qu’il<br />
utilise sont choisis avec justesse. On rencontre également chez lui un grand souci<br />
<strong>de</strong> replacer l’histoire <strong>locale</strong> dans son contexte général.<br />
Mais la phase finale du travail <strong>de</strong> l’historien, celle <strong>de</strong> la synthèse explica-<br />
tive, est rarement présente dans ses travaux. La remarque qu’il place dans I’avant-<br />
propos d’un <strong>de</strong> ses ouvrages vaut pour l’ensemble <strong>de</strong> son œuvre :
ponctuels et ne rédige pas <strong>de</strong> synthèses où toutes les composantes <strong>de</strong> la société<br />
sont en relation.<br />
Pourtant, une autre partie <strong>de</strong> I’œuvre <strong>de</strong> J. <strong>de</strong> Hennezel annonce <strong>de</strong>s ten-<br />
dances futures. Ce ne sont pas ses métho<strong>de</strong>s ni sa conception <strong>de</strong> l’écriture <strong>de</strong><br />
l’histoire qui sont neuves, mais certains <strong>de</strong> ses objets <strong>de</strong> recherche : la partie la<br />
plus originale <strong>de</strong> son travail est son enquête sur les images et médailles populaires<br />
<strong>de</strong>s XVIIc et XVIII‘ siècles. Ainsi, <strong>de</strong> 1902 à 1935, c’est par le biais <strong>de</strong> l’histoire<br />
religieuse et folkloriste que J. <strong>de</strong> Hennezel sera passé <strong>de</strong> la généalogie nobiliaire<br />
i l’histoire <strong>de</strong>s masses. I1 suivit en cela, par intuition et peut-être inconsciem-<br />
ment, un mouvement historiographique <strong>de</strong>stiné à un avenir fécond.<br />
Bruno MAËS
Madame Martinet<br />
Suzanne Goulard Martinet (1910-1998)<br />
>, dit Roger<br />
Thirault, directeur du Festival I, à la dame pleine <strong>de</strong> majesté qui vient <strong>de</strong> présen-<br />
ter sa vision <strong>de</strong> Roland <strong>de</strong> Roncevaux dans le cadre <strong>de</strong> la manifestation. Elle sou-<br />
rit <strong>de</strong> plaisir et, aimable, reçoit ce compliment qu’elle a conscience <strong>de</strong> mériter en<br />
présence <strong>de</strong> Monsieur Perreau-Pradier, préfet <strong>de</strong> l’Aisne, et <strong>de</strong> Monsieur Sabatier,<br />
maire <strong>de</strong> Laon, qui, elle le sait, apprécient l’un et l’autre sa valeur comme aussi<br />
le zèle et l’énergie qu’elle déploie en vue d’accroître la renommée <strong>de</strong> la cité.<br />
Au début <strong>de</strong> ces années 70, chacun voit en elle la bibliothécaire qui a mis<br />
et met toujours en œuvre, sans compter, sa force, sa compétence, son imagination,<br />
son entregent pour développer I’établissement qu’elle dirige et en étendre la noto-<br />
riété. Ni ses étu<strong>de</strong>s, ni son pass6 professionnel ne prédisposaient à cette fonction<br />
la personne à qui fut confiée, en 1960, la <strong>de</strong>stinée <strong>de</strong> la bibliothèque municipale<br />
<strong>de</strong> Laon. Sa personnalité, en revanche, attirait <strong>de</strong>puis longtemps l’attention sur<br />
cette dame et on avait déjia sollicité sa candidature à l’occasion <strong>de</strong>s élections<br />
municipales <strong>de</strong> 1953.<br />
Conseillère municipale<br />
Assez implantée pour être acceptée, elle avait cependant connu d’autres<br />
cieux ; assez engagée pour s’impliquer, elle faisait preuve néanmoins d’une lar-<br />
geur <strong>de</strong> vues et d’une tolérance <strong>de</strong> nature à la mettre au service <strong>de</strong> tous et elle<br />
obtint en effet, par le jeu du panachage, un excellent score à ce scrutin.<br />
Lu candidute<br />
L‘horizon <strong>de</strong> cette Laonnoise, qui résidait dans la maison <strong>de</strong> ses grands-<br />
parents, qu’on serait plus tard tenté d’appeler tant elle allait<br />
porter haut et loin la défense et illustration <strong>de</strong> la ville, ne se bornait pas au<br />
Laonnois. Originaire <strong>de</strong> Poissons (Marne) - ob elle naquit en 1910 - elle avait<br />
aussi vécu, petite fille, à Montdidier (Somme), à Lanester près <strong>de</strong> Lorient, puis à
Nersac en Charente et atteignait neuf ans quand sa Famille vint s’établir à Laon à<br />
l’issue <strong>de</strong> la Gran<strong>de</strong> Guerre. Par la suite, ses étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> droit à Paris I’écartèrent à<br />
nouveau <strong>de</strong> la ville, avant que son mariage ne l’entraîne à Vitry-le-François, <strong>de</strong><br />
1934 2 1936.<br />
Le mariage l’avait éloignée <strong>de</strong> Laon, la maladie allait la séparer <strong>de</strong> son<br />
mari et <strong>de</strong> ses trois premiers enfants. Elle consacra d’ailleurs une année <strong>de</strong> repos<br />
obligatoire sur le plateau d’Assy à son enrichissement intellectuel. La guerre<br />
l’évacua ensuite, avec ses enfants, à Sablé, puis h Solesmes, où elle mit à profit<br />
les possibilités <strong>de</strong> l’abbaye et s’initia au chant grégorien. Revenue 2 Laon après<br />
les hostilités, elle habita la maison où on l’avait amenée toute enfant chez sa<br />
grand-mère et où elle avait longtemps vécu pendant l’entre-<strong>de</strong>ux-guerres ; elle<br />
put <strong>de</strong> la sorte apporter un concours éclairé iì la chorale <strong>de</strong> sa paroisse, Saint-<br />
Marcel.<br />
Mais ses amis retrouvés attendaient d’elle davantage et l’incitèrent à<br />
prendre une responsabilité communale. On connaît l’ouverture d’esprit <strong>de</strong> la<br />
catholique engagée, pleine d’admiration pour sa grand-mère paternelle luthérien-<br />
ne, dont elle gardait un souvenir ébloui, et d’affection pour son grand-père anti-<br />
clérical dont le long cortège <strong>de</strong>s obsèques civiles, à Neufchltel, avait engendré,<br />
en 1925, une réprobation bien pensante qui, portée jusqu’aux oreilles <strong>de</strong> sa peti-<br />
te-fille, l’avait alors scandalisée.<br />
Par ailleurs, n’avait-elle pas déjà milité, autour <strong>de</strong> Georges Hoog, dans le<br />
mouvement Jeune République <strong>de</strong> Marc Sangnier, dès la fin <strong>de</strong>s années vingt, pour<br />
avoir pris la guerre en horreur dix ans plus tôt en découvrant avec ses parents les<br />
angoissants paysages <strong>de</strong>s champs <strong>de</strong> bataille : villages rasés, N partout <strong>de</strong>s<br />
tombes, <strong>de</strong>s fils <strong>de</strong> fer barbelés, <strong>de</strong>s obus abandonnés, plus aucun arbre, rien que<br />
<strong>de</strong>s troncs déchiquetés, sans feuillage en plein été N sur le Chemin <strong>de</strong>s Dames ?<br />
N’était-elle pas, enfin, docteur en droit, posskdant <strong>de</strong> ce fait les connais-<br />
sances juridiques nécessaires pour participer à l’administration d’une ville ? Cette<br />
formation <strong>de</strong> juriste, sans doute, l’avait incitée à s’intéresser <strong>de</strong>puis longtemps à<br />
la vie politique. Elle ne se présenta pas aux suffrages <strong>de</strong>s Laonnois sur la liste <strong>de</strong><br />
Marcel Levindrey qui remporta les élections, mais fut élue sur la liste adverse.<br />
L’élue<br />
La nouvelle conseillère était inscrite h la quatrième commission qui trai-<br />
tait, en particulier, <strong>de</strong>s affaires sociales. Pendant six ans et plus, elle mil en ccuvre<br />
sa clairvoyance et une gran<strong>de</strong> ténacité, autant que son pouvoir, pour résoudre<br />
chaque jour les problèmes divers et difficiles que venaient lui poser directement,<br />
même après la fin <strong>de</strong> son mandat, ses concitoyens les plus démunis.<br />
2. La célèbre abbaye avait été, dès le XIX‘ sikcle, iì l’origine d’un courant <strong>de</strong> piété, Vie liturgique >>,<br />
grâce à<strong>de</strong>s travaux sur la liturgie romaine et le chant grégorien. travaux qui s’y poursuivaient el per-<br />
mettaient <strong>de</strong> s’initier i ce chant auprès <strong>de</strong> ses maîtres les plus savants.<br />
3. Extraits <strong>de</strong> e mémoires >>, non <strong>de</strong>stinés A l’édition. h its par Summe Martinet pour lhire connaître<br />
ses souvenirs <strong>de</strong> famille i ses <strong>de</strong>scendants.
Or, la pénurie nationale <strong>de</strong> logements, liée à la politique économique <strong>de</strong><br />
l’immédiat après-guerre, prit un tour dramatique dans la froidure exceptionnelle<br />
<strong>de</strong> l’hiver 53-54 et suscita, au sein du célèbre mouvement <strong>de</strong> l’abbé Pierre, la<br />
création <strong>de</strong>
96<br />
Historienne<br />
Urie vocation cotztruribe<br />
Son goût pour l’Histoire avait dû naître avec Suzanne Goulard. Mais, en<br />
l’associant dès son plus jeune bge à leur tourisme culturel, ses parents le nourri-<br />
rent régulièrement, naturellement, inconsciemment peut-être.<br />
Elle s’en souvenait très bien : <strong>de</strong> Poissons, lorsque la famille allait prendre<br />
le > à Joinville, Sumnne <strong>de</strong>mandait à saluer le ><br />
qu’on voit toujours sur la place et sa mère avait dû raconter à sa toute petite fille<br />
l’histoire <strong>de</strong> ce L‘année suivante, à Rouen, elle vit la<br />
plaque marquant l’endroit du bûcher <strong>de</strong> Jeanne, encastrée dans la chaussée ! Ainsi<br />
flatté, son penchant se développa encore à I’école qu’elle fréquentait B Laon,<br />
<strong>de</strong>puis octobre 1919 : ><br />
L‘intérêt <strong>de</strong> Suzanne Goulard et <strong>de</strong> sa faniille pour cette discipline se reflétait<br />
aussi dans ses lectures préférées : d’abord Chaiisot~s <strong>de</strong> France et, surtout,<br />
Jemine d’Arc, illustrés par Louis Maurice Boutet <strong>de</strong> Monvel, puis Le riierrvilleux<br />
voyage <strong>de</strong> Nils Holgersori <strong>de</strong> Selma Lagerlöff, Colites populnires <strong>de</strong> I’Egypte<br />
ancietiiie <strong>de</strong> Gaston Maspéro, <strong>de</strong>s chansons <strong>de</strong> geste, <strong>de</strong>s ouvrages <strong>de</strong> Pierre<br />
Loti ... Comme on s’intéressait au style et au passé <strong>de</strong>s monuments variés disséminés<br />
dans le Laonnois et rencontrés au cours <strong>de</strong> longues promena<strong>de</strong>s dominicales<br />
en famille, comme on parlait d’histoire et d’histoire <strong>de</strong> l’art à la maison, on<br />
célèbrait les travaux d’Émile Mble et, sans oser l’espérer, l’adolescente rêvait <strong>de</strong><br />
possé<strong>de</strong>r L’art religieux du XIP siècle en Frcrrice qu’il venait <strong>de</strong> publier, en 1923.<br />
Son père lui offrit ce ca<strong>de</strong>au magnifique qui lui permit <strong>de</strong> franchir une nouvelle<br />
étape dans la connaissance <strong>de</strong> la cathédrale à laquelle l’avait déjB introduite une<br />
conférence <strong>de</strong> l’archiviste Lucien Broche complétée, sur le terrain, par l’observation<br />
détaillée du monument, <strong>de</strong> long en large et même <strong>de</strong> haut en bas, avec la<br />
complicité active et instructive <strong>de</strong> Monsieur Bi<strong>de</strong>aux, sacristain érudit.<br />
I1 n’était pas question <strong>de</strong> s’arrêter en si bonne voie. Nantie <strong>de</strong> son baccalauréat,<br />
en 1928, Suzanne voulut mettre le cap sur la prestigieuse École <strong>de</strong>s<br />
Chartes. Cette fois, le rêve ne se réalisa pas. Monsieur Goulard, certes cultivé et<br />
amateur d’art, était aussi docteur en droit. II va <strong>de</strong> soi qu’il offrit 2 sa fille <strong>de</strong> faire<br />
<strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures ... <strong>de</strong> droit, naturellement. Elle furent menées bon train,<br />
avec sérieux et succès.<br />
4. Ibid.<br />
5. Ihid.<br />
6. Ibid.
Uri periclicrnt persistunt<br />
Les aniours avec l’histoire ne sont cependant pas mortes. Suzanne<br />
Martinet la retrouva et en découvrit une autre approche au fil <strong>de</strong> longues conver-<br />
sations avec Jean Scapula’, consigné comme elle sur le plateau d’Assy oÙ ils<br />
firent connaissance. Puis elle eut, pour la première fois, accès à <strong>de</strong>s textes médié-<br />
vaux et à leur lecture en fréquentant l’abbaye <strong>de</strong> Solesmes. Là, elle sympathisa<br />
avec la famille, également réfugiée, du proíesseur Barbet, chirurgien parisien qui<br />
étudiait le Suaire <strong>de</strong> Turin. Cette attirance, toujours sous-jacente et tout à fait per-<br />
sonnelle, pour l’histoire <strong>de</strong>vait évi<strong>de</strong>mment amener l’attention d’une conseillère<br />
municipale sur les possibilités touristiques inexploitées <strong>de</strong> Laon et elle la condui-<br />
sit à s’intéresser <strong>de</strong> plus en plus au passé médiéval local.<br />
Engagée sur une telle voie, Suzanne Martinet ne cessa plus <strong>de</strong> communi-<br />
quer son réel enthousiasme pour le site, qu’elle faisait visiter, dont elle faisait<br />
connaître l’histoire par ses conférences, toujours plus <strong>de</strong>mandées, et par ses<br />
écrits. Un travail <strong>de</strong> dilettante, relevant initialement d’un pur intérêt personnel<br />
porté à l’histoire <strong>de</strong> Laon et <strong>de</strong> ses monuments, peu B peu sous-tendu par I’anibi-<br />
tion <strong>de</strong> biìtir un renom à la ville, la conduisit vers ses premières publications. Ses<br />
articles et brochures, <strong>de</strong>stinés au départ à encourager un tourisme éclairé et à<br />
éveiller l’intérêt <strong>de</strong>s visiteurs pour les monuments majeurs <strong>de</strong> Laon, mettent en<br />
lumière leur place éininente dans l’histoire et l’architecture, en relèvent les parti-<br />
cularités et le sens, sous un angle plus culturel que proprement historique.<br />
Sur sa lancée, la conseillère renonp finalement à solliciter un nouveau<br />
mandat municipal afin <strong>de</strong> briguer le poste <strong>de</strong> bibliothécaire dont le titulaire,<br />
Pierre Lefèvre, se trouvait sur le point <strong>de</strong> faire valoir ses droits h la retraite. Pierre<br />
Lefèvre ne se trompa pas en l’incitant et en l’encourageant dans ce sens, puis en<br />
soutenant sa candidature avec vigueur. Entrée en fonction le I“ juin 1960 dans cet<br />
établissernent au riche fonds ancien dont elle allait prendre toute la mesure,<br />
Suzanne Martinet, qui avait désormais les coudées franches pour appuyer ses<br />
Ctu<strong>de</strong>s sur une documentation <strong>de</strong> première main dont l’exploitation lui <strong>de</strong>vint <strong>de</strong><br />
plus en plus familière, put enfin donner libre cours à son goût pour l’histoire.<br />
Ses premiers ouvrages, La cuthCrlr-crle <strong>de</strong> Laon, publié aux Nouvelles Édi-<br />
tions latines dans la collection >, s.d., qui fut l’objet d’une<br />
secon<strong>de</strong> édition, et Laon Aisne, publié en 1971 aux éditions SAEP à Colmar-<br />
Ingersheirn, appartiennent nettement au volet touristique <strong>de</strong> son axivre. On peut<br />
y rattacher trois brochures plus tardives aux Éditions du Courrier <strong>de</strong> /’Aisne : en<br />
1979, Laon, ancienne capitule <strong>de</strong> In Fr-nnce, réédité dix ans plus tard ; Lu Srririte<br />
Filce <strong>de</strong> L~rori et soil histoire, en 1988 ; et, sous une toute nouvelle forme, La<br />
cnthkdriile <strong>de</strong> Luon, l’année suivante. Elle collabora par ailleurs, en 197 I , avec<br />
Georges Dumas, directeur <strong>de</strong>s archives départementales, à un ouvrage <strong>de</strong>stiné à<br />
divulguer les plus intéressantes pièces <strong>de</strong>s archives départementales et <strong>de</strong> la<br />
7. Jean Scapula, auteur, en particulier, dc l’exploration archéologique et <strong>de</strong> la mise en valcur du site<br />
et <strong>de</strong> I’église aux trois sanctuaires <strong>de</strong> l’Isle-Auinont (Auhe).<br />
97
98 Jacqueline Danysz<br />
Suzanne Martinet au pone-voix, 1981.<br />
bibliothèque municipale. I1 s’agit <strong>de</strong> L’histoire <strong>de</strong> l’Aisne, livre réalisé par<br />
l’Imprimerie du Courrier <strong>de</strong> Z’Aisne. Ce <strong>de</strong>rnier travail se situe déjà sur le versant<br />
plus scientifique <strong>de</strong>s préoccupations <strong>de</strong> la bibliothécaire qui a eu et aura plusieurs<br />
occasions <strong>de</strong> collaborer avec Georges Dumas.<br />
Une historienne pas comme les autres<br />
Ainsi, la démarche historique <strong>de</strong> Suzanne Martinet, doublement originale,<br />
commença à l’adolescence par une découverte approfondie <strong>de</strong> l’ancienne cathé-<br />
drale qui déborda ensuite sur celle <strong>de</strong>s monuments voisins et <strong>de</strong> leur histoire. Ce<br />
cheminement peu classique induisit chez elle une approche chronologique inha-<br />
bituelle qui la conduisit <strong>de</strong>s prémisses <strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> gothique vers les temps caro-<br />
lingiens, puis mérovingiens et gaulois.<br />
Le contact constant avec <strong>de</strong>s manuscrits anciens et avec les historiens<br />
venus les consulter invita leur conservatrice à les considérer d’un point <strong>de</strong> vue<br />
scientifique. Suzanne Martinet s’engagea dans une recherche historique, sans<br />
jamais dissocier son travail <strong>de</strong> sa vie. Elle se lia d’amitié avec les chercheurs qui<br />
fréquentaient la bibliothèque, les intéressa à ses propres recherches et les impli-<br />
qua dans ses projets tout comme elle y associait ses proches.<br />
Une gran<strong>de</strong> complicité intellectuelle s’instaura entre les Martinet et l’abbé<br />
Merlette, qui passait sa vie dans les bibliothèques. Ce chercheur a tres rarement
publié mais il fit bénéficier Suzanne Martinet <strong>de</strong> toute l’étendue <strong>de</strong> sa culture et<br />
<strong>de</strong> sa documentation et elle tenait grand compte <strong>de</strong> son esprit critique.<br />
Elle-même instruisait aussi volontiers les Laonnois, dans un contact indi-<br />
viduel. Elle était soucieuse d’informer, peu avare <strong>de</strong> son temps, perpétuellement<br />
ouverte à un échange personnel. c< Oui, précisait-elle à une interlocutrice, l’ancien<br />
séminaire abritait, avant guerre, une institution <strong>de</strong> jeunes aveugles, mais égale-<br />
ment <strong>de</strong> sour<strong>de</strong>s-muettes ; on faisait même <strong>de</strong>s confusions : en robe <strong>de</strong> mariée,<br />
sur le point <strong>de</strong> monter au bras <strong>de</strong> mon père les marches <strong>de</strong> Saint-Marcel, j’ai<br />
entendu dire, pour commenter un mouvement qui se produisait à l’entrée <strong>de</strong><br />
I’église : “Ce sont les sour<strong>de</strong>s-muettes qui arrivent pour chanter la messe”. J’ai<br />
bien failli avoir un fou rire. >)<br />
En 1975, sous la rubrique Elle était alors <strong>de</strong>puis longtemps à la retraite<br />
et le conférencier n’avait pas eu l’occasion <strong>de</strong> la rencontrer, inais elle I’écoutait<br />
ravie.<br />
A tort ou 2 raison, on pourrait lui reprocher l’idée d’une permanence <strong>de</strong> la<br />
nature humaine qui la conduisait à prêter sa propre psychologie aux humains <strong>de</strong><br />
tous les temps, sous tous les cieux, et un regard excessivement
Elle seule fut surprise par la question <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux <strong>de</strong> ses petites-filles lui<br />
<strong>de</strong>mandant un jour si elle avait connu Charlemagne et concluant d’elles-mêmes,<br />
<strong>de</strong>vant la négative : )<br />
Stupéfaction <strong>de</strong> la grand-mère ! I1 est vrai qu’elle s’attachait tant aux personnages<br />
dont elle faisait I’étu<strong>de</strong> qu’ils semblaient être ses familiers et <strong>de</strong>venaient, dans une<br />
certaine mesure, ses héros, au point que <strong>de</strong>s rues <strong>de</strong> la ville prirent peu à peu leurs<br />
noms sous son intluence.<br />
Suivons-la en Egypte avec sa petite-fille. Elles s’intéressent aux princi-<br />
paux égyptologlies mentionnés sur le haut <strong>de</strong> la fqa<strong>de</strong> du musée du Caire et, <strong>de</strong><br />
leur place, elles ont peine à déchiffrer l’un <strong>de</strong>s noms : > notre<br />
à fait particulière, imbriquant. pour ainsi dire, sa propre personne iì ses recherches<br />
et ses travaux à sa vie.<br />
Le colloque interncrtioncrl<br />
C’est, sans nul doute, par ses propres travaux, par sa manière <strong>de</strong> les<br />
conduire, mais aussi par sa personnalité, qu’elle sut attirer Laon, du 7 au 12<br />
juillet 1975, dans le cadre <strong>de</strong>s colloques internationaux du CNRS, le colloque<br />
Jean Scot Erig2ize et 1 ‘Histoire <strong>de</strong> la Philosophie. Elle en orchestra personnelle-<br />
ment sur place la logistique. Les sociétés savantes <strong>de</strong> Laon et <strong>de</strong> tout le dkparte-<br />
ment furent associées à la rencontre qui réunit, au chef-lieu, dans les locaux du<br />
Petit Saint-Vincent, une cinquantaine <strong>de</strong> spécialistes <strong>de</strong>s manuscrits carolingiens<br />
parmi les plus éminents, provenant <strong>de</strong> dix pays différents du mon<strong>de</strong> occi<strong>de</strong>ntal.<br />
Ces savants purent établir sur place, à cette occasion, que le manuscrit du<br />
Coinnientriire <strong>de</strong> 1 ’Évangile <strong>de</strong> Jean par Jean Scot, dont l’exemplaire unique est<br />
conservé à la bibliothèque <strong>de</strong> Laon, est en partie autographe.<br />
Au cours du colloque, on put entendre plus <strong>de</strong> vingt conférences, dont une<br />
<strong>de</strong> Suzanne Martinet, et les actes furent publiés aux éditions du CNRS, sous la<br />
direction <strong>de</strong> René Roques, en 1977.<br />
Bibliothécaire<br />
Ceux qui ont eu l’occasion <strong>de</strong> la secondcr ou <strong>de</strong> la rencontrer dans I’exer-<br />
cice <strong>de</strong> cette fonction sont unanimes à reconnaître en Madame Martinet une gran-<br />
<strong>de</strong> bibliothécaire. L‘établissement qu’elle prit en mains à la suite <strong>de</strong> Pierre<br />
Lefèvre n’avait pratiquement rien <strong>de</strong> commun avec celui qu’elle livra, en défini-<br />
tive, à Jean Lefebvre, une vingtaine d’années plus tard.<br />
Rendre ?I Cémr<br />
La bibliothèque gérée par Pierre Lefèvre était installée dans l’ancien hatel<br />
Milon <strong>de</strong> Martigny, remanié au XIX‘ siècle en vue d’héberger bibliothèque et<br />
musée. II y conservait, dans un rangement thématique à l’ancienne, <strong>de</strong>s ouvrages<br />
nombreux et divers dont son étonnante mémoire lui permettait <strong>de</strong> connaître<br />
l’existence et la place exacte parmi les volumes accumulés sur <strong>de</strong>s rayonnages<br />
dont la disposition avait été imposée par l’exiguïté <strong>de</strong>s locaux. La fréquentation<br />
<strong>de</strong> la bibliothèque emplissait d’aise Suzanne Goulard, encore écolibe.
louait fort le travail déji accompli m&me s’il n’avait pas encore été possible<br />
d’dtablir le catalogue du fonds ancien. Elle allait elle-même s’atteler à cette tâche<br />
et parvenir à faire cataloguer près du tiers <strong>de</strong>s quelque cinquante mille volumes<br />
qu’il comporte.<br />
Lorsque, à la fin <strong>de</strong>s années 70, la tombe <strong>de</strong> Jacques-François-Laurent<br />
Devisme fut menacée <strong>de</strong> disparition au cimetière Saint-Just, Madame Martinet,<br />
alertée, se mobilisa en faveur <strong>de</strong> la conservation du monument et l’obtint. Ce<br />
juriste et homme politique avait été le premier historien <strong>de</strong> la ville.
avons remarqué à ce sujet l’accueil si personnel qui leur était réservé : Suzanne<br />
Martinet se liait souvent d’amitié avec eux, les recevait à sa table et surtout leur<br />
consacrait un temps considérable. Ils découvraient ainsi les possibilités offertes<br />
par le fonds ancien, les mettaient à profit dans leurs propres travaux et furent<br />
aussi conduits à proposer à leurs dudiants <strong>de</strong>s sujets <strong>de</strong> recherche qui en tiraient<br />
parti. La bibliothécaire recevait ces jeunes chercheurs avec un soin égal, s’infor-<br />
mait <strong>de</strong> leurs projets et <strong>de</strong> leurs préoccupations afin <strong>de</strong> pouvoir leur donner les<br />
meilleures indications et <strong>de</strong> les gui<strong>de</strong>r vers les pièces les plus intéressantes pour<br />
eux. Malgré l’espace gagné grâce à un rangement nouveau <strong>de</strong>s livres, en fonction<br />
<strong>de</strong> leur taille, adopté suivant les conseils <strong>de</strong> l’Inspection <strong>de</strong>s bibliothèques, la<br />
place manquait et la bibliothécaire, obligée <strong>de</strong> mettre à profit sa parfaite connais-<br />
sance du fonds ancien et <strong>de</strong> la collection d’autographes, servie par une excellen-<br />
te mémoire, les impressionnait. Très douée dans l’art <strong>de</strong> transmettre son savoir,<br />
elle ne ménageait jamais le temps qu’elle leur accordait, les faisant bénéficier à<br />
tous égards <strong>de</strong> son expérience.<br />
L‘histoire <strong>locale</strong> préoccupait la bibliothécaire au premier chef. Elle s’atta-<br />
chait à en développer le fonds avec l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Amis <strong>de</strong> la bibliothèque. Elle y<br />
apportait aussi, outre ses propres travaux, ceux <strong>de</strong>s chercheurs qu’elle encoura-<br />
geait et guidait. Ce fonds, qui s’est encore accru <strong>de</strong>puis son départ, est consulté<br />
<strong>de</strong> plus en plus fréquemment.<br />
Néanmoins, aux yeux <strong>de</strong> leur conservatrice, les biens <strong>de</strong> la bibliothèque<br />
appartenaient aux Laonnois, elle se sentait responsable <strong>de</strong> les mettre i leur portée<br />
pour leur en permettre la jouissance. Ainsi acceptait elle avec plaisir, à la <strong>de</strong>man-<br />
<strong>de</strong> par exemple <strong>de</strong> leurs maîtres ou <strong>de</strong> leurs catéchistes, <strong>de</strong> présenter <strong>de</strong> précieux<br />
documents aux enfants. Toujours, elle expliquait ce qu’elle montrait, elle en fai-<br />
sait comprendre l’intérêt, usant <strong>de</strong> mots et <strong>de</strong> motifs simplcs adaptés à I’âge <strong>de</strong><br />
ses auditeurs attentifs qui suivaient sans peine ses explications. Dans cette<br />
tranche d’fige, elle estimait aussi <strong>de</strong> son <strong>de</strong>voir d’encourager la lecture et lança, à<br />
cette fin, avec la complicité <strong>de</strong> maîtres et <strong>de</strong>s Amis <strong>de</strong> la Bibliothèque, un<br />
concours littéraire ouvert à tous les enfants. I1 imposait la lecture d’au moins un<br />
livre emprunté à la bibliothèque.<br />
Les plus belles pièces étaient présentées à l’occasion d’expositions théma-<br />
tiques qui ouvraient à chacun la possibilité <strong>de</strong> les connaître et <strong>de</strong> les apprécier. On<br />
peut avancer hardiment que tous les Laonnois ont eu, dc la sorte, la possibilité <strong>de</strong><br />
voir gratuitement une bonne part <strong>de</strong> leurs livres les plus précieux.<br />
Enfin, loin <strong>de</strong> les abandonner, il faut aller vers ceux qui ne fréquentent pas<br />
spontanément ces sortes <strong>de</strong> manifestations. Faisant fcu <strong>de</strong> tout bois, la bibliothé-<br />
caire avait tri3 bien compris le rôle d’amplificateur <strong>de</strong>s Heures médiévales D.<br />
La dynamique du festival multiplie les visiteurs <strong>de</strong>s expositions et la complé-<br />
mentarité <strong>de</strong>s activités enrichit chacune d’elles. Évoquons, à titre d’exemple,<br />
dans le cadre <strong>de</strong> ce festival, une exposition <strong>de</strong> la bibliothèque consacrée à Laflow<br />
<strong>de</strong> Prhzonrré, associée à la présentation inaugurale du jardin <strong>de</strong> plantes médici-<br />
nales créé, à l’abbaye <strong>de</strong> Vauclair, par le père Courtois. Précédée, la veille, par<br />
une conférence <strong>de</strong> Madame Martinet à la Maison <strong>de</strong>s Arts. la visite du tout nou-
veau jardin fut couronnée sur place, à Vauclair, par un concert <strong>de</strong> cuivres suivi<br />
d’un repas champêtre.<br />
Le levier >, manié par la bibliothécaire, prit plus <strong>de</strong><br />
puissance encore et les manuscrits rayonnèrent<br />
... j usque sur les tribunes <strong>de</strong> la cathédrale, où ils <strong>de</strong>vinrent musique par les<br />
voix <strong>de</strong> l’ensemble vocal <strong>de</strong> Laon, chantant sous la direction <strong>de</strong> Simone Tavernier<br />
les lau<strong>de</strong>s carolingiennes d’après le manuscrit 263 <strong>de</strong> Laon, hymnaire <strong>de</strong> la cathé-<br />
drale datant du XIIc siècle ;<br />
... j usque dans le laboratoire <strong>de</strong> la boulangerie Berthiot, où on confection-<br />
na, chaque année, pendant toute la durée du festival, <strong>de</strong> délicieuses rissoles<br />
dorées dont elle avait su retrouver la recette - <strong>de</strong>s salées et <strong>de</strong>s sucrées ;<br />
... jusque dans l’atelier arithmétique du ) oh, sous la<br />
férule <strong>de</strong> l’abbé Merlette, les gamins apprenaient à calculer à la nianière <strong>de</strong>s<br />
élèves <strong>de</strong> Raoul <strong>de</strong> Laon, dont le traité sur l’abaque se trouve > à la Bibliothèque nationale.<br />
Enfin, pour associer plus largement et plus fortement le public local, il<br />
paraissait judicieux <strong>de</strong> le faire passer du sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> consommateur à celui d’acteur.<br />
Madame Martinet encouragea dans cette perspective la naissance, le 24 mai 1967,<br />
d’une association : Les Amis <strong>de</strong> la bibliothèque.<br />
Ses statuts permettent à cette instance <strong>de</strong> solliciter <strong>de</strong>s subventions à plu-<br />
sieurs échelons et elle en obtiendra, tout au moins, <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Laon et <strong>de</strong> la<br />
Caisse d’Épargne. Depuis sa fondation, sous la prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> Monsieur<br />
Rodolphe-Rousseau, rapi<strong>de</strong>ment relayé par Madame Gilliard, elle a contribué au<br />
rayonnement <strong>de</strong> la bibliothèque grke à l’organisation <strong>de</strong> conférences. Elle a aussi<br />
apporté un soutien moral régulier aux diverses activités et une contribution finan-<br />
cière à l’achat <strong>de</strong> pièces susceptibles d‘enrichir le fonds ancien ou celui d’histoi-<br />
re <strong>locale</strong>, à I’édition <strong>de</strong> cartes postales <strong>de</strong>stinées à faire connaître quelques unes<br />
<strong>de</strong>s enluminures et autres illustrations parmi les plus belles ou les plus notables<br />
<strong>de</strong>s ouvrages anciens, enfin à l’organisation <strong>de</strong>s expositions. Lorsque cclles-ci ont<br />
été enrichies d’un catalogue, dont le premier, consacré à l’exposition Rolrrnd, a<br />
été le fruit d’une collaboration entre Madame Martinet et l’archiviste Cécile<br />
Souchon, les Amis <strong>de</strong> la bibliothèque en ont le plus souvent assuré la diffusion.<br />
La bibliothèque prit, peu 2 peu, une dimension telle qu’elle menaçait <strong>de</strong><br />
faire éclater la trop étroite enveloppe <strong>de</strong> ses locaux.<br />
Corselée dans I’h8tel Milon <strong>de</strong> Martigny, telle la rose en son bouton, la<br />
bibliothèque ne pouvait éclore qu’en s’en échappant. Sa conservatrice en prit vite<br />
conscience et rechercha sans tar<strong>de</strong>r un site propice au déploiement <strong>de</strong>s collcctions<br />
entassées rue du Bourg.
Les bâtiments <strong>de</strong> l’ancienne abbaye Saint-Martin, endommagés par le<br />
bombar<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> 1944 et désertés <strong>de</strong>puis, ne reprendraient jamais leur fonction<br />
hospitalière puisque l’on venait <strong>de</strong> construire un nouvel hepital. On attendait leur<br />
restauration et ils n’avaient pas encore d’affectation. Or, on nc pouvait imaginer<br />
locaux plus élégants, plus spacieux, plus proches d’importants établissenients<br />
scolaires, en un niot plus indiqués pour abriter la bibliothèque. Ainsi logée, elle<br />
offrirait en outre au public accès à l’un <strong>de</strong>s plus remarquables monuments <strong>de</strong> la<br />
ville : il restait à en convaincre les déci<strong>de</strong>urs.<br />
En prenant la responsabilité <strong>de</strong> la bibliothèque, Madame Martinet avait<br />
l’intention d’y ouvrir plusieurs axes <strong>de</strong> développement et elle allait <strong>de</strong>voir, pour<br />
y parvenir, gagner l’appui <strong>de</strong>s principales autorités concernées. Nous avons<br />
remarqué que sa métho<strong>de</strong> a consisté à travailler au grand jour, à faire voir la<br />
progression <strong>de</strong> ses entreprises et à en faire percevoir l’utilité par tous les<br />
publics, et donc par les gestionnaires <strong>de</strong> la ville, du département ou <strong>de</strong>s biblio-<br />
thèques, par les responsables <strong>de</strong> la Culture et <strong>de</strong> I’Éducation. La bibliothécaire,<br />
ambassadrice <strong>de</strong> la bibliothèque, sut toujours obtenir que son action soit appré-<br />
ciée par le maire et le préfet, avec qui elle entretenait <strong>de</strong>s relations personnelles,<br />
ou d’une façon générale par les diverses personnalités en jeu. Elle gagna leur<br />
adhésion à ses projets. La proposition du transfert <strong>de</strong>s locaux intervint dès le<br />
milieu <strong>de</strong>s années 60. La conservatrice tit preuve à cet égard d’une ténacité<br />
extraordinaire, défendant le projet avec une énergie farouche, stigmatisant,<br />
après avoir obtenu accord et financement <strong>de</strong>s autorités <strong>locale</strong>s avec le soutien<br />
<strong>de</strong> l’Inspection générale <strong>de</strong>s bibliothèques,
établissement déployé à l’abbaye Saint-Martin, bientOt informatisé et pourvu en<br />
outre d’antennes en ville basse.<br />
Gran<strong>de</strong> figure <strong>de</strong> la vie associative laonnoise<br />
Comme conseillère municipale puis comme bibliothécaire, Madame<br />
Martinet ne manqua pas d’être sollicitée pour <strong>de</strong>venir membre <strong>de</strong> diverses asso-<br />
ciations. Elle apporta son concours à celles dont les objectifs s’accordaient à ses<br />
propres préoccupations, y acceptant, au besoin, <strong>de</strong>s responsabilités importantes.<br />
Les Atzcietzs Élèves<br />
Suzanne Goulard imprimait à son existence une continuité en vertu <strong>de</strong><br />
laquelle ses amitiés étaient fidèles. On ne s’étonnera pas <strong>de</strong> la voir appartenir, dès<br />
1925, à l’Association amicale <strong>de</strong>s anciennes et anciens élèves <strong>de</strong>s collè, oes et<br />
lycées <strong>de</strong> Laon, puis siéger longuement à son conseil d’administration et accep-<br />
ter la fonction <strong>de</strong> vice-prési<strong>de</strong>nte.<br />
Ces sortes d’associations convient traditionnellement un ancien condis-<br />
ciple <strong>de</strong>venu célèbre à prési<strong>de</strong>r leurs rencontre et banquet annuels. L‘association<br />
laonnoise fit à sa vice-prési<strong>de</strong>nte l’honneur <strong>de</strong> la choisir pour tenir ce rôle à la<br />
rencontre <strong>de</strong> 1977. Le discours qu’elle prononça dans cette circonstance, ville, a été<br />
édité dans le bulletin <strong>de</strong> l’Association, assorti d’une présentation <strong>de</strong> la prési<strong>de</strong>n-<br />
te du jour par son ancienne camara<strong>de</strong> <strong>de</strong> classe, Ma<strong>de</strong>leine Pringuet.<br />
L ’~iii ive rsit e‘ du Temps 1 ibre<br />
A cette même pério<strong>de</strong>, Ma<strong>de</strong>leine Pringuet se déchargea, en prenant sa<br />
retraite, <strong>de</strong> la direction du lycée Paul Clau<strong>de</strong>l et se lança, bans tar<strong>de</strong>r, dans la fon-<br />
dation d’une université du Temps libre. Elle put compter sur l’appui <strong>de</strong> son<br />
ancienne camara<strong>de</strong> el amie. encore en activité, qui accepta la vice-prési<strong>de</strong>nce <strong>de</strong><br />
l’université et lança ses travaux en présentant, lors <strong>de</strong> la première réunion, le<br />
17 octobre 1977, une topographie <strong>de</strong> la ville à partir <strong>de</strong> plans anciens.<br />
L‘université lui doit, <strong>de</strong> 1982 à 1996, une moyenne <strong>de</strong> quatre interventions<br />
annuelles, bans compter <strong>de</strong>s visites guidées dans lesquelles elle se fit quelquefois<br />
assister par son fils Gabriel. Les sujets abordés étaient toujours très variés :<br />
<strong>de</strong>scriptions <strong>de</strong> manuscrits, évocations <strong>de</strong> monuments, présentations <strong>de</strong> person-<br />
nages <strong>de</strong> l’histoire politique ou religieuse ... et elle a terminé le 25 avril 1996 par<br />
un compte rendu <strong>de</strong> son récent voyage aux Etats-Unis. Elle évoqua alors le<br />
Mississippi, le père Marquette dont on venait <strong>de</strong> lui présenter une généalogie à<br />
l’université <strong>de</strong> Milwaukee et sa propre éniotion lorsqu’elle y découvrit <strong>de</strong>s<br />
Goulard, <strong>de</strong> Trigny, dont elle était elle-même <strong>de</strong>scendante.
Les Heures iddikvales<br />
Nous avons déjh relevé qu’elle contribuait h l’organisation du festival inti-<br />
tulé Évocutiorz <strong>de</strong>s heures rrikc1iPvcile.s & Laori qui, pendant un peu plus <strong>de</strong> vingt<br />
ans, tenta <strong>de</strong> replacer, une quinnine <strong>de</strong> jours par an, la vie intellectuelle et artib-<br />
tique laonnoise au diapason <strong>de</strong> celle qui <strong>de</strong>vait y régner au temps oÙ s’élevait la<br />
cathédrale. Conférences, théâtre, danse, concerts, défilés se succédaient alors<br />
dans la ville, tandis que ses principaux établissements culturels présentaient <strong>de</strong>s<br />
expositions généralement coordonnées et que <strong>de</strong>s artistes sollicités, ou tout au<br />
moins acceptés par les organisateurs, exposaient leurs auvres dans les plus beaux<br />
lieux rendus accessibles pour la circonstance.<br />
A la suite <strong>de</strong> Jean Garel, Roger Thirault, directeur du conservatoire <strong>de</strong><br />
musique, très t8t choisi comme responsable <strong>de</strong> cette manifestation à laquelle il<br />
attachait une gran<strong>de</strong> importance, voyait en Madame Martinet sa collaboratrice la<br />
plus précieuse, la plus eftïcace, la plus fidèle et, par lui, la plus écoutée. Elle sug-<br />
gérait les thèmes, proposait <strong>de</strong>s conférences et <strong>de</strong>s conférenciers, organisait tou-<br />
jours <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s expositions à la bibliothèque et apportait d’utiles conseils ou<br />
assistances dans les domaines les plus divers.<br />
En 1978, on célébra au cours <strong>de</strong> ce festival, à Laon - une <strong>de</strong>s patries sup-<br />
posées, selon Madame Martinet, du héros <strong>de</strong> Roncevaux - le douzième centenai-<br />
re <strong>de</strong> la célèbre bataille. Une plaque <strong>de</strong> céramique, inaugurée dans ces circons-<br />
tances sur la Porte d'Ardori, en conserve le témoignage.<br />
Les Aiiiis <strong>de</strong>s orgues<br />
Dans les années précédant son décès, survenu en 1966, le titulaire du grand<br />
orgue, Jules Fouquet, ne donnait ni n’accueillait plus <strong>de</strong> concerts sur son instru-<br />
ment. La nomination à sa succession <strong>de</strong> son assistante, Marie Ducrot, qui sou-<br />
haitait jouer en concert, allait entraîner, avec les encouragements du chanoine<br />
Vasseur, affectataire <strong>de</strong> I’édifice, un renouveau autour <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s orgues <strong>de</strong> l’an-<br />
cienne cathédrale <strong>de</strong> Laon.<br />
Plusieurs <strong>de</strong> ses amis, qui déploraient cotnine elle le silence <strong>de</strong> l’orgue en<br />
<strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s offices, entouraient Marie Ducrot, l’assistaient volontiers dans ses<br />
entreprises et encourageaient ses projets. Quelques-uns parmi eux, dont Madame<br />
Martinet, se rendaient bien compte que l’organiste et le clergé avaient besoin d’un<br />
soutien plus structuré dans leurs projets musicaux. Ils fondèrent, au mois <strong>de</strong> mai<br />
1969, une association <strong>de</strong>s Amis <strong>de</strong>s orgues <strong>de</strong> Laon dans le but >.<br />
Madame Martinet avait, dès l’origine, accepté d’en assumer la prési<strong>de</strong>nce. Elle<br />
avait, dans ce cadre, favorisé l’organisation <strong>de</strong> concerts et donné elle-même <strong>de</strong>s<br />
conférences au profit <strong>de</strong> l’entretien et <strong>de</strong> la restauration <strong>de</strong>s instruments. Dans<br />
cette pério<strong>de</strong>, sur le conseil <strong>de</strong> l’organiste Jean Langlais, le suivi régulier du<br />
grand orgue <strong>de</strong> la cathédrale fut coniïé au facteur Muller. Sa titulaire put, <strong>de</strong> la<br />
sorte, donner <strong>de</strong>s concerts et accueillir ceux <strong>de</strong> son maître Jean Langlais, puis <strong>de</strong>
1 O8 Jucqdine Danysz<br />
Marie-Claire Alain, André Marchal, Pierre Cochereau et <strong>de</strong> bien d’autres orga-<br />
nistes, célèbres ou non.<br />
L‘association, affiliée à la Fédération départementale <strong>de</strong>s amis <strong>de</strong>s orgues<br />
<strong>de</strong> I’Aisnc, permit un premier relevage <strong>de</strong> l’instrument par le facteur Muller à la<br />
fin <strong>de</strong>s années 70.<br />
La Socittt historiq~ie<br />
La passionnée d’histoire était, évi<strong>de</strong>mment, membre actif <strong>de</strong> la Société<br />
historique <strong>de</strong> Haute Picardie dont le siège, le lieu <strong>de</strong> réunion et la bibliothèque<br />
d’histoire <strong>locale</strong> sont aux archives départementales <strong>de</strong> l’Aisne. Son secrétariat<br />
était assuré par le directeur <strong>de</strong>s archives, Georges Dumas.<br />
Cette société est l’héritière <strong>de</strong> la Société académique <strong>de</strong> Laon, fondée en<br />
1850, ressuscitée après la Gran<strong>de</strong> Guerre, en 1922, l’année même où naissait une<br />
rivale plus aristocratique présidée par MM. <strong>de</strong> Hennezel d’Ormois et <strong>de</strong> Sars, la<br />
Société historique <strong>de</strong> Haute-Picardie. Sous ce <strong>de</strong>rnier vocable, faute <strong>de</strong> sujets<br />
d’étu<strong>de</strong> ou <strong>de</strong> territoires distincts et d’adhérents assez nombreux, les <strong>de</strong>ux socié-<br />
tés fusionnèrent en 1937, puis reprirent une activité régulière et unifiée sous I’in-<br />
fluence <strong>de</strong> l’inspecteur d’académie, Monsieur Dubu, après le second conflit mon-<br />
dial.<br />
Madame Martinet appartenait au conseil d’administration <strong>de</strong> la Société<br />
historique <strong>de</strong> Haute-Picardie. Lorsque le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière, le colonel<br />
Henri <strong>de</strong> Buttet, choisit, en 1980, <strong>de</strong> se retirer <strong>de</strong> sa fonction, Cécile Souchon, qui<br />
avait succédé <strong>de</strong>puis 1977 à Georges Dumas h la direction <strong>de</strong>s archives départe-<br />
mentales et également au secrétariat <strong>de</strong> la Société historique, se jognit au colonel<br />
<strong>de</strong> Buttet pour solliciter la candidature <strong>de</strong> Madame Martinet à la prési<strong>de</strong>nce. Prise<br />
<strong>de</strong> court, cette <strong>de</strong>rnière se résigna néanmoins à accepter >, et prit<br />
la charge le 5 novembre, précisant qu’elle n’y ferait face que pour une seule<br />
année ... La prési<strong>de</strong>nte et la secrétaire ne virent pas passer le temps, leur entente<br />
cordiale régna sur les <strong>de</strong>stinées <strong>de</strong> la société savante jusqu’au départ, en 1993, <strong>de</strong><br />
Cécile Souchon, relayée par Patrice Marcilloux. La prési<strong>de</strong>nte commençait à res-<br />
sentir vraiment le poids <strong>de</strong>s ans et souhaita fermement, cette fois, une relève : e I1<br />
faut que vous me trouviez un remplaçant, même si je le voulais, je ne peux plus<br />
assumer cette responsabilité >>, dit-elle à la réunion du conseil d’administration<br />
qui suivit l’assemblée générale <strong>de</strong> 1994, le <strong>de</strong>rnier auquel elle ait participé. Son<br />
appel fut entendu et Clau<strong>de</strong> Carême accepta <strong>de</strong> prendre la relève.<br />
En 1953-54, les sociétés historiques n’étaient plus en mesure <strong>de</strong> financer<br />
régulièrement <strong>de</strong>s publications. Fut alors constituée la Fédération <strong>de</strong>s Sociétés<br />
d’histoire et d’archéologie <strong>de</strong> l’Aisne regroupant les sociétés dc sept villes du<br />
département : Château-Thicrry, Chauny, Laon, Saint-Quentin, Soissons, Vervins<br />
et Villers-Cotterêts. L‘union faisant la force, la Fédération prit le relais <strong>de</strong> ces<br />
associations pour publier chaque année les travaux <strong>de</strong> leurs membres dans un<br />
volume <strong>de</strong> Mémoires qui accueillit volontiers les nombreux articles proposés par<br />
Madame Martinet. En effet, entre 1962 et 1987, on ne compte pas moins <strong>de</strong> 26<br />
articles signés d’elle.
Gran<strong>de</strong> Dame<br />
Suzarirle Goulurd-Mmtinet I o9<br />
Nous resterions bien incomplet si nous passions sous silence <strong>de</strong>s aspects<br />
plus privés <strong>de</strong> son personnage qui y ajoutent un éclairage intéressant et que,<br />
d’ailleurs, elle n’a jamais tenus secrets.<br />
De lu,f¿ririille<br />
Une jeune mère, laonnoise <strong>de</strong> fraîche date, étonnée et même choquée d’en-<br />
tendre Madame Martinet tenir à une mère <strong>de</strong> six enfants <strong>de</strong>s propos relatifs à la<br />
nécessité d’une éducation individualisée, apprit avec la plus gran<strong>de</strong> surprise que<br />
Madame Martinet connaissait la famille <strong>de</strong> son interlocutrice et avait, du reste,<br />
elle-même six enfants. II est vrai que, dans les années 70, personne n’imaginait à<br />
la docte dame, si souvent en représentation, cinq tils et une fille. Elle en faisait<br />
bien rarement cas.<br />
La Grammaire, brandissant dcs verges à la rose nord <strong>de</strong> la cathédrale, ne<br />
scandalisait guère leur maman qui citait plut6t la remarque <strong>de</strong> Guibert <strong>de</strong> Nogent<br />
à propos <strong>de</strong> son maître dans la discipline : >, Monsieur Martinet y participa <strong>de</strong> plus en plus. Au fur et à mesure<br />
qu’il eut davantage <strong>de</strong> temps, il permit à sa femme d’en gagner, allant jusqu’à<br />
traduire pour elle <strong>de</strong>s textes latins. I1 l’assistait dans la présentation <strong>de</strong>s exposi-<br />
tions temporaires <strong>de</strong> la bibliothèque, les dimanches <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> affluence, et la<br />
soutenait, d’une façon générale, dans toutes ses entreprises. Ainsi l’accompa-<br />
gnait-il dans <strong>de</strong>s voyages àbut historique ; nous les retrouvons par exemple pis-<br />
tant sur la terre anglaise les traces ténues <strong>de</strong> la gran<strong>de</strong> quête organisée par les<br />
chanoines <strong>de</strong> Laon au profit <strong>de</strong>s réparations à apporter à leur cathédrale après<br />
l’incendie <strong>de</strong> I 112.
Écoutons Ma<strong>de</strong>leine Pringuet s’adresser à son amie à la réunion <strong>de</strong>s<br />
anciens élèves en 1977 : )<br />
I1 y a dans le jardinet qui précè<strong>de</strong> sa maison un arbre à kiwi (actirzidin<br />
sinrnsis) très productif. <br />
De 1 ’cime et du corps<br />
Suzanne Goulard, confrontée dès son enfance, dans sa famille, à <strong>de</strong>s<br />
options philosophiques variées et même opposées, instruite dans une religion que<br />
ses parents ne pratiquaient guère, s’était déterminée très librement mais claire-<br />
ment et fermement en tant que chrétienne. Elle ne se détourna jamais <strong>de</strong> ses pré-<br />
occupations d’ordre spirituel. Paroissienne active, elle apportait à Saint-Marcel sa<br />
présence, sa générosité et sa rigueur habituelles, pratiquant un catholicisme sans<br />
sectarisme et se trouvant impliquée dans <strong>de</strong>s démarches œcuméniques, en parti-<br />
culier les rencontres entre catholiques et protestants organisées, à Laon, par I’ab-<br />
bé Raux, curé <strong>de</strong> Saint-Marcel.<br />
Se voulant historienne jusque dans ses bijoux, elle portait couramment<br />
l’un ou l’autre <strong>de</strong> ses colliers figurant <strong>de</strong>s oiseaux issus <strong>de</strong> manuscrits laonnois et,<br />
notamment, <strong>de</strong>s aigles d’époque carolingienne, sortes d’émaux cloisonnés, réali-<br />
sés à sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> par un orfèvre lyonnais, Monsieur Pelissier, dont elle appréciait<br />
le travail.<br />
Elle pratiquait elle-même le <strong>de</strong>ssin et il est à noter qu’elle a illustré <strong>de</strong> sa<br />
main un article consacré aux manuscrits <strong>de</strong> Foigny, en reproduisant plus <strong>de</strong> vingt-<br />
cinq gran<strong>de</strong>s majuscules, <strong>de</strong>s détails relevés sur certaines autres majuscules très<br />
ouvragées et <strong>de</strong> petits graffiti qui avaient été surajoutés sur diverses pages. Elle<br />
réalisa également tous les <strong>de</strong>ssins <strong>de</strong> la plaquette diffusée à l’occasion <strong>de</strong> I’expo-<br />
sition <strong>de</strong> manuscrits cisterciens organisée dans le cadre <strong>de</strong> l’année Saint-Bernard<br />
( 1990).<br />
Du fait <strong>de</strong> son grand respect pour autrui, et donc pour sa propre personne,<br />
elle s’imposait en permanence un maintien digne et une mise étudiée. Plutôt en<br />
avance sur les femmes <strong>de</strong> sa génération, elle était titulaire d’un permis <strong>de</strong> condui-<br />
re, mais elle ne s’en servait jamais. Lorsqu’il lui fallut, du fait <strong>de</strong> son grand âge,<br />
assurer sa démarche à l’ai<strong>de</strong> d’une canne, elle dut s’inspirer du Grand Siècle dans<br />
l’usage <strong>de</strong> cet accessoire, tant elle le maniait avec majesté.
De la personrie<br />
Nous avons vu un ministre décorer Madame Martinet. Nous l’avons<br />
découverte amie, vraiment, dc personnalités du mon<strong>de</strong> universitaire français ou<br />
étranger, d’artistes ou <strong>de</strong> hauts fonctionnaires, lout comme <strong>de</strong> personnes très<br />
simples qui, dans le besoin, n’hésitaient pas à avoir recours à elle. Nous l’avons<br />
entendue prononcer bien <strong>de</strong>s conférences ; toujours manifestement préparées<br />
avec soin, elles ne prenaient jamais un tour répétitif, mais étaient au contraire pré-<br />
sentées dans l’éclairage <strong>de</strong> ses <strong>de</strong>rniers travaux. Nous l’avons rencontrée en<br />
Allemagne, en Angletcrre, en Egypte, aux Etats-Unis, au cours <strong>de</strong> voyages à<br />
caractère historique ou familial. Nous l’avons poursuivie jusque dans sa vie per-<br />
sonnelle et l’avons partout trouvée égale, droite, généreuse, partageant son savoir<br />
autant que son avoir, se présentant sans fard, engageant sans s’encombrer <strong>de</strong><br />
conventions protectrices <strong>de</strong>s échanges personnels avec tout un chacun.<br />
Sa personnalité si posée, si complète, si attentive, si ample doit probable-<br />
ment laisser avant tout à ceux qui l’ont approchée le souvenir gardé d’elle par<br />
Pierre Riché, celui d’une gran<strong>de</strong> dame.<br />
Jacqueline DANYSZ<br />
Article rédigé avec les contributions <strong>de</strong><br />
Gabriel Martinet, Marie-Thérèse Nolle,<br />
Martine Plouvier, Ma<strong>de</strong>leine Pringuet et Cécile Souchon<br />
Jean Lefebvre, conservateur en chef <strong>de</strong>s bibliothèques <strong>de</strong> Laon,<br />
a consacré à Suzanne Martinet un article ln ineinoriain<br />
publié dans le tome XLIII (1 998) <strong>de</strong>s Mémoires <strong>de</strong> la Fédération<br />
<strong>de</strong>s sociétés d’histoire et d’archéologie <strong>de</strong> 1 ’Aisne.
I12 Juc.cpelitie Diiitys:<br />
I. PUBIKATIONS<br />
Bibliographie <strong>de</strong> Suzanne Martinet<br />
(< Laon, ville carrefour sur les chemins <strong>de</strong> Saint-Jacques <strong>de</strong> Compostelle )>, Revue<br />
belge d’archéologie et d’histoire <strong>de</strong> l’ut, t. 23, fasc. 1-2, 1954, p. Il 1-1 18.<br />
Georges Dumas et Suzanne Martinet, L’Histoire <strong>de</strong> l’Aisne vile à travers les<br />
richesses <strong>de</strong>s archives dlpurteinentales et <strong>de</strong> lu bil~liothèque <strong>de</strong> Laon,<br />
Courrier <strong>de</strong> l’Aisne, Laon, 1968, 132 p.<br />
, Actes du 95 Congrès national <strong>de</strong>s<br />
sociétés scivantes, Reims, 1970, p. 55-63.<br />
Lion (Aisne) 02, éditions SAEP, Colmar-Ingersheim, 1971, 90 p.<br />
Mordoori : reflet,fidèle <strong>de</strong> la montagne et cles environs <strong>de</strong> Laon <strong>de</strong> 1100 à 1300,<br />
Courrier <strong>de</strong> l’Aisne, Laon, 1972, 173 p.<br />
, Dossiers <strong>de</strong> l’archéologie, no 14, janvier-<br />
février 1976, p. 26-34.<br />
114 Jrccqueline Danysz<br />
>, Mémoires <strong>de</strong> la<br />
Fédération <strong>de</strong>s sociétés d’histoire et d’archéologie <strong>de</strong> L’Aisne, t. XXIV,<br />
1979, p. 69-76.<br />
Quelques belles pièces <strong>de</strong> la bibliothèque municipale <strong>de</strong> Laon, catalogue <strong>de</strong><br />
l’inauguration du 16 juin 1980 <strong>de</strong> la nouvelle bibliothèque 2 l’abbaye Saint-<br />
Martin, 1980, 48 p.<br />
>, Les chartes et le mouvement communal<br />
: actes du colloque régional, octobre 1980, organisé en commémoration<br />
du neuvième centenaire <strong>de</strong> la Commune <strong>de</strong> Saint-Quentin, p. 27-38.<br />
>, Actes qfJiciels <strong>de</strong>s 4, 5, 6 et 7” colloques<br />
du Centre d’&i<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> recherches prkmontrées, 1980, p. 74-86.<br />
>, Mémoires <strong>de</strong> la<br />
Fédération <strong>de</strong>s sociétés d’histoire et cl’crrchéologie <strong>de</strong> l’Aisne, t. XXVI,<br />
1981, p. 57-63.<br />
, La chanson <strong>de</strong> geste et le mj-the carolingien : mélunges<br />
René Louis, 1982, p. 67-84.<br />
>, Amoul; mciriage et<br />
trmsgressions au Moyen Age : actes du colloque <strong>de</strong>s 24, 25, 26 et 27 mars<br />
1983, université <strong>de</strong> Picardie, Centre d’étu<strong>de</strong>s médiévales, p. 9-1 6.<br />
Trois érudits du X IF siècle : Edouard Fleury (1815-1883) [notices rédigées par<br />
Suzanne Martinet] ; Etienne Midoux (1829-1890) [notices rédigées par<br />
Andrée Rollas] ; Amédée Piette (1809-1883) [notices rédigées par Cécile<br />
Souchon], catalogue <strong>de</strong>s expositions présentées à la bibliothèque <strong>de</strong> Laon,<br />
au musée <strong>de</strong> Laon et aux archives <strong>de</strong> l’Aisne en septembre et octobre 1983,<br />
1983, non paginé.<br />
>, Mémoires <strong>de</strong> la Fédlration <strong>de</strong>s sociétés d’histoire<br />
et d’archéologie <strong>de</strong> 1 ’Aisne, t. XXVIII, 1983, p. 17-34.<br />
Suzanne Martinet et Cécile Souchon, , GuiIlaunie et Willehalrn : les épopéesfran-<br />
çaises et l’awvre <strong>de</strong> Wolfram von Eschenbuch : actes du colloque <strong>de</strong>s 12 et<br />
13 junvier 1985, université <strong>de</strong> Picardie, Centre d’étu<strong>de</strong>s médiévales,<br />
p. 7 1-80.<br />
Rois <strong>de</strong> France, rois <strong>de</strong> Lnon : F siècle, Courrier <strong>de</strong> l’Aisne, Laon, 1987, 188 p.<br />
>, L’Ami du Laonnois, no 1, mai 1987,<br />
p. 4-5.
Le Tortoir, s.d., 8 f., B.M.L. 20 CHL 47.<br />
Le mé<strong>de</strong>cin Guillaume d’Harcigny et son tomlmiu, 1967, 1 f., B.M.L. 4 CHL 80.<br />
Histoire du Sciuvoir : discours prononcé le jour <strong>de</strong> 1 ’inauguration <strong>de</strong> l’église du<br />
Sauvoir, 12 janvier 1969, 1969, 5 p., B.M.L. 16 CHL 13.<br />
Arsène Houssaye : dossier contencint 2 textes sur Arsène Houssaye, une biblio-<br />
graphie, 2 catalogues d’exposition (bibliothèque municipale <strong>de</strong> Laon, 1-8<br />
juin 1969), etc., 1969, n.p., B.M.L. 37 CHL 41.<br />
Les Frères Le Nain, 1971, 5 f., B.M.L. 16 CHL 47.<br />
Suzanne Martinet et Jean-Jacques Plantinet, Montage pièce et vitruil cathédrale<br />
<strong>de</strong> Lion sur : Gautier <strong>de</strong> Coincy, le miracle <strong>de</strong> Théophile, 1975, 20 p.,<br />
B.M.L. 19 CHL 17.<br />
Culte <strong>de</strong> saint Gilles dms les manuscrits <strong>de</strong> Luon, 1977, 4 f., B.M.L. 20 CHL 35.<br />
Historique du Val <strong>de</strong>s Écoliers, 1979, 4 f., B.M.L. 2 1 CHL 20.<br />
La relique <strong>de</strong> suint Laurent, [dossier contenant I’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> Suzanne Martinet et la<br />
photocopie <strong>de</strong>s lettres trouvées dans la chBsse <strong>de</strong> saint Laurent], 1979, n.p.,<br />
B.M.L. 42 CHL 50.<br />
Conférence sur Ernst Jünger, 1987, 25 p., B.M.L. 25 CHL 8.<br />
Bibliographie établie par Jean Lefebvre
Société historique et archéologique<br />
<strong>de</strong> Château-Thierry<br />
Séance <strong>de</strong> création du 9 septembre 1864<br />
Le vendredi 9 septembre 1864, une réunion coinposée <strong>de</strong> MM. Buirette,<br />
curé <strong>de</strong> Gland, Chauvac <strong>de</strong> La Place, ingénieur, chef <strong>de</strong> section au chemin <strong>de</strong> fer<br />
<strong>de</strong> l’Est, Gourniain, curé <strong>de</strong> Chézy-I’ Abbaye, membre <strong>de</strong>s Sociétés savantes <strong>de</strong><br />
Picardie, <strong>de</strong> Saint-Quentin, Laon et Abbeville, Hachette, ingénieur en chef <strong>de</strong>s<br />
Ponts et Chaussées, Harant, agent Voyer <strong>de</strong> l’arrondissement <strong>de</strong> Chiteau-Thierry,<br />
Hilaire, curé <strong>de</strong> Nogentel, Mayeux, propriétaire à Étampes, Perrin, propriétaire 2<br />
Chiìteau-Thierry, Petit, docteur en mé<strong>de</strong>cine à Chiteau-Thierry, Pignon, curé <strong>de</strong><br />
Crézancy, membre <strong>de</strong> la Société archéologique <strong>de</strong> Soissons, Renaud, imprimeur<br />
à Château-Thierry, Souliac, propriétaire à Chiteau-Thierry, membre correspon-<br />
dant du Comité impérial au ministère pour les Travaux historiques et membre <strong>de</strong><br />
la commission <strong>de</strong>s antiquités du département <strong>de</strong> l’Aisne, Usson, archiprêtre <strong>de</strong><br />
Chiteau-Thierry, membre <strong>de</strong> la Société archéologique <strong>de</strong> Soissons, <strong>de</strong> Vertus,<br />
propriétaire iì Brécy, membre correspondant <strong>de</strong> l’Institut historique <strong>de</strong> France, eut<br />
lieu dans la gran<strong>de</strong> salle <strong>de</strong> l’hôtel <strong>de</strong> ville <strong>de</strong> Chiteau-Thierry, dans le but <strong>de</strong> fon-<br />
<strong>de</strong>r une société historique et archéologique pour la ville et l’arrondissement.<br />
Pour entrer <strong>de</strong> suite en séance et procé<strong>de</strong>r avec ordre, M. Usson, archi-<br />
prêtre <strong>de</strong> Chiteau-Thierry, et M. Gourmain, curé <strong>de</strong> Chézy-I’ Abbaye, furent priés<br />
d’accepter provisoirement, l’un, l’honneur <strong>de</strong> la prési<strong>de</strong>nce, et l’autre, les fonc-<br />
tions <strong>de</strong> secrétaire. On procèda à la lecture <strong>de</strong>s statuts et règlements <strong>de</strong> la société<br />
dont les articles, après quelques discussions, furent unanimement adoptés. Les<br />
quatre premiers articles sont les plus importants :<br />
Article 1” - La société prend le titre <strong>de</strong> Société historique et archéologique<br />
<strong>de</strong> Chiteau-Thierry. L‘étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’arrondissement et <strong>de</strong> tout ce qui s’y rat-<br />
tache, forme l’objet <strong>de</strong> ses travaux. Toutes matières politiques ou discus-<br />
sions religieuses lui seront étrangères.<br />
Article 2 - Le personnel <strong>de</strong> la société se compose <strong>de</strong> membres titulaires,<br />
honoraires et correspondants. Le nombre <strong>de</strong>s membres titulaires est fixé à<br />
trente, celui <strong>de</strong>s membres correspondants est illimité.<br />
Article 3 - La société s’attachera principalement à faire connaître, par <strong>de</strong>s<br />
Mémoires soigneusement rédigés, les monuments historiques, artistiques,<br />
littéraires et scientifiques <strong>de</strong> l’arrondissement. Elle étudiera les églises,<br />
abbayes, édifices communaux, châteaux, archives, manuscrits, statues,<br />
tableaux, médailles, etc.
La Géologie, pour laquelle notre contrée offre une matière si fécon<strong>de</strong>, ne<br />
lui sera point étrangère. Elle regar<strong>de</strong>ra comme partie importante <strong>de</strong> ses tra-<br />
vaux, la biographie <strong>de</strong>s hommes remarquables <strong>de</strong> la ville et <strong>de</strong> l’arrondis-<br />
sement. Elle appellera l’attention <strong>de</strong> l’autorité sur l’abandon ou la dégra-<br />
dation dont les monuments qui intéressent l’art, pourraient être menacés.<br />
Article 4 - Le bureau <strong>de</strong> la société se compose d’un prési<strong>de</strong>nt, d’un vice-<br />
prési<strong>de</strong>nt, d’un secrétaire, d’un sous-secrétaire, d’un trésorier et d’un<br />
archiviste.<br />
Tous les membres du bureau son nommés pour un an ; ils pourraient être<br />
réélus.. .<br />
La lecture <strong>de</strong>s statuts et règlement achevée, M. Souliac proposa l’admis-<br />
sion immédiate <strong>de</strong> plusieurs membres titulaires. La proposition fut acceptée.<br />
Après ces préliminaires, la Société fut d’avis unanime <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r inimédiate-<br />
ment à la nomination définitive <strong>de</strong> son bureau. L‘unanimité <strong>de</strong>s votes se porta sur<br />
M. l’abbé Usson, curé-archiprêtre <strong>de</strong> Château-Thierry, qui fut donc proclamé pré-<br />
si<strong>de</strong>nt, et M. Souliac, vice-prési<strong>de</strong>nt. Furent ensuite nommés successivement et à<br />
l’unanimité : M. l’abbé Gourmain, curé <strong>de</strong> Chézy-I’ Abbaye, secrétaire ;<br />
M. Renaud, imprimeur, sous-secrétaire ; M. Besnard, trésorier, et M. Perrin,<br />
archiviste.<br />
La Société tint ensuite ses séances le premier vendredi <strong>de</strong> chaque mois, à<br />
l’hôtel <strong>de</strong> ville <strong>de</strong> Château-Thierry et publia tous les ans la collection <strong>de</strong> ses<br />
Bulletirzs et Mémoires.<br />
Séance du 8 avril 1869, sous la prési<strong>de</strong>nce d’Amédée Hachette<br />
Le décès du propriétaire <strong>de</strong> la maison natale <strong>de</strong> Jean <strong>de</strong> La Fontaine,<br />
M. Guilloux, fournit l’occasion à la Société historique <strong>de</strong> réaliser le projet conçu<br />
<strong>de</strong>puis longtemps d’acquérir la maison natale du fabuliste. Sur l’initiative <strong>de</strong><br />
MM. Mayeux, Encelain et Barbey, la Société prit immédiatement les mesures<br />
nécessaires pour ouvrir une souscription nationale ayant pour objet l’achal <strong>de</strong> la<br />
maison qui <strong>de</strong>vait être consacrée à l’établissement d’un musée local et d’une<br />
bibliothèque publique, ainsi qu’a assurer A la Société historique les appartements<br />
nécessaires à son service et à ses besoins. Les autorisations nécessaires furent<br />
sollicitées et la souscription fut ouverte dans toute la France, notamment dans les<br />
collèges et les écoles.<br />
De nombreux encouragements arrivèrent bien vite à la Société ;<br />
l’Empereur, le ministre <strong>de</strong> l’Instruction publique, Victor Duruy, le conseil giné-<br />
ral, le conseil d’arrondissement et un grand nombre <strong>de</strong> personnes amies <strong>de</strong>s<br />
Lettres envoyèrent leurs souscriptions. Tout laissait présager un succès rapi<strong>de</strong><br />
lorsqu’éclata la guerre <strong>de</strong> 1870.
La souscription ouverte dès juillet 1869 n’avait pu, en août 1870, atteindre<br />
les proportions qu’on en attendait ; mais, après la guerre, la souscription reprit.<br />
Le 21 juin 1873, la Société historique pul sol<strong>de</strong>r aux héritiers Guilloux le prix <strong>de</strong><br />
la maison et les intérêts alors dus, au total 16 666,70 E La inaison appartenait<br />
donc li la Sociétk et son prési<strong>de</strong>nt en était le propriétaire apparent.<br />
La cession <strong>de</strong> la maison <strong>de</strong> Jean <strong>de</strong> La Fontaine<br />
à la ville <strong>de</strong> Château-Thierry.<br />
La Société historique décida <strong>de</strong> cé<strong>de</strong>r la maison à la ville afin d’en assurer<br />
la conservation. Le 18 mai 1875, le conseil municipal en accepta le principe, en<br />
assurant à la Société, pendant toute son existence, la jouissance <strong>de</strong>s pièces du pre-<br />
mier étage sur le côté attenant au collège.<br />
Tony LEGENDRE
SociPtP historique et archkdogiqire <strong>de</strong> Chiileau-Thierry<br />
Historiographie <strong>de</strong> l’archéologie à Château-Thierry<br />
ou<br />
naissance d’une archéologie urbaine <strong>de</strong> 1864 à 2000 :<br />
le r6le <strong>de</strong> la Société<br />
En cette fin <strong>de</strong> siècle, une attention particulière est portée à l’histoire <strong>de</strong> la<br />
recherche scientifique. La création, en 1986, du service municipal d’archéologie<br />
<strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Chsteau-Thierry et le développement <strong>de</strong> la recherche archéologique<br />
mo<strong>de</strong>rne sur le site du château et <strong>de</strong> la ville ne résultent pas uniquement d’une<br />
démarche volontaire ex-nihilo <strong>de</strong> la collectivité territoriale <strong>de</strong> gérer ses archives<br />
du sol et son patrimoine. Ils s’inscrivent dans un processus ancien et lent <strong>de</strong> prise<br />
<strong>de</strong> conscience où le rôle <strong>de</strong> la Société historique et archéologique <strong>de</strong> Château-<br />
Thierry fut déterminant. I1 s’agit d’une mo<strong>de</strong>ste recherche historiographique<br />
<strong>locale</strong> sur I’émergence d’une discipline. Elle tend à montrer le lien et la continuité<br />
dans la recherche tout en rendant un hommage appuyé à la société savante<br />
castro-théodoricienne.<br />
A l’aube du troisième millénaire, l’archéologie se définit elle-même<br />
comme une science, niais il est évi<strong>de</strong>nt que ce statut ne lui a pas été accordé<br />
d’emblée. 11 convient aussi <strong>de</strong> rappeler que le débat sur ses relations avec I’his-<br />
toire ou encore la philologie est loin d’être épuisé. Cette > la<br />
Société. L‘impuissance face aux <strong>de</strong>structions massives <strong>de</strong>s archives du sol <strong>de</strong> la
122 Frmgois Bltrry<br />
ville dans ces années, l’absence <strong>de</strong> métho<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> moyens adaptés à ce type d’ar-<br />
chéologie ont progressivement détourné les chercheurs <strong>de</strong> la Société savante. La<br />
collectivité a pris le relais en dotant la ville d’un service adapté à l’acquisition et<br />
à la gestion <strong>de</strong> ces archives du sol (( pourvoyeuses d’histoire D. A l’heure où notre<br />
petite ville, comme notre Société, subit <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>s transformations, I’archéolo-<br />
gie a un rôle non négligeable h jouer dans la définition et le maintien d’une i<strong>de</strong>n-<br />
tité culturelle, et son histoire atteste sa capacité à l’assumer.<br />
La prise <strong>de</strong> conscience historique après la Révolution française<br />
Après la tourmente révolutionnaire I, un abbé du nom <strong>de</strong> Hébert se réfugia<br />
à Château-Thierry chez son cousin, M. Hou<strong>de</strong>t, maire <strong>de</strong> la ville. Cet homme,<br />
aussi savant que lettré, était atteint d’un bégaiement assez prononcé. II ne fut donc<br />
pas retenu dans la partie active <strong>de</strong>s prgtres du diocèse <strong>de</strong> Soissons lors <strong>de</strong> la<br />
réorganisation <strong>de</strong> l’exercice du culte, en 1802 ; le confessionnal lui fut même<br />
interdit ’. Ce grand érudit consacra ce temps <strong>de</strong> e chômage >> à réunir et h com-<br />
pulser les quelques sources écrites se rapportant à Chlteau-Thierry qui avaient<br />
échappé aux <strong>de</strong>structions massives et au pillage <strong>de</strong> ces temps troublés. II rassem-<br />
bla dans ses Mkmoir-es, entre le 15 novembre 1804 et le samedi 29 novembre<br />
1806, un matériel d’étu<strong>de</strong> irremplaçable pour l’histoire <strong>de</strong> la ville ’. Organisée en<br />
huit cahiers ou chapitres ’, cette œuvre pionnière et remarquable est cependant<br />
restée manuscrite ’. Tous les érudits et autres chercheurs qui ont écrit ou qui se<br />
sont intéressés à l’histoire <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Chliteau-Thierry, <strong>de</strong> l’abbé Poquet jus-<br />
yu’à Georges Pommier, ont puisé leur documentation dans un manuscrit rédigé<br />
par l’abbé Hébert ’, au début du XIX siècle.<br />
I . La ville. rebaptisée Egalité-sur-Marne. Fut marquée par la disparition <strong>de</strong>s archives conservées au<br />
chiteau. suivie <strong>de</strong> la <strong>de</strong>struction <strong>de</strong>s égliws <strong>de</strong> Saint-Martin et <strong>de</strong> Notre-Dame-du-Chileau.<br />
2. L. A. Riboulot, (* Les historiens <strong>de</strong> Chiteau-Thierry m. ASHACT. 1922.<br />
3. Pour l’anecdote, l’auteur achève son travail par ces mots : (( Ne pouvant autrement acquitter ma<br />
contribution d’utililé publique, envers la Société au milieu <strong>de</strong> laquelle je vis : Je lui offre sous les<br />
auspices <strong>de</strong> M. Hou<strong>de</strong>t, ofticier dans le I ’ régiment <strong>de</strong> hujsards, ce\ ménioires historiques sur<br />
ChBteau-Thierry, pour fournir <strong>de</strong>s matériaux celui qui voudrait faire quelque chose dc mieux, sur<br />
l’histoire <strong>de</strong> cette ville. >><br />
4. L‘organisation <strong>de</strong> ces niémoires wit tin plan chronologique événementiel : I. Noms et topographies<br />
<strong>de</strong> Chitcau-Thierry ; 2. Origine <strong>de</strong> Chlteau-Thierry : 3. Sous les cnmtes <strong>de</strong> Vcrmandoia ; 4.<br />
ChBteau-Thierry SOUL ses seigneurs particuliers ; 5. Chitcau-Thierry sou\ les comtes <strong>de</strong><br />
Champagne ; 6. ChBleau-Thierry sous le\ rois <strong>de</strong> France : 7. ChBteau-Thierry sous les ducs <strong>de</strong><br />
Bouillon ; 8. Chiteau-Thierry pendant la Révolution.<br />
5. L‘ouvrage <strong>de</strong> l’abbé Poquet. intitulé Hi\toirc. <strong>de</strong> C/rci/cwu-Thirrr~ et publié en 1839, cn <strong>de</strong>ux<br />
volumes, lui emprunte cependant la quasi-totalité dc son contenu.<br />
6. Alexandre-Eusèbe Poquet, Hi.\tniw CIC Clliiterrir-7%ic.r/?, Chiteau-Thierry, 1839. <strong>de</strong>ux volumes.<br />
7. L‘abbé PielTe-Faron Hébert naquit h Meaux le 8 juin 1749. II fut ordonné prêtre en 1774. II professa<br />
i sa sortie du séminaire et <strong>de</strong>vint curé <strong>de</strong> Mandres, puis <strong>de</strong> Haie. au diocèse <strong>de</strong> Toul oÙ il rmta<br />
jusque vers 179 I . Au niois <strong>de</strong> niai 1x07, I’ecclésiaslique, dont on avait apprécié la dignité <strong>de</strong> vie et<br />
I‘intelligence. fut nommé curé <strong>de</strong> la Chapelle-Monthodon, puis en 1808. <strong>de</strong> Lucy-le-Bocage où son<br />
wuvenir est longtemps resté estimé ; il conlinua h se livrer i I’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> ChBtcati-Thierry jiisqu’h sa<br />
mort. survenue le 21 mai 1818. L. A. Riboulot.
L‘auteur mentionne l’emploi ou la consultation <strong>de</strong> nombreux documents,<br />
tous écrits, qui ont malheureusement, pour bon nombre, été <strong>de</strong>puis égarés ou<br />
détruits. Les sources utilisées par lui pour la rédaction <strong>de</strong> ses Ménzoires ne sont<br />
pas directement explicites ou, tout simplement, comme il est souvent d’usage à<br />
cette époque, pas citées. Le découpagc dc son ouvrage fait clairement apparaître<br />
une histoire événementielle oÙ l’analyse monumentale et I’évolution <strong>de</strong> l’urba-<br />
nisme sont absentes ou superfétatoires. I1 s’agit bien plus <strong>de</strong> montrer la succes-<br />
sion <strong>de</strong>s possesseurs et <strong>de</strong>s anecdotes historiques qui s’y rapportent que <strong>de</strong> corn-<br />
prendre I’évolution <strong>de</strong> la ville.<br />
Les premières découvertes archéologiques urbaines<br />
Les travaux <strong>de</strong> rectifications <strong>de</strong> la route <strong>de</strong> Chiteau-Thierry à Soissons,<br />
réalisés au printemps 1862, firent découvrir, au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> l’actuel cimetière <strong>de</strong> la<br />
ville. un ancien lieu <strong>de</strong> sépulture. Deux hommes, Souliac et Barbey ‘, suivirent<br />
ces travaux et mirent au jour un grand nombre <strong>de</strong> sarcophages en pierre et en<br />
plâtre. Les vestiges découverts par ces pionniers <strong>de</strong> l’archéologie castro-théodo-<br />
ricienne ont été reproduits dans le bel ouvrage manuscrit <strong>de</strong> Jean-Pierre François<br />
Lecart L), conservé dans le fond ancien <strong>de</strong> la bibliothèque municipale <strong>de</strong> Château-<br />
Thierry. L‘aquarelliste mentionne sur la planche qu’il s’agit d’objets trouvés lors<br />
<strong>de</strong>s ) réalisées le 2 mars 1862.<br />
Les sarcophages, <strong>de</strong> pierre ou <strong>de</strong> platre, <strong>de</strong>ssinés par Lecart indiquent com-<br />
munément l’époque mérovingienne, comme on peut le constater aisément “l. Les<br />
quatre boucles ou plaques-boucles reproduites sur cette planche, par la qualité<br />
graphique <strong>de</strong> leur reproduction, peuvent être comparées à celles retrouvées dans<br />
<strong>de</strong>s fouilles récentes.<br />
Les boucles en bronze <strong>de</strong>ssinées sont comparables, notamment, à celles<br />
retrouvées dans le cimetières <strong>de</strong> Vorges I’. L‘anneau ovalaire )> est soit massif,<br />
<strong>de</strong> section circulaire, soit <strong>de</strong> section arquée oblique. Les ardillons sont àbouclier<br />
rond ou scutiforme. L‘anneau comporte parfois un décor <strong>de</strong> stries transversales<br />
groupées ou encore un ban<strong>de</strong>au <strong>de</strong> cercles oculés. Ces boucles sont généralement<br />
datées du VI’ siècle I?.<br />
8. Note sur ces travaux dans le Bidlefin <strong>de</strong> In Soci&& arclie‘ologiqiie <strong>de</strong> Sois.son.s, 1. XVI, 1862, p. I34<br />
et 143.<br />
9. Ce professeur <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssin du collège <strong>de</strong> Château-Thierry conçut un recueil en trois tomes entièrement<br />
consacré à la reproduction <strong>de</strong> documents iconographiques ou d’ob\ervations personnelles <strong>de</strong>s<br />
éléments tant monumentaux que mobiliers ayant trait à la ville <strong>de</strong> Château-Thierry.<br />
I O. P. Perrin, Collections riiPI.oi,iri,~ieiiries, Crrtolo,qirc,s d’ti,? et d’histoire du tirirsc’e Curnrri~alet. t. II,<br />
Paris, Imp. mun. <strong>de</strong> Paris. 1985.<br />
I I. Notamment dans les skpultures 3, 5, 17, 23. 29. 44 et 45.<br />
12. P. Perrin. La clntrrtiori <strong>de</strong>s totribes vn8roviviRieriiir.s. Hi.srorique, nie‘thotle.\, cipplicritions, Genève,<br />
Hautes Etu<strong>de</strong>s mCdiCvales et ino<strong>de</strong>rnes, 39, 1980. Voir les cas n”52 et 53 : 500-570680
La plaque-boucle, incomplète, figurée sur la planche aquarellée <strong>de</strong><br />
François Lecart, est ornée <strong>de</strong> quatre têtes humaines stylisées organisées en croix<br />
au centre <strong>de</strong> la plaque. I1 s'agit d'un bronze moulé et étamé à décor venu <strong>de</strong> fon-<br />
<strong>de</strong>rie ; la plaque ron<strong>de</strong> représentée était fixée à la ceinture par trois languettes à<br />
œillet se trouvant à son revers, les trois bossettes hémisphériques rivées n'ayant<br />
qu'un rôle décoratif complémentaire. Les plaques-boucles <strong>de</strong> ce type sont<br />
datables <strong>de</strong> la fin du VI' ou du début du VIP siècle. Patrick Perrin pense que leur<br />
distribution géographique autorise à situer leur centre <strong>de</strong> fabrication dans le nord-<br />
ouest du Bassin parisien, voire à Paris même ]'. La seule comparaison <strong>de</strong> décora-<br />
tion humaine pour cet objet que nous avons pu retrouver dans la bibliographie<br />
régionale récente se trouve dans le cimetière <strong>de</strong> Cou<strong>de</strong>lancourt-Lès-Pierrepont<br />
(Aisne) 14. La sépulture 228 b <strong>de</strong> ce cimetière présente une plaque-boucle <strong>de</strong><br />
même nature ornée d'une seule the humaine en son centre. La datation <strong>de</strong> cette<br />
sépulture, établie par René Legoux a permis aux auteurs <strong>de</strong> la fouille <strong>de</strong> cerner<br />
sa mise en place dans la fourchette chronologique comprise entre 560/70 et<br />
630/40 16.<br />
La découverte <strong>de</strong> ce cimetière, au nord <strong>de</strong> la commune actuelle <strong>de</strong><br />
Château-Thierry, au lieu-dit Les Chesneaux, permet <strong>de</strong> retrouver un jalon chro-<br />
nologique important <strong>de</strong> l'occupation <strong>de</strong> ce territoire communal. L'absence <strong>de</strong><br />
sources écrites sur cette pério<strong>de</strong> du haut Moyen Age montre, à elle seule, l'inté-<br />
rêt <strong>de</strong> telles observations matérielles. Cependant, <strong>de</strong> ces objets, il ne reste rien,<br />
aucun ne nous est parvenu ". Cette première confrontation connue <strong>de</strong> Château-<br />
Thierry avec une >, mise en rapport avec les ramas-<br />
13. Voir notamment P. Perrin, Co1lection.s rnr'rovingierliie s..., op. cit. et en particulier les plaques-<br />
boucles <strong>de</strong> ceinture inv. AM 896, 897. Sur ces plaques circulaires, nous renvoyons le lecteur h l'ar-<br />
ticle du même auteur, >. op. cit., p.127-137.<br />
M.-P. Fleche,
sages <strong>de</strong> surface d’objets sur le site du chdleau dévasté dans les premières décen-<br />
nies du XIX‘ sièclc IX, a certainement contribué à la naissance d’une réunion loca-<br />
le érudite, à l’instar <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s villes proches (Reims, Laon ou encore<br />
Soissons I”). En 1864, la Société historique apparaît.<br />
Création et rôle <strong>de</strong> la Société historique<br />
et archéologique <strong>de</strong> Château-Thierry<br />
La Société historique et archéologique <strong>de</strong> Château-Thierry fut fondée le<br />
9 septembre 1864, lors d’une réunion dans la gran<strong>de</strong> salle <strong>de</strong> I’h6tel <strong>de</strong> ville<br />
Les objectifs <strong>de</strong> cette assemblée savante du siècle <strong>de</strong>rnier sont clairement men-<br />
tionnés dans ses statuts ’’ : , sans que soit encore envisagée<br />
I’élu<strong>de</strong> concrète <strong>de</strong> sites. Les menibres <strong>de</strong> cette (< première D Société se recon-<br />
naissent davantage comme <strong>de</strong>s érudits <strong>de</strong> cabinet et <strong>de</strong>s collectionneurs anti-<br />
quaires. De nombreux mémoires et communications ont été publiés dans les<br />
AnilLiles <strong>de</strong> ICI Société historique et rirchéologique <strong>de</strong> Chciteau-Thierry<br />
18. Vente en bien national en 1793, mise en carrière <strong>de</strong>s bâtiments, en particulier I’église Notre-<br />
Dame, terrassements et nivellements pendant la campagne <strong>de</strong> France <strong>de</strong> 1814 par un régiment du<br />
génie et transformation en parc <strong>de</strong> villégiaturc en 1844 par la municipalité occasionnèrent <strong>de</strong> noni-<br />
breuses découvertes et fouilles sur lesquels nous ne connaissons rien ou peu <strong>de</strong> chose.<br />
19. Certains membres fondateurs, comme notaniment Barbey ou Souliac, étaient régulièrement en<br />
contact avec la Société savante <strong>de</strong> Soissons.<br />
20. Pour mémoire, rappelons que, parmi les membre\ fondateurs, se trouvaient M. Buirette, curé <strong>de</strong><br />
Gland, M. Gourinain, curé <strong>de</strong> Chézy-l’Abbaye. M. Hachette, ingénieur en chef <strong>de</strong>s Ponts et<br />
Chaussées, M. Petit, docteur en mé<strong>de</strong>cine à Chiieau-Thierry, M. Souliac, propriétaire à Chriteau-<br />
Thierry, M. Usson, archiprelie <strong>de</strong> Château-Thierry, M. <strong>de</strong> Veilus, propriélaire i Brécy ... M. Usson<br />
fut nommé prési<strong>de</strong>nt et M. Gourmain secrétaire <strong>de</strong> la Société. Le prési<strong>de</strong>nt d’honneur élait M. Viard,<br />
sous-préfet <strong>de</strong> Chiteau-Thierry et le vice-prési<strong>de</strong>nt d‘honneur M. <strong>de</strong> Gerbrois, inaire <strong>de</strong> Château-<br />
Thierry. Nous tenons ici à remercier M. Tony Legendre, actuel prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Soc<br />
archéologique. pour l’ai<strong>de</strong> apportée à la rédaction <strong>de</strong> cet article.<br />
21. Ils n’ont d’ailletm pas été modifiés <strong>de</strong>puis quant à leur objet.<br />
22. L‘année 195 I marque la fin <strong>de</strong> ces publication\ régulière\. A la même date. les textes <strong>de</strong>s socié-<br />
tés savante5 <strong>de</strong> l’Aisne ont été regroupés dans les MPnioirc.c <strong>de</strong> /ci FPd6rclrion (/e,\ Soci6tc;s historiqrres<br />
er nrchéolngiq~tr~<br />
dr / ‘Aisrie, publication annuelle.<br />
125
126 Frungois Blury<br />
(ASHACT) ”. La nature <strong>de</strong> ces articles est en elle-même révélatrice <strong>de</strong> l’intérêt<br />
<strong>de</strong>s membres pour l’histoire <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Château-Thierry. Ces textes sont tou-<br />
tefois moins révélateurs quant à la part archéologique réellement jouée par la<br />
Société. La lecture attentive <strong>de</strong>s comptes rendus d’ouvertures <strong>de</strong> séance ’’ permet<br />
<strong>de</strong> mieux se rendre compte <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong>s découvertes archéologiques faites<br />
à Château-Thierry. En effet, ces ouvertures sont l’occasion <strong>de</strong> présenter <strong>de</strong>s objets<br />
récemment découverts, souvent fortuitement, lors <strong>de</strong> travaux agricoles ou <strong>de</strong> ter-<br />
rassement. Ils sont alors confiés au jugement érudit <strong>de</strong> l’assemblée. La rapi<strong>de</strong><br />
transcription <strong>de</strong> ces présentations d’objets publiée au début <strong>de</strong>s Annales constitue<br />
bien souvent le seul témoignage <strong>de</strong>s découvertes archéologiques faites à Château-<br />
Thierry. Nous avons procédé au recensement exhaustif <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s décou-<br />
vertes relatées dans ces ouvertures <strong>de</strong> séances concernant le territoire communal<br />
<strong>de</strong> Château-Thierry. Le tableau récapitulatif qui figure en annexe permct <strong>de</strong> se<br />
rendre compte <strong>de</strong> la gran<strong>de</strong> quantité d’objets ainsi récoltés et soigneusement col-<br />
lectionnés par la Société entre 1864 et 1926 ”. Mais il permet également <strong>de</strong> réa-<br />
liser l’intérêt archéologique <strong>de</strong> ces découvertes pour la connaissance <strong>de</strong> la ville,<br />
d’en mesurer la portée réelle pour la recherche actuelle.<br />
DCcouvertes fortuites et discours d’antiquaire numismate<br />
La Société se qualifie elle-même d’archéologique dès sa création. En<br />
1 865, son prési<strong>de</strong>nt, Amédée Hachette, apporte quelques lumières sur l’acception<br />
<strong>de</strong> ce terme et sa portée : <br />
L‘intérêt pour les monnaies et médailles découvertes ici et là dans la ville<br />
apparaît clairement dans ces séances <strong>de</strong> travail. I1 s’agit encore, d’une certaine<br />
manière, <strong>de</strong> traces matérielles > ou du moins porteuses d’un message<br />
intrinsèque plus ou moins directement compréhensible. Ce message autorise les<br />
23. La lecture <strong>de</strong>s statuts nous apprend que
discours d’érudition mais ne mène pas directement les membres <strong>de</strong> la Société à<br />
s’intéresser au contexte urbain dans lequel ces numéraires ont été retrouvés. Sur<br />
quarante-huit mentions relevées dans les comptes rendus <strong>de</strong> séances entre 1864<br />
et 1926, vingt-six traitent quasi exclusivement <strong>de</strong> numismatique. I1 s’agit prati-<br />
quement toujours <strong>de</strong> découvertes fortuites faites par <strong>de</strong>s non-membres <strong>de</strong> l’as-<br />
semblée. En gran<strong>de</strong> majorité, les monnaies sont découvertes lors <strong>de</strong> travaux agri-<br />
coles ou viticoles en périphérie <strong>de</strong> la zone urbanisée <strong>de</strong> Château-Thierry (à<br />
l’ouest proche du village Saint-Martin, monnaies gauloises ou romaines). Lors <strong>de</strong><br />
constructions ou d’aménagements urbains (maisons particulières ou édifices<br />
publics) quelques monnaies sont parfois rec~ieillies dans les fouilles <strong>de</strong> fondations<br />
ou <strong>de</strong> murs. Dans tous les cas <strong>de</strong> figure, la démarche est empirique et ne donne<br />
pas lieu à <strong>de</strong>s travaux raisonnés sur le contexte <strong>de</strong> ces trouvailles isolées.<br />
I1 est clair que la métho<strong>de</strong> stratigraphique est totalement absente <strong>de</strong> la<br />
démarche <strong>de</strong> la Société <strong>de</strong> Château-Thierry jusque dans les années cinquante.<br />
Pourtant, cette métho<strong>de</strong> a été inaugurée sur les sites préhistoriques d’Europe occi-<br />
<strong>de</strong>ntale, mais les membres <strong>de</strong> notre Société se contentent d’extraire <strong>de</strong>s objets du<br />
sol ou <strong>de</strong> recevoir en assemblée plénière <strong>de</strong>s objets issus d’origines diverses et<br />
d’émettre <strong>de</strong>s conjectures sur le r6le <strong>de</strong> tel ou tel objet et son ancienneté. La<br />
démarche <strong>de</strong> recherche concernant la ville est essentiellement historique.<br />
Toutefois, ce désintérêt pour les traces matérielles urbaines médiévales ne doit<br />
pas masquer l’effort consacré à la connaissance archéologique, notamment méro-<br />
vingienne, comme en témoigne la présence <strong>de</strong> Frédéric Moreau au sein <strong>de</strong> la<br />
Société et les recherches qu’il consacre aux cimetières mérovingiens <strong>de</strong> la vallée<br />
<strong>de</strong> l’Ourcq. I1 fit don <strong>de</strong> nombreux objets issus <strong>de</strong>s fouilles qu’il avait entreprises<br />
à Brény, Armentières pour augmenter les collections <strong>de</strong> la Société.<br />
La démarche <strong>de</strong> recherche concernant la ville n’en <strong>de</strong>meure pas moins<br />
essentiellement historique. De plus, seules les origines antiques présumées <strong>de</strong> la<br />
ville, totalement dépourvues <strong>de</strong> sources écrites, retiennent l’attention <strong>de</strong>s cher-<br />
cheurs. Les sources écrites, fortement lacunaires, font l’objet <strong>de</strong> quelques notices,<br />
mais bien souvent il ne s’agit que d’emprunts au travail précurseur <strong>de</strong> l’abbé<br />
Hébert. La réflexion sur la ville, son évolution son développement ne semble<br />
guère avoir préoccupé les membres <strong>de</strong> cette première génération d’assemblées<br />
savantes.<br />
Du cabinet <strong>de</strong> collectionneur au musée d’histoire <strong>de</strong> la ville, <strong>de</strong> 1869 à 1876<br />
Le 8 avril 1869, sous la prési<strong>de</strong>nce d’Amédée Hachette et sur l’initiative<br />
<strong>de</strong> Mayeux, Encelain et Barbey, la Société prit les mesures nécessaires à l’ouver-<br />
ture d’une souscription nationale ayant pour objet l’achat <strong>de</strong> la maison <strong>de</strong> Jean <strong>de</strong><br />
La Fontaine, dont le propriétaire, M. Guilloux, venait <strong>de</strong> décé<strong>de</strong>r. Le but <strong>de</strong> cette<br />
acquisition ” était évi<strong>de</strong>mment <strong>de</strong> mettre en valeur la maison natale du célèbre<br />
26. L‘achat <strong>de</strong> la maison natale <strong>de</strong> Jean <strong>de</strong> la Fontaine a ité réalisé par Alphonse Barbey, membre<br />
fondateur <strong>de</strong> la Société.
I28<br />
fabuliste et, surtout, <strong>de</strong> donner à l’assemblée savante un cadre qui lui soit propre<br />
tout en se dotant d’un lieu pour accueillir et montrer les objets illustrant I’histoire<br />
<strong>locale</strong>. La conception bien connue <strong>de</strong>s musées <strong>de</strong> sociétés savantes a souvent<br />
été soulignée pour son grand apport au démarrage d’une véritable démarche<br />
scientifique ?’. Pendant près <strong>de</strong> vingt-cinq ans, la Société recueillit ainsi <strong>de</strong>s objets<br />
trouvés <strong>de</strong> toutes origines et <strong>de</strong> tous horizons ?*. Elle voulait que cette <strong>de</strong>meure<br />
soit consacrée à l’établissement d’un musée, d’une bibliothèque ainsi que d’un<br />
lieu <strong>de</strong> réunion. En 1876, la Société céda la maison à la municipalité <strong>de</strong> Chiteau-<br />
Thierry lL) qui y établit une bibliothèque et un musée. En contrepartie, la Société<br />
garda dans ce bitiment un local nécessaire à ses séances.<br />
Les > conduites par la Société dès 1878<br />
Quelques membres furent tentés <strong>de</strong> pallier l’absence <strong>de</strong> sources écrites sur<br />
certains édifices ou secteurs <strong>de</strong> la ville par <strong>de</strong>s recherches archéologiques <strong>de</strong> ter-<br />
rain. I1 ne s’agissait pas encore <strong>de</strong> comprendre l’évolution <strong>de</strong> la ville, mais <strong>de</strong> trai-<br />
ter ponctuellement certaines lacunes documentaires. Dans tous les cas, les<br />
fouilles étaient provoquées par <strong>de</strong>s aménagements qui donnaient l’occasion d’ou-<br />
vrir le sol. Les métho<strong>de</strong>s d’excavations utilisées ne permirent pas, cependant,<br />
d’en tirer toutes les informations escomptées.<br />
Lu jbuille <strong>de</strong> la chLipelle du coLweiit <strong>de</strong>s Cor<strong>de</strong>liers en 1878-1879<br />
La construction du collège <strong>de</strong> Chiteau-Thierry, en 1807, sur les ruines du<br />
couvent <strong>de</strong>s Cor<strong>de</strong>liers construit en 1487, fit disparaître les <strong>de</strong>rnières traces en<br />
élévation <strong>de</strong> cet ancien établissement religieux intra muros. Les travaux d’exten-<br />
sion <strong>de</strong> ce collège, entrepris en 1878, donnèrent aux membres <strong>de</strong> la Société I’oc-<br />
casion <strong>de</strong> pratiquer une fouille <strong>de</strong> l’emplacement présumé <strong>de</strong> la chapelle. De<br />
nombreux objets <strong>de</strong>s XV‘ et XVII siècles furent alors mis au jour ‘I’. L‘excavation<br />
pratiquée n’est pas dCcrite ni même <strong>de</strong>ssinée, et aucun plan <strong>de</strong>s structures qui<br />
27. Essentiellement après la Secon<strong>de</strong> Guerre mondiale.<br />
28. Ces objet? provenaient en effet <strong>de</strong> la région <strong>de</strong> ChBteau-Thierry, mais auszi <strong>de</strong> contrées beaucoup<br />
plus éloignées <strong>de</strong>s buts évoqtiés plus hauts, coniine en témoigne le don d’antiquités égyptiennes fait<br />
par tin membre et accepté par la Société.<br />
29. A ChBtcau-Thierry, le musCe d’histoire <strong>locale</strong> n’a jamais rCelleinent pris son Clan : la démarche<br />
niuséographique fut orientée par ses Conservateurs successifs. h partir <strong>de</strong> M. Amanjean, vers la<br />
mémoire du grand Ccrivain et relCgua les objets archéologiques dans les réserves inconiiues du public<br />
et clans l’espace restreint du cabinet <strong>de</strong> la Société.<br />
30. Un rapi<strong>de</strong> inventaire <strong>de</strong> ceux-ci est drcssé dans l’ouverture <strong>de</strong> séance du I ’ octobre 1878. Une<br />
gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> ces objets a it6 conservée dans le\ collections <strong>de</strong> la Socié16 : tin chan<strong>de</strong>licr en<br />
cuivre : <strong>de</strong>ux lainper; en cuivre (une h six becs et tine h quatre becs) : une cuillkre h pot en cuivre ;<br />
un débris d’écuelle avec <strong>de</strong>ux écussons [céramique glaçurée tit/ grujfiitrto du XVI, siècle] ; <strong>de</strong>s débris<br />
d’assiette en étain : un dé h coudre en cuivre ; une palette : <strong>de</strong>ux tessons <strong>de</strong> vases : un pilon en<br />
cuivre ; une fibule en cuivre avec le bouton d’allache : une fibule et un trépied en cuivre. Un <strong>de</strong>\\in<br />
dc ces objets, réalisé par Varin. accompagne cette lisie.
auraient pu être découvertes n’a été réalisé. La notice rédigée par M. Barbey dans<br />
les Annales <strong>de</strong> l’année suivante I ’ n’est guère plus illustrée. Aucune <strong>de</strong>s structures<br />
mentionnées par l’auteur ne peut être clairement positionnée. Cette fouille ras-<br />
semble <strong>de</strong>s objet5 sans tenir compte <strong>de</strong> leur contexte. Les conjectures sur la cha-<br />
pelle font appel aux données érudites et historiques <strong>de</strong> l’abbé Hébert. Les don-<br />
nées intrinsèques issues <strong>de</strong> cette excavation ne sont donc pas exploitées ou exploi-<br />
tables, par absence <strong>de</strong> contexte.<br />
Les ,fouilles clirx CliesrieLiiix lors <strong>de</strong> constrirction<br />
<strong>de</strong> lm ligue <strong>de</strong> chemin <strong>de</strong> fer Anziens-Dijon, en 1884<br />
En 1849, la création <strong>de</strong> la voie ferrée <strong>de</strong> Paris à Strasbourg passant par<br />
Chitcau-Thierry contribua gran<strong>de</strong>ment au développement et à l’extension <strong>de</strong> la<br />
ville sur la rive gauche <strong>de</strong> la Marne. I1 n’existe cependant aucune information<br />
relative à <strong>de</strong>s découvertes archéologiques sur le tracé <strong>de</strong> cette ligne I’. En 1884,<br />
la ligne secondaire reliant Chiteau-Thierry à Nanteuil-Notre-Dame (aujourd’hui<br />
déferrée) participa à la <strong>de</strong>struction <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rniers vestiges <strong>de</strong> l’abbaye <strong>de</strong> Val-Secret<br />
mais, en même temps, permit la découverte d’un cimetière mérovingien au nord<br />
<strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Chriteau-Thierry, au lieu-dit Les Chesneaux. Une courte note ’‘ men-<br />
tionne les travaux archéologiques <strong>de</strong> M. Barbey et la découvertes <strong>de</strong> nombreux<br />
mobiliers issus <strong>de</strong> sépultures >, confirmant<br />
du même coup les observations effectuées dès 1862. Aucune indication ne permet<br />
<strong>de</strong> savoir si celles-ci ont été menées par <strong>de</strong>s archéologues ou résultent, comme<br />
nous le pensons, du suivi <strong>de</strong>s excavations réalisées par les ouvriers <strong>de</strong> la voie fer-<br />
rée et <strong>de</strong> la gare <strong>de</strong>s Chesneaux (désormais désaffectée).<br />
La quête <strong>de</strong>s origines <strong>de</strong> la ville : démarches volontaires<br />
et fouilles privées <strong>de</strong> 1889 à 1893<br />
La recherche archéologique <strong>de</strong> ces années consiste en particulier à ranie-<br />
ner le plus d’objets antiques possibles et, à partir <strong>de</strong> cette collecte hétéroclite, à<br />
échafau<strong>de</strong>r une réflexion sur l’origine <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Chriteau-Thierry. La problé-<br />
matique est avant tout historique. I1 s’agit <strong>de</strong> circonscrire le chef-lieu du pugus<br />
otriieizsis préalablement étudié par Auguste Longnon, membre <strong>de</strong> l’Institut ’-I. I1<br />
convient <strong>de</strong> retrouver à toute force les traces matérielles <strong>de</strong> l’antique aggloméra-<br />
3 I. M. Barbey, (< Fouilles du college <strong>de</strong> Chiteau-Thierry D, ASHACT, 1879- 1880, p. 35-42.<br />
32. Les archives <strong>de</strong> la Compngnie du chemin <strong>de</strong> íer <strong>de</strong> Paris i Strasbourg. déposées jusqu’i une date<br />
récente dans une annexe <strong>de</strong> la gare <strong>de</strong> Chiteau-Thierry, 0111 malheureusement élé détruites wis avoir<br />
pu faire l’objet d’une étu<strong>de</strong> préalable. Les archives <strong>de</strong> la SNCF, récemment regroupées au Mans, ne<br />
\emblent pas contenir <strong>de</strong> documents relaliti à <strong>de</strong> telles découvertes.<br />
33. Compte rendu <strong>de</strong> séance du 8 janvier 1884. ASHAC7, 1884, p. 2-3. Ces fouilles n‘ont pas donné<br />
lieu i un article.<br />
34. A. Longnon,
130 Frcinqois Blary<br />
tion appelée plus tard vicus d ’Oclomagus ou d’Ormus. La découverte fortuite <strong>de</strong><br />
quatre monnaies portant la mention Odomo,fit par un vigneron du village Saint-<br />
Martin, à l’ouest <strong>de</strong> Château-Thierry, en 1888, excita la curiosité <strong>de</strong>s chercheurs<br />
érudits. De leurs conversations naquit bientôt l’hypothèse que la petite ville <strong>de</strong><br />
Château-Thierry pourrait avoir eu comme origine cet antique chef-lieu <strong>de</strong> pagus.<br />
Deux membres <strong>de</strong> I’érudite assemblée, Harant et Maréchal, prirent à ceur<br />
<strong>de</strong> vérifier cette hypothèse pour le compte <strong>de</strong> la société savante et entreprirent,<br />
chacun <strong>de</strong> son côté, <strong>de</strong> découvrir les vestiges les plus remarquables <strong>de</strong> l’antique<br />
occupation. Une course <strong>de</strong> vitesse s’engagea alors entre les <strong>de</strong>ux hommes<br />
pendant quatre ans, entre 1889 et 1893.<br />
Les fouilles ne sont plus alors réalisées au hasard <strong>de</strong> travaux d’aménage-<br />
ments urbains. Elles relèvent d’une démarche volontaire répondant à une problé-<br />
matique <strong>de</strong> recherche préalablement posée. Cette pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> recherches concur-<br />
rentes apparaît régulièrement dans les comptes-rendus <strong>de</strong> séance publiés dans les<br />
Annalrs. Les recherches portent essentiellement sur <strong>de</strong>ux lieux-dits, les Hérissons<br />
et les Praillons, petite colline sise à l’ouest <strong>de</strong> Château-Thierry, à proximité du<br />
village <strong>de</strong> Saint-Martin. Les <strong>de</strong>ux chercheurs mènent dans ce secteur, occupé par<br />
<strong>de</strong>s vignes et <strong>de</strong>s cultures maraîchères, <strong>de</strong> nombreuses fouilles, tant dans les sen-<br />
tiers que dans diverses propriétés. Cette quête, financée directement par les<br />
archéologues eux-mêmes, se traduit par une abondante moisson et un dépôt d’ob-<br />
jets gallo-romains triés en fonction <strong>de</strong> critères esthétiyues (beauté intrinsèque <strong>de</strong>s<br />
objets, <strong>de</strong> préférence complets ou peu fragmentés) et <strong>de</strong> monnaies. A ces collec-<br />
tions viennent s’ajouter les monnaies trouvées par les vignerons <strong>de</strong> Saint-Martin<br />
et données à cette docte assemblée.<br />
Les travaux <strong>de</strong> M. Harant - les plus organisés et les seuls publiés ’5 -<br />
s’attachèrent à ramener du
L’archkologie à Chdteau-Thierry 131<br />
Fouilles da fondations <strong>de</strong> la Banque <strong>de</strong> France, 1928, carte postale, coll. pnv& Y. l?<br />
Une fois la preuve matérielle <strong>de</strong> l’existence <strong>de</strong> cette agglomération secon-<br />
daire antique établie, les recherches n’avaient plus réellement d’objet. Le pro-<br />
gramme atteint, elles s’arrêtèrent en 1893, aussi simplement qu’elles avaient<br />
commend. Le site repéré ne donna pas lieu à plus d’approfondissement. Ces pré-<br />
mices d‘une > montrent un fort potentiel d‘6tu<strong>de</strong> mais<br />
qui ne fut pas concrètement entrepris. Les >, ASHACT, 1893,<br />
p. 65-71.
<strong>de</strong>rnières nientions d’objets archéologiques apparaissent en 1926 ”. Les fouilles<br />
du chantier <strong>de</strong> la Banque <strong>de</strong> France, en 1926, sur la rive gauche <strong>de</strong> la Marne,<br />
furent l’occasion <strong>de</strong> quelques découvertes monétaires mais les éventuelles struc-<br />
tures d’habitats dont elles étaient issues restèrent non observées. En fait, la sur-<br />
veillance > s’amoindrit et disparut. Les articles consa-<br />
crés à Chdteau-Thierry après cette date se contentent d’abor<strong>de</strong>r quelques ajuste-<br />
ments sur <strong>de</strong>s aspects mineurs. Le discours sur la ville <strong>de</strong>meure historique et<br />
puise souvent aux même sources, paraphrasant les fameux mémoires <strong>de</strong> l’abbé<br />
Hébert, ou se réfugient <strong>de</strong>rrière les quatre articles majeurs <strong>de</strong> Georges<br />
Pommier “). L‘histoire <strong>de</strong> la ville semble comme figée voire établie.<br />
Nouvel essor <strong>de</strong> l’archéologie au sein <strong>de</strong> la Société<br />
dans les années 1950-1960<br />
Les Aizrzirlrs <strong>de</strong> la Société <strong>de</strong> Chdteau-Thierry, <strong>de</strong> fréquence irrégulière et<br />
souvent en pénurie d’articles, finirent par disparaître dans les Bulleths fédéra-<br />
teurs <strong>de</strong>s Sociétés <strong>de</strong> l’Aisne, elles-mêmes confrontées aux mêmes difficultés, en<br />
195 I. A cette époque, l’archéologie a disparu <strong>de</strong> la ville, l’intérêt <strong>de</strong>s chercheurs<br />
est ailleurs. C’est le grand essor <strong>de</strong> la prospection archéologique et <strong>de</strong>s fouilles<br />
préhistoriques loin <strong>de</strong> la ville. Par provocation, nous serions tentés <strong>de</strong> parler<br />
d’une archéologie <strong>de</strong> la campagne. Les données sont directement accessibles et<br />
ne nécessitent pas <strong>de</strong> grands moyens pour exercer les recherches. Ces recherches<br />
mettent en place les premiers Cléments <strong>de</strong> la carte archéologique <strong>de</strong> notre région<br />
et permettent d’initier les membres aux métho<strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>rnes d’investigation, la<br />
stratigraphie et les sériations d’objets. Les prospections archéologiques terrestres<br />
et aériennes conduites par divers chercheurs locaux “’ définissent les gran<strong>de</strong>s<br />
lignes <strong>de</strong> l’archéologie mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong> notre région mais ne s’intéressent pas encore<br />
à l’archéologie médiévale et encore moins h celle <strong>de</strong> la ville.<br />
La Société confrontée aux fouilles urbaines <strong>de</strong> sauvetage <strong>de</strong> 1960-1980<br />
En 1964, forte <strong>de</strong> son passé <strong>de</strong> recherches archéologiques datant essentiel-<br />
lement <strong>de</strong> la tin du XIX siècle, la Société <strong>de</strong> Chdteau-Thierry fêta ses cent ans<br />
38. Le volume <strong>de</strong>s Annules regroupe le\ année\ I922 h 1926.<br />
39. G. POMMIER, (( Nos vieux mur\ Le Chiteau <strong>de</strong> Thierry ; essai <strong>de</strong> reconstitution. Partie 1 >>,<br />
ASHACT, 1908, p. 238-289 ; >. ASHACT, 1909, p. I97 258 ; (( Nos vieux mur5 La ville <strong>de</strong> Chiteau-Thierry. Partie I >>,<br />
ASHACT, l9l4I9l9, p. 137-170 et (< No.; vieux murs La ville <strong>de</strong> Chiteau-Thierry. Pulie II >>.<br />
ASHACT. 1920- I92 I. p. I 13-227.<br />
40. Citona notamment le\ trwatix pionniers <strong>de</strong> pro\pection terrestre ou aérienne et <strong>de</strong> fouille <strong>de</strong><br />
Roger Chevalier. René Purent. Pierre Fagot ou encore les fouille\ mCwlithiques <strong>de</strong> Jacques Hinout.
d’existence ‘l. La même année, le projet <strong>de</strong> construction d’un grand ensemble<br />
HLM dit <strong>de</strong>s Vaucrises vit le jour sur le site du vicus d’Odumugus découvert par<br />
la Société. Celle-ci s’émut et alerta les services competents <strong>de</strong> l’époque. M.<br />
Vigné ‘?, professeur d’anglais et membre <strong>de</strong> la Société, se vit confier par Ernest<br />
Will, directeur <strong>de</strong>s antiquités <strong>de</strong> Picardie, l’autorisation <strong>de</strong> fouilles. Avec toute sa<br />
bonne volonté, il essaya alors <strong>de</strong> coordonner <strong>de</strong>s fouilles <strong>de</strong> sauvetages héroïques<br />
sur une surface concernée par les travaux <strong>de</strong> près <strong>de</strong> dix hectares (!). Dépourvue<br />
<strong>de</strong> moyens financiers suffisants, <strong>de</strong> fouilleurs qualifiés, <strong>de</strong> métho<strong>de</strong>s adaptées,<br />
soumise aux sarcasmes <strong>de</strong>s entreprises du bâtiment, la petite équipe bénévole<br />
baissa finalement les bras, non sans avoir essayé <strong>de</strong> conserver le plus possible <strong>de</strong><br />
vestiges. Les divers objets recueillis en <strong>de</strong>ux mois <strong>de</strong> fouilles furent localisés<br />
sommairement sans pouvoir ni observer les contextes stratigraphiques ni relever<br />
les structures mises au jour. Ils témoignent <strong>de</strong> l’importance <strong>de</strong> cette agglornéra-<br />
tion antique mais ne permettent pas d’observer précisément I’évolution <strong>de</strong> la<br />
topographie urbaine. En 1965, le constat était amer. La Société savante ne pou-<br />
vaitt faire face seule à <strong>de</strong> tels travaux d’urbanisme mo<strong>de</strong>rnes.<br />
La construction <strong>de</strong> l’ensemble HLM dcs années 1964-65 concernait une<br />
zone <strong>de</strong> cultures maraîchères à l’ouest <strong>de</strong> Château-Thierry et non le cccur <strong>de</strong> la<br />
ville. Lorsque furent lancés les aménagements <strong>de</strong> nouveaux lotissements, dans les<br />
années /U, la Société historique ne pouvait plus que déplorer la <strong>de</strong>struction <strong>de</strong><br />
vieux quartiers, comme celui <strong>de</strong>s Filoirs, sur la rive gauche <strong>de</strong> la Marne. Cette<br />
fois, ce fut la démission complète, aucune surveillance, <strong>de</strong>struction quasi-com-<br />
plète d’un quartier ancien dépourvu <strong>de</strong> mémoire écrite. De nombreux mcmbres<br />
<strong>de</strong> la Société, à cette époque, s’inquiétèrent <strong>de</strong> ces pertes irrémédiables <strong>de</strong>s<br />
archives du sol <strong>de</strong> la ville.<br />
Structuration <strong>de</strong> la recherche et gestion du territoire communal<br />
Au milieu <strong>de</strong>s années 80, la ville décida d’aménager le site du château et<br />
un projet touristique fut mis en place -I’. En 1986, le service régional <strong>de</strong> I’archéo-<br />
logie <strong>de</strong> Picardie incita la municipalité à se doter d’un service archéologique pour<br />
effectuer les recherches préalables à l’aménagement du projet. Très vite, l’unité<br />
d’archéologie municipale dc Château-Thierry fut confrontée, au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> l’opéra-<br />
41. A t,wi’e/:t l’histoire <strong>de</strong> C/7ritetrir-T/ii~r,?.,<br />
exposition <strong>de</strong> la SHACT lenue du 24 mai au 16 août<br />
1964 à la maison natale <strong>de</strong> Jean <strong>de</strong> la Fontaine.<br />
42. Nous tenons ici à lui témoigner notre reconnaishance pour le dévouement dont il a fait preuve et<br />
pour le dépat spontané, lors dc la création du service archéologique municipal, du matériel issu <strong>de</strong><br />
ces fouilles.<br />
43. Des recherches d’amateurs réalisées sur le chiteau avaient donné l’idée d‘un tel projet. En 1973,<br />
<strong>de</strong>ux sondages <strong>de</strong> 2 m x 2 ftireni réalisés par Jacques Hinout, nienibre <strong>de</strong> lii SHACT, à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> la municipalité. De 1977 à 1985, une association appelée Amis du Vieux Château dégagea les<br />
abords <strong>de</strong> la porte principale du site <strong>de</strong> Saint-Jean.
tion <strong>de</strong> fouillcs spécifiques du chbteau, à la gestion <strong>de</strong>s fouilles préventives<br />
urbaines. En moins <strong>de</strong> quatorze ans, ce sont près <strong>de</strong> quarante interventions <strong>de</strong><br />
fouilles urbaines préventives qui ont pu être réalisées et menées à bien. La mise<br />
en œuvre <strong>de</strong> techniques mo<strong>de</strong>rnes d’investigations, <strong>de</strong> gestions <strong>de</strong>s données<br />
archéologiques, d’un laboratoire <strong>de</strong> conservation et <strong>de</strong> restauration adaptée ont<br />
permis <strong>de</strong> compléter les travaux commencés sous I’égi<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Société savante <strong>de</strong><br />
Chbteau-Thierry et <strong>de</strong> renouveler l’histoire <strong>de</strong> la ville. De nombreuses publica-<br />
tions et travaux universitaires permettent <strong>de</strong> rendre compte <strong>de</strong> cette avancée et du<br />
renouvellement <strong>de</strong>s connaissances. De (< pourvoyeuse d’objets D, l’archéologie<br />
est clairement <strong>de</strong>venue <strong>locale</strong>ment >. La complémenta-<br />
rité du service archéologique <strong>de</strong> la collectivité territoriale et <strong>de</strong> la Société est évi-<br />
<strong>de</strong>nte et a permis <strong>de</strong> raffermir l’intérêt <strong>de</strong>s habitants pour I’étu<strong>de</strong> du passé <strong>de</strong> la<br />
petite ville d’accession médiévale, du château qui lui a donné naissance et <strong>de</strong><br />
l’agglomération secondaire antique qui l’a précédé.<br />
A ce nouveau passage <strong>de</strong> siècle, I’auvre <strong>de</strong> la Société historique et archéo-<br />
logique <strong>de</strong> Château-Thierry se poursuit, renforcée et appuyée par un service <strong>de</strong><br />
collectivité territoriale adapté aux contraintes <strong>de</strong> l’archéologie urbaine et à sa ges-<br />
tion. A l’heure où notre société subit <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>s mutations, <strong>de</strong>mandant à tous<br />
un effort constant d’adaptation, l’archéologie a un rôle important à jouer dans la<br />
définition et le maintien d’une i<strong>de</strong>ntité culturelle <strong>locale</strong>.<br />
Ces quelques considérations historiographiques sur la lente émergence<br />
d’une archéologie <strong>locale</strong> sont écrits entre <strong>de</strong>ux opérations archéologiques pré-<br />
ventives urbaines <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> ampleur permettant <strong>de</strong> considérer, pour la première<br />
fois dans l’histoire <strong>de</strong> la ville, I’évolution complète <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux quartiers du bourg<br />
intra muros. La première, sous la future médiathèque, a permis <strong>de</strong> retrouver le<br />
couvent <strong>de</strong>s Cor<strong>de</strong>liers <strong>de</strong> 1487 et une portion <strong>de</strong> l’enceinte antérieure à celle,<br />
encore visible, du XIIIe siècle ; la secon<strong>de</strong>, d’explorer un quartier conjtruit sur un<br />
ancien bras progressivement asséché <strong>de</strong> la Marne. Les fouilles du chbteau per-<br />
mettent déjà <strong>de</strong> reconsidérer les données issues <strong>de</strong>s travaux érudits <strong>de</strong> Hébert ou<br />
<strong>de</strong> la Société. Ces perspectives d’étu<strong>de</strong> permettent d’envisager encore un long<br />
avenir à la recherche archéologique <strong>de</strong> notre ville et un regain d’intérêt pour les<br />
travaux <strong>de</strong> notre Société, consciente d’elle-même et du rôle qui lui revient.<br />
Franqois BLARY
ANNEXE<br />
Tableau récapitulatif : Inventaire exhaustif <strong>de</strong>s découvertes archéologiques<br />
faites iì Chlteau-Thierry mentionnées dans les ouvertures <strong>de</strong> séances <strong>de</strong> la Société<br />
historique et archéologique <strong>de</strong> Chlteau-Thierry.<br />
Annec<br />
dciiiuverlc<br />
"lllllc<br />
135<br />
4<br />
IXh?,<br />
p -104:<br />
I SOS,<br />
p. 53<br />
IXhh.<br />
I Xhh. p. 49-J I.<br />
l867.p 34<br />
1x73.<br />
p ?O?I<br />
lh7-1. p. 15<br />
7<br />
IX75.P 15<br />
IX7X. p. 15 :<br />
I x79 XII.<br />
p. 35 42<br />
IXS1. 1). 37<br />
I xxx. p. xs
I36<br />
IXL)?<br />
1 X')?<br />
1x91<br />
I X'W<br />
t t<br />
L L<br />
Kcl ASHACT
Les historiens du dimanche en Thiérache<br />
Milieu érudit et société savante, 1837-1973<br />
Les premiers érudits vervinois au XIX‘ siècle<br />
Nous ne savons rien <strong>de</strong> la vie culturelle et intellectuelle <strong>de</strong> Vervins <strong>de</strong>puis<br />
le XVIII’ siècle jusqu’à la Restauration. Cette histoire n’a pas été faite et nous<br />
ignorons s’il existe une documentation permettant <strong>de</strong> l’engager. Nous ne décou-<br />
vrons une trace <strong>de</strong>s intérêts intellectuels propres à certains milieux instruits <strong>de</strong><br />
Vervins que dans le second quart du XIX“ siècle. I1 s’agit du Journal <strong>de</strong> Vervins,<br />
un hebdomadaire d’annonces, dont le premier numéro paraît le 14 décembre<br />
1837 I. Dans son prospectus <strong>de</strong> lancement ?, la rédaction onidit <strong>de</strong>s pages aux<br />
érudits locaux : > C’est un imprimeur<br />
vervinois, Léandre Papillon, qui fonda et anima ce journal, assisté <strong>de</strong> son frère,<br />
Ferdinand. Fils d’un couple d’instituteurs ’, les jeunes gens n’avaient pas accédé<br />
à <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s supérieures niais pratiquaient la gravure et la lithographie.<br />
Leur projet d’histoire <strong>locale</strong> avait certainement été conçu avant même la<br />
parution du journal car, dès le 1“ mars 1838, ils commençaient la publication, en<br />
suppléments gratuits et illustrés, <strong>de</strong>s Essciis historiques sur [LI Ville <strong>de</strong> Vervins<br />
d’Amédée Piette. Les feuilletons furent rassemblés et réédités sous le même titre<br />
en 1841 J. Ce petit opuscule inaugurait l’histoire régionale, il était par ailleurs le<br />
premier ouvrage <strong>de</strong> celui qui allait travailler durant trois décennies à la consoli-<br />
dation d’un milieu savant, collectionneur, amateur et producteur <strong>de</strong> travaux éru-<br />
dits. Six ans plus tard, en 1847, Léandre Papillon imprima les recherches <strong>de</strong> Pietle<br />
sur l’abbaye <strong>de</strong> Foigny ’.<br />
I. Le titre complet était : Journrrl <strong>de</strong> Vervins, filiille d’crrrriorlces légalcs et volontaires ; Faits, Aiiv<br />
divers, No~i~elle.~ locc<strong>de</strong>s ; Iridustrie, Commerce : agricxlrure, horticulture., lii.ctoire. anricpir/s, titté-<br />
niture. Quelques années plus tard, il <strong>de</strong>viendra le Joun7nl <strong>de</strong> Vervins, & Gui.ve et <strong>de</strong> l’arrondisse-<br />
rllellt.<br />
2. Ce prospectus a été con\ervC par la Société historique et archéologique <strong>de</strong> Vervins et <strong>de</strong> la<br />
Thiérache (SAHVT). Lorque nous nous référerons CI <strong>de</strong>s documents faiwnt partie <strong>de</strong>s collections <strong>de</strong><br />
la SAHVT, nous indiquerom désormais : Arch. SAHVT.<br />
3. Les époux Papillon-Labois n’eurent que <strong>de</strong>ux fils, tous <strong>de</strong>ux nés Vervin\. Léandre le 30 janvier<br />
18 I3 et Théodore Ferdinand le 24 août I8 IS.<br />
4. Ils feront l’objet d’une première réédition en 1931. d’une secon<strong>de</strong> par Res Universis en 1988 et<br />
d’une troisième en 1998, toujours par Res Universis.<br />
5. Amédée Piette, Ni.vtoire <strong>de</strong> l’trbbnje <strong>de</strong> Foig/ij, Vervins, inipr. Papillon. 1847.
I38 Clautlir~r Vidtil. Alciin Britrirt<br />
Cette association entre les frères Papillon et Amédée Piette, fondée sur leur<br />
goût commun pour l’histoire <strong>locale</strong>, partait du même attachement à leur lieu <strong>de</strong><br />
naissance, attachement que Piette évoqua à plusieurs reprises dans ses écrits.<br />
Amédée n’avait que cinq ans <strong>de</strong> plus que Léandre, les maisons <strong>de</strong> leurs parents<br />
étaient voisines 6. Piette, que sa carrière dans l’administration <strong>de</strong>s impôts obligea<br />
à changer plusieurs fois <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nce, ne vécut pas à Vervins. I1 <strong>de</strong>meura cepen-<br />
dant à Laon <strong>de</strong> 1846 à 1866, puis se fixa à Soissons oh il mourut en 1883.<br />
1849-1865 : <strong>de</strong> Vervirzs Ù Ici Thikruche<br />
L‘installation <strong>de</strong> Piette à Laon, le rapprochant <strong>de</strong> Vervins, permit <strong>de</strong> lancer<br />
une entreprise plus ambitieuse : la publication, en 1849, <strong>de</strong> mélanges historiques<br />
regroupés sous le titre La Thiémche ’. Le volume comprenait <strong>de</strong>s suppléments du<br />
Jouriial <strong>de</strong> Vervins et <strong>de</strong>s textes nouveaux.<br />
L‘introduction justifie l’extension <strong>de</strong> l’intérêt historique à l’ensemble <strong>de</strong> la<br />
Thiérache en s’appuyant sur la thèse que les > forment, pour<br />
employer un vocabulaire mo<strong>de</strong>rne, une unité culturelle et une unité <strong>de</strong> compréhension<br />
: ) Par ailleurs, le but <strong>de</strong> la parution<br />
se veut d’utilité publique : pallier l’absence <strong>de</strong> bibliothèque en Thiérache en<br />
regroupant <strong>de</strong>s textes épars et difficiles d’accès. Cette intention va au-<strong>de</strong>vant<br />
d’une critique qui s’en prendrait au caractère incontestablement disparate <strong>de</strong> la<br />
publication. De fait, sont rassemblés <strong>de</strong>s textes <strong>de</strong> statuts très différents : <strong>de</strong>s<br />
> comme <strong>de</strong> longs articles, <strong>de</strong>s <strong>de</strong>scriptions minutieuses <strong>de</strong> monuments<br />
ou <strong>de</strong> médailles comme <strong>de</strong>s ) (soit <strong>de</strong>s reproductions<br />
intégrales <strong>de</strong> documents d’archives), <strong>de</strong>s recherches originales comme <strong>de</strong>s<br />
extraits d’ouvrages déji publiés. I1 n’y a pas <strong>de</strong> pério<strong>de</strong> privilégiée, les textes vont<br />
<strong>de</strong> l’archéologie celtique (>) au choléra <strong>de</strong> 1849 ’.<br />
Enfin le
Le volume est introduit par une brève notice sur la Thiérache, rédigée par<br />
Piette et déjà publiée dans les suppléments du J~iir-~l <strong>de</strong> Vervins. L‘auteur<br />
reconstitue à grands traits l’unité historique et géographique du pays <strong>de</strong>puis le<br />
Xc siècle, non sans rendre hommage à I’œuvre d’un précurseur, le bénédictin<br />
Dom Le Long qui publia une histoire du diockse <strong>de</strong> Laon dans le <strong>de</strong>rnier quart du<br />
XVIII‘ siècle,
140 Claudine Vìdul, Alain Brunet<br />
Piette, vervinois et cousin d’Amédée, Arthur Demarsy, un chartiste, qui écrit,<br />
dans cette livraison même, le premier article sur les églises fortifiées. I1 était fils<br />
du comte <strong>de</strong> Marsy, procureur à Vervins durant quelques années (1 85 1 à 1856),<br />
qui s’intéressa également à l’histoire régionale. La Thiémche <strong>de</strong> 1865 publie son<br />
étu<strong>de</strong> sur <strong>de</strong>s procès faits à <strong>de</strong>s cadavres aux XVII et XVIII‘ siècles, ainsi qu’un<br />
catalogue <strong>de</strong>s plantes sauvages <strong>de</strong> la Thiérache. Le magistrat fut membre <strong>de</strong> plu-<br />
sieurs sociétés savantes, notamment <strong>de</strong> la Société académique <strong>de</strong> Laon et <strong>de</strong> la<br />
Société <strong>de</strong>s Antiquaires <strong>de</strong> Picardie, à laquelle son fils appartint également.<br />
En une trentaine d’années, Amédée Piette et Léandre Papillon persistèrent<br />
à faire exister une histoire <strong>locale</strong>, à lui constituer un public, a susciter <strong>de</strong>s voca-<br />
tions <strong>de</strong> recherche. Nous ne savons pas très bien quel accueil ils reçurent, cepen-<br />
dant <strong>de</strong>s Cléments laissent penser que certains milieux s’y intéressaient réelle-<br />
ment : par exemple l’opuscule consacré aux > fut imprimé<br />
grâce à une souscription. Cependant, si l’on retient que les <strong>de</strong>ux numéros <strong>de</strong> La<br />
Tliie‘rcrche II, publiés à seiLe ans d’intervalle, reprenaient pour le principal <strong>de</strong>s<br />
textes déjà parus en suppléments du Journal <strong>de</strong> Vervins, le développement <strong>de</strong>s<br />
recherches savantes semble bien lent. I1 reste que la comparaison <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux numé-<br />
ros laisse percevoir <strong>de</strong>s changements essentiels.<br />
En premier lieu, <strong>de</strong> nouveaux auteurs s’intéressent à l’histoire <strong>locale</strong> et<br />
renforcent le duo Piette/Papillon qui fournissait jusqu’alors le plus gros <strong>de</strong> la<br />
copie. Même s’ils sont encore peu nombreux, leur apport diversifie et enrichit la<br />
recherche. Mais le fait novateur est qu’ils ne sont pas seulement <strong>de</strong>s notables éru-<br />
dits, originaires <strong>de</strong> la région. Pour eux, comme pour Amédée Piette, le statut<br />
d’érudit provient <strong>de</strong> leur appartenance à <strong>de</strong>s sociétés savantes ; par là, ils impor-<br />
tent une sociabilité qui débor<strong>de</strong> le petit mon<strong>de</strong> <strong>de</strong>s connaisseurs <strong>de</strong> l’histoire thié-<br />
rachienne. En effet, la sociabilité propre à ces sociétés incite les auteurs à suivre<br />
<strong>de</strong>s manifestations organisées à l’extérieur <strong>de</strong> la région, à y communiquer leurs<br />
travaux, à écouter ceux <strong>de</strong>s autres ; elle opère également la séparation <strong>de</strong> la liai-<br />
son > entre lieu <strong>de</strong> naissance et pratique <strong>de</strong> l’histoire <strong>locale</strong>. Ainsi,<br />
<strong>de</strong>s fonctionnaires, membres <strong>de</strong> sociétés savantes, non pas nés niais nommés en<br />
Thiérache, jugent-ils normal d’effectuer <strong>de</strong>s recherches sur le passé <strong>de</strong> la région.<br />
La Société archéologique <strong>de</strong> Vervins : première pério<strong>de</strong> (1873-1905)<br />
Des publications, aussi rares et espacées fussent-elles, avaient démontré<br />
que le travail érudit pouvait enrichir <strong>de</strong> significations inédites les monuments et<br />
les lieux du pays. Elles avaient aussi suscité le désir <strong>de</strong> rattacher un terroir bien<br />
peu connu à la >. Enfin, le cercle <strong>de</strong>s amateurs - que ce fût par<br />
snobisme ou par goût sincère <strong>de</strong> l’histoire - s’était élargi. Les conditions socio-<br />
Il. Nou ignorons le tirage <strong>de</strong> ceb <strong>de</strong>ux volumes, mais il semblait Irks rkduit. On pcut même penser<br />
que le second recueil eut un tirage quasiment confi<strong>de</strong>ntiel. Seuls quelques rares exemplaires sont<br />
connus.
logiques propices à la création d’une société savante étaient bien réunies à la fin<br />
<strong>de</strong>s années 1860. C’est pourquoi la guerre <strong>de</strong> 1870 ne la retarda guère puisque la<br />
Société archéologique <strong>de</strong> Vervins fut officiellement constituée en 1873.<br />
Lu créatioiz<br />
En 1872, le nouveau propriétaire <strong>de</strong> l’imprimerie et du Journul <strong>de</strong> Vervins,<br />
A. Flem, lithographe, comme son prédécesseur, annonçait la publication men-<br />
suelle <strong>de</strong> documents sur la Thiérache servis à ceux qui s’y abonneraient spéciale-<br />
ment et non plus <strong>de</strong> suppléments gratuits du journal, comme ce fut le cas trente-<br />
cinq ans auparavant. Les douze livraisons furent rassemblées dans un recueil inti-<br />
tulé La Thiérache. Une intére nte annonce aux abonnés terminait le volume 12.<br />
Le rédacteur précisait que l’ouvrage, abondamment illustré et tiré à 300 exem-<br />
plaires, avait coûté 2 500 francs, somme que les 180 souscriptions ne couvraient<br />
pas et <strong>de</strong> loin ”. Toujours est4 que cet effort accompagnait la création <strong>de</strong> la<br />
Société qui allait désormais assurer les publications suivantes. >, non signée mais dont I’érudition doit beaucoup à Amédée Piette<br />
et à Auguste Matton, l’archiviste départemental, inaugure le genre <strong>de</strong>s monogra-<br />
phies villageoises dont le succès ne Fdiblira pas.<br />
12. La Thiérache. recueil <strong>de</strong> docurrirrits com’errimit I‘hi\toire, les Beciu.r-cirts. les scierices nuturelles<br />
et I’hzdirstrie <strong>de</strong> cetle oiicicwie sitl~tlivision <strong>de</strong> /ti P icfidie, 1872. <strong>de</strong>uxiPme volume, Vervins,<br />
Imprimerie <strong>de</strong> A. Flem. lithographe. 1872, p. 203.<br />
13. L‘imprimeur dut certainement avancer ce qui mnnquait. Peut-Clre fut-il aidé par <strong>de</strong>s donateurs,<br />
mais nous l’ignorons.<br />
14. Il mourut en 1883, la même année qu’Ainédie Pictte.
142 CIriuclirze Virltil, Alriin Brunet<br />
Cette publication avait été décidée par un comité qui jugea le moment<br />
venu <strong>de</strong> former une société savante. I1 arrêta ses statuts en décembre 1872 et la<br />
Société archéologique <strong>de</strong> Vervins fut autorisée le 17 janvier 1873. Les membres<br />
fondateurs étaient au nombre <strong>de</strong> trente-<strong>de</strong>ux. Certes, il s’agissait d’un groupe <strong>de</strong><br />
notables, mais la composition du milieu était sociologiquement diversifiée : sept<br />
fonctionnaires civils, <strong>de</strong>ux militaires, quatre magistrats, <strong>de</strong>ux ecclésiastiques,<br />
<strong>de</strong>ux enseignants, trois membres <strong>de</strong> professions libérales (mé<strong>de</strong>cin, pharmacien,<br />
géomètre-expert), <strong>de</strong>ux élus locaux (le maire <strong>de</strong> Vervins et le conseiller général<br />
<strong>de</strong> l’arrondissement), <strong>de</strong>ux entrepreneurs (dont A. Flem, imprimeur et directeur<br />
du Jarrizcil <strong>de</strong> Vervins), quatre propriétaires et rentiers, trois retraités Is. Durant<br />
l’année 1873, la Société s’attacha à recruter <strong>de</strong> nouveaux membres titulaires et<br />
<strong>de</strong>s membres correspondants dans le département (notamment Edouard Fleury,<br />
prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Société académique <strong>de</strong> Laon et Amédée Piette, à ce moment vice-<br />
prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Société archéologique <strong>de</strong> Soissons), dans la région picar<strong>de</strong>, à Paris<br />
(notamment Ernest Lavisse, originaire du Nouvion et déjà célèbre à cette époque)<br />
et jusqu’à Oxford. A la fin <strong>de</strong> l’année, elle comptait 47 membres titulaires et 56<br />
correspondants (qui seront 6 1 l’année suivante).<br />
Les statuts, conformes au modèle <strong>de</strong> l’époque, prévoient une cotisation<br />
annuelle <strong>de</strong> quinLe francs pour les titulaires et huit francs pour les correspon-<br />
dants, donnant droit au Bullerin annuel. Ce ne sont pas <strong>de</strong>s montants négligeables<br />
mais ils ne signifient pas particulièrement une intention d’homogénéité sociale et<br />
culturelle, homogénéité que, par ailleurs, préservent les conditions d’accès : <strong>de</strong>ux<br />
parrains, membres titulaires, et l’acceptation <strong>de</strong> la majorité <strong>de</strong>s votants. I1 ne<br />
semble pas pour autant que la Société ait favorisé une attitu<strong>de</strong> férocement élitis-<br />
te. Le rapport presque égal, dès la première année, entre le nombre <strong>de</strong>s titulaires<br />
et celui <strong>de</strong>s correspondants l’atteste, alors que d’autres sociétés se fermaient aux<br />
milieux moins bien situés dans la hiérarchie sociale en limitant <strong>de</strong> façon drastique<br />
l’accès au groupe <strong>de</strong>s titulaires.<br />
La Société se réunissait mensuellement à l’hôtel <strong>de</strong> ville, le Biillrtiri don-<br />
nait les comptes-rendus <strong>de</strong> séance et, <strong>de</strong> plus en plus systématiquement, le texte<br />
<strong>de</strong>s conférences ou <strong>de</strong>s travaux présentés. La première séance (20 décembre<br />
1872) fut consacrée à l’allocution du prési<strong>de</strong>nt, Édouard Piette If’. Elle appelait<br />
principalement à un programme archéologique s’étendant <strong>de</strong> la préhistoire à<br />
I’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s abbayes et <strong>de</strong>s chsteaux. Elle invitait aussi à mener <strong>de</strong>s recherches à<br />
partir <strong>de</strong>s archives départementales, dont Auguste Matton venait d’établir un<br />
inventaire sommaire, et signalait une source importante, les anciennes minutes <strong>de</strong><br />
notaires.<br />
IS. La liste <strong>de</strong>s membres fondateurs, ainsi que les statuts <strong>de</strong> la Société. sont publiis dans Lcr<br />
Tliilroc~lw, Birlletiri ile lo SociPtP A~c~hPolo~~i~~ire (le Vervins, 1873, p. 1-5.<br />
16. Édouard Piette, un ancien banquier <strong>de</strong> Vervins, avait été brièvement maire <strong>de</strong> la ville et député<br />
<strong>de</strong> l’arrondissement. Son fils, Alfred, un juriste. était également membre titulaire <strong>de</strong> la Société.<br />
Édouard, nous l’avons rappelé, était cousin d’Amédée Piette mais aussi d’un autre Édouard Piette,<br />
surnommé >, car il était l’un <strong>de</strong>s fondateurs <strong>de</strong> lu science préhistorique en France.
Jean-Pierre Chaline, dans son indispensable ouvrage <strong>de</strong> synthèse sur les<br />
sociétés savantes en France, a établi les rythmes <strong>de</strong> créations <strong>de</strong> ces sociétés au<br />
XIX.‘ siècle ”. II est intéressant <strong>de</strong> constater que leur institution dans le départe-<br />
ment <strong>de</strong> l’Aisne reflète la périodisation établie par l’auteur. Le Premier Empire<br />
n’avait pas suscité un contexte favorable à la création <strong>de</strong> groupements savants<br />
dont le nombre resta stagnant (les créations ne compensant pas les disparitions).<br />
En revanche, le régime <strong>de</strong>s Bourbons Fdvorisa une reprise <strong>de</strong>s activités savantes,<br />
reprise très sensible dès 1820. De fait, si aucune société ne s’organisa dans le<br />
département <strong>de</strong> l’Aisne durant le Premier Empire, le milieu érudit <strong>de</strong> Saint-<br />
Quentin fonda, en 1825, la Société académique <strong>de</strong>s sciences, arts, belles lettres,<br />
agriculture et industrie, sous l’impulsion d’un fonctionnaire du fisc et archéo-<br />
logue qui avait été affecté dans cette ville I‘. La monarchie <strong>de</strong> Juillet fut, elle<br />
aussi, propice au développement <strong>de</strong>s sociétés savantes. Ainsi le CTHS (Comité<br />
<strong>de</strong>s travaux historiques et scientifiques) fut-il institué en 1834 à l’initiative <strong>de</strong><br />
Guizot, lui-même fondateur <strong>de</strong> la Société <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> France. A cette pério<strong>de</strong>,<br />
les activités savantes prirent, dans le département <strong>de</strong> l’Aisne, une ampleur visible<br />
dans <strong>de</strong>s publications spécialisées (entre autres, les suppléments historiques du<br />
Jouriial <strong>de</strong> Vervins dont les premiers, on s’en souvient, parurent en 1837). La<br />
Société archéologique, historique et scientifique <strong>de</strong> Soissons fut créée en 1847.<br />
La révolution <strong>de</strong> 1848 et la II’ République ne brisèrent pas ce mouvement ascen-<br />
dant qui s’amplifia encore sous le Second Empire. Le département <strong>de</strong> l’Aisne ne<br />
resta pas à I’écart <strong>de</strong>s tendances nationales : 1850, Société académique <strong>de</strong> Laon,<br />
1860, Société académique <strong>de</strong> la région <strong>de</strong> Chauny, 1864, Société historique et<br />
archéologique <strong>de</strong> Château-Thierry. Sur le plan national, les créations reprirent<br />
après la guerre <strong>de</strong> 1870 avec une rapidité inconnue jusque là. La Société archéo-<br />
logique <strong>de</strong> Vervins ( 1873) s’inscrit bien dans cette reprise qui culmina dans les<br />
premières années <strong>de</strong> la III République.<br />
Ainsi les sociétés savantes dans l’Aisne se sont-elles développées selon un<br />
rythme conforme à la périodisation nationale ; elles correspon<strong>de</strong>nt également,<br />
d’un point <strong>de</strong> vue géographique, à une tendance caractéristique <strong>de</strong>s régions nord<br />
<strong>de</strong> la France. J.-P. Chaline repère <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> cristallisation institutionnelle <strong>de</strong>s<br />
sociabilités érudites qui sont, <strong>de</strong> toute façon, un phénomène urbain : le monopo-<br />
le <strong>de</strong> chefs-lieux, gran<strong>de</strong>s cités qui concentrent à peu près toute l’activité savante<br />
du département (ce qui est le cas, par exemple, <strong>de</strong> la région toulousaine) ou, à<br />
l’inverse, la dissémination <strong>de</strong> cette activité entre les villes, préfecture et sous-pré-<br />
fectures (bien visible entre autres dans la région picar<strong>de</strong>) ”. L‘Aisne relève du<br />
17. Jean-Pierre Chaline, Socirrhilite‘ et ériditiorz. Les .socirifP.s SC~V~III~L‘S<br />
eli Frcuice, Pans, Éditions du<br />
CTHS, 1998.<br />
18. 11 s’agit <strong>de</strong> Charles-Florentin-Jacque\ Mangon <strong>de</strong> La Lan<strong>de</strong> qui, dans les différentes régions oÙ<br />
il fut affecté, incita systématiquement les milieux érudits B 5e constituer en sociétés savantes (J.-P.<br />
Chaline, p. 259).<br />
19. Un troisième type combine l’existence <strong>de</strong> pfiles concentrant un nombre important <strong>de</strong> sociétés.<br />
sans que cela empêche les petites villes <strong>de</strong> \e doter d’un organime savant (J.-P. Chaline. p. 97.102).
I44 Cltririlirir Vidtrl. Altrin Brrrtirt<br />
second type qui traduit à la fois le goût <strong>de</strong> certains milieux aisés pour <strong>de</strong>s activi-<br />
tés désintéressées <strong>de</strong> connaissance et les rivalités entre les villes. II reste que, si<br />
les érudits vervinois semblaient prêts à s’organiser dès la fin <strong>de</strong>s années 1860,<br />
l’énergie préfectorale fut indispensable à la mise en œuvre finale du projet. Ils le<br />
reconnurent d’ailleurs explicitement et conférèrent au sous-préfet le titre <strong>de</strong> pré-<br />
si<strong>de</strong>nt d’honneur <strong>de</strong> la Société. Ce titre fut également offert, la même année, au<br />
duc d’Aumale, qui possédait <strong>de</strong> nombreuses propriétés dans l’arrondissement, <strong>de</strong><br />
sorte que la Société put, comme souvent les groupements <strong>de</strong> cette époque, s’en-<br />
orgueillir <strong>de</strong> compter parmi ses membres un représentant du gotha nobiliaire.<br />
Le microcosnie <strong>de</strong> ICI SociPtP<br />
La composition sociologique <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> la Société vervinoise ne dif-<br />
fère pas <strong>de</strong>s tendances observables ailleurs, dans <strong>de</strong>s sociétés qui ont le même<br />
type d’intérêts : prédominance <strong>de</strong>s professions relevant du service public (fonc-<br />
tionnaires <strong>de</strong> pouvoir. personnel judiciaire, militaires et prêtres), professions libé-<br />
rales (juristes, mé<strong>de</strong>cins, pharmaciens) et rentiers divers (ou
FranGois Rogine. Ce bureau lut reconduit l’i<strong>de</strong>ntique jusqu’en 1890. Durant<br />
dix-huit ans donc, ces homines assumèrent plcinement leurs fonctions. Edouard<br />
Piette et Léandre Papillon avaient respectivement 67 et 60 ans en 1873, Eugène<br />
Mennesson, 42 ans. Les <strong>de</strong>ux premiers disparurent en I890 et Eugène Mennesson<br />
<strong>de</strong>vint prési<strong>de</strong>nt ; il avail alors 59 ans. II mourut doue ans plus tard, en 1902, et<br />
fut remplacé par le docteur Penant (né en 1827, mé<strong>de</strong>cin à Vervins <strong>de</strong>puis 1859)<br />
qui décéda en 1909.<br />
Piette et Papillon, les premiers, bientôt rejoints par Penant, puis par<br />
Mennesson, avaient déjà mené ensemble <strong>de</strong>s travaux d’histoire <strong>locale</strong>, avant même<br />
la création <strong>de</strong> la Société. Ces quatre érudits et François Rogine, professeur <strong>de</strong><br />
sciences au collège <strong>de</strong> Vervins, spécialiste <strong>de</strong> géologie thiérachienne, animèrent les<br />
réunions, assurèrent les liaisons extérieures avec les correspondants et les sociétés,<br />
rédigèrent l’essentiel <strong>de</strong>s Bulletirzs. Ainsi, lorsqu’en I883 la Société académique <strong>de</strong><br />
Laon organisa un congrès départemental <strong>de</strong>s sociétés du département, le bureau <strong>de</strong><br />
la Société archéologique <strong>de</strong> Vervins la représenta : les communications étaient<br />
signées <strong>de</strong> Rogine et Mennesson. Incontestablement, durant plus d’un <strong>de</strong>mi-siècle<br />
(dont une trentaine d’années à la Société), ils avaient maintenu la continuité <strong>de</strong>s<br />
activités propres au milieu érudit et profité <strong>de</strong>s opportunités liées à la cristallisation<br />
institutionnelle <strong>de</strong> ces activités en une société savante reconnue pour donner une<br />
forte impulsion à l’histoire <strong>locale</strong>. De fait, s’il y eut peu <strong>de</strong> publications avant 1873,<br />
la Société édita 2 1 numéros <strong>de</strong> Ln Thit:rcrthe jusqu’en 1905.<br />
Ce petit groupe sut conserver sa cohésion, charpenter les intérêts et les<br />
activités <strong>de</strong> connaissance, préserver à cette époque d’intense effervescence poli-<br />
tique l’autonomie et la sérénité <strong>de</strong> la recherche <strong>locale</strong>. Cependant, il ne réussit pas<br />
à élargir le public <strong>de</strong>s amateurs plus ou moins actifs (les correspondants), ni à ral-<br />
lier <strong>de</strong>s hommes plus jeunes, différemment formés, susceptibles d’ouvrir <strong>de</strong> nou-<br />
velles pistes. C’est pourquoi la Société connut un déclin continu <strong>de</strong>s ses effectifs<br />
et <strong>de</strong> ses activités jusqu’au point <strong>de</strong> risquer la pure et simple disparition.<br />
En 1873, à la fin <strong>de</strong> sa première année d’exercice, la Société comptait 103<br />
membres. Elle augmenta ses effectifs jusqu’en 1877 où elle alteint 1 I6 membres.<br />
A partir <strong>de</strong> celte année, le nombre <strong>de</strong>s adhérents commença à décroître lentement<br />
mais régulièrement, diminuant en moyenne <strong>de</strong> quatre ou cinq personnes par an.<br />
En 1880, trois ans plus tard, la Société avait perdu 21 membres et sa composition<br />
sociale commençait i différer <strong>de</strong> celle qu’elle présentait en 1873. Parmi les 38<br />
membres titulaires, le nombre <strong>de</strong>s retraités ( I 2) était <strong>de</strong>venu presque équivalent à<br />
celui <strong>de</strong>s fonctionnaires (I 3) : proportion qui atteste le vieillissement <strong>de</strong> ce grou-<br />
pe, le non-remplacement <strong>de</strong>s disparus, landis que la proportion entre agents <strong>de</strong><br />
1’État et l’ensemble <strong>de</strong>s autres membres n’est plus égale. En revanche, le nombre<br />
<strong>de</strong>s agents <strong>de</strong> 1’État prédominait encore parmi les correspondants (19 sur 57) : il<br />
s’agissait en fait <strong>de</strong> fonctionnaires, originaires <strong>de</strong> la Thiérache mais en poste<br />
ailleurs, comme Amédée Piette ou Ernest Lavisse. En 189 1, ne restaient que 22<br />
titulaires (et 39 correspondants). La liste <strong>de</strong>s titulaires, comparée à celle <strong>de</strong> l’an-<br />
née 1880, montre que, si la SociCté avait réussi à attirer quatre nouveaux membres<br />
(un journaliste, un architecte, un avoué, un propriétaire), elle n’avait pas<br />
remplacé les 14 titulaires
I46 Clnudirie Vidirl. Alain Brunei<br />
En 1902, lorsque décéda Eugène Mennesson, son successeur, le docteur<br />
Penant constatait : > Le nouveau prési<strong>de</strong>nt annonçait l’admission <strong>de</strong> huit nou-<br />
veaux membres titulaires - un notaire et son fils, un avoué et son fils, le fils d’un<br />
autre avoué lui-même membre titulaire, un mé<strong>de</strong>cin - et <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux membres cor-<br />
respondants - un abbé, professeur <strong>de</strong> rhétorique, et un journaliste, rédacteur du<br />
Républicain Vervinois. Cette liste donne à voir combien la Société s’était refer-<br />
mée sur un petit milieu <strong>de</strong> juristes vervinois (d’autres membres titulaires sont <strong>de</strong>s<br />
notaires en retraite, un ancien greffier, <strong>de</strong>ux avoués) qui, pour faire nombre, pré-<br />
sentaient leur fils. Le docteur Penant avait alors soixante-quinze ans. I1 mourut en<br />
1905. Son successeur, le docteur Gannelon, n’arriva à publier le tome XXI <strong>de</strong> Ln<br />
Thiéruche qu’en 1908 ; ce <strong>de</strong>rnier recouvrait les années 1904 et 1905. I1 n’y avait<br />
presque plus <strong>de</strong> réunions, la trésorerie était au plus bas. La Société ne comptait<br />
plus que quatorze titulaires : huit (< anciens >> (ils étaient déjà là en 1891) et six<br />
nouveaux. Ces <strong>de</strong>rniers comptaient <strong>de</strong>ux propriétaires (dont une femme, fille<br />
d’un titulaire décédé), <strong>de</strong>ux avoués, un ancien notaire, un mé<strong>de</strong>cin. I1 n’y avait<br />
plus <strong>de</strong> fonctionnaires. La Société, désormais coupée du milieu <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong><br />
I’État, n’avait pas pour autant élargi son assise dans la société notable <strong>de</strong> la région.<br />
Isolée, elle cessa toute activité en 1905 et ne conserva plus qu’une exis-<br />
tence formelle ”. En effet, les relations statutaires furent maintenues. Ainsi,<br />
Charles Gannelon, toujours prési<strong>de</strong>nt en titre, envoyait, en 1925, une lettre circu-<br />
laire aux membres <strong>de</strong> la Société où il rappelait : > Presque éteinte peu avant la première<br />
guerre mondiale, elle allait reprendre vie juste avant la secon<strong>de</strong>, en 1937.<br />
De la collection cì lu mise en histoire : les prutiques suvurites ’’<br />
La Société archéologique <strong>de</strong> Vervins réunissait <strong>de</strong>s personnalités diverses<br />
dont les formations, les activités et les intérêts différaient. Cependant, un trait<br />
commun peut être attribué à tous sans grand risque d’erreur : ils étaient <strong>de</strong>s col-<br />
lectionneurs acharnés. Trait nullement original d’ailleurs durant ce siècle où éru-<br />
22. La Thiérache, Lome vingtième, années 1902 et 1903, séance du 21 octobre 1902, p. 61.<br />
23. Sur ce point, la Société vervinoise évolue dill‘éreminent <strong>de</strong>s sociétés axonaises. Par exemple, en<br />
1905. au moment oil la première disparaissait, les sociétés <strong>de</strong> Laon et <strong>de</strong> Soissons voyaient la cour-<br />
be <strong>de</strong> leurs effectifs se redresser fortement entre 1905 et 19 13.<br />
24. Lettre manuscrite du docteur Charles Gannelon, datée du 15 mai 1925, Arch. SAHVT.<br />
25. Un tableau sociologique <strong>de</strong>s sociétés savantes <strong>de</strong> l’Aisne au XIX siècle et une enquête sur leurs<br />
objets d’étu<strong>de</strong> ont été effectués par Marc Le Pape : N Vers une histoire <strong>de</strong>s goûts savants. La décou-<br />
verte <strong>de</strong>s églises fortifiées <strong>de</strong> Thiérache, 1840- I939 >>, M6tnoire.s <strong>de</strong> lo Férlérrrtion <strong>de</strong>s .soc.iPtPs d’his-<br />
toire et d’nrchéologie tir I’Aisnr. t. XXXVII, 1992, p. 147.163.
dition riinait avec collection, où le qualificatif <strong>de</strong> collectionneur était un attribut<br />
non négligeable <strong>de</strong> la notabilité. Un trait d’époque donc et qu’illustre cet exemple<br />
purenient vervinois. En 1861, Amédée Piette édita une plaquette consacrée à<br />
l’histoire <strong>de</strong> sa famille. Or, sur la notice concernant son cousin, Louis-Édouard,<br />
qui n’était pas encore le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Société, il écrivait : ><br />
Les sociétaires centraient leurs collections sur l’histoire régionale : elles se<br />
composaient <strong>de</strong> N découvertes >) dues à <strong>de</strong>s fouilles, à <strong>de</strong>s récupérations <strong>de</strong> gre-<br />
niers, <strong>de</strong> maisons en démolition, etc., et qui allaient du silex taillé à <strong>de</strong>s pièces<br />
manuscrites, en passant par <strong>de</strong>s monnaies et <strong>de</strong>s objets divers. Elles comprenaient<br />
également <strong>de</strong>s achats, notamment d’imprimés anciens. A Vervins, comme ailleurs,<br />
la passion individuelle <strong>de</strong> collection trouvait une expression collective dans un<br />
espace public oh elle s’extériorisait : le musée. Le projet <strong>de</strong> musée, bien qu’il ne<br />
fût pas explicitement inscrit dans les statuts fondateurs, était inhérent à la créa-<br />
tion <strong>de</strong> la Société, ainsi que l’atteste le discours inaugural d’Édouard Piette<br />
recommandant aux sociétaires <strong>de</strong> signaler à temps c< les découvertes intéres-<br />
santes D <strong>de</strong> fqon à ce que la Société soit mise en position ) archéologique, ils finançaient <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> recherche, <strong>de</strong> voyage, ils ache-<br />
taient <strong>de</strong>s ouvrages <strong>de</strong> base pour la bibliothèque. Quant à leur temps, ils le dépen-<br />
saient sans compter. Pour ceux qui en avaient beaucoup, les propriétaires rentiers,<br />
les retraités, on constate, à la lecture <strong>de</strong>s bulletins, qu’ils l’utilisaient pleinement<br />
et se montraient à la fois archéologues, copistes, rédacteurs voire polygraphes.<br />
Quant à ceux qui en avaient moins, mé<strong>de</strong>cins, juristes, prêtres, professeurs, fonc-<br />
tionnaires, ils consacraient certainement la plus gran<strong>de</strong> part <strong>de</strong> leurs loisirs à pré-<br />
parer <strong>de</strong>s communications pour les séances <strong>de</strong> la Société et son Bulletin. 11 reste<br />
cependant que, titulaires ou correspondants, seule une ininorité <strong>de</strong>s sociétaires<br />
148 Clairtline Virlul. Alciin Brunet<br />
réunions tenues mensuellement à l’hôtel <strong>de</strong> ville <strong>de</strong> Vervins et portant sur la vie<br />
<strong>de</strong> la Société (nouveaux membres, dons, relations avec d’autres sociétés, etc.),<br />
ainsi qu’un résumé <strong>de</strong>s communications. Très rapi<strong>de</strong>ment, ces <strong>de</strong>rnières furent<br />
intégralement imprimées si bien qu’un corpus abondant, les 21 tomes <strong>de</strong> Lu<br />
Tlzitruche, permet <strong>de</strong> connaître les pratiques savantes propres B cette société.<br />
Née sous le signe <strong>de</strong> l’archéologie, la Société s’y adonna pour <strong>de</strong> bon sur-<br />
tout durant les premières années, sans pour autant délaisser ce filon par la suite.<br />
I1 y eut <strong>de</strong>ux lieux et <strong>de</strong>ux grands moments : Verhinum et le présumé puis, à nouveau, en 1880, mais associé cette fois à François<br />
Rogine, professeur <strong>de</strong> sciences et géologue : ce <strong>de</strong>rnier ne vit que les restes d’une<br />
carrière ancienne. E. Piette, L. Papillon (ce <strong>de</strong>rnier s’intéressait aussi à la préhis-<br />
toire), E. Mennesson et E Rogine (celui-ci publia, durant plusieurs années, une<br />
géologie <strong>de</strong> la Thiérache) furent certainement les plus archéologues dc la Société.<br />
En 1877, La Thir‘ruche faisait état d’une circulaire <strong>de</strong> la Socikté française<br />
d’archéologie <strong>de</strong>mandant aux sociétés savantes <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à un inventaire <strong>de</strong>s<br />
objets d’art contenus dans les églises et autres biìtiments publics. Les sociétaires<br />
s’organisèrent pour y répondre sans rencontrer <strong>de</strong> difficultés particulières, tant la<br />
pratique <strong>de</strong> l’inventaire leur était familière. En effet, les bulletins manifestent une<br />
tendance, qui ne faiblira pas, à l’accumulation <strong>de</strong>scriptive <strong>de</strong> monuments et objets<br />
anciens, églises villageoises, chiteaux, pierres tombales, sceaux, armoiries,<br />
plaques <strong>de</strong> cheminée, etc. Un trait constant également, mais qui préexislait à la<br />
Société, consiste à reproduire <strong>de</strong>s textes anciens concernant <strong>de</strong>s villes, <strong>de</strong>s vil-<br />
lages ou <strong>de</strong>s individus. Le genre biographique est souvent abordé <strong>de</strong> cette façon :<br />
une brève introduction sur le personnage puis la reproduction pure et simple <strong>de</strong><br />
textes qui leur sont liés.<br />
En fait, la plupart <strong>de</strong>s rédacteurs, en continuité avec leurs habitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> col-<br />
lection, conçoivent une histoire <strong>de</strong> leur région à condition <strong>de</strong> l’attacher à <strong>de</strong>s<br />
objets visibles, palpables - tous les monuments, toutes les ruines, tous les objets,<br />
<strong>de</strong> la poterie gallo-romaine à un contrat <strong>de</strong> mariage établi au XVI siècle - ou B<br />
<strong>de</strong>s événements matérialisés tels que <strong>de</strong>s coutumes <strong>locale</strong>s, l’usage d’un patois.<br />
Pour la plupart, donc, la pratique savante consiste B choisir et fréquemment<br />
> un objet historique pour en faire la notice avec les moyens du bord.<br />
28. Lu ThiPruche, 1875. p. 62. Pour les subventions, voir note 21.<br />
29. La Tliilrrrche. 1877, p. 135.
Milieu érurlit et .socic~té .wrv~inte m ThiPr~rchr 149<br />
Marc Le Pape, qui désigne cette attitu<strong>de</strong> intellectuelle, cette pratique, sous le nom<br />
et moins attirants selon l’esthétique explicite<br />
<strong>de</strong>s milieux savants ’I’.<br />
Des sociétaires vervinois publièrent aussi <strong>de</strong>s articles et <strong>de</strong>s travaux d’his-<br />
toire au sens mo<strong>de</strong>rne du terme. Sans doute le meilleur, à nos yeux actuels, fut-il<br />
composé, mais vingt-huit ans avant la création <strong>de</strong> la Société, par Amédée Piette.<br />
11 s’agit <strong>de</strong> son histoire <strong>de</strong> Foigny (voir note 5), et notamment <strong>de</strong>s pages consa-<br />
crées au développement économique <strong>de</strong> l’abbaye où, loin <strong>de</strong> s’en tenirà recopier<br />
ses sources, Piette construit ses données, évalue le capital foncier, en analyse les<br />
mises en valeur, étudie les comportements économiques <strong>de</strong>s prieurs. Membre<br />
correspondant <strong>de</strong> la Société vervinoise, il publia peu cependant dans la Thiérache.<br />
Son cousin, en revanche, écrivit beaucoup et, loin <strong>de</strong> se montrer exclusivement<br />
archéologue, publia durant neuf ans <strong>de</strong>s sources notariales qu’il éclairait <strong>de</strong> com-<br />
mentaires précis, son but étant <strong>de</strong> révéler Le docteur Penant céda, lui aussi, à l’engouement général<br />
pour
I so Clautlirir Vidiil, Aloin Brunet<br />
pas lieu ; la Société, réduite à quelques fidèles, ruinée, avait perdu son public. Son<br />
nouveau prési<strong>de</strong>nt, Alfred Falaize, publia à grand-peine, en 1908, les travaux <strong>de</strong><br />
1904 et 1905, puis ce fut le silence jusqu’en 1937. La municipalité se contenta <strong>de</strong><br />
fermer les <strong>de</strong>ux pièces qui constituaient le musée <strong>de</strong> la Société.<br />
Trois décennies sans aucune activité. Curieusement, le <strong>de</strong>rnier carré eut un<br />
réflexe <strong>de</strong> survie légale, maintint un bureau statutairement constitué, conserva le<br />
livret <strong>de</strong> Caisse d’épargne <strong>de</strong> la société et un titre du Crédit foncier. I1 y eut, en<br />
1912, une réunion qui confirma les rôles respectifs <strong>de</strong>s membres du bureau.<br />
TreiLe ans plus tard, en mai 1925, Alfred Falaize convoquait une réunion par I’in-<br />
termédiaire du docteur Gannelon, secrétaire <strong>de</strong> la Société (voir note 24). I1<br />
s’adressait aux sept sociétaires : cinq (< anciens >>, titulaires en 1905 (lui-même,<br />
Madame Albert Duflot, le docteur Gannelon, Adrien Herbert, déjà ancien notaire<br />
à cette date, Louis Lefèvre, ancien notaire) et <strong>de</strong>ux > (Henri Penant,<br />
mé<strong>de</strong>cin lui aussi,et Robert Falaize, avoué comme son père). La lettre proposait<br />
I’élection d’un nouveau bureau et la reprise <strong>de</strong>s activités
puisque les origines <strong>de</strong> la Société avaient été liées à une entreprise <strong>de</strong> presse -<br />
était acceptable, mais remettre l’avenir <strong>de</strong> la Société entre les mains d’un radical<br />
était tout autre chose. En effet, à ce moment, Creveaux était à I’évi<strong>de</strong>nce le seul<br />
qui pouvait redonner vie à la Société. D’abord parce qu’il écrivait sur la région :<br />
il avait publié en 1909 une étu<strong>de</strong> sociologique <strong>de</strong> la Thiérache ’9, tout en faisant<br />
paraître, dans Le Dé/iiocrate, <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s historiques sur la révolution <strong>de</strong> 1789 à<br />
Vervins. Ensuite parce qu’il était un élu municipal. Enfin parce qu’il nourrissait,<br />
précisément en tant qu’élu, un projet sur la Société.<br />
En septembre 1923, un journal régional, Le Lihérul, avait consacré <strong>de</strong>s<br />
pages appelant 2 la résurrection <strong>de</strong> la société archéologique <strong>de</strong> Vervins (malheu-<br />
reusement, nous ne possédons pas ces numéros). I1 reçut une lettre <strong>de</strong> Creveaux<br />
qu’il publia in exferzso “l. Ce <strong>de</strong>rnier, qui s’exprimait à la fois en tant qu’élu et en<br />
tant que continuateur <strong>de</strong> la Société, traçait un programme. > Un tel projet<br />
d’histoire immédiate, pour utiliser un terme actuel, était évi<strong>de</strong>niment radicale-<br />
ment étranger aux conceptions <strong>de</strong>s sociétaires. Mais il ne s’en tenait pas là et lan-<br />
çait une opération <strong>de</strong> ) au cours <strong>de</strong>s années par <strong>de</strong>s cher-<br />
cheurs désintéressés. Ce local sera mis à la disposition <strong>de</strong> la Société archéolo-<br />
gique qui pourra y tenir ses séances. Enfin, il répondait à une invite du journal :<br />
> Nous connaissons la réponse <strong>de</strong> la Société : la<br />
réélection, <strong>de</strong>ux ans plus tard, d’Alfred Falaize à la prési<strong>de</strong>nce et le maintien d’un<br />
bureau comportant les mêmes membres que celui <strong>de</strong> 1905.<br />
De 1911 à 1914, puis <strong>de</strong> 1919 à 1926, Alfred Falaize avait publié un<br />
feuilleton dans Le Dé/nocrute intitulé (< Le vieux Vervins >>, recueil d’historiettes<br />
<strong>locale</strong>s, comportant les stéréotypes, l’humour <strong>de</strong> bon aloi, les mièvreries et les<br />
préciosités souvent caractéristiques d’une littérature <strong>de</strong> la c< couleur <strong>locale</strong> >> 4’.<br />
Eugène Creveaux, dans ce même journal, publia durant les années 1926- 1927 ses<br />
travaux sur Vervins pendant l’occupation alleman<strong>de</strong> <strong>de</strong> 19 14- 19 18. Certes, les<br />
39. Eugène Creveaux, Le type thiirtrchieri, Paris, Bureau <strong>de</strong> la science sociale, 1909.<br />
40. Page du Libr‘rrrl conservée dans les Arch. <strong>de</strong> la SAHVT.<br />
41. Sur ce point. nous rcnvoyons au beau travail <strong>de</strong> Anne-Marie Thiesse, Écrire la Frcrnce. Le rnow<br />
verirent littProirr rc;qionrili.ste <strong>de</strong> Inngue,fi.trn(,ai.se erifre la Belle Epoque et lu Lihénrtion, Paris, PUF,<br />
1991.
I52 Cloudine Vidiil, Alriin Brunet<br />
<strong>de</strong>ux hommes n’appartenaient pas à la même génération, mais plus encore les<br />
séparaient leurs conceptions antagonistes du mon<strong>de</strong> et <strong>de</strong> l’histoire que l’on pou-<br />
vait en faire.<br />
En 1872, ce fut grlice à l’influence d’une personnalité extérieure à la<br />
région, le sous-préfet Etienne Pichon, que le milieu érudit <strong>de</strong> Vervins réussit à<br />
créer la Société archéologique <strong>de</strong> Vervins. En 1937, soixante-cinq ans plus tard,<br />
présida à la refondation <strong>de</strong> la Société un homme qui n’était pas né et n’avait pas<br />
vécu en Thiérache.<br />
La Société dans le X X siècle : 1937-1973<br />
Pierre Noailles, originaire <strong>de</strong> la Giron<strong>de</strong>, épousa en 1925 Henriette Duflot,<br />
dont la mère, Madame Albert Duflot, était <strong>de</strong>venue, on s’en souvient, membre <strong>de</strong><br />
la Société après le décès <strong>de</strong> son époux (I 899). Professeur d’histoire du droit<br />
romain à la faculté <strong>de</strong> droit <strong>de</strong> Paris, <strong>de</strong>venu picard d’adoption par son mariage,<br />
il présidait en 1936 la société académique
civil <strong>de</strong> Vervins). Quatre nouveaux membres furent admis dont Madame Noailles.<br />
I1 y eut trois communications, respectivement <strong>de</strong> Robert Falaize (qui lut une étu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> son père), du docteur Gannelon et d’Eugène Creveaux.<br />
Le nouveau prési<strong>de</strong>nt lança une vigoureuse campagne d’adhésion, se<br />
débarrassa <strong>de</strong> la distinction entre membres titulaires et membres correspondants.<br />
A la fin <strong>de</strong> l’année 1937, la Société comptait déjà 189 membres : 130 résidaient<br />
<strong>locale</strong>ment (69 %), 37 (20 %) à Paris, en Picardie, dans le Nord et dans d’autres<br />
départements. Jusqu’à l’assemblée générale du 17 juin 1939, ce bureau redonna<br />
vie à la Société : réouverture du musée, conférences publiques, venue d’invités<br />
prestigieux, réanimation <strong>de</strong>s relations avcc d’autres sociétés savantes, publication<br />
d’un premier Bulletin <strong>de</strong> LU Tliiértlclze en 1937 (le <strong>de</strong>uxième Bulletin était prêt en<br />
1939 mais ne put être publié qu’en 1945). La guerre interrompit cette efferves-<br />
cence, Pierre Noailles mourut en novembre 1943.<br />
Pierre Noailles, dans un article déjà cité (voir note 33), a exposé dans<br />
quelles directions <strong>de</strong>vaient être orientés, selon lui, les travaux <strong>de</strong> la Société. I1<br />
s’agit, bien entendu, <strong>de</strong> s’intéresser exclusivement à l’histoire <strong>locale</strong> : >, c’est-à-dire en s’ouvrant aux acquis <strong>de</strong> l’histoire nationale, en<br />
acceptant > pour reprendre le mot <strong>de</strong> Paul Veyne 45.<br />
D’abord en intégrant <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s que, sauf Eugène Creveaux, les sociétaires<br />
n’avaient qu’exceptionnellement abordées : la Révolution <strong>de</strong> 1789, la guerre <strong>de</strong><br />
19 14-1918. Ensuite en s’ouvrant aux enrichissements apportés par l’ensemble<br />
<strong>de</strong>s sciences sociales (économie politique, démographie, sociologie, géographie).<br />
Enfin, sous le terme <strong>de</strong> folklore, il introduit les investigations ethnologiques. Sur<br />
ce <strong>de</strong>rnier point, il suggère une possible division du travail entre les amateurs<br />
locaux et les Thiérachiens <strong>de</strong> l’extérieur. Les premiers n’ont plus le temps, les<br />
moyens et la culture <strong>de</strong> leurs prédécesseurs ‘‘l. II faut <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r aux seconds,<br />
I54 Clnuclitze VitIril. Alain Brunet<br />
Restait une <strong>de</strong>rnière mission assignée à la Société par son nouveau prési<strong>de</strong>nt<br />
: développer le musée, mais en dépassant sa spécificité archéologique pour<br />
le transformer en musée historique <strong>de</strong> la Thiérache, auquel serait adjoint un<br />
musée folklorique. La municipalité soutenait le projet : elle avait attribué <strong>de</strong>ux<br />
salles <strong>de</strong> I’h6tel <strong>de</strong> ville et un crédit pour les aménager.<br />
Le premier Birlletin (1937) <strong>de</strong> La TMruhe, nouvelle série, parut en 1938.<br />
Savant équilibre entre les pratiques anciennes <strong>de</strong> la Société et les voies tracées par<br />
Pierre Noailles (l’article <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier sur l’histoire <strong>de</strong> la Société ouvrant le volume),<br />
la livraison comportait <strong>de</strong>s articles signés par <strong>de</strong>s était représentés<br />
par Gabriel Hanotaux, <strong>de</strong> l’Académie française (sur <strong>de</strong>s poètes <strong>de</strong> la<br />
Thiérache), Roland Derche, professeur au lycée Carnot, et Ernest Ledrus, professeur<br />
à l’ÉCole militaire royale <strong>de</strong> Bruxelles.<br />
Le <strong>de</strong>uxième Bulletirz ( 1940) concrétisait l’effort entrepris pour mettre en<br />
valeur les églises fortifiées comme symbole touristique tout aussi bien qu’objet <strong>de</strong><br />
recherche et expression d’un art >. Étaient reproduites seize lithographies<br />
par Albert Lemasson, peintre et neveu par alliance <strong>de</strong> Pierre Noailles, qu’accompagnait<br />
un article <strong>de</strong> Hanotaux (a Les Eglises fortifiées <strong>de</strong> Thiérache dans I’histoire<br />
<strong>de</strong> France >>), précédé <strong>de</strong> a Sur les chemins <strong>de</strong> Thiérache >> par Jean Loize.<br />
1947- 1973<br />
La Société courut à nouveau le risque <strong>de</strong> disparaître, malgré la publication<br />
en 1945 <strong>de</strong> son <strong>de</strong>uxième Biilletin. La guerre, le décès <strong>de</strong> Pierre Noailles, le<br />
départ d’Eugène Creveaux, avaient brisé l’effervescence <strong>de</strong> 1937. I1 fallut le<br />
retour à Vervins <strong>de</strong> Henriette Noailles-Duflot, en 1947, pour que reprennent les<br />
activités. I1 n’y avait plus eu <strong>de</strong> réunions statutaires <strong>de</strong>puis 1939, elle en suscita<br />
une qui constitua un bureau présidé par Robert Falaize. Une assemblée générale<br />
extraordinaire suivit en 1948 ”. Les témoignages concor<strong>de</strong>nt sur ce point,<br />
Henriette Noailles continua I’œuvre <strong>de</strong> son mari. Elle renoua les liens avec les<br />
>, parmi lesquels Jacques Meurgey <strong>de</strong> Tupigny,<br />
conservateur aux Archives nationales, fut particulièrement actif. Elle continua à<br />
maintenir l’intérêt pour l’histoire <strong>locale</strong> dans le milieu vervinois par <strong>de</strong>s excur-<br />
sions, <strong>de</strong>s expositions et <strong>de</strong>s publications qu’elle finançait largement.<br />
Contrairement à ses prédécesseurs <strong>de</strong> la fin du siècle précé<strong>de</strong>nt, elle ouvrit la<br />
Société à <strong>de</strong> jeunes amateurs d’histoire <strong>locale</strong> qui, plus tard, en assurèrent la<br />
continuité. Lorsqu’en 1947 le maire <strong>de</strong> Vervins exigea <strong>de</strong> récupérer sans tar<strong>de</strong>r<br />
les pièces <strong>de</strong> I’h6tel <strong>de</strong> ville mises à disposition <strong>de</strong> la Société, les collections<br />
furent installées dans une dépendance <strong>de</strong> sa propriété <strong>de</strong> la Chaussée <strong>de</strong> Fontaine.<br />
A certains égards, l’entreprise menée par Henriette Noailles avait un aspect para-<br />
doxal : elle avait maintenu les directions mo<strong>de</strong>rnisatrices <strong>de</strong> Pierre Noailles mais,<br />
pour les accomplir, elle agissait comme, au XIX’ siècle, certains préTi<strong>de</strong>nts dont<br />
~<br />
47. Cette assemblée décida <strong>de</strong> donner une raison sociale inoins restrictive i la SociCté qui prit le nom<br />
<strong>de</strong> Société archéologique <strong>de</strong> Vervins et <strong>de</strong> la Thiérache.
la <strong>de</strong>meure, les ressources financières et sociales, l’énergie personnelle finissaient<br />
par ne plus faire qu’un avec leur Société.<br />
En 1949, la Société marqua le centenaire du titre La Thiéruche et publia un<br />
troisième tome <strong>de</strong> la nouvelle série. Si tous ses auteurs étaient bien membres <strong>de</strong><br />
la Société, ils vivaient tous ailleurs qu’en Thiérache, à l’exception d’un seul,<br />
Henri Sohier, un industriel hirsonnais, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la société <strong>de</strong>s amis du musée<br />
d’Hirson. Ce fut la <strong>de</strong>rnière parution <strong>de</strong> cette série. La Société, comme beaucoup<br />
d’autres, ne pouvait plus envisager d’assurer les frais et la diffusion d’un bulle-<br />
tin. En 1953, fut constituée la Fédération <strong>de</strong>s Sociétés savantes et historiques <strong>de</strong><br />
l’Aisne, éditrice (grâce à une subvention départementale) <strong>de</strong> Ménzoires annuels,<br />
auxquels collabora régulièrement la Société vervinoise.<br />
Robert Falaize démissionna <strong>de</strong> la prési<strong>de</strong>nce en 1955. I1 fut remplacé par<br />
un architecte, Jean Cannone, qui mourut en 1972. Henriette Noailles accepta <strong>de</strong><br />
lui succé<strong>de</strong>r pour un court laps <strong>de</strong> temps. Les réunions <strong>de</strong> la Société étaient <strong>de</strong>ve-<br />
nues trimestrielles, un petit groupe d’adhérents intéressés par la recherche<br />
archéologique avait fondé sa propre association (le groupe <strong>de</strong> Recherches archéo-<br />
logiques <strong>de</strong> la Thiérache) tout en continuant à faire partie <strong>de</strong> la Société.<br />
Le centenaire <strong>de</strong> la Société<br />
Depuis sa création, la Société n’avait jamais renoncé à constituer un<br />
musée. Après la secon<strong>de</strong> guerre mondiale, faute <strong>de</strong> local, six expositions tempo-<br />
raires avaient été ouvertes au public dans une salle prêtée par l’hôtel <strong>de</strong> ville. En<br />
1971, les collections <strong>de</strong> la Société, abritées chez Henrictte Noailles, élaient trans-<br />
férées dans une maison ancienne, propriété <strong>de</strong> la commune <strong>de</strong> Vervins, <strong>de</strong>venue<br />
le siège administratif <strong>de</strong> la Société qui comptait alors 199 membres.<br />
Le nouveau bureau profita du centenaire pour monter une exposition qui<br />
serait une avant-première du futur musée. I1 décida également qu’une publication<br />
s’imposait. Ce fut la <strong>de</strong>rnière fois que la Société publia sous le titre La Thiérache<br />
un volume tiré à 2 O00 exemplaires. Quinze auteurs y participèrent, Meurgey <strong>de</strong><br />
Tupigny avait écnt l’article introductif qui faisait le point sur les <strong>de</strong>rnières vingt-<br />
cinq années d’activité <strong>de</strong> la Société. I1 décéda en août <strong>de</strong> la même année. Henriette<br />
Noailles démissionna après le centenaire, ainsi qu’elle l’avait annoncé “.<br />
Son départ, qui coïncidait avec le centenaire <strong>de</strong> la Société, marquait sym-<br />
boliquement la rupture avec le style <strong>de</strong> la sociabilité savante, très liée au mon<strong>de</strong><br />
dcs notables que, volontairement ou non, elle représentait encore. Depuis cette<br />
date, les déterminations sociologiques et les pratiques effectives <strong>de</strong> l’histoire<br />
<strong>locale</strong> ont donné <strong>de</strong>s formes bien différentes à cette sociabilité qui compose<br />
désormais avec <strong>de</strong>s tendances aussi diverses que la recherche <strong>de</strong> loisirs culturels,<br />
le succès <strong>de</strong> la notion <strong>de</strong> patrimoine, la mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> la recherche généalogique, l’en-<br />
gouement pour l’écologie, la généralisation <strong>de</strong>s sentiments i<strong>de</strong>ntitaires liés à la<br />
région d’origine et, enfin, le développement accru <strong>de</strong>s liens établis avec la<br />
recherche universitaire.<br />
38. Elle déceda en 1982.<br />
Claudine VIDAL, Alain BRUNET
156 Claudine HaM, A& Brunet<br />
Membres <strong>de</strong> h MM archblogique <strong>de</strong> Ve**<br />
3. Ethm pichon m~~ <strong>de</strong> Vervin6, fondateur <strong>de</strong> la SocW archCologique <strong>de</strong> &s (1 873) et d’honneur<br />
* Ces portraits proviennent <strong>de</strong>$ archives <strong>de</strong> la SAHVT. (Cl. B. Vasseur). Aucun document mnm-<br />
nant Charles Gannelon, me<strong>de</strong>ci, @i<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> 1m h 1937. n’a pu etre re”5
Milieu &rudit et société savante en Thiérache 157<br />
4. Le duc d'Aumale, Ni<strong>de</strong>nt d'honneur
158 Claudine Vidal, Alain Brunet<br />
5. E d w a r d Pieae. ancien banquier, ancien &put& prmh prt%i<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Soci&? (1873-1890)<br />
7. Edwarouard Fleury, imprimeur, journaliste, bistaien, membre cOrreSpOndant
Milieu érudit et société savante en Thiérache 159<br />
6. Ernest Lavisse, historien, membre <strong>de</strong> l'Académie fiançaise, membre correspondant<br />
8. Charles Graux, linguiste, membre correspondant
160 Claudine Vïl, Alain Brunet<br />
11. Auguste Penant, mMecin, p&i<strong>de</strong>.nt (1902-1909)
Milieu érudit et société savante en Thiérache<br />
10. Eugbne Mennason, docteur I<br />
opri6taire. phi<strong>de</strong>nt (1890-1902)<br />
12. Alfred Falaize, avoué, pdsi<strong>de</strong>nt (1912-1928)<br />
161
162 Claudine Vial, Alain Brunet<br />
15. Eughe Creveaux, entrepreneur, maire <strong>de</strong> Vervins
Milieu érudit et société savante en Thiérache<br />
r<br />
14. Abbe M6ra<br />
163
164 Claudine Vidal, Alain Brunet<br />
17. Ji<br />
r<br />
s Meurgey <strong>de</strong> lbpigny, conservateur <strong>de</strong>s Archives nationales, @i<strong>de</strong>nt d'honneur<br />
19. Jean Calonne, architecte, pdsi<strong>de</strong>nt (1955-1972)
Milieu érudit et société savante en Thiérache 165<br />
18. Robert Falaize, avoue, pdsi<strong>de</strong>nt (1947-1955)<br />
20. Henriette Noailles-Duflot, propri&tak, pdsi<strong>de</strong>nte (1972-1973)
De l’imaginaire <strong>de</strong>s historiens locaux<br />
à l’imaginaire <strong>de</strong> François Ir et <strong>de</strong> Henri II :<br />
les sculptures scandaleuses<br />
du château <strong>de</strong> Villers-Cotterêts<br />
Tous les historiens cotteréziens <strong>de</strong>s XIX et X X siècles se sont penchés sur<br />
l’histoire du château construit à Villers-Cotterêts par François I“ et Henri II. Ils<br />
ont collecté <strong>de</strong>s renseignements et ont rédigé <strong>de</strong>s synthèses. De cette façon, ils ont<br />
essayé <strong>de</strong> >. Mais lorsqu’il leur a fallu parler <strong>de</strong>s H, <strong>de</strong>s K et <strong>de</strong>s croissants du<br />
pavillon <strong>de</strong> l’auditoire, <strong>de</strong>s caissons <strong>de</strong> l’escalier sud-est et <strong>de</strong>s euvres disparues,<br />
ils n’ont pas su se gar<strong>de</strong>r <strong>de</strong> leurs préjugés et, plutôt que d’aller vers l’imaginai-<br />
re <strong>de</strong> François I’ et <strong>de</strong> Henri II, sont restés prisonniers du leur. Ainsi est né le<br />
mythe <strong>de</strong>s sculptures scandaleuses du chateau <strong>de</strong> Villers-Cotterêts. Analyser son<br />
contenu. c’est montrer les difficultés du travail <strong>de</strong> l’historien local.<br />
Les H, les K et les croissants du pavillon <strong>de</strong> l’auditoire<br />
Deux couples <strong>de</strong> H et <strong>de</strong> K sont visibles sur la face occi<strong>de</strong>ntale du pavillon<br />
<strong>de</strong> l’auditoire. Tous sont surmontés d’une couronne fermée mais, alors que celui<br />
<strong>de</strong> droite est uni par un lacs d’amour, celui <strong>de</strong> gauche l’est par un croissant. Ce<br />
<strong>de</strong>rnier emblème n’apparaît seul qu’à cet endroit. Plus bas sur la face occi<strong>de</strong>nla-<br />
le, ainsi que sur la faça<strong>de</strong>, on voit <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> trois croissants enlacés qui alter-<br />
nent avec <strong>de</strong>s H feuillagés.<br />
L‘abbé François Chollet, curé-doyen <strong>de</strong> Villers-Cotterêts, a été le premier<br />
historien local à exprimer son étonnement B la vue <strong>de</strong> ces sculptures. I1 l’a fait<br />
ainsi dans son Sernierat nid gar<strong>de</strong>‘ ou Villers-Cottergts et ses enviroris publié en<br />
1853 : ><br />
1. Marcel Leroy, Le Ckirtenu <strong>de</strong> Viller.~-CotterCr.s, Villers-Cotterêts, Soci&é historique régionale <strong>de</strong><br />
Villers-Cotter¿%. 1964, 3‘ éd., p. I.<br />
2. Franpis Chollet, Un .serrnenf nid g d P ou Vil/í.rs-Co//rr~/s et .ses eiivirons, Villers-Colterêts -<br />
Soissons, Obry-Lalance, 1853, p. 200.
168 Eric Thierry<br />
Ce que l’abbé Chollet a du mal à imaginer, c’est qu’un roi <strong>de</strong> France - un<br />
roi dit très chrétien - n’avait pas honte <strong>de</strong> son adultère. Pour bien comprendre ce<br />
prêtre, il ne faut pas oublier qu’entre Henri II et lui, il y a le concile <strong>de</strong> Trente et<br />
la revalorisation du sacrement du mariage. Au XVII‘ siècle, saint François <strong>de</strong><br />
Sales a proclamé, dans son Introduction à la vie &vote, la sainteté <strong>de</strong> celui-ci, son<br />
éminente dignité et le respect qui lui est dû, et il a été suivi par Fénelon et<br />
Bossuet, ce <strong>de</strong>rnier écrivant à Madame Cornuau : ) Mais, dans la première moitié du siècle précé<strong>de</strong>nt, ce sacrement<br />
était encore privé <strong>de</strong> prestige : la dame <strong>de</strong>s pensées doublait alors couramment la<br />
femme <strong>de</strong> tous les jours.<br />
Comme dans la LXIII‘ nouvelle <strong>de</strong> L’Hepcinzéron <strong>de</strong> Marguerite <strong>de</strong><br />
Navarre, la sœur <strong>de</strong> FranGois I“, il n’était pas rare <strong>de</strong> rencontrer > qui, >, et qui, >, Diane <strong>de</strong> Poitiers, et son<br />
épouse légitime, Catherine <strong>de</strong> Médicis. L‘ambassa<strong>de</strong>ur Lorenzo Contarini n’a pas<br />
caché les efforts que <strong>de</strong>vait faire celle-ci pour supporter sa situation : ><br />
Le romantique Alexandre Dumas, quant à lui, pouvait facilement imaginer<br />
ce qu’avait dû être le ménage à trois formé par Henri II, Catherine <strong>de</strong> Médicis et<br />
Diane <strong>de</strong> Poitiers. Dans La Reine Mcrrgot, La Dame <strong>de</strong> Monsoreau et Les<br />
Quaranre-Cinq, il avait déjà su montrer <strong>de</strong>s Grands du XVI’ siècle dissimulateurs<br />
et débauchés qui faisaient fi du sacrement du mariage. Aussi, dans un article <strong>de</strong><br />
1864 consacré à son Villers-Cotterêts natal, s’est-il proposé <strong>de</strong> raconter l’histoire<br />
<strong>de</strong>s H, <strong>de</strong>s K et <strong>de</strong>s croissants du pavillon <strong>de</strong> l’auditoire. I1 l’a fait avec son incon-<br />
testable talent <strong>de</strong> romancier, mais - comme à son habitu<strong>de</strong> - sans un grand souci<br />
<strong>de</strong> l’exactitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s hits :<br />
3. François <strong>de</strong> Sales, Introd~rction ir In vie d&ote. éd. André Ravier, S.I., Atelier Henry Labat. 1989,<br />
chap. XXXVllI :
L’irrrugiiiuire <strong>de</strong>s kistoriens IOCNUX : Ir chillemu <strong>de</strong> Villers-Co~~c~rêts I69<br />
: onze ans était l’&e qu’il avait 2 sa libération, eil<br />
1530, après une captivité qui avait commencé en 1526, au len<strong>de</strong>main du Traité <strong>de</strong><br />
Madrid imposé par Charles Quintà François I“ ’. I1 n’était pas non plus déjà l’amant<br />
<strong>de</strong> Diane <strong>de</strong> Poitiers lorsqu’il épousa, en 1533, Catherine <strong>de</strong> Medicis : la gran<strong>de</strong><br />
sénéchale <strong>de</strong> Normandie fut une veuve irréprochable jusqu’en 1538 et Henri dut lui<br />
faire une cour assidue, sans pour autant se détourner <strong>de</strong> sa femme légitime ’.<br />
6. Alexandre Dumas, Le Arqs na/nl, éd. Clau<strong>de</strong> Schopp, Paris, Mercure <strong>de</strong> France, 1996, p. 23-25.<br />
7. I. Cloulas, Henri II, Paris. Fayard. 1985, p. 35-53.<br />
8. 1. Cloulas, Dinne <strong>de</strong> Poitierx. Paris, Fayard. 1999. p. 78- 103. Rien ne prouve que Diane <strong>de</strong> Poitiers<br />
ait été la inaitresse <strong>de</strong> Franpois IL‘ : ibid., p. 59-61.
170 Eric Thierry<br />
Certes, Catherine <strong>de</strong> Médicis n’était pas particulièrement belle, avec son<br />
visage rond, ses yeux gros et sa lèvre forte, mais elle avait un regard intelligent,<br />
elle était gracieuse et aimable, et faisait preuve d’une remarquable élégance et<br />
d’une culture brillante. Aussi était-elle très appréciée par son mari et par son<br />
beau-père, bien qu’elle tard% à engendrer : >, nous apprend Brantôme, que,<br />
><br />
Alexandre Dumas a en revanche raison lorsqu’il évoque l’ai<strong>de</strong> décisive<br />
apportée par Diane <strong>de</strong> Poitiers à Catherine <strong>de</strong> Médicis pour lui permettre <strong>de</strong> sur-<br />
monter l’épreuve <strong>de</strong> sa stérilité. C’était parce que la maîtresse du dauphin ne<br />
souffrait aucune négligence et qu’elle obligeait son amant à coucher assidûment<br />
avec sa femme que l’ambassa<strong>de</strong>ur vénitien Matteo Dandolo put dire <strong>de</strong> celle-ci<br />
en 1542 : > Ainsi le miracle tant attendu se produisit : le 19 janvier 1544,<br />
Catherine <strong>de</strong> Médicis donna naissance à son premier enfant, le futur François II,<br />
et dix autres suivirent jusqu’en 1556, à un rythme remarquable. Quant à admettre,<br />
comme l’illustre romancier, que ce fut pour remercier Diane <strong>de</strong> Poitiers qu’Henri<br />
mêla le et, plutôt que <strong>de</strong> croire un souverain très<br />
chrétien capable <strong>de</strong> n’avoir pas honte <strong>de</strong> son adultère, il a cherché à montrer que<br />
le croissant était avant tout un emblème <strong>de</strong> Catherine <strong>de</strong> Médicis.<br />
Pour cela, il a dit :
pouvait bien, en mémoire <strong>de</strong> son illustre ancêtre, adopter le croissant oriental >>,<br />
et il n’a donné qu’un seul exemple :<br />
, que ses propos ont fait autorité chez ses successeurs.<br />
L‘un <strong>de</strong> ceux-ci a été Ernest Roch, le premier secrétaire <strong>de</strong> la Société his-<br />
torique régionale <strong>de</strong> Villers-Cotterêts créée en 1905. Dans son histoire du chsteau<br />
paru en 1909, il n’a pas hésité - avec conviction - à paraphraser Alexandre<br />
Michaux : > Mais il a cru tout <strong>de</strong><br />
même bon <strong>de</strong> rajouter quelques justificatifs tirés du mythe fort en vogue au<br />
XIX‘ siècle <strong>de</strong> la Catherine florentine, machiavélique et éprise <strong>de</strong> sciences<br />
occultes : ><br />
Certes, Catherine <strong>de</strong> Médicis eut souvent recours aux astrologues et aux<br />
magiciens, mais ce fut surtout dans la pério<strong>de</strong> d’incertitu<strong>de</strong> et d’angoisse person-<br />
12. Alexandre Michaux, CT//er.c-Correr2f.s er SYS em,irnris, Paris, reed. Res Universis. 1988. p. 32<br />
et 31.<br />
13. Ernczt Roch, e L‘Ancien Chdteau royal D, Birllrtiri <strong>de</strong> In Société his~oriqiio régkimle <strong>de</strong> Villcrs-<br />
Corter-?ts, 1909. p. 177-178. Sur le mythe í‘or1 en vogue au XIX siècle <strong>de</strong> la Catherine Ilorentine,<br />
machiavélique et éprise <strong>de</strong> sciences occultes, I. Cloulas, Critheririe tle Mklicis, op. cit.. p. 16.
172 Eric Thierrv<br />
nelle qui suivit la mort <strong>de</strong> son mari en 1559. Ce fut ainsi peu <strong>de</strong> temps après I’avè-<br />
nement <strong>de</strong> Franqois II qu’elle aurait consulté le miroir magique détenu par Côme<br />
Ruggieri : ses fils seraient apparus, ils auraient tourné autant <strong>de</strong> fois qu’ils<br />
<strong>de</strong>vaient régner d’années et, après une courte apparition du futur Henri <strong>de</strong> Guise,<br />
Henri <strong>de</strong> Navarre aurait terminé le défilé I‘. Quant à la puissance protectrice<br />
extraordinaire D qu’elle aurait accordée au croissant, on a du mal à s’en rendre<br />
compte à l’examen <strong>de</strong> quelques-uns <strong>de</strong> ses talismans qui nous sont connus : la<br />
lune naissante n’est qu’un <strong>de</strong>s très nombreux signes utilisés, que ce soit sur la<br />
médaille en bronze <strong>de</strong> la Bibliothèque nationale <strong>de</strong> France, sur le parchemin évo-<br />
qué par Le Laboureur ou sur le bracelet décrit par Paul Lacroix IC.<br />
Même non fondée, l’attribution à Catherine <strong>de</strong> Médicis <strong>de</strong>s croissants du<br />
pavillon <strong>de</strong> l’auditoire est restée une vérité soli<strong>de</strong>ment établie chez les historiens<br />
cotteré7iens. Ainsi, en 1959, Marcel Leroy, nouveau secrétaire <strong>de</strong> la Société his-<br />
torique régionale <strong>de</strong> Villers-Cotterêts, ne s’est pas cru autorisé à la contester :<br />
. I1 y a écrit avec justesse, à propos du croissant :
s’étaler sur les boiseries <strong>de</strong> la chambre du Louvre qui était le sanctuaire <strong>de</strong> la<br />
monarchie, sur le reliquaire <strong>de</strong> la Résurrection oÙ ils furent ajoutés lorsque Henri<br />
donna cet objet <strong>de</strong>s collections royales iì la cathédrale <strong>de</strong> Reims à l’occasion <strong>de</strong><br />
son sacre, sur un émail du Louvre offert par lui à la Sainte-Chapelle sur lequel il<br />
figure à genoux près <strong>de</strong> Catherine <strong>de</strong> Médicis, ou encore sur l’armure du jeune<br />
François, son fils aîné, avec la salamandre <strong>de</strong> son grand-père, on doute que le<br />
croissant puisse être l’affirmation d’une liaison, officielle mais fort illégitime I’. n<br />
Un siècle après l’Histoire <strong>de</strong> Villet-s-Cofferêfs d’Alexandre Michaux, les mêmes<br />
préjugés sévissaient encore.. .<br />
Malgré ses anachronismes, l’article <strong>de</strong> Francis Salet fait encore aujour-<br />
d’hui autorité. II serait pourtant temps d’éclairer les H, les K et les croissants du<br />
pavillon <strong>de</strong> l’auditoire à la lumière <strong>de</strong> quelques témoignages qui leur sont<br />
contemporains. Lisons tout d’abord, dans le livret <strong>de</strong> son sacre célébré le 26<br />
juillet 1547, la <strong>de</strong>scription du pourpoint porté par le roi Henri II : il était <br />
Grâce à ces <strong>de</strong>ux documents, nous pouvons confirmer que, pour le roi et<br />
ses contemporains, les croissants évoquaient bien Diane <strong>de</strong> Poitiers et que Henri<br />
II n’hésitait pas à montrer à tous que la duchesse <strong>de</strong> Valentinois était la dame <strong>de</strong><br />
ses pensées. Dans l’exercice <strong>de</strong> la fonction royale, s’il confondait sa <strong>de</strong>vise avec<br />
le chiffre <strong>de</strong> sa maîtresse, c’était parce que l’amour <strong>de</strong> sa Dame <strong>de</strong>vait lui per-<br />
17. Francis Salet, ,<br />
F6dircrtion .... O/’. cit., t. XV. 1969. p. 119. Avec trois croissants entrelacés. Hcnri II a fait incruster<br />
sur le reliquaire <strong>de</strong> la Résurrection un H l‘ornié - <strong>de</strong> kqon très apparente <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux D majuscules,<br />
l’un émaillé <strong>de</strong> blanc, I‘autre <strong>de</strong> noir. II s’agit li d’une allusion manifeste B l’amour ressenti pal- le<br />
roi pour Diane <strong>de</strong> Poitiers : I. Cloulas. Henri II, op. cir.. p. 154-155.<br />
18. Cité par Jchanne d’Orliac, Ditrrie <strong>de</strong> Poitiers, Grmit ‘.s~trPchtr//e tlr Nor/riurzdie, Paris, Plon, 1930.<br />
p. 142.<br />
19. Arnaud Baschet (éd.), Ln Diplorrrotie vdnirierwe. Le.r /~rir7c.es <strong>de</strong> 1’E~rope NU XVP siècle I...],<br />
d’après les ropporrs <strong>de</strong>s nrrihu.s.~rrrlerrr.v i@riiticrr.r. Paris. Plon, 1862. p. 443.
mettre <strong>de</strong> se comporter en héros et <strong>de</strong> surmonter tous les obstacles. Le successeur<br />
<strong>de</strong> François Ier aspirait à être un véritable roi chevalier, l’Amadis <strong>de</strong> Gaule dont<br />
il appréciait tant les aventures racontées par Garcia Ordonez <strong>de</strong> Montalvo ’(l. I1<br />
était animé par un désir <strong>de</strong> gloire chevaleresque et ce fut ce désir qu’il fit expri-<br />
mer sur les murs du pavillon <strong>de</strong> l’auditoire <strong>de</strong> son chsteau <strong>de</strong> Villers-Cotterêts.<br />
Les caissons <strong>de</strong> l’escalier sud-est<br />
D’autres sculptures mal comprises sont six grands caissons visibles dans<br />
l’angle sud-est <strong>de</strong>s bltiments qui encadrent la cour du jeu <strong>de</strong> paume. Ils ornent les<br />
voûtes <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux volées d’un petit escalier droit qui permettait d’accé<strong>de</strong>r à la cha-<br />
pelle par un raccord <strong>de</strong> maçonnerie en pan coupé. Tous sont travaillés en haut-<br />
relief mais, alors que les trois qui occupent la voûte inclinée <strong>de</strong> la volée montant<br />
d’un entresol au premier étage sont rectangulaires et portés par <strong>de</strong>s arcs en anse<br />
<strong>de</strong> panier, les trois qui forment la voûte plate <strong>de</strong> la volée allant du premier étage<br />
à un autre entresol sont carrés et soutenus par <strong>de</strong>s architraves.<br />
Les historiens locaux ont toujours été scandalisés par les scènes représen-<br />
tées. Ainsi, en 1853, l’abbé Chollet a écrit : >, et, en 1986, Marcel Leroy a encore parlé <strong>de</strong> ces . Puis, en 191 I , E. Lefèvre-Pontalis l’a qualifié <strong>de</strong> >, tandis qu’en 1927, François Gebelin a parlé <strong>de</strong> la > <strong>de</strong> son<br />
plafond. Enfin, en 1990, Jean-Pierre Babelon l’a jugé et, l’année sui-<br />
vante. Christiane Riboulleau lui a fait la part belle dans son ouvrage tout entier<br />
consacré au chdteau <strong>de</strong> Villers-Cotterêts ?’.<br />
Les comptes <strong>de</strong>s bdtiments du roi étudiés par cette <strong>de</strong>rnière nous autorisent<br />
20. 1. Cloulas. Heriri II. op. cit.. p. 62 65.<br />
21. E Chollet, op. cit.. p. 178 : M. Leroy. M LEpoque “Rennissance” avec la Société historique )>,<br />
L‘U/rion, 16 avril I986 : Léon Palu\tre. Ltr Kwrri.\.\o/rc.e PII Frtrtice. 3 liiartrisori : /le tk-Frtuice<br />
(Ai~c,). Paris, A. Quaiitin, 1880, p. 130 ; E. Lefèvre Pontalis. (< Ch3teau <strong>de</strong> Villers-Cotterêts n,<br />
Corrgrt.~ crn~l~Pol~~,~it~rrr tle Frtrrrce. LXXVlll se.\ \iwi teiriit’ ir Keirrrs eu 191 I ptrr It/ Soc.iPtP,frtrri(,trisr<br />
d’cr,r~liiolo,~i~, t. I : Gui<strong>de</strong> dir cmgrt.\. Paria-Caen. Sociéti franpaise d‘archéologie, I9 12. p. 427 :<br />
Franpois Gebelin. Le.\ Clrcitcwirx tlr Irr R~woi.sco/rce. Paris, 1927, p. I82 : Jean-Pierre Babelon,
à situer la réalisation <strong>de</strong> ces caissons entre 1532 et 1540 ‘2, mais ne nous permet-<br />
tent pas <strong>de</strong> savoir qui les a sculptés. Marcel Leroy les a attribués à >, mais c’était oublier que Jean Goujon n’est <strong>de</strong>venu sculpteur du roi qu’à<br />
partir <strong>de</strong> l’avènement <strong>de</strong> Henri II, en 1547, et que ses premières œuvres, à Rouen,<br />
dans la cathédrale et dans I’église Saint-Maclou, ne datent que <strong>de</strong>s alentours <strong>de</strong><br />
1540 :‘. Plus intéressant est le rapprochement qu’a fait Léon Palustre entre les<br />
caissons cotteréziens et ceux qui auraient illustré les Mttarnorphoses d’Ovi<strong>de</strong> sur<br />
la voûte d’un escalier en vis du château <strong>de</strong> Madrid. Malheureusement, cet édifi-<br />
ce construit dans le bois <strong>de</strong> Boulogne à partir <strong>de</strong> 1528 a été entièrement détruit en<br />
1792 et son historienne, Monique Chatenet, a récemment remis en cause le témoi-<br />
gnage <strong>de</strong> Poncet <strong>de</strong> La Grave sur lequel s’est fondé Léon Palustre 24.<br />
Les gran<strong>de</strong>s plaques historiées en haut-relief du château <strong>de</strong> Villers-<br />
Cotterêts restent sans équivalents connus, mais les scènes représentées peuvent<br />
être facilement i<strong>de</strong>ntifiées <strong>de</strong>puis les recherches faites par Christiane Riboulleau<br />
et ses <strong>de</strong>vanciers. La voûte <strong>de</strong> la volée qui monte d’un entresol au premier étage<br />
commence par un caisson représentant un satyre et une nymphe. Léon Palustre y<br />
a vu une illustration d’un passage du Songe <strong>de</strong> Poliphile, mais Christiane<br />
Riboulleau a noté avec raison que le satyre <strong>de</strong> l’ouvrage <strong>de</strong> Francesco Colonna se<br />
contente <strong>de</strong> regar<strong>de</strong>r avec admiration la nymphe endormie, alors que celui <strong>de</strong><br />
Villers-Cotterêts profite <strong>de</strong> son sommeil pour la dévêtir. Le caisson cotterézien<br />
semble plutôt représenter Jupiter séduisant Antiope sous la forme d’un satyre. Ce<br />
sujet a été évoqué par plusieurs gravures <strong>de</strong> Marcantonio Raimondi d’après <strong>de</strong>s<br />
peintres italiens ou d’après l’antique, par <strong>de</strong> nombreuses compositions <strong>de</strong>s<br />
maîtres <strong>de</strong> 1’Ecole <strong>de</strong> Fontainebleau, par la Vénus du Pardo peinte par Titien et<br />
conservée au Louvre et par un <strong>de</strong>ssin du British Museum attribué à Perino <strong>de</strong>l<br />
Vaga ou à Jules Romain. Toutefois, la plaque sculptée du château <strong>de</strong> Villers-<br />
Cotterêts ne reproduit aucune <strong>de</strong> ces œuvres<br />
Le caisson suivant n’a pas non plus <strong>de</strong> modèle connu. I1 représente une<br />
nymphc, ou Vénus, accompagnée <strong>de</strong> l’Amour tenant une flèche. François<br />
Gebelin y a vu lui aussi une illustration d’un passage du Sorige <strong>de</strong> Poliphile : > Mais, là encore,<br />
Christiane Riboulleau a remarqué avec justesse qu’à Villers-Cotterêts l’Amour<br />
est aptère. Elle a aussi écrit :
ce qui empêche à tout jamais la compréhension exacte du geste, mais nous ne<br />
pensons pas nous tromper <strong>de</strong> bcaucoup en supposant que la jeune femme levait le<br />
bras pour maintenir hors <strong>de</strong> portée <strong>de</strong> l’enfant son carquois ou son arc, ou bien<br />
pour le frapper ?h. >> Pour ma part, je ne peux pas m’empêcher <strong>de</strong> rapprocher la<br />
scène <strong>de</strong> Villers-Cotterêts <strong>de</strong> ce passage <strong>de</strong>s Métcimorphoses d’Ovi<strong>de</strong> : e [. . .] en<br />
donnant un baiser à Vénus, le petit dieu armé du carquois a effleuré, sans le<br />
savoir, avec le roseau d’une flèche qui dépassait le bord, la poitrine maternelle.<br />
La déesse, se sentant blessée, a repoussé son fils 27. >><br />
Quant au <strong>de</strong>rnier caisson <strong>de</strong> la volée, il représente Hercule terrassant le<br />
lion <strong>de</strong> Némée. Depuis 1927, on connaît, grâce à François Gebelin, le modèle uti-<br />
lisé pour cette scène. I1 s’agit d’une plaquette en bronze <strong>de</strong> Mo<strong>de</strong>rno, dont on pos-<br />
sè<strong>de</strong> encore aujourd’hui plusieurs exemplaires ”. Des différences subsistent tou-<br />
tefois : le tronc d’arbre et l’armement du héros ne figurent pas à Villers-Cotterêts<br />
et ce n’est pas un Hercule imberbe qui y a été représenté, mais un Hercule barbu.<br />
Sur la volée suivante, celle qui monte du premier étage à un entresol, on<br />
peut tout d’abord voir un Mercure mutilé. Une moitié du caisson manque, mais<br />
on peut observer le caducée utilisé par le dieu pour séparer <strong>de</strong>ux serpents qui se<br />
battaient, ainsi qu’une flûte, l’instrument qui lui a permis d’endormir Argus, le<br />
géant aux cent yeux - dont cinquante restaient toujours ouverts - chargé par<br />
Junon <strong>de</strong> surveiller Io ”. I1 s’agit d’une représentation qui n’est inspirée d’aucu-<br />
ne œuvre connue, mais Christiane Riboulleau a remarqué que (( le hanchement du<br />
corps et l’allongement <strong>de</strong>s membres inférieurs rappellent à la fois les composi-<br />
tions <strong>de</strong> 1’Ecole raphaëlesque et <strong>de</strong> I’Ecole <strong>de</strong> Fontainebleau, inspirées elles-<br />
mêmes <strong>de</strong> l’observation <strong>de</strong>s statues antiques ”’ >>.<br />
Ensuite, c’est un Jupiter embrassant l’Amour qui est visible. Le premier<br />
peut être reconnu grâce à l’aigle à la foudre qui se tient à ses pieds. Quant au<br />
<strong>de</strong>uxième, il a <strong>de</strong>s ailes et tient une flèche et un arc. François Gebelin a vu là une<br />
illustration <strong>de</strong> la suite du passage du Sor7ge <strong>de</strong> Poliphile cité précé<strong>de</strong>mment : > Mais c’est une fois <strong>de</strong> plus à tort : l’Amour,<br />
chez Colonna, n’est qu’un enfant, tandis que le caisson <strong>de</strong> Villers-Cotterêts le<br />
représente adolescent.<br />
Christiane Riboulleau a découvert le véritable modèle <strong>de</strong> ce panneau :<br />
c’est I’écoinçon <strong>de</strong> Jupiter et <strong>de</strong> l’Amour dans la loggia <strong>de</strong> Psyché à la Farnésine.<br />
L‘invention du <strong>de</strong>ssin revient à Raphacl, mais la scène a été exécutée par Jules<br />
26. E Gebelin, up. cit.. p. 182 : C. Ribotilleau, Le Chcitecru ..., O J ~ . cit., p. 1.54.<br />
27. Ovi<strong>de</strong>, MPtrr,ttorp/zo.ses. X. S 16, id. Jcan-Pierre Nérautlau et Gcorgen Lafaye. Paris, Gallimard,<br />
1996. p. 339.<br />
28. E Gebelin, op. cif., p. I82 C. Ribotilleau. Vi//er.v Cortc,r?ts .... O ~ J cit., . p. 96.<br />
29. Ovi<strong>de</strong>, op. cit., I, 668-721, p. 63-68.<br />
30. C. Ribotilleau. Le CliRfetrii ..., (J/J. cit., p. ISS.<br />
3 I. E Gebelin. op. cit.. p. 182.
Romain entre 15 17 et 15 19. Puis, elle a été gravée par Marcantonio Rainiondi, ce<br />
qui explique sa diffusion ’l. 11 s’agit d’une illustration <strong>de</strong> l’action centrale <strong>de</strong> cet<br />
épi\o<strong>de</strong> <strong>de</strong> la fable <strong>de</strong> Psyché racontée par Apulée dans son Arie d’or : ><br />
Enfin, le <strong>de</strong>rnier caisson représente le défi musical lancé à Apollon par<br />
Marsyas ”. Le satyre jouant <strong>de</strong> la flûte figure à gauche assis, tandis qu’a droite,<br />
le dieu se tient <strong>de</strong>bout avec, à ses pieds, sa lyre. Christiane Riboulleau a trouvé le<br />
modèle qui a influencé cette scène : il s’agit d’un inédaillon attribué à Giovanni<br />
Bernard¡, dont un exemplaire est aujourd’hui conservé à Washington ’s.<br />
Reste maintenant à interpréter l’ensemble <strong>de</strong> ces caissons, ce qui n’est pas<br />
une t8che facile. Après que Franqois Gebelin eut essayé en vain <strong>de</strong> voir en eux<br />
<strong>de</strong>s illustrations du Sorige du Poliphile, Jean-Pierre Babelon a renoncé à trouver<br />
le thème unique sous-jacent a ce décor : >, a-t-il écrit en 1990 I‘. L‘année sui-<br />
vante, Christiane Riboulleau a pourtant tenté une explication : >. L‘analyse reste pru-<br />
<strong>de</strong>nte, niais la proposition est pertinente :
178 Eric Tliierv<br />
cha dans la théorie <strong>de</strong> l’amour du Banquet une préfiguration du pur amour chrétien<br />
’g. Essayons donc d’examiner les caissons cotteréziens à la lumière <strong>de</strong> l’enseignement<br />
<strong>de</strong> ce mouvement philosophique. Peut-être pourrons-nous ainsi saisir<br />
le message que leur commanditaire a voulu leur faire délivrer.<br />
Un texte <strong>de</strong> Pic <strong>de</strong> La Mirandole semble parfaitement adapté au caisson<br />
représentant le défi musical lancé par Marsyas àApollon. I1 s’agit d’une lettre <strong>de</strong><br />
1485 dirigée contre les complaisances littéraires en philosophie : ><br />
Comme Alcibia<strong>de</strong> dans le Bcrnquet <strong>de</strong> Platon ’‘I, Pic <strong>de</strong> La Mirandole a<br />
compris que les apparences ne sont rien et que seule importe la splen<strong>de</strong>ur du vrai,<br />
même exprimée sans grâce et inaccessible à la foule. Aussi appelle-t-il son correspondant<br />
à s’arracher aux attachements terrestres et à s’élever pour contempler<br />
l’harmonie <strong>de</strong> Dieu. Tel est le sens <strong>de</strong> la fable <strong>de</strong> Marsyas : la victoire d’Apollon<br />
est celle <strong>de</strong> la lyre, instrument divin qui transporte les âmes vers le ciel, sur la<br />
flûte qui excite les passions impures ‘l.<br />
On peut donc voir, dans le caisson cotterézien, I’élévation <strong>de</strong> l’âme vers<br />
Dieu grâce à la musique divine. Elle s’oppose à son abaissement par la concupiscence.<br />
Or, n’est-ce pas ce que représente le panneau où figurent la nymphe et<br />
le satyre ? Celui-ci symbolise le désir sexuel effréné que n’ont pas manqué <strong>de</strong><br />
condamner les néo-platoniciens. Dans Lu Ruelle rnd ussortie <strong>de</strong> Marguerite <strong>de</strong><br />
Valois, par exemple, est mise en scène une jeune femme qui essaye <strong>de</strong> modérer<br />
son amant très emporté. Se comparant aux belettes et aux colombes, elle lui dit :<br />
[...I je prens plaisir comme elles 5 faire l’amour du bec D. Lui lui répond : > Mais c’est finalement la jeune femme qui<br />
a le <strong>de</strong>rnier mot :
science ; mais ouy bien <strong>de</strong>s fausses voluptés, parce qu’elles proce<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s sens<br />
exlerieurs ‘I. >><br />
Le <strong>de</strong>uxième caisson <strong>de</strong> la volée qui va du premier étage à un entresol,<br />
quant à lui, représente Jupiter embrassant l’Amour. Pour le comprendre, il faut<br />
rappeler ce qu’est la théorie ><br />
A Villers-Cotterêts, on est finalement bien loin <strong>de</strong> la scène <strong>de</strong> pédérastie<br />
que James Saslow a cru voir dans le mod<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssiné par Raphad à la Farnésine 44.<br />
Le baiser sur la bouche s’inscrit en fait dans la tradition chrétienne, comme le rap-<br />
pellent la citation du Cmtique <strong>de</strong>s Caritiques donnée par Le Livre du courtisan ”,<br />
mais aussi Guillaume <strong>de</strong> Saint-Thierry et saint Bemard, pour qui le Saint-Esprit<br />
est
I80 Eric Tliirrr;)<br />
satiété et <strong>de</strong> l’ennui, mais ils haïssent la personne aimée, comme si l’appétit se<br />
repentait <strong>de</strong> sa faute [...I ; ou bien ils conservent le même désir et la même<br />
convoitise, comme ceux qui ne sont pas vraiment parvenus à la fin qu’ils cher-<br />
chaient ; et bien que sous l’effet <strong>de</strong> l’aveugle opinion qui les a enivrés, il leur<br />
semble qu’à ce moment ils sentent du plaisir, [. . .] ils ne sont néanmoins ni satis-<br />
faits ni apaisés 47. >><br />
Là aussi, on peut opposer entre eux <strong>de</strong>ux caissons situés chacun au-<strong>de</strong>ssus<br />
d’une volée différente <strong>de</strong> l’escalier sud-est. II s’agit du Jupiter embrassant<br />
l’Amour et <strong>de</strong> la Vénus chassant son fils. Alors que le premier représente l’union<br />
<strong>de</strong> l’âme à Dieu, le <strong>de</strong>uxième illustre la désunion <strong>de</strong>s corps. Ainsi, l’amour rai-<br />
sonnable s’oppose à l’amour sensuel.<br />
Interprétons maintenant Mercure, ainsi qu’Hercule terrassant le lion <strong>de</strong><br />
Némée. Le premier est le dieu <strong>de</strong> I’doqucnce, un dieu dont Erasme a vanté la<br />
force <strong>de</strong> la parole dans I’(< Exhortation au pieux lecteur D placée en tête <strong>de</strong> son<br />
Nouveau Testciment : a Si jamais pareille force <strong>de</strong> la parole échut à quelqu’un, les<br />
fables <strong>de</strong>s anciens poètes ont souligné non sans raison que ce fut bien à Mercure,<br />
qui en usait comme d’une baguette magique ou d’une cithare divine pour envoyer<br />
à son gré le sommeil ou le retirer, expédiant aux Enfers, ramenant <strong>de</strong>s Enfers qui<br />
bon lui semblait ‘8. >><br />
D’oÙ vient la force <strong>de</strong> la parole ? Les humanistes <strong>de</strong> la Renaissance ont<br />
trouvé la réponse chez Cicéron, celui-ci écrivant dans son Traité <strong>de</strong> 1’orLiteur que<br />
(< sans la philosophie on ne saurait parvenirà I’éloquence que nous cherchons Ir) >>.<br />
Mercure représente la puissance <strong>de</strong> la parole, mais aussi celle <strong>de</strong> la sagesse qui,<br />
bien évi<strong>de</strong>mment, s’oppose à la puissance physique, illustrée par Hercule terrassant<br />
le lion <strong>de</strong> Némée.<br />
Ainsi, c’est le contlit entre le corps et l’esprit qui est le thème du décor <strong>de</strong><br />
l’escalier sud-est : la volée la plus sombre illustre tout ce qui abaisse l’âme et la<br />
plus lumineuse - jusqu’à l’obstruction au XVIIIL siècle d’une fenetre à meneau<br />
- montre tout ce qui l’élève ’I. On a ici le développement d’un sujet hérité <strong>de</strong><br />
Platon, et revisité par saint Paul ”, qui connaît une gran<strong>de</strong> vogue au début du<br />
XVI‘ siècle. Celle-ci est illustrée non seulement par 1’Eloge <strong>de</strong> la folie d’Emme,<br />
mais aussi par le Discord estcirit en 1 ‘homme pcir la contrciriété <strong>de</strong> 1 ’Esprit et <strong>de</strong><br />
la Chair <strong>de</strong> Marguerite <strong>de</strong> Navarre ‘l.<br />
47. B. Castiglione, op. cit., IV, 52, p. 3x1 382.<br />
48. Erasme. Eloge clc lo ,fidie. Atltr,yr.s. Collorps. R(~fIuiori\ siir l‘art. l’édiicdrirr, Itr rrligion, In<br />
?lierre, /rl /J/!i/lMJphie. Corr~rporit/nrrc.e. ed. Clau<strong>de</strong> Blum, André Godin. JeamClau<strong>de</strong> Margolin et<br />
Daniel Ménager, Paris. Robert Lallimt, 1992. p. 594.<br />
49. Cicéron, Tririté <strong>de</strong> /’ormirr, II. 14. éd. Abbé Colin. Pari\. Augwte Delalain. 1809, p. 133.<br />
50. c. Riboulleau. Lr Ch2tenir .... op. cit., p. 140.<br />
5 I. Voir A. Chastel. Morsile Fic,irr et l’Art, Genève, Droi. 1996. p. 91 -95 : G L‘Universelle VoluptC<br />
el In lumière D.<br />
S2. Epître mix Rorrirrir7.s. 7. 14-75.<br />
53. Erame. op. cit.. LXVI, p. 95-98 : Le.\ Mtrqiwriie\ <strong>de</strong> Irr M[rr;yrreritr (les Prirrcrsses. éd. Franck,<br />
t. 1. Paris, 1873. p. 69-76.
Une anomalie reste cependant à expliquer. Pourquoi l’Hercule terrassant le<br />
lion <strong>de</strong> Némée porte-t-il une barbe à Villers-Cotterêts, alors qu’il est imberbe sur<br />
la plaquette en bronze <strong>de</strong> Mo<strong>de</strong>rno ayant servi <strong>de</strong> modèle ? L‘artiste qui a travaillé<br />
sur cette partie <strong>de</strong> la voûte <strong>de</strong> l’escalier sud-est a sans doute voulu y représenter<br />
Franqois ILr.<br />
Celui-ci a souvent ét6 i<strong>de</strong>ntifié à Hercule pendant son règne. Ainsi<br />
> est à l’honneur lors <strong>de</strong>s entrées royales <strong>de</strong> Lyon en juillet<br />
15 15 et <strong>de</strong> Rouen en juillet 15 I7 ou mCme dans le décor historié <strong>de</strong> la faça<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
Loges du chliteau <strong>de</strong> Blois qui raconte une partie <strong>de</strong>s Trcivaux ”.<br />
Le vainqueur <strong>de</strong> Marignan étant aussi souvent assimilé à Mercure pour ses<br />
talents d’orateur ”, on peut se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r s’il n’a pas été également représenté sous<br />
cette forme à Villers-Cotterêts sur le caisson malheureusement mutilé. On aurait<br />
ainsi, sur la voûte <strong>de</strong> l’escalier sud-est, une illustration du mythe <strong>de</strong>
182 Eric Tlzierry<br />
sons finement sculptés <strong>de</strong> “l’escalier du Roi”) nous confirment dans cette opinion<br />
quand on nous dit que c’étaient les moins impudiques ”. >><br />
Qui sont les > évoqués ? I1 s’agit en fait d’Ernest Roch qui<br />
a écrit en 1909 : ><br />
Le premier secrétaire <strong>de</strong> la Société historique cotterézienne, quant à lui,<br />
s’inspirait <strong>de</strong> ce passage <strong>de</strong> l’Histoire <strong>de</strong> Villers-Cotterêts d’Alexandre Michaux<br />
publiée en 1867 :<br />
L ‘iiwgirruirc. <strong>de</strong>s historieris locrrux : le chûteair <strong>de</strong> Villeus-Cottei3t.v 183<br />
><br />
Ce que Henri Sauval a décrit ici, ce sont surtout <strong>de</strong>s œuvres érotiques ras-<br />
semblées par Frangois I” au chdteau <strong>de</strong> Fontainebleau pendant les années 1530 et<br />
1540 et encore visibles sur place au début du règne <strong>de</strong> Louis XIV. Certaines<br />
étaient <strong>de</strong>s comman<strong>de</strong>s du vainqueur <strong>de</strong> Marignan, comme les Vénus et Diane<br />
nues peintes par Le Primatice pour les Appartements <strong>de</strong>s bains et les amours <strong>de</strong>s<br />
dieux représentées par Le Primatice et par Rosso pour les tableaux ovales déli-<br />
mitant les centres <strong>de</strong>s quatre murs <strong>de</strong> la Galerie François I . Mais d’autres avaient<br />
été achetées par ce souverain ou lui avaient été of‘íertes, comme l’illligorie <strong>de</strong><br />
61. Henri Sauval, Galanteries <strong>de</strong>s Roi.s <strong>de</strong> Frunce. L. II, Paris, Ch. Moette, 1738, p. 234-236. II s’agit<br />
d’un appendice <strong>de</strong>s Hi.stoirc~s et reí~herchc~s <strong>de</strong>.v aniiyriiib <strong>de</strong> lo ville <strong>de</strong> Paris du même auteur<br />
publiées pour la première fois en 1724. Le passage cité s’y trouve i la page 17 du troisième tome.
I84 Eric Tliirrty<br />
Vktuts <strong>de</strong> Bronzino, la L& <strong>de</strong> Rosso ou les V~/ZLIS et Cupiclon <strong>de</strong> Girolamo da<br />
Carpi 62.<br />
François I appréciait beaucoup les représentations <strong>de</strong> nus, essentiellement<br />
féminins, comme en témoigne cette lettre écrite en 1519 par le marquis <strong>de</strong><br />
Mantoue pour accompagner un ca<strong>de</strong>au, la Ve‘nus 2 lu corile d’abondutice <strong>de</strong><br />
Costa : ><br />
Le roi aimait les nus parce qu’il était un grand amateur <strong>de</strong> femmes, mais<br />
aussi parce qu’il était un prince <strong>de</strong> la Renaissance protecteur <strong>de</strong>s humanistes<br />
Alors, l’humanisme mettait en valeur l’homme, sa dignité, son intelligence et ses<br />
capacités créatrices. Beaucoup s’écriaient, à la suite <strong>de</strong> Pic <strong>de</strong> La Mirandole :<br />
)<br />
Aussi le nu apparaissait-il comme l’exaltation <strong>de</strong> la puissance souveraine du<br />
corps, comme un hymne à la vie et à la force.<br />
Cette vision optimiste ne dura pas car, dès 1563, lors <strong>de</strong> sa XXV‘ session,<br />
le concile <strong>de</strong> Trente déclara : C Désormais toute superstition doit être bannie, dans<br />
l’invocation <strong>de</strong>s saints, la vénération <strong>de</strong>s reliques, l’usage sacré <strong>de</strong>s effigies ; que<br />
tout ce qui est jugé honteux soit éliminé, que toute indécence enfin soit fuie, afin<br />
que les effigies ne soient plus peintes ni décorées avec un charme insolent ‘h. )><br />
L‘indécence <strong>de</strong>s ceuvres d’art, assimilée par les catholiques à l’esprit luthérien<br />
Cotterêts >>, mais l’ouvrage donné en référence, les Norrs .siir 1 ’Itulie <strong>de</strong> Fonvielle,<br />
est introuvable dans les plus gran<strong>de</strong>s bibliothèques h8. Quant au rapport du 5 brumaire<br />
an II également cité par cet historien local. rapport selon lequel le caisson<br />
représentant le satyre et la nymphe n’a pas été supprimé >, je ne l’ai pas non plus retrouvé, malgré <strong>de</strong>s recherches dans les<br />
archives communales <strong>de</strong> Villers-CotterCts et dans la série L <strong>de</strong>s archives départementales<br />
<strong>de</strong> l’Aisne.<br />
Je crois néanmoins qu’Ernest Roch ne l’a pas inventé et qu’il l’a eu réellement<br />
entre les mains car <strong>de</strong>ux autres documents écrits une dizaine <strong>de</strong> jours plus<br />
tcit l’éclairent. I1 s’agit d’une correspondance échangée entre le conseil général <strong>de</strong><br />
la commune <strong>de</strong> Villers-Cotterêts et celui du district <strong>de</strong> Soissons en vendémiaire<br />
an II.<br />
Le 24, c’est-à-dire le 15 octobre 1793. le premier écrivit au second :<br />
. I1 est donc possible<br />
que quelques sculptures aient eu à souffrir du marteau <strong>de</strong> l’inspecteur, mais les<br />
dégiits sont vraisemblablement <strong>de</strong>meurés mo<strong>de</strong>stes. Faute d’argent, les autorités<br />
<strong>de</strong> Villers-Cotterêts et <strong>de</strong> Soissons ont dû vite renoncer à un vandalisme systématique.<br />
Les efforts nécessités par la guerre menée contre la Première Coalition<br />
ont finalement permis la sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s F, <strong>de</strong>s couronnes. <strong>de</strong>s fleurs <strong>de</strong> lys et <strong>de</strong>s<br />
quelques nudités héritées <strong>de</strong> la Renaissance.<br />
68. E. Roch, (irt. cit.. p. 154, note 4.<br />
69. Ibid., p. 155.<br />
70. Arch. dép. Aisne, L 1886, fol. 13-V.
I86 Eric Tliitrry<br />
Malgré leur enthousiasme, les historiens cotteréziens qui ont écrit sur le<br />
chliteau <strong>de</strong> Villers-Cotterêts n’ont pas su échapper à l’anachronisme. Ne s’effor-<br />
gant pas <strong>de</strong> replacer les sculptures dans leur contexte, ils ne les ont pas regardées<br />
avec les yeux <strong>de</strong> Franqois I r et <strong>de</strong> Henri II, mais avec les leurs, ceux <strong>de</strong> notables<br />
provinciaux <strong>de</strong>s XIXeet XX“ siècles. Quel dommage qu’ils n’aient pas lu avec<br />
plus d’attention Alexandre Dumas ! En critiquant l’abbé Chollet, celui-ci leur<br />
avait donné la métho<strong>de</strong> à suivre pour comprendre ce qui les scandalisait :<br />
I-<br />
r r i<br />
. --<br />
L’imaginaire <strong>de</strong>s historiens locaux : le château <strong>de</strong> Villers-Cotter&ts 187<br />
Fig. 1 : EmbKmatique d‘Henri II et <strong>de</strong> Catherine <strong>de</strong> Médicis<br />
ornant la face occi<strong>de</strong>ntale du pavillon <strong>de</strong> l’auditoire (Cl. E. Thierry)<br />
..<br />
Fig. 2 : Embl&natique d‘Henri U ornant la faça<strong>de</strong> du pavillon <strong>de</strong> I’auditoin? (Cl. E. Thieny)
188 Eric Thierry<br />
Fig. 3 : Hercule terrassant le lion <strong>de</strong> Némk. Caisson <strong>de</strong> l'escalier sud-est (Cl. E. Thierry)<br />
~ ~~ ~~ ~~~~~~~<br />
Fig. 4 : Mercure. Caisson <strong>de</strong> l'escalier sud-est (Cl. E. Thierry)
L’imaginaire <strong>de</strong>s historiens locaux : le château <strong>de</strong> Villers-Cotterêts 189<br />
Fig. 5 : Jupiter skduisant Antiope sous la forme d‘un satyre. Caisson <strong>de</strong> l’escalier sud-est (CI. E. Thierry)<br />
Fig. 6 : Le ddfi musical land par Marsyas ?I Apollon. Caisson <strong>de</strong> l’escalier sud-est (CL E. Thierry)
190 Eric Thierry<br />
I<br />
Fig. 7 : Vtnus chassant l’Amour. Caisson <strong>de</strong> l’escalier sud-est (CI. E. Thierry)<br />
Fig. 8 : Jupiter embrassant l’Amour. Caisson <strong>de</strong> l’escalier sud-est (CI. E. Thierry)
congrès <strong>de</strong> la Fédération <strong>de</strong>s sociétés d’histoire<br />
et d’archéologie <strong>de</strong> l’Aisne<br />
Soissons<br />
II revenait à la Société archéologique, historique et scientifique <strong>de</strong> Soissons d’or-<br />
ganiser le XLIII‘ congrès <strong>de</strong> la Fédération <strong>de</strong>s sociétés d’histoire et d’archéologie<br />
<strong>de</strong> l’Aisne. En début d’année, le bureau fédéral avait décidé <strong>de</strong> rebaptiser cette<br />
manifestation qui <strong>de</strong>vient désormais (< Journée <strong>de</strong> la Fédération <strong>de</strong>s sociétés his-<br />
torique <strong>de</strong> l’Aisne D. I1 avait aussi formulé le v eu d’en relancer l’audience.<br />
Pour atteindre ce but, la Société historique <strong>de</strong> Soissons avait choisi un thème sus-<br />
ceptible d’attirer un large public,
FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE<br />
ET D’ARCHÉOLOGIE DE L’AISNE<br />
Archives départementales <strong>de</strong> l’Aisne<br />
28, rue Fernand-Christ - 02000 Laon<br />
Bureau <strong>de</strong> la Fédération pour l’année 2000<br />
Prési<strong>de</strong>nts d’honneur ................ Pierrette BEGUE<br />
................................................... Alain BRUNET<br />
................................................... Henry <strong>de</strong> BUTTET<br />
Prési<strong>de</strong>nt ................................... Roger ALLEGRET<br />
Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Société historique régionale<br />
<strong>de</strong> Villers-Cotterets<br />
Vice-prési<strong>de</strong>nt ........................... René GERARD<br />
Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Société académique<br />
<strong>de</strong> Chauny<br />
Autres membres :<br />
Tony LEGENDRE, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Société historique et archéologique <strong>de</strong><br />
Chriteau-Thierry<br />
Clau<strong>de</strong> CAREME, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Société historique <strong>de</strong> Haute-Picardie<br />
André TRIOU, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Société académique <strong>de</strong> Saint-Quentin<br />
Denis ROLLAND, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Société historique, archéologique et scienti-<br />
fique <strong>de</strong> Soissons<br />
Frédéric STEVENOT, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Société historique et archéologique <strong>de</strong><br />
Vervins et <strong>de</strong> la Thiérache<br />
Secrétaire général :<br />
Frédérique PILLEBOUE, directeur <strong>de</strong>s Archives départementales <strong>de</strong> l’Aisne<br />
Trésorier :<br />
Robert LEFEBURE, secrétaire <strong>de</strong> la Société historique régionale <strong>de</strong> Villers-<br />
Cotterêts<br />
Comité <strong>de</strong> lecture :<br />
Suzanne Fiette, Marc Le Pape, Maurice Per<strong>de</strong>reau, Frédérique Pilleboue, Martine<br />
Plouvier, Éric Thierry, Emmanuel Véziat, Bernard Vinot<br />
Comité technique d’édition : Fabienne Bliaux, Sabine Delaunay, Marc Le Pape,<br />
Frédéric Stévenot (coordinateur), Éric Thierry, Emmanuel Véziat, Claudine Vidal<br />
Les publications <strong>de</strong> la Fédération sont subvcntionnkes par le Conseil général <strong>de</strong><br />
l’Aisne et le ministgre <strong>de</strong> la Culture (direction régionale <strong>de</strong>s Affaires culturelles<br />
<strong>de</strong> Picardie)<br />
I93
SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE<br />
DE CHÂTEAU-THIERRY<br />
Bureau <strong>de</strong> la Société en 2000<br />
Prési<strong>de</strong>nte d’honneur ................. Mlle Colette PRIEUR<br />
Prési<strong>de</strong>nt .................................... M. Tony LEGENDRE<br />
Vice-prési<strong>de</strong>nts .......................... M. Robert LEROUX<br />
................................................... M. Xavier <strong>de</strong> MASSARY<br />
Secrétaire ................................... M. Raymond PLANSON<br />
Secrétaire adjoint .......................<br />
.\<br />
Trésoriere ...................................<br />
M. Georges ROBINETTE<br />
Mme Berna<strong>de</strong>tte MOYAT<br />
Trisorier adjoint ......................... M. Roger LALOYAUX<br />
Conservateur <strong>de</strong>s collections ........ M. François BLARY<br />
BibliothCcaire ............................. Mlle Florence COULOMBS<br />
Mcinbres .................................... Mme Catherine DELVAILLE<br />
Mme Anne-Marie HIGEL<br />
Mme Thérèse PICHARD<br />
Membres décédés en 1999<br />
Mlle Lucienne BRAYER, Mine Jacqueline DUBOURG, Mme Ma<strong>de</strong>leine<br />
PORET.<br />
Membres entrés a la Société en 1999<br />
Mine Nicole BLONDEL, Mme Christiane FAYET, M. et Mine Frédéric HERI-<br />
COURT, M. Jacques KRABAL, M. Jean-Luc LIEZ, Mine Sinione TEVISSEN<br />
Activités <strong>de</strong> l’année 1999<br />
6 FÉVRIER : Assemblée générale annuelle.<br />
Les chripiteaux sculptés <strong>de</strong>s &lises cle I’Orxoìs au XIP sì2cle, par Xavier <strong>de</strong><br />
Massary.<br />
L‘Orxois est un ancien paps aux contours mal définis, correspondant grossière-<br />
nient au cours moyen <strong>de</strong> l’Ourcq. Ce pays connut, du milieu du XI‘ siècle à la fin<br />
du siècle suivant, une étonnante floraison artistique qui s’est traduite en particu-<br />
lier dans la sculpture <strong>de</strong>s chapiteaux. L‘église <strong>de</strong> La-Croix-sur-Ourcq en est sans<br />
doute le témoin le plus ancien, en tout cas le plus naïf dans son expression artis-<br />
tique <strong>de</strong>s chapiteaux. Bien plus affirmé apparaît l’art <strong>de</strong>s sculpteurs <strong>de</strong> I’église<br />
I YS
196<br />
d’Oulchy-le-Château. Dans les années 1 150 à 1 180, un ensemble d’édifices pré-<br />
sente <strong>de</strong>s chapiteaux dont la forte originalité permet <strong>de</strong> les attribuer à un même<br />
atelier <strong>de</strong> sculpteurs : Bussiares, Hautevesnes, Marigny-en-Orxois, Veuilly-la-<br />
Poterie, Marizy-Saint-Mard. Beaucoup reste à faire pour i<strong>de</strong>ntifier les différents<br />
ateliers <strong>de</strong> sculpteurs qui ont montré en Orxois une si gran<strong>de</strong> inventivité.<br />
6 MARS ; Entre pouvoir et méinoìre : une histoire cles archives, par Frédérique<br />
Pilleboue, directrice <strong>de</strong>s archives départementales <strong>de</strong> l’Aisne.<br />
10 AVRIL : Gland, nion villuge, par Bernard Sonnette.<br />
Ce village <strong>de</strong> la vallée <strong>de</strong> la Marne porta les noms <strong>de</strong> Glandiacum, Glandiacus,<br />
Glana en 12 18, Glans en 1573, enfin Gland <strong>de</strong>puis le XVII‘ siècle. Gland subit<br />
les gran<strong>de</strong>s invasions. La guerre <strong>de</strong> 19 14- 19 I8 en est le plus récent exemple. Le<br />
village est détruit à 67 %. Son chiteau, ancienne britisse fortifiée, sera démoli.<br />
Son église du début du XII1 siècle, flanquée d’un seul collatéral du XV siècle,<br />
au sud, ne sera plus que ruines et sera rasée. Le maître-autel du XV siècle, une<br />
plaque tombale et les trois cloches <strong>de</strong> l’ancienne église, miraculeusement épar-<br />
gnés, auront leur place dans le nouvel édifice inauguré en 193 I . Gland possè<strong>de</strong><br />
un terroir <strong>de</strong> 569 hectares dont 158, au nord <strong>de</strong> la route départementale, sont clas-<br />
sés
La seule cuisine comparable pour le XIV‘ siècle est celle du château <strong>de</strong><br />
Montreuil-Bellay, dans le Maine-et-Loire, mais la surface <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière<br />
n’atteint que 8 I m’, contre 690 m’ à Chiteau-Thierry. Les cuisines <strong>de</strong> notre ville<br />
comportaient une saucerie où l’on pouvait préparer 15 plats en même temps.<br />
L‘eau était fournie par un puits <strong>de</strong> 3,50 mètres <strong>de</strong> diamètre et 54 mètres <strong>de</strong> pro-<br />
fon<strong>de</strong>ur. Une véritable batterie <strong>de</strong> cuisine a été retrouvée : céramiques, réci-<br />
pients d’une contenance <strong>de</strong> 1 à 10 litres, vaisselle métallique assez rare, comme<br />
les chaudrons et les plats. Le service <strong>de</strong> la table prenait place au sud, dans la<br />
rési<strong>de</strong>nce seigneuriale dite galerie <strong>de</strong>s Princes. Les déchets alimentaires retrou-<br />
vés nous renseignent sur le mo<strong>de</strong> d’alimentation <strong>de</strong>s châtelains et <strong>de</strong> leur cour<br />
à la fin du Moyen Age.<br />
2 OCTOBRE : L’eilfLiizce cle Jean Rucine, par François Valadon.<br />
L‘enfance <strong>de</strong> Racine est mal connue. La date exacte et la maison <strong>de</strong> sa naissance<br />
sont une énigme. II a été baptisé le 22 décembre 1639 par Nicolas Colletet, curé<br />
<strong>de</strong> l’église Notre-Dame <strong>de</strong> La Ferté-Milon. Sa petite enfance est marquée par <strong>de</strong>s<br />
drames familiaux. I1 a un peu plus d’un an lorsqu’il perd sa mère, quelques jours<br />
après la naissance <strong>de</strong> sa sœur Marie. Deux ans plus tard, son père, Jehan Racine,<br />
décè<strong>de</strong> également. Les <strong>de</strong>ux orphelins sont séparés et confiés, Marie aux grands-<br />
parents maternels Sconin, Jean aux grands-parents paternels. Les grands-pères,<br />
tous <strong>de</strong>ux fonctionnaires au grenier à sel, ont entre eux <strong>de</strong>s relations <strong>de</strong> supérieur<br />
à subordonné. A cette atmosphère tendue s’ajoutent les troubles politiques. En<br />
1649, meurt le grand-père Racine. Marie Desmoulins reste seule avec son petit-<br />
fils. Elle quittera La Ferté-Milon avec lui en 1651 ou 1652 pour se réfugier à<br />
Port-Royal-<strong>de</strong>s-Champs. I1 y suivra le soli<strong>de</strong> enseignement <strong>de</strong>s
198<br />
4 DkCEMßRE : L’antiquite‘ <strong>de</strong>s nolm <strong>de</strong>s villciges <strong>de</strong> la région <strong>de</strong> Chciteau-Thierry,<br />
par Jean-Clau<strong>de</strong> Malsy.<br />
L‘historien <strong>de</strong>s noms <strong>de</strong> lieux ne peut avancer dans la connaissance du plus<br />
ancien patrimoine qu’en se référant aux documents écrits. La région <strong>de</strong> Château-<br />
Thierry se distingue par un important vi<strong>de</strong> documentaire. Entre l’Ourcq et le Petit<br />
Morin, seuls 18 noms <strong>de</strong> lieux sont mentionnés avant l’an mil. Ainsi la Marne,<br />
Matrona, est le plus ancien. Sur <strong>de</strong>s pièces <strong>de</strong> monnaie, on trouve Chariliaco et<br />
Cariliaco pour Charly, Odomo pour Odomagus, nom antique <strong>de</strong> Chiteau-Thierry.<br />
Deux axes <strong>de</strong> communication ont forgé l’histoire régionale : la Marne et la route<br />
antique Soissons-Troyes. On peut distinguer les noms d’origine toponymique<br />
comme Condé (confluent) Nanteuil (narzt = vallée), Baulne (terre humi<strong>de</strong>) ; les<br />
noms suffixes à finale (< y >> : Marigny, Lucy.. . ; les noms d’origine religieuse :<br />
Saint-Eugène, Mont-Saint-Père.. . ; le règne végétal : L‘Epine-aux-Bois ; I’habi-<br />
tat : Viels-Maisons. Seules les formes anciennes et les analyses comparatives per-<br />
mettent <strong>de</strong> saisir la signification <strong>de</strong>s noms <strong>de</strong>s villes et villages.
SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE D’HISTOIRE,<br />
D’ARCHÉOLOGIE, DES ARTS ET DES LETTRES<br />
DE CHAUNY ET DE SA RÉGION<br />
Bureau <strong>de</strong> la Société en 2000<br />
Prési<strong>de</strong>nt .................................... M. R. GERARD<br />
Vice-prési<strong>de</strong>nt ............................ M. J. SENECHAL<br />
Vice-prési<strong>de</strong>nte .......................... Mme M.-F. WATTIAUX<br />
Secrétaire ................................... Mme H. TONDEUR<br />
Secrétaire adjoint suppléant ....... M. J.-L. MOUTON<br />
Trésorière ................................... Mme J. FRENOT<br />
Trésorier adjoint ......................... M. C. SBARDELLA<br />
Bibliothécaire archiviste ............ poste vacant en l’absence <strong>de</strong> la titulaire,<br />
Mine MESSIAS<br />
Activités <strong>de</strong> l’année 1999<br />
JANVIER : M. Langkt propose une causerie sur Le trciiri eritre eri (irt. A sa suite,<br />
nous faisons un voyage en images entre le XIX et le XX siècles, avec <strong>de</strong>s<br />
peintres tels que William Turner, Daumier, Clau<strong>de</strong> Monet et G ses gares >> et<br />
d’autres impressionnistes. II nous présente les chemins <strong>de</strong> fer américains avec<br />
Edward Hopper, les affichistes français, pour terminer par les surréalistes,<br />
Magritte, etc.<br />
Cette très intéressante causerie sur les peintres et leurs euvres est accompagnée<br />
d’une projection <strong>de</strong> diapositives.<br />
FÉVRIER : Mine Petitbon relate Les croyiiices, /murs, coutiirnes, trcrtlitiom, f;te.s<br />
popilaires <strong>de</strong> notre pays. Cet exposé a permis aux spectateurs <strong>de</strong> se replonger<br />
dans les coutumes et traditions qui viennent <strong>de</strong> nos ancêtres et se per<strong>de</strong>nt peu à<br />
peu. C’est le cas, entre autres, avec : les bûches <strong>de</strong> Noël - le gui - le buis - les<br />
eufs <strong>de</strong> Piìques - les feux <strong>de</strong> la Saint-Jean - la naissance, le mariage - les funérailles<br />
- les calvaires - le repas funéraire - les civilités villageoises.<br />
9 MARS : Réunion du conseil d’administration en vue <strong>de</strong> la préparation <strong>de</strong> l’as-<br />
semblée générale du 19 mars et étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la suite du programme 1999.<br />
19 MARS : Assemblée générale ouverte par le prési<strong>de</strong>nt, M. Gérard. Pour fêter les<br />
25 ans <strong>de</strong> notre Société académique, M. Gérard donne une rétrospective <strong>de</strong>s acti-<br />
vités <strong>de</strong> notre société durant ces années et particulièrement durant les 20 années<br />
199
200<br />
<strong>de</strong> sa prési<strong>de</strong>nce que nous fêtons également cette année. Une rétro-projection <strong>de</strong><br />
documents accompagne cette causerie.<br />
L‘Assemblée générale se déroule avec les rapports d’activité et financier acceptés<br />
à l’unanimité <strong>de</strong>s présents, le quorum ayant été atteint. Elle est suivie d’une<br />
réunion du Conseil d’administration en vue <strong>de</strong> former le bureau pour 1999 , qui<br />
se compose comme suit :<br />
Prési<strong>de</strong>nt .................................... M. R. GERARD<br />
Vice-prési<strong>de</strong>nt ............................ M. J. SENECHAL<br />
Vice-prési<strong>de</strong>nte .......................... Mme M.-E WATTIAUX<br />
Secrétaire ................................... Mme H. TONDEUR<br />
Secrétaire adjoint ....................... Mme PETITBON<br />
Trésorière ................................... Mme J. FRENOT<br />
Trésorier adjoint ......................... M. C. SBARDELLA<br />
Bibliothécaire archiviste ............ Mme MESSIAS<br />
Membres .................................... Mines MARQUETTE, PELLETIER,<br />
MM. GORSKI, PUGIN et VINOT<br />
AVRIL : M. Bonnard, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’association Prométhée à Chiry-Ourscamps,<br />
donne une causerie sur L’íispect <strong>de</strong> la recoiz.struc.tioii <strong>de</strong> Noyon, illustrée <strong>de</strong> diapositives.<br />
Le 14 mars 1919, I’État impose le premier plan urbain à toutes les villes<br />
<strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 1 O00 habitants, les obligeant à créer un plan d’aménagement, d’embellissement<br />
et d’extension et donc iì choisir entre une ville mo<strong>de</strong>rne et la conservation<br />
<strong>de</strong>s vestiges, tout en gommant les défectuosités <strong>de</strong> la guerre <strong>de</strong> 14-18.<br />
C’est la <strong>de</strong>uxième hypothèse qui a été retenue à Noyon, mais était-elle bonne ?<br />
C’est ce que M. Bonnard a réussi à démontrer avec brio.<br />
MAI : M. Andrieu traite <strong>de</strong> I ’analyse trciiz.sac‘tioniielle, causerie accompagnée<br />
d’une projection <strong>de</strong> documents. Cette théorie psychologique globale <strong>de</strong> la per-<br />
sonnalité et <strong>de</strong>s relations a été élaborée par le Dr Eric Berne aux Etats-Unis dans<br />
les années 50. Théorie accessible, le langage <strong>de</strong> l’analyse transactionnelle est<br />
compréhensible, afin <strong>de</strong> donner à chacun une suffisante autonomie d’analyse<br />
dans le maniement <strong>de</strong> l’outil pour ne pas avoir recours i?¡ un spécialiste. Elle cla-<br />
rifie et améliore les relations individuelles et <strong>de</strong> groupes en permettant <strong>de</strong><br />
résoudre les problèmes <strong>de</strong> comportement, mais ne prétend pas être une panacée.<br />
JUIN : Voyage <strong>de</strong> la Société en Champagne avec visite du château <strong>de</strong> Condé-en-<br />
Brie, <strong>de</strong>s caves Mercier et d’une chocolaterie artisanale tout en parcourant les<br />
coteaux champenois.<br />
SEPTEMBRE : Réunion <strong>de</strong> rentrée avec la relation par M. et Mme Noyelle du voyage<br />
en Champagne, causerie agrémentée d’une projection <strong>de</strong> diapositives et documents.<br />
26 SEPTEMBRE : Congrès <strong>de</strong>s Sociétés d’hi\toire à Soissons.
12 OCTOBRE : Réunion du conseil d’administration.<br />
20 I<br />
OCTOBRE : M. et Mme Noyelle évoqiicnt 1 ‘histoire <strong>de</strong> lu Sicile et <strong>de</strong>s îles<br />
Eolieriizes avec projection <strong>de</strong> diapositives. La Sicile, terre volcanique située à<br />
trois kilomètres <strong>de</strong> l’Italie, a connu toutes les vicissitu<strong>de</strong>c <strong>de</strong>s différentes ethnies<br />
qui l’ont occupée : Grecs, Phéniciens, Carthaginois, Romains, etc. se la disputèrent<br />
au cours <strong>de</strong>s siècles, tout en y laissant leurs souvenirs archéologiques.<br />
Statues, temples, mosaïques, théâtres, chapelles et châteaux normands. églises et<br />
palais baroques, l’art sicilien témoigne d’une histoire mouvementée marquée par<br />
la volonté esthétique et politique <strong>de</strong>s dirigeants successifs.<br />
NOVEMBRE<br />
: Mme Helen McPhail, historienne anglaise, a étudié l’occupation<br />
alleman<strong>de</strong> lors <strong>de</strong> la première guerre mondiale qu’elle relate dans son <strong>de</strong>rnier<br />
livre, Le loizg silerice. Silence pendant la guerre, suivi d’un silence dans l’histoi-<br />
re et la mémoire mo<strong>de</strong>rne.<br />
Elle relate la vie <strong>de</strong>s FranGais du Nord <strong>de</strong> la France pendant cette longue guerre<br />
en nous rappelant le marché noir, la disette, les fusillés, les trahisons et les dénon-<br />
ciations, la clan<strong>de</strong>sLinité, le ravitaillement, les réquisitions, <strong>de</strong>s mots qui, dans la<br />
mémoire <strong>de</strong>s auditeurs, font resurgir <strong>de</strong> nombreux souvenirs qu’ils avaient déjà<br />
entendu Cvoquer <strong>de</strong>s années auparavant, par leurs parents. Les Français étaient<br />
prisonniers en France. Tout ceci illustre bien la question primordiale <strong>de</strong> la confé-<br />
rencière : ><br />
En novembre, également, nous avons été conviés au Forum, centre culturel <strong>de</strong><br />
Chauny, pour assister B la pièce <strong>de</strong> thé3tre relatant Les rn&moives d’un vat - <strong>de</strong><br />
Verdiin clii Chernin <strong>de</strong>s Darnes, accompagnée d’une exposition <strong>de</strong> la Société aca-<br />
dhique <strong>de</strong> Chauny sur Cliuiiny a\mt et LiprPs ILI giterre <strong>de</strong> 14-18 et d’une autre,<br />
présentée par la fédCration Maginot et ayant pour thème /’uprP.s-guerve jiisyii ’eri<br />
1939.
SOCIETE HISTORIQUE DE HAUTE PICARDIE<br />
Bureau <strong>de</strong> la Société<br />
Prési<strong>de</strong>nt ................................... M. Jean-Louis BAUDOT<br />
Trésorier ..................................... M. Jérôme BURIDANT<br />
Secrétaire ................................... M. Emmanuel VEZIAT<br />
Membres du conseil ................... Mme Jacqueline DANYSZ<br />
Mlle Frédérique PILLEBOUE<br />
M. Pierre BOCQUET<br />
M. Thierry BONHOMME<br />
M. Clau<strong>de</strong> CAREME<br />
M. Marcel CARNOY<br />
M. Jean HALLADE<br />
M. Rémy LAHAYE<br />
M. Robert LEFEVRE<br />
M. Jean PARENT<br />
Activités <strong>de</strong> la Société en 1999<br />
203<br />
2 1 JANVIER : communication <strong>de</strong> Monsieur Carnoy et conférence <strong>de</strong> Monsieur<br />
Jorrand.<br />
Monsieur Carnoy communique une <strong>de</strong> ses recherches, extraite <strong>de</strong> L’Aisrie il y a<br />
ceru a17s ( I9 12) : l’origine du hameau La-Gar<strong>de</strong>-<strong>de</strong>-Dieu, à mi-chemin entre<br />
Rozoy et Brunehamel, sur la commune <strong>de</strong> Grandrieux.<br />
Né en 1769, Pierre Leleu est issu d’une famille <strong>de</strong> charpentiers <strong>de</strong> Parfon<strong>de</strong>val et<br />
<strong>de</strong>vient lui-même charpentier dks l’lige <strong>de</strong> huit ans. Maître <strong>de</strong> famille à 18 ans, il<br />
réussit à s’enrichir quelque peu grlice à l’achat d’une coupe <strong>de</strong> bois revendue<br />
habilement. I1 en profite pour acheter une auberge que les habitants surnomment<br />
N la gar<strong>de</strong> <strong>de</strong> Dieu >) quand lui-même, Pierre Leleu, enrcilé sous la Révolution, se<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> qui gar<strong>de</strong>ra son auberge et s’écrie >. Peu après,<br />
il installe une Salpêtrière, puis un moulin et, en 1802, une brasserie, tout en res-<br />
tant un actif charpentier. L‘ensemble attire et le hameau fondé par Pierre Leleu se<br />
peuple.<br />
Monsieur Jorrand, archéologue municipal, présente ensuite un état <strong>de</strong> ses<br />
recherches archéologiques laonnoises entreprises <strong>de</strong>puis 15 ans, état illustré <strong>de</strong><br />
nombreuses photographies.<br />
Le plan chronologique adopté l’amène à signaler les traces les plus anciennes <strong>de</strong><br />
la ville dans le marais <strong>de</strong> Leuilly, près <strong>de</strong> la décharge : <strong>de</strong>s fosses, <strong>de</strong>s morceaux
204<br />
<strong>de</strong> céraniique datent <strong>de</strong> 1’3ge du fer et révèlent une installation entre la civilisa-<br />
tion <strong>de</strong> Halstatt et la Tène.<br />
Le Plateau serait occupé seulement <strong>de</strong>puis le Pr siècle (vers 40) avant Jésus-<br />
Christ. La fosse du site <strong>de</strong> la (< Comédie n, près <strong>de</strong> l’hiitel <strong>de</strong> ville, une exploita-<br />
tion <strong>de</strong> carrière à ciel ouvert remblayée, une latrine rue Saint-Jean, un puisard<br />
avec déversoir sur le nord <strong>de</strong> la place du parvis, un puits sur l’emplacement <strong>de</strong><br />
l’ancienne église Saint-Rémi-8-la-Porte signalent une occupation gallo-romaine.<br />
Une intéressante nécropole a été découverte en <strong>de</strong>ux temps, dans la rue Saint-Jean<br />
en 1996 (inhumations en fosse et 13 sarcophages) et dans la rue Saint-Martin en<br />
1998. Cette <strong>de</strong>rnière est riche <strong>de</strong> 37 sépultures d’adultes et d’enfants orientées<br />
est-ouest, mais aussi d’une pierre portant le signe du Christ ; peut-être date-t-elle<br />
du Vc siècle. Monsieur Y ves Créteur, archéologue-paléontologue <strong>de</strong> I’ AFAN<br />
(Association pour les fouilles archéologiques nationales) a détaillé les sépultures<br />
et les squelettes.<br />
Parmi les autres vestiges se signale, à La Neuville, Line voûte à ressauts <strong>de</strong> <strong>de</strong>s-<br />
cente <strong>de</strong> cave, seniblable à celle <strong>de</strong> l’abbaye Saint-Vincent.<br />
Les quelques cent à cent dix personnes qui remplirent totalement la salle mon-<br />
trent l’intérêt porté par la population laonnoise à son histoire et au mystère <strong>de</strong>s<br />
fouilles archéologiques. On aimerait tellement en savoir plus, et avec précision.<br />
La nécropole <strong>de</strong> la rue Saint-Martin interpelle : il est urgent <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s<br />
fouilles à l’abbaye Saint-Vincent !<br />
23 FÉVRIER : Sui-tre ir Oien par Yves-Marie Lucot.<br />
Yves-Marie Lucot, journaliste, écrivain et ... membre <strong>de</strong> la Société hi\torique a<br />
présenté et tenté <strong>de</strong> cerner pourquoi Sartre n’a pas aimé Laon. Le public - tou-<br />
jours aussi nombreux - semblait curieux d’en savoir plus sur ce ren<strong>de</strong>~-~~~<br />
manqué avec l’Histoire >>.<br />
Né en 1905, orphelin <strong>de</strong> père, Jean-Paul Sartre est élevé par sa mère, personne<br />
effacée, et par son grand-père, instituteur, protestant, alsacien cousin d’Albert<br />
SchweitLer. Dans cet entourage et avec la découverte <strong>de</strong> sa >, l’enfant<br />
se réfugie dans les livres et conserve une nientalité d’adolescent. Mais c’est un<br />
élève brillant qui, après le lycée Louis-le-Grand, entre à I’Ecole normale supé-<br />
rieure en 1924. I1 y rencontre Raymond Aron, Paul Nizan et la belle Siinone <strong>de</strong><br />
Beauvoir, dite le Castor n, qui <strong>de</strong>vient sa compagne pour la vie. Jean-Paul<br />
Sartre est rey premier 8 l’agrégation <strong>de</strong> philosophie en 1929. Fait aussitiit, le ser-<br />
vice militaire aurait pu l’arracher à sa jeunesse, le pousser 8 une condition<br />
(< d’homme >>, mais il lui laisse surtout le temps <strong>de</strong> lire tant <strong>de</strong>s romans <strong>de</strong> quatre<br />
sous que Antoine <strong>de</strong> Saint-Exupéry (Vol <strong>de</strong> nuif), Paul Clau<strong>de</strong>l (Le soulier <strong>de</strong><br />
.safin), Bertold Brecht.<br />
De I931 8 1933, il exerce au lycée du Havre, ville qui ne lui diplail pas car<br />
proche <strong>de</strong> Paris. Il s’investit un peu puisqu’il rédige le discours <strong>de</strong> remise dcs<br />
prix. Simonc <strong>de</strong> Beauvoir et Jean-Paul Sartre constiluent un (< couple mo<strong>de</strong>rne D<br />
où chacun reste libre ; loutelhis, lorsque les mutations les séparent, ils n’ont<br />
qu’une idée : se retrouver. Ainsi, Sartrc quille Le Havre pour l’institut franpis <strong>de</strong><br />
Berlin ; Simone prend un congé maladie.
Sartre écrit. Alors qu’il est près <strong>de</strong> terminer La n~urske, il se jette dans<br />
L’imagination B tel point qu’il expérimente une drogue pour connaître les hallu-<br />
cinations. Simone, aidée d’une certaine Olga, l‘en libère. Puis elle écarte Olga.<br />
Sartre commence peu après les nouvelles du Mur- et met en forme la <strong>de</strong>rnière ver-<br />
sion <strong>de</strong> LN riau.\&, roman où il approche une réflexion nouvelle : I’existentialis-<br />
me. C’est dans cet état d’esprit créatif <strong>de</strong> jeune écrivain et philosophe qu’en 1936<br />
il est nommé à Lyon, pendant que Simone est mutée à Paris. I1 refuse Lyon,<br />
accepte Laon, proche <strong>de</strong> ... Paris.<br />
Alors, sont-ce les jeunes élèves du lycée <strong>de</strong> garqons qui
206<br />
précepteur <strong>de</strong> Philippe IV le Bel ; il fait ensuite son droit à Bologne avant <strong>de</strong> pos-<br />
sk<strong>de</strong>r les prében<strong>de</strong>s à Paris, Rouen, Amiens, Sens, Bayeux, Reims, Saint-Omer,<br />
Cambrai et Saint-Pierre-<strong>de</strong>-Rome oÙ il est inhumé en 1341 ; lui non plus ne vient<br />
pas à Laon puisqu’il est assidu à la curie ; il se fait représenter par Giotto dans un<br />
triptyque qui marque les débuts <strong>de</strong> l’art du portrait.<br />
Francesco Gaetani, indigne et dissolu, est désigné, en tant que neveu du pape<br />
Boniface VIII, trésorier du chapitre en 1275 ; il est dispensé du serment dû à<br />
I’évêque et ne paraît donc pas à Laon, mais à Rome il est utile au chapitre laon-<br />
nois qu’il défend victorieusement contre la commune lors d’un conflit qui a lieu<br />
en 1293- 1295.<br />
Avec la <strong>de</strong>uxième moitié du XIV‘ siècle, le recrutement <strong>de</strong>s chanoines est plus<br />
local. On suit Michel Casse par ses achats <strong>de</strong> manuscrits : il rési<strong>de</strong> en Avignon<br />
jusqu’en 1348, date iì laquelle il arrive à Laon et prépare le banquet <strong>de</strong> Noël pour<br />
37 chanoines et 33 chapelains ; il <strong>de</strong>vient aumbnier <strong>de</strong> la reine Blanche, veuve <strong>de</strong><br />
Philippe VI <strong>de</strong> Valois ; il finit sous-aumbnier du roi en 1368- 1374 avant <strong>de</strong> léguer<br />
I7 manuscrits à la bibliothèque du chapitre <strong>de</strong> la cathédrale ; il en reste actuelle-<br />
ment 9 à la bibliothèque !<br />
Dans la <strong>de</strong>rnière pério<strong>de</strong>, <strong>de</strong> 1407 à 1412, on remarque Jean <strong>de</strong> Haucourt, musi-<br />
cien à la cour pontificale : <strong>de</strong>ux ron<strong>de</strong>aux et un virelai, qui figurent dans un<br />
manuscrit à Carpentras, sont parvenus jusqu’à nous. Jean <strong>de</strong> Monampteuil est<br />
reçu docteur en mé<strong>de</strong>cine en I38 I , à l’époque <strong>de</strong> Guillaume <strong>de</strong> Harcigny ; il a lui<br />
aussi soigné Charles VI ; il témoigne <strong>de</strong> la renommée <strong>de</strong> l’enseignement <strong>de</strong> la<br />
mé<strong>de</strong>cine à Laon. Lui est tout <strong>de</strong> même resté un temps dans la ville, en tant que<br />
bouteiller du chapitre cathédrale.<br />
2 AVRIL : Le coininerce iì Lcioii LIU XVIII’ siècle, par Mine Geoffroy.<br />
A l’heure où la géographie commerciale à Laon pose problème, il est nécessaire<br />
d’étudier la situation passée. Mme Geoffroy le fait pour la fin <strong>de</strong> l’Ancien Régime<br />
; sa recherche et sa présentation rigoureuses donnent tort aux ab\ents.<br />
L‘économie, au XVIIP siècle, passe <strong>de</strong> la rareté à l’abondance par I’accroisse-<br />
ment <strong>de</strong> la production et <strong>de</strong>s échanges qui assurent l’enrichissement et I’embel-<br />
lissement <strong>de</strong>s villes. Comment se font ces échanges à Laon, ville-type d’Ancien<br />
Régime avec ses nombreux clercs et officiers ? Par les marchés, les foires et les<br />
boutiques <strong>de</strong>s marchands-artisans.<br />
Les marchés ont une périodicité élevée ; ils ont lieu trois fois par semaine, les<br />
mercredi, vendredi et samedi, au lieu <strong>de</strong>s mardi, jeudi et samedi au XIV‘ siècle ;<br />
ils offrent <strong>de</strong>s produits frais et rayonnent jusqu’h quatre lieues ; les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
207<br />
économiques entre Laon et Reims sont actives.<br />
Les r8les et le registre <strong>de</strong>s métiers <strong>de</strong> I777 montrent que les marchands laonnois<br />
représentent 36 ?k <strong>de</strong>s feux fiscaux (familles imposables) et même 44,5 % <strong>de</strong><br />
ceux du Plateau, soit 633 foyers ! Laon est alors une ville commerçante, comme<br />
le montrent les 94 niarchands-artisans sur 96 foyers fiscaux <strong>de</strong> la paroisse Saint-<br />
Jean-au-Bourg et les 126 sur 126 <strong>de</strong> la paroisse Sainte-Geneviève ; ils sont la<br />
moitié <strong>de</strong>s foyers <strong>de</strong>s paroisses Saint-Cyr, Sainte-Benoîte, Saint-Pierre-le-Vieil,<br />
le quart <strong>de</strong>s foyers <strong>de</strong>s paroisses Saint-Julien et Saint-Rémi-Place. On distingue<br />
au total 25 bouchers, 50 cabaretiers, 35 marchands-fripiers, 33 tailleurs, 23 cor-<br />
donniers, 13 bonnetiers ... qui ven<strong>de</strong>nt du neuf et reven<strong>de</strong>nt du > car on ne<br />
jette pas facilement à cette époque. Mine Geoffroy relève en particulier que Jean-<br />
Philibert Regnault, fils <strong>de</strong> l’hôte <strong>de</strong> la >, s’est enrichi<br />
comme niarchand-mercier, grâce à <strong>de</strong>ux c beaux >> mariages, et s’est imposé poli-<br />
tiquement sous la Révolution pour <strong>de</strong>venir adjoint au maire sous l’Empire. La<br />
diversité <strong>de</strong>s tissus vendus - lainages, cotonna<strong>de</strong>s, soieries - atteste que la mo<strong>de</strong><br />
est à Laon, ville d’autre par1 bien intégrée iì un large commerce ainsi que le prou-<br />
vent la liste <strong>de</strong>s fournisseurs dispersés dans tout le Nord-Est <strong>de</strong> la France (Reims,<br />
Paris, Elbeuf, Sedan, Troyes, Lyon...).<br />
1 1 MAI : Elie Bloncoirrt, dkpité <strong>de</strong> l’Aime eri 1936, par M. Chathuant.<br />
M. Chathuant. professeur à Reims, présente la personnalité d’Elie Bloncourt,<br />
député <strong>de</strong> la circonscription <strong>de</strong> La Fère en 1936 et après la <strong>de</strong>uxième guerre.<br />
C’est par hasard que Monsieur Chathuant s’intéresse au dépulé <strong>de</strong> l’Aisne. Dans<br />
le cadre <strong>de</strong> sa thèse sur les mouvements nationalistes dans les (très) anciennes<br />
colonies françaises <strong>de</strong>s Antilles, sa recherche le mène à Chartres oh s’est retiré un<br />
gouverneur <strong>de</strong> la Gua<strong>de</strong>loupe après sa mise à la retraite par le Front populaire<br />
pour frau<strong>de</strong> électorale ... par ailleurs constante dans les colonies ! Dans les<br />
archives <strong>de</strong> ce gouverneur, un certain Max Bloncourt est classé > ; un gendarme zélé a noté j. En réalité, IC gendarme a confondu Max et Elie, son frère. I1 est vrai<br />
que les Bloncourt, <strong>de</strong> génération en génération, participent aux mouvements<br />
socio-politiques d’opposition ... comme <strong>de</strong> la Résistance.<br />
Elie Bloncourt, né en 1896 à la Gua<strong>de</strong>loupe, est fils <strong>de</strong> commis <strong>de</strong>s Douanes,<br />
donc <strong>de</strong> milieu petit-bourgeois. Ainsi que tous les habitants <strong>de</strong> ces anciennes<br />
colonies, il se considère Français, plus Français que les Niçois, les Alsaciens,<br />
Francs-Comtois ou ... les Corses, rattachés à la France après eux. En outre, sa peau<br />
claire, quasi blanche, ne peut que favoriser son intégration dans la métropole. La<br />
<strong>de</strong>uxième partie <strong>de</strong> son existence le dkmontre.<br />
En effet, Elie Bloncourt participe 2 la Première Guerre mondiale et tout d’abord<br />
à l’expédition <strong>de</strong>s Dardannelles (1915). Blessé près <strong>de</strong> Chiìteau-Thierry en mai<br />
1918, il reste aveugle. II s’installe en France, apprend le braille, s’inscrit à la<br />
Sorbonne, obtient une licence <strong>de</strong> philosophie en 1921 et <strong>de</strong>vient professeur 2 La<br />
Fère. Quelques années plus tard, le voilà conseiller général, puis la SFIO l’inves-<br />
tit candidat à la députation en 1936. Dans sa profession <strong>de</strong> foi, outre les revendi-<br />
cations sociales du Front populaire, il soutient les betteraviers aux dépens <strong>de</strong>s
208<br />
producteurs <strong>de</strong> sucre <strong>de</strong>s c Isles D. Un reniement ? Une simple intégration ‘? Le<br />
résultat est une élection dans l’enthousiasme.<br />
Pendant l’Occupation, Elie Bloncourt participe à la Résistance. Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la<br />
SFIO pour la zone occupée, il met en place le mouvement >,<br />
appartient au Conseil national <strong>de</strong> la Résistance, s’installe au ministère <strong>de</strong>s<br />
Colonies, rue Oudinot, le 26 août 1944 ... En 1945, il est réélu avec Pierre-Bloch.<br />
Mais, mécontent <strong>de</strong> la rupture entre la SFIO et le PCF en 1947, il quitte la SFIO<br />
pour animer la gauche socialiste, avant <strong>de</strong> rejoindre le parti socialiste et<br />
Mitterrand en 197 I .<br />
Homme mutilé, engagé, dévoué (il défend les Gua<strong>de</strong>loupéens arrêtés après une<br />
manifestation sanglante <strong>de</strong> niai 1967, oÙ les Etats-Unis auraient fait croire au<br />
gouvernement franpis à une action castriste) et, semble-t-il, déjà oublié, Elie<br />
Bloncourt meritait d’être rappelé à la mémoire collective.<br />
6 ET 14 JUIN : Les grin?/?ertes, visite conférence par M. Baudot.<br />
Descente <strong>de</strong> la grimpette <strong>de</strong>s Froids-Culs, remontée par la sente Morlot, <strong>de</strong>scen-<br />
te par la ruelle <strong>de</strong>s Morts, remontée par la ruelle <strong>de</strong> la Vieille-Montagne.<br />
Cette sortie fait suite A l’exposition C/?einiiifiii.wiif, réalisée aux archives dépar-<br />
tementales <strong>de</strong> septembre h décembre 1998.<br />
17 SEPTEMBRE : Lrion, cleiix sitcdrs <strong>de</strong> vie inusiccile, par Clau<strong>de</strong> Carême.<br />
Clau<strong>de</strong> Carême, à l‘occasion du 120 anniversaire <strong>de</strong> l’harmonie municipale et du<br />
50 anniversaire du conservatoire, présente les origines et les évolutions <strong>de</strong> ces<br />
institutions.<br />
La municipalité, aux XIX’ et XX‘ siècles, se montre constainment soucieuse d’en-<br />
tretenir une activité musicale populaire. Dans le cadre du mouvement orphéo-<br />
nique, le maire Beauvillé, en 1858, fait appel à un bon et jeune chef <strong>de</strong> musique<br />
militaire, Em<strong>de</strong> Guérin, pour réorganiser la musique <strong>de</strong> la gar<strong>de</strong> nationale, plus<br />
ou moins satisfaisante. Celui-ci crée une école <strong>de</strong> musique, pour former les ins-<br />
trumentistes, et une union chorale. L‘opposition <strong>de</strong> certains musiciens entraîne<br />
son remplacement par Charles Frédéric Selmer, chef <strong>de</strong> musique militaire à la<br />
retraite.<br />
Après la dissolution <strong>de</strong>s gar<strong>de</strong>s nationales par Thiers en 187 I , le maire Glatigny<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> à Seliner <strong>de</strong> revenir à Laon pour fon<strong>de</strong>r l’harmonie municipale. Elle est<br />
créée en 1879, peu aprks l’inauguration du kiosque, promena<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Couloire.<br />
Mais la naissance est difficile ; si Georges Siegrist (1 882- 1894) est un bon chef,<br />
Porsch, entre I879 et 1882, et Boyer, entre 1894 et I90 I , créent <strong>de</strong>s crises.<br />
A partir <strong>de</strong> 1901 et <strong>de</strong>s nouveaux statuts qui impliquent beaucoup plus la niuni-<br />
cipalité, les institutions musicales laonnoises sont stnbilisées. La longévité <strong>de</strong>s<br />
directeurs - quatre en cent ans ! - assurent aussi cette stabilité. L‘activité<br />
d’Alphonse Crousez (1901-1920) met fin à la crise. Emile Filllltre réorganise<br />
l’harmonie et I’école après chacune <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux guerres.<br />
Mais le grand moment reste la <strong>de</strong>uxième moitié du XX si6cle. Tout d’abord, le<br />
inaire Levindrey installe I’école <strong>de</strong> musique dans <strong>de</strong> vastes locaux où le nouveau<br />
directeur, Roger Thirault (1949-19841, artiste qui rompt avec la tradition militai-
209<br />
cent instrumentistes. En 1985, M. Maumené, le directeur actuel, issu <strong>de</strong> l’école<br />
normale, multiplie les activités pédagogiques pour initier le mieux possible IC<br />
plus grand nombre d’enfants à In musique.<br />
Le succès du conservatoire impose une réhabilitation <strong>de</strong>s locaux trop vétustes,<br />
dangereux.<br />
28 OCTOBRE : Le iiioiiiiiiieizt <strong>de</strong>s trois iristitutrirrs <strong>de</strong> l’Aisne, par Robert Lefèvre.<br />
Robert Lefèvre, professeur li I’IUFM, rappelle l’histoire glorieuse et chaotique du
210<br />
> dont c’est le centenaire.<br />
La guerre <strong>de</strong> 1870- I87 1 est un désastre pour la France. Laon est occupée du 7<br />
septembre 1870 au 24 octobre 187 1 ; l’explosion <strong>de</strong> la cita<strong>de</strong>lle, le 9 septembre,<br />
est un épisodc célèbre <strong>de</strong> ce moment tragique. Dans l’Aisne, parmi les fusillés par<br />
les Allemands, trois instituteurs passent à la postérité : Jules Debor<strong>de</strong>aux, institu-<br />
teur à Pasly, fusillé le I 0 octobre 1870, Louis Poulette, instituteur à Vauxrezis,<br />
fusillé le 11 octobre, Jules Leroy, instituteur à Vendières, fusillé le 22 janvier<br />
187 1 à Châlons-sur-Marne.<br />
Dans une atmosphère d’humiliation et <strong>de</strong> revanche, le Conseil général <strong>de</strong> l’Aisne,<br />
dès sa première session, en novembre 187 I , vote la fabrication d’une tablette <strong>de</strong><br />
marbre en leur mémoire. Elle est d’abord déposée à l’école normale, rue Clerjot,<br />
le 20 août 1872, puis rue <strong>de</strong> la République, en 188 I . Les personnalités présentes<br />
glorifient les instituteurs dans les mêmes termes que Jules Ferry un peu plus tard.<br />
Leur souvenir est entretenu par une brochure, puis par une affiche où figurent<br />
leurs portraits et, enfin et surtout, par le monument conçu par le statuaire Jean<br />
Carlus. Laon et Soissons se disputent sa possession. L‘importance politique du<br />
maire <strong>de</strong> Laon, Georges Ermant, député et conseiller général, fait que le monu-<br />
ment est finalement érigé à Laon. I1 est inauguré le 20 mai 1899 <strong>de</strong>vant 1 600 ins-<br />
tituteurs et institutrices <strong>de</strong> France et les personnalités du département.<br />
Surmontant une groupe d’enfants, les trois instituteurs sont tournés vers la fron-<br />
tière mutilée. Jules Debor<strong>de</strong>aux est à gauche, Louis Poulette au centre. Jules<br />
Leroy, à droite, lève le bras.<br />
Détruit par les Allemands en 19 17, le monument est réédifié, toujours par Carlus,<br />
griìce aux dommages <strong>de</strong> guerre. L‘inauguration a lieu le 28 juillet 1929, en même<br />
temps que celle <strong>de</strong> l’école normale <strong>de</strong> filles, sans les officiels prévus, puisque le<br />
gouvemement Poincaré a démissionné la veille.<br />
Célébré avec enthousiasme en 1899 et 1929, considéré comme un lieu <strong>de</strong> souve-<br />
nir en 1945, il est tombé <strong>de</strong>puis dans une indifférence d’où les organisateur <strong>de</strong>s<br />
manifestations pour son centenaire espèrent le sortir.<br />
4 DÉCEMBRE : J~SUS, iin yrrsonncige historique ?, par Nicole Moine.<br />
>, démontre Nicole Moine (professeur<br />
d’histoire ancienne à l’université <strong>de</strong> Reims, spécialiste du christianisme),<br />
invitCe par la Société historique <strong>de</strong> Laon, reprenant ainsi les couvertures <strong>de</strong><br />
diverses revues à grand tirage parues <strong>de</strong>puis 1998. Les titres se veulent accrocheurs<br />
:
21 1<br />
pereur Clau<strong>de</strong>
SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE SAINT-QUENTIN<br />
fondée en 1825<br />
Reconnue d'utilité publique<br />
En son hCitel B Saint-Quentin<br />
9, rue Villebois-Mareuil<br />
Bureau <strong>de</strong> la Société en 2000<br />
Prési<strong>de</strong>nt ................................... M. André TRlOU<br />
Vice-prési<strong>de</strong>nts ......................... Mme Monique SEVERIN<br />
M. Francis CREPIN<br />
M. Bernard DELAIRE<br />
Secrétaire général ..................... M. André VACHERAND<br />
Trésorier .................................... M. Jean-Paul ROUZE<br />
Bibliothécaire ............................ Mine Arlette SART<br />
Archiviste .................................. Mine Annie ELSNER<br />
Conservateur du musée ............. M. Dominique MORION<br />
Conservateur adjoint ................. Mme Josiane POURRIER<br />
Activités <strong>de</strong> l'année 1999<br />
Communications lors <strong>de</strong>s réunions mensuelles<br />
22 JANVIER : Assemblée générale. Les ritourrielles du círrillon et leurs d$férenis<br />
iizocles <strong>de</strong> progríiiiiiizcrtiori, par Francis Crépin.<br />
26 FÉVRIEK : H~LII*S et r~iulheurs <strong>de</strong> 1 'Art clt:co Ci Saint-Queritin, par André Triou.<br />
26 MARS : Odile Gnhecrux, wie r&sisteinte suiiit-yuentinoise et m e artiste mécon-<br />
nue, par Roger-Max Busseniers.<br />
23 AVRIL : Quin:e uiis <strong>de</strong> tr~ii~~iiix I'cihthiye du Moiit-Striiit-Marlin, par le docteur<br />
Eric Wosnicki.<br />
26 MAI : La mliizoire íle Montbrehairz, soil histoire autremeril ; L'&<strong>de</strong> <strong>de</strong> notre<br />
er!fiirzce, par le docteur Jean Bou<strong>de</strong>rlique.<br />
213
214<br />
18 JUIN : Le couple Fourier-Godin, utopie ou réalité, par Clau<strong>de</strong> Venet.<br />
24 SEPTEMBRE : Horiirizage 6 Christiiie Debrie, par André Triou.<br />
Lesfmritons CILI piliiis <strong>de</strong> Fervayiies, par Monique Séverin.<br />
Le Jjpriton tiir thliltre, par Louis Armbrust.<br />
22 OCTOBRE : Les tecliiziques ~iicieriiies <strong>de</strong> IN peinture b l’huile, par François<br />
Waen<strong>de</strong>ndries.<br />
19 NOVEMBRE : Les t?g/ises fortifikes <strong>de</strong> Irr T/iit?rcrche rrxonaise, hier et aiijoirr-<br />
d’hui, par Jean-Louis Tétart.<br />
IO D&EMBRE : Avoir21 NILS en 1944, par Janine Cotin.<br />
Voyages d’étu<strong>de</strong> et visites<br />
19 AOîJT : Gouj ; visite <strong>de</strong> /’abbaye du Morir-Sriint-Mrirtiii, guidée par le docteur<br />
Eric Wosnick, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’association <strong>de</strong>s Amis <strong>de</strong> l’abbaye.<br />
29 SEPTEMBRE : Soissoris et C~~irc~-le-Chiltrriir ; participation à la journée <strong>de</strong> la<br />
Fédération <strong>de</strong>s sociétés d’histoire et d’archéologie <strong>de</strong> l’Aisne.<br />
Travaux en cours<br />
EnquCte pour la Contrihirtioii il la tiiltiioire rlu citoyen s~iint-qirrntiriois, d’après<br />
une idée d’ Arlette Sart, dirigée par une commision composée <strong>de</strong> Monique<br />
Séverin, Arlette Sart et Jean-Louis Tétart, <strong>de</strong>stinée h recueillir témoignages et<br />
documents en cette fin <strong>de</strong> siècle.<br />
Lancement lors <strong>de</strong>s journees du Patrimoine, les 18 et 19 septembre, par la distribution<br />
<strong>de</strong> cahiers <strong>de</strong>stinés à recevoir ces archives du futur. Appel par courrier à<br />
tous les membres du conseil municipal, à tous les dirigeants <strong>de</strong> sociétés, aux<br />
membres du conseil <strong>de</strong>s sages, du conseil <strong>de</strong>s jeunes, aux maires <strong>de</strong>s communes<br />
voisines et d’autres personnalités, pour leur participation et leur soutien.<br />
Emissions radiophoniques sur Radio-France-Picardie, sous le titre , initiée par André Triou, <strong>de</strong>vient solidaire <strong>de</strong> la nouvelle<br />
enquete.<br />
Bibliothèque<br />
Elle est maintenant ouverte au public les lundis et mercredis après-midi : classe-<br />
ment <strong>de</strong>s livres, archives, dons et legs par Mmes Sart, Séverin et Eher ; consti-<br />
tution <strong>de</strong>s dossiers thématiques.
Musée archéologique<br />
I1 est ouvert aux enfants <strong>de</strong>s écoles, sur ren<strong>de</strong>z-vous, et lors <strong>de</strong>s journées >, sous la direction du conservateur, Dominique Morion, et <strong>de</strong> son<br />
adjointe, Josiane Pourrier.<br />
25 OCTOBRE : visite <strong>de</strong> la Société par une classe du collège Hanotaux accompa-<br />
gnée <strong>de</strong> correspondants allemands et <strong>de</strong> leurs maîtres du collkge <strong>de</strong> Lü<strong>de</strong>nscheid,<br />
sous la conduite <strong>de</strong> M. Denis Lefevre, avec une animation <strong>de</strong> Mmes Séverin et<br />
Pourrier.<br />
Participations<br />
lcr MARS : Bourse aux livres, salle <strong>de</strong> Verdun, par Monique Séverin.<br />
24 ET 25 AVRIL : Portes ouvertes au musée archéologique, exposition <strong>de</strong> docu-<br />
ments, cartes et plans : Dominique Morion, Josiane Pourrier, Monique Séverin,<br />
André Triou.<br />
18 AVRIL ET 29 MAI : Prix <strong>de</strong> la nouvelle en picard : réunions du jury avec Jean-<br />
Pierre Semblat et André Vacherand. Remise <strong>de</strong> prix et citations aux lauréats.<br />
23 MAI : Fêtes du Bouffon : concert <strong>de</strong> carillon par Francis Crépin. Jean-Pierre<br />
Semblat chante, <strong>de</strong> sa voix picar<strong>de</strong>, c L‘gayant Herbert D, dont il a écrit les<br />
paroles, accompagné au carillon par Francis Crépin, auteur <strong>de</strong> la musique.<br />
JUIN : Pour le tournage d’un filni sur >, concert <strong>de</strong><br />
carillon avec exécution <strong>de</strong> la chanson ci-<strong>de</strong>ssus.<br />
5 ET 6 JUIN : Journées du tourisme et <strong>de</strong> l’environnement : visites guidées du<br />
musée archéologique ; exposition <strong>de</strong> documents et photos anciennes.<br />
19 JUIN : Fête <strong>de</strong> la musique : concert <strong>de</strong> carillon iì l’hôtel <strong>de</strong> ville par Francis<br />
Crépin.<br />
12-27 JUIN : Journées du patrimoine industriel : exposition Raconte-moi le canal<br />
(canal <strong>de</strong> Saint-Quentin <strong>de</strong> Fargniers a Cambrai). Participation active à la pré-<br />
sentation : cartes postales anciennes <strong>de</strong> Monique Séverin et Georges Boudon.<br />
Collection <strong>de</strong> photos en couleurs <strong>de</strong> toutes les écluses, <strong>de</strong> Serge Sallandre.<br />
Programme chargé <strong>de</strong>s journées par Francis Crépin, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’association <strong>de</strong><br />
sauvetage du patrimoine industriel du Vermandois.<br />
Pendant l’été : visites du patrimoine urbain à bicyclette, guidées par Bernard<br />
Delaire.<br />
215
216<br />
12 SEPTEMBKE : A Lehaucourt, conférence L’exo<strong>de</strong> <strong>de</strong> 1940, par Monique Séverin.<br />
18 ET 19 SEPTEMBRE. : Journées du patrimoine : portes ouvertes B l’h6tel <strong>de</strong> la<br />
Société. Musée par M. Morion et Mme Pourrier. Accueil par Arlette Sart, qui distribue<br />
les cahiers aux participants B l’opération >, aidée par<br />
MM. Mareuse, Monnoyer et Tétart.<br />
Conférences permanentes avec projections : le 18, Le clécor urbciin <strong>de</strong> la remis-<br />
triiction, par André Triou, et le 19, Les ~iioiiiii~ieiits <strong>de</strong> Saint-Queiitin, par<br />
Monique Séverin.<br />
Visites <strong>de</strong>s monuments guidées par <strong>de</strong> nombreux membres <strong>de</strong> la Société.<br />
17 ET 18 SEPTEMBRE : Grand spectacle, place <strong>de</strong> I’H6tel-<strong>de</strong>-Ville et au théstre :<br />
Les six jours d’Henri IV. Reconstitution par André Triou <strong>de</strong> la visite fameuse du<br />
roi en 1590. Parmi les comédiens, Thierry Comble dans le r81e du roi ; dans celui<br />
du mayeur, André Triou, Annette Poulet épouse du mayeur, etc. De nombreux<br />
acteurs et membres <strong>de</strong> l’équipe technique étaient membres <strong>de</strong> notre Société. Mise<br />
en scène d’Hubert Mercereau.<br />
1“ ET 2 OCTOBRE : Fêtes Saint-Quentin : grand spectacle L’itweiition &i corps <strong>de</strong><br />
Moiisieur Soirit-Quentin, d’après un manuscrit du XV siècle, adapté pour la<br />
repréjentation B la basilique par André Triou ; conception et mise en scène <strong>de</strong><br />
Francis Crépin ; son et lumière conçus par Bernard Delaire.<br />
I6 OCTOBRE : Lire en fête : 2 la bibliothèque municipale, conférence Les inLiires<br />
<strong>de</strong> Suint-Queritin Nzi XIX’ siècle, par Monique Séverin. A l’espace Saint-Jacques,<br />
Coritrs <strong>de</strong> Proverzce (<strong>de</strong> Mistral et Roumanille) par André Triou. Au Logis<br />
Voltaire, exposition Lci presse sciint-yiirritiiioi.sr par <strong>de</strong>s étudiants, avec l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Monique Séverin et André Triou.<br />
17 OCTOBRE : Semaines <strong>de</strong> l’environnement : iì la maison <strong>de</strong> la Nature, au faubourg<br />
d’Isle. projection d’un film <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> beauté, Le ni~iniis criifil <strong>de</strong>s saisons,<br />
œuvre <strong>de</strong> René Bertré. <strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong>s sciences <strong>de</strong> l’environnement.<br />
23 OCTOBRE : La semaine <strong>de</strong> la science : à l’Institut supérieur <strong>de</strong>s sciences et techniques,<br />
conférence Conii~ii.s.wiice et ,s~iiiwg~ir<strong>de</strong> du patrimoine iizdirstriel clctiis le<br />
Saiiir-Quriztiiiois, par Francis Crépin.<br />
18 SFPTEMBRE AU 30 OCTOBRE : Dans le cadre <strong>de</strong>s Mémoires campanaires <strong>de</strong><br />
Saint-Quentin - L‘art du carillon <strong>de</strong>puis I880 D, à l’espace Saint-Jacques, exposition<br />
Histoire dir cciri//on et u~iri~/oii~ieurs <strong>de</strong> Saiiit-Queritin.<br />
Publication d’un ouvrage avec la participation <strong>de</strong> Francis Crépin et Alexis<br />
Grandin.<br />
Avec le carillon ambulant <strong>de</strong> Douai, Francis Crépin a donné <strong>de</strong>s concerts publics,<br />
place <strong>de</strong> I’HBtel-<strong>de</strong>-Ville ainsi que dans trois écoles : les ékves <strong>de</strong> 27 classes ont<br />
en même temps profité <strong>de</strong> conférences B propos <strong>de</strong>s cloches et <strong>de</strong>s carillons.
217<br />
NOVEMBRE : Mairie annexe Saint-Martin, exposition Histoire dir 87 RI, par Serge<br />
Sal 1 andre.<br />
Office du tourisme<br />
Enregistrement par Francis Crépin d’un audio-gui<strong>de</strong> pour l’histoire <strong>de</strong> la collé-<br />
giale, réalisé par André Thiébaut.<br />
Autres confbrences<br />
IO F~VRIER : A la mairie annexe <strong>de</strong> Saint-Martin, Antoine cle Soint-E.nrpép, par<br />
Serge Sallandre.<br />
6 AVRIL : Au restaurant <strong>de</strong>s Champs-Elysées, pour I’ ASPIV, Ccrrillons, carillon-<br />
neurs Ù Sriint-Qcrentin, par Francis Crépin.<br />
20 AVRIL : Dans le même cadre, Heirrs et rnallzecrrs <strong>de</strong> l’Art clCco ir Suint-Qirentirz,<br />
par André Triou.<br />
MAI : Printemps <strong>de</strong>s poètes à l’école <strong>de</strong> Saint-Paul-au-Bois, par Janine Cotin.<br />
23 SEPTEMBRE : Conférence à la Société archéologique <strong>de</strong> Péronne, L’iinpossihle<br />
paix cle Versailles, par Dominique Morion.<br />
11 NOVEMBRE : Pour le salon d’automne Art et Littérature, conférences Pierre<br />
Acig~rstin Ccrrorz <strong>de</strong> Beoirr~i~ir~~I~~ri.r, riiort erz 1799, par Louis Goret et Avcrnt, pendcrnt,<br />
après Hin<strong>de</strong>nburg, par Pierre-Paul Trannois.<br />
13 NOVEMBRE : Jerrn Mo~rlin, rié en 1899, par Janine Cotin : poèmes, par Henry<br />
<strong>de</strong> Julliot.<br />
18 NOVEMBRL : Anniversaire <strong>de</strong> la mort <strong>de</strong> Richard Cceur <strong>de</strong> Lion, par Suanne<br />
Liétoir ; poèmes, par Monique Salandre.<br />
20 NOVEMBRE : Lire Btrlzac, né en 1799, par Joseph Leroux.<br />
Publications <strong>de</strong> nos membres<br />
Cahiers Mcirtin Suint-Renk, hommage à l’abbé Henry <strong>de</strong> Julliot : poèmes.<br />
Jean Bou<strong>de</strong>rlique, Lu Mhoire <strong>de</strong> Monthreliciin, son histoire autrement,<br />
11 volumes 21 x 29,7, à compléter plus tard par <strong>de</strong>ux autres, déposés à la mairie<br />
<strong>de</strong> Montbrehain, à la bibliothèque municipale et Li la Société académique.
218<br />
Christian Millet, , revue Parchenziiz.<br />
Christine Debrie,
SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE, HISTORIQUE ET<br />
SCIENTIFIQUE DE SOISSONS<br />
4, rue <strong>de</strong> la Congrégation, 02200 Soissons<br />
Téléphone-fax : O3 23 59 32 36<br />
Bureau <strong>de</strong> la Société en 2000<br />
Prési<strong>de</strong>nte d’honneur ................ Mme Geneviève CORDONNIER<br />
Prési<strong>de</strong>nt ................................... M. Denis ROLLAND<br />
Vice-prési<strong>de</strong>nts ......................... M. Robert ATTAL<br />
M. Maurice PERDEREAU<br />
.\<br />
Trésoriere ..................................<br />
M. René VERQUIN<br />
Mme Ma<strong>de</strong>leine DAMAS<br />
Trésorier adjoint ........................ M. Lucien LEVIEL<br />
Secrétaire .................................. M. Georges CALAIS<br />
Bibliothécaire ............................ M. Pierre MEYSSIREL<br />
Archiviste .................................. M. Maurice PERDEREA J<br />
Membres ................................... Mme Jeanne DUFOUR<br />
M. Yves GUEUGNON<br />
Activités <strong>de</strong> l’année 1999<br />
Communications<br />
219<br />
24 JANVIER : Assemblée générale, rapports moral et financier, élection du bureau.<br />
Communication <strong>de</strong> Denis Defenle sur le bilan <strong>de</strong>s activités du musée <strong>de</strong> Soissons<br />
durant la pério<strong>de</strong> pendant laquelle il a dirigé cet établissement, précédé d’un bref<br />
rappel historique <strong>de</strong>puis les origines du musée dont la création, à partir <strong>de</strong>s col-<br />
lections <strong>de</strong> l’Ancien Régime, fut <strong>de</strong>mandée dès 1795.<br />
21 FÉVRIER : Conférence <strong>de</strong> Suzanne Fiette sur la noblesse française, <strong>de</strong>s<br />
Lumières à la Belle Epoque. Partant du constat que l’on a cru longtemps, après la<br />
Révolution, la noblesse déclinante, dépouillée <strong>de</strong> ses biens ou fondue dans la<br />
société <strong>de</strong> droits égaux, elle démontre qu’elle a non seulement sauvegardé son<br />
prestige et sa conscience <strong>de</strong> soi mais s’est adaptée au mon<strong>de</strong> nouveau en restant<br />
une aristocratie.<br />
7 MARS : Michèle Sapori raconte la vie exceptionnelle <strong>de</strong> Rose Bertin, ministre
220<br />
<strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s sous Marie-Antoinette, que l’on considère comme l’ancetre <strong>de</strong>s grands<br />
couturiers. Si rarement, <strong>de</strong> mémoires <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>s, il n’y eut autant <strong>de</strong> variétés et <strong>de</strong><br />
créations que sous Louis XVI, c’est parce que Rose Bertin fut la véritable inspi-<br />
ratrice <strong>de</strong> ces inventions vestimentaires. Elle exerça une extraordinaire fascina-<br />
tion sur les femmes qui se prirent pour elle d’un véritable engouement, <strong>de</strong> la capi-<br />
tale à la province, en France comme à I’étranger. Elle régenta ainsi le costume<br />
dans les cours étrangères et fut le grand fournisseur <strong>de</strong> leurs monarques. En<br />
habillant l’Europe, elle rendit tout le continent tributaire <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s françaises.<br />
18 AVRIL : Conférence <strong>de</strong> Julien Sapori sur l’histoire et les institutions <strong>de</strong> la répu-<br />
blique <strong>de</strong> Venise. Pendant <strong>de</strong>s siècles, au-<strong>de</strong>li d’une situation géographique pri-<br />
vilégiée, la véritable force <strong>de</strong> cette cité a résidé dans la sagesse et l’efficacité <strong>de</strong><br />
ses institutions qui lui permirent <strong>de</strong> <strong>de</strong>venir la première puissance maritime et<br />
commerciale, capable <strong>de</strong> faire face, seule, au gigantesque Empire ottoman, tout<br />
en assurant à ses administrés une véritable paix sociale.<br />
17 OCTOBRE : Conference <strong>de</strong> Pierre Rho<strong>de</strong> sur la forteresse souterraine <strong>de</strong><br />
Margival. C’est toute l’histoire <strong>de</strong> cette installation que l’historien a présentée<br />
dans le détail : le choix stratégique, l’architecture utilisée, la construction avec<br />
toutes les protections alentour, pour terminer sur l’unique visite d’Hitler, le<br />
17 juin 1944, la reprise par les armées alliées à la Libération puis par les autori-<br />
tés françaises à partir <strong>de</strong> 1950.<br />
14 NOVEMBRE : Conférence <strong>de</strong> Robert Atta] sur les misères et la charité du XVII‘<br />
au Xx’ siècle. L‘analyse la situation matérielle <strong>de</strong>s gens du peuple en France et<br />
dans le Soissonnais sur ce long terme montre que la misère. que l’on croyait ban-<br />
nie, réapparaît aujourd’hui par suite d’un ch8mage important dont le corollaire<br />
est une nouvelle pauvreté, une précarité qui paralyse une part non négligeable du<br />
corps social.<br />
Conférence dîner<br />
10 D~CEMBRE : René Verquin retrace le parcours professionnel et politique <strong>de</strong><br />
Jean Mermoz. Dans son exposé très détaillé, l’orateur témoigne sa conviction que<br />
raviver la mémoire <strong>de</strong> Mermoz permet <strong>de</strong> le laver <strong>de</strong> certains préjugés ; il ne fut<br />
ni un ultra intolérant, ni compromis dans une poubelle politico-financière, niais il<br />
se battit pour obtenir le retrait <strong>de</strong>s hydravions afin <strong>de</strong> les remplacer par <strong>de</strong>s appareils<br />
plus rapi<strong>de</strong>s permettant <strong>de</strong> raccourcir les temps <strong>de</strong> vols et <strong>de</strong> ne voler que <strong>de</strong><br />
jour. L‘enjeu était la sécurité <strong>de</strong>s équipages et la survie <strong>de</strong> l’Aérospatiale.<br />
Sorties<br />
9 MAI : Visite du fort <strong>de</strong> Condé, sous la conduite <strong>de</strong> Philippe Baud. Après un rap-<br />
pel historique sur la niotivation <strong>de</strong> l’amélioration du système <strong>de</strong> fortification <strong>de</strong><br />
la France après la guerre <strong>de</strong> 1870, M. Baud décrit l’organisation <strong>de</strong> ce système et
22 1<br />
sa mission, la construction du fort et son déclassement presque consécutif avec<br />
les progrès <strong>de</strong> l’artillerie, pour terminer par l’utilisation du site durant la guerre<br />
<strong>de</strong> 14-18.<br />
6 JUIN : Cette traditionnelle journée pique-nique a conduit nos sociétaires en<br />
Thiérache, pour la visite guidée <strong>de</strong> quelques églises fortifiées d’où ressort nette-<br />
ment le rôle joué par ces édifices dans l’administration civile <strong>de</strong>s communautés<br />
d’habitants jusqu’à la fin du XVII siècle.<br />
Journée <strong>de</strong>s Sociétés d’histoire <strong>de</strong> l’Aisne<br />
26 SEPTEMBRE : Comme cela se produit tous les sept ans, notre Société avait la<br />
charge d’organiser le
SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE<br />
DE VERVINS ET DE LA THIÉRACHE<br />
(reconnue d’utilité publique)<br />
Bureau <strong>de</strong> la Société en 2000<br />
Prési<strong>de</strong>nt ................................... M. Frédéric STEVENOT<br />
Vice-prési<strong>de</strong>nts ......................... M. Alain BRUNET<br />
M. Pierre LAMBERT<br />
Mine Claudine VIDAL<br />
Secrétaire administrative .......... Mme Jacqueline VASSEUR<br />
Secrétaire archivi5te .................. M. Marc LE PAPE<br />
Trésorier .................................... M. Bernard CHOQUET<br />
Administrateurs ........................ M. Jean-Pierre BALLIGAND (député, maire<br />
<strong>de</strong> Vervins, conseiller général)<br />
M. Guy DELABRE<br />
M. Yves DREUX<br />
Mine Jeannine HOUDEZ<br />
M. René LIBERSA (maire adjoint <strong>de</strong> Vervins)<br />
M. TRICQUENAUX (sous-préfet <strong>de</strong> Vervins)<br />
M. Bernard VASSEUR<br />
Cornmissaire aux comptes ........ M. Marc VANNES<br />
Activités <strong>de</strong> l’année 1999<br />
Confikences<br />
6 MARS : Claudine Vidal, Les <strong>de</strong>stins historiques <strong>de</strong> Nicole <strong>de</strong> Vervins.<br />
24 AVRIL : Bernard Choquet, Les chenzins <strong>de</strong> fer <strong>de</strong> Tliitrciclie (1870-1914).<br />
29 MAI : Joseph Baillot, Jeantes et l’muvre picturule <strong>de</strong> Clicrrles Eyck ; Jacky<br />
Billard, Au nmii du Fils, diaporama sur l’ozuvre <strong>de</strong> Charles Eyck.<br />
2 OCTOBRE : Claudine Vidal, Historiogr~il,liie <strong>de</strong> /’abl?mqe <strong>de</strong> Foigi7y. Cette confé-<br />
rence a été donnée 2 l’occasion du retour <strong>de</strong> restauration <strong>de</strong> l’une <strong>de</strong>s pièces <strong>de</strong>s<br />
collections <strong>de</strong> la SAHVT, un tableau anonyme du début du XVIII‘ siècle repré-<br />
sentant l’abbaye <strong>de</strong> Foigny.<br />
223
224<br />
4 DÉCEMBRE : Ginette Day, Auguste Lnhouret, un artiste picard <strong>de</strong> renommée<br />
internationale.<br />
Publications<br />
Yves Dreux,
SOCIÉTÉ HISTORIQUE RÉGIONALE<br />
DE VILLERS-COTTERÊTS<br />
Bureau <strong>de</strong> la Société en 2000<br />
Prési<strong>de</strong>nt d’honneur .................. M. Marcel LEROY t<br />
Vice-prési<strong>de</strong>nt d’honneur ......... M. Clau<strong>de</strong> VIVANT t<br />
Prési<strong>de</strong>nt ................................... M. Roger ALLEGRET<br />
Vice-prési<strong>de</strong>nts ......................... M. Alain ARNAUD<br />
M. Yves TARDIEU<br />
M. Eric THIERRY<br />
Secrétaire .................................. M. Robert LEFEBURE<br />
Secrétaire adjointe .................... Mme Ma<strong>de</strong>leine LEYSSENE<br />
.\<br />
Trésoriere .................................. Mme Christiane TOUPET<br />
Trésorier adjoint ........................ M. Serge ODEN<br />
Membres du conseil ................... M. Maurice DELAVEAU<br />
M. Louis PATOIS<br />
M. Clau<strong>de</strong> ROYER<br />
M. Franqois VALADON<br />
Activités <strong>de</strong> l’année 1999<br />
I6 JANVIER : D’Ahrdicirn ir Scrdchiz HLISW~IZ, à la découverte <strong>de</strong> la Mésopotamie,<br />
par Louis Patois, membre du conseil.<br />
Une évasion traditionnelle, en ce mois írileux <strong>de</strong> janvier, vers <strong>de</strong>s contrées plus<br />
chau<strong>de</strong>s, mais toujours chargées d’histoire.<br />
20 FÉVRIER : UIZ préfet <strong>de</strong> 1 ’Aisrie : le baron Whlk~‘n~ier, par François Valadon,<br />
membre du conseil.<br />
Une page d’histoire départementale sous Charles X pratiquement inédite. Un per-<br />
sonnage hors du commun qui, en dépit d’un passage assez bref dans l’Aisne, y a<br />
laissé d’importantes réalisations et qui, par son charisme, a sauvé d’un saccage<br />
certain la ville <strong>de</strong> Saint-Quentin lors d’émeutes d’ouvriers. Nul mieux que<br />
Franqois Valadon n’était en mesure d’évoquer cette figure, grlice aux documents<br />
familiaux <strong>de</strong> son épouse, dont
226<br />
Utiliser les registres <strong>de</strong>s trois paroisses <strong>de</strong> Crépy pour établir <strong>de</strong>s statistiques <strong>de</strong><br />
la mortalité infantile <strong>de</strong> ces enfants <strong>de</strong> familles parisiennes pauvres était déjà en<br />
soi une recherche historique intéressante, mais tirer <strong>de</strong> ces renseignements un<br />
tableau <strong>de</strong> la vie <strong>de</strong>s familles pauvres <strong>de</strong> Crépy, qui les élevaient, en a fait une<br />
causerie évocatrice <strong>de</strong> la vie paysanne <strong>de</strong> grand intérêt.<br />
17 AVRIL : Autour tie notre mus<strong>de</strong> Alexandre Durnus, par Dominique Roussel,<br />
conservateur <strong>de</strong>s musées <strong>de</strong> Soissons et <strong>de</strong> Villers-Cotterêts.<br />
Le thème choisi par notre nouveau conservateur, qui a succédé iì Denis Defente,<br />
était axé sur la fondation du musée en 1902, l’expansion <strong>de</strong> ses collections, due<br />
en majeure partie aux dons <strong>de</strong> généreux Cotteréziens, mais aussi sur les vicissi-<br />
tu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> ses emménagements successifs jusqu’à son installation rue Demoustier,<br />
qui n’est sans doute pas son local définitif.<br />
15 MAI : Les Tritiitciires : huit si2cle.y service <strong>de</strong> la liDPrLitioti (les cciptifs, par<br />
le père Thierry Knecht, <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> Cerfroid.<br />
C’est en 1 193 que l’ermite Félix <strong>de</strong> Valois fonda. avec Jean <strong>de</strong> Matha, l’ordre <strong>de</strong>s<br />
trinitaires, <strong>de</strong>stiné au rachat <strong>de</strong>s captifs chez les Barbaresques. Le siège <strong>de</strong> l’ordre<br />
est à Cerfroid, au bord du Clignon, à l’orée du bois aujourd’hui appelé<br />
Waddington qui n’est autre qu’un prolongement <strong>de</strong> la forêt <strong>de</strong> Retz. L‘histoire en<br />
est longue et l’objectif initial a évolué au cours <strong>de</strong>s siècles pour s’adapter à<br />
d’autres libérations. Les Trinitaires sont revenus <strong>de</strong>puis peu a Cerfroid et les<br />
ruines <strong>de</strong> l’ancien monastère ont fait l’objet <strong>de</strong> fouilles et <strong>de</strong> restaurations. Ce<br />
soir-là, les propos du conférencier portaient principalement sur l’adaptation<br />
actuelle <strong>de</strong> l’ordre à <strong>de</strong> nouvelles tkhes humanitaires.<br />
19 JUIN : Les sciilpr~ires sccrtztl~i1euse.s du chrjrerru tie Villet-s-Coriet-êts, par Eric<br />
Thierry, vice-prési<strong>de</strong>nt.<br />
I1 appartenait à notre vice-prési<strong>de</strong>nt, professeur d’histoire à Laon niais cotterézien<br />
<strong>de</strong> souche, <strong>de</strong> s’attaquer à ce mythe <strong>de</strong>s sculptures en ron<strong>de</strong>-hose d’un escalier<br />
du château que les historiens du XIX’ siècle ont qualifiées <strong>de</strong> >.<br />
Grâce à son minutieux travail <strong>de</strong> recherches, notamment dans les domaines litté-<br />
raire et philosophique <strong>de</strong> l’époque, Eric Thierry a replacé ces scènes mytholo-<br />
giques dans un contexte beaucoup plus intellectuel.<br />
20 NOVEMBRE : L’&lit cle Nmites, ur1 essai <strong>de</strong> (( toldruhle pix- >>, par Cécile<br />
Souchon, conservateur en chef aux Archives nationales.<br />
Nous avons la chance que notre ancienne directrice <strong>de</strong>s archives <strong>de</strong> l’Aisne ait<br />
conservé à notre région une íïdélité qui nous vaut <strong>de</strong> frkquents passages dans<br />
notre ville pour nous parler d’histoires que l’on peut toujours relier à celle <strong>de</strong><br />
notre proximité. Une causerie sur l’édit <strong>de</strong> Nantes, n’est-ce pas évoquer aussi <strong>de</strong>s<br />
luttes fratrici<strong>de</strong>s qui n’ont pas épargné notre sol ?<br />
1 1 DÉCEMBRE : Etz pays cotterkzicw : hier et uiljourd’hui.<br />
Notre propos était <strong>de</strong> confronter vues anciennes <strong>de</strong> cartes postales et photos
227<br />
actuelles <strong>de</strong> villages du pays cotteréLien. Plusieurs membres ont répondu a notre<br />
appel et nous avons sélectionné trois villages avec les commentaires <strong>de</strong> trois<br />
d’entre eux, collectionneurs passionnés. Maurice Delaveau a présenté Haramont,<br />
Serge O<strong>de</strong>n, Coyolles, et Alain Amaud, Villers-Hélon. L‘expérience, très réussie,<br />
mérite d’être renouvelée.
Contacts<br />
F~D~RATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOlRk ET D’AKCH6OLOGIE DE L’AISNE<br />
Archives départementales <strong>de</strong> l’Aisne<br />
28, rue Fernand-Christ - 02000 Laon<br />
Tél. : 03.23.24.61.47<br />
Télécopie : 03.23.24.61.26<br />
SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE CHÂTEAU-THIERRY<br />
Musée Jean <strong>de</strong> La Fontaine<br />
Rue Jean <strong>de</strong> La Fontaine - 02 400 Chliteau-Thierry<br />
Tél. : 03.23.69.05.60<br />
Permanence : samedi <strong>de</strong> 14 h à I7 h<br />
Informations sur www.la-fontaine-ch-thierry.net<br />
MCl : pichard@la-fontaine-ch-thierry.net<br />
229<br />
SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE D’HISTOIRE, D’ ARCH~OLOGIE, DES ARTS ET DES LETTRES DE<br />
CHAUNY<br />
Chez M. René Gérard, 02300 Comnienchon<br />
SOCI~~TÉ HISTORIQUE DE HAUTE-PICARDIE<br />
Archives départementales <strong>de</strong> l’Aisne<br />
28, rue Fernand-Christ - 02000 Laon<br />
Tél. : 03.23.24.61.47<br />
Télécopie : 03.23.24.61.26<br />
SOCIGTÉ ACAD~MIQUE DE SAINT-QUENTIN<br />
En son hCitel à Saint-Quentin<br />
9, rue Villebois-Mareuil - 021 O0 Saint-Quentin<br />
Tél. : 03.23.64.26.36<br />
Permanence : mercredi <strong>de</strong> 14 h à I7 h<br />
SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE, HISTORIQUE ET SClENTlFlQUE DE SOISSONS<br />
4, rue <strong>de</strong> la Congrégation - 02200 Soissons<br />
Téléphoneltélécopie : 03.23.59.32.36<br />
Permanence : mercredi et samedi <strong>de</strong> 16 h à 18 h (sauf juillet et août)<br />
Informations sur http://perso.wanadoo.fr\sahs.soissons.net<br />
SOCIÉTÉ ARCHÉOLOCIQUE ET HISTORIQUE DE VEKVlNS ET DE LA THIeRACHE<br />
Musée <strong>de</strong> la Thiérache<br />
3 et 5, rue du Traité-<strong>de</strong>-Paix - B.P. 19 02 140 Vervins<br />
SOCI~TÉ<br />
HISTORIQUE RÉGIONALE DE VILLERS-COTTERkTS<br />
24, rue Demoustier - 02600 Villers-Cotterêts<br />
Tél. : 03.23.96.11.86
Note à l’attention <strong>de</strong>s auteurs<br />
Les auteurs désirant publier dans les Mémoires <strong>de</strong> la Fédération <strong>de</strong>s socié-<br />
tés d’histoire et d’archéologie doivent proposer leur article au prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la<br />
société dont ils sont membres qui, après avis évenluel <strong>de</strong> son bureau ou d’un<br />
comité <strong>de</strong> lecture, l’adresse au secrétariat général pour examen par le comité <strong>de</strong><br />
lecture <strong>de</strong> la Fédération. Après avis <strong>de</strong> ce comité, le conseil d’administration <strong>de</strong><br />
la Fédération arrête la liste <strong>de</strong>s articles publiés. Les articles doivent parvenir sous<br />
la forme d’une disquette informatique accompagnée d’un tirage sur papier.<br />
D’une manière générale, on veillera à indiquer <strong>de</strong> manière très précise les<br />
sources et la bibliographie utilisées en notes infrapaginales ou en fin d’article. Les<br />
cotes d’archives seront indiquées <strong>de</strong> maniche exhaustive, précédkes du lieu <strong>de</strong><br />
conservation : Arch. dép. Aisne, C 306 ; Arch. nat., JJ IO ; Arch. coni. Saint-<br />
Quentin, BB 3 ; Bibl. nat., ms. fr. 1601. Les appels <strong>de</strong> notes se font par un chiffre<br />
suscrit, sans parenthèse, dans le corps du texte, par un chiffre sur la ligne, suivi<br />
d’un point, dans le corps <strong>de</strong> la note. Les collections <strong>de</strong> presse consultées sont éga-<br />
lement indiquées <strong>de</strong> manière précise et exhaustive. Les références bibliogra-<br />
phiques sont données selon le modèle suivant :<br />
Suzanne Martinet, hori pronrontoire sacré <strong>de</strong>s drui<strong>de</strong>s (i11 Ix’ siècle, Laon,<br />
1994,217 p.<br />
Georges Dumas, (< L‘état démographique et économique en 1698 <strong>de</strong> la par-<br />
tie <strong>de</strong> la généralité-intendance <strong>de</strong> Soissons qui a formé le département <strong>de</strong><br />
l’Aisne D, Mémoires <strong>de</strong> la Fédération <strong>de</strong>s sociétés d’histoire et d’archéologie <strong>de</strong><br />
l’Aisne, t. IX, 1963, p. 56-70.<br />
Les noms d’auteur sont en bas <strong>de</strong> casse, sauf dans le cas oÙ la bibliographie<br />
est rassemblée en une annexe en fin d’article, cas oÙ l’on adopte la présentation<br />
DUMAS (Georges). Le prénom est développé lorsque l’auteur est cité pour<br />
la première fois ; il est abrégé dès la secon<strong>de</strong> citation. On ne redouble pas les<br />
lettres pour marquer la pluralité (p. 56-70 et non pp. 56-70). Les mentions<br />
e voir D ou cf sont le plus souvent inutiles ; <strong>de</strong> m¿?me, (< dans >> ou in (sauf dans<br />
le cas <strong>de</strong> toniaisons très complexes).<br />
Les normes <strong>de</strong> publications <strong>de</strong> la revue sont, en tout point, conformes aux<br />
usages typographiques <strong>de</strong> I’lmpritnerie nationale. Les ponctuations simples<br />
(point et virgule) suivent directement le mot qui précè<strong>de</strong> et sont suivies d’un<br />
espace. Les ponctuations doubles (<strong>de</strong>ux points, point virgule, point d’interroga-<br />
tion, point d’exclamation) sont précédées et suivies d’un espace. On mettra un<br />
espace à l’extérieur <strong>de</strong>s parenthèses et crochets, mais pas à l’intérieur.<br />
Dans le corps du texte, les auteurs veilleront à ne pas faire un emploi abu-<br />
sif <strong>de</strong>s majuscules : les noins <strong>de</strong>s mois, <strong>de</strong>s jours, <strong>de</strong>s points cardinaux sont en<br />
23 1
232<br />
minuscules. Les noms <strong>de</strong> lieux et <strong>de</strong> personnes <strong>de</strong>meurent en bas <strong>de</strong> casse. Les<br />
adjectifs ne prennent jamais <strong>de</strong> majuscules : l’Assemblée nationale, l’Académie<br />
française, la Société générale. On évitera l’usage <strong>de</strong>s abréviations : saint est tou-<br />
jours écrit en toutes lettres ; on écrit saint Jean lorsqu’il s’agit du saint lui-même,<br />
et Saint-Jean lorsqu’il s’agit d’une église. Les titres d’euvres et journaux cités<br />
dans le texte sont en italiques bas <strong>de</strong> casse. Un nom propre lorsqu’il est employé<br />
en nom <strong>de</strong> lieu (rue, place . . .) s’écrit avec un tiret : place Victor-Hugo. Les siècles<br />
s’indiquent <strong>de</strong> la manière suivante : XV‘ siècle, XVIII‘-XIX‘ siècles. Les inter-<br />
valles <strong>de</strong> dates sont présentés comme suit : 1789-1812 (avec un tiret, sans<br />
espace).<br />
On évitera la multiplicité <strong>de</strong>s paragraphes : les titres <strong>de</strong>s parties éventuelles<br />
sont en bas <strong>de</strong> casse gras centrés ; les titres <strong>de</strong>s paragraphes en bas <strong>de</strong> casse gras<br />
ou italique en fer à gauche.<br />
Le style est évi<strong>de</strong>minent libre. En revanche, on veillera au respect <strong>de</strong><br />
quelques règles particulièrement importantes pour un article d’histoire. Le futur<br />
est à bannir dans presque tous les cas. Afin d’éviter les difficultés <strong>de</strong> la concor-<br />
dance <strong>de</strong>s temps, le présent est souvent à conseiller. L‘emploi <strong>de</strong>s parenthèses<br />
dans le corps du texte doit être limité. On prendra gar<strong>de</strong> à ne pas faire commen-<br />
cer une partie par une tournure grammaticale mise pour son titre. On évitera<br />
l’abus <strong>de</strong>s points <strong>de</strong> suspension.<br />
Si cela est nécessaire, les auteurs font une proposition d’iconographie.<br />
L‘iconographie doit être étroitement liée au texte, sous la forme <strong>de</strong> références<br />
dans ce <strong>de</strong>rnier. Leu légen<strong>de</strong>s proposées doivent être précises : type <strong>de</strong> support<br />
(photographie, carte postale, lithographie, aquarelle sur papier, huile sur toile,<br />
etc.) titre, date, lieu <strong>de</strong> conservation, cote éventuelle, crédit photographique. Les<br />
auteurs sont invités à fournir <strong>de</strong>s photographies <strong>de</strong> bonne qualité, 2 l’exclusion <strong>de</strong><br />
photocopies.<br />
Achevé d’iinprinier par Triangle ßlcu - 59600 Maubeuge<br />
DCpAt ICgd : 4 trimestre 2001
Avant-propos<br />
Claudine VIDAL<br />
La Socidt6 acaddmique <strong>de</strong> Saint-Quentin<br />
Monique S&ERIN, André TRIOUX<br />
Jean HCd, un drudit saint-quentinois d’adoption (1796-1865)<br />
Monique S&ERIN<br />
Bernard Ancien, 60 ans <strong>de</strong> recherche<br />
Denis ROLLAND<br />
Saint-Marc Girardin, portrait d’un notable du XIX” si5cle<br />
Julien SAPORI<br />
Regard historiographique sur l’oeuvre <strong>de</strong> Jehan <strong>de</strong> Hennezel ( 1876- 1956)<br />
Bruno MAËS<br />
Madame Martinet. Suzanne Groulard-Martinet (1910-1998)<br />
Jacqueline DMSZ<br />
La Société historique et archéologique <strong>de</strong> Château-Thierry<br />
Tony LEGENDRE<br />
Historiographie <strong>de</strong> I’archdologie il Château-Thierry<br />
ou naissance d’une archdologie urbaine entre 1864 et 2000<br />
le rôle <strong>de</strong> la Sociétd<br />
François BLARY<br />
Les historiens du dimanche. Milieu érudit et socidté savante, 1837-1973<br />
Claudine VIDAL, Alain BRUNET<br />
CAISNE<br />
De l’imaginaire <strong>de</strong>s historiens locaux B l’imaginaire<br />
<strong>de</strong> François I” et d’Henri II :<br />
les sculptures scandaleuses du château <strong>de</strong> Villers-Cotterêts<br />
Érie THIERRY<br />
120 F - 18,29 4<br />
ISSN 0248-1535