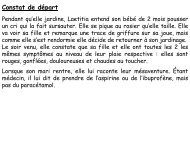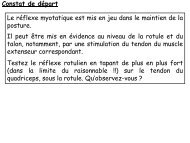Diaporama TP1 - Lycée Van Dongen
Diaporama TP1 - Lycée Van Dongen
Diaporama TP1 - Lycée Van Dongen
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Biologie végétale<br />
<strong>TP1</strong> : SÉLECTION ET DOMESTICATION DES<br />
PLANTES D’INTÉRÊT
Constat de départ<br />
Des études récentes, essentiellement génétiques et cytogénétiques, ont permis d'établir une classification des blés<br />
actuels et de leurs ancêtres et une nomenclature claire des différentes espèces botaniques.<br />
À notre époque, on trouve du blé sauvage et du blé cultivé. La répartition géographique des espèces sauvages de blé<br />
se limite au Bassin méditerranéen (au Moyen-Orient).<br />
La différence essentielle entre les blés sauvages et les blés cultivés est qu'à maturité, les épillets composant les<br />
épis des variétés sauvages tombent spontanément au sol après désarticulation de l'épi. Au sol, sous l'effet de<br />
l'humidité, les grains contenus dans ces épillets germent. On ne peut donc les utiliser pour les conserver et en faire<br />
de la farine.<br />
Les premiers cultivateurs ont sélectionné des mutants dont les épis ne se désarticulent pas spontanément (-9 500<br />
ans environ). Les grains ne tombent pas au sol ce qui permet de les récolter, de les conserver et d'en faire de la<br />
farine.<br />
Ces blés mutants ne sont plus capables de survivre et de se multiplier spontanément, et pour avoir une nouvelle<br />
récolte, l'homme doit intervenir en semant lui-même une partie des grains qu'il a récoltés.<br />
Dans le tableau de classification des blés, les études génétiques et cytogénétiques montrent que le blé nu dur,<br />
Triticum turgidum variété durum dérive du blé vêtu T. turgidum var. dicoccum, alors que le Τ. aestivum var.<br />
aestivum, blé nu tendre, dérive du blé vêtu, T. aestivum var. spelta.<br />
Des études cytogénétiques ont montré que les blés hexaploïdes dérivaient des blés tétraploïdes qui, eux-mêmes,<br />
dérivaient des blés diploïdes.<br />
Blé<br />
sauvage Vêtu<br />
Blé<br />
cultivé<br />
Vêtu<br />
Nu<br />
Diploïde Tétraploïde Hexaploïde<br />
T. monococcum var. T. turgidum var. Aucune espèce<br />
boeoticum<br />
dicoccoïdes<br />
connue<br />
T. monococcum var. T. turgidum T. turgidum var.<br />
monococcum var.dicoccum<br />
spelta<br />
Engrain<br />
Amidonnier<br />
T. turgidum var.<br />
Grand épeautre<br />
durum<br />
Blé dur<br />
T. turgidum var.<br />
turgidum<br />
Blé Poulard<br />
T. aestivum var.<br />
aestivum<br />
Blé tendre<br />
Source : « Le blé dans l'Egypte ancienne. Étude botanique liée à la terminologie utilisée dans les scènes agricoles et dans les textes<br />
religieux. » Mémoire présenté à l'École des Langues Orientales Anciennes (Institut catholique de Paris). Septembre 1990.
Acquis :<br />
Les cultures végétales se font dans des agrosystèmes sous le contrôle de<br />
l’Homme<br />
La biodiversité évolue au cours du temps, notamment par l’apparition de<br />
nouvelles espèces<br />
L’apparition de nouvelles espèces se fait toujours à partir d’espèces<br />
préexistantes par spéciation<br />
La diversification du vivant se fait, notamment, grâce à des mécanismes<br />
génétiques divers<br />
Observations :<br />
L’homme a sélectionné, il y a près de 10 000 ans, des caractères spécifiques et<br />
intéressants du blé sauvage pour le cultiver<br />
Cette sélection s’est traduite par une diversification des "blés" et une<br />
complexification de leur génome<br />
Problème : Comment la sélection empirique des plantes<br />
cultivées par l’Homme a-t-elle conduit à une complexification<br />
des génomes à l’origine d’une augmentation de la<br />
biodiversité végétale ?
Les blés cultivés, actuels,<br />
ont des caractéristiques<br />
proches d’espèces sauvages<br />
telles que l’amidonnier<br />
ou l’engrain<br />
Ces espèces sauvages<br />
proches des blés cultivés<br />
se situent dans des régions<br />
où l’on retrouve archéologiquement<br />
les plus anciens<br />
grains de blé connus
On peut donc supposer :<br />
- Que les blés actuels sont apparentés aux espèces sauvages<br />
- Que les blés actuels ont été domestiqués, en premier lieu, dans les<br />
régions où l’on trouve ces espèces sauvages (foyers de domestication)<br />
Les caractères des espèces<br />
sauvages favorisent leur survie<br />
en milieu naturel (protection des<br />
grains, bonne dissémination et<br />
adaptation en fonction des<br />
conditions)<br />
En revanche, la culture des blés<br />
est facilitée si ces caractères<br />
sont exactement inversés<br />
Les caractères favorables aux espèces cultivées ne sont pas favorables à<br />
leur vie en milieu naturel, ce qui explique leur incapacité à y survivre
Les espèces cultivées ont été sélectionnées artificiellement à partir d’espèces<br />
sauvages dans différentes régions en fonction de l’espèce concernée<br />
Cette sélection artificielle est appelée « processus de domestication » et les<br />
régions de sélection « foyers de domestication »<br />
Les caractères recherchés par l’Homme lors de cette sélection sont ceux qui<br />
facilitent la culture, les récolte et l’utilisation des espèces cultivées<br />
BILAN<br />
La sélection exercée par l'Homme sur les plantes cultivées<br />
a souvent retenu (volontairement ou empiriquement) des<br />
caractéristiques génétiques différentes de celles qui sont<br />
favorables pour les plantes sauvages.
Mécanismes de diversification des génomes<br />
Spartina maritima Spartina alterniflora Spartina x townsendii Spartina anglica<br />
/<br />
2n = 60<br />
2n = 62<br />
2n = 61<br />
2n = 122<br />
L’ordre d’apparition des différentes spartines et leur nombre respectif de<br />
chromosomes permettent de déduire que :<br />
- Il y a eu croisement entre Spartina maritima et Spartina alterniflora (espèces<br />
parentales)<br />
- On a alors obtenu Spartina x townsendii (hybride)<br />
- Puis il y a eu doublement de la quantité des chromosomes de Spartina x<br />
townsendii à l’origine de l’apparition de Spartina anglica<br />
Comment se passe ce doublement à l’origine d’une nouvelle espèce?
Deux individus appartenant à 2<br />
espèces différentes peuvent<br />
s’hybrider<br />
Le descendant hérite donc d’un lot<br />
de chromosome de chaque parent<br />
Ces chromosomes provenant de deux<br />
espèces différentes ils ne sont pas<br />
homologues, l’appariement pendant la<br />
méiose n’est pas possible (les<br />
hybrides sont en général stériles)<br />
Un événement accidentel de doublement des chromosomes peut suivre l’hybridation<br />
chaque chromosome retrouve son homologue méiose possible fertilité<br />
rétablie<br />
Ces polyploïdes ont des génomes différents de ceux des espèces parentales<br />
ils expriment des caractères différents<br />
Une espèce polyploïde se caractérise par plus de 2 jeux complets de chromosomes :<br />
- Si ils ont pour origine la même espèce : autopolyploïdie<br />
- Si ils ont pour origine des espèces différentes : allopolyploïdie<br />
Dans le monde végétal, les événements de polyploïdisation ont été relativement<br />
fréquents<br />
70 % des plantes à fleurs (angiospermes) ont eu au moins un événement de<br />
polyploïdisation dans leur histoire évolutive
BILAN<br />
Les hybridations suivies de polyploïdisation sont un des<br />
mécanismes de diversification des génomes.
Génome 4n = 28<br />
Génome 4n = 28<br />
Génome 4n = 28 Génome 6n = 42<br />
Dans l’histoire évolutive<br />
du blé, on constate qu’il y<br />
a plusieurs événements<br />
d’hybridation qui ont été<br />
suivis de doublement du<br />
nombre de chromosomes,<br />
ce qui a aboutit à<br />
l’obtention de nouvelles «<br />
espèces » de blés
La sélection phénotypique<br />
correspond<br />
à la sélection d’un<br />
caractère d’intérêt,<br />
ici le poids des<br />
graines récoltées<br />
On constate que le poids du grain est un caractère héréditaire car les graines<br />
récoltées l’année n+1 à partir des semences sélectionnées l’année n ont un poids plus<br />
important<br />
Pour pouvoir être sélectionné, ce caractère doit être visible et pouvoir être<br />
transmis à la descendance (il doit donc être codé génétiquement)<br />
Des caractères intéressants sont identifiés par l’homme qui sélectionnent les<br />
graines les possédant : il modifie, de générations en générations, les<br />
caractéristiques des espèces cultivées qui présentent finalement un ensemble de<br />
caractères utiles à l’homme<br />
L’ensemble de ces caractères constitue le syndrome de domestication :<br />
processus de sélection artificielle
BILAN<br />
Les techniques de croisement permettent d'obtenir de<br />
nouvelles plantes qui n'existaient pas dans la nature<br />
(nouvelles variétés, hybrides, etc.).
Les différentes variétés de choux existant actuellement sont issues de processus<br />
de domestication ayant eu lieu dans différentes régions (foyers de domestication)<br />
Mais toutes ces nouvelles variétés de choux ont été obtenues à partir de la même<br />
espèce sauvage, présente dans les 4 foyers de domestication<br />
Comment une même espèce peut-elle être à l’origine de 4 nouvelles variétés ?
Les choux de Bruxelles, le<br />
chou-fleur, le chou vert et<br />
le Brocoli sont tous issus<br />
de la même espèce<br />
sauvage, Brassica oleracea<br />
Chacune de ces variétés<br />
de chou correspond à une<br />
partie différente de<br />
l’espèce sauvage<br />
Dans le cas du chou, la sélection a porté sur une hypertrophie de 4 régions de<br />
l’espèce sauvage :<br />
- De l’inflorescence pour le brocoli<br />
- Des bourgeons latéraux (axillaires) pour les choux de Bruxelles<br />
- Des bourgeons terminaux pour le chou vert<br />
- Des fleurs et tiges pour le chou-fleur<br />
Parallèlement, une pratique culturale spécifique et des qualités nutritionnelles<br />
spécifiques ont été sélectionnées
A partir d’espèces déjà domestiquées il est possible de poursuivre une sélection<br />
artificielle, d’origine humaine<br />
Une même espèce domestiquée peut ainsi présenter différentes variétés, différant<br />
par leur pratique culturale, leurs qualités nutritionnelles …<br />
Ces différentes variétés sont le produit d’une variété domestiquée plus ancienne,<br />
elle-même produit d’une sélection agricole localisée<br />
BILAN<br />
Une même espèce cultivée comporte souvent plusieurs<br />
variétés sélectionnées selon des critères différents ; c'est<br />
une forme de biodiversité.
Mécanismes génétiques à la<br />
base des sélections variétales<br />
Dans cet exemple, à<br />
chaque génération on<br />
croise le résultat de la<br />
génération précédente<br />
présentant une résistance<br />
à la tavelure avec<br />
la variété « élite »,<br />
intéressante pour sa<br />
productivité, ses qualités<br />
gustatives …<br />
En recherchant le<br />
génotype de chaque<br />
génération, on remarque<br />
que la sélection induit un<br />
génotype caractéristique<br />
de la variété « élite »<br />
avec cependant une<br />
homozygotie pour le gène<br />
de résistance à la<br />
tavelure
SÉLECTION<br />
GÉNÉTIQUE<br />
(production<br />
de nouvelles<br />
espèces<br />
végétales par<br />
hybridation<br />
d’espèces<br />
parentales,<br />
stables)<br />
POINTS POSITIFS POINTS NÉGATIFS<br />
- Homogénéité de la F1<br />
- Apparition de nouvelles variétés<br />
végétales hybrides ayant uniquement<br />
les caractères d’intérêt<br />
des variétés parentales = vigueur<br />
hybride<br />
Meilleure performance des<br />
variétés hybrides<br />
Meilleur rendement des<br />
variétés hybrides<br />
- Hybrides non stables<br />
Achat des semences de ces<br />
hybrides chaque année auprès des<br />
industries agro-alimentaires<br />
Coût important pour l’agriculteur<br />
- Variétés souvent plus demandeuses<br />
en eau<br />
Augmentation des irrigations<br />
Fort prélèvement sur les<br />
ressources en eau douce de la<br />
planète<br />
- Variétés souvent moins résistantes<br />
naturellement malgré leurs performances<br />
Augmentation de l’utilisation des<br />
produits phytosanitaires<br />
Augmentation des risques de<br />
pollutions<br />
- Variétés cultivées en monoculture<br />
Diminution de la biodiversité<br />
Et un documentaire intéressant : http://www.youtube.com/watch?v=-qX0KHYBum8