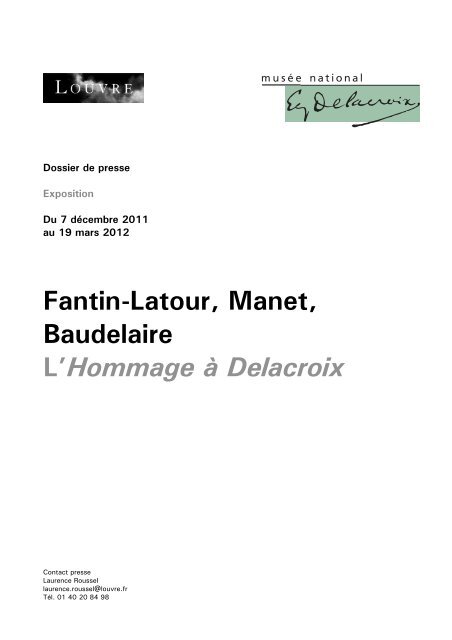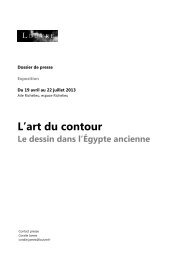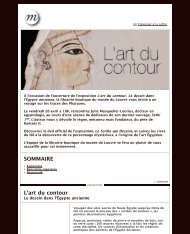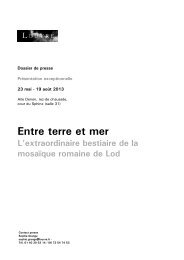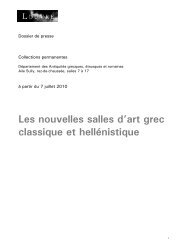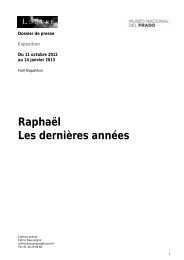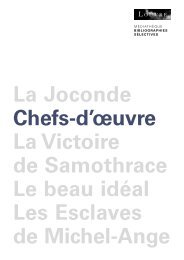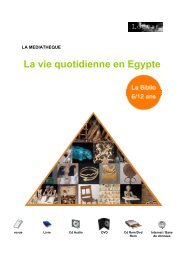Télécharger le dossier de presse > pdf - 0.99 Mo - Musée du Louvre
Télécharger le dossier de presse > pdf - 0.99 Mo - Musée du Louvre
Télécharger le dossier de presse > pdf - 0.99 Mo - Musée du Louvre
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Dossier <strong>de</strong> <strong>presse</strong><br />
Exposition<br />
Du 7 décembre 2011<br />
au 19 mars 2012<br />
Fantin-Latour, Manet,<br />
Bau<strong>de</strong>laire<br />
L’Hommage à Delacroix<br />
Contact <strong>presse</strong><br />
Laurence Roussel<br />
laurence.roussel@louvre.fr<br />
Tél. 01 40 20 84 98
Sommaire<br />
Communiqué <strong>de</strong> <strong>presse</strong> page 3<br />
Préface par Henri Loyrette,<br />
Prési<strong>de</strong>nt directeur <strong>du</strong> musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong> page 5<br />
Parcours <strong>de</strong> l’exposition page 7<br />
Poème d’inauguration pour <strong>le</strong> monument d’hommage à Delacroix page 13<br />
Publications page 14<br />
L’histoire <strong>du</strong> musée Eugène-Delacroix page 15<br />
Visuels disponib<strong>le</strong>s pour la <strong>presse</strong> page 17<br />
2
Communiqué <strong>de</strong> <strong>presse</strong><br />
Exposition<br />
7 décembre 2011<br />
19 mars 2012<br />
<strong>Musée</strong> national<br />
Eugène-Delacroix<br />
Henri Fantin-Latour, (1836-1904)<br />
Hommage à Delacroix,<br />
musée d’Orsay<br />
© RMN (<strong>Musée</strong> d'Orsay) /Hervé Lewandowski<br />
Avec <strong>le</strong>s prêts exceptionnels <strong>du</strong><br />
musée d’Orsay<br />
Informations pratiques :<br />
Exposition ouverte tous <strong>le</strong>s jours, sauf<br />
<strong>le</strong> mardi, <strong>de</strong> 9h30 à 17h (fermeture <strong>de</strong>s<br />
caisses à 16h30).<br />
<strong>Musée</strong> national Eugène-Delacroix<br />
6, rue <strong>de</strong> Fürstenberg / 75006 Paris<br />
01 44 41 86 50<br />
www.musee-<strong>de</strong>lacroix.fr<br />
Tarif : 7 €<br />
Gratuit pour <strong>le</strong>s moins <strong>de</strong> 26 ans<br />
ressortissants <strong>de</strong> l’Union européenne et<br />
pour tous <strong>le</strong> 1 er dimanche <strong>de</strong> chaque<br />
mois.<br />
Accès gratuit avec <strong>le</strong> bil<strong>le</strong>t d’entrée <strong>du</strong><br />
musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong> <strong>le</strong> même jour.<br />
Fantin-Latour, Manet,<br />
Bau<strong>de</strong>laire<br />
L’Hommage à Delacroix<br />
Si 1863 est l’année <strong>du</strong> scanda<strong>le</strong> <strong>du</strong> Déjeuner sur l’herbe <strong>de</strong><br />
Manet au Salon <strong>de</strong>s Refusés, c’est aussi cel<strong>le</strong> <strong>de</strong> la mort<br />
d’Eugène Delacroix dans son appartement <strong>de</strong> la place <strong>de</strong><br />
Fürstenberg. Choqué par la tié<strong>de</strong>ur <strong>de</strong>s hommages officiels<br />
ren<strong>du</strong>s à l’artiste lors <strong>de</strong> sa disparition, Fantin-Latour,<br />
encouragé par Manet et Bau<strong>de</strong>laire, se lança dans la<br />
réalisation <strong>de</strong> son fameux Hommage à Delacroix pour <strong>le</strong><br />
Salon suivant : gran<strong>de</strong> toi<strong>le</strong>-manifeste qui rassemblait une<br />
nouvel<strong>le</strong> génération d’artistes novateurs et <strong>de</strong> critiques<br />
comme Bau<strong>de</strong>laire et Champf<strong>le</strong>ury, autour <strong>de</strong> l’austère<br />
effigie <strong>du</strong> maître disparu. L’exposition <strong>du</strong> musée Delacroix<br />
retrace l’aventure <strong>de</strong> cette toi<strong>le</strong>, sa conception, <strong>le</strong>s variantes,<br />
<strong>le</strong>s élus et <strong>le</strong>s exclus parmi <strong>le</strong>s figurants. Grâce aux prêts<br />
exceptionnels <strong>de</strong> nombreuses institutions françaises et<br />
étrangères, el<strong>le</strong> relate cette fraternité artistique à travers <strong>le</strong>s<br />
œuvres croisées <strong>de</strong>s artistes en présence et cel<strong>le</strong>s qui <strong>le</strong>s<br />
rattachent à l’héritage <strong>de</strong> Delacroix.<br />
La réception <strong>du</strong> tab<strong>le</strong>au par la critique <strong>de</strong> l’époque fut assez<br />
vive : on dénonça une captation d’héritage, usurpé par une<br />
ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> Réalistes. L’admiration <strong>de</strong> la plupart pour l’œuvre <strong>de</strong><br />
Delacroix est pourtant indéniab<strong>le</strong>, même si l’exposition explore<br />
<strong>le</strong>s compromis et <strong>le</strong>s alliances <strong>de</strong> circonstance : une histoire qui<br />
commence par une camara<strong>de</strong>rie d’atelier et <strong>de</strong> café d’artistes –<br />
la « Société <strong>de</strong>s Trois » formée par Fantin-Latour, Legros et<br />
Whist<strong>le</strong>r – et s’achève bien après l’exposition <strong>du</strong> tab<strong>le</strong>au en<br />
1864. Mais en 1889, lorsque Fantin-Latour brosse une nouvel<strong>le</strong><br />
allégorie à la gloire <strong>de</strong> Delacroix, Immortalité (musée <strong>de</strong><br />
Cardiff), <strong>le</strong>s temps ont changé. L’artiste s’est détaché <strong>du</strong> courant<br />
Impressionniste et il choisit <strong>de</strong> ne représenter cette fois qu’une<br />
femme évanescente semant <strong>de</strong>s péta<strong>le</strong>s <strong>de</strong> f<strong>le</strong>urs sur <strong>le</strong> tombeau<br />
<strong>du</strong> maître. L’exposition se conclut sur l’hommage officiel confié<br />
fina<strong>le</strong>ment au sculpteur Dalou dont <strong>le</strong> grand monument <strong>de</strong><br />
bronze est inauguré officiel<strong>le</strong>ment en 1889, dans <strong>le</strong>s jardins <strong>du</strong><br />
Luxembourg.<br />
Commissaire <strong>de</strong> l’exposition :<br />
Christophe Leribault, directeur <strong>du</strong> musée national Eugène-<br />
Delacroix et adjoint au directeur <strong>du</strong> département <strong>de</strong>s Arts<br />
graphiques <strong>du</strong> musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>.<br />
Publication :<br />
Catalogue <strong>de</strong> l’exposition, sous la direction <strong>de</strong> Christophe<br />
Leribault. Textes <strong>de</strong> Stéphane Guégan, Christophe Leribault,<br />
Marie-Pierre Salé, Amélie Simier. Coédition Le Passage /<br />
musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong> Editions. 168 p., 104 ill., 28 €.<br />
Direction <strong>de</strong> la communication Contact <strong>presse</strong><br />
Anne-Laure Beatrix Laurence Roussel<br />
laurence.roussel@louvre.fr - Tél. : 01 40 20 84 98 / Fax : 54 52<br />
3
AUTOUR DE L’EXPOSITION<br />
A l’auditorium <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong><br />
Présentation <strong>de</strong> l’exposition<br />
Mercredi 25 janvier à 12h30<br />
Par Christophe Leribault, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong> et musée national<br />
Eugène-Delacroix.<br />
Au musée Delacroix<br />
Concert : Autour <strong>du</strong> piano<br />
Vendredi 10 février 2012 à 20 h,<br />
Ouverture <strong>de</strong>s portes dès 19 h 30<br />
<strong>Musée</strong> Eugène-Delacroix,<br />
6 rue <strong>de</strong> Fürstenberg,<br />
75006 Paris<br />
Réservation obligatoire : 01 44 41 86 50<br />
Dans <strong>le</strong> cadre <strong>de</strong> l’exposition, récital <strong>de</strong> la pianiste Alice A<strong>de</strong>r<br />
autour <strong>de</strong>s compositeurs <strong>du</strong> temps, dans l’atelier <strong>de</strong> Delacroix.<br />
Œuvres <strong>de</strong> Johannes Brahms, Gabriel Fauré, César Franck,<br />
Déodat <strong>de</strong> Séverac, Clau<strong>de</strong> Debussy, Emmanuel Chabrier.<br />
4
Le titre <strong>de</strong> la toi<strong>le</strong> <strong>de</strong> Fantin-Latour, Hommage à Delacroix, sonne comme celui d’une exposition que <strong>le</strong><br />
musée dédié au culte <strong>du</strong> vieux maître aurait pu organiser, avec un brin <strong>de</strong> so<strong>le</strong>nnité, à l’occasion d’un<br />
anniversaire – celui, par exemp<strong>le</strong>, <strong>de</strong> la disparition <strong>de</strong> l’artiste dans ses murs mêmes, en 1863. Jamais pourtant<br />
ce tab<strong>le</strong>au-phare n’y avait été présenté. L’œuvre fait partie <strong>de</strong>s f<strong>le</strong>urons, avec <strong>le</strong> Déjeuner sur l’herbe <strong>de</strong><br />
Manet, <strong>de</strong> la mythique donation d’Étienne <strong>Mo</strong>reau-Nélaton au <strong>Louvre</strong>, dont on sait qu’el<strong>le</strong> exclut <strong>le</strong>s prêts à<br />
l’extérieur <strong>du</strong> musée. La création <strong>du</strong> musée d’Orsay a toutefois con<strong>du</strong>it au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la Seine certaines œuvres <strong>de</strong><br />
la col<strong>le</strong>ction – certaines seu<strong>le</strong>ment, <strong>le</strong>s Delacroix et <strong>le</strong>s Corot étant restés au <strong>Louvre</strong>. Le rattachement <strong>du</strong> musée<br />
Delacroix au <strong>Louvre</strong> en 2004 autorise un pareil changement <strong>de</strong> rive. Mais avant même ce transfert<br />
institutionnel, dès 1948, <strong>le</strong>s <strong>de</strong>scendants <strong>de</strong> <strong>Mo</strong>reau-Nélaton avaient accepté que <strong>de</strong>s prêts importants soient<br />
accordés au musée Delacroix, eu égard à l’admiration <strong>du</strong> donateur pour un artiste dont il avait fait un <strong>de</strong> ses<br />
sujets <strong>de</strong> recherches favoris comme historien <strong>de</strong> l’art. Dans son étu<strong>de</strong> en <strong>de</strong>ux tomes, Delacroix raconté par<br />
lui-même (1916), il repro<strong>du</strong>isait d’ail<strong>le</strong>urs la toi<strong>le</strong> <strong>de</strong> Fantin-Latour, alors encore en sa possession, ainsi que <strong>le</strong><br />
monument <strong>de</strong> Ju<strong>le</strong>s Dalou, et <strong>le</strong>ur consacrait quelques pages qui concluent son grand ouvrage. Hommage à<br />
Delacroix et à Fantin-Latour, l’exposition se doit donc <strong>de</strong> l’être à Étienne <strong>Mo</strong>reau-Nélaton, mais aussi à<br />
Madame Fantin-Latour, Victoria Dubourg, el<strong>le</strong>-même peintre ta<strong>le</strong>ntueuse, épouse attentive et veuve<br />
scrupu<strong>le</strong>use, qui classa l’atelier, rassembla <strong>le</strong>s documents, recopia <strong>le</strong>s manuscrits, en répartit <strong>le</strong>s versions pour<br />
en assurer la survie et offrit au <strong>Louvre</strong> une série d’albums <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssins dont sont tirées ici, pour la première fois,<br />
toutes <strong>le</strong>s étu<strong>de</strong>s préparatoires au tab<strong>le</strong>au.<br />
Cet assaut <strong>de</strong> pensées respectueuses envers <strong>le</strong>s artistes et <strong>le</strong>s donateurs ne doit pourtant pas cacher une autre<br />
réalité : l’événement qu’est la présentation <strong>de</strong> ce tab<strong>le</strong>au dans l’atelier même <strong>de</strong> Delacroix ne se teinterait-il pas<br />
<strong>de</strong>s cou<strong>le</strong>urs <strong>du</strong> sacrilège ? Derrière cet hommage à la fois austère et éclatant d’une nouvel<strong>le</strong> génération envers<br />
ce grand <strong>de</strong>vancier, <strong>le</strong> soupçon a toujours plané qu’il y avait là autant d’autopromotion que <strong>de</strong> filiation directe<br />
avec <strong>le</strong> vieux lion solitaire <strong>de</strong> la rue <strong>de</strong> Fürstenberg. Laissons aux auteurs <strong>du</strong> catalogue <strong>le</strong> soin <strong>de</strong> démê<strong>le</strong>r<br />
l’écheveau <strong>de</strong> la genèse <strong>du</strong> tab<strong>le</strong>au, la question <strong>de</strong> sa réception critique et, au-<strong>de</strong>là, <strong>le</strong> roman vrai <strong>de</strong>s relations<br />
croisées entre <strong>le</strong>s protagonistes <strong>de</strong> la toi<strong>le</strong>. Certains d’entre eux sont tel<strong>le</strong>ment célèbres et étudiés, <strong>de</strong> Manet à<br />
Bau<strong>de</strong>laire, qu’il n’était guère nécessaire d’y revenir en détail. D’autres restent si méconnus que montrer <strong>le</strong>urs<br />
œuvres, comme cel<strong>le</strong>s <strong>de</strong> l’attachant Albert <strong>de</strong> Bal<strong>le</strong>roy, est déjà l’occasion d’heureuses redécouvertes. Mais <strong>le</strong><br />
mérite <strong>du</strong> catalogue est aussi <strong>de</strong> mettre en va<strong>le</strong>ur <strong>le</strong>s relations intimes entre trois <strong>de</strong>s personnages <strong>le</strong>s plus liés<br />
entre eux et jusqu’ici traités plus indivi<strong>du</strong>el<strong>le</strong>ment qu’en groupe : Whist<strong>le</strong>r, Legros et Fantin-Latour, cette<br />
ban<strong>de</strong> <strong>de</strong>s trois <strong>du</strong> Paris-Londres <strong>de</strong>s années 1860.<br />
De ces divers éclairages, il ressort que l’influence <strong>de</strong> Delacroix fut cel<strong>le</strong> d’un catalyseur d’énergies nouvel<strong>le</strong>s<br />
en mal <strong>de</strong> cohésion et que l’artiste offrait à cette génération un modè<strong>le</strong> <strong>de</strong> liberté plus précieux encore que <strong>de</strong>s<br />
recettes pictura<strong>le</strong>s. Plutôt que d’alimenter contre <strong>le</strong>s faits <strong>le</strong> vieux mythe <strong>de</strong> Delacroix père <strong>de</strong><br />
l’impressionnisme, il faut porter au crédit <strong>du</strong> musée qu’il a su illustrer, dans une perspective plus juste et plus<br />
origina<strong>le</strong>, la force d’une œuvre qui transcen<strong>de</strong> <strong>le</strong>s sty<strong>le</strong>s et qui a toujours su susciter l’admiration <strong>de</strong>s plus<br />
grands artistes, <strong>de</strong> Van Gogh à Picasso, <strong>de</strong> Cézanne – dont on regrettera <strong>de</strong> ne pas avoir pu exposer<br />
L’Apothéose <strong>de</strong> Delacroix <strong>du</strong> musée Granet – à Maurice Denis, <strong>le</strong> fondateur <strong>du</strong> musée Delacroix. Ce <strong>de</strong>rnier<br />
n’avait-il pas su réunir, parmi <strong>le</strong>s premiers parrains <strong>de</strong> la Société <strong>de</strong>s Amis au début <strong>de</strong>s années 1930, Matisse,<br />
Signac, Bonnard et Vuillard ?<br />
Ce texte est extrait <strong>du</strong> catalogue <strong>de</strong> l’exposition.<br />
Préface<br />
Par Henri Loyrette,<br />
prési<strong>de</strong>nt-directeur <strong>du</strong> musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong><br />
5
Quatre-vingts ans plus tard, en 2007, l’actuel<strong>le</strong> Société <strong>de</strong>s Amis <strong>du</strong> musée Delacroix offrait une touchante<br />
esquisse peinte pour <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au <strong>de</strong> Fantin-Latour, acquisition qui fut à l’origine <strong>de</strong> ce projet exemplaire. On ne<br />
soulignera jamais assez <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> actif <strong>de</strong> cette Société pour la vie <strong>de</strong> l’établissement. Cette exposition n’aurait pu<br />
être non plus organisée sans <strong>le</strong> concours exceptionnel <strong>du</strong> musée d’Orsay. Son prési<strong>de</strong>nt, Guy Cogeval et ses<br />
collaborateurs ont accueilli avec enthousiasme ce projet et accordé d’emblée <strong>le</strong> prêt <strong>du</strong> tab<strong>le</strong>au <strong>de</strong> Fantin-<br />
Latour et <strong>de</strong>s nombreux <strong>de</strong>ssins, pour l’essentiel inédits, qui forment <strong>le</strong> cœur <strong>de</strong> l’accrochage. Aussi nous est-il<br />
vraiment agréab<strong>le</strong> <strong>de</strong> souligner cette collaboration entre <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ux établissements, tant pour <strong>le</strong>s prêts que pour<br />
<strong>le</strong>s contributions au catalogue. La Fondation Custodia, dirigée à présent par Ger Luijten, a su acquérir et<br />
continue à enrichir un fonds d’autographes <strong>de</strong> Fantin-Latour et <strong>de</strong> ses correspondants en tout point<br />
exceptionnel ; il est présenté à l’exposition par une sé<strong>le</strong>ction <strong>de</strong> pièces, mais nombre d’autres documents<br />
inédits ont nourri <strong>le</strong> catalogue. Le département <strong>de</strong>s Estampes et <strong>de</strong> la Photographie <strong>de</strong> la Bibliothèque nationa<strong>le</strong><br />
<strong>de</strong> France, en la personne <strong>de</strong> sa directrice, Sylvie Aubenas, a soutenu, comme à l’accoutumée, l’exposition par<br />
<strong>de</strong>s prêts capitaux. Autres institutions habituées à nos sollicitations, <strong>le</strong> musée <strong>du</strong> Petit Palais et <strong>le</strong> musée<br />
Carnava<strong>le</strong>t ont répon<strong>du</strong> à l’appel avec la même générosité. La Bibliothèque centra<strong>le</strong> et <strong>le</strong>s Archives <strong>de</strong>s<br />
<strong>Musée</strong>s <strong>de</strong> France ont permis éga<strong>le</strong>ment <strong>de</strong> partager avec <strong>le</strong>s visiteurs certaines découvertes documentaires qui<br />
font la richesse <strong>de</strong> cette présentation. Cette exposition ambitieuse a eu recours aussi à <strong>de</strong>s prêts internationaux :<br />
c’est la première fois que <strong>le</strong> Rijksmuseum d’Amsterdam, <strong>le</strong> National Museum Wa<strong>le</strong>s à Cardiff, <strong>le</strong> Museo<br />
Thyssen-Bornemisza <strong>de</strong> Madrid et <strong>le</strong> musée d’Art et d’Histoire <strong>de</strong> Neuchâtel ont accepté <strong>de</strong> se <strong>de</strong>ssaisir<br />
d’œuvres significatives en faveur <strong>du</strong> musée Delacroix. De même, <strong>le</strong>s musées <strong>de</strong>s Beaux-Arts <strong>de</strong> Bayeux, <strong>de</strong><br />
Bor<strong>de</strong>aux, <strong>de</strong> Grenob<strong>le</strong>, <strong>de</strong> Lil<strong>le</strong> et <strong>de</strong> Lyon, ainsi que <strong>le</strong> musée Fabre <strong>de</strong> <strong>Mo</strong>ntpellier nous ont accordé sans la<br />
moindre hésitation <strong>de</strong>s œuvres importantes <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur col<strong>le</strong>ction. La ga<strong>le</strong>rie Paul-Prouté et <strong>de</strong>s col<strong>le</strong>ctionneurs<br />
particuliers ont éga<strong>le</strong>ment répon<strong>du</strong> favorab<strong>le</strong>ment à nos <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s, notamment notre ami Kip Forbes,<br />
Chairman of the American Friends of the <strong>Louvre</strong>, et Madame Karen B. Cohen, gran<strong>de</strong> donatrice <strong>du</strong><br />
Metropolitan Museum <strong>de</strong> New York, dont <strong>le</strong> musée Delacroix, sa secon<strong>de</strong> maison, est fier <strong>du</strong> soutien attentif<br />
qu’el<strong>le</strong> lui apporte. Après <strong>le</strong> succès public remporté par <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ux précé<strong>de</strong>ntes expositions présentées dans<br />
l’atelier <strong>de</strong> Delacroix, c’est avec confiance que nous espérons que cette manifestation démontrera <strong>de</strong> nouveau<br />
que <strong>le</strong>s objectifs scientifiques exigeants impartis au musée sont bien la voie d’un développement exemplaire.<br />
6
Le parcours <strong>de</strong> l’exposition<br />
Textes <strong>de</strong>s panneaux didactiques <strong>de</strong> l’exposition<br />
Fantin-Latour, Manet, Bau<strong>de</strong>laire :<br />
l’Hommage à Delacroix<br />
1863 : l’année <strong>du</strong> scanda<strong>le</strong> <strong>du</strong> Déjeuner sur l’herbe <strong>de</strong> Manet est aussi cel<strong>le</strong> <strong>de</strong> la mort d’Eugène Delacroix<br />
dans son appartement <strong>de</strong> la rue <strong>de</strong> Fürstenberg. Choqué par la tié<strong>de</strong>ur <strong>de</strong>s hommages officiels ren<strong>du</strong>s à l’artiste<br />
lors <strong>de</strong> sa disparition, Fantin-Latour se lança dans la réalisation <strong>de</strong> son Hommage à Delacroix pour <strong>le</strong> Salon<br />
suivant : toi<strong>le</strong>-manifeste qui rassemblait une nouvel<strong>le</strong> génération d’artistes novateurs et <strong>de</strong> critiques, comme<br />
Bau<strong>de</strong>laire et Champf<strong>le</strong>ury, autour <strong>de</strong> l’austère effigie <strong>du</strong> maître disparu. Manet, Whist<strong>le</strong>r, Legros et <strong>le</strong>s autres<br />
n’étaient pourtant pas <strong>de</strong>s discip<strong>le</strong>s fidè<strong>le</strong>s, mais en se plaçant sous son égi<strong>de</strong>, ils revendiquaient une même<br />
liberté artistique face aux conventions.<br />
Grâce aux prêts exceptionnels <strong>du</strong> musée d’Orsay et <strong>de</strong> nombre d’institutions françaises et étrangères,<br />
l’exposition retrace l’aventure <strong>de</strong> cette toi<strong>le</strong>, sa conception et sa postérité, jusqu’à l’hommage officiel<br />
fina<strong>le</strong>ment confié au sculpteur Ju<strong>le</strong>s Dalou, dont <strong>le</strong> monument à Delacroix fut érigé dans <strong>le</strong>s jardins <strong>du</strong><br />
Luxembourg en 1890.<br />
Le parcours commence dans <strong>le</strong> salon et la pièce au fond à droite, puis se prolonge, via l’escalier <strong>du</strong> jardin, dans<br />
l’atelier où figure <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au <strong>de</strong> Fantin-Latour. Il s’achève par <strong>le</strong> retour dans l’appartement, dans la chambre <strong>de</strong><br />
Delacroix située à gauche <strong>du</strong> salon.<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Hommage à Delacroix, 1864<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
Dimensions : 160 cm × 250 cm<br />
Paris, musée d’Orsay<br />
RF 1664<br />
© RMN (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski<br />
7
I - Delacroix et <strong>le</strong>s <strong>Mo</strong><strong>de</strong>rnes<br />
L’effet imposant <strong>de</strong> l’Hommage à Delacroix, hérité <strong>de</strong>s grands portraits <strong>de</strong> corporations <strong>de</strong> l’ancienne<br />
Hollan<strong>de</strong>, a fait oublier <strong>le</strong> caractère paradoxal <strong>du</strong> tab<strong>le</strong>au. La toi<strong>le</strong> <strong>de</strong> Fantin-Latour, sans cesse repro<strong>du</strong>ite, est<br />
<strong>de</strong>venue la preuve <strong>de</strong> la filiation directe entre Delacroix et <strong>le</strong>s Impressionnistes – masquant, dans <strong>le</strong>s faits, <strong>le</strong><br />
peu d’estime <strong>du</strong> maître pour <strong>le</strong>s débuts <strong>de</strong> ses jeunes confrères. Quel<strong>le</strong> était la légitimité <strong>de</strong> ces dix hommes à<br />
se mettre ainsi en avant en se déclarant ses héritiers ?<br />
L’admiration réel<strong>le</strong> <strong>de</strong> la génération nouvel<strong>le</strong> pour <strong>le</strong> sty<strong>le</strong> sans compromis <strong>de</strong> Delacroix est attestée par <strong>le</strong>s<br />
copies auxquel<strong>le</strong>s Fantin-Latour, Manet ou Renoir s’adonnèrent dans <strong>le</strong>ur jeunesse d’après <strong>le</strong>s toi<strong>le</strong>s <strong>du</strong> vieux<br />
maître. Son coloris flamboyant et la liberté <strong>de</strong> sa touche semb<strong>le</strong>nt justifier cet ascendant <strong>de</strong> Delacroix sur <strong>le</strong>s<br />
futurs Impressionnistes, sentiment renforcé par certaines étu<strong>de</strong>s atmosphériques, marines ou ciels, où il explora<br />
avec hardiesse, dans <strong>le</strong>s années 1850, <strong>le</strong>s effets d’ombres colorées. Ces étu<strong>de</strong>s restèrent toutefois cachées dans<br />
l’atelier jusqu’à la dispersion <strong>de</strong> son contenu à l’hôtel Drouot en 1864, lors <strong>de</strong> ventes publiques qui firent<br />
sensation.<br />
Reste la bel<strong>le</strong> image qu’illustre ici la touchante vue <strong>de</strong> l’atelier par Frédéric Bazil<strong>le</strong>, situé au <strong>de</strong>rnier étage <strong>du</strong><br />
bâtiment où nous sommes. Depuis sa verrière, <strong>le</strong> jeune peintre, avec <strong>Mo</strong>net et ses autres amis, aurait épié avec<br />
enthousiasme <strong>le</strong>s cent pas <strong>du</strong> vieux lion dans <strong>le</strong> secret <strong>de</strong> son jardin et <strong>de</strong> son propre atelier. Peu importe que<br />
Bazil<strong>le</strong> n’ait emménagé ici qu’à la fin <strong>de</strong> 1864, après la mort <strong>de</strong> Delacroix : <strong>le</strong> ton y est. Le plus bel hommage<br />
est peut-être celui <strong>de</strong> Cézanne qui, vers la fin <strong>de</strong> sa vie, échangea auprès <strong>de</strong> son marchand Vollard un ensemb<strong>le</strong><br />
<strong>de</strong> ses œuvres pour pouvoir placer dans l’intimité <strong>de</strong> sa chambre à coucher à Aix-en-Provence, comme son<br />
plus beau trésor, <strong>le</strong> sp<strong>le</strong>ndi<strong>de</strong> Bouquet <strong>de</strong> Delacroix exposé ici-même.<br />
Frédéric Bazil<strong>le</strong> (1841-1870)<br />
L’Atelier <strong>de</strong> la rue Fürstenberg,<br />
1865-1866<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
Dimensions : 80 cm × 65 cm<br />
<strong>Mo</strong>ntpellier, musée Fabre<br />
8
II - Fantin-Latour et <strong>le</strong>s siens<br />
L’auteur <strong>de</strong> l’Hommage à Delacroix était un si<strong>le</strong>ncieux. Fils d’un portraitiste grenoblois, Henri Fantin-Latour<br />
(1836-1904) fut élève <strong>de</strong> Lecoq <strong>de</strong> Boisbaudran à la Petite Éco<strong>le</strong> où étaient cultivées l’observation et la<br />
mémoire. Il fréquenta ensuite brièvement <strong>le</strong>s Beaux-Arts puis l’atelier <strong>de</strong> Courbet. Mais c’est au <strong>Louvre</strong>, au<br />
contact <strong>de</strong>s maîtres <strong>du</strong> passé, qu’il apprit son métier, multipliant <strong>le</strong>s copies qui lui fournirent aussi ses premiers<br />
revenus. C’est là qu’il se lia avec Manet, Whist<strong>le</strong>r et <strong>le</strong>s autres. Pour lui-même et ses amis, il a peint et <strong>de</strong>ssiné<br />
<strong>de</strong>s autoportraits, comme il l’écrit à Whist<strong>le</strong>r en 1859 : « Je rentre <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, je dîne et <strong>de</strong> 5 h à 8 h <strong>du</strong> soir, je<br />
me mets <strong>de</strong>vant ma glace et, en tête à tête avec la nature, nous nous disons <strong>de</strong>s choses qui va<strong>le</strong>nt mil<strong>le</strong> fois tout<br />
ce que la plus charmante femme peut dire, ah l’art ! » La dramatisation <strong>de</strong> l’éclairage souligne son attachement<br />
au Romantisme dont il cultiva la nostalgie au point <strong>de</strong> se détacher fina<strong>le</strong>ment <strong>de</strong>s Impressionnistes, réservant<br />
son admiration au seul Édouard Manet (1832-1883).<br />
C’est autant par culte <strong>de</strong> l’amitié que par penchant pour <strong>le</strong> réalisme qu’il s’associa à partir <strong>de</strong> 1859 aux peintres<br />
et graveurs Alphonse Legros (1836-1911) et James McNeill Whist<strong>le</strong>r (1834-1903) au sein <strong>de</strong> la « Société <strong>de</strong>s<br />
Trois », fraternité qui éclata cinq ans plus tard tant <strong>le</strong>urs itinéraires esthétiques avaient divergé. À Londres, où<br />
ses <strong>de</strong>ux confrères plus lancés lui offrirent <strong>le</strong>ur appui, Fantin trouva un débouché enviab<strong>le</strong> pour ces natures<br />
mortes et bouquets <strong>de</strong> f<strong>le</strong>urs qui allaient constituer <strong>du</strong>rab<strong>le</strong>ment son moyen d’existence. Mais l’observateur<br />
consciencieux <strong>de</strong> la nature et fin mélomane voulait néanmoins en découdre avec <strong>le</strong> jury <strong>du</strong> Salon, <strong>le</strong>quel<br />
refusait presque toutes ses œuvres et cel<strong>le</strong>s <strong>de</strong> ses amis, afin d’obtenir une juste reconnaissance <strong>du</strong> public<br />
parisien. L’Hommage à Delacroix fut, au Salon <strong>de</strong> 1864, <strong>le</strong> premier <strong>de</strong> ses coups d’éclat, avant d’autres<br />
portraits col<strong>le</strong>ctifs qui scandèrent la carrière – pourtant essentiel<strong>le</strong>ment solitaire – d’un maître <strong>de</strong> l’austérité<br />
per<strong>du</strong> dans une vil<strong>le</strong> <strong>de</strong> lumières.<br />
<strong>Musée</strong> Delacroix: l'atelier, vue intérieure<br />
<strong>Musée</strong> Delacroix<br />
© 2009 <strong>Musée</strong> <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong> / Angè<strong>le</strong> Dequier<br />
9
III - La fabrique <strong>de</strong> l’Hommage<br />
Les circonstances sont connues : rentrant avec Manet et Bau<strong>de</strong>laire <strong>de</strong> l’enterrement <strong>de</strong> Delacroix au cimetière<br />
<strong>du</strong> Père-Lachaise, Fantin-Latour, indigné comme eux <strong>du</strong> manque <strong>de</strong> so<strong>le</strong>nnité <strong>de</strong> la cérémonie, se lança, avec<br />
<strong>le</strong>s encouragements <strong>de</strong> ses amis, dans une gran<strong>de</strong> toi<strong>le</strong> en hommage au défunt. Même si Delacroix avait été<br />
comblé <strong>de</strong> comman<strong>de</strong>s officiel<strong>le</strong>s, même si ses funérail<strong>le</strong>s n’avaient pas été tota<strong>le</strong>ment dénuées d’éclat malgré<br />
une assistance clairsemée, <strong>le</strong>s difficultés que l’artiste avait dû surmonter toute sa vie pour s’imposer et la<br />
modération <strong>de</strong>s réactions à sa disparition en faisaient un porte-drapeau <strong>du</strong> combat <strong>de</strong> la nouvel<strong>le</strong> génération.<br />
C’est pourquoi Fantin ne reprit pas <strong>le</strong> souhait <strong>de</strong> Bau<strong>de</strong>laire que Delacroix apparaisse au milieu <strong>de</strong>s grands<br />
hommes qui l’avaient inspiré, comme Shakespeare, Rubens, Goethe ou Byron. Le jeune peintre désirait<br />
davantage représenter l’hommage d’une relève bien vivante. Fantin envisagea toutefois une formu<strong>le</strong><br />
allégorique traditionnel<strong>le</strong> - un groupe d’artistes entourant <strong>le</strong> buste <strong>du</strong> maître couronné par une figure féminine<br />
<strong>de</strong> la Gloire - et chercha sur cette voie <strong>de</strong> septembre 1863 à janvier 1864, multipliant <strong>de</strong>ssins et esquisses<br />
peintes. Ce n’est que <strong>le</strong> 27 janvier qu’il adopta un tout autre schéma : une ga<strong>le</strong>rie <strong>de</strong> portraits qu’il exécuta<br />
ensuite en urgence, sans autre <strong>de</strong>ssin préparatoire, pour <strong>le</strong> Salon <strong>du</strong> printemps 1864. Ce revirement aurait été<br />
suscité par la vue d’une copie d’un portrait <strong>de</strong> groupe <strong>de</strong> Frans Hals, artiste que l’on redécouvrait alors.<br />
Appliquée <strong>de</strong> façon inédite à un groupe d’artistes, cette formu<strong>le</strong> s’oppose à la représentation plus traditionnel<strong>le</strong><br />
<strong>de</strong> l’atelier. Le portrait <strong>de</strong> Delacroix n’est pas sur un cheva<strong>le</strong>t mais accroché à la paroi d’un salon. Certains<br />
critiques remarqueront avec ironie que <strong>le</strong>s admirateurs <strong>de</strong> Delacroix lui tournent tous <strong>le</strong> dos, même si son<br />
portrait – peint d’après une photographie – domine <strong>le</strong> groupe. Dans cet alignement rythmé, seul Fantin se<br />
distingue par sa blouse <strong>de</strong> peintre et sa pa<strong>le</strong>tte.<br />
Au-<strong>de</strong>là <strong>du</strong> schéma d’ensemb<strong>le</strong>, il convenait <strong>de</strong> rég<strong>le</strong>r la distribution fina<strong>le</strong> <strong>de</strong>s rô<strong>le</strong>s. Certains amis <strong>de</strong> Fantin,<br />
évoqués un temps comme Myionnet, Ribot et Regamey, disparurent on ne sait pourquoi, d’autres, comme<br />
Dante Gabriel Rossetti qu’avait suggéré Whist<strong>le</strong>r, ne purent se rendre à temps aux séances <strong>de</strong> pose. Fantin<br />
réserva en tout cas un espace bien en vue à Whist<strong>le</strong>r lui-même, venu spécia<strong>le</strong>ment <strong>de</strong> Londres <strong>de</strong> même<br />
qu’Alphonse Legros, avec qui ils formaient la « Société <strong>de</strong>s Trois ».<br />
En définitive, avec Manet, Cordier, Bracquemond et Bal<strong>le</strong>roy, la toi<strong>le</strong> réunit sept artistes, tous <strong>de</strong>bout à part<br />
Fantin et trois critiques, Duranty, Champf<strong>le</strong>ury et Bau<strong>de</strong>laire représentés assis, équitab<strong>le</strong>ment répartis <strong>de</strong> part<br />
et d’autre <strong>du</strong> portrait <strong>du</strong> maître. Pourquoi eux et pas d’autres, <strong>le</strong> choix allait forcément déchaîner la polémique,<br />
ce qui n’était pas pour déplaire au jeune artiste.<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Esquisse pour l’Hommage à Delacroix<br />
(1863-1864)<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
Dimensions : 25,5 cm × 26 cm<br />
Paris, musée Eugène-Delacroix<br />
MD 2008-21<br />
© RMN (musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>) /<br />
Harry Bréjat<br />
10
IV - L’hommage au mort face aux vivants<br />
Derrière <strong>le</strong> caractère so<strong>le</strong>nnel <strong>de</strong> l’Hommage à Delacroix et son titre respectueux, se cachait un manifeste,<br />
celui d’une génération excédée par <strong>le</strong> poids <strong>de</strong> la tradition académique. Les tenants <strong>de</strong> cel<strong>le</strong>-ci bloquaient<br />
régulièrement l’accès <strong>de</strong>s œuvres <strong>de</strong> Fantin et <strong>de</strong> ses amis au Salon, suscitant en réaction en 1863, la création<br />
<strong>du</strong> « Salon <strong>de</strong>s Refusés ». La réforme <strong>du</strong> jury qui suivit, pour mettre fin temporairement à ces désordres qui<br />
avaient fina<strong>le</strong>ment servi <strong>de</strong> faire-valoir à Manet et Whist<strong>le</strong>r, offrit la possibilité aux scanda<strong>le</strong>ux <strong>de</strong> la veil<strong>le</strong><br />
d’exposer <strong>le</strong>urs travaux au Salon officiel <strong>de</strong> 1864. L’Hommage y affichait une fière ga<strong>le</strong>rie <strong>de</strong> portraits<br />
d’artistes jusque-là rejetés <strong>de</strong>s cimaises.<br />
Restait toutefois à voir figurer la toi<strong>le</strong> en bonne place dans l’immensité <strong>de</strong>s sal<strong>le</strong>s : Bau<strong>de</strong>laire tint à intervenir<br />
lui-même en écrivant au responsab<strong>le</strong> <strong>de</strong> l’accrochage, sans grand effet d’ail<strong>le</strong>urs. Les critiques surent<br />
cependant la remarquer et la commenter abondamment. Il n’en alla pas <strong>de</strong> même <strong>de</strong> l’autre tab<strong>le</strong>au exposé par<br />
l’artiste, Tannhäuser : Venusberg (Los Ange<strong>le</strong>s County Museum of Art), hommage parallè<strong>le</strong> à Richard<br />
Wagner, tout aussi militant après la caba<strong>le</strong> qui avait frappé <strong>le</strong>s représentations parisiennes <strong>de</strong> l’opéra en 1861.<br />
Le débat porta sur la légitimité <strong>de</strong>s figurants <strong>de</strong> l’Hommage, dont l’i<strong>de</strong>ntité n’était d’ail<strong>le</strong>urs pas donnée dans<br />
<strong>le</strong> livret <strong>du</strong> Salon : n’étaient-ils pas plutôt <strong>de</strong>s suiveurs <strong>du</strong> plus décrié <strong>de</strong>s maîtres, Gustave Courbet ? Ainsi<br />
Edmond About écrit avec causticité : « Une gran<strong>de</strong> tête assez malpropre nous représente Delacroix enlaidi par<br />
<strong>le</strong> réalisme et si terrib<strong>le</strong> à voir qu’une dizaine <strong>de</strong> bons bourgeois lui tournent <strong>le</strong> dos en faisant la grimace [.…]<br />
Mais peut-être M. Fantin-Latour a-t-il voulu consulter l’illustre mort, et lui dire : Vois comme nous faisons <strong>de</strong><br />
mauvaise peinture <strong>de</strong>puis que tu n’es plus avec nous ! » Face à tant <strong>de</strong> mauvais esprit, <strong>le</strong>s partisans <strong>du</strong> tab<strong>le</strong>au<br />
n’avaient plus qu’à opposer <strong>le</strong>ur foi en une peinture qui ferait cesser <strong>le</strong> supposé conflit entre réalisme et<br />
romantisme.<br />
L’œuvre avait, en tout cas, fait par<strong>le</strong>r d’el<strong>le</strong>. El<strong>le</strong> réussit éga<strong>le</strong>ment à intéresser un marchand londonien<br />
influent, Ernest Gambart, ce qui confirmait <strong>le</strong>s perspectives <strong>de</strong> succès <strong>de</strong> l’artiste outre-Manche. Ce n’est<br />
qu’après plusieurs al<strong>le</strong>rs-retours entre <strong>le</strong>s marchés anglais et français que la toi<strong>le</strong> échut en 1897 au<br />
col<strong>le</strong>ctionneur Étienne <strong>Mo</strong>reau-Nélaton, chez qui el<strong>le</strong> formait un pivot idéal entre <strong>de</strong> nombreuses œuvres <strong>de</strong><br />
Delacroix et <strong>le</strong> Déjeuner sur l’herbe <strong>de</strong> Manet, qu’il offrit en bloc au <strong>Louvre</strong> en 1906.<br />
Mais loin <strong>de</strong> se satisfaire <strong>de</strong> ce premier succès <strong>de</strong> 1864, Fantin brûlait <strong>de</strong> récidiver, ce qu’il tenta au Salon <strong>de</strong><br />
1865 avec Toast! hommage à la Vérité, autre toi<strong>le</strong> programmatique où figuraient en partie <strong>le</strong>s mêmes et qu’il<br />
détruisit tant sa réception fut médiocre. Diverses tentatives avortées, comme L’Anniversaire <strong>de</strong> Bau<strong>de</strong>laire,<br />
marquent son désir <strong>de</strong> reprendre la formu<strong>le</strong> <strong>de</strong> l’Hommage. El<strong>le</strong>s aboutirent en 1871 à Un atelier aux<br />
Batignol<strong>le</strong>s, portrait <strong>de</strong> groupe tout à l’honneur <strong>de</strong> Manet mais où Fantin ne figure plus au milieu <strong>de</strong> ses<br />
coreligionnaires dont <strong>le</strong>s innovations <strong>le</strong> rebutent. Pour lui, définitivement, « <strong>le</strong> Romantisme, c’est <strong>le</strong> véritab<strong>le</strong><br />
art mo<strong>de</strong>rne ».<br />
11
V - D’un hommage l’autre<br />
À la fin <strong>de</strong>s années 1880, Fantin, recherché pour <strong>le</strong>s bouquets <strong>de</strong> f<strong>le</strong>urs que lui réclame sa clientè<strong>le</strong> britannique,<br />
se lasse <strong>de</strong> cette pro<strong>du</strong>ction et déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> s’adonner davantage aux sujets d’imagination. L’univers <strong>de</strong> Wagner et<br />
<strong>de</strong> Berlioz offre au peintre mélomane autant d’occasions <strong>de</strong> s’éva<strong>de</strong>r <strong>de</strong> l’observation scrupu<strong>le</strong>use à laquel<strong>le</strong> il<br />
s’astreint dans ses natures mortes. Ainsi en 1889, il présente au Salon, vingt-cinq ans après son premier coup<br />
d’éclat, un nouvel hommage à Delacroix, d’une tonalité tout autre, Immortalité (Cardiff, National Museum<br />
Wa<strong>le</strong>s), une figure féminine portant une palme et semant <strong>de</strong>s f<strong>le</strong>urs sur <strong>le</strong> tombeau <strong>de</strong> Delacroix. L’accueil <strong>de</strong><br />
la toi<strong>le</strong> par la critique fut louangeur mais assez convenu, la grâce <strong>de</strong> l’allégorie inspirée <strong>de</strong> Prud’hon et son<br />
harmonie colorée s’inscrivant involontairement dans l’atmosphère symboliste <strong>du</strong> moment. Plus qu’un<br />
reniement <strong>de</strong> son premier hommage col<strong>le</strong>ctif, sans doute faut-il voir ici l’aboutissement d’un itinéraire<br />
personnel <strong>de</strong> Fantin, inspiré par ses recherches sur la transposition d’impressions musica<strong>le</strong>s. L’artiste reprenait<br />
d’ail<strong>le</strong>urs ici, en l’inversant, un <strong>de</strong>ssin en hommage à Wagner conçu pour <strong>le</strong> journal <strong>de</strong> Bayreuth.<br />
Ce regain d’intérêt pour Delacroix fut incontestab<strong>le</strong>ment motivé chez lui par <strong>le</strong> succès <strong>de</strong> la campagne <strong>de</strong>stinée<br />
à é<strong>le</strong>ver un monument à la mémoire <strong>du</strong> maître, initiative lancée par Auguste Vacquerie et Alfred Robaut,<br />
l’auteur <strong>du</strong> catalogue <strong>de</strong> l’œuvre <strong>de</strong> Delacroix. L’appel à la souscription était <strong>le</strong> mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> financement <strong>le</strong> plus<br />
fréquent <strong>de</strong>s monuments publics tout au long <strong>du</strong> XIX e sièc<strong>le</strong> pour la sculpture, mais c’était aussi une façon <strong>de</strong><br />
forcer la main à l’administration. Fantin soutint <strong>le</strong> projet dès son lancement en 1884. Le critique Philippe Burty<br />
plaida pour un monument d’une gran<strong>de</strong> sobriété, arguant <strong>du</strong> testament <strong>de</strong> l’artiste, <strong>le</strong>quel spécifiait que ni<br />
statue ni buste ne <strong>de</strong>vait être placé sur son tombeau. Le sculpteur retenu, Ju<strong>le</strong>s Dalou, afficha plus d’ambition.<br />
Il adopta un parti allégorique, comme Fantin l’avait envisagé dans ses premières esquisses pour l’Hommage à<br />
Delacroix. Autour d’un pié<strong>de</strong>stal supportant <strong>le</strong> buste <strong>du</strong> maître, <strong>le</strong> Temps ailé soulève la Gloire, qui tend une<br />
couronne, tandis qu’Apollon applaudit. Le souff<strong>le</strong> baroque <strong>de</strong> la composition contraste avec <strong>le</strong> buste<br />
emmitouflé <strong>du</strong> peintre pensif, pour <strong>le</strong>quel <strong>le</strong> sculpteur emprunta à l’effigie conçue par Carrier-Bel<strong>le</strong>use pour<br />
l’exposition Delacroix <strong>de</strong> 1864. Un exemplaire en plâtre <strong>du</strong> buste <strong>de</strong> Dalou domine aujourd’hui l’escalier <strong>du</strong><br />
musée, à proximité <strong>de</strong> la petite place où l’on envisagea d’instal<strong>le</strong>r <strong>le</strong> monument avant <strong>de</strong> lui préférer <strong>le</strong> jardin<br />
<strong>du</strong> Luxembourg. Il y fut inauguré <strong>de</strong> façon tout à fait officiel<strong>le</strong> <strong>le</strong> 5 septembre 1890 avec musique et discours.<br />
Ainsi était effacé <strong>le</strong> souvenir <strong>de</strong>s pâ<strong>le</strong>s funérail<strong>le</strong>s <strong>de</strong> 1863 dont l’ultime allégorie <strong>de</strong> Fantin, présentée ici dans<br />
la chambre même où s’éteignit Delacroix, semb<strong>le</strong> encore évoquer la mélancolie.<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Chrysanthèmes dans un vase<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
Dimensions : 42,5 cm × 39,5 cm<br />
Madrid, musée Thyssen Bornemisza<br />
© Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid<br />
12
Poème d’inauguration pour <strong>le</strong> monument d’hommage à Delacroix<br />
Théodore <strong>de</strong> Banvil<strong>le</strong> : « à Eugène Delacroix », Rimes dorées.<br />
Strophes dites par l’acteur <strong>Mo</strong>unet-Sully, <strong>le</strong> 5 octobre 1890, pour l’inauguration <strong>du</strong> monument é<strong>le</strong>vé<br />
à Eugène Delacroix au jardin <strong>du</strong> Luxembourg.<br />
O Delacroix ! songeur, poète, âme, génie !<br />
Magicien vibrant d’orgueil et <strong>de</strong> courroux,<br />
Calme, fier, évoqué <strong>de</strong> la nuit infinie,<br />
Peintre <strong>de</strong> l’idéal, te voici <strong>de</strong>vant nous !<br />
Tes mains ont loin <strong>de</strong> toi rejeté <strong>le</strong> suaire,<br />
Et toi, <strong>le</strong> conquérant, jadis persécuté,<br />
Grâce à la piété <strong>du</strong> hardi statuaire,<br />
Te voici, tu renais pour l’immortalité.<br />
Terre et cieux, tu prends tout dans ton vaste domaine,<br />
Et si la clarté bril<strong>le</strong> en ton œil enchanté,<br />
C’est que tu te donnas à la souffrance humaine.<br />
Le poème divin, c’est toi qui l’as chanté.<br />
Massacres, guerre, amour, fragilité, démence,<br />
Tu peignis tout, <strong>le</strong> sang pourpré comme <strong>le</strong>s f<strong>le</strong>urs,<br />
Et l’enfer et l’azur, et dans ton œuvre immense<br />
L’héroïque Pitié lave tout <strong>de</strong> ses p<strong>le</strong>urs !<br />
Ah ! l’avenir, <strong>le</strong> grand avenir magnanime,<br />
Est pour celui qui porte une plaie à son flanc<br />
Et qui ne peut pas voir un condamné sublime<br />
Sans laver ce martyr avec son propre sang.<br />
Il vivra, celui-là qui jette, comme Orphée,<br />
Une plainte que rien ne saurait apaiser,<br />
Et qui, domptant d’abord sa colère étouffée,<br />
Pose sur chaque plaie un fraternel baiser.<br />
O peintre ! la cou<strong>le</strong>ur sereine est une lyre ;<br />
El<strong>le</strong> dit <strong>le</strong> triomphe à l’aurore pareil,<br />
Et l’épopée au glaive ar<strong>de</strong>nt, et <strong>le</strong> délire<br />
Du beau qui resp<strong>le</strong>ndit comme un rouge so<strong>le</strong>il.<br />
O Delacroix ! parmi <strong>le</strong>s pages qu’illumine<br />
Ton âme, il en est une où, furieux encor,<br />
Apollon, clair vainqueur <strong>de</strong> la nuit, extermine<br />
Les monstres <strong>de</strong>s marais avec ses flèches d’or.<br />
Haine, ignorance, erreur, tous <strong>le</strong>s bourreaux <strong>de</strong> l’âme,<br />
Les mensonges avec <strong>le</strong>s trahisons rampants,<br />
Le dieu tue et détruit, s’envolant dans la flamme,<br />
Tout ce tas <strong>de</strong> crapauds hi<strong>de</strong>ux et <strong>de</strong> serpents.<br />
Ce dieu, c’est toi, vivant dans la clarté première,<br />
Chassant l’obscurité détestab<strong>le</strong> qui nuit,<br />
O toi qui t’enivras <strong>de</strong> la pure lumière<br />
Et qui n’eus jamais d’autre ennemi que la nuit.<br />
Mais tu peignis aussi, pur en ses chastes lignes,<br />
Caressé par la brise et par <strong>le</strong> doux écho,<br />
Un jardin où parmi <strong>le</strong>s lauriers et <strong>le</strong>s cygnes<br />
Retentissent <strong>le</strong>s vers d’Homère et <strong>de</strong> Sapho.<br />
C’est là que, maintenant, rassasié <strong>de</strong> gloire,<br />
Tu contemp<strong>le</strong>s, superbe et d’un regard vainqueur,<br />
Les bosquets verdoyants et <strong>le</strong> temp<strong>le</strong> d’ivoire<br />
À côté <strong>de</strong> Hugo, cet Eschy<strong>le</strong> au grand cœur.<br />
Le statuaire, en qui l’espérance tressail<strong>le</strong>,<br />
À mo<strong>de</strong>lé pour nous ce beau front sérieux,<br />
Ta lèvre au pli songeur, tes cheveux en broussail<strong>le</strong>,<br />
Et sous tes fiers sourcils tes yeux mystérieux.<br />
Et nous te saluons d’une ar<strong>de</strong>nte louange,<br />
O toi qui fus émus, grand homme, et qui p<strong>le</strong>uras,<br />
O tra<strong>du</strong>cteur <strong>du</strong> verbe égal à Michel-Ange,<br />
Qui pris <strong>le</strong> feu <strong>du</strong> ciel et qui t’en emparas !<br />
Maintenant que ton œuvre austère et magnifique<br />
Bril<strong>le</strong> dans la lumière et l’éblouissement,<br />
Et que, dans la ver<strong>du</strong>re et l’ombre pacifique,<br />
Un flot mélodieux baigne ton monument,<br />
Notre Apel<strong>le</strong> triomphe ainsi que notre Homère,<br />
Et, tressant pour ton front <strong>de</strong>s lauriers toujours verts,<br />
Cette fil<strong>le</strong> d’Hellas, ta nourrice et ta mère,<br />
La France avec orgueil te donne à l’univers.<br />
13
<strong>Musée</strong> Delacroix: jardin et vue extérieure <strong>de</strong><br />
l'atelier<br />
<strong>Musée</strong> Delacroix<br />
© 2009 <strong>Musée</strong> <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong> / Angè<strong>le</strong> Dequier<br />
L’histoire <strong>du</strong> musée Eugène-Delacroix<br />
C’est grâce à l’action d’un groupe <strong>de</strong> peintres, <strong>de</strong> col<strong>le</strong>ctionneurs et<br />
d’historiens <strong>de</strong> l’art que la <strong>de</strong>rnière <strong>de</strong>meure d’Eugène Delacroix<br />
(1798-1863) <strong>du</strong>t d’être sauvée et transformée en un musée dans <strong>le</strong>s<br />
années 1930. S’il n’est rattaché au <strong>Louvre</strong> que <strong>de</strong>puis 2004, <strong>le</strong> musée<br />
Delacroix présente <strong>de</strong>s col<strong>le</strong>ctions parfaitement complémentaires<br />
<strong>de</strong> sa maison-mère. Tandis que <strong>le</strong>s gran<strong>de</strong>s toi<strong>le</strong>s-manifestes <strong>de</strong><br />
l’artiste trônent dans <strong>le</strong>s sal<strong>le</strong>s <strong>Mo</strong>llien au <strong>Louvre</strong>, l’appartement <strong>de</strong><br />
Delacroix offre un cadre intime à ses souvenirs et portraits familiaux<br />
tandis que son ancien atelier présente notamment <strong>de</strong>s esquisses<br />
qui illustrent sa pratique <strong>de</strong> la peinture. En décembre 1857, désireux<br />
<strong>de</strong> se rapprocher <strong>du</strong> chantier <strong>de</strong>s peintures mura<strong>le</strong>s <strong>de</strong> l’église<br />
<strong>de</strong> Saint-Sulpice, Delacroix s’installa dans cet appartement<br />
confortab<strong>le</strong> mais dénué d’ostentation, après huit mois <strong>de</strong> travaux<br />
consacrés à la construction <strong>de</strong> l’atelier. L’endroit l’avait sé<strong>du</strong>it<br />
pour <strong>le</strong> calme <strong>de</strong> la cour et l’agréab<strong>le</strong> jardin dont <strong>le</strong> peintre avait la<br />
jouissance exclusive et dont il entreprit avec soin la rénovation et<br />
<strong>le</strong> f<strong>le</strong>urissement.<br />
L’appartement lui-même, situé au premier étage était composé d’un salon, d’une sal<strong>le</strong> à manger, d’une petite<br />
pièce dont il fit sa bibliothèque, d’une chambre à coucher, d’une autre pour sa gouvernante, Jenny Le Guillou,<br />
ainsi que d’une cuisine et <strong>de</strong> quelques débarras. L’ameub<strong>le</strong>ment et <strong>le</strong> décor, connus grâce à l’inventaire après<br />
décès, ne se distinguaient ni par <strong>le</strong>ur luxe ni <strong>le</strong>ur originalité, même s’il convient <strong>de</strong> noter la présence dans <strong>le</strong><br />
salon <strong>du</strong> grand portrait <strong>de</strong> la sœur <strong>de</strong> Delacroix, Madame <strong>de</strong> Verninac, par David (<strong>Louvre</strong>). Faute d’éléments<br />
suffisants, la présentation actuel<strong>le</strong> ne vise pas à reconstituer cet intérieur. Le musée bénéficie néanmoins <strong>du</strong><br />
caractère intime <strong>de</strong>s espaces, en soi évocateurs <strong>de</strong> la personnalité <strong>de</strong> l’artiste, qui s’éteignit <strong>le</strong> 13 août 1863<br />
dans la chambre donnant sur <strong>le</strong> jardin.<br />
Loin d’avoir envisagé, à la manière d’un Gustave <strong>Mo</strong>reau, la création d’un mémorial à sa gloire, Delacroix,<br />
mort célibataire et sans enfant, avait disposé dans son testament que l’intégralité <strong>de</strong> ses œuvres <strong>de</strong>vait être<br />
ven<strong>du</strong>e aux enchères, hormis quelques portraits <strong>de</strong> famil<strong>le</strong> et pièces à choisir par ses proches. L’appartement<br />
<strong>du</strong> 6 rue <strong>de</strong> Fürstenberg, vidé <strong>de</strong> son contenu, fut restitué au propriétaire <strong>de</strong> l’immeub<strong>le</strong>, ainsi que l’atelier que<br />
Delacroix avait fait construire pour son usage dans <strong>le</strong> jardin. Ce n’est que l’annonce, en 1928, <strong>de</strong> la <strong>de</strong>struction<br />
possib<strong>le</strong> <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier, pour y bâtir un garage, qui suscita une vague d’émotion à l’origine <strong>du</strong> musée.<br />
Le sauvetage <strong>de</strong>s lieux s’opéra en plusieurs temps, grâce à l’action <strong>de</strong> la Société <strong>de</strong>s Amis d’Eugène Delacroix<br />
créée en 1929 dans ce but. Ayant obtenu l’abandon <strong>du</strong> projet <strong>de</strong> <strong>de</strong>struction, l’association s’engagea à louer<br />
l’atelier puis l’appartement. El<strong>le</strong> y organisa alors une série d’expositions dont la première en 1932 fut<br />
inaugurée par <strong>le</strong> prési<strong>de</strong>nt Albert Lebrun, et se constitua une col<strong>le</strong>ction permanente alimentée notamment par<br />
<strong>le</strong>s dons <strong>de</strong> son premier conservateur et mécène, <strong>le</strong> baron Vitta. Présidée par Maurice Denis, et comptant parmi<br />
ses membres <strong>de</strong>s personnalités aussi prestigieuses que Paul Signac et Henri Matisse, la Société obtint d’emblée<br />
<strong>de</strong> nombreux prêts <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>.<br />
15
La mise en vente <strong>de</strong> l’immeub<strong>le</strong> en 1952 menaça toutefois la pérennité <strong>de</strong> cette ambitieuse entreprise, mais<br />
fina<strong>le</strong>ment un arrangement fut trouvé : pour se porter enchérisseur <strong>du</strong> lot comprenant l’appartement et l’atelier<br />
<strong>de</strong> Delacroix, la Société vendit une partie <strong>de</strong> ses col<strong>le</strong>ctions à l’Etat et <strong>le</strong>s œuvres furent dès lors inscrites sur<br />
<strong>le</strong>s inventaires <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, pour une somme qui lui permit d’acquérir <strong>le</strong>s murs eux-mêmes offerts à l’Etat. En<br />
1956, la Société fait don à l’Etat <strong>de</strong>s lieux en contrepartie <strong>de</strong> l’engagement d’en garantir l’ouverture au public.<br />
La Société <strong>de</strong>s Amis <strong>du</strong> musée Eugène Delacroix, qui a été refondée en 2000 avec <strong>de</strong> nouveaux statuts,<br />
conserve un rô<strong>le</strong> actif dans la vie <strong>de</strong> l’établissement, notamment par la publication d’un bul<strong>le</strong>tin annuel et par<br />
une contribution régulière à l’enrichissement <strong>de</strong>s col<strong>le</strong>ctions. L’ensemb<strong>le</strong> <strong>du</strong> musée a bénéficié d’une<br />
rénovation au début <strong>de</strong>s années 1990 accompagnée d’une extension à l’étage. L’acquisition en 2010 d’une<br />
partie <strong>du</strong> rez-<strong>de</strong>-chaussée <strong>de</strong> l’immeub<strong>le</strong> va engendrer une réorganisation plus rationnel<strong>le</strong> <strong>de</strong>s espaces tant pour<br />
l’accueil d’un public croissant que pour la présentation <strong>de</strong>s œuvres dans l’appartement. Par ail<strong>le</strong>urs, <strong>du</strong>rant<br />
l’hiver 2011-2012, grâce à l’exploitation <strong>de</strong> nouveaux documents d’archives, <strong>le</strong> jardin <strong>du</strong> musée va pouvoir<br />
être rétabli dans une configuration plus proche <strong>de</strong> son état d’origine.<br />
Riche <strong>de</strong> plus d’un millier <strong>de</strong> pièces, la col<strong>le</strong>ction se compose d’un important fonds <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssins, d’estampes et<br />
<strong>de</strong> manuscrits <strong>de</strong> l’artiste ou <strong>de</strong> son entourage. Outre <strong>de</strong>s toi<strong>le</strong>s majeures comme L’E<strong>du</strong>cation <strong>de</strong> la Vierge<br />
(1842) et La Ma<strong>de</strong><strong>le</strong>ine dans <strong>le</strong> désert (1848), ainsi que <strong>de</strong> nombreux dépôts notamment <strong>du</strong> département <strong>de</strong>s<br />
Peintures <strong>du</strong> musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, <strong>le</strong> musée conserve une série d’esquisses qui illustrent au plus près <strong>le</strong> travail <strong>de</strong><br />
l’artiste. Cet aspect est renforcé par <strong>de</strong>s objets personnels et <strong>le</strong>s souvenirs qu’il rapporta <strong>de</strong> son voyage en<br />
Afrique <strong>du</strong> Nord en 1832, céramiques, armes, costumes et instruments <strong>de</strong> musique, qui lui servirent toute sa<br />
vie pour <strong>le</strong>s compositions inspirées par ce séjour.<br />
Chaque année une exposition dotée d’un catalogue scientifique vient illustrer certains aspects <strong>de</strong> l’œuvre <strong>de</strong><br />
Delacroix et <strong>de</strong> sa postérité. Le site internet www.musee-<strong>de</strong>lacroix.fr présente l’actualité <strong>de</strong> l’établissement<br />
(concert, conférences, expositions, publications, nouvel<strong>le</strong>s acquisitions, etc.) mais au-<strong>de</strong>là, il offre une riche<br />
documentation sur l’artiste et son œuvre, complétée par la base <strong>de</strong> données en ligne <strong>de</strong> ses <strong>le</strong>ttres :<br />
www.correspondance-<strong>de</strong>lacroix.fr (projet mené en association avec l’université <strong>de</strong> Paris IV-Sorbonne et <strong>le</strong><br />
soutien <strong>de</strong> l’Agence nationa<strong>le</strong> <strong>de</strong> la Recherche).<br />
16
Visuels <strong>de</strong> l’exposition<br />
Fantin-Latour, Manet, Bau<strong>de</strong>laire.<br />
L’Hommage à Delacroix<br />
<strong>du</strong> 7 décembre au 19 mars 2012<br />
Les visuels sont libres <strong>de</strong> droit avant, pendant et jusqu’à la fin <strong>de</strong> l’exposition.<br />
Ils peuvent être utilisés uniquement dans <strong>le</strong> cadre <strong>de</strong> la promotion <strong>de</strong> l’exposition.<br />
Les images peuvent être téléchargées sur <strong>le</strong> nouveau site internet <strong>du</strong> musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong> : www.louvre.fr<br />
Merci <strong>de</strong> mentionner <strong>le</strong> crédit photographique et <strong>de</strong> nous envoyer une copie <strong>de</strong> l’artic<strong>le</strong> :<br />
<strong>Musée</strong> <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, Direction <strong>de</strong> la communication, 75058 Paris ce<strong>de</strong>x 01<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Hommage à Delacroix, 1864<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
Dimensions : 160 cm × 250 cm<br />
Paris, musée d’Orsay<br />
RF 1664<br />
© RMN (musée d’Orsay) /<br />
Hervé Lewandowski<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Esquisse pour l’Hommage à Delacroix<br />
(1863-1864)<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
Dimensions : 25,5 cm × 26 cm<br />
Paris, musée Eugène-Delacroix<br />
MD 2008-21<br />
© RMN (musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>) /<br />
Harry Bréjat<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Autoportrait, 1860<br />
Fusain, lavis, encore noire<br />
Dimensions : 30.3 cm × 23.4 cm<br />
Lil<strong>le</strong>, Palais <strong>de</strong>s Beaux-Arts<br />
Inv. W 2076<br />
© RMN (musée d’Orsay) /<br />
Jacques Quecq d’Henripret<br />
17
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Autoportrait, 1860<br />
Fusain, lavis, encore noire<br />
Dimensions : 14.3 cm × 12.1 cm<br />
Paris, musée d’Orsay<br />
RF 15651<br />
© RMN (musée d’Orsay) / Frank Raux<br />
Edouard Manet (1832-1883)<br />
La Barque <strong>de</strong> Dante,<br />
d’après Delacroix<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
Dimensions : 38 cm × 46 cm<br />
Lyon, musée <strong>de</strong>s Beaux-Arts<br />
Inv. B 830<br />
© RMN / Droits réservés<br />
Frédéric Bazil<strong>le</strong> (1841-1870)<br />
L’Atelier <strong>de</strong> la rue Fürstenberg,<br />
1865-1866<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
Dimensions : 80 cm × 65 cm<br />
<strong>Mo</strong>ntpellier, musée Fabre<br />
Inv. 85.5.3<br />
© <strong>Musée</strong> Fabre / Frédéric Jaulmes<br />
18
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Immortalité, 1889<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
Dimensions : 116 cm × 87 cm<br />
Cardiff, National Museum of Wa<strong>le</strong>s<br />
NMW A 2462<br />
© National Museum of Wa<strong>le</strong>s<br />
Albert <strong>de</strong> Bal<strong>le</strong>roy (1828-1872)<br />
Combat <strong>de</strong> chevaux, 1866<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
Dimensions : 121 cm × 97 cm<br />
Bayeux, musée Baron-Gérard<br />
P 0227<br />
© Bayeux, <strong>Musée</strong> Baron-Gérard<br />
Eugène Delacroix (1798-1863)<br />
La mer au coucher <strong>du</strong> so<strong>le</strong>il, 1832<br />
Pastel<br />
Dimensions : 15,8 cm × 21 cm<br />
Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>,<br />
département <strong>de</strong>s Arts graphiques<br />
RF 9154.4<br />
© RMN / Thierry <strong>le</strong> Mage<br />
19
Sal<strong>le</strong> 1<br />
Eugène Delacroix (1798-1863)<br />
La mer au coucher <strong>du</strong> so<strong>le</strong>il<br />
Pastel<br />
Ce précieux album <strong>de</strong> la série <strong>de</strong> ceux où Delacroix<br />
nota ses impressions <strong>du</strong>rant son voyage au Maroc,<br />
débute par cette page exécutée en mer entre <strong>le</strong> 12 et <strong>le</strong><br />
18 janvier 1832. El<strong>le</strong> anticipe sur <strong>le</strong>s recherches que<br />
l’artiste développa dans ses pastels et aquarel<strong>le</strong>s<br />
norman<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s années 1849-1855.<br />
Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Arts<br />
graphiques, RF 9154.4 (<strong>le</strong>gs Etienne <strong>Mo</strong>reau-Nélaton)<br />
Eugène Delacroix (1798-1863)<br />
Étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> ciel. Crépuscu<strong>le</strong>, 1850<br />
Pastel<br />
Ce pastel fait partie d’une série d’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> ciel<br />
réalisée en 1850 à Champrosay, village près <strong>de</strong> la<br />
forêt <strong>de</strong> Sénart où Delacroix avait une maison.<br />
Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Arts<br />
graphiques, RF 3706 (<strong>le</strong>gs Raymond Kœchlin)<br />
James McNeill Whist<strong>le</strong>r (1834-1903)<br />
Bord <strong>de</strong> mer<br />
Aquarel<strong>le</strong><br />
Paris, musée d’Orsay, RF 35897 (<strong>le</strong>gs Robert Le<br />
Mas<strong>le</strong>)<br />
Albert <strong>de</strong> Bal<strong>le</strong>roy (1828-1872)<br />
Vue d’une plage norman<strong>de</strong><br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
Dans <strong>le</strong>s années 1850, Delacroix exécuta <strong>de</strong>s marines,<br />
notamment à Etretat et Dieppe, qui précé<strong>de</strong>nt cel<strong>le</strong>s<br />
<strong>de</strong> Boudin, Bazil<strong>le</strong> et <strong>Mo</strong>net. Ami <strong>de</strong> Manet, Alfred<br />
<strong>de</strong> Bal<strong>le</strong>roy figure sur l’Hommage à Delacroix.<br />
Château <strong>de</strong> Bal<strong>le</strong>roy (Calvados), col<strong>le</strong>ction Forbes<br />
Édouard Manet (1832-1884)<br />
La Barque <strong>de</strong> Dante, d’après Delacroix.<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
Manet réalisa dans <strong>le</strong>s années 1855-1858 <strong>de</strong>ux copies<br />
d’après <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au <strong>de</strong> Delacroix (<strong>Louvre</strong>), l’autre étant<br />
conservée au Metropolitan Museum <strong>de</strong> New York.<br />
Son Buveur d’absinthe (Copenhague, Ny Carlsberg<br />
Glyptotek) fut refusé au Salon <strong>de</strong> 1859, malgré l’avis<br />
favorab<strong>le</strong> <strong>de</strong> Delacroix.<br />
Antonin Proust relate dans ses souvenirs sur Manet :<br />
«Il y a au Luxembourg une maitresse toi<strong>le</strong> [fit Manet].<br />
Si nous allions voir Delacroix ? nous prendrions pour<br />
prétexte <strong>de</strong> notre visite <strong>de</strong> lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r l’autorisation<br />
<strong>de</strong> faire une copie <strong>de</strong> la Barque <strong>de</strong> Dante. “Prenez<br />
gar<strong>de</strong>, nous avait dit Murger, à qui Manet avait fait<br />
part <strong>de</strong> son projet en déjeunant, Delacroix est froid. ”<br />
Delacroix nous reçut, au contraire, dans son atelier <strong>de</strong><br />
la rue Notre-Dame-<strong>de</strong>-Lorette avec une grâce parfaite,<br />
nous questionna sur nos préférences et nous indiqua<br />
<strong>le</strong>s siennes. […] Manet me dit : “Ce n’est pas<br />
Delacroix qui est froid : c’est sa doctrine qui est<br />
glacia<strong>le</strong>. Malgré tout, copions la Barque”.»<br />
Lyon, musée <strong>de</strong>s Beaux-Arts, Inv B 830.<br />
Liste <strong>de</strong>s œuvres exposées<br />
Texte <strong>de</strong>s cartels <strong>de</strong> l’exposition<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Femme au narguilé d’après Les Femmes d’Alger<br />
d’Eugène Delacroix, 1854.<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
La même année Fantin reprit éga<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> groupe<br />
central <strong>de</strong> L’Entrée <strong>de</strong>s croisés à Constantinop<strong>le</strong>, un<br />
groupe <strong>de</strong>s Massacres <strong>de</strong> Chio, et une autre figure <strong>de</strong>s<br />
Femmes d’Alger. Il copia la composition complète en<br />
1875.<br />
Paris, col<strong>le</strong>ction particulière.<br />
Henri Fantin-Latour d’après Eugène Delacroix<br />
Goetz écrivant ses mémoires.<br />
Crayon graphite et encre sur papier calque<br />
Copie par Fantin exécutée non d’après la lithographie<br />
original <strong>de</strong> Delacroix mais <strong>le</strong>s illustrations d’une<br />
brochure publiée à l’occasion <strong>de</strong> l’exposition Delacroix<br />
<strong>de</strong> 1864 où quatre planches <strong>de</strong> la série étaient<br />
repro<strong>du</strong>ites.<br />
Grenob<strong>le</strong>, <strong>Musée</strong>, MG IS 63-7 (don <strong>de</strong> Mme Fantin-<br />
Latour)<br />
Henri Fantin-Latour d’après Eugène Delacroix<br />
Goetz b<strong>le</strong>ssé secouru par <strong>de</strong>s Bohémiens.<br />
Crayon graphite et encre sur papier calque<br />
Grenob<strong>le</strong>, <strong>Musée</strong>, MG IS 63-8 (don <strong>de</strong> Mme Fantin-<br />
Latour)<br />
Henri Fantin-Latour d’après Eugène Delacroix<br />
Goetz et frère Martin.<br />
Crayon graphite et encre sur papier calque<br />
Grenob<strong>le</strong>, <strong>Musée</strong>, MG IS 63-6 (don <strong>de</strong> Mme Fantin-<br />
Latour)<br />
Pa<strong>le</strong>tte et pinceaux ayant appartenu à Delacroix<br />
Suivant <strong>le</strong> donateur, qui <strong>de</strong>scendait <strong>de</strong> la famil<strong>le</strong><br />
Riesener avec laquel<strong>le</strong> Fantin était liée, ces souvenirs <strong>de</strong><br />
Delacroix proviendraient <strong>de</strong> Fantin-Latour. Ce <strong>de</strong>rnier<br />
accordait un grand soin à la préparation <strong>de</strong> ses pa<strong>le</strong>ttes<br />
et s’intéressa particulièrement à la façon dont Delacroix<br />
composait <strong>le</strong>s siennes.<br />
Paris, musée Eugène-Delacroix MD 2002-257 et 258 ab<br />
(don <strong>de</strong> Mme Claudie Léouzon-<strong>le</strong>-Duc via la Société<br />
<strong>de</strong>s Amis <strong>de</strong> Delacroix)<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Re<strong>le</strong>vé <strong>de</strong> la composition <strong>de</strong> la pa<strong>le</strong>tte <strong>de</strong> Delacroix,<br />
janvier 1866<br />
Fantin était particulièrement méticu<strong>le</strong>ux dans la<br />
préparation <strong>de</strong> sa pa<strong>le</strong>tte. Les notes très précises que<br />
l’on conserve <strong>de</strong> lui au sujet <strong>de</strong> sa composition (fonds<br />
Fantin <strong>de</strong> la bibliothèque municipa<strong>le</strong> <strong>de</strong> Grenob<strong>le</strong>)<br />
montrent sa proximité avec cel<strong>le</strong> <strong>de</strong> Delacroix, intérêt<br />
que corrobore ce re<strong>le</strong>vé, <strong>de</strong> la main <strong>de</strong> Fantin, <strong>de</strong>s<br />
cou<strong>le</strong>urs employées par <strong>le</strong> maître.<br />
Paris, Fondation Custodia, inv. 1997-A.928<br />
1
Philippe Burty (1830-1890)<br />
Lettre à Henri Fantin-Latour, à propos <strong>de</strong> ses<br />
lithographies, 25 septembre 1862<br />
Le criçtique Philippe Burty félicite Fantin pour <strong>le</strong>s<br />
lithographies qu’il lui a offertes et lui adresse une<br />
planche <strong>de</strong> Delacroix. « J’aimais déjà vos peintures,<br />
<strong>Mo</strong>nsieur, et vos étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> f<strong>le</strong>urs, mais aujourd’hui, je<br />
vous sens une force incontestab<strong>le</strong> et je vous vois une<br />
<strong>de</strong>s plus bel<strong>le</strong>s places dans la jeune éco<strong>le</strong>. […]. Vous<br />
trouverez ci-joint une épreuve d’une <strong>de</strong>s lithographies<br />
<strong>de</strong> Mr Eugène Delacroix pour l’Ham<strong>le</strong>t. Si par hasard,<br />
vous la possédiez déjà, et qu’une autre vous soit plus<br />
agréab<strong>le</strong>, j’espère que vous viendrez un soir la choisir<br />
dans mes cartons. »<br />
Paris, Fondation Custodia, inv. 1997-A.786.<br />
Eugène Delacroix (1798-1863)<br />
Bouquet <strong>de</strong> f<strong>le</strong>urs, 1849.<br />
Aquarel<strong>le</strong>, gouache et pastel<br />
Dans <strong>le</strong> cadre d’un échange <strong>de</strong> ses œuvres avec <strong>le</strong><br />
marchand Vollard, Cézanne obtint en 1902 ce bouquet<br />
qu’il plaça dans sa chambre à Aix-en-Provence. Il <strong>le</strong><br />
conservait tourné vers <strong>le</strong> mur pour <strong>le</strong> protéger <strong>du</strong> so<strong>le</strong>il<br />
et en exécuta une copie à l’hui<strong>le</strong> (<strong>Mo</strong>scou, musée<br />
Pouchkine). Il avait copié comme Manet, vers 1863-<br />
1864, la Barque <strong>de</strong> Dante. Plus tard, il esquissa une<br />
Apothéose <strong>de</strong> Delacroix (Aix-en-Provence, musée<br />
Granet).<br />
Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Arts<br />
graphiques, RF 31719 (<strong>le</strong>gs César Mange <strong>de</strong> Haucke)<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Chrysanthèmes dans un vase, 1875.<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
Même s’il se lassa <strong>de</strong> la peinture <strong>de</strong> f<strong>le</strong>urs à la fin <strong>de</strong> sa<br />
vie, Fantin en vécut toute sa carrière grâce au marché<br />
anglais. Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> cet intérêt commercial, l’artiste s’y<br />
adonna avec sincérité, comme il l’écrit <strong>de</strong> Londres à<br />
ses parents en 1864 : «Je vais me reposer et faire mes<br />
bouquets avec plaisir et tout doucement, tâcher <strong>de</strong> faire<br />
<strong>de</strong> [la] bonne peinture. »<br />
Madrid, Museo Thyssen Bornemisza, 1971-10.<br />
Frédéric Bazil<strong>le</strong> (1841-1870)<br />
L’Atelier <strong>de</strong> la rue <strong>de</strong> Fürstenberg, 1866.<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
Le peintre ne s’installa au <strong>de</strong>rnier étage <strong>de</strong> l’immeub<strong>le</strong><br />
où nous sommes qu’à la fin <strong>de</strong> 1864, un an après la<br />
mort <strong>de</strong> Delacroix. Sa correspondance témoigne<br />
cependant <strong>de</strong> son admiration pour <strong>le</strong> maître.<br />
<strong>Mo</strong>ntpellier, musée Fabre, Inv. 85.5.3.<br />
Ed. Albertini<br />
L’Exposition <strong>de</strong>s œuvres <strong>de</strong> Delacroix aux ga<strong>le</strong>ries<br />
Martinet, bou<strong>le</strong>vard <strong>de</strong>s Italiens, en 1864.<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
A défaut d’une exposition plus officiel<strong>le</strong> à l’Eco<strong>le</strong> <strong>de</strong>s<br />
Beaux-arts, une rétrospective <strong>de</strong> l’œuvre <strong>de</strong> Delacroix<br />
eut lieu en 1864 dans <strong>le</strong>s ga<strong>le</strong>ries Martinet à l’initiative<br />
privée <strong>de</strong> la Société nationa<strong>le</strong> <strong>de</strong>s beaux-arts fondée<br />
par Théophi<strong>le</strong> Gautier et Louis Martinet.<br />
Le tab<strong>le</strong>au donne une image sé<strong>du</strong>isante <strong>de</strong><br />
l’aménagement <strong>de</strong>s trois gran<strong>de</strong>s sal<strong>le</strong>s et <strong>de</strong><br />
l’importance <strong>de</strong>s prêts obtenus grâce à l’appui <strong>de</strong><br />
Napoléon III contre son administration : cent cinquante<br />
tab<strong>le</strong>aux et une centaine <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssins et estampes. Une<br />
programmation <strong>de</strong> concerts et <strong>de</strong> conférences comptait<br />
parmi <strong>le</strong>s agréments <strong>du</strong> lieu. Ainsi A<strong>le</strong>xandre Dumas<br />
vint-il évoquer en public ses souvenirs sur Delacroix.<br />
Paris, musée Carnava<strong>le</strong>t – Histoire <strong>de</strong> Paris, P. 1440<br />
Commission <strong>de</strong> l’exposition Delacroix <strong>de</strong> la Société<br />
nationa<strong>le</strong> <strong>de</strong>s Beaux-Arts<br />
Lettre au comte <strong>de</strong> Nieuwerkerke, surintendant <strong>de</strong>s<br />
Beaux-Arts, mai 1864<br />
Cette <strong>le</strong>ttre <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> prêt <strong>de</strong>s œuvres <strong>de</strong> Delacroix<br />
propriétés <strong>de</strong> l’Etat est signée <strong>de</strong> tous <strong>le</strong>s membres <strong>de</strong> la<br />
commission chargée <strong>de</strong> l’organisation <strong>de</strong> l’exposition<br />
Delacroix : artistes comme Cabanel, Pils, Puvis <strong>de</strong><br />
Chavannes,, Ziem et Carrier-Bel<strong>le</strong>use, col<strong>le</strong>ctionneurs<br />
comme <strong>le</strong>s frères Pereire, et <strong>de</strong>s proches <strong>du</strong><br />
peintre comme Riesener, Haro, Andrieux et Philippe<br />
Burty, son exécuteur testamentaire. La <strong>le</strong>ttre est annotée<br />
défavorab<strong>le</strong>ment par Nieuwerkerke.<br />
Paris, Archives <strong>de</strong>s musées nationaux, P 11 X<br />
Concessions, 1864<br />
Jean-Baptiste Vaillant (1790-1872), maréchal, ministre<br />
<strong>de</strong> la Maison <strong>de</strong> l’Empereur et <strong>de</strong>s Beaux-Arts<br />
Lettre au comte <strong>de</strong> Nieuwerkerke, surintendant <strong>de</strong>s<br />
Beaux-Arts, 14 mai 1864<br />
«<strong>Mo</strong>n cher Comte, J’ai pris <strong>le</strong>s ordres <strong>de</strong> l’Empereur :<br />
Sa majesté nous ordonne <strong>de</strong> prêter <strong>le</strong>s tab<strong>le</strong>aux <strong>de</strong><br />
Delacroix. Votre dévoué.»<br />
De même qu’il avait soutenu <strong>le</strong>s artistes trop<br />
sévèrement traités par <strong>le</strong> jury <strong>de</strong> l’Académie au Salon <strong>de</strong><br />
1863, en suscitant la tenue d’une section dite « Salon<br />
<strong>de</strong>s Refusés », Napoléon III imposa <strong>le</strong> prêt <strong>le</strong>s toi<strong>le</strong>s <strong>de</strong><br />
Delacroix <strong>de</strong>s musées <strong>du</strong> Luxembourg et <strong>de</strong> Versail<strong>le</strong>s à<br />
la rétrospective.<br />
Paris, Archives <strong>de</strong>s musées nationaux P 11 X<br />
Concessions, 1864<br />
Théophi<strong>le</strong> Gautier (1811-1872)<br />
Lettre au comte <strong>de</strong> Nieuwerkerke, surintendant <strong>de</strong>s<br />
Beaux-Arts, 28 juil<strong>le</strong>t 1864<br />
Dans cette <strong>le</strong>ttre à l’en tête <strong>de</strong> la Société nationa<strong>le</strong> <strong>de</strong>s<br />
Beaux-Arts dont il était <strong>le</strong> prési<strong>de</strong>nt, Gautier doit<br />
rappe<strong>le</strong>r au comte <strong>de</strong> Nieuwerkerke l’engagement <strong>de</strong><br />
l’Etat à prêter <strong>le</strong>s toi<strong>le</strong>s <strong>de</strong> Delacroix à l’exposition qui<br />
doit ouvrir incessamment.<br />
Paris, Archives <strong>de</strong>s musées nationaux P 11 X<br />
Concessions, 1864<br />
2
Louis Cordier (1823- vers 1875)<br />
Lettre à Henri Fantin-Latour, 2 octobre 1864<br />
Peintre oublié hormis pour sa présence dans<br />
l’Hommage à Delacroix, Louis Cordier évoque dans<br />
<strong>de</strong>ux <strong>le</strong>ttres à Fantin, alors à Londres, ses visites <strong>de</strong><br />
l’exposition Delacroix <strong>de</strong> 1864 et ses relations avec <strong>le</strong>s<br />
autres figurants <strong>du</strong> tab<strong>le</strong>au : «Aurais-je donc parlé en<br />
termes irrévérencieux <strong>de</strong> Delacroix dans ma <strong>de</strong>rnière<br />
<strong>le</strong>ttre. S’il en était ainsi, je <strong>le</strong> regretterai beaucoup,<br />
mais en vérité, dans <strong>le</strong>s jours <strong>de</strong> lassitu<strong>de</strong> sa peinture<br />
m’est pénib<strong>le</strong>, ce qui ne m’arrive jamais pour <strong>le</strong>s<br />
choses bel<strong>le</strong>s et sereines <strong>de</strong>s anciens maîtres et même<br />
<strong>de</strong> Ingres. Comme vous, je trouve que Delacroix est<br />
une superbe intelligence, mais il a toujours marché<br />
dans une fausse voie, ce qui prouve une fois <strong>de</strong> plus<br />
son génie, puisqu’avec <strong>de</strong> mauvais moyens, il a su<br />
combattre et triompher . Lorsque je verrai Manet et<br />
Bracquemond, je <strong>le</strong>ur transmettrai vos compliments ; je<br />
suis allé hier au café <strong>de</strong> Ba<strong>de</strong> dans cette intention, mais<br />
je ne <strong>le</strong>s ai pas rencontrés. […] Je voudrais pouvoir,<br />
selon votre intention, donner aussi <strong>de</strong> vos nouvel<strong>le</strong>s à<br />
Duranty ; je passerai exprès au café <strong>de</strong> la Fontaine dans<br />
l’espérance <strong>de</strong> <strong>le</strong> rencontrer […]. Adieu, ou plutôt à<br />
bientôt. Mes compliments à Legros et à Whist<strong>le</strong>r.»<br />
Paris, Fondation Custodia, inv. 1997-A.813<br />
Sal<strong>le</strong> 2<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Autoportrait, 1860.<br />
Fusain et lavis<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 15651.<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Autoportrait, 1859.<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
Fantin offrit cette esquisse à Félix Régamey, frère <strong>de</strong><br />
Guillaume, son condiscip<strong>le</strong> chez Lecoq <strong>de</strong><br />
Boisbaudran.<br />
Lyon, musée <strong>de</strong>s Beaux-Arts, Inv B 1153-d (<strong>le</strong>gs <strong>du</strong><br />
Dr Tripier)<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Autoportrait, vers 1858.<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
L’exercice <strong>de</strong> l’autoportrait permet à Fantin d’étudier<br />
<strong>le</strong>s effets <strong>de</strong> lumière, <strong>du</strong> clair-obscur <strong>le</strong> plus contrasté à<br />
un <strong>de</strong>mi-jour indistinct.<br />
Bor<strong>de</strong>aux, musée <strong>de</strong>s Beaux-Arts, Bx E 1688 (don <strong>de</strong><br />
M. et Mme <strong>de</strong> Graaff)<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Autoportrait, 1860.<br />
Crayon graphite et fusain<br />
Lil<strong>le</strong>, Palais <strong>de</strong>s Beaux-Arts, W. 2076 (don <strong>de</strong> Mme<br />
Fantin-Latour)<br />
Ju<strong>le</strong>s Castagnary (1830-188)<br />
Lettre à Henri Fantin-Latour, 1 ère séance <strong>de</strong> l’atelier<br />
Courbet, 7 octobre 1861<br />
Inscrit dès sa création dans l’atelier <strong>de</strong> Courbet (1819-<br />
1877), rue Hautefeuil<strong>le</strong>, Fantin ne prolongea pas très<br />
longtemps sa formation auprès d’un maître dont il<br />
récusa plus tard l’héritage, en partie en raison <strong>de</strong> la forte<br />
personnalité <strong>du</strong> maître d’Ornans. Whist<strong>le</strong>r fut sensib<strong>le</strong><br />
au réalisme social dans ses premières œuvres, mais c’est<br />
surtout Legros qui resta davantage dans son orbite<br />
comme l’illustre son Ex-voto (1860, Dijon, musée <strong>de</strong>s<br />
Beaux-Arts), acquis par Albert <strong>de</strong> Bal<strong>le</strong>roy.<br />
Paris, Fondation Custodia, inv. 1997-A.823<br />
James McNeill Whist<strong>le</strong>r (1834-1903)<br />
Portrait <strong>de</strong> Fantin-Latour, 1859.<br />
Crayon noir et crayon graphite<br />
Comme l’indique l’inscription en haut, ce <strong>de</strong>ssin<br />
témoigne <strong>de</strong>s années <strong>de</strong> bohème <strong>de</strong>s jeunes artistes :<br />
« Fantin au lit, la poursuite <strong>de</strong> ses étu<strong>de</strong>s sous <strong>de</strong>s<br />
difficultés, 14° <strong>de</strong> froid, Déc. <strong>le</strong> 20 1859. Whist<strong>le</strong>r »<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 12246 (don <strong>de</strong> Mme Fantin-<br />
Latour).<br />
James McNeill Whist<strong>le</strong>r (1834-1903)<br />
The Music Room, 1859<br />
Eau-forte et pointe-sèche<br />
Whist<strong>le</strong>r a représenté ici <strong>le</strong> chirurgien, graveur et<br />
col<strong>le</strong>ctionneur Francis Seymour Ha<strong>de</strong>n, son épouse<br />
Deborah qui était la <strong>de</strong>mi-sœur <strong>de</strong> l’artiste, et l’associé<br />
<strong>de</strong> Ha<strong>de</strong>n dans ses activités médica<strong>le</strong>s, James Reeves<br />
Traer. Ha<strong>de</strong>n hébergea Fantin dans da <strong>de</strong>meure<br />
londonienne, Sloane Street, l’initia à la gravure et lui<br />
commanda <strong>de</strong>s tab<strong>le</strong>aux. Le thème si<strong>le</strong>ncieux <strong>de</strong> la<br />
<strong>le</strong>cture sous la lampe fut éga<strong>le</strong>ment traité par Fantin.<br />
Paris, col<strong>le</strong>ction <strong>de</strong> la ga<strong>le</strong>rie Paul-Prouté<br />
Félix Bracquemond (1833-1914)<br />
Portrait d’Alphonse Legros, 1861.<br />
Eau-forte<br />
Tous <strong>de</strong>ux brillants graveurs, Legros comme<br />
Bracquemond participèrent au renouveau <strong>du</strong> genre que<br />
fédéra la Société <strong>de</strong>s Aquafortistes créée en 1862 à<br />
l’initiative <strong>de</strong> l’éditeur Cadart.<br />
Paris, Bibliothèque nationa<strong>le</strong> <strong>de</strong> France, département<br />
<strong>de</strong>s Estampes et <strong>de</strong> la Photographie, EF-411 (5) IFF 138<br />
Alphonse Legros (1837-1911)<br />
Portrait <strong>de</strong> Manet assis, 1863.<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
Bien que ce portrait ait été admis par <strong>le</strong> jury dans la<br />
section officiel<strong>le</strong> <strong>du</strong> Salon <strong>de</strong> 1863, Legros préféra <strong>le</strong><br />
présenter au Salon <strong>de</strong>s Refusés non loin <strong>du</strong> Déjeuner<br />
sur l’herbe <strong>de</strong> Manet, ce qui lui assura davantage<br />
d’écho.<br />
Paris, Petit Palais – musée <strong>de</strong>s Beaux-Arts <strong>de</strong> la Vil<strong>le</strong> <strong>de</strong><br />
Paris, cat. 1982, n° 531.<br />
Alphonse Legros (1837-1911)<br />
Bil<strong>le</strong>t à Fantin, pour déjeuner<br />
Paris, Fondation Custodia, inv. 1997-A.807<br />
3
Edouard Manet (1832-1884)<br />
Bil<strong>le</strong>t à Henri Fantin-Latour, invitation à dîner avec<br />
Alphonse Legros<br />
Paris, Fondation Custodia, inv. 1997-A.651<br />
Edouard Manet (1832-1884)<br />
Bil<strong>le</strong>t à Henri Fantin-Latour, invitation à dîner avec<br />
Félix Bracquemond<br />
Paris, Fondation Custodia, inv. 1997-A.654b<br />
Edouard Manet (1832-1884)<br />
Lettre à Henri Fantin-Latour, au sujet <strong>de</strong> Londres,<br />
1868<br />
Les liens <strong>de</strong> Manet et <strong>de</strong> Fantin allèrent se renforçant.<br />
Outre <strong>le</strong> beau portrait en pied <strong>de</strong> son ami, Fantin lui<br />
consacra sa gran<strong>de</strong> toi<strong>le</strong> Un Atelier aux Batignol<strong>le</strong>s.<br />
L’intérêt « médiatique » <strong>de</strong> tel<strong>le</strong>s effigies est<br />
clairement évoqué par Manet dans cette <strong>le</strong>ttre à Fantin<br />
écrite <strong>de</strong> Boulogne-sur-Mer, au retour d’un bref séjour<br />
à Londres, en 1868, où il sentit qu’il pourrait y<br />
remporter un certain succès.<br />
« J’ai été enchanté <strong>de</strong> Londres, <strong>de</strong> la bonne réception<br />
que j’y ai reçu par tous <strong>le</strong>s gens chez qui j’ai été,<br />
Legros a été très aimab<strong>le</strong> et très complaisant. […]<br />
Whist<strong>le</strong>r n’étant pas à Londres, je n’ai pu <strong>le</strong> voir. J’en<br />
ai été très fâché, il était en excursion sur son yacht.<br />
Mais je crois qu’il y a à faire quelque chose là-bas. Le<br />
terrain, l’atmosphère, tout m’y plait et je vais tenter <strong>de</strong><br />
m’y pro<strong>du</strong>ire l’année prochaine. Il faudrait entre autre<br />
chose que vous exposiez [comme] ouvrage mon<br />
portrait, ce serait très favorab<strong>le</strong> à tous <strong>de</strong>ux. Adieu,<br />
mon cher Fantin, donne- moi un peu <strong>de</strong> vos nouvel<strong>le</strong>s,<br />
dites-moi ce qui se passe à Paris, par<strong>le</strong>z-moi <strong>de</strong> vous et<br />
<strong>de</strong> nos amis communs – bien <strong>de</strong>s choses à Duranty. Je<br />
vous serre la main et suis tout à vous.»<br />
Paris, Fondation Custodia, inv. 1997-A.648<br />
Antoine Etex (1808-1888)<br />
Buste <strong>de</strong> Delacroix, 1865<br />
Marbre<br />
Elève d’Ingres mais auteur <strong>du</strong> tombeau <strong>de</strong> Géricault au<br />
cimetière <strong>du</strong> Père-Lachaise (1839), Etex exposa au<br />
Salon <strong>de</strong> 1865 ce portrait posthume <strong>de</strong> Delacroix en<br />
habit d’académiciens (n°2968). Il fut jugé moins<br />
inspiré que celui en bronze que présenta Albert<br />
Carrier-Bel<strong>le</strong>use à la même exposition (n°2898).<br />
Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Sculptures,<br />
RF 1847<br />
Sal<strong>le</strong> 3a (vestibu<strong>le</strong> <strong>de</strong> l’Atelier)<br />
Paul Baudry (1828-1886)<br />
Portrait d’Albert <strong>de</strong> Bal<strong>le</strong>roy, 1859.<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
Après avoir longtemps partagé un atelier avec Manet,<br />
Bal<strong>le</strong>roy prêta régulièrement à Fantin celui où il<br />
s’installa ensuite, lorsqu’il quittait Paris pour son<br />
château normand. Il figure sur l’Hommage à<br />
Delacroix.<br />
Château <strong>de</strong> Bal<strong>le</strong>roy (Calvados), col<strong>le</strong>ction Forbes<br />
Albert <strong>de</strong> Bal<strong>le</strong>roy (1828-1872)<br />
Combat <strong>de</strong> chevaux (esquisse).<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
Peintre ta<strong>le</strong>ntueux, Bal<strong>le</strong>roy n’entreprit pas une<br />
véritab<strong>le</strong> carrière professionnel<strong>le</strong> en raison <strong>de</strong> son statut<br />
social, et se cantonna aux sujets animaliers et scènes <strong>de</strong><br />
chasse.<br />
Bayeux, musée Baron-Gérard, P 0328 (<strong>le</strong>gs <strong>du</strong> marquis<br />
Philippe <strong>de</strong> Bal<strong>le</strong>roy)<br />
Albert <strong>de</strong> Bal<strong>le</strong>roy (1828-1872)<br />
Combat <strong>de</strong> chevaux, 1866.<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
Cette toi<strong>le</strong> s’inspire directement d’une œuvre d’Eugène<br />
Delacroix <strong>de</strong> 1860, Chevaux arabes se battant dans une<br />
écurie (musée d’Orsay).<br />
Bayeux, musée Baron-Gérard, P 0227 (<strong>le</strong>gs <strong>du</strong> marquis<br />
Philippe <strong>de</strong> Bal<strong>le</strong>roy)<br />
Sal<strong>le</strong> 3b (Atelier)<br />
Institut impéria<strong>le</strong> <strong>de</strong> France<br />
Invitation aux funérail<strong>le</strong>s <strong>de</strong> Delacroix, <strong>le</strong> 17 août 1863<br />
Après une messe à Saint-Germain-<strong>de</strong>s-Prés, <strong>le</strong> cortège<br />
se rendit au Père-Lachaise. Les cordons <strong>du</strong> poê<strong>le</strong> étaient<br />
tenus par <strong>le</strong> comte <strong>de</strong> Nieuwerkerke, surintendant <strong>de</strong>s<br />
Beaux-Arts, <strong>le</strong> sculpteur François Jouffroy, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />
l’Académie <strong>de</strong>s beaux-arts, <strong>le</strong> peintre Hippolyte<br />
Flandrin et l’architecte Alphonse <strong>de</strong> Gisors. Le 20 e<br />
bataillon <strong>de</strong> la gar<strong>de</strong> nationa<strong>le</strong> rendit <strong>le</strong>s honneurs au<br />
comman<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> la Légion d’honneur qu’était Delacroix.<br />
Des <strong>de</strong>ux discours prononcés sur la tombe, celui <strong>de</strong><br />
Jouffroy au nom <strong>de</strong> l’Académie gêna l’assistance par<br />
<strong>de</strong>s sous-enten<strong>du</strong>s qui marquaient la distance <strong>de</strong><br />
l’institution par rapport à un artiste qu’el<strong>le</strong> avait tant<br />
tardé à accueillir dans ses rangs.<br />
Paris, Archives <strong>de</strong>s musées nationaux, P 30 Delacroix<br />
Col<strong>le</strong>ctions permanentes (au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> la cimaise)<br />
Paul Huet (1803-1869)<br />
Calme <strong>du</strong> matin ; intérieur <strong>de</strong> forêt<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong>.<br />
Lors <strong>de</strong>s funérail<strong>le</strong>s <strong>de</strong> Delacroix, après l’allocution <strong>du</strong><br />
sculpteur François Jouffroy, au nom <strong>de</strong> l’Académie, qui<br />
gêna l’assistance par <strong>de</strong>s sous-enten<strong>du</strong>s peu favorab<strong>le</strong>s<br />
envers l’artiste, l’éloge prononcé par Paul Huet au nom<br />
<strong>de</strong>s amis <strong>du</strong> peintre l’emporta par sa cha<strong>le</strong>ur.<br />
Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Peintures, Inv.<br />
5414<br />
Col<strong>le</strong>ctions permanentes (au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> la cimaise)<br />
Eugène Delacroix (1798-1863)<br />
L’E<strong>du</strong>cation <strong>de</strong> la Vierge, 1842<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
La toi<strong>le</strong> fut peinte pour l’église <strong>de</strong> Nohant lors d’un<br />
séjour chez George Sand. Soumise au jury <strong>du</strong> Salon <strong>de</strong><br />
1845, l’œuvre fut refusée et retourna dans <strong>le</strong> Berry. Des<br />
difficultés d’argent poussèrent George Sand à la mettre<br />
en vente un an après la mort <strong>de</strong> Delacroix.<br />
Paris, musée Eugène-Delacroix, MD 2003-8<br />
4
Étienne Carjat (1828-1906)<br />
Portrait <strong>de</strong> Char<strong>le</strong>s Bau<strong>de</strong>laire<br />
Photographie<br />
Ce portrait « carte <strong>de</strong> visite » <strong>du</strong> poète et critique a<br />
appartenu à Fantin-Latour.<br />
Paris, Fondation Custodia, inv. 1997-A.705a<br />
Char<strong>le</strong>s Bau<strong>de</strong>laire (1821-1867))<br />
Liste <strong>de</strong> noms, annotée par Fantin-Latour<br />
Bau<strong>de</strong>laire aurait souhaité que Delacroix apparaisse<br />
sur l’Hommage au milieu <strong>de</strong>s grands hommes qui l’ont<br />
inspiré, ce que confirme cette liste rapi<strong>de</strong>ment<br />
crayonnée : « Raphaël, Michel-Ange, Rubens,<br />
Véronèse, Rembrandt, Vélasquez, Goethe, Byron,<br />
Shakespeare, Arioste, Dante, Virgi<strong>le</strong>, Haydn,<br />
Beethoven, <strong>Mo</strong>zart, Weber ». Fantin a inscrit sur <strong>le</strong><br />
côté : « De Bau<strong>de</strong>laire / pour mon tab<strong>le</strong>au / A<br />
Delacroix », et collé plus tard cette note au revers<br />
d’une feuil<strong>le</strong> formant l’enveloppe d’une <strong>le</strong>ttre <strong>du</strong><br />
critique.<br />
Paris, Fondation Custodia, inv. 1997-A.705<br />
L’idée première <strong>de</strong> Fantin relève d’une tradition<br />
ancienne, cel<strong>le</strong> <strong>de</strong>s frontispices gravés où un buste <strong>de</strong><br />
l’auteur ou <strong>du</strong> personnage central <strong>du</strong> livre est couronné<br />
par une Victoire, une Renommée ou une figure <strong>de</strong> la<br />
Gloire. Le couronnement d’un buste intervenait dans<br />
certaines cérémonies académiques, l’épiso<strong>de</strong> <strong>le</strong> plus<br />
spectaculaire ayant été <strong>le</strong> couronnement public, en<br />
présence <strong>de</strong> l’auteur, <strong>du</strong> buste <strong>de</strong> Voltaire sur la scène<br />
<strong>du</strong> Théâtre-Français en 1778.<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Étu<strong>de</strong> pour l’Hommage à Delacroix,<br />
11 septembre 1863.<br />
Crayon graphite, plume et lavis<br />
Datant <strong>de</strong> moins d’un mois après l’enterrement <strong>de</strong><br />
Delacroix, ce premier <strong>de</strong>ssin conservé donne la<br />
première sé<strong>le</strong>ction <strong>de</strong>s personnages.<br />
Chaque figure est numérotée : « 1 <strong>Mo</strong>i ; 2 Legros ;<br />
3 Whist<strong>le</strong>r ; 4 Manet ; 5 Bracquemond ; 6 Duranty ;<br />
7 Myionnet, regar<strong>de</strong> <strong>le</strong> public ; 8 Guillaume<br />
[Régamey] ; 9 Cordier ». Initia<strong>le</strong>ment, c’est donc<br />
Fantin lui-même qui couronnait <strong>le</strong> buste <strong>de</strong> Delacroix<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 12696 (don <strong>de</strong> Mme Fantin-<br />
Latour).<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Étu<strong>de</strong> pour l’Hommage à Delacroix, 13 septembre<br />
1863.<br />
Fusain<br />
La femme qui couronne à présent <strong>le</strong> buste serait <strong>le</strong><br />
sculpteur Marcello, <strong>de</strong> son vrai nom Adè<strong>le</strong> d’Affry,<br />
<strong>du</strong>chesse <strong>de</strong> Castiglione Colonna, amie <strong>de</strong> Delacroix,<br />
et qui avait placé une couronne sur son cercueil.<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 3413 (don Étienne <strong>Mo</strong>reau-<br />
Nélaton).<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Étu<strong>de</strong> pour l’Hommage à Delacroix.<br />
Crayon graphite<br />
C’est désormais l’allégorie ailée <strong>de</strong> la Gloire, tenant ici<br />
une palme, ou sur d’autres essais, la trompette <strong>de</strong> la<br />
Renommée, qui couronne <strong>le</strong> buste.<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 12640 (don <strong>de</strong> Mme Fantin-<br />
Latour).<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Étu<strong>de</strong> pour l’Hommage à Delacroix<br />
Crayon graphite<br />
Fantin se distingue nettement <strong>du</strong> groupe par sa blouse<br />
blanche <strong>de</strong> peintre et sa pa<strong>le</strong>tte, attribut qu’il conserve<br />
sur la toi<strong>le</strong> définitive.<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 12467 (don <strong>de</strong> Mme Fantin-<br />
Latour).<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Étu<strong>de</strong> pour l’Hommage à Delacroix, 2 octobre 1863.<br />
Crayon graphite, lavis gris<br />
Le buste est passé <strong>de</strong> la droite à la gauche <strong>de</strong> la<br />
composition. La figure éplorée assise au pied <strong>de</strong> la<br />
colonne serait la Peinture en <strong>de</strong>uil.<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 12470 (don <strong>de</strong> Mme Fantin-<br />
Latour).<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Étu<strong>de</strong> pour l’Hommage à Delacroix, 6 octobre 1863.<br />
Crayon graphite<br />
L’espace architectural est clarifié, <strong>le</strong> groupe <strong>de</strong>s<br />
admirateurs semblant <strong>de</strong>scendre d’un temp<strong>le</strong>. La Gloire<br />
a disparu et c’est un <strong>de</strong>s hommes qui couronne <strong>le</strong> buste.<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 12641 (don <strong>de</strong> Mme Fantin-<br />
Latour).<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Étu<strong>de</strong> pour l’Hommage à Delacroix.<br />
Crayon graphite, lavis gris, gouache<br />
Dans ces recherches, l’artiste n’essaie pas d’élu<strong>de</strong>r <strong>le</strong><br />
contraste entre l’allégorie drapée et <strong>le</strong>s chapeaux hauts<br />
<strong>de</strong> forme <strong>de</strong>s contemporains.<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 12468 (don <strong>de</strong> Mme Fantin-<br />
Latour).<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Étu<strong>de</strong> pour l’Hommage à Delacroix.<br />
Crayon graphite, lavis gris, gouache<br />
La secon<strong>de</strong> allégorie féminine a disparu et l’un <strong>de</strong>s<br />
protagonistes inscrit <strong>le</strong> nom <strong>de</strong> Delacroix au-<strong>de</strong>ssus <strong>du</strong><br />
buste, Fantin <strong>de</strong>ssinant la scène, <strong>de</strong>bout à droite.<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 12469 (don <strong>de</strong> Mme Fantin-<br />
Latour).<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Étu<strong>de</strong> pour l’Hommage à Delacroix, 6 janvier 1864.<br />
Fusain<br />
Ici réapparaît une allégorie tracée à l’estompe, qui<br />
embouche la trompette <strong>de</strong> la Renommée.<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 12652 (don <strong>de</strong> Mme Fantin-<br />
Latour)<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Étu<strong>de</strong> pour l’Hommage à Delacroix.<br />
Crayon graphite<br />
Comme dans <strong>le</strong> <strong>de</strong>ssin précé<strong>de</strong>nt, <strong>le</strong> peintre se met en<br />
exergue à mi-corps en bas à droite, dans sa tenue<br />
immaculée, disposition que l’on retrouve sur <strong>le</strong>s<br />
esquisses peintes.<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 12653 (don <strong>de</strong> Mme Fantin-<br />
Latour).<br />
5
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Esquisse pour l’Hommage à Delacroix.<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
Le buste est désormais bien au centre, une femme<br />
en<strong>de</strong>uillée au pied <strong>de</strong> la colonne.<br />
Amsterdam, Rijksmuseum, A 2894 (<strong>le</strong>gs Andries van<br />
Wezel)<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Esquisse pour l’Hommage à Delacroix.<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
La figure <strong>du</strong> peintre à mi-corps désignant <strong>le</strong><br />
couronnement <strong>du</strong> buste est une citation <strong>de</strong> cel<strong>le</strong> <strong>de</strong><br />
Poussin en bas à gauche <strong>de</strong> L’Apothéose d’Homère<br />
d’Ingres.<br />
Paris, musée Eugène-Delacroix, MD 2008-21 (don <strong>de</strong><br />
la Société <strong>de</strong>s Amis <strong>du</strong> musée Eugène-Delacroix).<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Esquisse pour l’Hommage à Delacroix.<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
Sur une autre esquisse (coll. part.), la Renommée vêtue<br />
<strong>de</strong> rouge apparaît sur la droite, suivant une pratique<br />
habituel<strong>le</strong> chez Fantin qui aime à retourner ses<br />
compositions.<br />
Neuchâtel, musée d’Art et d’Histoire, AP 1691.<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Étu<strong>de</strong> pour l’Hommage à Delacroix.<br />
Crayon graphite<br />
Nouvel<strong>le</strong> direction dans <strong>le</strong>s recherches <strong>de</strong> Fantin, qui<br />
renonce ici au buste, l’allégorie ailée portant un<br />
portrait encadré.<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 12561 (don <strong>de</strong> Mme Fantin-<br />
Latour).<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Étu<strong>de</strong> pour l’Hommage à Delacroix, 27 janvier 1864.<br />
Crayon graphite<br />
Le groupe est désormais disposé autour <strong>du</strong> portrait<br />
peint, qui n’est pas au centre. Un bouquet est placé en<br />
<strong>de</strong>ssous, mais l’un <strong>de</strong>s protagonistes, <strong>de</strong> dos, présente<br />
encore une couronne. D’autres orientent éga<strong>le</strong>ment<br />
<strong>le</strong>urs regards vers la toi<strong>le</strong>.<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 12639 (don <strong>de</strong> Mme Fantin-<br />
Latour).<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Hommage à Delacroix.<br />
Crayon graphite et encre sur papier calque<br />
L’abandon <strong>du</strong> parti allégorie fut inspiré à l’artiste par<br />
un portrait <strong>de</strong> groupe <strong>de</strong> Frans Hals, dont il vit une<br />
copie à Paris, et celui <strong>de</strong>s échevins <strong>de</strong> Paris <strong>de</strong> Philippe<br />
<strong>de</strong> Champaigne exposé dans <strong>le</strong>s Ga<strong>le</strong>ries Martinet.<br />
<strong>Musée</strong> <strong>de</strong> Grenob<strong>le</strong>, MG 1469-2 (don <strong>de</strong> Mme Fantin-<br />
Latour).<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Hommage à Delacroix, 1864<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
De gauche à droite, figurent, assis : Edmond Duranty,<br />
Henri Fantin-Latour, Ju<strong>le</strong>s Champf<strong>le</strong>ury et Char<strong>le</strong>s<br />
Bau<strong>de</strong>laire ; <strong>de</strong>bout, <strong>de</strong> part et d’autre <strong>du</strong> portrait<br />
encadré d’Eugène Delacroix : Louis Cordier, Alphonse<br />
Legros, James McNeil Whist<strong>le</strong>r, Edouard Manet, Félix<br />
Bracquemond, Albert <strong>de</strong> Bal<strong>le</strong>roy.<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 1664 (don Étienne <strong>Mo</strong>reau-<br />
Nélaton).<br />
Étienne Carjat (1828-1906)<br />
Portrait <strong>de</strong> Delacroix.<br />
Papier albuminé<br />
Delacroix n’a laissé que <strong>de</strong>ux autoportraits, celui <strong>de</strong>s<br />
Offices à Florence, et celui dit « au gi<strong>le</strong>t vert ». Très<br />
connu <strong>de</strong>puis qu’il est au <strong>Louvre</strong>, ce <strong>de</strong>rnier était alors<br />
conservé chez l’ancienne gouvernante <strong>de</strong> l’artiste.<br />
Paris, musée Eugène-Delacroix<br />
Victor Laisné<br />
Portrait <strong>de</strong> Eugène Delacroix, 1852.<br />
Photographie<br />
Faute d’autoportrait <strong>de</strong> Delacroix disponib<strong>le</strong>, Fantin-<br />
Latour s’inspira paradoxa<strong>le</strong>ment <strong>de</strong> cette photographie,<br />
et <strong>de</strong> cel<strong>le</strong> par Carjat, pour l’effigie qui figure encadrée<br />
au centre <strong>de</strong> l’Hommage à Delacroix.<br />
Paris, BnF, département <strong>de</strong>s Estampes et <strong>de</strong> la<br />
Photographie, Eo-226-folio.<br />
Antoine Etex (1808-1888)<br />
Buste <strong>de</strong> Delacroix, 1865<br />
Plâtre patiné<br />
La version en marbre <strong>de</strong> ce buste posthume <strong>de</strong><br />
Delacroix en habit d’académiciens, présentée dans<br />
l’appartement, fut exposée au Salon <strong>de</strong> 1865 (n°2968).<br />
Etex <strong>le</strong> présenta <strong>de</strong> nouveau, dans une version en plâtre,<br />
au Salon <strong>de</strong> 1876 (n°3261).<br />
Paris, Les Arts décoratifs, dépôt <strong>du</strong> musée <strong>de</strong>s Arts<br />
décoratifs au musée Delacroix<br />
Guillaume Régamey (1837-1875)<br />
Spahis et chasseur d’Afrique avançant à cheval<br />
Encre et aquarel<strong>le</strong><br />
Régamey, ami <strong>de</strong> Fantin, compte parmi <strong>le</strong>s artistes<br />
figurant sur la première étu<strong>de</strong> pour l’Hommage à<br />
Delacroix, mais il disparut <strong>du</strong> choix définitif.<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 29273 (don Raymond<br />
Régamey).<br />
Dante Gabriel Rossetti (1828-1882)<br />
Lettre à Henri Fantin-Latour, à propos <strong>de</strong> Legros et<br />
Whist<strong>le</strong>r, 7 septembre 1864<br />
Très lié à Whist<strong>le</strong>r et Legros, qu’il tenta <strong>de</strong> réconcilier<br />
lors <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur brouil<strong>le</strong>, <strong>le</strong> maître préraphaélite <strong>de</strong>vait<br />
figurer dans l’Hommage à Delacroix. L’impossibilité<br />
pour lui <strong>de</strong> venir à temps à Paris pour poser lui fit<br />
décliner l’offre <strong>de</strong> Fantin avec qui il resta en excel<strong>le</strong>nt<br />
terme comme l’illustre cette <strong>le</strong>ttre en français : « <strong>Mo</strong>n<br />
cher Fantin, Vous me pardonnez déjà la mort <strong>du</strong><br />
‘<strong>Mo</strong>nsieur’ ? Enterrons-<strong>le</strong> donc ensemb<strong>le</strong>.»<br />
Paris, Fondation Custodia, inv. 1997-A.790<br />
Édouard Manet (1832-1884)<br />
Bau<strong>de</strong>laire en chapeau, 1868-1869.<br />
Eau-forte<br />
Bau<strong>de</strong>laire et Manet se sont rencontrés vers 1859. Ce<br />
portrait reprend celui qui apparaît dans La musique aux<br />
Tui<strong>le</strong>ries (1862, Londres, National Gal<strong>le</strong>ry) où Manet<br />
avait réuni ses amis, dont Fantin-Latour et Bal<strong>le</strong>roy.<br />
Paris, musée Eugène-Delacroix, MD1992-6<br />
6
Édouard Manet (1832-1884)<br />
Bau<strong>de</strong>laire tête nue, <strong>de</strong> face, 1867-1869.<br />
Eau-forte<br />
À la mort <strong>du</strong> poète en 1867, Manet voulut participer,<br />
avec ces <strong>de</strong>ux portraits, au volume <strong>de</strong> souvenirs que<br />
Char<strong>le</strong>s Asselineau lui consacra en hommage. Ce<br />
portrait est inspiré d’une photographie par Nadar <strong>de</strong><br />
1862.<br />
Paris, musée Eugène-Delacroix, MD1992-7<br />
Char<strong>le</strong>s Bau<strong>de</strong>laire (1821-1867)<br />
Lettre à Henri Fantin-Latour, au sujet <strong>de</strong> l’accrochage<br />
<strong>de</strong> l’Hommage à Delacroix au Salon, 22 mars 1864<br />
Bau<strong>de</strong>laire voulut prévenir <strong>le</strong> danger <strong>de</strong> voir <strong>le</strong>s<br />
tab<strong>le</strong>aux <strong>de</strong> ses amis mal placés au Salon : « […] J’ai<br />
sans vous consulter, écrit une <strong>le</strong>ttre à Chennevières<br />
pour <strong>le</strong> prier <strong>de</strong> bien placer vos tab<strong>le</strong>aux ainsi que ceux<br />
<strong>de</strong> Manet. Je crois que j’ai bien fait, car, quand <strong>le</strong>s<br />
porteurs <strong>de</strong> Manet sont arrivés, Chennevières a<br />
<strong>de</strong>mandé à voir tout <strong>de</strong> suite <strong>le</strong>s tab<strong>le</strong>aux. » De fait,<br />
l’Hommage à Delacroix fut plutôt mal accroché, mais<br />
suffisamment en vue pour que l’on débatte <strong>de</strong><br />
l’i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong>s modè<strong>le</strong>s qui n’était pas donnée par <strong>le</strong><br />
livret .<br />
Paris, Fondation Custodia, inv. 1997-A.705<br />
Félix Bracquemond (1833-1914)<br />
Portrait <strong>de</strong> Champf<strong>le</strong>ury d’après Courbet, 1859.<br />
Eau-forte<br />
Le critique et romancier Ju<strong>le</strong>s Husson, dit<br />
Champf<strong>le</strong>ury (1821-1889) fut l’un <strong>de</strong>s principaux<br />
défenseurs <strong>du</strong> réalisme <strong>de</strong> Courbet qui <strong>le</strong> représenta au<br />
centre <strong>de</strong> l’Atelier <strong>du</strong> peintre (musée d’Orsay, 1855).<br />
Cette gravure forme <strong>le</strong> frontispice <strong>du</strong> recueil <strong>de</strong>s Amis<br />
<strong>de</strong> la nature, publié chez Pou<strong>le</strong>t-Malassis.<br />
Paris, BnF, département <strong>de</strong>s Estampes et <strong>de</strong> la<br />
Photographie, Ef 411, t. 5.<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> redingote pour <strong>le</strong> portrait <strong>de</strong> Champf<strong>le</strong>ury.<br />
Fusain<br />
La place d’honneur <strong>de</strong> Champf<strong>le</strong>ury au centre <strong>de</strong><br />
l’Hommage à Delacroix parait étonnante, mais il<br />
venait <strong>de</strong> se brouil<strong>le</strong>r définitivement avec Courbet et<br />
revenait alors à Delacroix qu’il avait défen<strong>du</strong> dès <strong>le</strong><br />
Salon <strong>de</strong> 1846. Il acquit <strong>de</strong>s œuvres à la vente d’atelier<br />
<strong>de</strong> 1864 et épousa, en 1867, la fil<strong>le</strong>u<strong>le</strong> <strong>de</strong> Delacroix.<br />
Outre cette admiration pour Delacroix, Champf<strong>le</strong>ury<br />
partageait avec Bau<strong>de</strong>laire et Fantin cel<strong>le</strong> pour Richard<br />
Wagner. Au moment <strong>de</strong> l’Hommage, Champf<strong>le</strong>ury se<br />
place définitivement en retrait <strong>du</strong> courant réaliste et<br />
s’oriente vers <strong>le</strong>s travaux d’érudition qui occuperont la<br />
secon<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> sa carrière : <strong>le</strong>s frères Le Nain,<br />
l’imagerie populaire, la caricature et <strong>le</strong>s faïences<br />
patriotiques se substituera au romancier et au critique<br />
d’art engagé.<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 12803 (don <strong>de</strong> Mme Fantin-<br />
Latour).<br />
Edouard Manet (1832-1884)<br />
Lettre à Henri Fantin-Latour, invitation à dîner avec<br />
Bracquemond et Champf<strong>le</strong>ury<br />
« <strong>Mo</strong>n cher ami, Je suis chargé par M me Meurice <strong>de</strong> vos<br />
inviter à dîner pour <strong>de</strong>main 7h avenue Frochot 6. Vous<br />
serez en pays <strong>de</strong> connaissance car <strong>le</strong>s convives sont<br />
Bracquemond, Champf<strong>le</strong>ury et <strong>le</strong> ménage Manet. Vous<br />
auriez mauvaise grâce à refuser. Tout à vous. E.<br />
Manet. »<br />
Le dramaturge Paul Meurice et son épouse comptait<br />
dans <strong>le</strong> cerc<strong>le</strong> <strong>de</strong>s intimes <strong>de</strong> Victor Hugo. Durant son<br />
exil, il représentait ses intérêts à Paris.<br />
Paris, Fondation Custodia, inv. 1997-A.645<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
La Vérité, notes manuscrites, 23 mai 1864.<br />
Crayon graphite<br />
Décidé à renouve<strong>le</strong>r <strong>le</strong> coup d’éclat <strong>de</strong> 1864, Fantin se<br />
lança <strong>de</strong> front sur plusieurs sujets ambitieux pour <strong>le</strong><br />
Salon suivant. Ces notes concernant <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au consacré<br />
à la Vérité, révè<strong>le</strong>nt la conscience qu’il avait <strong>de</strong>s défauts<br />
<strong>de</strong> l’Hommage à Delacroix.<br />
« 23 mai 1864 au soir / Les ombres <strong>de</strong> mon tab<strong>le</strong>au <strong>du</strong><br />
salon <strong>de</strong> 64 sont trop sombres pas <strong>le</strong>s ombres <strong>de</strong>s clairs /<br />
<strong>le</strong>s habits noirs trop noirs pas assez <strong>de</strong> lumière et <strong>le</strong>s<br />
ombres sont trop faites avec <strong>du</strong> noir pas assez <strong>de</strong> jaune,<br />
<strong>de</strong> rouge, <strong>de</strong> b<strong>le</strong>u / <strong>le</strong>s coups <strong>de</strong> brosse font <strong>de</strong>s <strong>de</strong>miteintes<br />
dans mes chairs, <strong>le</strong> fond est trop semblab<strong>le</strong> <strong>de</strong><br />
va<strong>le</strong>ur aux habits noirs, il aurait dû être plus clair […].»<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 12648<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Étu<strong>de</strong> pour La Vérité, 16 janvier 1865.<br />
Crayon graphite, estompe, fusain<br />
Fantin imagina un groupe d’artistes portant un toast à la<br />
Vérité, personnifiée par une figure nue. Il marquait<br />
aussi une prise <strong>de</strong> position plus affirmée dans <strong>le</strong> débat<br />
sur <strong>le</strong> réalisme au sens <strong>de</strong> culte <strong>de</strong> la sincérité. Mais la<br />
scène pouvait être mal interprétée.<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 12418 (don <strong>de</strong> Mme Fantin-<br />
Latour)<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Étu<strong>de</strong> pour La Vérité, 1865.<br />
Crayon graphite, estompe, fusain<br />
Toast ! Hommage à la Vérité réunissait une partie <strong>de</strong>s<br />
protagonistes <strong>du</strong> tab<strong>le</strong>au <strong>de</strong> 1864 : Manet,<br />
Bracquemond, Cordier, Duranty et Fantin. Whist<strong>le</strong>r était<br />
mis en va<strong>le</strong>ur au premier plan, en robe <strong>de</strong> chambre<br />
japonaise. S’y ajoutaient Zacharie Astruc, Jean-Char<strong>le</strong>s<br />
Cazin et Antoine Vollon.<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 12419 (don <strong>de</strong> Mme Fantin-<br />
Latour)<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Portrait d’Antoine Vollon, 1865<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
Mené à bien en dépit <strong>de</strong>s objections <strong>de</strong> ses amis, Toast !<br />
Hommage à la Vérité fut ridiculisé par la critique <strong>du</strong><br />
Salon <strong>de</strong> 1865. Meurtri, Fantin se résolut à détruire sa<br />
composition, n’en sauvant que trois portraits découpés,<br />
celui <strong>de</strong> Vollon (1833-1900), <strong>de</strong> Whist<strong>le</strong>r (Washington,<br />
Freer Gal<strong>le</strong>ry) et <strong>le</strong> sien (coll. part.)<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 1974-17.<br />
7
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Delacroix reçu aux Champs-Élysées, 14 novembre<br />
1865.<br />
Crayon graphite<br />
L’inauguration <strong>du</strong> monument funéraire <strong>de</strong> Delacroix<br />
au Père-Lachaise, <strong>le</strong> 22 mai 1865, suscita chez Fantin<br />
l’idée d’une nouvel<strong>le</strong> composition. Ce sujet fina<strong>le</strong>ment<br />
assez conventionnel n’eut pas <strong>de</strong> suite.<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 12524 (don <strong>de</strong> Mme Fantin-<br />
Latour)<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Delacroix reçu aux Champs-Élysées, 14 novembre<br />
1865.<br />
Crayon graphite<br />
Delacroix est accueilli au royaume <strong>de</strong>s morts par<br />
Titien, Vélasquez, Rembrandt, Rubens et Véronèse.<br />
Fantin revenait à l’idée <strong>de</strong> Bau<strong>de</strong>laire, mais sans <strong>le</strong>s<br />
poètes, préférant se limiter au panthéon <strong>de</strong>s artistes<br />
qu’il avait copiés au <strong>Louvre</strong>.<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 12523 (don <strong>de</strong> Mme Fantin-<br />
Latour)<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Étu<strong>de</strong> pour Un repas, 20 décembre 1864.<br />
Fusain<br />
Fantin envisagea <strong>de</strong> célébrer un Dîner <strong>de</strong> la Société<br />
<strong>de</strong>s aquafortistes, réunissant, entre autres, Manet,<br />
Bracquemond et Ribot,. mais il y renonça à l’issue<br />
d’un banquet qui l’avait mécontenté. Il retint l’idée<br />
d’un Repas d’artistes, autour d’un portrait cette fois<br />
<strong>de</strong> Vélasquez .<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 12651 (don <strong>de</strong> Mme Fantin-<br />
Latour)<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Étu<strong>de</strong> pour un Hommage à Bau<strong>de</strong>laire, 28 août 1869<br />
Crayon graphite et crayon <strong>de</strong> cou<strong>le</strong>ur<br />
Fantin assista au mo<strong>de</strong>ste enterrement <strong>de</strong> Bau<strong>de</strong>laire,<br />
<strong>le</strong> 2 septembre 1867. Deux ans plus tard, il esquissait<br />
ce croquis rapi<strong>de</strong> montrant un groupe <strong>de</strong> personnages<br />
déposant <strong>de</strong>s couronnes et <strong>de</strong>s palmes au pied <strong>du</strong> buste<br />
<strong>du</strong> poète, à la manière <strong>de</strong>s premières pensées pour<br />
l’Hommage à Delacroix.<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 12483 (don <strong>de</strong> Mme Fantin-<br />
Latour)<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Étu<strong>de</strong> pour L’Anniversaire <strong>de</strong> Bau<strong>de</strong>laire.<br />
Crayon graphite<br />
En 1871, Fantin reprenait l’idée d’une composition en<br />
l’honneur <strong>de</strong> Bau<strong>de</strong>laire pour commémorer au Salon<br />
suivant <strong>le</strong>s cinquante ans qu’aurait eus <strong>le</strong> poète s’il<br />
avait vécu jusque-là. Ici, l’une <strong>de</strong>s figures, <strong>de</strong>bout<br />
<strong>de</strong>vant <strong>le</strong> portrait <strong>de</strong> Bau<strong>de</strong>laire, lit un poème pendant<br />
qu’une autre tient une couronne.<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 12489 (don <strong>de</strong> Mme Fantin-<br />
Latour)<br />
Cartel complémentaire :<br />
Dans d’autres étu<strong>de</strong>s, <strong>le</strong> groupe <strong>de</strong> figures assises ou<br />
<strong>de</strong>bout entourant <strong>le</strong> portrait encadré reprend la structure<br />
<strong>de</strong> l’Hommage à Delacroix et <strong>de</strong>s projets pour Un<br />
repas. Fantin écrit d’ail<strong>le</strong>urs : « C’est presque <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au<br />
<strong>de</strong> Delacroix. Mes modè<strong>le</strong>s sont très contents <strong>de</strong> poser,<br />
ne coûtent rien. […] Je ferai <strong>le</strong> Bau<strong>de</strong>laire d’après <strong>le</strong><br />
portrait que j’en ai dans <strong>le</strong> Delacroix . » Bau<strong>de</strong>laire<br />
n’apparaît plus dans la toi<strong>le</strong> définitive, Coin <strong>de</strong> tab<strong>le</strong><br />
(1872, musée d’Orsay) qui ne rassemb<strong>le</strong> plus que <strong>de</strong>s<br />
poètes vivants.<br />
Attribué à Victoria Fantin-Latour (1840-1926)<br />
Fantin-Latour à la pa<strong>le</strong>tte <strong>de</strong>vant l’Hommage à<br />
Delacroix, vers 1896-1898<br />
Photographie<br />
L’artiste, âgé <strong>de</strong> soixante ans environ, pose <strong>de</strong>vant une<br />
toi<strong>le</strong> peinte plus <strong>de</strong> trente ans auparavant. L’image a<br />
servi d’illustration <strong>de</strong> couverture <strong>du</strong> n° <strong>du</strong> 15 mars 1898<br />
<strong>de</strong> La Presse internationa<strong>le</strong> avec la légen<strong>de</strong> : « Fantin-<br />
Latour peignant l’Hommage à Delacroix ».<br />
Paris, BnF, département <strong>de</strong>s Estampes et <strong>de</strong> la<br />
Photographie, NA-338-4, folio 14, n° 28<br />
Attribué à Victoria Fantin-Latour (1840-1926)<br />
Vues <strong>de</strong> l’atelier <strong>de</strong> Fantin-Latour, vers 1896<br />
Photographie<br />
Exposé plusieurs fois à Londres et Paris, l’Hommage à<br />
Delacroix tarda à trouver preneur et fut apparemment<br />
ren<strong>du</strong> par la ga<strong>le</strong>rie Gambart. La toi<strong>le</strong> apparaît sur <strong>de</strong>s<br />
photographies <strong>de</strong> l’atelier <strong>du</strong> peintre, au 8, rue <strong>de</strong>s<br />
Beaux-Arts. Fantin, dont l’épouse était une fervente<br />
a<strong>de</strong>pte <strong>de</strong> l’appareil Kodak, fait mention <strong>de</strong> ces images<br />
dans une <strong>le</strong>ttre <strong>de</strong> janvier 1896 à son ami Schol<strong>de</strong>rer : «<br />
Puis l’atelier un peu plus loin : sur la porte condamnée<br />
avec <strong>le</strong>s Noces <strong>de</strong> Cana et <strong>le</strong>s Femmes d’Alger <strong>de</strong><br />
Delacroix, là <strong>de</strong>rrière faisant suite, un portrait <strong>de</strong> ma<br />
femme et un morceau <strong>de</strong> l’Hommage à Delacroix. Ma<br />
femme vous enverra nos portraits, quand nous aurons un<br />
peu plus <strong>de</strong> jour. »<br />
Paris, BnF, département <strong>de</strong>s Estampes et <strong>de</strong> la<br />
Photographie, NA-338-4, folio 13, n° 25-26<br />
Félix Bracquemond (1833-1914)<br />
Lettre à Henri Fantin-Latour, à propos <strong>de</strong> Bal<strong>le</strong>roy et<br />
d’un portrait <strong>de</strong> groupe, s.d. [1867]<br />
« <strong>Mo</strong>n cher Fantin, En écrivant à Bal<strong>le</strong>roy, je lui avais<br />
parlé <strong>de</strong> l’incertitu<strong>de</strong> où vous êtes relativement à votre<br />
tab<strong>le</strong>au [<strong>le</strong> portrait <strong>de</strong> la famil<strong>le</strong> Fitz-James]. Je vous<br />
transcris sa réponse : ‘Comment Fantin hésiterait-il à<br />
entreprendre la tartine <strong>de</strong> famil<strong>le</strong>, qu’il songe donc que<br />
son tab<strong>le</strong>au où nous avons eu l’honneur <strong>de</strong> poser<br />
ensemb<strong>le</strong>, il l’a fait en 13 jours et que c’est ainsi<br />
librement et sans se fou<strong>le</strong>r la rate qu’il fasse ces 17<br />
morceaux – ce tab<strong>le</strong>au même à moitié réussi peut lui<br />
faire un bien énorme. C’est folie <strong>de</strong> ca<strong>le</strong>r – Dites-lui<br />
aussi que je ne serai pas établi à Paris avant la fin <strong>de</strong><br />
Décembre et qu’ainsi, il peut tout ce qu’il voudra,<br />
occuper mon atelier’ Tout cela est tel<strong>le</strong>ment mon avis<br />
que je n’ai rien à rajouter. C’est une si bel<strong>le</strong> occasion<br />
qu’il est malheureux <strong>de</strong> la voir gâcher par un être qui<br />
peut la mener à très bonne fin. Pas <strong>de</strong> manière, Fantin,<br />
pas <strong>de</strong> société <strong>du</strong> doigt dans l’œil, suer, rager, soyez<br />
mala<strong>de</strong>, mais faites <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au. Tout à vous.<br />
Bracquemond. »<br />
8
Fantin renonça malgré tout à cette comman<strong>de</strong>, suscité<br />
par Bal<strong>le</strong>roy, <strong>du</strong> portrait <strong>de</strong> la <strong>du</strong>chesse douairière <strong>de</strong><br />
Fitz-James entourée <strong>de</strong> ses quinze petits-enfants.<br />
Paris, Fondation Custodia, inv. 1997-A.667<br />
Edmond Duranty (1833-1880)<br />
Lettre à Henri Fantin-Latour, au sujet <strong>de</strong> son succès à<br />
Londres, 14 août 1864<br />
Auteur <strong>du</strong> roman <strong>de</strong> mœurs Le Malheur d’Henriette<br />
Gérard (1861) dédié à Champf<strong>le</strong>ury et illustré par<br />
Legros, Edmond Duranty fut un <strong>de</strong>s défenseurs <strong>le</strong>s<br />
plus combatif <strong>du</strong> mouvement réaliste. Si ces relations<br />
avec Bau<strong>de</strong>laire furent à éclipse, la franchise <strong>de</strong> liens<br />
avec Fantin apparaît dans <strong>le</strong>ur correspondance. Au<br />
récit <strong>de</strong>s premiers succès <strong>du</strong> peintre à Londres, il lui<br />
écrit : « Ne <strong>de</strong>vriez-vous pas essayer <strong>de</strong> rester <strong>le</strong> plus<br />
longtemps possib<strong>le</strong> à Londres pour profiter <strong>de</strong> cette<br />
veine. […] Epuisez <strong>le</strong> filon d’or que vous avez trouvé<br />
là-bas, ne <strong>le</strong> lâchez pas trop tôt, c’est la base <strong>de</strong> votre<br />
avenir parisien. Ne pensez qu’à l’argent pendant trois<br />
ou quatre mois encore. Vous aurez <strong>le</strong> temps à partir <strong>de</strong><br />
janvier d’en<strong>le</strong>ver vos tab<strong>le</strong>aux pour <strong>le</strong> salon prochain.<br />
Je ne crois pas que vous perdriez jamais l’art <strong>de</strong> vue.<br />
[…] Des écus, <strong>de</strong>s écus, <strong>de</strong>s écus ! Ne vous occupez<br />
que <strong>de</strong> cela pour <strong>le</strong> moment. Tâchez d’en rapporter et<br />
vous pouvez être parfaitement lancé ici en 1865. Vous<br />
étourdirez <strong>le</strong> cerc<strong>le</strong> <strong>de</strong> vos connaissances. Qu’enfin je<br />
vois donc quelqu’un parmi nous se sortir <strong>de</strong> ces coins<br />
où nous restons bloqués. […] Ne revenez pas trop tôt,<br />
surtout, mon cher ami, ne faites pas cette faute. Il est<br />
très important que <strong>le</strong>s gens en vous voyant revenir<br />
s’aperçoivent que votre absence vous a été profitab<strong>le</strong>,<br />
cela <strong>le</strong>s fera penser à vous plus souvent qu’ils ne <strong>le</strong><br />
voudraient. »<br />
Paris, Fondation Custodia, inv. 1997-A.679<br />
Louis Cordier (1823- vers 1875)<br />
Lettre à Henri Fantin-Latour, à propos <strong>du</strong> départ <strong>de</strong><br />
Fantin à Londres, 13 septembre 1864<br />
Le peintre Louis Cordier est la figure <strong>de</strong> loin la moins<br />
connue <strong>de</strong> l’Hommage à Delacroix. C’est à la Petite<br />
Éco<strong>le</strong>, où ils suivaient l’enseignement <strong>de</strong> Lecoq <strong>de</strong><br />
Boisbaudran, que Fantin et lui s’étaient liés d’une<br />
amitié que confirment <strong>le</strong>s quelques <strong>le</strong>ttres retrouvées<br />
ici. Les livrets <strong>de</strong> Salon mentionnent seu<strong>le</strong>ment<br />
trois tab<strong>le</strong>aux <strong>de</strong> lui : Femme endormie en 1865,<br />
Femme au bain en 1866 et Joueuse d’accordéon<br />
en 1868. Il semb<strong>le</strong> s’être ensuite replié sur <strong>le</strong><br />
journalisme. Le catalogue <strong>de</strong> la vente <strong>de</strong> ses œuvres à<br />
l’hôtel Drouot, en 1875, comprend soixante et un<br />
tab<strong>le</strong>aux et sept aquarel<strong>le</strong>s.<br />
« <strong>Mo</strong>n cher Fantin, Je vous avouerai que j’ai été<br />
furieux d’apprendre par hasard votre départ dans <strong>le</strong>s<br />
ga<strong>le</strong>ries <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong> où j’étais allé pour vous voir ; mais<br />
je vous avouerai aussi que je suis furieusement<br />
enchanté <strong>de</strong> recevoir votre bien aimab<strong>le</strong> <strong>le</strong>ttre […].<br />
Vous savez que j’appartiens par ma nature susceptib<strong>le</strong>,<br />
à l’éco<strong>le</strong> <strong>de</strong> sensib<strong>le</strong>rie dont J.J. Rousseau est <strong>le</strong> grand<br />
chef, aussi, je n’aime pas un ami à moitié […]. /<br />
« Après votre départ [pour Londres], j’avais été voir<br />
Bracquemond dans l’espoir d’avoir <strong>de</strong> vos nouvel<strong>le</strong>s.<br />
Depuis nous nous sommes trouvés plusieurs fois<br />
ensemb<strong>le</strong>, et j’ai reconnu la vérité <strong>de</strong> ce que vous<br />
m’aviez dit, que Bracquemond gagne beaucoup à être<br />
connu et que c’est un bien excel<strong>le</strong>nt garçon. […]. Dites<br />
mil<strong>le</strong> choses aimab<strong>le</strong>s à Legros et à Whist<strong>le</strong>r.»<br />
Paris, Fondation Custodia, inv. 1997-A.812<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Lettre à Germain Hédiard, au sujet <strong>du</strong> Journal <strong>de</strong><br />
Delacroix, 4 août 1893<br />
« J’ai fini <strong>le</strong> Journal <strong>de</strong> Delacroix et cela m’a paru<br />
toujours plus intéressant. […] Ah ! ces promena<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
Champrosay ! Il me semblait <strong>le</strong>s faire avec lui. Il me<br />
donne envie d’entendre <strong>le</strong> Rossignol. »<br />
Paris, Fondation Custodia, inv. 2000-A.308<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Lettre à Mme Ruth Edwards, 6 février 1887<br />
« La critique <strong>du</strong> Magazine of Art ne me déplait pas, <strong>le</strong><br />
reproche <strong>de</strong> romantisme est pour moi un éloge, car <strong>le</strong><br />
romantisme, c’est <strong>le</strong> véritab<strong>le</strong> art mo<strong>de</strong>rne. Il n’y a rien<br />
en <strong>de</strong>hors que <strong>de</strong>s platitu<strong>de</strong>s bourgeoises. »<br />
Paris, Fondation Custodia, inv. Paris, Fondation<br />
Custodia, inv. 1997-A.554<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Lettre à Mme Ruth Edwards, au sujet <strong>de</strong> la vente <strong>de</strong> ses<br />
tab<strong>le</strong>aux, 16 octobre 1897<br />
« Tampelaere a ven<strong>du</strong> ces jours-ci <strong>le</strong> Coin <strong>de</strong> Tab<strong>le</strong> à E.<br />
Blémont qui a voulu avoir son portrait et qui aimait<br />
beaucoup ce tab<strong>le</strong>au ! même prix que l’Hommage à<br />
Delacroix. Il sera dans sa sal<strong>le</strong> à manger et très bien<br />
placé dans son hôtel et bien vu par <strong>le</strong> mon<strong>de</strong> artistique.<br />
Il n’a pas d’enfants et doit <strong>le</strong> léguer soit au <strong>Louvre</strong>, soit<br />
à la Vil<strong>le</strong> <strong>de</strong> Paris.<br />
Celui <strong>du</strong> Luxembourg [Un atelier aux Batignol<strong>le</strong>s] ;<br />
Celui <strong>de</strong> Julien [Autour <strong>du</strong> piano] ; Celui <strong>de</strong> <strong>Mo</strong>reau<br />
Nélaton [Hommage à Delacroix] ; Quatre tab<strong>le</strong>aux bien<br />
placés !<br />
Paris, Fondation Custodia, inv. 1997-A.564<br />
Gustave Tampelaere (1840-1904)<br />
Lettre à Henri Fantin-Latour, au sujet <strong>de</strong> la vente <strong>de</strong><br />
l’Hommage à Delacroix, 27 septembre 1897<br />
« <strong>Mo</strong>n cher Fantin, Je suis chargé par <strong>Mo</strong>nsieur<br />
<strong>Mo</strong>reau-Nélaton <strong>de</strong> vous offrir Quinze mil<strong>le</strong> francs<br />
(15 000) pour votre tab<strong>le</strong>au ‘L’Hommage à Delacroix’ :<br />
j’ai dit à ce <strong>Mo</strong>nsieur que je vous transmettrais son<br />
offre, mais je ne lui ai fait <strong>presse</strong>ntir ni espoir, ni<br />
déception. Faites-moi donc l’amitié <strong>de</strong> me répondre <strong>de</strong><br />
suite afin que je <strong>le</strong> fixe à mon tour. »<br />
Paris, Fondation Custodia, inv. 1997-A.503<br />
9
Sal<strong>le</strong> 3c (cabinet à droite <strong>de</strong> l’Atelier)<br />
Albert <strong>de</strong> Bal<strong>le</strong>roy (1828-1872)<br />
Portrait d’Édouard Manet<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
Le comte <strong>de</strong> Bal<strong>le</strong>roy partagea <strong>de</strong> 1855 à 1860 un<br />
atelier avec Manet, rue Lavoisier, où se retrouvait la<br />
jeune génération.<br />
Château <strong>de</strong> Bal<strong>le</strong>roy (Calvados), col<strong>le</strong>ction Forbes<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Portrait d’Édouard Manet.<br />
Crayon graphite sur papier calque<br />
L’inscription « A mon ami Manet 1867 » correspond à<br />
cel<strong>le</strong> figurant sur <strong>le</strong> grand portrait peint (Chicago, The<br />
Art Institute). Ce <strong>de</strong>ssin été exécuté par l’artiste<br />
d’après une photographie, en 1880, pour une revue.<br />
Paris, musée d’Orsay, RF 12793 (don <strong>de</strong> Mme Fantin-<br />
Latour)<br />
Édouard Manet (1832-1884)<br />
Lola <strong>de</strong> Va<strong>le</strong>nce, 1863.<br />
Eau-forte et aquatinte<br />
Editée par la Société <strong>de</strong>s Aquafortistes, la gravure<br />
d’après <strong>le</strong> portrait <strong>de</strong> la danseuse espagno<strong>le</strong> (musée<br />
d’Orsay), fut exposée au Salon <strong>de</strong>s Refusés en 1863.<br />
Suivant Zola, <strong>le</strong> célèbre quatrain <strong>de</strong> Bau<strong>de</strong>laire qui<br />
enrichit la planche « fut sifflé et maltraité autant que <strong>le</strong><br />
tab<strong>le</strong>au lui-même ».<br />
Paris, col<strong>le</strong>ction <strong>de</strong> la ga<strong>le</strong>rie Paul-Prouté.<br />
Félix Bracquemond (1833-1914)<br />
Femme couchée en costume espagnol, d’après Manet,<br />
vers 1863.<br />
Eau-forte<br />
Inspirée dans sa pose par la Maja vêtue <strong>de</strong> Goya<br />
(Madrid musée <strong>du</strong> Prado), cette jeune femme en offre<br />
une version mo<strong>de</strong>rne sur un canapé capitonné. Le<br />
ri<strong>de</strong>au figurant à gauche sur l’estampe fut<br />
ultérieurement supprimé par Manet <strong>de</strong> sa composition.<br />
La toi<strong>le</strong> <strong>de</strong> 1862 (New Haven, Ya<strong>le</strong> University Art<br />
Gal<strong>le</strong>ry) serait l’une <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux œuvres <strong>de</strong> l’artiste qui<br />
formaient l’ornement principal <strong>de</strong> la chambre <strong>de</strong><br />
Bau<strong>de</strong>laire.<br />
Paris, BnF, département <strong>de</strong>s Estampes et <strong>de</strong> la<br />
Photographie, EF-411 (7) IFF 213.<br />
Édouard Manet (1832-1884)<br />
Portrait <strong>de</strong> Félix Bracquemond, 1864<br />
Eau-forte à la plume<br />
La même année, Bracquemond entreprit un portrait au<br />
pastel <strong>de</strong> son ami Manet, <strong>le</strong> haut-<strong>de</strong>-forme calé sous <strong>le</strong><br />
bras. Bracquemond figure aux côtés <strong>de</strong> Manet sur<br />
l’Hommage à Delacroix et <strong>le</strong> portrait <strong>de</strong> groupe<br />
suivant <strong>de</strong> Fantin-Latour, Hommage à la Vérité<br />
(1865). Il était éga<strong>le</strong>ment très lié à Bal<strong>le</strong>roy qui lui<br />
commanda <strong>le</strong> portait peint <strong>de</strong> son épouse.<br />
Paris, BnF, département <strong>de</strong>s Estampes et <strong>de</strong> la<br />
Photographie, Dc 300 d. rés. (3).<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Esquisse pour Un atelier aux Batignol<strong>le</strong>s, 1869-1870.<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
Pourvu d’un titre volontairement neutre, Un atelier aux<br />
Batignol<strong>le</strong>s (musée d’Orsay) était un hommage non plus<br />
à un défunt, Delacroix, Vélasquez ou Bau<strong>de</strong>laire, mais<br />
au peintre vivant que Fantin admirait <strong>le</strong> plus, Édouard<br />
Manet. Il est représenté dans un cadre élégant qui<br />
ressemb<strong>le</strong> davantage à un salon, entouré d’artistes bien<br />
mis qui étaient <strong>de</strong>venus ses proches – <strong>Mo</strong>net, Renoir,<br />
Bazil<strong>le</strong> – et <strong>de</strong> critiques, Astruc et Zola. Fantin inclut un<br />
peu à l’écart <strong>du</strong> groupe son ami Otto Schol<strong>de</strong>rer, qui<br />
n’avait pas pu venir poser d’Al<strong>le</strong>magne pour <strong>le</strong>s<br />
précé<strong>de</strong>ntes toi<strong>le</strong>s. Mais contrairement à l’Hommage à<br />
Delacroix et à Toast ! Hommage à la Vérité, Fantin n’y<br />
figure pas lui-même, signe qu’il ne se sent plus<br />
appartenir à cette tendance mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong> la peinture. Il<br />
n’allait d’ail<strong>le</strong>urs plus représenter <strong>de</strong> peintres, mais <strong>de</strong>s<br />
poètes ou <strong>de</strong>s musiciens. La gran<strong>de</strong> toi<strong>le</strong> si maîtrisée, et<br />
officiel<strong>le</strong>ment récompensée par une médail<strong>le</strong> au Salon<br />
<strong>de</strong> 1870, marque l’aboutissement <strong>de</strong>s recherches<br />
entreprises au temps <strong>de</strong> l’Hommage à Delacroix.<br />
<strong>Mo</strong>ntpellier, musée Fabre, dépôt <strong>du</strong> musée d’Orsay, RF<br />
3637 (don <strong>de</strong> l’artiste)<br />
Sal<strong>le</strong> 4 (chambre <strong>de</strong> Delacroix)<br />
Eugène Delacroix (1798-1863)<br />
Portrait <strong>de</strong> Jenny Le Guillou, vers 1840<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
Entrée au service <strong>de</strong> Delacroix vers 1835, Jenny Le<br />
Guillou acquit une place <strong>de</strong> plus en plus importante<br />
dans son existence. C’est el<strong>le</strong> qui recueillit son <strong>de</strong>rnier<br />
soupir <strong>le</strong> 13 août 1863. Bau<strong>de</strong>laire en fit un vibrant<br />
éloge.<br />
Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s peintures, RF<br />
3091<br />
Cartel complémentaire :<br />
« Quand j’appris la mort <strong>de</strong> M. Delacroix […], je<br />
courus vers la maison <strong>du</strong> grand défunt, et je restai <strong>de</strong>ux<br />
heures à par<strong>le</strong>r <strong>de</strong> lui avec la vieil<strong>le</strong> Jenny, une <strong>de</strong> ces<br />
servantes <strong>de</strong>s anciens âges, qui se font une nob<strong>le</strong>sse<br />
personnel<strong>le</strong> par <strong>le</strong>ur adoration pour d’illustres maîtres.<br />
Pendant <strong>de</strong>ux heures, nous sommes restés, causant et<br />
p<strong>le</strong>urant, <strong>de</strong>vant cette boîte funèbre, éclairée <strong>de</strong> petites<br />
bougies, et sur laquel<strong>le</strong> reposait un misérab<strong>le</strong> crucifix <strong>de</strong><br />
cuivre. Car je n’ai pas eu <strong>le</strong> bonheur d’arriver à temps<br />
pour contemp<strong>le</strong>r, une <strong>de</strong>rnière fois, <strong>le</strong> visage <strong>du</strong> grand<br />
peintre-poète. » Bau<strong>de</strong>laire, conférence sur Delacroix<br />
donnée à Bruxel<strong>le</strong>s <strong>le</strong> 2 mai 1864.<br />
Albert Carrier-Bel<strong>le</strong>use (1824-1887)<br />
Ré<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> buste <strong>de</strong> Delacroix, 1864<br />
Plâtre patiné<br />
La gran<strong>de</strong> version en bronze <strong>de</strong> ce buste posthume,<br />
commandé par la Société nationa<strong>le</strong> <strong>de</strong>s Beaux-Arts,<br />
figura dans la rétrospective <strong>de</strong> l’œuvre <strong>de</strong> Delacroix <strong>de</strong>s<br />
Ga<strong>le</strong>ries Martinet.<br />
Paris, musée Eugène-Delacroix, MD 1969 (don <strong>de</strong> M.<br />
André J. Kahn-Wolf)<br />
10
Alfred Robaut (1830-1909)<br />
Lettre à Henri Fantin-Latour, 5 mai 1884<br />
Robaut invita Fantin à participer à toutes <strong>le</strong>s réunions<br />
<strong>du</strong> Comité <strong>du</strong> <strong>Mo</strong>nument à Delacroix. La première se<br />
tint à la mairie <strong>du</strong> VI e arrondissement.<br />
Paris, Archives <strong>de</strong>s musées nationaux, P 30 Delacroix<br />
Alfred Robaut (1830-1909)<br />
Carte posta<strong>le</strong> adressée à Henri Fantin-Latour, 14 mai<br />
1884<br />
Paris, Archives <strong>de</strong>s musées nationaux, P 30 Delacroix<br />
Comité Eugène Delacroix<br />
Formulaire <strong>de</strong> souscription imprimé, 4 juin 1884<br />
Paris, Archives <strong>de</strong>s musées nationaux, P 30 Delacroix<br />
Reçus adressés à Henri Fantin-Latour et son épouse<br />
pour <strong>le</strong>ur participation à la souscription au <strong>Mo</strong>nument<br />
à Delacroix, 10 juin 1884<br />
Fantin, qui compta parmi <strong>le</strong>s premiers membres <strong>du</strong><br />
comité <strong>du</strong> monument versa 100 fr. – et son épouse 25<br />
fr., ce qui <strong>le</strong> place à égalité avec Alfred Robaut,<br />
Philippe Burty ou Gustave <strong>Mo</strong>reau. M me Nathaniel <strong>de</strong><br />
Rothschild fut la plus généreuse avec 5 000 fr.,<br />
Auguste Vacquerie offrit 1000 fr., Victor Hugo,<br />
500 fr. Au total la souscription, <strong>le</strong>s bénéfices <strong>de</strong><br />
l’exposition et une subvention <strong>de</strong> 8 000 fr. <strong>de</strong> l’État<br />
permirent <strong>de</strong> réunir <strong>le</strong>s 90 000 francs nécessaires.<br />
Paris, Fondation Custodia, inv. 1997-A.906<br />
Alfred Robaut (1830-1909)<br />
Lettre à Henri Fantin-Latour, 26 janvier 1888<br />
Robaud invite Fantin à assister à la fonte <strong>de</strong> la figure<br />
d’Apollon <strong>du</strong> <strong>Mo</strong>nument à Delacroix <strong>de</strong> Ju<strong>le</strong>s Dalou<br />
(dont une photographie est présentée dans cette sal<strong>le</strong>).<br />
Paris, Archives <strong>de</strong>s musées nationaux, P 30 Delacroix<br />
Alphonse Legros (1837-1911)<br />
Portrait <strong>de</strong> Ju<strong>le</strong>s Dalou, 1877.<br />
Eau-forte<br />
Camara<strong>de</strong> <strong>de</strong> jeunesse <strong>de</strong> Legros comme <strong>de</strong><br />
Bracquemond et <strong>de</strong> Fantin-Latour, tous issus <strong>de</strong> la<br />
Petite Éco<strong>le</strong>, Dalou est l’un <strong>de</strong>s sculpteurs <strong>le</strong>s plus en<br />
vue lorsque <strong>le</strong> comité <strong>du</strong> monument à Delacroix <strong>le</strong><br />
choisit sans concours en 1885. Médaillé au Salon <strong>de</strong><br />
1883, pour l’immense relief <strong>de</strong> la Chambre <strong>de</strong>s<br />
députés, Mirabeau répondant au marquis <strong>de</strong> Dreux-<br />
Brézé, il est en p<strong>le</strong>in dans l’élaboration <strong>du</strong> Triomphe<br />
<strong>de</strong> la République commandé la Vil<strong>le</strong> <strong>de</strong> Paris pour<br />
l’actuel<strong>le</strong> place <strong>de</strong> la Nation.<br />
Paris, BnF, département <strong>de</strong>s Estampes et <strong>de</strong> la<br />
Photographie, DC 310d Rès.<br />
Ju<strong>le</strong>s Dalou (1838-1902)<br />
Esquisse pour <strong>le</strong> <strong>Mo</strong>nument à Delacroix, 1885.<br />
Cire sur armature métallique<br />
Première pensée pour <strong>le</strong>s figures<br />
allégoriques entourant <strong>le</strong> pié<strong>de</strong>stal <strong>du</strong> monument : une<br />
figure ailée s’élève en torsion <strong>de</strong>s genoux d’un<br />
personnage assis. Durant <strong>le</strong>s six années que prirent la<br />
réalisation <strong>de</strong> ce monument, Dalou travailla sans être<br />
rémunéré et <strong>du</strong>t même emprunter pour achever <strong>de</strong><br />
payer <strong>le</strong> fon<strong>de</strong>ur.<br />
Paris, Petit Palais, musée <strong>de</strong>s Beaux-Arts <strong>de</strong> la Vil<strong>le</strong> <strong>de</strong><br />
Paris, Inv. SDUT01752.<br />
Ju<strong>le</strong>s Dalou (1838-1902)<br />
Étu<strong>de</strong> pour <strong>le</strong> <strong>Mo</strong>nument à Eugène Delacroix, vers 1885<br />
Plume et encre brune<br />
Ce croquis fixe <strong>le</strong>s principaux éléments <strong>de</strong> cette<br />
composition animé d’un souff<strong>le</strong> néo-baroque : la figure<br />
féminine <strong>de</strong> la Gloire portée par un vieillard ailé, <strong>le</strong><br />
Temps, tient d’une main une trompette et <strong>de</strong> l’autre une<br />
couronne qu’el<strong>le</strong> tend <strong>de</strong>vant <strong>le</strong> buste <strong>du</strong> peintre, tandis<br />
qu’Apollon, dieu <strong>de</strong>s Arts, applaudit, assis sur un<br />
rocher.<br />
Paris, musée Eugène-Delacroix, MD 1979-1.<br />
Ju<strong>le</strong>s Dalou (1838-1902)<br />
<strong>Mo</strong>nument à Eugène Delacroix, 1885<br />
Plâtre patiné<br />
Cette esquisse au 6 e d’exécution fut examinée <strong>le</strong><br />
13 novembre 1885 par <strong>le</strong>s membres <strong>du</strong> comité <strong>du</strong><br />
monument. L’achèvement <strong>du</strong> modè<strong>le</strong> à la gran<strong>de</strong>ur<br />
définitive <strong>du</strong> monument occupa Dalou en 1886-1887,<br />
avant la fonte <strong>de</strong>s éléments en 1888. Le monument fut<br />
inauguré <strong>le</strong> 5 octobre 1890.<br />
Paris, Petit Palais, musée <strong>de</strong>s Beaux-Arts <strong>de</strong> la Vil<strong>le</strong> <strong>de</strong><br />
Paris, Inv. PPS00357.<br />
Anonyme<br />
Apollon bronze fon<strong>du</strong> à cire per<strong>du</strong>e, brut <strong>de</strong> fonte, 1888<br />
Photographie<br />
Dalou, fervent partisan <strong>de</strong> la technique diffici<strong>le</strong> <strong>de</strong> la<br />
fonte à cire per<strong>du</strong>e, l’imposa à ses commanditaires. La<br />
coulée <strong>du</strong> bronze dans <strong>le</strong> mou<strong>le</strong> enfermant <strong>le</strong> modè<strong>le</strong> <strong>de</strong><br />
cire, si el<strong>le</strong> réussit, donne une œuvre unique. Les<br />
membres <strong>du</strong> comité assistèrent à l’opération<br />
spectaculaire <strong>de</strong> la fonte, <strong>le</strong> 28 janvier 1888. Ce cliché<br />
montre l’Apollon en bronze sorti brut <strong>de</strong> fon<strong>de</strong>rie et<br />
encore armé <strong>de</strong> ses réseaux d’évents.<br />
Paris, col<strong>le</strong>ction particulière, fonds Becker, Ph. 354.<br />
Ju<strong>le</strong>s Dalou (1838-1902)<br />
Buste d’Eugène Delacroix, vers 1886-1888<br />
Plâtre<br />
La version en bronze <strong>de</strong> ce buste couronne <strong>le</strong> <strong>Mo</strong>nument<br />
à Delacroix <strong>du</strong> jardin <strong>du</strong> Luxembourg (1890). Dalou<br />
s’inspira nettement <strong>du</strong> buste rétrospectif réalisé par<br />
Albert Carrier-Bel<strong>le</strong>use pour la Société nationa<strong>le</strong> <strong>de</strong>s<br />
beaux-arts en 1864.<br />
Paris, musée Eugène-Delacroix, dépôt <strong>du</strong> Petit Palais,<br />
musée <strong>de</strong>s Beaux-Arts <strong>de</strong> la Vil<strong>le</strong> <strong>de</strong> Paris, PPS 00283.<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Centenaire H. Berlioz, 1903.<br />
Lithographie<br />
Berliozien convaincu, Fantin multiplia <strong>le</strong>s illustrations<br />
d’après ses œuvres et peignit un immense Anniversaire<br />
<strong>de</strong> Berlioz (1875, <strong>Musée</strong> <strong>de</strong> Grenob<strong>le</strong>). Il reprend pour<br />
cette planche, publiée à l’occasion <strong>de</strong> son centenaire, <strong>le</strong><br />
motif <strong>du</strong> couronnement <strong>du</strong> buste d’abord imaginé pour<br />
Delacroix.<br />
Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Arts<br />
graphiques, Est. 1 (don Beur<strong>de</strong><strong>le</strong>y).<br />
11
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Victoire ailée (À Eugène Delacroix).<br />
Crayon lithographique, mise au carreau sur papier<br />
calque<br />
La composition avait été conçue en hommage à<br />
Wagner, mort en 1883, pour un album commémoratif<br />
publié à Bayreuth. Fantin a utilisé ici <strong>le</strong> papier calque<br />
pour recopier puis inverser la composition d’origine.<br />
Grenob<strong>le</strong>, <strong>Musée</strong>, MG 1461.<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Étu<strong>de</strong> pour l’Immortalité, 1889.<br />
Graphite, craie blanche, rehauts d’aquarel<strong>le</strong> et gouache<br />
sur papier calque<br />
L’élévation <strong>du</strong> tombeau <strong>de</strong> Delacroix remplace la dal<strong>le</strong><br />
funéraire <strong>de</strong> celui <strong>de</strong> Wagner. Cette feuil<strong>le</strong> mise au<br />
carreau a un caractère pictural rare dans l’œuvre<br />
<strong>de</strong>ssiné <strong>de</strong> Fantin. Signée, el<strong>le</strong> fut cédée <strong>de</strong> son vivant<br />
par l’artiste, d’ordinaire réticent à se séparer <strong>de</strong> ses<br />
<strong>de</strong>ssins, qu’il aimait pouvoir réutiliser.<br />
New York, col<strong>le</strong>ction Karen B. Cohen.<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
Immortalité, 1889.<br />
Hui<strong>le</strong> sur toi<strong>le</strong><br />
Cette vision est d’autant plus irréel<strong>le</strong> que la figure<br />
semb<strong>le</strong> émerger <strong>de</strong> l’atmosphère obscurcie <strong>de</strong> la vil<strong>le</strong>.<br />
La position en hauteur <strong>de</strong> la sépulture est suggérée par<br />
l’apparition, au loin à droite, <strong>de</strong>s tours <strong>de</strong> Notre-Dame<br />
et <strong>de</strong> la coupo<strong>le</strong> <strong>du</strong> Panthéon, promesse d’éternité aux<br />
grands hommes.<br />
Cardiff, National Museum Wa<strong>le</strong>s, NMW A 2462<br />
Henri Fantin-Latour (1836-1904)<br />
À Eugène Delacroix, 1890.<br />
Lithographie<br />
Cette rare épreuve <strong>du</strong> 1 er état <strong>de</strong> la lithographie tirée <strong>du</strong><br />
tab<strong>le</strong>au est dédicacée au crayon par Fantin au : « Au<br />
fervent admirateur <strong>de</strong> E. Delacroix et <strong>de</strong> Corot, Alfred<br />
Robaut », l’initiateur <strong>du</strong> monument à Delacroix <strong>du</strong><br />
Luxembourg.<br />
Paris, BnF, département <strong>de</strong>s Estampes et <strong>de</strong> la<br />
Photographie, DC 310a Rès, t. 5 (<strong>le</strong>gs Paul Cosson)<br />
12