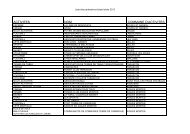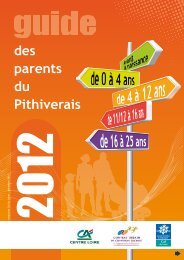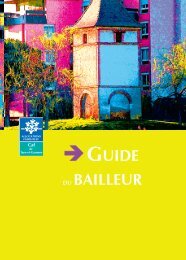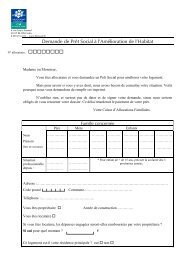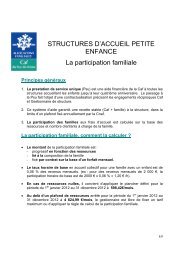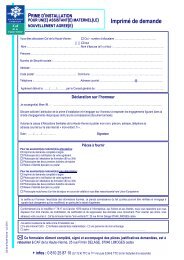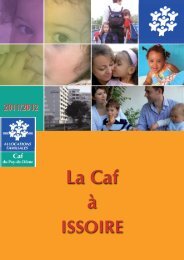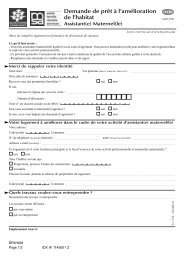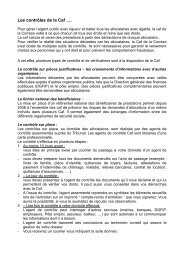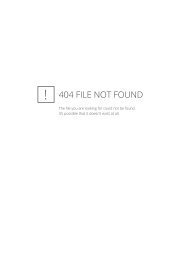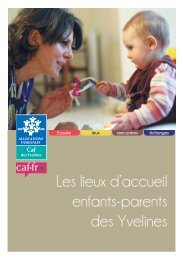Alessandro Cavalli, Vincenzo Cicchelli et Olivier Galland (dir.) - Caf.fr
Alessandro Cavalli, Vincenzo Cicchelli et Olivier Galland (dir.) - Caf.fr
Alessandro Cavalli, Vincenzo Cicchelli et Olivier Galland (dir.) - Caf.fr
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Alessandro</strong> <strong>Cavalli</strong>, <strong>Vincenzo</strong> <strong>Cicchelli</strong> <strong>et</strong> <strong>Olivier</strong> <strong>Galland</strong> (<strong>dir</strong>.)<br />
Coordonné par <strong>Alessandro</strong> <strong>Cavalli</strong>, <strong>Vincenzo</strong><br />
<strong>Cicchelli</strong> <strong>et</strong> <strong>Olivier</strong> <strong>Galland</strong>, c<strong>et</strong> écrit collectif<br />
interroge les conceptions <strong>et</strong> les stratégies éducatives<br />
de parents, institutions sociales, <strong>et</strong> décrypte<br />
les comportements des jeunes. Le centre d’intérêt<br />
est l’adolescent dans sa trajectoire d’expériences<br />
vers l’autonomie <strong>et</strong> la vie adulte. Les concepts<br />
pour devenir autonome s’opposent, se contredisent,<br />
se complètent. Les inflexions selon les<br />
conduites <strong>et</strong> les aspirations des jeunes du Sud ou<br />
du Nord révèlent des situations de contextes plus<br />
que des aptitudes culturelles. C<strong>et</strong> ouvrage, qui<br />
lève de nombreuses idées reçues, est un débat en<br />
soi sur l’adolescence <strong>et</strong> la jeunesse : il montre<br />
comment les contextes infléchissent les comportements,<br />
relève des traits de comparaison entre<br />
France <strong>et</strong> Italie, suscite des pistes de réflexion pour<br />
la recherche, relaye des enseignements pour la<br />
politique familiale. L’apprentissage de l’autonomie<br />
est traité au regard des relations familiales,<br />
des valeurs d’attachement des adolescents envers<br />
leurs parents, d’évolutions réactives à l’histoire,<br />
d’explications de contexte. Les analyses s’intéressent<br />
à la socialisation <strong>et</strong> à la transmission par les<br />
pères <strong>et</strong> les pairs, à l’expérience de l’investissement<br />
scolaire, social <strong>et</strong> politique, à l’autonomie<br />
face à la dépendance des institutions <strong>et</strong> de la<br />
famille.<br />
Ce compte rendu s’attache à quelques thèmes<br />
d’analyse des conditions d’autonomie : adolescence<br />
<strong>et</strong> socialisation familiale ; expérience de la vie<br />
amoureuse ; cohabitation intergénérationnelle ; enseignements<br />
pour des politiques.<br />
Les atouts de la socialisation familiale pour les<br />
adolescents sont associés à des sentiments d’attachement.<br />
Le profil des adolescentes demandant<br />
une permission de sortie à leurs parents relève<br />
moins d’un comportement d’obéissance que<br />
d’affection. Dans une démonstration entre une<br />
adolescente <strong>et</strong> sa mère dans le choix de vêtements,<br />
François de Singly décrit sa stratégie pour<br />
obtenir la validation de ses décisions par ses amis,<br />
sa mère <strong>et</strong> son père. Une autre adolescente<br />
s’arrange pour que sa mère venant la chercher au<br />
cours d’équitation puisse la voir évoluer dans son<br />
apprentissage. Pour les jeunes, la famille est un<br />
lieu de confiance <strong>et</strong> de soutien <strong>et</strong>, pour les parents,<br />
un lieu de fort investissement. Si les parents ont<br />
Deux pays, deux jeunesses ?<br />
La condition juvénile en France <strong>et</strong> en Italie<br />
2009, Presses universitaires de Rennes, collection Le sens social.<br />
Politiques sociales <strong>et</strong> familiales n° 97 - septembre 2009<br />
103 Comptes rendus de lectures<br />
une perception positive du fonctionnement de la<br />
famille, de la qualité des relations, de la communication,<br />
de l’efficacité collective, du soutien, les<br />
jeunes sont plus critiques. D’après une observation<br />
auprès de jeunes âgés de 17 ans à 25 ans, les<br />
parents sous-estiment leur autonomie, alors que<br />
les jeunes ont la perception inverse. Selon Eugenia<br />
Scabini, l’important pour les parents est le lien de<br />
proximité <strong>et</strong>, pour les jeunes, la possibilité d’autonomie.<br />
Pour les chercheurs, les difficultés éprouvées<br />
par les parents viennent de la contradiction à<br />
attendre de l’obéissance <strong>et</strong> de l’individualisation<br />
(apprendre à être soi-même). Il existe une tension<br />
entre besoin de dépendance <strong>et</strong> d’autonomie. Les<br />
fonctions maternelles <strong>et</strong> paternelles peu ressenties<br />
dans leurs différences par les jeunes se distinguent<br />
: la mère guide la vie quotidienne (scolarité,<br />
vie amicale) de sa fille plus que de son fils, pour<br />
lequel les amis <strong>et</strong> les hommes de l’entourage ont<br />
un impact identitaire. Le père donne un avis sur<br />
les événements : son accord est déterminant dans<br />
les étapes de l’histoire scolaire, les orientations,<br />
les décisions, l’avenir. Le père rééquilibre le déséquilibre<br />
maternel, la mère gardant une influence dans<br />
les choix professionnels.<br />
Autres formes d’apprentissage vers l’autonomie, la<br />
vie amoureuse <strong>et</strong> l’entrée dans la sexualité représentent<br />
des conceptions de socialisation à l’adolescence,<br />
différenciées selon les générations<br />
<strong>et</strong> le genre : la « révolution sexuelle » caractérise<br />
l’évolution des rapports sociaux entre générations,<br />
entre sexes, avec des impacts sur la conception du<br />
couple <strong>et</strong> de la famille. Les premières expériences<br />
sont dissociées du proj<strong>et</strong> durable, plus souvent<br />
qu’aux générations précédentes. Les injonctions<br />
par les pairs d’expérimenter la sexualité remplacent<br />
les interdits des années 1960. La puberté<br />
passe de 16 ans à 13 ans ; 80 % des jeunes font<br />
l’expérience de « la première fois » avant 19 ans<br />
contre 25 auparavant. La vie amoureuse, se sentir<br />
en couple, avoir un(e) p<strong>et</strong>it(e) ami(e) (75 % des<br />
filles <strong>et</strong> 60 % des garçons) sont centraux à l’adolescence.<br />
Le trait le plus marquant est l’évolution récente<br />
d’émancipation des jeunes filles : elles prennent<br />
des initiatives, font les premiers pas. Ces comportements<br />
produisent des tensions ou de nouvelles<br />
communications <strong>et</strong> ont des impacts sur la sexualité
des jeunes hommes. Ces évolutions contribuent<br />
aux écarts de perception entre générations, entre<br />
adolescents <strong>et</strong> parents, catégories sociales, niveaux<br />
d’études, familiarisation avec les nouvelles technologies.<br />
Intern<strong>et</strong> participe des changements de la<br />
vie affective : l’accès aux informations sur la<br />
sexualité favorise les liens, les rencontres. La<br />
sexualité n’est plus un tabou <strong>et</strong> devient un droit.<br />
Les eff<strong>et</strong>s des technologies sembleraient orienter<br />
une régulation unisexe <strong>et</strong> d’appartenance sociale<br />
des comportements dans la vie amoureuse <strong>et</strong>,<br />
finalement, dans la vie sociale de la jeunesse.<br />
Un renversement de tendance s’observerait en<br />
Italie en réaction aux générations précédentes : la<br />
jeunesse recule l’âge de la « première fois », préfère<br />
la fidélité à l’amour libre, associe la sexualité à<br />
l’amour, aspire à « une sexualité apaisée ». Autonomes<br />
dans leurs relations affectives <strong>et</strong> de loisirs,<br />
les jeunes sont très dépendants de la vie familiale.<br />
Encouragée par les relations, les médias <strong>et</strong> la publicité,<br />
la sexualité favorise la confirmation de soi<br />
ou provoque l’anxiété. Avoir un partenaire stable<br />
contrecarre l’inquiétude <strong>et</strong> engage aux proj<strong>et</strong>s.<br />
Les conditions d’accès à l’autonomie familiale<br />
représentent des enjeux contradictoires <strong>et</strong> peuvent<br />
avoir des eff<strong>et</strong>s inverses de ceux escomptés. Elles<br />
dépendent de l’attitude des générations précédentes,<br />
des politiques publiques, des contextes économiques,<br />
sociaux <strong>et</strong> familiaux, individuels <strong>et</strong> collectifs.<br />
En France comme en Italie, le passage vers l’âge<br />
adulte reflète le vécu <strong>et</strong> le fonctionnement familial.<br />
La cohabitation tardive du jeune chez ses parents<br />
peut davantage signifier un déséquilibre familial<br />
qu’une conception traditionnelle de la famille. La<br />
relation prolongée du jeune avec sa mère peut<br />
<strong>fr</strong>einer les aspirations d’autonomie : la mère protectrice<br />
<strong>et</strong> permissive affaiblit le père <strong>et</strong> la famille,<br />
perturbe « le passage de témoin entre les générations<br />
» (p. 178), génère la culpabilité, maintient la<br />
dépendance.<br />
Pour Claude Martin, la cohabitation des jeunes<br />
dans leur famille n’est pas, comme l’avancent de<br />
nombreux auteurs, une forme de culture traditionnelle<br />
du Sud (Italie). Il s’agit d’expression<br />
profonde de déséquilibre des générations dans<br />
un pays aux prises avec le vieillissement de<br />
population, l’inactivité féminine massive, le<br />
chômage des jeunes élevé (30 % en Italie, 20 %<br />
en France). Dans les années 2000, l’Italie <strong>et</strong> la<br />
France ont tenté de donner à la famille un rôle<br />
central <strong>et</strong> de considérer « l’intérêt de l’enfant au<br />
cœur du droit de la famille » (p. 182), contrariant<br />
à l’adolescence l’aspiration à l’autonomie. La<br />
cohabitation intergénérationnelle, « la famille<br />
prolongée » du modèle méditerranéen, correspond<br />
à une transition : deux générations adultes<br />
vivent ensemble. Ce mode de vie interdit l’éman-<br />
(*) Voir le compte rendu de l’ouvrage de Cécile Van de Velde dans ce même numéro, p. 100.<br />
Politiques sociales <strong>et</strong> familiales n° 97 - septembre 2009<br />
104 Comptes rendus de lectures<br />
cipation de la jeune génération <strong>et</strong> « l’avantage<br />
relationnel réciproque » (p.171). Le jeune fait<br />
l’expérience de la vie affective, sociale, du<br />
travail avec sa famille, renvoie à plus tard ses<br />
décisions ; les parents compensent la peur de la<br />
solitude. Parents <strong>et</strong> jeunes se proj<strong>et</strong>tent dans un<br />
avenir incertain, ont une représentation négative<br />
des vies familiale, professionnelle <strong>et</strong> sociale<br />
future. L’atout d’une vie intergénérationnelle<br />
peut menacer le « processus de différenciation<br />
nécessaire à la relation entre enfants <strong>et</strong> parents »<br />
(Eugenia Scabini:172).<br />
En France, l’expérience de la cohabitation familiale<br />
perm<strong>et</strong> aux parents, préoccupés par les enjeux du<br />
diplôme <strong>et</strong> de la première expérience professionnelle<br />
de leurs jeunes, d’anticiper le déclassement<br />
social. La dépendance familiale <strong>et</strong> le manque d’autonomie<br />
risquent, au contraire, de conduire au désinvestissement<br />
<strong>et</strong> au désintérêt. Quitter ses parents<br />
s’effectue de façon « progressive, ambiguë <strong>et</strong> réversible<br />
» (*). Les trajectoires d’émancipation passent<br />
par des transitions selon deux types de décohabitation<br />
: les études <strong>et</strong> l’emploi. Ce que confortent les<br />
politiques sociales en infléchissant la solidarité familiale<br />
jusqu’à 25 ans : les familles favorisées financent<br />
un logement indépendant dans un objectif éducatif<br />
<strong>et</strong> de protection, les allers-r<strong>et</strong>ours au foyer familial<br />
palliant la culpabilité.<br />
Les conditions d’autonomie des jeunes diffèrent<br />
selon le contexte politique (V. <strong>Cicchelli</strong>). L’État<br />
libéral anglo-saxon n’intervient pas dans le domaine<br />
familial. L’État conservateur ou corporatiste soutient<br />
les familles, le père chef de famille apportant les<br />
ressources. L’État social-démocrate scandinave<br />
universaliste aide les personnes individuellement<br />
<strong>et</strong> favorise l’égalité entre les hommes <strong>et</strong> les femmes.<br />
En Europe du Sud, l’État familialiste investit peu,<br />
s’appuie sur les femmes, compte sur la famille <strong>et</strong><br />
les solidarités familiales entre les générations : en<br />
Italie, les jeunes restent longtemps dépendants de<br />
leurs parents. En France, l’État conservateur, universaliste<br />
<strong>et</strong> familialiste contribue à l’entr<strong>et</strong>ien des<br />
enfants <strong>et</strong> aide au logement. Ces modèles concourent<br />
à moduler les comportements des jeunes.<br />
Même les expériences citoyennes associant les<br />
jeunes interrogent. Selon V. <strong>Cicchelli</strong>, l’invitation<br />
à participer à la vie sociale viendrait de la peur<br />
qu’ont les adultes du désintérêt des jeunes pour le<br />
bien commun. L’objectif serait de canaliser la<br />
jeunesse face à la violence. Les conseils de jeunes<br />
initiés par les communes ne sont pas plébiscités<br />
car ils n’infléchissent pas les décisions. Certains<br />
des mille deux cents conseils d’enfants <strong>et</strong> de jeunes<br />
âgés de 9 ans à 18 ans les consultent sur les suj<strong>et</strong>s<br />
qui les concernent sans pour autant finaliser des<br />
proj<strong>et</strong>s concr<strong>et</strong>s. En Italie, cinq cents conseils municipaux<br />
de jeunes âgés de moins de 16 ans sont
articulés avec l’école : adolescents <strong>et</strong> jeunes représentent<br />
des indicateurs de qualité de vie.<br />
Des questionnements soulevés dans c<strong>et</strong> ouvrage<br />
pourraient être explorés par les chercheurs selon<br />
les axes suivants :<br />
• les manifestations de la demande d’attachement<br />
des adolescents à l’égard de leurs parents, <strong>et</strong> les<br />
manières d’y répondre ;<br />
• les eff<strong>et</strong>s d’Intern<strong>et</strong> sur les relations affectives <strong>et</strong><br />
sociales des adolescents selon les milieux sociaux<br />
<strong>et</strong> selon leurs pratiques des nouvelles technologies ;<br />
• les difficultés éprouvées par les parents (la mère,<br />
le père) dans la compréhension des demandes des<br />
adolescents : comment transformer leurs propres<br />
attentes d’obéissance en principes de responsabilité ?<br />
• les expériences innovantes <strong>et</strong> structurantes de<br />
cohabitation familiale intergénérationnelle : quelles<br />
contributions participatives, actives pourraient<br />
contrecarrer le risque d’une protection (maternelle)<br />
contre-productive ? quelles expériences d’implication<br />
active <strong>et</strong> de soutien familial mutuel créent un<br />
L’analyse des politiques publiques, utilisées pour<br />
lire <strong>et</strong> comprendre l’action gouvernementale (1),<br />
ambitionne plus largement d’étudier la fonction<br />
régulatrice du politique consistant à gérer les<br />
conflits, de représentations de la réalité sociale<br />
notamment, <strong>et</strong> à intégrer des intérêts sociaux<br />
contradictoires. L’ouvrage collectif <strong>dir</strong>igé par<br />
<strong>Olivier</strong> Giraud <strong>et</strong> Philippe Warin, tous deux<br />
chercheurs en analyse des politiques publiques<br />
– le premier au centre Marc-Bloch CNRS de<br />
Berlin, le second au PACTE (Politiques publiques,<br />
Action politique, Territoires) de l’Institut d’études<br />
politiques de Grenoble – parvient de façon<br />
convaincante à nourrir scientifiquement c<strong>et</strong>te<br />
prétention. Il rassemble les contributions de<br />
plusieurs spécialistes de la science politique<br />
<strong>fr</strong>ançaise contemporaine, articulées autour de la<br />
pensée d’un auteur incontournable de la discipline,<br />
<strong>et</strong> rayonnant bien au-delà des <strong>fr</strong>ontières<br />
hexagonales : Bruno Jobert, <strong>dir</strong>ecteur de recherche<br />
<strong>Olivier</strong> Giraud <strong>et</strong> Philippe Warin<br />
Politiques sociales <strong>et</strong> familiales n° 97 - septembre 2009<br />
105 Comptes rendus de lectures<br />
contexte positif pour le passage à l’âge adulte ?<br />
• la comparaison des expériences européennes de<br />
coopération familiale <strong>et</strong> institutionnelle vers<br />
l’accès des jeunes à l’autonomie : comment lever<br />
les ambiguïtés de la solidarité familiale à l’âge<br />
adulte ? quelles coopérations de solidarité familiale<br />
<strong>et</strong> sociale seraient positives pour les jeunes,<br />
valorisantes pour les familles <strong>et</strong> l’État ?<br />
• quels principes r<strong>et</strong>enir pour une politique familiale<br />
prenant en compte individuellement l’adolescent,<br />
le jeune, à partir de 16 ou 18 ans ?<br />
De l’école au lycée, de l’engagement citoyen au<br />
parcours d’initiation amoureuse, de la culture<br />
adolescente aux relations intergénérationnelles, il<br />
revient au lecteur de privilégier quelques aspects<br />
de c<strong>et</strong>te œuvre plurielle, tant les concepts dans<br />
ces domaines s’entrecroisent, s’entrechoquent, se<br />
renouvellent, sans jamais être établis.<br />
Politiques publiques <strong>et</strong> démocratie<br />
2008, Paris, La Découverte/Pacte, 428 pages.<br />
Christiane Crépin<br />
CNAF – Département de l’animation de la recherche<br />
<strong>et</strong> du réseau des chargés d’études<br />
émérite au CNRS <strong>et</strong> au PACTE. De la pensée de ce<br />
dernier, fil conducteur de l’ouvrage dont il a écrit<br />
la postface, O. Giraud <strong>et</strong> P. Warin ont principalement<br />
r<strong>et</strong>enu les éléments suivants :<br />
• l’approche structurelle du politique : les politiques<br />
publiques sont des politiques instituantes<br />
plus que des politiques instituées, c’est-à-<strong>dir</strong>e que<br />
si elles mobilisent des configurations institutionnelles,<br />
ces dernières sont davantage envisagées<br />
comme l’expression de relations de domination<br />
que comme le simple produit desdites politiques.<br />
Autrement dit, les politiques publiques sont des<br />
« processus de définition sociale de la réalité, <strong>et</strong><br />
sont analysées comme telles » (p. 9), notamment à<br />
l’aide du concept de référentiel ;<br />
• l’importance du langage politique : la mise en<br />
mots des problèmes à résoudre <strong>et</strong> des solutions à<br />
leur apporter est un instrument essentiel de la<br />
construction de la légitimité politique ;<br />
• le politique comme adaptabilité permanente : la<br />
(1) Certains auteurs préfèrent la notion d’action publique à celle de politique publique. Pierre Lascoumes <strong>et</strong> Patrick Le Galès,<br />
notamment, sont de ceux-là, « pour prendre en compte l’ensemble des interactions qui, sur des suj<strong>et</strong>s comme le<br />
développement industriel, l’immigration ou l’alimentation, sont nécessairement traités à des niveaux multiples »(Sociologie de<br />
l’action publique, Armand Colin, collection « 128 », 2007:6). O. Giraud <strong>et</strong> P. Warin ne s’inscrivent pas dans ce débat<br />
sémantique, eux qui utilisent à plusieurs reprises l’une pour l’autre des deux notions dans leur introduction.