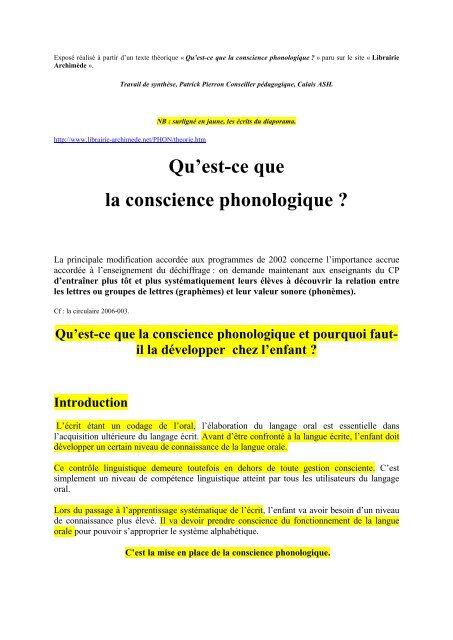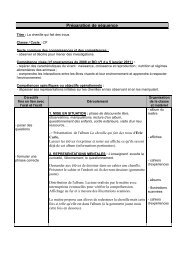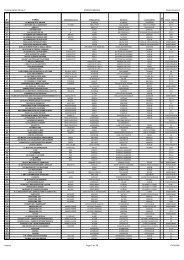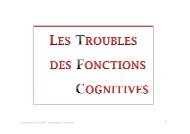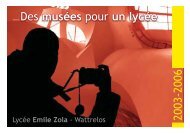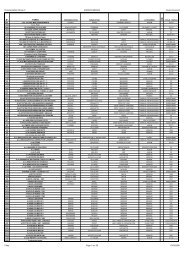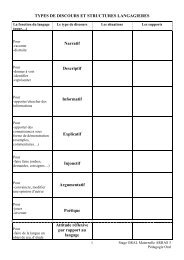Qu'est-ce que la conscience phonologique
Qu'est-ce que la conscience phonologique
Qu'est-ce que la conscience phonologique
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Exposé réalisé à partir d’un texte théori<strong>que</strong> « Qu’est-<strong>ce</strong> <strong>que</strong> <strong>la</strong> conscien<strong>ce</strong> phonologi<strong>que</strong> ? » paru sur le site « Librairie<br />
Archimède ».<br />
Travail de synthèse, Patrick Pierron Conseiller pédagogi<strong>que</strong>, Ca<strong>la</strong>is ASH.<br />
http://www.librairie-archimede.net/PHON/theorie.htm<br />
NB : surligné en jaune, les écrits du diaporama.<br />
Qu’est-<strong>ce</strong> <strong>que</strong><br />
<strong>la</strong> conscien<strong>ce</strong> phonologi<strong>que</strong> ?<br />
La principale modification accordée aux programmes de 2002 con<strong>ce</strong>rne l’importan<strong>ce</strong> accrue<br />
accordée à l’enseignement du déchiffrage : on demande maintenant aux enseignants du CP<br />
d’entraîner plus tôt et plus systémati<strong>que</strong>ment leurs élèves à découvrir <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion entre<br />
les lettres ou groupes de lettres (graphèmes) et leur valeur sonore (phonèmes).<br />
Cf : <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>ire 2006-003.<br />
Qu’est-<strong>ce</strong> <strong>que</strong> <strong>la</strong> conscien<strong>ce</strong> phonologi<strong>que</strong> et pourquoi fautil<br />
<strong>la</strong> développer chez l’enfant ?<br />
Introduction<br />
L’écrit étant un codage de l’oral, l’é<strong>la</strong>boration du <strong>la</strong>ngage oral est essentielle dans<br />
l’acquisition ultérieure du <strong>la</strong>ngage écrit. Avant d’être confronté à <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue écrite, l’enfant doit<br />
développer un <strong>ce</strong>rtain niveau de connaissan<strong>ce</strong> de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue orale.<br />
Ce contrôle linguisti<strong>que</strong> demeure toutefois en dehors de toute gestion consciente. C’est<br />
simplement un niveau de compéten<strong>ce</strong> linguisti<strong>que</strong> atteint par tous les utilisateurs du <strong>la</strong>ngage<br />
oral.<br />
Lors du passage à l’apprentissage systémati<strong>que</strong> de l’écrit, l’enfant va avoir besoin d’un niveau<br />
de connaissan<strong>ce</strong> plus élevé. Il va devoir prendre conscien<strong>ce</strong> du fonctionnement de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue<br />
orale pour pouvoir s’approprier le système alphabéti<strong>que</strong>.<br />
C’est <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong><strong>ce</strong> de <strong>la</strong> conscien<strong>ce</strong> phonologi<strong>que</strong>.
L’objectif affiché dans <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>ire 2006-003 est de développer <strong>la</strong> conscien<strong>ce</strong> des unités<br />
phonologi<strong>que</strong>s du <strong>la</strong>ngage oral dès <strong>la</strong> Grande Section de Maternelle. C’est <strong>ce</strong> qui permet de<br />
préparer les enfants à aborder le <strong>la</strong>ngage écrit dans les meilleures conditions possibles et<br />
munis des compéten<strong>ce</strong>s indispensables à un apprentissage réussi de <strong>la</strong> lecture-écriture.<br />
La conscien<strong>ce</strong> phonologi<strong>que</strong> est <strong>la</strong> conscien<strong>ce</strong> de toute unité linguisti<strong>que</strong> (syl<strong>la</strong>bes, rimes,<br />
phonèmes). Elle permet des opérations mentales sur le <strong>la</strong>ngage parlé comme par exemple,<br />
segmenter des mots en syl<strong>la</strong>bes, reconnaître <strong>la</strong> rime d’un mot, supprimer le premier phonème<br />
d’une syl<strong>la</strong>be...<br />
Syl<strong>la</strong>bes, rimes, phonèmes sont des unités du <strong>la</strong>ngage oral. La phonologie est l’étude de <strong>ce</strong>s<br />
unités.<br />
Quel<strong>que</strong>s points essentiels né<strong>ce</strong>ssaires à l’explicitation du<br />
vocabu<strong>la</strong>ire employé.<br />
- Les phonèmes :<br />
Les phonèmes peuvent être répartis en deux principales catégories : les voyelles et les<br />
consonnes.<br />
La voyelle est de façon générale décrite comme traduisant un son “musical” très dis<strong>ce</strong>rnable<br />
(étymologie: du <strong>la</strong>tin “vocalis”, adjectif de voix), alors <strong>que</strong> <strong>la</strong> consonne est, quant à elle,<br />
définie comme un “bruit”, supposant toujours une voyelle pour <strong>la</strong> rendre per<strong>ce</strong>ptible<br />
(étymologie : du <strong>la</strong>tin “consona”, qui sonne avec). Ainsi, <strong>la</strong> voyelle est autonome mais <strong>la</strong><br />
consonne ne peut pas l’être.<br />
Le Français écrit compte six voyelles. Mais le Français oral possède seize sons<br />
vocali<strong>que</strong>s. On y distingue en particulier les voyelles orales et les voyelles nasales.<br />
Si l’air phonateur emprunte uni<strong>que</strong>ment <strong>la</strong> cavité buccale, <strong>la</strong> voyelle est dite orale ou pure ou buccale ([a], [o], etc...). Si l’air phonateur<br />
emprunte à <strong>la</strong> fois <strong>la</strong> cavité buccale et les fosses nasales, <strong>la</strong> voyelle est dite nasale ([aâ], [ â], etc...).<br />
Le Français écrit possède vingt consonnes.<br />
Dans le <strong>la</strong>ngage oral, on compte trois consonnes nasales ([m], [n], [gn]), toutes les autres sont orales. On oppose également les<br />
sourdes aux sonores. Si, lors de l’émission d’une consonne, les cordes vocales entrent en<br />
activité, <strong>la</strong> consonne est sonore ; sinon, <strong>la</strong> consonne est sourde. Six consonnes sourdes ont<br />
leur correspondante sonore ([p]/[b] ; [t]/[d] ; [k]/[g] ; [f]/[v] ; [s]/[z]). Deux consonnes /l/ et /r/<br />
sont désignées sous le terme de liquides. Ce sont deux sonores qui n’ont pas de<br />
correspondantes sourdes, mais leur association avec une autre consonne définit un “groupe<br />
consonanti<strong>que</strong>” (comme “br”, “pr”, “dr”, “cl”, “fl”, ...).<br />
Chez l’enfant, entre trois et six ans, l’essentiel du système phonologi<strong>que</strong> est déjà acquis<br />
puis<strong>que</strong> <strong>la</strong> période d’acquisition massive se situe autour de 18-20 mois. On observe,<br />
pourtant, <strong>que</strong> seulement le quart des enfants entre cinq et six ans possède une maîtrise
correcte du système phonologi<strong>que</strong>. Le système vocali<strong>que</strong> (voyelles orales seulement) étant<br />
plus rapidement possédé <strong>que</strong> le système consonanti<strong>que</strong>.<br />
De par leur abstraction au niveau de l’émission vocale, <strong>la</strong> détection des phonèmes (sauf<br />
les voyelles orales) est très difficile. Par contre, les jeunes enfants parviennent très tôt à<br />
détecter les syl<strong>la</strong>bes.<br />
- Les syl<strong>la</strong>bes :<br />
La syl<strong>la</strong>be (étymologie: du <strong>la</strong>tin “syl<strong>la</strong>ba” : prendre avec) peut se définir comme un groupe<br />
de phonèmes (parfois un seul phonème) <strong>que</strong> l’on pronon<strong>ce</strong> d’une seule émission de voix. La<br />
syl<strong>la</strong>be est ainsi définie comme une unité d’autonomie vocale.<br />
La syl<strong>la</strong>be, véritable unité de segmentation du <strong>la</strong>ngage oral apparaît ainsi comme l’unité<br />
privilégiée dont va se servir l’enfant pour commen<strong>ce</strong>r à développer sa conscien<strong>ce</strong><br />
phonologi<strong>que</strong>.<br />
Progression :<br />
- isoler les unités mots dans le flux oral, sur des groupes de mots<br />
- isoler l’unité articu<strong>la</strong>toire du mot, <strong>la</strong> syl<strong>la</strong>be.<br />
L’unité syl<strong>la</strong>bi<strong>que</strong> Consonne/Voyelle constitue <strong>la</strong> structure de base sur <strong>la</strong><strong>que</strong>lle va reposer les<br />
premiers acquis de l’enfant en lecture-écriture.<br />
L’émergen<strong>ce</strong> d’une conscien<strong>ce</strong> syl<strong>la</strong>bi<strong>que</strong>, liée à <strong>la</strong> capacité de repérer cha<strong>que</strong> syl<strong>la</strong>be à<br />
l’intérieur d’un mot, se fait à partir de l’exerci<strong>ce</strong> de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue orale.<br />
1.1- La conscien<strong>ce</strong> syl<strong>la</strong>bi<strong>que</strong><br />
La conscien<strong>ce</strong> syl<strong>la</strong>bi<strong>que</strong> apparaît bien avant l’apprentissage systémati<strong>que</strong> de <strong>la</strong> lecture. Des<br />
enfants d’âge pré-élémentaire peuvent réussir des tâches de repérage de structures syl<strong>la</strong>bi<strong>que</strong>s<br />
(par exemple, taper dans les mains autant de fois qu’il y a de syl<strong>la</strong>bes dans un mot).<br />
La syl<strong>la</strong>be est une unité facilement perçue car facilement iso<strong>la</strong>ble dans l’acte articu<strong>la</strong>toire. A<br />
l’inverse, <strong>la</strong> difficulté d’appréhension du phonème vient du fait qu’il n’est jamais perçu<br />
de façon isolée mais toujours articulé à d’autres phonèmes pour former une syl<strong>la</strong>be.<br />
1.2- La conscien<strong>ce</strong> phonémi<strong>que</strong>
La conscien<strong>ce</strong> phonémi<strong>que</strong> peut se définir comme <strong>la</strong> capacité à considérer les mots parlés<br />
comme étant formés d’unités phonologi<strong>que</strong>s insegmentables: les phonèmes. Les phonèmes<br />
sont des abstractions linguisti<strong>que</strong>s. Unités de base, ils forment ainsi <strong>la</strong> structure<br />
phonologi<strong>que</strong> des mots. Ils constituent <strong>la</strong> plus petite unité de segmentation de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue orale.<br />
La capacité d’analyse phonémi<strong>que</strong> peut être étudiée à travers différentes tâches. On répertorie<br />
entre autres et à titre d’exemples:<br />
-<strong>la</strong> segmentation d’un mot en phonèmes (ex: “carton” -> [k-a-r-t- ] );<br />
-l’isolement de phonèmes (ex: qu’est-<strong>ce</strong> <strong>que</strong> j’entends au début de “arbre”, de “lune”?...);<br />
-<strong>la</strong> recherche d’un phonème dans un mot (notion d’intrus ; ex: ballon, banane, baleine, bille);<br />
-<strong>la</strong> suppression ou l’addition de phonèmes (ex: <strong>que</strong> devient le mot “route” si j’enlève [r]?).<br />
Pour pouvoir apprendre un système alphabéti<strong>que</strong>. Les enfants doivent né<strong>ce</strong>ssairement être<br />
capables de décomposer explicitement les mots en syl<strong>la</strong>bes et les syl<strong>la</strong>bes en phonèmes<br />
La lecture alphabéti<strong>que</strong> associe en effet, une composante visuelle graphi<strong>que</strong> à une composante<br />
auditive ; on parle de <strong>la</strong> correspondan<strong>ce</strong> grapho-phonémi<strong>que</strong>.<br />
Pendant longtemps, deux niveaux seulement de conscien<strong>ce</strong> phonologi<strong>que</strong> étaient donc<br />
étudiés : le phonème en tant <strong>que</strong> plus petite unité de segmentation de <strong>la</strong> syl<strong>la</strong>be; <strong>la</strong> syl<strong>la</strong>be en<br />
tant qu’enchaînement linéaire de phonèmes. Depuis les années 80, d’autres possibilités<br />
d’analyse phonologi<strong>que</strong> sont apparues.<br />
1.3- La conscien<strong>ce</strong> d’unités intra-syl<strong>la</strong>bi<strong>que</strong>s<br />
Dans les années 1980, des études sur des unités phonologi<strong>que</strong>s de taille infra-syl<strong>la</strong>bi<strong>que</strong> sont<br />
apparues. La syl<strong>la</strong>be a été alors décrite comme comportant deux parties principales:<br />
l’atta<strong>que</strong> et <strong>la</strong> rime. L’atta<strong>que</strong> (appelée aussi amor<strong>ce</strong>) est <strong>la</strong> partie consonanti<strong>que</strong> initiale de <strong>la</strong><br />
syl<strong>la</strong>be. C’est une consonne isolée ou un groupe de consonnes. La rime est constituée par <strong>la</strong><br />
voyelle et les éventuelles consonnes qui <strong>la</strong> suivent.<br />
Il semble <strong>que</strong> <strong>la</strong> détection des unités intra-syl<strong>la</strong>bi<strong>que</strong>s est plus facile et antérieure à <strong>ce</strong>lle des<br />
phonèmes. Ainsi, l’enfant serait capable de <strong>la</strong> décomposition en atta<strong>que</strong> et rime d’une syl<strong>la</strong>be,<br />
sans être conscient de <strong>la</strong> possibilité de segmentation en phonèmes.<br />
En Français, <strong>la</strong> rime beaucoup plus <strong>que</strong> l’atta<strong>que</strong> semble être traitée de façon privilégiée par le<br />
jeune enfant (cf. les comptines et les jeux de rimes). La prise en compte implicite de l’unité<br />
rime apparaît très tôt chez l’enfant.<br />
1.4- Conscien<strong>ce</strong> phonologi<strong>que</strong> et acquisition de <strong>la</strong> lecture-écriture
Les enfants en difficulté de lecture présentent des performan<strong>ce</strong>s nettement inférieures aux<br />
enfants bons lecteurs dans des tâches de conscien<strong>ce</strong> phonologi<strong>que</strong>. On observe un grave<br />
déficit en analyse phonémi<strong>que</strong> chez les lecteurs malhabiles. Les enfants présentant <strong>ce</strong> type de<br />
déficit ont un apprentissage extrêmement lent et <strong>la</strong>borieux.<br />
De par l’importan<strong>ce</strong> du rôle qu’elle revêt dans l’acquisition de <strong>la</strong> lecture, <strong>la</strong> conscien<strong>ce</strong><br />
phonologi<strong>que</strong> apparaît ainsi comme indissociable de <strong>la</strong> réussite ou de l’échec en lecture.<br />
L’apprentissage de <strong>la</strong> lecture se structure selon trois axes qui se renfor<strong>ce</strong>nt les uns les<br />
autres :<br />
- La reconnaissan<strong>ce</strong> des mots écrits<br />
- La compréhension des phrases et des textes<br />
- La production de textes<br />
En effet, d’une façon générale, l’enfant apprenti lecteur passe par :<br />
- une lecture logographi<strong>que</strong> : reconnaissan<strong>ce</strong> visuelle “globale” des mots; “devinement” de<br />
mots appris par coeur;<br />
- une lecture alphabéti<strong>que</strong> : mise en re<strong>la</strong>tion de <strong>la</strong> version écrite et de <strong>la</strong> version orale des<br />
mots; correspondan<strong>ce</strong> grapho-phonologi<strong>que</strong>;<br />
- une lecture orthographi<strong>que</strong> : étape finale aboutissant à <strong>la</strong> lecture experte; lecture automati<strong>que</strong><br />
et rapide.<br />
Grâ<strong>ce</strong> à <strong>ce</strong>tte correspondan<strong>ce</strong> entre lettres et sons (<strong>la</strong> correspondan<strong>ce</strong> grapho-phonologi<strong>que</strong>) <strong>la</strong><br />
lecture perd le caractère arbitraire de <strong>la</strong> lecture logographi<strong>que</strong> et permet à l’enfant de lire tous<br />
les mots nouveaux. C’est dans <strong>ce</strong>tte étape d’apprentissage <strong>que</strong> <strong>la</strong> phonologie joue un rôle<br />
essentiel.<br />
Introduction<br />
L’écrit étant un codage de l’oral, l’é<strong>la</strong>boration du <strong>la</strong>ngage oral est essentielle dans<br />
l’acquisition ultérieure du <strong>la</strong>ngage écrit. Avant d’être confronté à <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue écrite, l’enfant doit<br />
développer un <strong>ce</strong>rtain niveau de connaissan<strong>ce</strong> de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue orale.<br />
Ce contrôle linguisti<strong>que</strong> demeure toutefois en dehors de toute gestion consciente. C’est<br />
simplement un niveau de compéten<strong>ce</strong> linguisti<strong>que</strong> atteint par tous les utilisateurs du <strong>la</strong>ngage<br />
oral.
Lors du passage à l’apprentissage systémati<strong>que</strong> de l’écrit, l’enfant va avoir besoin d’un niveau<br />
de connaissan<strong>ce</strong> plus élevé. Il va devoir prendre conscien<strong>ce</strong> du fonctionnement de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue<br />
orale pour pouvoir s’approprier le système alphabéti<strong>que</strong>.<br />
C’est <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong><strong>ce</strong> de <strong>la</strong> conscien<strong>ce</strong> phonologi<strong>que</strong>.