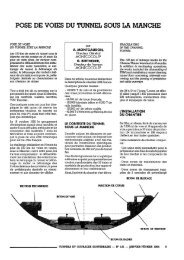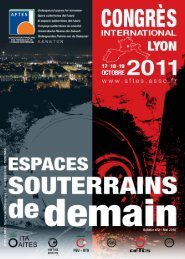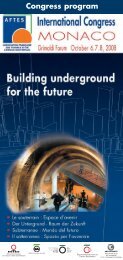Congrès international de Monaco Le souterrain : espace d ... - AFTES
Congrès international de Monaco Le souterrain : espace d ... - AFTES
Congrès international de Monaco Le souterrain : espace d ... - AFTES
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1 - LES 4 THÈMES DU CONGRÈS<br />
Etant le premier <strong>de</strong>s rapporteurs <strong>de</strong> ce <strong>Congrès</strong>, je me permets <strong>de</strong><br />
commencer par un petit aperçu <strong>de</strong> ce qui vous attend.<br />
Pour chacun <strong>de</strong>s thèmes choisis, j’ai indiqué le nombre <strong>de</strong> présentations<br />
retenues pour une présentation orale ou comme réserve,<br />
par rapport au nombre <strong>de</strong> présentations proposées.<br />
Vous constatez que notre thème A <strong>de</strong> cet après-midi est celui qui a<br />
eu le moins <strong>de</strong> succès en ce qui concerne les propositions <strong>de</strong> communications,<br />
peut-être parce qu’il a été perçu comme le moins <strong>de</strong>scriptif<br />
ou le plus philosophique.<br />
J’ai reçu 13 présentations à vous résumer dans ce rapport général,<br />
sur les 101 qui ont été soumises au Comité scientifique du <strong>Congrès</strong>.<br />
2 - LES PRÉSENTATIONS RETENUES<br />
POUR LE THÈME A<br />
Voici les 9 propositions que le Comité scientifique a retenues pour<br />
une présentation orale durant cette séance consacrée au thème A.<br />
A titre purement personnel, j’ai indiqué en rouge les 4 présentations<br />
qui, selon moi, se situent réellement dans le sujet <strong>de</strong> la présente<br />
session, c’est-à-dire <strong>de</strong>s communications relatives aux principes<br />
mêmes <strong>de</strong> l’utilisation rationnelle du sous-sol, et qui ne traitent pas<br />
essentiellement <strong>de</strong> l’une ou l’autre réalisation spécifique.<br />
<strong>Le</strong> manque d’intérêt, ou du moins <strong>de</strong> propositions pour ce sujet,<br />
n’est pas propre à ce <strong>Congrès</strong>-ci. <strong>Le</strong> même phénomène s’est présenté<br />
au <strong>Congrès</strong> mondial qui s’est tenu à Agra en In<strong>de</strong>.<br />
3 - LES PRÉSENTATIONS EN RÉSERVE<br />
Ces 4 propositions ont été retenues par le Comité scientifique pour<br />
le cas où il y aurait l’une ou l’autre absence ou défection dans le<br />
groupe précé<strong>de</strong>nt ; on m’a <strong>de</strong>mandé <strong>de</strong> les commenter également<br />
dans le présent rapport général.<br />
De plus, les 2 propositions non retenues figureront aussi dans le<br />
Recueil <strong>de</strong> Documentation du <strong>Congrès</strong>, ou dans un <strong>de</strong>s prochains<br />
numéros <strong>de</strong> la Revue « Tunnels et Ouvrages Souterrains ».<br />
4 - PRÉSENTATION 1<br />
Monsieur Brégeon nous indiquera comment le sous-sol peut<br />
apporter <strong>de</strong>s réponses aux défis climatiques <strong>de</strong> <strong>de</strong>main, et donc<br />
aussi au développement durable.<br />
Il nous parlera <strong>de</strong> l’inertie et <strong>de</strong> la faible conductivité thermique du<br />
sous-sol, et <strong>de</strong> sa capacité à générer <strong>de</strong>s calories et <strong>de</strong>s frigories.<br />
Il nous parlera aussi <strong>de</strong> sa résistance mécanique contre <strong>de</strong>s effets<br />
naturels (séismes, tempêtes, cyclones, etc.) et contre <strong>de</strong>s effets<br />
d’origine humaine (agressions, bombes, avions et missiles, etc.).<br />
Il nous parlera enfin <strong>de</strong> l’accessibilité du sous-sol, en particulier en<br />
terrain acci<strong>de</strong>nté, et <strong>de</strong> ses capacités d’isolation auditive et antivibratoire.<br />
Il mentionnera 2 aspects dont on parle en général moins : la disponibilité<br />
du sous-sol et sa discrétion.<br />
La disponibilité a toutefois conduit à <strong>de</strong>s gaspillages, notamment<br />
en ce qui concerne le sous-sol <strong>de</strong>s voiries urbaines.<br />
Pour la discrétion, on peut citer les caves <strong>de</strong>s banques, les sites <strong>de</strong><br />
stockage et les sites <strong>de</strong> recherche ; je pense que l’auteur n’a pas<br />
osé mentionner les caves à vin.<br />
A plus gran<strong>de</strong> profon<strong>de</strong>ur, la géothermie ne nous a pas encore<br />
montré tous les bénéfices que l’on pourrait en tirer.<br />
L’auteur terminera par quelques exemples, en particulier <strong>de</strong> sites privilégiés<br />
par leur morphologie ou la structure géologique environnante.<br />
5 - PRÉSENTATION 2<br />
VIE DE L’<strong>AFTES</strong><br />
<strong>Congrès</strong> <strong>de</strong> <strong>Monaco</strong><br />
<strong>Congrès</strong> <strong>international</strong> <strong>de</strong> <strong>Monaco</strong><br />
<strong>Le</strong> <strong>souterrain</strong> : <strong>espace</strong> d’avenir<br />
Textes <strong>de</strong> présentation <strong>de</strong>s rapporteurs<br />
<strong>Le</strong>s communications mentionnées dans les textes <strong>de</strong> présentation <strong>de</strong>s rapporteurs ont toutes été publiées dans<br />
le Recueil <strong>de</strong>s actes du <strong>Congrès</strong> distribué aux participants du <strong>Congrès</strong> <strong>de</strong> <strong>Monaco</strong> (6, 7 ,8 octobre 2008).<br />
THÈME A - <strong>Le</strong> sous-sol, <strong>espace</strong> <strong>de</strong> projets<br />
Par Willy De Lathauwer (ABTUS/BVOTS, Belgique)<br />
Ray Sterling indiquera dans sa présentation un certain nombre<br />
d’exemples d’importantes routes ou autoroutes côtières urbaines,<br />
TUNNELS ET OUVRAGES SOUTERRAINS - N° 210 - NOVEMBRE/DECEMBRE 2008 437
438<br />
VIE DE L’<strong>AFTES</strong><br />
<strong>Congrès</strong> <strong>de</strong> <strong>Monaco</strong><br />
sur berge ou dans <strong>de</strong>s zones portuaires, qui ont été réalisées en<br />
ouvrages aériens ou <strong>de</strong> surface, et qui soit ont été mises en <strong>souterrain</strong>,<br />
soit pourraient avoir intérêt à l’être.<br />
Dans l’exemple <strong>de</strong> la fameuse Central Artery à Boston, il soulignera<br />
les difficultés <strong>de</strong> construire un ouvrage <strong>souterrain</strong> sous un ouvrage<br />
aérien existant, surtout dans le voisinage d’un cours d’eau, mais<br />
aussi l’accroissement substantiel <strong>de</strong> la valeur <strong>de</strong>s biens immobiliers<br />
riverains entre le début et la fin du projet, soit dans ce cas précis<br />
+ 80 % en 15 ans.<br />
Je me permets d’ajouter un exemple analogue à Bruxelles, où<br />
l’accroissement <strong>de</strong> la valeur <strong>de</strong>s terrains riverains a été <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong><br />
500 % en 10 ans ; la particularité est toutefois que l’investissement<br />
en infrastructure <strong>souterrain</strong>e <strong>de</strong> transport a été fait exclusivement à<br />
charge du budget public, alors que la plus-value <strong>de</strong>s terrains avoisinants<br />
est entièrement revenue au promoteur immobilier concerné ;<br />
les taxes sur l’immobilier permettent toutefois un certain retour.<br />
6 - PRÉSENTATION 3<br />
Messieurs Baghary et Chaubert nous parleront du tunnel T 33 situé<br />
dans le centre <strong>de</strong> <strong>Monaco</strong>.<br />
Un bon nombre d’entre vous auront vu que le même sujet a été<br />
abordé, sous un angle différent, dans le numéro 208 <strong>de</strong> la revue<br />
« Tunnels et Ouvrages Souterrains » <strong>de</strong> l’<strong>AFTES</strong>.<br />
En plus <strong>de</strong>s circonstances <strong>de</strong> relief et géologiques difficiles, un<br />
point essentiel a été le nombre et la variété <strong>de</strong>s contraintes environnementales<br />
liées au site urbain <strong>de</strong>nse :<br />
- minimalisation <strong>de</strong>s nuisances sonores<br />
- gestion <strong>de</strong>s poussières<br />
- respect <strong>de</strong>s critères en matière <strong>de</strong> vibrations<br />
- existence <strong>de</strong> courants vagabonds<br />
- phasage <strong>de</strong>s travaux suite aux nécessités <strong>de</strong> la circulation<br />
<strong>Le</strong> creusement <strong>de</strong> ce tunnel <strong>de</strong> 145 m <strong>de</strong> longueur a été entamé<br />
début 2007, et en est actuellement aux travaux <strong>de</strong> parachèvement.<br />
7 - PRÉSENTATION 4<br />
La présentation <strong>de</strong> Monique Labbé vient <strong>de</strong> paraître dans le<br />
numéro 209 <strong>de</strong> la revue « Tunnels et Ouvrages Souterrains » <strong>de</strong><br />
l’<strong>AFTES</strong>, que vous avez reçu dans votre documentation.<br />
<strong>Le</strong>s auteurs proposent une nouvelle façon <strong>de</strong> concevoir la planification<br />
urbanistique d’une région, en associant le plus tôt possible le<br />
sous-sol à la surface. Cette nouvelle conception inclut les aspects<br />
géographiques traditionnels, tels le relief, les écoulements <strong>de</strong>s eaux<br />
et la géologie, mais aussi les implantations antérieures et actuelles,<br />
<strong>de</strong> la population mais aussi <strong>de</strong>s divers mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> transport.<br />
Dans l’étu<strong>de</strong> du cas particulier du Département Val-<strong>de</strong>-Marne, au<br />
Sud-Est <strong>de</strong> Paris, et incluant notamment Orly et Rungis, on constate<br />
que le sous-sol est actuellement très peu utilisé, et encore exclusivement<br />
pour l’assainissement.<br />
Des propositions sont formulées, qui concernent en particulier <strong>de</strong>s<br />
nouvelles lignes <strong>de</strong> transport en commun et <strong>de</strong>s nouveaux quartiers<br />
d’habitat, qui seraient <strong>de</strong>sservis exclusivement par <strong>de</strong>s liaisons<br />
largement <strong>souterrain</strong>es.<br />
Je reprends une partie <strong>de</strong>s conclusions <strong>de</strong> cette présentation : « <strong>Le</strong><br />
sous-sol est le grand absent <strong>de</strong>s schémas d’urbanisme ; après le<br />
temps <strong>de</strong>s tours <strong>de</strong>vrait venir celui <strong>de</strong>s villes profon<strong>de</strong>s ».<br />
TUNNELS ET OUVRAGES SOUTERRAINS - N° 210 - NOVEMBRE/DECEMBRE 2008<br />
Cette présentation <strong>de</strong> Monique Labbé terminera la première partie<br />
<strong>de</strong> la séance consacrée au thème A.<br />
8 - PRÉSENTATION 5<br />
Monsieur Parriaux sera le premier orateur et présentera un projet<br />
<strong>de</strong> recherche suisse « Deep City » <strong>de</strong> l’Ecole Polytechnique Fédérale<br />
<strong>de</strong> Lausanne, qui introduit une approche holistique <strong>de</strong>s possibilités<br />
du sous-sol urbain et préconise une utilisation coordonnée et<br />
optimisée <strong>de</strong> ses ressources. <strong>Le</strong> projet part donc <strong>de</strong>s ressources au<br />
lieu <strong>de</strong> partir <strong>de</strong>s besoins.<br />
L’expression « coloniser le <strong>souterrain</strong> pour faire <strong>de</strong> la place à l’air<br />
libre » me fait à la fois rêver et craindre.<br />
<strong>Le</strong> problème essentiel que l’on rencontre dans le <strong>souterrain</strong> serait<br />
que, trop souvent encore, il est utilisé à un endroit et à un moment<br />
donnés pour résoudre un problème ponctuel dans l’<strong>espace</strong> et dans<br />
le temps, et que l’on ne pense pas encore suffisamment aux<br />
besoins futurs et à leur intégration dans un ensemble cohérent.<br />
Dans cet ordre d’idées, un participant finlandais nous a dit lors du<br />
récent <strong>Congrès</strong> mondial que la capitale finlandaise serait la seule<br />
gran<strong>de</strong> ville au mon<strong>de</strong> qui disposerait <strong>de</strong> ce qu’ils appellent un<br />
« master-plan » <strong>de</strong> l’ensemble du sous-sol.<br />
9 - PRÉSENTATION 6<br />
<strong>Le</strong> projet qui sera présenté par Didier De Bruyn est celui d’un parking<br />
<strong>souterrain</strong> à créer sous une cour intérieure arborée, encerclée par<br />
<strong>de</strong>s bâtiments ancien rénovés et à gar<strong>de</strong>r en service, et dont certaines<br />
parties sont par ailleurs classées.<br />
Dans ce projet, les obstacles principaux à une réalisation technique<br />
idéale sont :<br />
- le classement <strong>de</strong>s faça<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> la cour par l’Administration <strong>de</strong>s<br />
Monuments et <strong>de</strong>s Sites<br />
- la présence <strong>de</strong>s rangées <strong>de</strong> tilleuls le long <strong>de</strong> ces faça<strong>de</strong>s<br />
- les ouvrages préexistants d’évacuation <strong>de</strong>s eaux<br />
- la limitation <strong>de</strong> la capacité du parking, pour <strong>de</strong>s raisons d’ordre<br />
administratif, à 200 places.<br />
10 - PRÉSENTATION 7<br />
<strong>Le</strong> professeur Sebastiano Pelizza nous parlera <strong>de</strong> l’adaptation <strong>de</strong> la<br />
conception d’un tunnel pour lequel il s’est avéré au cours <strong>de</strong>s travaux<br />
<strong>de</strong> creusement, que le massif comportait, dans une certaine zone,<br />
<strong>de</strong>s couches imprégnées d’asbeste, qui n’avaient pas été détectées<br />
lors <strong>de</strong>s forages <strong>de</strong> reconnaissance malgré que la zone soit connue<br />
pour ce risque <strong>de</strong> présence d’asbeste.<br />
L’inci<strong>de</strong>nt a eu <strong>de</strong> larges échos, car il se situait dans le cadre <strong>de</strong>s<br />
Jeux olympiques d’hiver <strong>de</strong> Turin - Sestrière.<br />
Il est à noter que certaines parties <strong>de</strong>s tunnels <strong>de</strong> la nouvelle ligne<br />
ferroviaire Lyon - Turin se trouvent dans le même secteur.<br />
La présentation se terminera par quelques explications sur la<br />
conception d’une caverne qui servira à l’entreposage définitif du<br />
matériau contaminé.<br />
Un point essentiel pour permettre l’achèvement du tunnel a donc<br />
été <strong>de</strong> rechercher <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> remplacement pour le forage<br />
et l’excavation, qui minimiseraient la production <strong>de</strong> poussière et qui
isoleraient au maximum les matériaux excavés, mais aussi le rocher<br />
subsistant.<br />
La présentation décrira également les conditions requises pour la<br />
caverne d’entreposage du matériau contaminé, et particulier la<br />
nécessité <strong>de</strong> placer ce matériau dans <strong>de</strong>s conteneurs en béton<br />
armé.<br />
11 - PRÉSENTATION 8<br />
Nous arrivons maintenant aux <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rnières présentations orales<br />
<strong>de</strong> la séance <strong>de</strong> cet après-midi, qui auront toutes <strong>de</strong>ux trait à <strong>de</strong>s<br />
aspects bien spécifiques du tunnel <strong>de</strong> base <strong>de</strong> la nouvelle liaison<br />
ferroviaire Lyon – Turin, qui aura à lui seul une longueur <strong>de</strong> 53 km.<br />
Monsieur Darmendrail nous parlera <strong>de</strong> la gestion et <strong>de</strong> la valorisation<br />
<strong>de</strong>s matériaux d’excavation du tunnel.<br />
<strong>Le</strong> total <strong>de</strong>s déblais <strong>de</strong> la section française, qui aura une longueur<br />
<strong>de</strong> 45 km et comportera outre le tunnel <strong>de</strong> nombreux ouvrages<br />
annexes, est estimé à 12 millions <strong>de</strong> m3 , soit un km2 sur 12 m <strong>de</strong><br />
hauteur. Grosso modo la moitié pourra être réutilisée, soit comme<br />
agrégats pour les divers ouvrages en béton, soit pour les remblais<br />
aux abords <strong>de</strong> l’ouvrage.<br />
12 - PRÉSENTATION 9<br />
Finalement Monsieur Piraud, qui est par ailleurs le Prési<strong>de</strong>nt du<br />
Comité scientifique <strong>de</strong> notre <strong>Congrès</strong>, nous parlera <strong>de</strong> la modélisation<br />
géothermique et du système <strong>de</strong> refroidissement prévus pour ce<br />
même tunnel <strong>de</strong> base.<br />
Plus <strong>de</strong> la moitié <strong>de</strong>s 53 km <strong>de</strong> longueur <strong>de</strong> ce tunnel seront construits<br />
sous une couverture <strong>de</strong> rocher <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 1000 m, et plus <strong>de</strong> 10 km<br />
sous une couverture <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 1500 m, ce qui équivaut en<br />
pratique à <strong>de</strong>s élévations <strong>de</strong> température <strong>de</strong> respectivement plus<br />
<strong>de</strong> 30 °C et <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 45 °C.<br />
Ces augmentations <strong>de</strong> température nécessitent évi<strong>de</strong>mment un<br />
refroidissement en pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> creusement, et même pendant<br />
certaines pério<strong>de</strong>s d’exploitation.<br />
Pendant l’excavation, les règlements du travail imposent une température<br />
maximale <strong>de</strong> 26 °C, ce qui nécessitera bien entendu un<br />
refroidissement. <strong>Le</strong> type qui est proposé est un refroidissement<br />
flexible au moyen d’appareils situés à proximité <strong>de</strong>s ateliers <strong>de</strong><br />
travail et <strong>de</strong>s sources <strong>de</strong> chaleur principales, qui refroidiront<br />
directement l’air du tunnel.<br />
En exploitation, on estime qu’une température <strong>de</strong> 35 °C peut être<br />
considérée comme acceptable, qui peut être obtenue la plupart du<br />
temps par la ventilation naturelle et l’effet <strong>de</strong> pistonnement <strong>de</strong>s<br />
trains en mouvement. Durant les fortes chaleurs d’été, un refroidissement<br />
artificiel <strong>de</strong>vra malgré tout être prévu. Un système <strong>de</strong><br />
refroidissement à eau est proposé.<br />
13 - PRÉSENTATION 10<br />
Je passe maintenant aux quatre propositions que le Comité scientifique<br />
a tenues en réserve, et qui ne seront donc pas présentées oralement.<br />
La proposition <strong>de</strong> communication présentée par Monsieur Favre<br />
concerne le tunnel <strong>de</strong> Pinchat et la gare <strong>de</strong> Carouge Bachet sur la<br />
nouvelle liaison ferroviaire transfrontalière Genève – Annemasse.<br />
Sur le territoire suisse, la nouvelle liaison aura une longueur <strong>de</strong><br />
15 km, dont 9 km en tracé neuf essentiellement en <strong>souterrain</strong>, et<br />
comportera 5 gares, dont 4 en <strong>souterrain</strong>.<br />
La section française aura une longueur <strong>de</strong> 2 km, essentiellement<br />
en site existant à ciel ouvert.<br />
<strong>Le</strong> tracé <strong>souterrain</strong> en Suisse comporte 5 lots avec à la fois <strong>de</strong>s<br />
sections en tranchées couvertes et en excavation mécanisée<br />
traditionnelle.<br />
La présentation proposée concerne spécifiquement le lot 3<br />
incluant le tunnel <strong>de</strong> Pinchat et la gare <strong>de</strong> Carouge Bachet. <strong>Le</strong>s<br />
contraintes principales sont d’ordre géologique, environnemental<br />
et <strong>de</strong> cohabitation, vu la présence d’une autoroute elle-même<br />
déjà en passage inférieur et du réseau routier et tramway <strong>de</strong><br />
surface.<br />
<strong>Le</strong> tunnel <strong>de</strong> Pinchat aura une longueur <strong>de</strong> 2 km et comportera<br />
un tube unique à 2 voies.<br />
Il sera réalisé par excavation mécanisée traditionnelle.<br />
La gare <strong>de</strong> Carouge Bachet <strong>de</strong>sservira d’un côté le quartier environnant<br />
et les transports publics, et <strong>de</strong> l’autre côté un sta<strong>de</strong>.<br />
Elle aura une longueur <strong>de</strong> 150 m et une largeur hors-tout <strong>de</strong><br />
presque 15 m, et sera réalisée en parois moulées reliées par un<br />
radier et une dalle <strong>de</strong> couverture.<br />
D’autres tronçons <strong>de</strong> la liaison seront réalisés également en<br />
tranchée couverte, sans spécificités propres.<br />
<strong>Le</strong>s travaux <strong>de</strong>vraient commencer en 2009 et durer 5 ans.<br />
14 - PRÉSENTATION 11<br />
La proposition <strong>de</strong> communication présentée par Monsieur<br />
Lamarche concerne les aménagements <strong>souterrain</strong>s pour améliorer<br />
les « entrées <strong>de</strong>s villes ».<br />
Sa thèse est que les entrées <strong>de</strong>s villes sont <strong>de</strong> plus en plus <strong>de</strong>s<br />
cicatrices dans le paysage urbain, bordées <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s surfaces<br />
qui se développent en périphérie par manque <strong>de</strong> place dans le<br />
centre, et qui pourraient être transférées vers le <strong>souterrain</strong>.<br />
L’auteur part d’une étu<strong>de</strong> d’un cabinet immobilier <strong>international</strong>,<br />
qui indique que les parcs d’activités commerciales sont les plus<br />
développés en France et en Belgique, avec en moyenne 220 m2 par habitant. Un rapi<strong>de</strong> calcul montre que, dans mon pays, cela<br />
équivaudrait à 2.200 km2 , ou 6 % <strong>de</strong> la superficie totale <strong>de</strong> la<br />
Belgique. En Italie et en Espagne, la surface occupée ne serait<br />
que <strong>de</strong> 40 m2 par habitant, soit 1/5 ème <strong>de</strong> ce qui se passe en<br />
France ou en Belgique.<br />
La structure urbaine proposée comprendrait une mise en <strong>souterrain</strong><br />
<strong>de</strong> toutes les activités commerciales <strong>de</strong> type « gran<strong>de</strong> surface », y<br />
compris leurs accès routiers, mais aussi les transports en commun,<br />
tout en maintenant ces <strong>espace</strong>s ouverts, et en relation avec <strong>de</strong>s<br />
parcs et autres zones vertes.<br />
15 - PRÉSENTATION 12<br />
VIE DE L’<strong>AFTES</strong><br />
<strong>Congrès</strong> <strong>de</strong> <strong>Monaco</strong><br />
La proposition <strong>de</strong> communication présentée par Monsieur <strong>Le</strong> Nir<br />
met l’accent sur la nécessité <strong>de</strong> connaître le sous-sol avant<br />
d’entamer tout projet d’urbanisme, a fortiori s’il comprend <strong>de</strong>s<br />
éléments en <strong>souterrain</strong>.<br />
TUNNELS ET OUVRAGES SOUTERRAINS - N° 210 - NOVEMBRE/DECEMBRE 2008 439
440<br />
VIE DE L’<strong>AFTES</strong><br />
<strong>Congrès</strong> <strong>de</strong> <strong>Monaco</strong><br />
Une liste exhaustive <strong>de</strong>s domaines à envisager est présentée, et<br />
comprend :<br />
- la géologie<br />
- les sols sensibles<br />
- les risques naturels<br />
- l’eau <strong>souterrain</strong>e<br />
- les cavités<br />
- les sols pollués<br />
- la chaleur<br />
- l’exploitation géothermique<br />
INTRODUCTION<br />
Pour le thème B, 17 communications ont été retenues :<br />
9 ont été retenues pour une présentation écrite et orale,<br />
8 ont été retenues pour une présentation écrite.<br />
Si nous classons ces 17 communications par la nature du sujet<br />
traité, nous aboutissons aux catégories suivantes.<br />
1 - MÉTHODOLOGIE<br />
Trois communications traitent <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s risques d’un point<br />
<strong>de</strong> vue méthodologique. Il s’agit <strong>de</strong> :<br />
• Une incertitu<strong>de</strong> sur les risques et une approche <strong>de</strong> l’arbre <strong>de</strong> réussite<br />
dans les travaux <strong>souterrain</strong>s par A. Balan et D. André, consultants<br />
ex-SNCF,<br />
• Projets <strong>de</strong> tunnels : anticipation et réduction <strong>de</strong>s dérives <strong>de</strong> coûts<br />
par management <strong>de</strong>s risques par F. Rival et G. Hamai<strong>de</strong> (CETU),<br />
• <strong>Le</strong> management <strong>de</strong>s risques techniques pour la construction<br />
d’un tunnel en site urbain : la théorie et la pratique par J. Robert<br />
(Arcadis).<br />
<strong>Le</strong>s 3 communications sont retenues pour une présentation orale<br />
<strong>de</strong> la métho<strong>de</strong> formalisée que chacune propose pour faire les étu<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> projets et en évaluer le coût ; elles en tirent les conséquences sur<br />
la rédaction <strong>de</strong>s contrats et le partage <strong>de</strong>s risques entre Maître<br />
d’Ouvrage, Entreprises et Maître d’œuvre.<br />
<strong>Le</strong> principe général est le suivant :<br />
• on détermine la liste <strong>de</strong>s risques (évènements indésirables possibles<br />
mais pas certains) qui peuvent survenir pendant la construction<br />
et on évalue leur probabilité d’occurrence ;<br />
• on détermine les conséquences <strong>de</strong> ces évènements en termes <strong>de</strong><br />
coût et <strong>de</strong> délai, ce qui permet d’évaluer leur gravité ;<br />
• la combinaison <strong>de</strong> la probabilité et <strong>de</strong> la gravité par rapport aux<br />
objectifs recherchés, permet d’aboutir à <strong>de</strong>s dispositions pour<br />
réduire (« optimiser ») les risques, pour bâtir le budget du Maître<br />
d’Ouvrage et pour définir un partage contractuel <strong>de</strong>s risques entres<br />
les acteurs,<br />
• le cas <strong>de</strong>s évènements absolument imprévisibles est traité à part.<br />
TUNNELS ET OUVRAGES SOUTERRAINS - N° 210 - NOVEMBRE/DECEMBRE 2008<br />
La présentation se termine par l’exemple <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Paris, où un<br />
modèle géologique en 3 dimensions a été réalisé.<br />
16 - PRÉSENTATION 13<br />
Finalement, la proposition <strong>de</strong> communication présentée par<br />
Monsieur Colomb fait le point <strong>de</strong> la section française <strong>de</strong> la nouvelle<br />
liaison ferroviaire Lyon – Turin.<br />
THÈME B - Maîtrise <strong>de</strong>s risques et <strong>de</strong>s coûts<br />
Par Michel Lévy (SETEC-TPI)<br />
2 - APPLICATION DE CES MÉTHODES<br />
POUR OPTIMISER UN PROJET AVANT<br />
DE LE RÉALISER<br />
Trois communications montrent comment on peut appliquer ces<br />
métho<strong>de</strong>s pour optimiser un projet avant <strong>de</strong> commencer sa réalisation.<br />
Il s’agit <strong>de</strong> :<br />
• Optimisation <strong>de</strong>s choix fondamentaux pour l’excavation <strong>de</strong>s tunnels.<br />
Exemple du tunnel <strong>de</strong> base du Brenner par P. Cucino, S. Fuoco et<br />
A. Laner (SWS Engineering) : cette communication explique<br />
comment on a pris en compte, dans le projet du tunnel du Brenner,<br />
les risques, à l’excavation, présentés par les différents sols traversés<br />
et l’évaluation <strong>de</strong> leurs conséquences. <strong>Le</strong>s longueurs <strong>de</strong> chaque<br />
nature <strong>de</strong> sol traversé étant hypothétiques, une optimisation portant<br />
sur le couple coût-délai a été réalisée, à l’ai<strong>de</strong> du logiciel « mo<strong>de</strong><br />
FRONTIER », sur une maquette <strong>de</strong> la géologie en 3D.<br />
• Tunnel <strong>de</strong> Koralm : l’estimation <strong>de</strong>s risques ai<strong>de</strong> à choisir le tracé,<br />
à estimer le coût et à définir les travaux <strong>de</strong> reconnaissance géologique<br />
par C. Harer (OBB) qui a fait le même genre d’exercice pour<br />
le tunnel <strong>de</strong> Koralm en Autriche (présentation orale prévue) où la<br />
maquette géologique est améliorée à chaque nouvelle information<br />
dans un GIS (Geological Information System).<br />
• Métro <strong>de</strong> Marseille : prolongement ligne 1 entre la Timone et<br />
la Fourragère. Comparaison et critères <strong>de</strong> choix entre tunnelier<br />
et métho<strong>de</strong> traditionnelle (article 1) par JP. Kuntzer (CUMPM),<br />
B. Lions (SMM) et B. Ricome (Arcadis).<br />
Cette communication décrit les réflexions <strong>de</strong>s auteurs sur les<br />
risques présentés par une métho<strong>de</strong> traditionnelle d’excavation et<br />
par un tunnelier (TBM) ouvert ou à pression, qui serait utilisé, pour<br />
la première fois, à Marseille. Ils ont conclu à l’utilisation d’un tunnelier<br />
à pression <strong>de</strong> terre dont ils racontent le comportement,<br />
conforme aux espérances, dans l’article 2 (qui ne fera pas l’objet<br />
d’une présentation orale contrairement à l’article 1).<br />
3 - ETUDE DE RISQUES PARTICULIERS<br />
AVANT RÉALISATION DES TUNNELS<br />
Quatre communications étudient <strong>de</strong>s risques particuliers pour en<br />
évaluer les conséquences et les moyens <strong>de</strong> les minimiser.
3.1 - Risque <strong>de</strong> coincement d’un tunnelier<br />
• La communication <strong>de</strong> M. Ramoni et G. Anagnostou <strong>de</strong> l’ETH <strong>de</strong><br />
Zurich porte sur les risques <strong>de</strong> coincement <strong>de</strong>s tunneliers sans<br />
bouclier ou avec bouclier simple ou double dans les roches poussantes<br />
(squeezing ground). Elle comporte <strong>de</strong>s exemples et <strong>de</strong>s recommandations<br />
concrètes sur la surcoupe, la poussée et le couple d’un<br />
tunnelier à prévoir dans diverses configurations. Cette communication<br />
est très documentée et s’appuie sur <strong>de</strong>s considérations théoriques<br />
et <strong>de</strong>s constatations faites dans <strong>de</strong> nombreuses réalisations. Une<br />
<strong>de</strong>s recommandations, celle <strong>de</strong> ne pas arrêter un tunnelier lorsque<br />
l’on traverse une zone à forte convergence, n’est pas facile à mettre<br />
en œuvre, car lorsque l’on doit arrêter un tunnelier, on ne le fait pas<br />
exprès, en général. Cependant, il est recommandé d’éviter les<br />
arrêts pour cause <strong>de</strong> vacances ou <strong>de</strong> week-end et <strong>de</strong> limiter les<br />
arrêts pour maintenance et <strong>de</strong> les étaler, dans le temps, <strong>de</strong> façon à<br />
s’arrêter le moins longtemps possible à un endroit donné.<br />
• Excavation, par tunnelier, <strong>de</strong> tunnels profonds : la communication<br />
<strong>de</strong> M. Innaurato et P. Aresto porte, d’une façon plus générale, sur<br />
les problèmes que pose l’emploi du tunnelier (TBM) dans <strong>de</strong>s<br />
tunnels à couverture <strong>de</strong> plus en plus importante (plus <strong>de</strong> 1 000 m)<br />
tels que ceux auxquels on est conduit, pour les tunnels <strong>de</strong> base très<br />
longs envisagés ou réalisés actuellement.<br />
Cette communication fait moins appel à la mécanique <strong>de</strong>s roches<br />
que la précé<strong>de</strong>nte, mais elle propose <strong>de</strong>s formules empiriques<br />
étalonnées sur un grand nombre <strong>de</strong> cas ou tirées <strong>de</strong>s publications<br />
<strong>de</strong> Barton ; ces formules donnent : la vitesse <strong>de</strong> pénétration, le<br />
coefficient d’utilisation, etc.<br />
3.2 - Risques pour la sécurité du personnel<br />
• Etu<strong>de</strong> <strong>de</strong> dangers (incendie) en travaux <strong>souterrain</strong>s :<br />
La communication <strong>de</strong> JM. Vergnault (Setec TPI) et J. Trognon<br />
(Bouygues) donne une métho<strong>de</strong> pour étudier (et minimiser) les<br />
risques d’incendie, dans un chantier <strong>de</strong> tunnel, et sur les moyens <strong>de</strong><br />
sauver, en les évacuant ou en les mettant à l’abri, les personnes<br />
présentes sur le chantier. De nombreux exemples (puits et galeries<br />
du laboratoire d’essai <strong>de</strong> Bure, abaissement du radier du tunnel<br />
ferroviaire du Mont Cenis, improprement appelé tunnel ferroviaire<br />
du Fréjus par le Maître d’Ouvrage, etc.) illustrent l’application à <strong>de</strong>s<br />
chantiers actuellement terminés ou en cours. M. Vergnault étant un<br />
colonel <strong>de</strong>s pompiers en retraite et M. Trognon étant membre<br />
d’une gran<strong>de</strong> entreprise, leurs étu<strong>de</strong>s en commun ont permis<br />
d’obtenir l’adhésion, à leurs conclusions, <strong>de</strong> l’entreprise, <strong>de</strong>s autorités<br />
en matière <strong>de</strong> sécurité (Inspection du Travail, CRAM, etc.) et <strong>de</strong>s<br />
services <strong>de</strong> secours (SDIS, pompiers) : ces étu<strong>de</strong>s ont d’ailleurs fait<br />
l’objet d’une étroite concertation avec tous ces services.<br />
• La ventilation lors <strong>de</strong>s travaux <strong>souterrain</strong>s : cas du tunnelier par<br />
P. Sergi, F. Vial et A. Good <strong>de</strong> la CRAM Rhône-Alpes (CRAM : caisse<br />
régionale d’assurance maladie). Cette communication porte sur la<br />
ventilation <strong>de</strong>s chantiers réalisés au tunnelier. Grâce à une coopération<br />
initiée, dès le départ, entre la CRAM, l’Entreprise et le constructeur<br />
du tunnelier, le système <strong>de</strong> ventilation du tunnelier du Mont Sion<br />
(sur l’autoroute A41) a pu être conçu <strong>de</strong> façon plus sophistiquée et<br />
plus efficace que d’habitu<strong>de</strong>, pour limiter les poussières dans les<br />
zones <strong>de</strong> travail.<br />
L’article recomman<strong>de</strong> <strong>de</strong> recommencer cette expérience qui a<br />
conduit à une amélioration <strong>de</strong>s résultats.<br />
VIE DE L’<strong>AFTES</strong><br />
<strong>Congrès</strong> <strong>de</strong> <strong>Monaco</strong><br />
Je pense qu’il y a lieu <strong>de</strong> féliciter tous les acteurs <strong>de</strong> cette collaboration<br />
(entreprise, constructeur du tunnelier, CRAM) et, plus particulièrement,<br />
les auteurs <strong>de</strong> la communication qui ont fait preuve d’un<br />
état d’esprit constructif et ne se sont pas contentés (comme cela est<br />
parfois arrivé dans le passé) <strong>de</strong> commencer à étudier le projet une<br />
fois que tout est figé.<br />
4 - RISQUES PRÉVUS OU RENCONTRÉS<br />
DANS DES TUNNELS RÉALISÉS OU<br />
EN COURS DE RÉALISATION<br />
<strong>Le</strong>s 7 autres communications concernent <strong>de</strong>s ouvrages réalisés ou<br />
en cours <strong>de</strong> réalisation, dans <strong>de</strong>s conditions difficiles, pour montrer<br />
quels ont été les risques prévus ou rencontrés et quels moyens ont<br />
été pris pour surmonter les difficultés et en limiter les conséquences.<br />
4.1 - Limites d’emploi du tunnelier<br />
en terrain difficile au métro <strong>de</strong> Marseille<br />
La communication sur le prolongement <strong>de</strong> la ligne 1 du métro <strong>de</strong><br />
Marseille (article 2) par JM. Kuntzer (CUMPM), B. Lions (SMM),<br />
S. Ghozayel (SMM) et B. Ricome (Arcadis), décrit le contexte<br />
géotechnique et l’environnement du projet. Elle rappelle les<br />
réflexions (décrites dans l’article 1) qui ont abouti au choix d’un<br />
tunnelier à pression <strong>de</strong> terre (EPB-TBM) <strong>de</strong> 9,8 m <strong>de</strong> diamètre<br />
extérieur, avec possibilité d’injection radiale <strong>de</strong> bentonite, et <strong>de</strong><br />
forages obliques autour du tunnelier. Il indique les inci<strong>de</strong>nts<br />
particuliers qui se sont produits :<br />
- casse <strong>de</strong>s attaches <strong>de</strong>s 3 molettes centrales,<br />
- franchissement d’un thalweg limoneux <strong>de</strong>scendant plus bas que<br />
prévu,<br />
- venues d’eau localement importantes (20 m3 /h),<br />
- puits anciens non répertoriés conduisant à une résurgence <strong>de</strong><br />
mousse en surface.<br />
Au total, les 2 350 m <strong>de</strong> ligne, incluant 4 stations, ont été excavés<br />
en 13 mois, <strong>de</strong> façon satisfaisante.<br />
4.2 - La maîtrise du coût du creusement<br />
du tunnel du Bois du Peu<br />
La maîtrise du coût du creusement du tunnel du Bois du Peu par<br />
O. Vannière (DDE du Doubs) et G. Hamai<strong>de</strong> (CETU) vient en<br />
complément <strong>de</strong> la communication <strong>de</strong> MM. Rival et Hamai<strong>de</strong> sur<br />
l’anticipation et la réduction <strong>de</strong>s dérives <strong>de</strong> coûts par le management<br />
<strong>de</strong>s risques.<br />
La communication décrit le projet, le contexte géologique,<br />
les reconnaissances effectuées en plusieurs phases, pendant une<br />
quinzaine d’années et incluant, notamment, une galerie <strong>de</strong> reconnaissance<br />
sur toute la longueur. <strong>Le</strong>s contraintes du CCTP sont bien<br />
décrites et le marché permet <strong>de</strong> les adapter en cours <strong>de</strong> travaux.<br />
L’organisation du maître d’œuvre et l’esprit <strong>de</strong> collaboration avec<br />
l’entreprise ont permis <strong>de</strong> résoudre les difficultés techniques<br />
rencontrées (Karsts notamment).<br />
L’outil OSCART du CETU a été utilisé pour suivre le chantier, les<br />
auscultations et le récolement <strong>de</strong>s travaux.<br />
<strong>Le</strong> résultat, remarquable, est le respect du délai et celui du coût du<br />
marché initial, à 1 % près.<br />
Tous les éléments mis en place pour la conduite <strong>de</strong>s travaux y ont<br />
TUNNELS ET OUVRAGES SOUTERRAINS - N° 210 - NOVEMBRE/DECEMBRE 2008 441
442<br />
VIE DE L’<strong>AFTES</strong><br />
<strong>Congrès</strong> <strong>de</strong> <strong>Monaco</strong><br />
sûrement contribué mais la galerie <strong>de</strong> reconnaissance sur toute la<br />
longueur du tunnel et les étu<strong>de</strong>s et reconnaissances géotechniques<br />
réalisées pendant 15 ans, pour un bi-tube <strong>de</strong> 521 m <strong>de</strong> longueur,<br />
ne doivent pas être complètement étrangères à ce succès.<br />
4.3 - Construction d’un tunnel au tunnelier<br />
dans <strong>de</strong>s conditions très difficiles<br />
La communication concerne la construction d’un tunnel au tunnelier,<br />
dans <strong>de</strong>s conditions très difficiles (tunnel ferroviaire <strong>de</strong> Hallandsas<br />
en Suè<strong>de</strong>) par F. Dudouit et R. Sturk (Skanska – Vinci HB).<br />
<strong>Le</strong> bitube <strong>de</strong> 8,6 km creusé par un tunnelier <strong>de</strong> 10,6 m <strong>de</strong> diamètre<br />
doit être excavé dans <strong>de</strong>s conditions extraordinairement difficiles :<br />
- rocher généralement très dur mais très fracturé en blocs, avec<br />
quelques passages argileux,<br />
- eau en forte pression,<br />
- limitation <strong>de</strong>s quantités d’eau drainée autorisées, pendant la<br />
construction comme en service, pour ne pas déprimer une nappe<br />
d’eau très utilisée.<br />
La présentation orale présentera le tunnelier prévu, les difficultés rencontrées<br />
et les moyens utilisés jusqu’à ce jour pour résoudre les difficultés.<br />
4.4 - <strong>Le</strong> « tunnel <strong>de</strong> base » <strong>de</strong> l’autoroute A1<br />
Milan-Naples<br />
La communication concerne le tunnel <strong>de</strong> « base » <strong>de</strong> l’autoroute A1<br />
Milan-Naples pour traverser les Apennins par P. Lunardi, G. Cassani<br />
et M. Gatti (Rocksoil SpA).<br />
Elle décrit les étu<strong>de</strong>s et la réalisation récente d’un bi-tube <strong>de</strong><br />
8,55 km dans un terrain difficile avec une couverture atteignant<br />
400 m. Deux galeries <strong>de</strong> reconnaissance, l’une <strong>de</strong> 4 km au Nord et<br />
l’autre <strong>de</strong> 0,95 km au Sud, ont été réalisées avec un tunnelier <strong>de</strong><br />
3,4 m (ou 4 m ?) <strong>de</strong> diamètre.<br />
<strong>Le</strong> tunnel a été réalisé en métho<strong>de</strong> traditionnelle, en section entière et a<br />
dû utiliser <strong>de</strong>s boulons <strong>de</strong> fibres <strong>de</strong> verre pour stabiliser le front et réaliser<br />
<strong>de</strong>s voûtes parapluie (métho<strong>de</strong> A.DE.CO-RS, chère au Pr Lunardi).<br />
La présentation orale donnera plus <strong>de</strong> détails sur le projet, les<br />
difficultés rencontrées et les métho<strong>de</strong>s utilisées.<br />
4.5 - Deuxième tube <strong>de</strong> la traversée <strong>souterrain</strong>e<br />
<strong>de</strong> Toulon<br />
La communication concerne le <strong>de</strong>uxième tube <strong>de</strong> la traversée<br />
<strong>souterrain</strong>e <strong>de</strong> Toulon par G. Gilbert (maître d’ouvrage) et <strong>de</strong>s<br />
représentants du CETE (AMO), <strong>de</strong> Setec Tpi-Terrasol (maître<br />
d’œuvre) et <strong>de</strong> Bouygues/Solétanche-Bachy (entreprise).<br />
La communication décrit le projet, le contexte géologique (très<br />
complexe), le bâti <strong>de</strong> surface (très <strong>de</strong>nse et pas toujours en bon<br />
état) et les étu<strong>de</strong>s réalisées : nombreux sondages et un essai sur 35 m<br />
<strong>de</strong> profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> jet grouting et d’injection avec un puits <strong>de</strong> 3 m<br />
<strong>de</strong> diamètre pour examiner les colonnes <strong>de</strong> jet sur toute leur hauteur.<br />
La conception du tunnel et <strong>de</strong> ses tranchées couvertes d’extrémité<br />
est très influencée par la conception du tube Nord et par les difficultés<br />
rencontrées pour le réaliser (11 ans <strong>de</strong> travaux pour 3 km,<br />
dont 2 ans d’arrêt <strong>de</strong> chantier suite à effondrement).<br />
La présentation orale montrera, avec plus <strong>de</strong> détails, le pilotage du<br />
soutènement provisoire (le tunnel est excavé en section entière par<br />
<strong>de</strong>s moyens mécaniques traditionnels), à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong><br />
tassements <strong>de</strong> surface et <strong>de</strong>s déformations en tunnel. <strong>Le</strong> système<br />
automatique <strong>de</strong> mesure implanté par Sol Data est très sophistiqué<br />
TUNNELS ET OUVRAGES SOUTERRAINS - N° 210 - NOVEMBRE/DECEMBRE 2008<br />
et efficace. <strong>Le</strong> marché incite l’entreprise à réduire les soutènements<br />
lorsque les tassements sont faibles et que les déformations intérieures<br />
du tunnel le permettent.<br />
4.6 - Tunnel DUPLEX A 86 à l’Ouest <strong>de</strong> Paris<br />
La communication concerne le tunnel DUPLEX A 86 à l’Ouest <strong>de</strong><br />
Paris par JL. Toris et P. Bony (Socatop).<br />
Elle présente le projet <strong>de</strong> ce tunnel à 2 étages pour VL, creusé avec<br />
un tunnelier <strong>de</strong> 11,56 m <strong>de</strong> diamètre. La communication porte sur<br />
la 1ère partie, longue <strong>de</strong> 4,5 km <strong>de</strong> ce tunnel <strong>de</strong> 10,07 km.<br />
<strong>Le</strong>s terrains difficiles et variables ainsi que la situation <strong>de</strong> la surface<br />
(notamment une voie ferrée parcourue par <strong>de</strong>s TGV) ont conduit l’entreprise<br />
à choisir un tunnelier transformable capable <strong>de</strong> travailler en<br />
mo<strong>de</strong> pression <strong>de</strong> terre ou en pression <strong>de</strong> boue. <strong>Le</strong>s ouvrages<br />
annexes (puits, rameaux avec escaliers, etc.) souvent définis après la<br />
conception initiale du tunnel pour cause d’évolution <strong>de</strong> la réglementation,<br />
ont rencontré, eux aussi, <strong>de</strong>s conditions difficiles et ont dû faire<br />
appel, soit aux injections <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong> terrain, soit à la congélation.<br />
La communication orale donnera plus <strong>de</strong> détails sur ce projet innovant<br />
et sur sa réalisation. En donnera-t-elle sur les coûts et les<br />
délais ? Nous allons le savoir bientôt.<br />
4.7- Risques <strong>de</strong> venues d’eau au moment<br />
<strong>de</strong> pratiquer une ouverture dans le revêtement<br />
en voussoirs d’un tunnel, pour réaliser<br />
une galerie d’embranchement,<br />
par F. Melaneo, C. Jorge et J. Bilé Serra.<br />
La communication décrit les problèmes géologiques et surtout<br />
hydrogéologiques qui sont apparus lorsque l’on a démoli le revêtement<br />
d’un tunnel du métro <strong>de</strong> Lisbonne pour réaliser la jonction du tunnel<br />
avec un tunnel d’embranchement (on utilise parfois le mot <strong>de</strong><br />
culotte pour désigner cette zone d’intersection).<br />
Ces problèmes (présence <strong>de</strong> sables fins, venues d’eau abondantes,<br />
etc.) ont été d’autant plus surprenants qu’ils n’avaient pas été décelés<br />
au moment du passage du tunnelier qui a réalisé le tunnel initial.<br />
Après étu<strong>de</strong> plus approfondie, il a fallu réaliser un rabattement <strong>de</strong><br />
nappe.<br />
5 - CONCLUSION<br />
<strong>Le</strong> thème B « Maîtrise <strong>de</strong>s risques et <strong>de</strong>s coûts » a attiré <strong>de</strong><br />
nombreuses communications très intéressantes qui n’ont pas pu<br />
être toutes retenues.<br />
Il apparaît que :<br />
• la technique en progrès permet <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s tunnels dans <strong>de</strong>s<br />
conditions <strong>de</strong> plus en plus difficiles, pour <strong>de</strong>s coûts et <strong>de</strong>s délais qui<br />
se réduisent,<br />
• les risques et le coût <strong>de</strong> leurs conséquences restent difficiles à<br />
maîtriser ; il faut réunir <strong>de</strong> nombreuses conditions pour y parvenir :<br />
étu<strong>de</strong>s longues et détaillées, reconnaissances géotechniques<br />
nombreuses incluant <strong>de</strong>s galeries <strong>de</strong> reconnaissance chaque fois<br />
que possible,<br />
• les métho<strong>de</strong>s pour établir le budget et le délai les plus probables,<br />
malgré les incertitu<strong>de</strong>s qui pèsent sur le projet, progressent et sont<br />
<strong>de</strong> mieux en mieux formalisées.<br />
Des progrès ont été faits, mais il en reste à faire.
INTRODUCTION<br />
A total of 13 papers have been inclu<strong>de</strong>d in this sub-session I. They<br />
can be classified into 5 topics, as shown in table 1.<br />
Swelling or squeezing<br />
behaviour of the ground<br />
and its impact on the tunnel<br />
support.<br />
Settlements induced<br />
by tunnelling.<br />
Mo<strong>de</strong>lisation of tunnel<br />
construction<br />
New materials & processes<br />
TBM performance<br />
In this General Report I will present a brief summary of each paper,<br />
highlighting the innovative aspects of the work. I will end each topic<br />
with my personal view of future <strong>de</strong>velopments within that particular<br />
field. Finally, I will make some closing remarks on the general<br />
subject of this session.<br />
1 - TOPIC 1: SWELLING AND SQUEEZING<br />
BEHAVIOUR OF THE GROUND AND ITS<br />
IMPACT ON THE TUNNEL SUPPORT.<br />
Table 2. shows the 3 papers addressing this Topic<br />
THÈME C - Innovations techniques en tunnel<br />
Topics Communications presented<br />
3<br />
2<br />
2<br />
4<br />
The first paper by Silvestre, analyses the non-stabilized wall<br />
<strong>de</strong>formations of the wall of the tunnel of Tartaiguille bored in<br />
marly-clayey ground. The author conclu<strong>de</strong>s that viscosity effects are<br />
remarkable in such ground, with an important strength reduction<br />
Par Davor Simic (Ferrovial, Espagne)<br />
Silvestre A.<br />
Kovari K. et al.<br />
Samana L. et al.<br />
Merlanti P. et al.<br />
Hejazi Y. et al<br />
Billaux D. et al.<br />
Ilker Ü. et al.<br />
De Rivaz B.<br />
Montagneux P. et al.<br />
Giuliani-<strong>Le</strong>onardi S.<br />
Castrogiovanni G.<br />
Boissonnas Y.<br />
Mendaña F<br />
Authors Paper Title<br />
Silvestre A.<br />
Kovari K.<br />
Chiaverio F.<br />
Samana L.<br />
Hingant P.<br />
Valle C.<br />
Zancan W.<br />
2<br />
Effets du comportement différé sur le<br />
creusement <strong>de</strong>s tunnels.<br />
Système déformable modulaire pour les tunnels<br />
en terrain fortement gonflant<br />
Tunnel <strong>de</strong> Mezzolombardo: le comportement<br />
différé <strong>de</strong>s argilites induit <strong>de</strong>s convergences<br />
<strong>de</strong> gran<strong>de</strong> amplitu<strong>de</strong>.<br />
VIE DE L’<strong>AFTES</strong><br />
<strong>Congrès</strong> <strong>de</strong> <strong>Monaco</strong><br />
with strain rate as shown in figure 1. A viscoplastic numerical mo<strong>de</strong>l<br />
has been elaborated incorporating the rock <strong>de</strong>gradation. An<br />
interesting conclusion of this paper is that simple elastoplastic<br />
mo<strong>de</strong>ls un<strong>de</strong>restimate forces on the lining.<br />
Figure 1: Strength reduction with strain rate for a marl rock (Silvestre, A.).<br />
The paper by Kovari, K. Chiaverio, F. stresses the most frequent<br />
un<strong>de</strong>sirable effects noticed in tunnels in swelling rock, i.e. bottom<br />
heave and uplift pressures against the slab. To cope with such<br />
behaviour, the authors propose an innovative Modular Yielding<br />
Support shown in figure 2. This system requires an un<strong>de</strong>rground<br />
space for control and replacement when the compressible<br />
elements reach their limit.<br />
Figure 2: Flexible solutions in swelling ground (Kovari, K. and Chiaverio, F.).<br />
The paper by Samana L., Hingand P., Valle C. and Zancan W.<br />
analyses the viscoplastic behaviour of the claystone during the<br />
excavation of the Tunnel of Mezzolombardo where, in contrast with<br />
the previous paper, an active or rigid approach was used to contain<br />
the <strong>de</strong>formations by means of a reinforced concrete lining, as<br />
shown in figure 3.<br />
TUNNELS ET OUVRAGES SOUTERRAINS - N° 210 - NOVEMBRE/DECEMBRE 2008 443
444<br />
VIE DE L’<strong>AFTES</strong><br />
<strong>Congrès</strong> <strong>de</strong> <strong>Monaco</strong><br />
As a conclusion of this Topic, more research is nee<strong>de</strong>d to unify the<br />
different constitutive mo<strong>de</strong>ls that have been proposed in the bibliography<br />
to account for the expansion phenomena. Besi<strong>de</strong>s, more<br />
on-site experiences are <strong>de</strong>sirable to contrast active (rigid) support<br />
systems with passive (flexible) ones.<br />
2 - TOPIC 2: SETTLEMENT INDUCED BY<br />
TUNNELLING.<br />
Table 3 shows the 2 papers addressing this topic.<br />
Authors Paper Title<br />
Merlanti P.<br />
Bellochio A.<br />
Sicilia R.<br />
Hejazi Y.<br />
Dias D.<br />
Kastner R.<br />
Figure 3: Samana L.;<br />
Hingand P.; Valle C.;<br />
Zancan W.:<br />
Tunnel <strong>de</strong> Mezzolombardo:<br />
<strong>Le</strong> comportement differé<br />
<strong>de</strong>s argilites induit <strong>de</strong>s<br />
convergences <strong>de</strong> gran<strong>de</strong><br />
amplitu<strong>de</strong>.<br />
Analysis and predictions of subsi<strong>de</strong>nce<br />
phenomena induced by excavation employing<br />
an EPB-S in the works to construct the Brescia<br />
metro-Design predictions and back-analysis.<br />
Influence <strong>de</strong> la rigidité <strong>de</strong>s sols lors <strong>de</strong> la<br />
modélisation <strong>de</strong>s ouvrages <strong>souterrain</strong>s.<br />
The first paper by Merlanti P., Bellochio A. and Sicilia R. <strong>de</strong>als with a<br />
case history of a 9,15 m diameter EPB machine excavating a<br />
gravely soil un<strong>de</strong>r the foundation of a singular building. The predicted<br />
settlement was consi<strong>de</strong>red unacceptable so it was <strong>de</strong>ci<strong>de</strong>d to<br />
consolidate the soil by means of a preformed arch of grouted soil of<br />
cement and silicate grout. Figure 4 shows the geometry of the<br />
treated area, which successfully reduced the settlements to a tenth<br />
of the expected value.<br />
Figure 4: Merlanti P.; Bellochio A.; Sicilia R.: Analysis and predictions of<br />
subsi<strong>de</strong>nce phenomena induced by excavation employing an EPB-S in the works<br />
to construct the Brescia metro-Design predictions and back-analysis.<br />
TUNNELS ET OUVRAGES SOUTERRAINS - N° 210 - NOVEMBRE/DECEMBRE 2008<br />
The paper by Hejazi Y., Dias D. and Kastner R. studies 4 different<br />
constitutive mo<strong>de</strong>ls to simulate the behaviour of stiff over consolidated<br />
clays in tunnel construction. The mo<strong>de</strong>ls account for shear<br />
modulus <strong>de</strong>gradation with the stress level and the resulting settlement<br />
troughs are higly sensitive to mo<strong>de</strong>l input parameters. Figure<br />
5 shows the scatter of settlement troughs obtained by the authors<br />
which conclu<strong>de</strong> that still there is significant discrepancy between<br />
numerical mo<strong>de</strong>ls and empirical data.<br />
Figura 5: Hejazi Y.; Dias D.; Kastner R.:<br />
Impact of soil stiffness on the mo<strong>de</strong>lling of un<strong>de</strong>rground constructions.<br />
As a conclusion of this topic, more research is nee<strong>de</strong>d in the<br />
constitutive equations of the numerical mo<strong>de</strong>ls to approximate real<br />
settlement troughs.<br />
However, it is <strong>de</strong>bated the usefulness of that effort if it is not<br />
accompanied by an equal work for measuring in the reality of the<br />
soil parameters for ever more sophisticated mo<strong>de</strong>ls.<br />
3 - TOPIC 3: MODELISATION OF TUNNEL<br />
CONSTRUCTION.<br />
Table 4 shows the 2 papers addressing this topic.<br />
Authors Paper Title<br />
Billaux D.<br />
Senis M.<br />
Ilker Ü.<br />
Erdogan E.<br />
Uzman A.<br />
Detailed analysis of the excavation and heating<br />
of nuclear waste storage drifts<br />
Deepest top-down LRT station in Istambul<br />
Çinçin Station, Otorgar-Bagcilar lightrail project.<br />
The first paper by Billaux D. and Senis M. studies the combined<br />
effect of excavation and thermal loads for two <strong>de</strong>ep un<strong>de</strong>rground<br />
nuclear repositories. A FLAC 3D mo<strong>de</strong>l has been run, as shown at<br />
figure 6, which <strong>de</strong>monstrates the time <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt loading of the<br />
lining due to the temperature increase.
Figure 6: Billaux D.; Senis M.:<br />
Detailed analysis of the excavation<br />
and heating of nuclear waste storage drifts.<br />
The paper by Ilker U., Erdogan E. and Uzman A. analyses the displacements<br />
of a diaphragm wall during excavation, by means of finite<br />
elements Plaxis and structural SAP 2000 mo<strong>de</strong>l. As shown in figure<br />
7, the authors conclu<strong>de</strong> that mo<strong>de</strong>ls tend to overestimate maximum<br />
displacements.<br />
As a conclussion of Topic 3, as more sophisticated mo<strong>de</strong>ls are<br />
commercially available for <strong>de</strong>signers, this does not mean an easier<br />
task for the engineer due to the doubts about the representativity<br />
of the results. To be sure, one should always check the results with<br />
simpler mo<strong>de</strong>ls.<br />
VIE DE L’<strong>AFTES</strong><br />
<strong>Congrès</strong> <strong>de</strong> <strong>Monaco</strong><br />
4 - TOPIC 4: NEW MATERIALS<br />
AND PROCESSES<br />
Table 5 shows the 4 papers addressing this topic.<br />
Authors Paper Title<br />
De Rivaz B.<br />
Montagneux P.<br />
Genre C.<br />
Pagan J.<br />
Revil-Signorat J.<br />
Giuliani-<br />
<strong>Le</strong>onardi S.<br />
Castrogiovanni G.<br />
Vanni D.<br />
Siepi M.<br />
Martella A.<br />
Steel fiber reinforced concrete (SFRC):<br />
<strong>de</strong>velopment of a behaviour test for<br />
application to precast segment for tunnel<br />
lining.<br />
Deepest top-down LRT station in Istambul<br />
Çinçin Station, Otorgar-Bagcilar lightrail<br />
project.<br />
Innovation technique en matière<br />
<strong>de</strong> confortement <strong>de</strong>s tunnels revêtus <strong>de</strong><br />
voussoirs prefabriqués au droit <strong>de</strong>s structures<br />
annexes.<br />
Rome-Great Ring Road-Cassia and Trionfale<br />
Tunnels-The biggest fullface tunnels<br />
excavation ever performed (260 sqm) with<br />
shallow cover, using ADECO-RS approach<br />
<strong>de</strong>sign and special patented jet-grouting.<br />
Figure 7: Ilker U. ; Erdogan E.;<br />
Uzman A.: Deepest top-down LRT<br />
station in Istambul Çinçin Station,<br />
Otorgar-Bagcilar lightrail project.<br />
TUNNELS ET OUVRAGES SOUTERRAINS - N° 210 - NOVEMBRE/DECEMBRE 2008 445
446<br />
VIE DE L’<strong>AFTES</strong><br />
<strong>Congrès</strong> <strong>de</strong> <strong>Monaco</strong><br />
The paper by De Rivaz B. makes a <strong>de</strong>tailed assessment of an<br />
original type of test of cylindrical samples of concrete subject to<br />
impacts along their axis excentrically. The author compares the<br />
behaviour of unreinforced, conventionally reinforced and steel-fibre<br />
reinforced concrete. Figure 8 shows the samples of unreinforced<br />
concrete after the test which behave with sud<strong>de</strong>n cracking and<br />
block separation irrespective of the position of the impact.<br />
In contrast, the samples with steel fibers show a more diffuse<br />
cracking that avoids collapse. The author conclu<strong>de</strong>s that this<br />
multicracking of the SFRC allows for much higher ductility than<br />
conventional reinforced concrete.<br />
Figure 8: De Rivaz B.: Steel fiber reinforced concrete (SFRC): <strong>de</strong>velopment<br />
of a behaviour test for application to precast segment for tunnel lining.<br />
The paper by Montagneux P., Genre C., Pagan J. and Revil-Signorat,<br />
J. <strong>de</strong>als with the manufacturing of explosives directly at the tunnel<br />
face as an alternative to the pre charge of dynamites or slurry<br />
cartridges, because of its obvious advantages minimizing handling<br />
and stocking constraints. As a conclusion the authors show 5 sites of<br />
successful application of this method.<br />
The paper by Giuliani-<strong>Le</strong>onardi S. reviews the different construction<br />
procedures for structures built out of main tunnels ma<strong>de</strong> of segmental<br />
lining rings. Focus is ma<strong>de</strong> to shear keys to transfer loads<br />
from opened rings to adjacent closed ones. Figure 9 shows the<br />
typical shear-key which was tested to cyclic loading. The author<br />
conclu<strong>de</strong>s that with such systems it is possible to optimize the<br />
creation of openings in lining rings.<br />
Figure 9: Giuliani-<strong>Le</strong>onardi S.: Innovative supporting systems<br />
of segmental lining tunnels during secondary structures construction<br />
(recesses, cross passages…).<br />
The paper by Castrogiovanni G., Vanni D., Siepi M. and Martella A.<br />
<strong>de</strong>scribes the reinforcing systems which were applied for the construction<br />
of big tunnels (260 sqm) excavated full face by means<br />
ADECO-RS approach. The authors specifically treat a patented<br />
variant of jet-grouting where the rotoinjection is carried out during<br />
TUNNELS ET OUVRAGES SOUTERRAINS - N° 210 - NOVEMBRE/DECEMBRE 2008<br />
the advancement of the tool (see figure 10). The columns can incorporate<br />
a steel pipe and, according to the authors, to be successful<br />
the system requires continuous fluid spoil avoiding clay chips that<br />
clogg the outflow.<br />
As a conclusion, the papers in this topic have shown how construction<br />
procedures in different fields (such as segmental lining, drill &<br />
blast, full face excavation) has triggered the search of new materials<br />
(such as SFRC, explosives, shear keys or jet-grouting techniques).<br />
Figure 10: Castrogiovanni G.; Vanni D.; Siepi M.; Martella A.:<br />
Rome-Great Ring Road-Cassia and Trionfale Tunnels-The biggest fullface<br />
tunnels excavation ever performed (260 sqm) with shallow cover,<br />
using ADECO-RS approach <strong>de</strong>sign and special patented jet-grouting.<br />
5 - TOPIC 5: TBM PERFORMANCE<br />
Table 6 shows the 2 papers inclu<strong>de</strong>d in this topic.<br />
The paper by Boissonnas Y. presents an interesting application of<br />
the flexible approach to <strong>de</strong>al with the high <strong>de</strong>formations induced<br />
by the excavation of <strong>de</strong>ep tunnels. The Gothard Base tunnel<br />
employs a mechanized TBM, allowing for controlled <strong>de</strong>formation to<br />
reduce the high rock pressures in squeezing rock conditions as<br />
show schematically in figure 11.<br />
Authors Paper Title<br />
Boissonnas Y.<br />
Mendaña F.<br />
Gothard Base Tunnel Experience of a TBM<br />
Excavation with large overbur<strong>de</strong>n.<br />
The excavation of two twin tunnels of Seville<br />
metro line through alluvium by an EPB shield<br />
un<strong>de</strong>r the Guadalquivir River<br />
The paper by Mendaña F. compares the performance of two<br />
different EPB’s in the gravely waterbearing soils of Seville (Spain).<br />
TBM number 1 has a conventional four radii cutterhead with rippers<br />
and variable size openings, whilst TBM number 2 has smaller<br />
openings and more rippers. According to the author, although<br />
TBM number 1 had more stoppages for tool replacement, both<br />
machines had similar productions per working day. The paper also<br />
conclu<strong>de</strong>s on the innovative use of EPB machines in soil types<br />
which were traditionally the field of application of hydroshields (see<br />
figure 12).
Figure 11. Boissonnas Y.: Gothard Base Tunnel Experience of a TBM Excavation<br />
with large overbur<strong>de</strong>n.<br />
Figure 12. Mendaña F.: The excavation of two twin tunnels of Seville metro line through alluvium by an EPB shield<br />
un<strong>de</strong>r the Guadalquivir River.<br />
As conclusion of Topic 5, there is a continued innovative application<br />
of full-face mechanized tunnelling either in flexible or rigid approaches<br />
that show the progress in the making.<br />
6 - CONCLUDING REMARKS<br />
Innovation must be an attitu<strong>de</strong>, the basic behaviour of everybody in<br />
the industry to survive. Value creation through innovation must permeate<br />
the whole construction organization: from the work conception,<br />
throughout the <strong>de</strong>sign & construction. Persons are basic in<br />
this process: open-min<strong>de</strong>d engineers that share i<strong>de</strong>as and <strong>de</strong>sires.<br />
These Conferences have provi<strong>de</strong>d the framework for such a fertile<br />
interchange.<br />
VIE DE L’<strong>AFTES</strong><br />
<strong>Congrès</strong> <strong>de</strong> <strong>Monaco</strong><br />
TUNNELS ET OUVRAGES SOUTERRAINS - N° 210 - NOVEMBRE/DECEMBRE 2008 447
448<br />
VIE DE L’<strong>AFTES</strong><br />
<strong>Congrès</strong> <strong>de</strong> <strong>Monaco</strong><br />
1 - INTRODUCTION<br />
<strong>Le</strong> thème C2 sur les innovations techniques en tunnel (2ème partie) a<br />
reçu 14 communications écrites. La nationalité <strong>de</strong> leurs auteurs est<br />
indiquée sur le tableau ci-<strong>de</strong>ssous.<br />
Répartition <strong>de</strong>s communications suivant la nationalité <strong>de</strong> leurs<br />
auteurs :<br />
Nationalité <strong>de</strong> l’auteur Nombre <strong>de</strong> communications<br />
France,<br />
Principauté <strong>de</strong> <strong>Monaco</strong> 7<br />
Italie 3<br />
USA 2<br />
Belgique 1<br />
Allemagne 1<br />
Etu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> tunnels<br />
THÈME C - Innovations techniques en tunnel<br />
TUNNELS ET OUVRAGES SOUTERRAINS - N° 210 - NOVEMBRE/DECEMBRE 2008<br />
Par Guy Colombet (Coyne & Bellier)<br />
Nombre <strong>de</strong> communications par type d’ouvrage - Tableau 2<br />
Elles confirment que les techniques <strong>de</strong> construction <strong>de</strong>s ouvrages<br />
<strong>souterrain</strong>s, tant mécanisées que conventionnelles, continuent <strong>de</strong><br />
se perfectionner dans tous les domaines.<br />
<strong>Le</strong> présent rapport rassemble les points principaux qui ressortent<br />
<strong>de</strong>s 14 communications du thème C2. Ils sont regroupés sous les<br />
différentes rubriques suivantes :<br />
• Innovations concernant les tunneliers<br />
• Innovations concernant les matériaux utilisés comme éléments <strong>de</strong><br />
soutènement,<br />
• Principaux enseignements que l’on peut tirer <strong>de</strong>s retours d’expérience<br />
<strong>de</strong>s cas concrets (étu<strong>de</strong>s et chantiers),<br />
• Remarques complémentaires sur les <strong>de</strong>ux communications qui<br />
abor<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s sujets plus généraux.<br />
Tunnels ferroviaires Tunnels routiers Galeries hydrauliques Ouvrages <strong>de</strong> stockage<br />
8 articles 2 articles 1 article 1 article<br />
Localisation : Localisation : Localisation : Localisation :<br />
France (1) Algérie Belgique<br />
USA (2)<br />
Dubaï (1) France<br />
Italie (1) <strong>Monaco</strong><br />
Chine (1)<br />
Espagne (2)<br />
Nombre <strong>de</strong> communications par secteur d’activité - Tableau 1<br />
Procédés mécanisés<br />
<strong>Le</strong>s 14 communications traitent d’étu<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> chantiers <strong>de</strong> tunnels<br />
répartis dans 8 pays différents comme le montre le tableau 1.<br />
Chantiers <strong>de</strong> tunnel<br />
3 articles 8 articles 3 articles<br />
Etu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> tunnels : Localisation <strong>de</strong>s chantiers : Localisation <strong>de</strong>s chantiers :<br />
En France (1) USA (2) France (2)<br />
entre l’Espagne et le Maroc (1) Algérie (1) Principauté <strong>de</strong> <strong>Monaco</strong> (1)<br />
En Italie (1) Belgique (1)<br />
Chine (1)<br />
Dubaï (1)<br />
Espagne (1)<br />
France (1)<br />
Métho<strong>de</strong>s conventionnelles
2 - PRINCIPALES INNOVATIONS<br />
PRESENTEES DANS LES COMMUNICATIONS<br />
2.1 - Innovations concernant les tunneliers<br />
Cinq communications présentent <strong>de</strong>s innovations très importantes<br />
qui ont été apportées récemment à <strong>de</strong>s tunneliers.<br />
Elles consistent notamment en :<br />
• Tunneliers <strong>de</strong> très gran<strong>de</strong> dimension<br />
• Tunneliers pouvant être montés et démontés rapi<strong>de</strong>ment<br />
• Maintenance <strong>de</strong>s tunneliers facilitée.<br />
Tunneliers récents <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> dimension<br />
La communication <strong>de</strong> M. HERRENCKNECHT et al (Herrenknecht<br />
AG) décrit la conception <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux plus gros tunneliers au mon<strong>de</strong> :<br />
• Un tunnelier à pression <strong>de</strong> terre (∅ 15,2 m) utilisé à Madrid pour la<br />
construction d’un tunnel routier <strong>de</strong> 3,6 km<br />
• Un tunnelier à pression <strong>de</strong> boue (∅ 15,4 m) utilisé à Shanghai pour<br />
la construction <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux tubes d’un tunnel routier <strong>de</strong> 7,2 km qui<br />
passe sous la rivière Yangtze.<br />
La communication indique également les principales innovations<br />
dans la conception <strong>de</strong> ces grands tunneliers.<br />
Tunnelier et bouclier montés dans une chambre<br />
<strong>de</strong> dimension réduite<br />
• La communication <strong>de</strong> M. OFIARA (The Robbins Company)<br />
présente un tunnelier pour roche dure utilisé pour le métro <strong>de</strong> New<br />
York.<br />
Sa conception lui permet d’être installé dans une chambre <strong>de</strong> montage<br />
<strong>de</strong> dimension réduite et d’être transporté dans <strong>de</strong>s tunnels<br />
déjà construits <strong>de</strong> petite dimension. Il peut également être ressorti<br />
par le tunnel qu’il vient <strong>de</strong> creuser.<br />
Quelques innovations : tête d’abattage démontable avec joints<br />
boulonnés, jupe rétractable, marinage avec un convoyeur extensible.<br />
• La communication <strong>de</strong> M. BASTIENS (EIG Euridice) et al décrit la<br />
réalisation <strong>de</strong> la galerie expérimentale Praclay à Mol (Belgique).<br />
Cette galerie a été excavée avec un bouclier <strong>de</strong> 2,5 m <strong>de</strong> diamètre,<br />
perpendiculairement à un tunnel existant <strong>de</strong> 4 m <strong>de</strong> diamètre<br />
intérieur, sans avoir besoin d’élargir ce tunnel au voisinage <strong>de</strong><br />
l’intersection.<br />
Tunneliers pour terrains <strong>de</strong> mauvaise qualité<br />
avec maintenance facilitée<br />
• L’article <strong>de</strong> M. LONGCHAMP et al (Bouygues TP) présente le système<br />
MOBYDIC qui enregistre les conditions <strong>de</strong> fonctionnement<br />
<strong>de</strong> chacun <strong>de</strong>s outils <strong>de</strong> coupe d’un tunnelier.<br />
Ce système innovant :<br />
- permet d’optimiser l’avancement d’un tunnelier en toute sécurité<br />
- facilite la maintenance <strong>de</strong>s outils<br />
- fournit une diagraphie du front du tunnel en temps réel.<br />
• La communication M. HERRENKNECHT (Herrenknecht AG)<br />
indique que le tunnelier <strong>de</strong> 15,4 m <strong>de</strong> diamètre qui a été utilisé<br />
pour le métro <strong>de</strong> Shanghai :<br />
- permet <strong>de</strong> remplacer les outils <strong>de</strong> coupe dans <strong>de</strong>s conditions<br />
atmosphériques, même lorsqu’il passe sous la rivière Yantze<br />
- est équipé d’un dispositif électronique pour contrôler les<br />
conditions <strong>de</strong> travail <strong>de</strong>s outils.<br />
VIE DE L’<strong>AFTES</strong><br />
<strong>Congrès</strong> <strong>de</strong> <strong>Monaco</strong><br />
2.2 - Innovations concernant les matériaux<br />
utilisés pour les soutènements<br />
Deux articles présentent la mise en œuvre <strong>de</strong> matériaux innovants<br />
pour réaliser <strong>de</strong>s soutènements et <strong>de</strong>s revêtements <strong>de</strong> tunnel sous<br />
forte couverture.<br />
Ces matériaux ont un comportement élastoplastique. Ils permettent<br />
<strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s soutènements semi-rigi<strong>de</strong>s qui supportent <strong>de</strong>s<br />
poussées <strong>de</strong> terrain élevées tout en se déformant.<br />
Ils ont été utilisés récemment avec succès pour construire en France<br />
et en Belgique <strong>de</strong>s tunnels sous forte couverture dans <strong>de</strong>s terrains<br />
avec déformations différées importantes.<br />
Galerie <strong>de</strong> Saint Martin la Porte<br />
La communication <strong>de</strong> M. RETTIGHIERI (LTF) et al décrit le procédé<br />
<strong>de</strong> construction et <strong>de</strong> suivi <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> la <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>rie <strong>de</strong> Saint<br />
Martin la Porte.<br />
<strong>Le</strong> soutènement actuellement mis en œuvre comprend, entre<br />
autres, une coque <strong>de</strong> béton projeté <strong>de</strong> 20 cm d’épaisseur, avec<br />
intercalations <strong>de</strong> blocs préfabriqués en béton compressible.<br />
Ces blocs en béton compressible ont un palier plastique <strong>de</strong> 8 MPa<br />
et une compressibilité <strong>de</strong> 50%. La coque en béton projeté a donc<br />
un comportement élastoplastique, avec un palier plastique à<br />
8 MPa.<br />
Galerie expérimentale Praclay<br />
La communication <strong>de</strong> M. BASTIENS (EIG Euridice) et al présente les<br />
voussoirs qui ont été placés à l’arrière du bouclier dans la galerie<br />
expérimentale Praclay.<br />
Pour obtenir un revêtement semi-rigi<strong>de</strong> avec palier plastique élevé,<br />
<strong>de</strong>s blocs en acier inox compressibles ont été intercalés entre les<br />
voussoirs. Ces blocs en acier compressible ont un palier plastique<br />
<strong>de</strong> 40 MPa. L’anneau <strong>de</strong> voussoirs a donc un comportement élastoplastique<br />
avec un palier plastique à 40 MPa.<br />
Un tronçon <strong>de</strong> la même galerie a été soutenu avec <strong>de</strong>s voussoirs,<br />
sans intercalation <strong>de</strong>s cales compressibles. <strong>Le</strong> revêtement étant<br />
alors rigi<strong>de</strong>, il <strong>de</strong>vait être capable <strong>de</strong> supporter <strong>de</strong>s poussées <strong>de</strong><br />
terrain beaucoup plus élevées. C’est pourquoi, dans ce cas, les<br />
voussoirs ont dû être réalisés avec un béton à très haute résistance<br />
(résistance à la compression mesurée sur cubes <strong>de</strong> 160 MPa).<br />
3 - RETOUR D’EXPERIENCE<br />
DES CAS CONCRETS<br />
<strong>Le</strong>s dix communications qui décrivent le retour d’expérience <strong>de</strong><br />
chantiers récents confirment l’importance :<br />
- <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s reconnaissances et <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s effectuées avant<br />
les travaux,<br />
- <strong>de</strong>s observations et <strong>de</strong> l’auscultation en cours <strong>de</strong> travaux.<br />
Par ailleurs ces communications montrent l’intérêt, notamment<br />
dans le cas <strong>de</strong>s chantiers difficiles, d’un esprit <strong>de</strong> coopération entre<br />
maître d’ouvrage, maître <strong>de</strong> l’œuvre, entreprises et constructeurs.<br />
Projet <strong>de</strong> traitement du terrain à l’avant d’un tunnelier<br />
La communication <strong>de</strong> M. FLORIA et al (Geodata S.A) propose <strong>de</strong><br />
consoli<strong>de</strong>r par drainage les flyschs argileux tectonisés que<br />
recoupera le tunnel sous le détroit <strong>de</strong> Gibraltar, à 475 m sous le<br />
niveau <strong>de</strong> la mer.<br />
TUNNELS ET OUVRAGES SOUTERRAINS - N° 210 - NOVEMBRE/DECEMBRE 2008 449
450<br />
VIE DE L’<strong>AFTES</strong><br />
<strong>Congrès</strong> <strong>de</strong> <strong>Monaco</strong><br />
<strong>Le</strong>s calculs présentés montrent que, malgré la faible perméabilité<br />
<strong>de</strong>s terrains argileux (K = 10 -10 m/s), le processus <strong>de</strong> consolidation<br />
apparait assez rapi<strong>de</strong>ment compte tenu <strong>de</strong>s forts gradients.<br />
Comme précisé dans la communication, ce procédé <strong>de</strong> construction<br />
innovant reste à expérimenter et à vali<strong>de</strong>r sur un chantier réel.<br />
Calculs et dimensionnement <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s cavités <strong>souterrain</strong>es<br />
• La communication <strong>de</strong> M. NASRI et al (DMJH Harris) décrit les<br />
métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> calcul qui ont été utilisées pour la conception <strong>de</strong> 2<br />
stations <strong>souterrain</strong>es du métro <strong>de</strong> New York (largeur maxi <strong>de</strong>s<br />
stations : 30 m – hauteur <strong>de</strong> la couverture rocheuse : 10 m environ).<br />
• la communication <strong>de</strong> M. MONROY (Vinci Construction) indique<br />
d’une manière détaillée les métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> calcul qui ont été utilisées<br />
pour le dimensionnement <strong>de</strong>s niches <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> dimension du tunnel<br />
<strong>de</strong> bouclage <strong>de</strong> l’autoroute A86 en Ile <strong>de</strong> France.<br />
Ces <strong>de</strong>ux communications, qui concernent <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s d’ouvrage<br />
<strong>de</strong> gran<strong>de</strong> dimension situés dans un environnement urbain sensible,<br />
rappellent que le dimensionnement du soutènement et du revêtement<br />
d’un tunnel complexe ne peut pas se limiter à l’utilisation d’un logiciel<br />
3D, même sophistiqué :<br />
• <strong>Le</strong> projet d’un grand ouvrage <strong>souterrain</strong> nécessite au préalable<br />
<strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s réflexions approfondies, en utilisant <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong> calcul simplifiées.<br />
• <strong>Le</strong>s modèles numériques plus élaborés sont utilisés dans les<br />
<strong>de</strong>rnières phases d’étu<strong>de</strong>, pour optimiser le dimensionnement <strong>de</strong>s<br />
éléments structurels et pour vali<strong>de</strong>r les options <strong>de</strong> conception.<br />
Chantiers <strong>de</strong> tunnel sous forte couverture<br />
La communication <strong>de</strong> M. RETTIGHIERI (LTF) et al sur la <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>rie<br />
<strong>de</strong> Saint Martin La Porte ainsi que celle <strong>de</strong> M. BASTIENS (EIG Euridice)<br />
et al sur la galerie expérimentale Praclay montrent que dans<br />
les terrains hétérogènes et les terrains avec déformations différées<br />
importantes, le retour d’expérience d’un chantier en vraie gran<strong>de</strong>ur<br />
est nécessaire.<br />
En effet, seules les observations du comportement du terrain en<br />
cours <strong>de</strong> travaux et un programme d’auscultation approfondi<br />
permettent <strong>de</strong> caler un modèle fiable pour caractériser le comportement<br />
à court et long terme du complexe terrain / soutènement,<br />
et, en conséquence, pour garantir la sécurité du tunnel tout en<br />
optimisant les procédés <strong>de</strong> construction et les soutènements.<br />
Descen<strong>de</strong>ries <strong>de</strong> reconnaissance du projet Lyon – Turin<br />
<strong>Le</strong> projet <strong>de</strong> liaison ferroviaire Lyon Turin fait l’objet <strong>de</strong> reconnaissances,<br />
essais et mesures nombreuses et variées.<br />
La communication <strong>de</strong> Mme MONIN (LTF) et al présente d’une<br />
manière détaillée, la base <strong>de</strong> données géoréférencée Géodatabase,<br />
que LTF a mis en place pour stocker l’ensemble <strong>de</strong>s données<br />
acquises d’une manière cohérente et homogène.<br />
Géodatabase permet notamment le suivi en temps réel <strong>de</strong> l’avancement<br />
<strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> reconnaissance (géologie, hydrogéologie,<br />
géomécanique) et le suivi environnemental.<br />
Galerie d’assainissement à Alger<br />
La communication <strong>de</strong> M. CHAPUIS (CSM Bessac) décrit les travaux<br />
<strong>de</strong> construction d’un important collecteur d’assainissement dans la<br />
ville d’Alger en site géotechniquement et hydrogéologiquement<br />
difficile.<br />
L’ouvrage se situe dans un environnement urbain très <strong>de</strong>nse et<br />
contraint.<br />
TUNNELS ET OUVRAGES SOUTERRAINS - N° 210 - NOVEMBRE/DECEMBRE 2008<br />
<strong>Le</strong> collecteur ∅ 4 m <strong>de</strong> 4,3 km <strong>de</strong> longueur est excavé avec un<br />
tunnelier à pression <strong>de</strong> terre fabriqué dans l’usine <strong>de</strong> CSM Bessac à<br />
Toulouse.<br />
<strong>Le</strong> projet comprend plusieurs puits <strong>de</strong> chute à Vortex, avec <strong>de</strong>s<br />
dispositifs complexes <strong>de</strong> dissipation d’énergie et d’aération. <strong>Le</strong>ur<br />
conception permet <strong>de</strong> réguler les flux et <strong>de</strong> garantir un écoulement<br />
gravitaire dans le collecteur.<br />
Tunnel en tranchée couverte à <strong>Monaco</strong><br />
La communication <strong>de</strong> M. LHUISSIER (SGTM) et al décrit les travaux<br />
<strong>de</strong> l’ensemble I1, qui constitue l’un <strong>de</strong>s lots du Projet d’Urbanisation<br />
<strong>de</strong>s terrains à l’emplacement <strong>de</strong>s anciennes voies SNCF dans la<br />
ville <strong>de</strong> <strong>Monaco</strong>. Coyne et Bellier est maître d’œuvre <strong>de</strong> l’ensemble<br />
<strong>de</strong> cette opération.<br />
L’Ensemble I1 comprend une tranchée <strong>de</strong> 180 m <strong>de</strong> longueur et <strong>de</strong><br />
20 m <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>ur. Elle est excavée dans <strong>de</strong>s éboulis et <strong>de</strong>s<br />
marno-calcaires altérés.<br />
La fouille <strong>de</strong> 40 m <strong>de</strong> largeur a été butonnée par trois nappes <strong>de</strong><br />
butons longs et précontraints, reliés en treillis et appuyés sur <strong>de</strong>s<br />
poteaux préfondés.<br />
La comparaison entre les déformations observées et les pressions<br />
mesurées dans chaque buton, a permis d’optimiser le phasage <strong>de</strong>s<br />
travaux, notamment les phases <strong>de</strong> débutonnage et <strong>de</strong> construction<br />
<strong>de</strong>s structures définitives.<br />
Métro <strong>de</strong> Dubaï<br />
A partir d’un retour d’expérience pendant la construction d’un<br />
tronçon <strong>de</strong> métro à Dubaï, la communication <strong>de</strong> M. BEAU et al (Systra)<br />
montre l’intérêt d’une collaboration étroite entre l’entreprise et le<br />
maître d’œuvre, notamment en cas <strong>de</strong> difficultés et d’imprévus<br />
pendant les travaux.<br />
<strong>Le</strong> tunnel et les stations ont été réalisés par un consortium d’entreprises<br />
japonaise et turque, dans le cadre d’un contrat clé en main à<br />
prix forfaitaire.<br />
<strong>Le</strong> tunnel est excavé avec un tunnelier à pression <strong>de</strong> terre dans <strong>de</strong>s<br />
terrains sableux sous forte charge d’eau.<br />
Suite aux problèmes <strong>de</strong> traitement <strong>de</strong>s terrains aux entrées et<br />
sorties <strong>de</strong> station, Systra maître d’œuvre a apporté son appui<br />
technique aux entreprises pour modifier la métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> réalisation<br />
<strong>de</strong>s entrées et sorties <strong>de</strong> stations.<br />
4 - COMMUNICATIONS TRAITANT<br />
DE SUJETS GENERAUX<br />
La communication M. JULIEN (Laboratoire <strong>de</strong>s Ponts et Chaussées<br />
<strong>de</strong> l’Est Parisien) et al présente une métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> calcul nouvelle<br />
pour évaluer la stabilité d’un front <strong>de</strong> taille. Elle consiste à déterminer<br />
par une approche 3D, non seulement la surface <strong>de</strong> rupture<br />
potentielle du front sans ou avec confortement, mais également un<br />
champ <strong>de</strong> déplacement compatible avec cette surface <strong>de</strong> rupture.<br />
Son emploi pour analyser la stabilité du front <strong>de</strong> taille semble<br />
prometteuse. En effet, cette métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> calcul :<br />
• permet <strong>de</strong> choisir le confortement à appliquer au front en<br />
fonction <strong>de</strong>s déplacements induits par le creusement, et non pas<br />
seulement à partir d’un simple coefficient <strong>de</strong> sécurité par rapport à<br />
la rupture (comme on le fait avec les métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> calcul habituelles),<br />
• facilite l’interprétation <strong>de</strong>s mesures d’auscultation en cours <strong>de</strong><br />
travaux (mesures <strong>de</strong> déplacements à l’avancement <strong>de</strong> l’excavation).
Dans la continuité du thème Eupalinos 2000 (thème B3), la communication<br />
<strong>de</strong> M. BORIO et al présente les résultats <strong>de</strong>s essais <strong>de</strong><br />
laboratoire réalisés à l’Université Polytechnique <strong>de</strong> Turin.<br />
Ces essais permettent <strong>de</strong> mieux évaluer les propriétés <strong>de</strong>s sols<br />
sableux avec ajout d’adjuvants dans la chambre d’abattage d’un<br />
tunnelier à pression <strong>de</strong> terre.<br />
Deux mo<strong>de</strong>s opératoires ont été utilisés : les slump tests et <strong>de</strong>s essais<br />
avec un appareillage <strong>de</strong> laboratoire équipé d’un convoyeur à vis.<br />
L’article montre également les avantages comparés <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux<br />
types d’essai.<br />
5 - CONCLUSIONS<br />
<strong>Le</strong>s communications du thème C2 montrent que les techniques <strong>de</strong><br />
construction <strong>de</strong>s ouvrages <strong>souterrain</strong>s continuent <strong>de</strong> se perfectionner<br />
dans tous les domaines :<br />
• <strong>Le</strong>s possibilités d’emploi <strong>de</strong>s tunneliers continuent <strong>de</strong> s’élargir<br />
(diamètre <strong>de</strong>s plus gros tunneliers, facilité <strong>de</strong> montage et démontage<br />
<strong>de</strong> certains tunneliers, facilités <strong>de</strong> maintenance dans les<br />
terrains difficiles).<br />
• L’emploi <strong>de</strong> cales compressibles en béton ou en acier permet<br />
désormais <strong>de</strong> concevoir <strong>de</strong>s soutènements / revêtements semi-rigi<strong>de</strong>s,<br />
1 - INTRODUCTION<br />
Sur les réseaux <strong>de</strong> transport, les tunnels, et en particulier les longs<br />
tunnels, sont les ouvrages probablement les plus complexes, car ils<br />
constituent <strong>de</strong>s systèmes dont la conception et l’exploitation<br />
doivent prendre en compte l’interaction entre ouvrage et usagers.<br />
Dans l’<strong>espace</strong> confiné d’un tunnel, les acci<strong>de</strong>nts sont principalement<br />
dus à <strong>de</strong>s collisions par l’arrière, à <strong>de</strong>s collisions avec les parois <strong>de</strong><br />
l’ouvrage et, plus gravement, à <strong>de</strong>s collisions frontales. Comme à<br />
ciel ouvert, les causes <strong>de</strong> ces acci<strong>de</strong>nts sont très majoritairement<br />
<strong>de</strong>s erreurs humaines <strong>de</strong> comportement, et beaucoup plus rarement<br />
<strong>de</strong>s inci<strong>de</strong>nts techniques <strong>de</strong> véhicules. En tunnel cependant, les<br />
usagers ne subissent pas les difficultés dues aux intempéries, aux<br />
basses températures, aux conditions changeantes d’éclairage, à<br />
<strong>de</strong>s géométries <strong>de</strong> tracé difficiles, à <strong>de</strong>s flux <strong>de</strong> trafic <strong>de</strong> vitesses<br />
très différenciées, et il n’y a pas d’acci<strong>de</strong>nts dus à <strong>de</strong>s croisements<br />
avec d’autres voies <strong>de</strong> communication. L’usager a également<br />
tendance à conduire plus pru<strong>de</strong>mment, dans un <strong>espace</strong> confiné<br />
perçu comme potentiellement hostile.<br />
En raison <strong>de</strong> ces conditions différentes <strong>de</strong> circulation, on constate<br />
que les taux d’acci<strong>de</strong>nts sont tendanciellement moins élevés en<br />
tunnel qu’à ciel ouvert. Une différence importante existe cependant<br />
dans l’ampleur potentielle <strong>de</strong>s dégâts en cas d’incendie d’un ou <strong>de</strong><br />
plusieurs véhicules. En tunnel, un incendie est susceptible <strong>de</strong> se<br />
transformer rapi<strong>de</strong>ment en catastrophe, car le confinement peut<br />
VIE DE L’<strong>AFTES</strong><br />
<strong>Congrès</strong> <strong>de</strong> <strong>Monaco</strong><br />
procédé innovant et très utile pour les tunnels dans les terrains<br />
déformables sous forte couverture.<br />
<strong>Le</strong>s communications sur le retour d’expérience <strong>de</strong> chantiers rappellent<br />
les points essentiels suivants :<br />
• un projet <strong>de</strong> tunnel fiable ne peut être établi qu’à partir <strong>de</strong> données<br />
fiables, c’est-à-dire à partir <strong>de</strong> reconnaissances approfondies,<br />
• le suivi et l’auscultation du comportement du complexe terrain /<br />
soutènement en cours <strong>de</strong> travaux reste indispensable pour assurer<br />
la sécurité du chantier et pour optimiser les travaux.<br />
Par ailleurs, plusieurs communications soulignent l’intérêt, notamment<br />
dans le cas <strong>de</strong> chantiers difficiles, d’une collaboration étroite entre<br />
les entrepreneurs, le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre.<br />
En travaux <strong>souterrain</strong>s, l’absence <strong>de</strong> certitu<strong>de</strong> est omniprésente.<br />
Pour surmonter cette difficulté, un esprit <strong>de</strong> coopération entre les<br />
différents intervenants dans une relation contractuelle équilibrée<br />
doit être recherché.<br />
On peut rappeler à ce sujet, les recommandations du GT 25 <strong>de</strong><br />
l’<strong>AFTES</strong> sur la maîtrise <strong>de</strong>s coûts et la contractualisation <strong>de</strong>s risques.<br />
Ces recommandations du GT 25 précisent les règles à respecter<br />
pour améliorer les relations contractuelles entre le maître<br />
d’ouvrage, les entrepreneurs et le maître d’œuvre, en vue d’obtenir<br />
une meilleure maîtrise du coût <strong>de</strong>s ouvrages <strong>souterrain</strong>s.<br />
THÈME D - Des tunnels pérennes et sûrs<br />
Par Jürg Röthlisberger (OFROU, Berne - Suisse)<br />
entraîner un développement considérable <strong>de</strong> l’incendie, dont la<br />
maîtrise peut échapper presque totalement à l’exploitant. Des<br />
développements catastrophiques <strong>de</strong> ce genre peuvent se retrouver<br />
dans certains autres milieux (grands hôtels et acci<strong>de</strong>nts aériens, par<br />
exemple), mais, en principe, pas ailleurs sur les réseaux routiers.<br />
<strong>Le</strong>s tunnels constituent donc un environnement particulier pour<br />
l’usager et on peut affirmer, en particulier suite aux grands incendies<br />
survenus dans quelques tunnels européens aux alentours <strong>de</strong>s<br />
années 2000, que l’acceptation d’inci<strong>de</strong>nts avec un développement<br />
catastrophique est moindre pour ces ouvrages. En effet, l’usager a<br />
l’impression d’être contraint <strong>de</strong> voyager dans un environnement<br />
confiné susceptible <strong>de</strong> se transformer en milieu hostile duquel il n’a<br />
pas la possibilité <strong>de</strong> s’échapper facilement. Malgré leurs faibles<br />
fréquences d’occurrence et le faible nombre <strong>de</strong> morts survenus<br />
<strong>de</strong>puis <strong>de</strong>s décennies dans les tunnels, les quelques incendies<br />
catastrophiques mentionnés ont frappé les esprits et ont contribué<br />
à ce sentiment <strong>de</strong> dangerosité.<br />
D’un autre point <strong>de</strong> vue, il faut encore constater que les tunnels<br />
sont généralement les ouvrages les plus chers au kilomètre, aussi<br />
bien pour leur réalisation que dans leur phase d’exploitation. <strong>Le</strong>ur<br />
réalisation dépend <strong>de</strong> conditions géologiques et hydrogéologiques<br />
qui ne peuvent pas toujours être prévues <strong>de</strong> manière suffisamment<br />
précise, et nécessitent la mise en œuvre <strong>de</strong> métho<strong>de</strong>s<br />
d’exécution lour<strong>de</strong>s et chères. <strong>Le</strong>s difficultés imprévues sont relativement<br />
fréquentes et provoquent <strong>de</strong>s surcoûts qui peuvent être<br />
TUNNELS ET OUVRAGES SOUTERRAINS - N° 210 - NOVEMBRE/DECEMBRE 2008 451
452<br />
VIE DE L’<strong>AFTES</strong><br />
<strong>Congrès</strong> <strong>de</strong> <strong>Monaco</strong><br />
importants. <strong>Le</strong> potentiel d’industrialisation <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong><br />
construction semble peu élevé, chaque ouvrage possédant <strong>de</strong>s<br />
caractéristiques propres. <strong>Le</strong> <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> mécanisation est déjà<br />
assez élevé, et se justifie principalement pour les tunnels <strong>de</strong><br />
longueur conséquente.<br />
Pour sa part, l’exploitation met en œuvre <strong>de</strong>s équipements chers<br />
également (éclairage, ventilation, vidéo détection, signalisation,<br />
etc.), avec une durée <strong>de</strong> vie technologique relativement courte,<br />
ainsi que <strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong> contrôle dont la sophistication va<br />
croissant, et qui nécessitent l’engagement à plusieurs niveaux <strong>de</strong><br />
personnels assez nombreux et donc coûteux.<br />
2 - APPROCHE INTÉGRALE POUR<br />
LA SÉCURITÉ DANS LES TUNNELS<br />
Afin d’assurer la sécurité <strong>de</strong>s usagers dans les tunnels, le premier<br />
objectif consiste à mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables<br />
susceptibles d’empêcher l’occurrence <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts. Cet objectif<br />
premier étant impossible à atteindre <strong>de</strong> manière absolue, il faut<br />
s’attendre malgré tout à l’occurrence d’acci<strong>de</strong>nts avec <strong>de</strong>s incendies<br />
pouvant se développer <strong>de</strong> manière plus ou moins incontrôlée.<br />
C’est pourquoi, le second objectif consiste à concevoir l’ouvrage,<br />
ses équipements et son système d’exploitation <strong>de</strong> manière à ce<br />
que l’usager puisse bénéficier d’une chance raisonnable <strong>de</strong> se mettre<br />
à l’abri du danger en cas d’inci<strong>de</strong>nt nécessitant l’évacuation <strong>de</strong><br />
l’<strong>espace</strong> <strong>de</strong> circulation.<br />
Cette approche intégrale pour la sécurité dans les tunnels est maintenant<br />
généralement acceptée et comprise. Il est également admis<br />
que la sécurité ne doit pas uniquement concerner l’infrastructure<br />
<strong>de</strong>s ouvrages (équipements <strong>de</strong> sécurité, voies <strong>de</strong> fuite, systèmes <strong>de</strong><br />
ventilation, etc.), mais également les trois autres domaines que sont<br />
les usagers (éducation, information, sensibilisation, etc.), les véhicules<br />
(conception, équipements, sécurité intrinsèque, etc.), et l’exploitation<br />
<strong>de</strong>s ouvrages (vidéo détection d’inci<strong>de</strong>nts, désenfumage, etc.).<br />
Cette approche s’est concrétisée en 2004 par la publication <strong>de</strong> la<br />
directive <strong>de</strong> l’Union Européenne relative aux exigences <strong>de</strong> sécurité<br />
minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen.<br />
La directive européenne constitue elle-même une consolidation<br />
<strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong> plusieurs travaux réalisés dès la fin <strong>de</strong>s années<br />
1990 dans plusieurs instances <strong>international</strong>es telles que la Réunion<br />
<strong>de</strong>s pays alpins, la CEE ONU et l’AIPCR. Pour la première fois à un<br />
tel niveau, la directive européenne exige concrètement la mise en<br />
œuvre d’étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> risques pour examiner certains aspects <strong>de</strong> la<br />
sécurité <strong>de</strong>s tunnels, et en particulier pour évaluer l’efficacité <strong>de</strong><br />
mesures <strong>de</strong> sécurité alternatives. Si les métho<strong>de</strong>s d’étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s<br />
risques ne sont pas appelées à se substituer à l’approche normative<br />
classique, seule à même <strong>de</strong> permettre une uniformisation <strong>de</strong> la<br />
conception <strong>de</strong>s ouvrages <strong>de</strong> manière rapi<strong>de</strong>, simple et économique,<br />
elles ouvrent cependant un champ d’optimisations et <strong>de</strong> comparaisons<br />
peu connues à ce jour dans le domaine routier, et en particulier <strong>de</strong>s<br />
tunnels.<br />
3 - ASSURER LA RÉALISATION<br />
DE TUNNELS PÉRENNES ET SÛRS<br />
<strong>Le</strong>s communications remises à l’occasion du <strong>Congrès</strong> sur le thème<br />
D permettent <strong>de</strong> montrer <strong>de</strong> quelle manière les concepteurs<br />
s’efforcent <strong>de</strong> prendre en compte les aspects mentionnés ci-<strong>de</strong>ssus<br />
afin d’optimiser les lourds investissements nécessités par la réalisation<br />
TUNNELS ET OUVRAGES SOUTERRAINS - N° 210 - NOVEMBRE/DECEMBRE 2008<br />
et l’exploitation <strong>de</strong>s tunnels, d’une part, tout en assurant une<br />
sécurité optimale <strong>de</strong>s usagers, d’autre part.<br />
<strong>Le</strong>s communications montrent clairement que ces efforts ont lieu<br />
dans tous les sta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> réalisation <strong>de</strong>s tunnels, soit lors <strong>de</strong> leur<br />
conception et réalisation, lors <strong>de</strong> leur exploitation et lors <strong>de</strong> leur<br />
rénovation. De même, à l’exception <strong>de</strong>s véhicules, tous les domaines<br />
relatifs à la sécurité dans les tunnels ont également été abordés<br />
dans les communications, soit l’infrastructure, l’exploitation, les usagers.<br />
<strong>Le</strong>s problématiques principales abordées dans les communications<br />
relatives au thème D « Tunnels pérennes et sûrs » sont présentées<br />
en synthèse ci-après.<br />
4 - PHASE DE CONCEPTION ET<br />
DE RÉALISATION<br />
<strong>Le</strong> développement actuel <strong>de</strong>s projets intégrés <strong>de</strong> conception,<br />
construction, financement et exploitation d'infrastructures <strong>de</strong><br />
transports nécessite <strong>de</strong> plus en plus une approche globale <strong>de</strong> la<br />
gestion du cycle <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s infrastructures. Dans ce contexte, une<br />
société a développé une approche innovante en concevant un<br />
concept d’ai<strong>de</strong> à la décision basé principalement sur l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
risques d'une structure prise dans sa globalité en étudiant l'impact<br />
d'une ou plusieurs défaillances sur tous les enjeux associés. Elle propose<br />
<strong>de</strong>s outils permettant par conséquent <strong>de</strong> modéliser l'ouvrage<br />
dans son ensemble et <strong>de</strong> visualiser son évolution dans le temps et<br />
d'accréditer l'impact <strong>de</strong>s divers plans d'action qui <strong>de</strong>vront être mis<br />
en œuvre. Cette gestion par les risques avec mise en place d'une<br />
stratégie maitrisée à moyen ou long terme permet <strong>de</strong> n'opérer que<br />
les interventions indispensables à la pérennité <strong>de</strong>s ouvrages tout en<br />
disposant d'une vision claire et objective <strong>de</strong>s risques résiduels.<br />
L'utilisation <strong>de</strong> système d'aspersion d'eau pour lutter contre les<br />
incendies en tunnel est effective <strong>de</strong>puis les années 60 au Japon et<br />
en Australie. Au cours <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rnières années, la recherche s'est<br />
concentrée sur les systèmes par brouillard d'eau, qui présentent un<br />
meilleur rapport coût-efficacité. <strong>Le</strong> projet <strong>de</strong> recherche européen<br />
UPTUN a ainsi abouti à la définition <strong>de</strong> tests incendie spécifiques<br />
ainsi qu'à l'énoncé d'exigences minimales en la matière. Une<br />
communication décrit les résultats obtenus dans le cadre du projet<br />
<strong>de</strong> recherche SOLIT, lancé par le gouvernement allemand et dont<br />
l'objectif était non seulement d'étudier les effets du système par<br />
brouillard d'eau sur les incendies en tunnel, mais également<br />
d’évaluer les interactions avec les autres éléments d'un système <strong>de</strong><br />
sécurité tels que la détection incendie, la protection passive ou la<br />
ventilation. Cinquante essais d’incendie ont ainsi été réalisés dans<br />
le cadre d'un programme à large échelle. <strong>Le</strong>s essais ont démontré<br />
que les systèmes par brouillard d'eau permettent <strong>de</strong> contrôler le<br />
rayonnement thermique <strong>de</strong>s incendies en tunnel. <strong>Le</strong>s effets dangereux<br />
<strong>de</strong>s gaz toxiques sur les utilisateurs diminuent, et l'approche <strong>de</strong>s<br />
services d'intervention est sensiblement facilitée, grâce à une<br />
réduction <strong>de</strong> la température et du rayonnement. En outre, la propagation<br />
<strong>de</strong> l'incendie est entravée et la charge thermique est<br />
réduite, <strong>de</strong> même que les dégâts sur la structure, permettant ainsi<br />
une remise en service plus rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'ouvrage.<br />
Une communication traite <strong>de</strong> l'importance <strong>de</strong>s facteurs liés au<br />
comportement humain quant à la sécurité <strong>de</strong>s tunnels routiers. Elle<br />
résume les étu<strong>de</strong>s menées <strong>de</strong>puis quelques années pour comprendre<br />
l'écart constaté entre le comportement attendu et le comportement<br />
réel <strong>de</strong>s usagers en cas d'évènement grave en tunnel routier. Elle<br />
présente ensuite les travaux en cours menés dans le cadre d'un
projet <strong>de</strong> la Direction Interdépartementale <strong>de</strong>s Routes d'Ile <strong>de</strong><br />
France, qui consistent à tester et évaluer les dispositifs <strong>de</strong> sécurité, et<br />
en particulier ceux liés à l'évacuation d'un tunnel routier, auprès d'usagers<br />
volontaires. Au vu <strong>de</strong>s résultats obtenus, la question se pose <strong>de</strong><br />
l'adaptation <strong>de</strong>s dispositifs <strong>de</strong> sécurité réglementaires existants.<br />
Elle préconise dans tous les cas l'évaluation in situ associant <strong>de</strong>s<br />
usagers volontaires avant d'envisager le déploiement plus large <strong>de</strong><br />
nouveaux systèmes.<br />
La protection thermique <strong>de</strong>s chambres <strong>de</strong> tirage en tunnels permet<br />
le maintien <strong>de</strong> fonctionnalités indispensables lors d’incendies, soit<br />
l’alimentation et le pilotage <strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong> sécurité et <strong>de</strong> gestion<br />
<strong>de</strong> l’ouvrage (ventilation, éclairage <strong>de</strong> sécurité, niches techniques,<br />
réseaux <strong>de</strong> transport <strong>de</strong> données pour la surveillance et la gestion<br />
<strong>de</strong>s systèmes, etc.). Diverses solutions ont été appliquées <strong>de</strong>puis<br />
quelques années pour cette protection thermique <strong>de</strong>s chambres <strong>de</strong><br />
tirage. Une démarche a été engagée pour le développement d'une<br />
protection thermique incluant la vérification du maintien <strong>de</strong>s<br />
fonctionnalités <strong>de</strong>s divers réseaux transitant dans les chambres <strong>de</strong><br />
tirage. <strong>Le</strong>s essais menés en laboratoire ont abouti à la production<br />
<strong>de</strong> fermetures <strong>de</strong> chambre <strong>de</strong> tirage constituées d'une trappe en<br />
fonte à remplissage <strong>de</strong> mortier complétée par une protection<br />
thermique respectant non seulement les contraintes règlementaires<br />
françaises <strong>de</strong> résistance au feu, mais satisfaisant également celles<br />
liées à la résistance mécanique, à l'étanchéité et à la maniabilité.<br />
<strong>Le</strong> trafic augmentant toujours plus dans certains tunnels, la rupture<br />
acci<strong>de</strong>ntelle d'un tel ouvrage lors d'un incendie engendre <strong>de</strong>s<br />
désordres majeurs <strong>de</strong> plusieurs types, non seulement humains,<br />
mais aussi environnementaux et économiques, pour la région<br />
limitrophe. Il est donc primordial <strong>de</strong> pouvoir estimer et prédire la<br />
tenue <strong>de</strong> la structure, et en particulier le comportement du béton<br />
<strong>de</strong> revêtement <strong>de</strong>s tunnels en cas d'incendie. Une analyse <strong>de</strong>s<br />
effets consécutifs à une exposition à <strong>de</strong>s hautes températures sur<br />
les bétons utilisés pour le tunnel autoroutier <strong>de</strong> Bouira en Algérie<br />
est présentée. Cette analyse s'est concentrée sur le comportement<br />
mécanique du béton. L’étu<strong>de</strong> a permis <strong>de</strong> mieux comprendre les<br />
phénomènes complexes qui apparaissent en cas <strong>de</strong> surexposition<br />
thermique <strong>de</strong>s bétons <strong>de</strong> revêtement, et à formuler <strong>de</strong> nouvelles<br />
exigences <strong>de</strong> comportement au feu.<br />
5 - PHASE D’EXPLOITATION<br />
A l'instar d'autres domaines, le retour d'expérience en tunnel<br />
routier a d'abord été élaboré dans une optique « technique » et<br />
« quantitative ». <strong>Le</strong>s progrès technologiques ayant permis d'atteindre<br />
un niveau <strong>de</strong> sécurité élevé, il est aujourd'hui nécessaire d'avoir une<br />
démarche qualitative qui inclut les aspects humains et organisationnels,<br />
ceci dans le but <strong>de</strong> permettre une meilleure prise en compte <strong>de</strong>s<br />
usagers dans le retour d'expérience en tunnel routier. Dans le<br />
« système tunnel », constitué <strong>de</strong>s composants usager – exploitant –<br />
infrastructure (le véhicule n’étant pas ici mentionné), l'interaction<br />
entre les usagers et les <strong>de</strong>ux autres composants présente un potentiel<br />
d'amélioration. En effet, il existe une confusion parmi les usagers<br />
entre les différents dispositifs d'alarme, <strong>de</strong> fuite, <strong>de</strong> détection, etc..<br />
De plus, en cas d'évènement anormal, l'usager souffre d'un<br />
manque d'informations pour bien comprendre l'importance du<br />
danger. Or, cela le pousse à avoir un comportement non-conforme<br />
aux attentes, voire parfois à mettre en péril sa sécurité. C'est pourquoi<br />
une meilleure intégration dans le retour d'expérience <strong>de</strong>s aspects<br />
humains et organisationnels clarifiera les interactions usagers –<br />
infrastructure et exploitants. Lors d’un travail <strong>de</strong> recherche, une<br />
VIE DE L’<strong>AFTES</strong><br />
<strong>Congrès</strong> <strong>de</strong> <strong>Monaco</strong><br />
métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> recueil <strong>de</strong> témoignages <strong>de</strong>s usagers a été développée,<br />
puis utilisée au cours d’exercices <strong>de</strong> sécurité et à la suite d’événements<br />
réels. <strong>Le</strong>s résultats recueillis permettent une meilleure compréhension<br />
du comportement <strong>de</strong>s usagers en cas d’inci<strong>de</strong>nt et permettent<br />
d’aller au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> certaines idées préconçues.<br />
Sis sur l'A51 un peu au nord <strong>de</strong> Monestier-<strong>de</strong>-Clermont, dans le<br />
département <strong>de</strong> l'Isère, le tunnel <strong>de</strong> Sinard, long d'un peu moins<br />
d'un kilomètre, comporte une chaussée en béton délavé. En effet,<br />
soumis à un fort trafic ce tunnel restera en circulation bidirectionnelle<br />
pendant environ 15 ans sans intervention lour<strong>de</strong> sur la chaussée, ce<br />
qui nécessite un revêtement <strong>de</strong> chaussée particulièrement durable.<br />
Profitant <strong>de</strong> la clarté naturelle du béton, il a été décidé <strong>de</strong> lancer<br />
une campagne <strong>de</strong> mesures photométriques visant à prouver l'intérêt<br />
<strong>de</strong> chaussées claires dans les tunnels et tentant <strong>de</strong> quantifier les<br />
économies escomptées en terme <strong>de</strong> puissance d'éclairage. <strong>Le</strong>s<br />
premiers résultats sont encourageants et ten<strong>de</strong>nt à confirmer le<br />
potentiel d’économie d’énergie d’éclairage. La campagne <strong>de</strong><br />
mesure se poursuit actuellement.<br />
Dans le but <strong>de</strong> désengorger un tronçon d'autoroute <strong>de</strong> 14 km <strong>de</strong><br />
long entre Madrid et La Coruña, les <strong>de</strong>ux tunnels <strong>de</strong> Guadarrama,<br />
longs <strong>de</strong> 3 000 m environ, seront complétés d'un troisième tube.<br />
Ce <strong>de</strong>rnier pourra être mis en service <strong>de</strong> manière réversible, principalement<br />
pour les véhicules légers, en fonction <strong>de</strong>s flux <strong>de</strong> trafic<br />
dominants. Ce tunnel sera l’un <strong>de</strong>s premiers en Espagne à avoir fait<br />
l'objet d'un concept global <strong>de</strong> sécurité, conformément au Décret<br />
Royal 635/2006 concernant les conditions minimales <strong>de</strong> sécurité<br />
dans les tunnels routiers <strong>de</strong> l'État. Il faut mettre en évi<strong>de</strong>nce la<br />
construction <strong>de</strong> 14 galeries <strong>de</strong> liaison du nouveau tube avec les<br />
tubes existants, pour une longueur <strong>de</strong> galeries <strong>de</strong> près <strong>de</strong> 2 200 m.<br />
Sur cette base a été rédigé un « Manuel d'exploitation » contenant<br />
entre autres un « Plan d'urgence intérieur ou d'autoprotection »,<br />
ainsi qu’un chapitre concernant le « Plan d'évacuation ».<br />
Afin d'éviter les conflits d'autorité entre les différents intervenants<br />
lors d'incendie dans un tunnel, <strong>de</strong>s procédures claires et précises<br />
ont été mises en place pour les dix plus grands tunnels <strong>de</strong> Bruxelles.<br />
Ainsi la chronologie d'un événement peut être divisée en quatre<br />
phases distinctes, pour lesquelles sont clairement définis le début,<br />
la fin et la hiérarchie <strong>de</strong>s intervenants. En fonction <strong>de</strong> cela sont définies<br />
les actions que les opérateurs doivent effectuer ainsi que la méthodologie<br />
à suivre pour établir les consignes particulières <strong>de</strong> ventilation.<br />
L'auteur porte un regard constructif mais critique sur la possibilité<br />
d'automatiser certaines procédures.<br />
6 - PHASE DE RÉNOVATION<br />
Dans le cadre <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux projets monégasques, l’un d’un tunnel neuf<br />
et l’autre du réaménagement d’un tunnel existant, les aménagements<br />
envisagés pour l'évacuation, la protection <strong>de</strong>s usagers et les accès<br />
<strong>de</strong> secours, déclinent un même principe constructif. Il consiste à<br />
aménager une galerie latérale protégée contre l'incendie parallèlement<br />
à la chaussée, à l'intérieur du profil courant du tunnel. La<br />
galerie permet la combinaison <strong>de</strong>s fonctions d’amenée d’air frais,<br />
d’accès <strong>de</strong> secours et d’évacuation. Pour un ouvrage existant, une<br />
telle solution n’est en principe possible que si une réduction du<br />
nombre <strong>de</strong> voies <strong>de</strong> circulation est réalisable en parallèle. <strong>Le</strong>s projets<br />
comportent également l’intégration <strong>de</strong> ces galeries parallèles avec<br />
<strong>de</strong>s communications inter-tubes et <strong>de</strong>s débouchés vers l’extérieur.<br />
Cet ensemble cohérent permet d’offrir un niveau <strong>de</strong> sécurité jugé<br />
satisfaisant au terme <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s spécifiques <strong>de</strong> danger.<br />
TUNNELS ET OUVRAGES SOUTERRAINS - N° 210 - NOVEMBRE/DECEMBRE 2008 453
VIE DE L’<strong>AFTES</strong><br />
<strong>Congrès</strong> <strong>de</strong> <strong>Monaco</strong><br />
Construit en 1937 et exploité en tant que tunnel ferroviaire jusqu'en<br />
1967, le tunnel Maurice <strong>Le</strong>maire est <strong>de</strong>venu un tunnel routier<br />
bidirectionnel, mis en service à partir <strong>de</strong> 1976. Long <strong>de</strong> 7 km, il a fait<br />
l'objet d'une refonte complète du concept <strong>de</strong> sécurité durant ces<br />
<strong>de</strong>rnières années. Il a notamment été doté d'une galerie <strong>de</strong> fuite et<br />
d'un système <strong>de</strong> ventilation performant. Une <strong>de</strong>s particularités est<br />
l'évacuation <strong>de</strong>s fumées en cas d'incendie par un canal situé dans la<br />
galerie <strong>de</strong> fuite. Une autre est l'évacuation <strong>de</strong>s usagers à l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
véhicules spécialement conçus à cet effet. Un réseau complexe et<br />
redondant <strong>de</strong> systèmes d'alimentation, <strong>de</strong> gestion et d'intervention<br />
permet <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r la maîtrise <strong>de</strong>s événements à tout moment. La<br />
volonté <strong>de</strong> respecter au mieux les notions <strong>de</strong> fiabilité, maintenabilité,<br />
disponibilité et sécurité, a guidé les choix <strong>de</strong>s matériels et matériaux<br />
ainsi que celui <strong>de</strong>s architectures systèmes et <strong>de</strong>s cheminements.<br />
Il existe plusieurs types <strong>de</strong> drainages surfaciques applicables aux<br />
revêtements existants lors <strong>de</strong> rénovations ou d’assainissements<br />
<strong>de</strong> tunnels routiers. Dans le cas du tunnel Maurice <strong>Le</strong>maire déjà<br />
mentionné ci-<strong>de</strong>ssus, en plus <strong>de</strong>s exigences particulières <strong>de</strong> tenue<br />
au gel et au feu, vient s'ajouter la contrainte liée à l'<strong>espace</strong> libre très<br />
restreint. La réponse a été apportée par un drainage surfacique<br />
quadri-couches protégé au gel avec une épaisseur maximale <strong>de</strong><br />
15mm. Ce type <strong>de</strong> solution est applicable en cas <strong>de</strong> gabarit<br />
restreint. S’il correspond aux exigences <strong>de</strong> la législation française, le<br />
comportement à long terme du prototype mis en place au tunnel<br />
Maurice <strong>Le</strong>maire doit faire l’objet d’un suivi attentif.<br />
L’une <strong>de</strong>s particularités <strong>de</strong> la rénovation <strong>de</strong>s 4 tunnels <strong>de</strong> la section<br />
La Turbie – Tunnel <strong>de</strong> la Coupière <strong>de</strong> l’A8, dans le département <strong>de</strong>s<br />
Alpes-Maritimes, est l’exigence d’effectuer les travaux sous exploitation,<br />
ce qui implique la mise en œuvre d’une organisation et <strong>de</strong><br />
métho<strong>de</strong>s précises et strictes, avec un souci permanent <strong>de</strong> sécurité<br />
<strong>de</strong>s personnels et <strong>de</strong>s usagers. D’un point <strong>de</strong> vue technique,<br />
l’ensemble <strong>de</strong>s ouvrages et <strong>de</strong> ses éléments ont subi une rénovation<br />
complète : génie civil <strong>de</strong>s réseaux, <strong>de</strong>s ouvrages et <strong>de</strong>s bâtiments<br />
d’exploitation et <strong>de</strong> sécurité, travaux <strong>de</strong> rénovation et <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnisation<br />
<strong>de</strong>s équipements <strong>de</strong> sécurité et d’exploitation.<br />
7 - CONCLUSION<br />
<strong>Le</strong>s contributions présentées sous le thème D « Tunnels pérennes et<br />
sûrs » montrent l’intense activité qui règne autour <strong>de</strong> cette thématique,<br />
dont les domaines principaux font l’objet <strong>de</strong> réflexions, <strong>de</strong> recherches,<br />
<strong>de</strong> retours d’expérience, <strong>de</strong> projets. Depuis les années 2000, la<br />
notion d’approche intégrale pour la sécurité <strong>de</strong>s tunnels, prenant<br />
en compte les usagers, l’infrastructure, l’exploitation et les véhicules,<br />
s’est imposée <strong>de</strong> manière notoire. En parallèle à cette approche<br />
globale, il s’avère nécessaire d’intensifier l’évaluation <strong>de</strong> l’efficacité<br />
<strong>de</strong>s mesures d’amélioration <strong>de</strong> la sécurité par <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s d’étu<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>s risques non seulement qualitatives, mais également quantitatives.<br />
Ces métho<strong>de</strong>s, qui doivent encore être développées et affinées<br />
dans le domaine <strong>de</strong> la sécurité <strong>de</strong>s tunnels, ne peuvent pas se<br />
substituer à l’approche normative classique, mais elles sont seules à<br />
même d’évaluer scientifiquement l’efficacité <strong>de</strong>s mesures prévues<br />
en tenant compte <strong>de</strong> tous les paramètres concernés et pour<br />
l’ensemble du cycle <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s ouvrages.