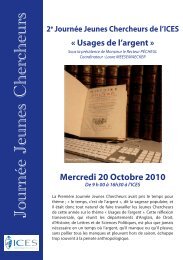Le développement du répertoire didactique des enseignants ... - ICES
Le développement du répertoire didactique des enseignants ... - ICES
Le développement du répertoire didactique des enseignants ... - ICES
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
soulignent aussi plus récemment Billiez & Millet (2001), les représentations sociales, constituent <strong>des</strong><br />
« cadres de référence », « <strong>des</strong> normes sociales », permettant aux indivi<strong>du</strong>s de « comprendre le monde<br />
environnant [afin] de se situer et de développer <strong>des</strong> relations » (p. 35). De ce fait, tout en étant<br />
« façonnées par les rapports sociaux », elles jouent un rôle dans l’établissement et le maintien de ces<br />
rapports. Enfin, comme le précisent Lüdi & Py (2002 : 98), les représentations sociales – qu’ils<br />
définissent comme « <strong>des</strong> micro théories socialement partagées et prêtes à l’emploi, suffisamment<br />
vagues pour faciliter un large consensus et une application éten<strong>du</strong>e » (p. 98) – se diffusent par la<br />
circulation de discours, « elles existent et se diffusent dans le tissu social » (Py, 2000), elles sont à la<br />
fois travaillés par le discours « lieu où les représentations sociales se constituent, se façonnent, se<br />
modifient ou se désagrègent » (Py : idem) et observables dans le discours. À la suite notamment <strong>des</strong><br />
travaux de Charlier (1989 et 2001), de Bucher-Poteaux (1991 : 17), de Baillauquès (2001) ou encore<br />
de Cambra (2002), nous pensons que les représentations qu’un indivi<strong>du</strong> se forge en tant qu’apprenant<br />
et en tant qu’enseignant sur les langues étrangères, sur l’apprentissage et sur l’enseignement, jouent un<br />
rôle déterminant dans les activités d’apprentissage comme dans les activités d’enseignement. En effet,<br />
comme l’ont souligné ces auteurs, les conceptions qu’un enseignant a construites sur l’apprentissage<br />
au cours de son histoire d’apprenant – qui est aussi la plus grande source pour l’élaboration <strong>des</strong><br />
représentations selon Cambra (idem) – déterminent spontanément sa manière d’enseigner. Elles<br />
orientent les con<strong>du</strong>ites et peuvent être considérées comme « un <strong>des</strong> moyens à partir <strong>des</strong>quels ils<br />
structurent leur comportement d’enseignement et d’apprentissage » (Charlier, 1989 : 46). De ce fait,<br />
les représentations qu’un enseignant nourrit sur les langues semblent bien avoir une influence sur<br />
l’élaboration de ses représentations professionnelles, c'est-à-dire les représentations que l'on a sur un<br />
métier ou sur une profession donnée « fondées sur un système plus ou moins cohérent et conscientisé<br />
de ce qu’est la profession qu’[on] exerce ou que l’on va exercer » (Altet, 2000 : 37). C’est la raison<br />
pour laquelle on peut considérer, avec Baillauquès (2001) et Semal-<strong>Le</strong>bleu (2003) qu’une véritable<br />
formation initiale devrait permettre aux futurs <strong>enseignants</strong> d’effectuer, un « travail <strong>des</strong><br />
représentations » qui, nous semble-t-il, pourrait être mené à partir et en complément <strong>des</strong> différentes<br />
observations de classe auxquels les étudiants se trouvent confrontés.<br />
2. Un cycle cohérent d’observations formatives<br />
La construction d'un <strong>répertoire</strong> <strong>didactique</strong> nécessite <strong>des</strong> étudiants la mise en relation/confrontation <strong>des</strong><br />
connaissances théoriques apprises <strong>du</strong>rant la formation à une réflexion sur la pratique enseignante en<br />
général et sur leur pratique enseignante personnelle en particulier pour se rendre opérationnels dans la<br />
classe de langue. Nous estimons, à la suite de Castellotti & de Carlo (1995), que ce travail représente<br />
le « nœud central » d’une réelle formation et transformation <strong>du</strong> sujet au cours de laquelle on doit<br />
permettre aux se formants d’acquérir <strong>des</strong> savoirs, <strong>des</strong> savoir-faire et <strong>des</strong> savoir-être mais aussi et<br />
surtout de leur donner les moyens de les remettre en question pour leur permettre de continuer à<br />
développer et à diversifier leurs compétences professionnelles tout au long de leur carrière 4 . Au cours<br />
de leur cursus complet de Didactique <strong>du</strong> FLE à Paris 3, les étudiants entrent sur le terrain de la classe<br />
de langue étrangère en réalisant trois types différents d’observation de classe in vivo (deux en Mention<br />
et une en Maîtrise). Ces trois types d’observations de classe sont complémentaires et exercent une<br />
influence réciproque. Elles forment ce que nous appelons un cycle cohérent d’observations formatives<br />
au cours <strong>des</strong>quelles les étudiants voient petit à petit le rôle, leur tâche, leur implication et leur travail de<br />
réflexion se complexifier. Ils sont amenés à entrer progressivement les étudiants dans une posture<br />
réflexive et passent successivement <strong>du</strong> statut d’étudiant-observateur-auto-observateur à celui<br />
d’enseignant-auto-observateur puis d’enseignant-auto-observateur-observateur mutuel et enfin à celui<br />
d’analyste de pratiques. Il nous semble que la mise en relation entre représentations, modèles, théorie<br />
et pratique qui devrait permettre aux étudiants de se forger les compétences d’un enseignant réflexif<br />
peut commencer dès la première étape de formation. En effet, dès que les étudiants prennent un contact<br />
direct avec le terrain de la classe de langue étrangère – il s’agit bien de la classe de langue étrangère et<br />
4<br />
En d’autres termes et pour reprendre l’idée développée notamment par G. Mialaret (1983), M. Postic & J.-M.<br />
De Ketele (1988), P. Jonnaert (1993), L. Paquay (1993), S. Gasibirège (1998) et comme le soulignent M.-Th.<br />
Vasseur & B. Grandcolas (1999) la formation initiale, comme son nom l’indique, doit placer les<br />
étudiants dans une véritable optique de formation et d’autoformation permanente.<br />
4