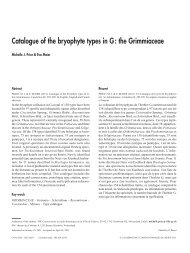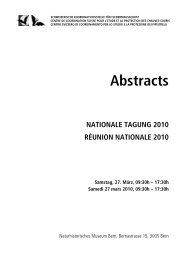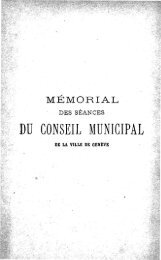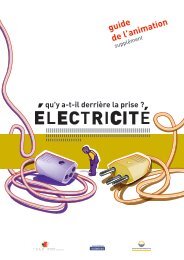VOLTAIRE ET LA CHINE - Ville de Genève
VOLTAIRE ET LA CHINE - Ville de Genève
VOLTAIRE ET LA CHINE - Ville de Genève
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
avoir mangé d’un fruit rouge. » La réponse, évi<strong>de</strong>mment attendue, reproduit les schémas que Voltaire avait<br />
développés dans ses écrits précé<strong>de</strong>nts : « Cela peut révolter, lui répondis-je ; mais non pas dégoûter ; <strong>de</strong> pareils<br />
contes ont toujours réjoui les peuples ; la mère <strong>de</strong> Gengis-Kan était une vierge qui fut grosse d’un rayon <strong>de</strong><br />
soleil. » Dans le privé, Voltaire ne semblait guère estimer le poème <strong>de</strong> Kien-Long.<br />
55. Pastoret, Zoroastre, Confucius et Mahomet, Paris, 1788, Institut et Musée Voltaire,<br />
<strong>Genève</strong>.<br />
Le comte <strong>de</strong> Pastoret (1756-1840), auteur d’un Eloge <strong>de</strong> Voltaire (1779), est couronné en 1785 par l’Académie<br />
<strong>de</strong>s Inscriptions pour ses travaux, au nombre <strong>de</strong>squels ce Zoroastre, Confucius et Mahomet. Après un tableau<br />
historique et critique « long, lent et lourd », si l’on en croit le rédacteur <strong>de</strong> la Correspondance littéraire, Pastoret<br />
défend une idée simple : « Si Mahomet, dit-il, connut mieux que ses prédécesseurs l’art d’enchaîner le peuple<br />
par <strong>de</strong>s opinions religieuses, l’art plus grand d’approprier ses dogmes au climat et aux besoins naturels <strong>de</strong> ceux<br />
auxquels il annonçait sa doctrine, on ne peut se dissimuler que Confucius n’ait développé avec plus <strong>de</strong> sagesse et<br />
<strong>de</strong> profon<strong>de</strong>ur les principes <strong>de</strong> la morale, et que Zoroastre ne mérite <strong>de</strong> leur être préféré comme législateur . »<br />
« Il est dommage, précise la Correspondance littéraire, que le lecteur n’y soit pas conduit [à cette idée] par un<br />
chemin plus facile et plus court. » Pastoret se rendra plus tard célèbre pour <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r la transformation <strong>de</strong><br />
l’église Sainte-Geneviève en Panthéon patriotique. L’Académie française lui est ouverte en 1820 : il y succè<strong>de</strong> à<br />
Volney.<br />
56. Clau<strong>de</strong> Farrère, Discours aux cinq académies, manuscrit autographe, 25 septembre 1946.<br />
Clau<strong>de</strong> Farrère est, <strong>de</strong> tous les écrivains intéressés par l’extrême Orient, un <strong>de</strong>s seuls à prendre le contrepied <strong>de</strong>s<br />
Segalen, Clau<strong>de</strong>l et autres Saint-John Perse. Pour lui, « la Chine, cela n’existe pas ; cela n’a jamais existé. »<br />
Dans un article du 1 er mai 1938 intitulé « Voyage en Chine », il précisait : « Quatre cent cinquante millions <strong>de</strong><br />
Chinois qui, presque tous, sont les plus admirables <strong>de</strong>s hommes, les plus patients, les plus tenaces, les plus laborieux,<br />
les plus ingénieux… Ils n’ont jamais formé une nation que sous le joug écrasant d’empereurs étrangers,<br />
envahisseurs et farouches. Les Ta Tsinn étaient mandchous, les Youen étaient Mongols, les Ts’rinn étaient<br />
Turcs. Entre ces dynasties terribles, qui ont forgé un cadre et une armature à l’empire, quelques dynasties chinoises<br />
se sont insinuées, ont végété, puis sombré dans l’anarchie… » Un certain Richard Chevreuil répond à<br />
l’écrivain quelques mois plus tard et l’accuse d’être aveuglé par la double admiration qu’il porte à Tsiang Kaï<br />
Chek et au Japon : son analyse <strong>de</strong>s événements <strong>de</strong> Changhaï, en particulier, est erronée : « Les Changhaïens,<br />
d’après M. Farrère, n’auraient été sauvés du massacre que par l’héroïque défense japonaise. »<br />
Le présent manuscrit est un peu plus tardif (1946). Clau<strong>de</strong> Farrère est invité à prononcer un discours sur la littérature<br />
<strong>de</strong>s voyages, et plus particulièrement sur les marins écrivains. Au détour d’une analyse <strong>de</strong>s raisons qui<br />
poussent les voyageurs à écrire, Clau<strong>de</strong> Farrère fait la triste constatation d’une uniformisation <strong>de</strong>s goûts et <strong>de</strong>s<br />
mo<strong>de</strong>s, laquelle atteint même Pékin et Lhassa. L’ennemi, on l’aura compris, est à chercher plus à l’ouest. La<br />
culture extrême orientale, pour Farrère, qu’elle vienne <strong>de</strong> Chine ou du Japon, a l’avantage <strong>de</strong> ne rien imposer,<br />
contrairement au modèle américain.<br />
57. Voltaire, Candi<strong>de</strong> [traduction chinoise], Pékin, mars 2000, Institut et Musée Voltaire,<br />
<strong>Genève</strong>.<br />
58. Voltaire, Le Siècle <strong>de</strong> Louis XIV [traduction chinoise], Pékin, 1991, Institut et Musée<br />
Voltaire, <strong>Genève</strong>.<br />
59. Voltaire, Lettres philosophiques [traduction chinoise], septembre 2002, Shanghai, Institut<br />
et Musée Voltaire, <strong>Genève</strong>.<br />
60. Voltaire, Essai sur les mœurs et l’esprit <strong>de</strong>s nations [traduction chinoise], 3 volumes,<br />
Pékin, 2000, Institut et Musée Voltaire, <strong>Genève</strong>.<br />
61. Voltaire, Dictionnaire philosophique [traduction chinoise], 2 volumes, 2000, Institut et<br />
Musée Voltaire, <strong>Genève</strong>.<br />
12