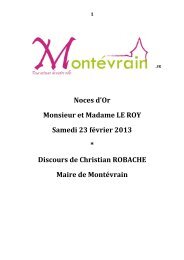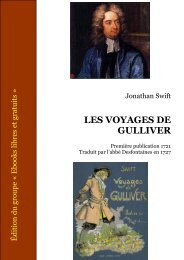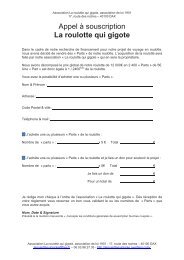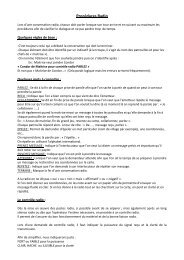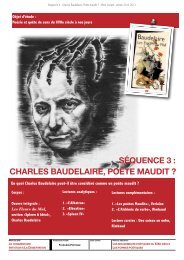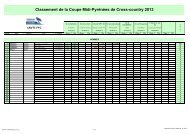La ville dans La mémoire tatouée de Abdelkébir Khatibi : l ...
La ville dans La mémoire tatouée de Abdelkébir Khatibi : l ...
La ville dans La mémoire tatouée de Abdelkébir Khatibi : l ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>La</strong> <strong>ville</strong> <strong>dans</strong> <strong>La</strong> <strong>mémoire</strong> <strong>tatouée</strong> <strong>de</strong> Ab<strong>de</strong>lkébir <strong>Khatibi</strong> :<br />
l’organisation subjective d’un site historique<br />
Les constructions spatiales <strong>dans</strong> l'œuvre <strong>de</strong> Ab<strong>de</strong>lkébir <strong>Khatibi</strong> se<br />
caractérisent, au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> leur abondance, par leur complexité. L'objet <strong>de</strong> ce travail est<br />
d'analyser un type <strong>de</strong> topologie bien précis. Il s'agit <strong>de</strong> l'espace <strong>de</strong> la <strong>ville</strong> <strong>dans</strong> <strong>La</strong><br />
<strong>mémoire</strong> <strong>tatouée</strong>. Pour mieux cerner notre propos, il est important <strong>de</strong> signaler que les<br />
constructions spatiales <strong>dans</strong> les textes <strong>de</strong> <strong>Khatibi</strong> dérogent au principe <strong>de</strong><br />
représentativité tel qu'il est défini par les réalistes. C'est dire que l'espace n'est plus ce<br />
lieu privilégié où l'auteur développe la psychologie <strong>de</strong> ses personnages. Autrement<br />
dit, le poétique qui détermine la facture du récit réfute toute construction objective<br />
<strong>de</strong>s topologies. C'est pour cette raison que nous avons choisi <strong>de</strong> parler non pas <strong>de</strong><br />
spatialité mais d'effectuation spatiale telle qu'elle est conçue par Denis Bertrand.<br />
Celui-ci écrit :<br />
il nous faudrait dès lors distinguer la spatialité et l'aspectualité spatiale<br />
comme <strong>de</strong>ux régions différentes produisant <strong>de</strong>ux types d'effets <strong>de</strong> sens : le premier<br />
lié à la mise en place <strong>de</strong>s catégories organisatrices <strong>de</strong> l'espace et en disposant les<br />
repères, et l'autre envisageant la spatialité sous l'angle du procès d'effectuation<br />
spatiale par un actant observateur situé ( Bertrand, 1985 : 93 )<br />
Dans la <strong>mémoire</strong> <strong>tatouée</strong> il n'est pas question d'une <strong>de</strong>scription d'un lieu<br />
extérieur focalisé, mais d'un narrateur qui livre ses compétences cognitives et qui<br />
nous permet <strong>de</strong> saisir indirectement les espaces dont il est question. En effet, il nous<br />
donne tous les éléments sur sa situation engendrée par la remémoration <strong>de</strong>s lieux.<br />
C'est dire que " l'isotopie axiologique " se développe à partir du narrateur. Dans le
cas <strong>de</strong> l'espace urbain, elle se rapporte au sème <strong>de</strong> la négativité. Cette situation<br />
dysphorique qui prend plusieurs dimensions, reflète un tiraillement entre <strong>de</strong>ux<br />
espaces qui se développent <strong>dans</strong> un rapport antinomique. L'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la spatialité n'est<br />
donc pas envisageable sans une prise en considération <strong>de</strong> la situation du sujet. C'est<br />
ce que Bertrand appelle " le mo<strong>de</strong> perceptif <strong>de</strong> la construction spatiale ". Une<br />
dialectique s'instaure entre les différentes dispositions <strong>de</strong>s espaces et la position du<br />
sujet observateur.<br />
De ce fait, c'est " l'aspectualité spatiale " qui permet <strong>de</strong> dégager les<br />
connexions entre le sujet et l'espace qui sont le propre <strong>de</strong> notre analyse. Si la<br />
disposition topologique renvoie à la position d'un sujet observateur, celui-ci, par un<br />
effet inverse, laisse apparaître, à travers une panoplie <strong>de</strong> stratégies <strong>de</strong> focalisation, la<br />
construction <strong>de</strong>s espaces. Pour ce faire, Bertrand s'appuie sur l'ensemble <strong>de</strong>s " mo<strong>de</strong>s<br />
sensoriels " pour établir " les parcours figuratifs <strong>de</strong> l'espace ".<br />
Dans la <strong>mémoire</strong> <strong>tatouée</strong>, les lieux se <strong>de</strong>ssinent comme <strong>de</strong>s souvenirs qui<br />
hantent la <strong>mémoire</strong> du narrateur. L'espace est absent-présent. Absent <strong>dans</strong> la mesure<br />
où le récit s'envole <strong>dans</strong> une verve poétique qui dissout toute référentialité directe au<br />
mon<strong>de</strong>. Présent <strong>dans</strong> ce sens où la <strong>mémoire</strong> est structurée spatialement. Elle se donne<br />
à lire en terme <strong>de</strong> spatialité. C'est dire que l'espace extérieur ne se réduit plus à un<br />
simple encadrement <strong>de</strong> l'œuvre où se déroulent les actions <strong>de</strong>s personnages comme<br />
c'était le cas chez les réalistes. L'espace <strong>dans</strong> la <strong>mémoire</strong> <strong>tatouée</strong> accè<strong>de</strong> au statut <strong>de</strong><br />
langage. Son immersion ne peut advenir que comme un jeu <strong>de</strong> paraboles. Le regard<br />
du narrateur qui envahit le texte détient tous les pouvoirs et ne livre l'espace que par<br />
fragments successifs. Le lyrisme du récit naît à partir d'un choc entre <strong>de</strong>ux espaces.<br />
D'une part, un espace mythique : celui <strong>de</strong> la permanence et <strong>de</strong> l'enfance innocente.<br />
D'autre part, celui <strong>de</strong> l'histoire et <strong>de</strong> l'idéologie. Cette rencontre permet l'émergence<br />
d'un espace autre, à venir, et qui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à se constituer en termes <strong>de</strong> non-lieu et<br />
d'images. Et comme dit justement Jean-Yves Tadié :<br />
L'image n'est plus au service <strong>de</strong> la <strong>de</strong>scription d'un espace supposé<br />
préexistant (comme <strong>dans</strong> le roman réaliste, il nous est <strong>de</strong>mandé <strong>de</strong> croire à<br />
l'antériorité <strong>de</strong> la pension Vauquer sur sa <strong>de</strong>scription ) ; elle perturbe et<br />
métamorphose la représentation initiale ( Tadié, 1978 : pp. 52-53 )
Comment se construit cet espace historique ( la <strong>ville</strong> ) ? Quel est son mo<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
fonctionnement ?<br />
1- Compétences cognitives et effectuation spatiale<br />
Notre analyse va porter sur le chapitre qui s'intitule " Deux <strong>ville</strong>s parallèles ".<br />
Les espaces sont désignés onomastiquement : El Jadida et Essaouira. Dès l'entrée du<br />
texte, le lecteur est installé <strong>dans</strong> l'espace <strong>de</strong> la <strong>mémoire</strong>. Ce <strong>de</strong>rnier est structuré par<br />
une double dimension temporelle. D'une part, un temps historique et d'autre part, un<br />
temps mythique. Cette interférence du temps mental ( narration ) et du temps social<br />
( événements ), renvoie à une autre dualité au niveau <strong>de</strong> l'espace. En effet, par un<br />
processus <strong>de</strong> remémoration, le narrateur relate quelques fragments <strong>de</strong> son enfance<br />
qui sont entrecoupés <strong>de</strong> temps à autre par <strong>de</strong>s moments d'arrêt où il délègue la parole<br />
à l'auteur pour livrer ses réflexions philosophiques.<br />
Dans la partie consacrée à El Jadida, le texte est organisé autour d'un jeu <strong>de</strong>s<br />
temps verbaux. L'imparfait, temps mental, et qui joue ici une fonction<br />
<strong>de</strong>scriptive ( Weinrich ), s'interfère avec le présent et l'impératif, temps du<br />
commentaire, qui eux, introduisent les interventions <strong>de</strong> l'auteur.<br />
Ce regard appelle la renaissance d'un espace. Par le jeu <strong>de</strong> la dissimulation,<br />
le souvenir métamorphose la <strong>ville</strong> <strong>de</strong> notre passé en une nostalgie blanche ; les<br />
chemins partent et aboutissent au même noeud, les quartiers se renvoient les uns aux<br />
autres <strong>dans</strong> un puzzle <strong>de</strong> formes, <strong>de</strong> surfaces et <strong>de</strong> couleurs. ( <strong>Khatibi</strong>, 1971 : 46 )<br />
Si cette interpénétration <strong>de</strong>s temps joue un rôle primordial <strong>dans</strong> la <strong>de</strong>struction<br />
du système du récit tel qu'il est conçu par le roman réaliste, elle nous permet <strong>dans</strong><br />
notre optique d'analyse <strong>de</strong> voir comment se trace l'itinéraire du regard du sujet<br />
implicite qui détermine l'émergence <strong>de</strong> l'espace. El Jadida bifurque en <strong>de</strong>ux espaces<br />
s'opposant l'un à l'autre. Seules les différentes focalisations du regard déterminent les<br />
formations spatiales qui, à leur tour, <strong>dans</strong> une lecture à rebours, nous renseignent sur<br />
les présupposés du discours <strong>de</strong> cet observateur. Pour reconstituer ces espaces qui se<br />
<strong>de</strong>ssinent en creux, le recours à la <strong>mémoire</strong>, qui est un facteur <strong>de</strong> taille <strong>de</strong> la
localisation, est nécessaire. <strong>La</strong> <strong>ville</strong> d'El Jadida se <strong>de</strong>ssine d'abord à travers le<br />
souvenir du coiffeur. Celui-ci est doté d'un savoir-faire : c'est un collectionneur <strong>de</strong><br />
prépuces et <strong>de</strong> mèches.<br />
Le coiffeur collectionnait prépuces et mèches, opération proche par l'office,<br />
mais horriblement dissemblable par la bifurcation. J'en connaissais – <strong>de</strong>s coiffeurs à<br />
la main caressante – qui nous coupaient les cheveux, accompagnés par le gazouillis<br />
<strong>de</strong>s canaris, gazouillis ajouté à la rumeur publique, toujours sableuse, impossible à<br />
détecter; petit, je récoltais, à tout hasard, du sang sur une partie <strong>de</strong> mon crâne.<br />
(<strong>Khatibi</strong>, 1971 : 47 )<br />
<strong>La</strong> relation <strong>de</strong> cet événement n'a <strong>de</strong> sens ici que <strong>dans</strong> la mesure où elle<br />
signifie une culture et l'appartenance à un génération bien précise. Au niveau narratif,<br />
elle se donne à lire en tant que prétexte pour introduire la <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> la <strong>ville</strong>. Cet<br />
embrayage prend la forme d'un saut qui rappelle les stratégies <strong>de</strong>s contes populaires :<br />
Autre est la faveur <strong>de</strong> se promener en <strong>ville</strong>. Quelques calèches assoupies,<br />
<strong>de</strong>s chevaux si maigres qu'on se <strong>de</strong>man<strong>de</strong> s'ils vont finir la journée. Le conducteur<br />
fait semblant <strong>de</strong> frapper, claque <strong>de</strong>s <strong>de</strong>nts, hurle sur place; le fouet qui cingle sur lui-<br />
même retombe, invariablement, sur notre tête, nous les assis. ( <strong>Khatibi</strong>, 1971 : 48 ).<br />
A partir <strong>de</strong> quels points nodaux est constitué cet espace <strong>de</strong> la <strong>ville</strong> ? Et<br />
comment nous permet-il <strong>de</strong> saisir les savoirs <strong>de</strong> l'observateur qui déterminent ses<br />
différentes dispositions ?<br />
D'emblée, il est à noter que l'ensemble du texte obéit à une structuration<br />
syntaxique basée sur les différents faires qui sont donc à analyser à travers cette<br />
panoplie <strong>de</strong> gestes et <strong>de</strong> positions <strong>de</strong>s sujets. Plus importante encore est l'implication<br />
du regard et <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s sensoriels <strong>dans</strong> la constitution <strong>de</strong>s espaces. <strong>La</strong> <strong>de</strong>scription <strong>de</strong><br />
la <strong>ville</strong> obéit aux différents positionnements du regard qui est tantôt implicite, tantôt<br />
explicite.<br />
Dans un premier temps, c'est le conducteur qui est focalisé à travers son faire.<br />
Le narrateur s'efface pour laisser la place au conducteur <strong>de</strong> chevaux dont les
compétences paradoxales se rapportent à <strong>de</strong>s actions (frapper, claquer, hurler,<br />
fouetter, ... ) et à <strong>de</strong>s sentiments ( tendresse ). Celui-ci est suppléé à son tour par les<br />
chevaux qui sont caractérisés par <strong>de</strong>s compétences humaines. Leurs pouvoirs faire,<br />
leurs actions et leurs observations les promeuvent au sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'humain.<br />
les chevaux font <strong>de</strong>s grèves tournantes, prétextent <strong>de</strong>s maux <strong>de</strong> cerveau<br />
effroyables en plus <strong>de</strong>s pipis kilométriques qui traversent la <strong>ville</strong>; la route est droite,<br />
les piétons d'ici connaissent parfaitement les détours, les fantaisies, l'horaire <strong>de</strong> la<br />
belle couleur, et enfin tout. ( <strong>Khatibi</strong>, 1971 : 48)<br />
Il en ressort que les chevaux et les hommes sont dotés d'un savoir et d'une<br />
intelligence qui leur permettent <strong>de</strong> se livrer à un jeu qui les place sur le même plan<br />
d'égalité. D'ailleurs, l'i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s faires est telle que l'homme et le cheval ne<br />
font plus qu'un.<br />
A croire, à la fin, que les chevaux mettent en action tout ce qui leur passe<br />
par la tête, et peut-être <strong>de</strong>venu plus cheval que les chevaux, le conducteur ne<br />
contrôle plus la situation. ( <strong>Khatibi</strong>, 1971 : 48)<br />
A ces différents faires s'ajoutent d'autres compétences d'ordre sensoriel. Il<br />
s'agit du goût : " Les chevaux goûtent, naturellement, la fraîcheur <strong>de</strong> la couleur,<br />
herbes vertes, figues mauves ... ".<br />
Au-<strong>de</strong>là d'une simple <strong>de</strong>scription objective, ce que nous donne à lire cette<br />
panoplie <strong>de</strong> faires, c'est la constitution d'un espace et sa signification. <strong>La</strong> <strong>ville</strong> d'El<br />
Jadida n'est pas présentée en tant qu'espace géométrique mais plutôt, comme une<br />
accumulation <strong>de</strong> fragments définis par un regard implicite qui délègue ses<br />
compétences à d'autres sujets, en l'occurrence, le conducteur et les chevaux. Cette<br />
procédure <strong>de</strong> délégation et d'alternance n'exclut pas les retours du narrateur<br />
enfant/adulte. C'est dire que finalement, la <strong>de</strong>scription du conducteur et <strong>de</strong>s chevaux<br />
est loin <strong>de</strong> se réduire à un simple décor anodin. D'une part elle dissimule à travers le<br />
lyrisme du récit, un espace qui ne peut advenir que sous forme d'images. D'autre part,<br />
elle sert <strong>de</strong> support à <strong>de</strong>s spéculations philosophiques. Dans ce sens, la notion <strong>de</strong><br />
point <strong>de</strong> vue est très fonctionnelle <strong>dans</strong> la localisation. L'actant implicite <strong>de</strong>ssine <strong>de</strong>s
espaces absents par délégation, tout en livrant <strong>de</strong>s réflexions par ses retours<br />
successifs qui ponctuent le texte. L'exemple <strong>de</strong> la mouche est très révélateur. Elle<br />
joue le rôle d'un vecteur <strong>de</strong> mouvement en excitant le cheval à faire le tour <strong>de</strong> la<br />
<strong>ville</strong>, mais surtout elle permet le retour <strong>de</strong> l'auteur <strong>dans</strong> la narration.<br />
Pour exciter le cheval, il faut exciter la mouche ; pour exciter la mouche, il<br />
faut exciter toutes les autres mouches, cercle vicieux comme hypothèse universelle,<br />
que l'humanité n'a jamais transgressée. Alors pourquoi les hypothèses sur les<br />
mouches sous les mouches, pourquoi ? ( <strong>Khatibi</strong>, 1971 : 50)<br />
Il est à signaler que le passage <strong>de</strong> la <strong>de</strong>scription au commentaire est corroboré<br />
par l'usage <strong>de</strong>s temps verbaux. On passe du temps <strong>de</strong> la <strong>de</strong>scription ( imparfait ) aux<br />
temps <strong>de</strong> discours ( présent ou impératif ). En restant toujours <strong>dans</strong> le cadre <strong>de</strong> cette<br />
<strong>de</strong>scription, une harmonie très significative se dégage au niveau lexical. Les<br />
compétences <strong>de</strong>s sujets soulignées antérieurement se rapportent toutes à un pouvoir<br />
faire négatif. <strong>La</strong> récurrence du sème <strong>de</strong> la violence qui caractérise les différents faires<br />
nous autorise à qualifier cet espace <strong>de</strong> la <strong>ville</strong> <strong>de</strong> dysphorique. Par ailleurs la<br />
catégorie sémique <strong>de</strong> la directionnalité constituée par cette promena<strong>de</strong> en <strong>ville</strong>, prend<br />
la forme d'une dimension circulaire.<br />
De ce fait, il est intéressant <strong>de</strong> voir la signification <strong>de</strong> cette localisation<br />
négative. <strong>La</strong> constitution <strong>de</strong> l'espace <strong>de</strong> la <strong>ville</strong> n'est possible qu'à partir d'un<br />
ensemble <strong>de</strong> faits cognitifs que le lecteur actif doit détecter. L'absence <strong>de</strong> l'espace qui<br />
se réduit à <strong>de</strong>s images ne peut donc émerger qu'à partir du sujet - ici le narrateur - qui<br />
met en place <strong>de</strong>s principes <strong>de</strong> substitution - le faire, le goût, l'olfactif, ... - qui sont<br />
spatialisés. Autrement dit, à travers l'absence <strong>de</strong> l'espace effacé par un lyrisme<br />
poétique, le regard implicite récuse la présence du sens unique. L'introduction <strong>de</strong>s<br />
réflexions du narrateur <strong>dans</strong> le récit prend la forme d'une critique où le<br />
philosophique et le poétique ne font qu'un. Le processus <strong>de</strong> négativisation <strong>de</strong> l'espace<br />
<strong>de</strong> la <strong>ville</strong> s'oppose au discours idéologique qui, lui, définit son espace et impose un<br />
sens univoque. C'est dire que la <strong>ville</strong> est le lieu du pouvoir et <strong>de</strong> l'histoire. Ceci se<br />
confirme <strong>dans</strong> l'ensemble <strong>de</strong>s œuvres <strong>de</strong> <strong>Khatibi</strong> et notamment le Livre du sang et<br />
son <strong>de</strong>rnier roman triptyque <strong>de</strong> Rabat. A l'intérieur <strong>de</strong> cet univers se construit un<br />
autre espace qui subit d'ailleurs le même traitement.
2- L'espace <strong>de</strong> la perte : déchirure <strong>de</strong> la <strong>mémoire</strong>.<br />
A présent, nous avons vu que la <strong>ville</strong> est l'espace du discours<br />
idéologique, <strong>de</strong> l'histoire et du sens. Si le poétique prési<strong>de</strong> à son effacement et à la<br />
dilapidation du sens, une autre question surgit à l'avant-scène historique. Il s'agit <strong>de</strong><br />
la colonisation dont la violence a marqué le narrateur. L'univers du colon fait partie<br />
<strong>de</strong> cet espace <strong>de</strong> la <strong>ville</strong>. Voyons comment il se définit à travers la perception et la<br />
situation du narrateur.<br />
<strong>La</strong> <strong>de</strong>scription du parc Spiney est déléguée à un sujet neutre " on " qui institue<br />
la parole comme étant une vérité. Ceci est accentué par la référence à la phrase<br />
cartésienne :<br />
Si chacun est bien chez soi et Dieu bien partout, on pouvait <strong>de</strong> ma maison<br />
rejoindre rapi<strong>de</strong>ment le parc Spiney, arrangé – m’a-ton dit– selon la phrase<br />
cartésienne,claire comme la clarté et pure comme la pureté, balancé selon la<br />
métrique <strong>de</strong> l'ordre militaire, <strong>de</strong> l'agréable excitant, du Beau, du Vrai et peut-être<br />
même d'autres choses. ( <strong>Khatibi</strong>, 1971 : 52-53 )<br />
<strong>La</strong> <strong>de</strong>scription du parc se donne à lire par le biais d'une rhétorique. Ainsi la<br />
multiplication <strong>de</strong>s redondances et l'usage <strong>de</strong>s correspondances donnent une<br />
amplification à l'idée que le narrateur implicite veut donner <strong>de</strong> cet espace. Le<br />
poétique permet ainsi <strong>de</strong> combler ce vi<strong>de</strong> créé par l'absence d'une réalité référentielle.<br />
L'accentuation <strong>de</strong> la valeur <strong>de</strong> ce lieu élevé au <strong>de</strong>gré d'un langage abstrait, se fait par<br />
opposition à un autre espace plastique et artificiel. Il s'agit <strong>de</strong> l'espace <strong>de</strong>s arabes<br />
( marocains ).<br />
Et quoi ! les Arabes aiment regar<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s roses en papier, ou en plastique, la<br />
nature leur a échappé d’entre les doigts, ils croupissent, grisés par l’absinthe. Et pour<br />
cacher leur misère, ils forniquent toute la journée.Il faut créer <strong>de</strong>s jardins rationnels,<br />
<strong>de</strong>s <strong>ville</strong>s géométriques, une économie en flèche, il faut créer <strong>de</strong>s paradis sur terre,<br />
Dieu est mort, vive le colon. » Voici la parole du colon <strong>de</strong>ssinant la <strong>ville</strong> comme une<br />
carte militaire. ( <strong>Khatibi</strong>, 1971 :. 53 )
Ce qui nous intéresse ici, c'est l'actant observateur qui, par son absence,<br />
délègue la parole au colon lui-même pour décrire son espace. L'emploi d'un discours<br />
indirect libre atteste pourtant <strong>de</strong> la présence d'un ton ironique qui se <strong>de</strong>ssine à l'ombre<br />
<strong>de</strong> cette parole. C'est le regard qui produit un renversement <strong>de</strong> valeurs <strong>dans</strong> la mesure<br />
où l'opposition <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux espaces ( positif/négatif ) poussée à l'extrême permet une<br />
transformation paradoxale <strong>de</strong> la négativité en positivité et vice-versa. En effet, c'est<br />
la clarté même <strong>de</strong> cet espace " sacré du conquérant " qui le rend étrange. Lieu <strong>de</strong> la<br />
perte et <strong>de</strong> la mort.<br />
Voici le Parc, voici un petit musée <strong>de</strong> fleurs et <strong>de</strong> plantes, dont les parfums<br />
se per<strong>de</strong>nt <strong>dans</strong> la géométrie maniaque. Traînez vos pieds, reposez vos fesses, puis<br />
regar<strong>de</strong>z au travers, en travers, <strong>de</strong><strong>dans</strong> et par <strong>de</strong>là. Sachez que le Parc est une<br />
douceur qui habitue à la tombe. Voici, mon lecteur, la fraîcheur <strong>de</strong> l'esprit cartésien<br />
qui se morfond sous l'ombre <strong>de</strong>s arbres, et voici la vierge intouchable . ( khatibi,<br />
1971 :. 53)<br />
Le renversement que nous avons signalé et donc la négativisation <strong>de</strong> l'espace<br />
du colon, se fait <strong>dans</strong> une amplification rhétorique qui confirme la présence d'un<br />
sujet implicite qui tient les fils <strong>de</strong> la narration. L'usage <strong>de</strong> l'énumération, <strong>de</strong> la<br />
répétition et <strong>de</strong> la redondance, accentue le changement du registre sémantique. Ceci<br />
est corroboré par le jeu <strong>de</strong>s temps verbaux et en particulier l'emploi du temps infini<br />
du commentaire : l'impératif qui introduit le lecteur <strong>dans</strong> la trame narrative.<br />
En fait, à travers ces renversements <strong>de</strong> situation et ces oppositions d'espaces,<br />
ce sont <strong>de</strong>ux regards qui se confrontent. Celui du colonisateur sur l'espace autochtone<br />
et celui du narrateur sur l'espace du conquérant. A partir <strong>de</strong> cette dichotomie, c'est<br />
finalement une problématique i<strong>de</strong>ntitaire qui se pose. Ceci est d’autant plus pertinent<br />
que la question <strong>de</strong> l'i<strong>de</strong>ntité et <strong>de</strong> la différence tient une place fondamentale <strong>dans</strong> les<br />
écrits <strong>de</strong> <strong>Khatibi</strong>.<br />
Pour le moment, suivons le regard <strong>dans</strong> la structuration <strong>de</strong>s espaces. Le<br />
passage à l'imparfait marque le retour du " je " <strong>de</strong> la narration. " Je jouais parfois<br />
avec <strong>de</strong>s copains <strong>dans</strong> ce lieu ... " p.54. Le regard est cette fois-ci explicite. Par son<br />
pouvoir-faire, et son pouvoir-voir, le narrateur nous parle à partir d'un espace décrit
en termes d'activités répétitives qui, en instaurant un temps circulaire, font <strong>de</strong> ce lieu<br />
un univers <strong>de</strong> perte.<br />
Je me retrouvais, perdu <strong>dans</strong> ce montage d'images baroques, défilant <strong>dans</strong><br />
le désordre d'un enfant colonisé.( <strong>Khatibi</strong>, 1971 :. 54)<br />
C'est <strong>dans</strong> cette zone interdite que l'imagination coloniale se donne à lire <strong>dans</strong><br />
les découpages et les séparations géographiques, ethniques et culturels. <strong>La</strong> <strong>ville</strong> est le<br />
lieu <strong>de</strong> l'errance et du dépaysement. C'est l'espace brisé <strong>de</strong> l'histoire du peuple à qui<br />
on a confisqué sa <strong>mémoire</strong>.<br />
Il est à noter que, <strong>dans</strong> l'espace <strong>de</strong> la <strong>ville</strong>, la <strong>mémoire</strong> et le sens ne sont livrés<br />
qu'à travers un langage poétique qui comble ce vi<strong>de</strong> crée par l'absence d'une réalité<br />
référentielle. Cet effacement marque un écart vis-à-vis du discours du pouvoir et du<br />
colon qui font <strong>de</strong> la <strong>ville</strong> leur lieu <strong>de</strong> légitimation par l'instauration d'un sens et d'une<br />
spatialité géométrique.<br />
Par ailleurs, cette absence reflète le rejet aussi bien d'une réalité aveugle qui<br />
se replie sur un sens univoque que d'une altérité sauvage qui ignore la <strong>mémoire</strong> du<br />
peuple. Face à cet espace clos, étouffant et circulaire, la seule échappatoire possible<br />
rési<strong>de</strong> <strong>dans</strong> le refuge <strong>dans</strong> l'espace <strong>de</strong> la médina qui, par sa résistance sauve la<br />
<strong>mémoire</strong> du peuple en exaspérant l'errance <strong>de</strong> l'autre.<br />
3- Le lieu <strong>de</strong> l'histoire fissurée<br />
Dans l'espace dysphorique <strong>de</strong> la <strong>ville</strong>, il y a un lieu qui échappe à la<br />
violence <strong>de</strong> l'autre. C'est la médina qui se présente par ses dédales où s'égare<br />
l'étranger. <strong>La</strong> constitution <strong>de</strong> cet espace est déterminée par les mythes et les légen<strong>de</strong>s<br />
qui le structurent. Le narrateur cite à titre d'exemple les jnouns et la légen<strong>de</strong> <strong>de</strong> Aïcha<br />
Kendicha qui habitent la <strong>mémoire</strong> collective. Le nom <strong>de</strong> cette ogresse légendaire<br />
renvoie aussi bien au mythe archaïque qu'à la mère du narrateur. Ceci est loin d'être<br />
gratuit, car la médina est le lieu <strong>de</strong> la femme qui protège, qui rassure et qui préserve<br />
l'i<strong>de</strong>ntité. D'ailleurs, la présence <strong>de</strong> l'élément aquatique <strong>dans</strong> ce paragraphe renforce<br />
cette chaleur apaisante qui caractérise cet espace. Outre cette dimension protectrice,
l'univers féminin est le lieu du fantastique et <strong>de</strong> l'inconscient. Ce retour <strong>de</strong> la mère<br />
qui prend la parole introduit une révolte contre l'hégémonie patriarcale.<br />
Aïcha est le nom même <strong>de</strong> ma mère et nos femmes bro<strong>de</strong>nt à loisir sur le<br />
fantastique pour dire non à la religion <strong>de</strong>s hommes (...). Quand elles te disent :<br />
l'inconscient est maternel, réponds : je suis patriarche et ordonne le système.<br />
( <strong>Khatibi</strong>, 1971 : 55)<br />
A partir <strong>de</strong> la figure maternelle qui accè<strong>de</strong> au pouvoir au niveau <strong>de</strong> l'écriture,<br />
c'est une dualité spatiale qui se <strong>de</strong>ssine. Celle <strong>de</strong> l'espace maternel ( la médina ) et <strong>de</strong><br />
l'espace idéologique ( la <strong>ville</strong> ). Le premier, constitué <strong>de</strong> la <strong>mémoire</strong> collective, <strong>de</strong><br />
l'histoire polyphonique, <strong>de</strong> l'enfance ..., s'oppose au second qui impose un espace<br />
géographique et un sens unique.<br />
Ainsi, les figures spatiales se constituent à partir <strong>de</strong> divers points <strong>de</strong><br />
focalisation du narrateur. En l'absence <strong>de</strong> tout espace construit géométriquement, le<br />
lecteur doit définir à travers <strong>de</strong>s images, <strong>de</strong>s formes et <strong>de</strong>s paraboles, les lieux qui se<br />
<strong>de</strong>ssinent <strong>dans</strong> le creuset <strong>de</strong> la narration. Face à l'impossibilité d'une autobiographie<br />
anecdotique et à la faillite <strong>de</strong> la <strong>mémoire</strong>, ce sont <strong>de</strong>s fragments d'espaces qui nous<br />
sont donnés à lire. Dans le cas <strong>de</strong> la <strong>mémoire</strong> <strong>tatouée</strong>, ils sont constitués à partir d'un<br />
regard implicite qui tisse une dynamique <strong>de</strong> combinaisons permettant aux différents<br />
sujets <strong>de</strong> se relayer la parole. Ainsi le lecteur est informé <strong>de</strong>s programmes<br />
pragmatiques qui déterminent les paramètres <strong>de</strong>s localisations. Et comme le texte<br />
khatibien est d'une facture poétique, d'autres principes <strong>de</strong> substitution à la vision sont<br />
à envisager. C'est le cas du faire olfactif, du goût, du contact, <strong>de</strong>s métaphores, ...etc.<br />
Par ailleurs, notons que l'espace patriarcal est déterminé par le regard <strong>de</strong><br />
l'enfant. Autrement dit, il ne peut exister qu'à partir d'un point <strong>de</strong> repère, en<br />
l'occurrence l'espace <strong>de</strong> l'enfance, <strong>de</strong> la mère et <strong>de</strong> la <strong>mémoire</strong>.<br />
<strong>La</strong> <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> la <strong>ville</strong> d'Essaouira confirme, si besoin est, cet attachement<br />
à l'espace enfantin. Espace maternel, Essaouira jouit d'un passé mythique. Dans le<br />
premier paragraphe, le narrateur décrit cette <strong>ville</strong> écrasée par les portugais. L'espace<br />
vécu n'est pas ici celui d'une référentialité, mais d'un désir. Sa formulation s'appuie<br />
sur l'usage <strong>de</strong>s métaphores et <strong>de</strong>s paraboles. Ceci exige l'implication du lecteur afin<br />
<strong>de</strong> combler les vi<strong>de</strong>s et les failles engendrées par cette absence.
Il faut un regard pâle et malicieux pour éviter les grains <strong>de</strong> sable, qui<br />
attaquent quand on tourne la tête, et s'envolent gentiment, <strong>dans</strong> tous les sens . (<br />
<strong>Khatibi</strong>, 1971 : 56 )<br />
Essaouira est décrite en termes humains renvoyant au registre <strong>de</strong> la tendresse,<br />
mais également à sa soumission au pouvoir du conquérant. Ceci est confirmé par<br />
l'usage d'un lexique d'adéquation : " se laisse coiffer ", fugue, s'excuser,…etc. A<br />
l'effacement <strong>de</strong>s hommes s'ajoute celui <strong>de</strong> l'élément aquatique :<br />
Pas même les vagues, car elles se bousculent, comme pour s'excuser, elles<br />
contournent au loin un îlot, prison <strong>de</strong><strong>dans</strong>, près du port, l'empire portugais avec la<br />
marque massive <strong>de</strong> ses forteresses, gran<strong>de</strong>ur poussive <strong>de</strong> ceux qui croyaient<br />
enchaîner les hommes à la pierre . ( <strong>Khatibi</strong>, 1971 : 56)<br />
Ecrasée par les portugais, piratée ( costaud ), sacrifiée à coups <strong>de</strong> dollars,<br />
cette <strong>ville</strong> résiste au drame <strong>de</strong> son histoire. Elle <strong>de</strong>meure désespérément tendre. C'est<br />
pour dire combien l'attachement <strong>de</strong> l'enfant à cet espace est grand et profond. C'est le<br />
lieu du cri premier.<br />
Coquille entourée <strong>de</strong> sable, cette <strong>ville</strong> s'ébauche en une<br />
miniature aux couleurs tendres, et je tais d'autres vibrations : la<br />
surprise du soleil, la <strong>ville</strong> se recroquevillant et le parfum d'argan, lieu<br />
commun du sud marocain et impression douceâtre d'un vol continu .<br />
( <strong>Khatibi</strong>, 1971 : 57 )<br />
Il en ressort que la formulation spatiale est encore une fois définie à partir<br />
d'un principe <strong>de</strong> substitution. Au pouvoir voir <strong>de</strong> l'actant implicite se succè<strong>de</strong>nt un<br />
pouvoir sentir et un faire olfactif qui sont spatialisés. En effet, le parfum d'argan<br />
renvoie à un espace ( sud marocain ) qui comme le mellah, se <strong>de</strong>ssine à travers ses<br />
o<strong>de</strong>urs. Il est à noter que la <strong>de</strong>scription obéit ici à une progression programmée par<br />
un regard poétique qui consiste à passer <strong>de</strong> l'espace <strong>de</strong> la <strong>ville</strong> à l'espace <strong>de</strong> l'enfance.<br />
Ce passage est assuré par le faire olfactif.
Le mellah n'est pas loin, d'autres o<strong>de</strong>urs, un autre dialecte légèrement<br />
chantant qui me faisait pouffer. ( <strong>Khatibi</strong>, 1971 : 57 )<br />
Essaouira, " tendre et mignonne ", est le lieu <strong>de</strong>s femmes protectrices et<br />
nourrissantes. Par la récupération <strong>de</strong> cet espace chaleureux et flui<strong>de</strong>, le narrateur<br />
procè<strong>de</strong> à la réappropriation d'un lieu qui échappe aux contraintes et aux agressions<br />
du <strong>de</strong>hors. Face à la violence <strong>de</strong> l'espace historique, le seul remè<strong>de</strong> est le retour à<br />
l'espace mythique.<br />
Le poétique joue ici un rôle <strong>de</strong> médiateur entre <strong>de</strong>ux contrées qui s'opposent.<br />
De la rencontre d'un espace historique, idéologique et d'un espace mythique et<br />
maternel, naît un choc. Ceci traduit le passage <strong>de</strong> l'enfant d'un lieu protecteur à un<br />
lieu agressif. Dans ce sens, on peut dire que la poésie se nourrit <strong>de</strong> ce retour à une<br />
enfance nostalgique et <strong>de</strong> cette ambiguïté d'un espace à-venir.<br />
Quand je retourne à cette forteresse et que je m'y attar<strong>de</strong> seul le soir,<br />
j'allonge la main entre le mur et la mer, m'enfermant en une douce souffrance,<br />
rêverie <strong>de</strong> plus en plus lente et évasive. ( <strong>Khatibi</strong>, 1971 : 56 )<br />
<strong>La</strong> récurrence <strong>de</strong>s termes : le soir, la main, la mer, souffrance, rêverie,<br />
évasion, renvoie à l'activité <strong>de</strong> l'écriture. Elle marque une prise <strong>de</strong> conscience et<br />
l'éclosion d'un espace-signifiant. C’est dire que les lieux, et plus particulièrement la<br />
<strong>ville</strong>, <strong>dans</strong> l’écriture <strong>de</strong> <strong>Khatibi</strong> sont <strong>de</strong>s tremplins <strong>de</strong> création. En débordant le cadre<br />
d’un simple miroir <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong> la vie <strong>de</strong>s personnages, ils <strong>de</strong>viennent le creuset<br />
où se transfèrent les instances réflexive et poétique. Autrement dit, la <strong>ville</strong> accè<strong>de</strong> au<br />
statut <strong>de</strong> langage.<br />
L’espace <strong>de</strong> la <strong>ville</strong> <strong>dans</strong> la <strong>mémoire</strong> <strong>tatouée</strong> ne relève pas d’une simple<br />
typologie. Au contraire, il est indissociable <strong>de</strong> la situation d'un sujet, <strong>de</strong> son point <strong>de</strong><br />
vue et du programme pragmatique qui lui est préalable. L'absence d’un espace<br />
référentiel s'accompagne <strong>de</strong> différents véhicules <strong>de</strong> substitution comme les<br />
compétences cognitives et les éléments sensoriels ( olfactif, goût, ... ) que nous avons<br />
analysé <strong>dans</strong> ce texte. D’autres facteurs que nous traiterons ailleurs, comme la<br />
catégorie sémique <strong>de</strong> la directionnalité ( horizontal/vertical ), les positionnements <strong>de</strong>s
corps, les programmes narratifs…., permettent la restitution <strong>de</strong>s espaces <strong>dans</strong> les<br />
textes <strong>de</strong> <strong>Khatibi</strong>. L’espace <strong>de</strong> la <strong>ville</strong> <strong>de</strong>meure un lieu <strong>de</strong> prédilection <strong>dans</strong> l’œuvre<br />
<strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier. Par son statut, il donne la possibilité au narrateur <strong>de</strong> développer un<br />
discours. Mieux encore d’organiser poétiquement une historicité et une socialité au<br />
niveau du langage.
BIBLIOGRAPHIE<br />
Bertrand Denis, L’espace et le sens, Germinal d’Emile Zola, Paris-Amsterdam,<br />
Hadès-Benjamin, 1985.<br />
<strong>Khatibi</strong> Ab<strong>de</strong>lkébir, <strong>La</strong> <strong>mémoire</strong> <strong>tatouée</strong>, Paris, <strong>de</strong>noël, Lettres nouvelles, 1971.<br />
<strong>Khatibi</strong> Ab<strong>de</strong>lkébi, Le livre du sang, Paris, Gallimard, 1979.<br />
<strong>Khatibi</strong> Ab<strong>de</strong>lkébir,Triptyque <strong>de</strong> Rabat, Paris, Noël Blandin, 1993.<br />
Tadié Jean Yves, Le récit poétique, Paris, P.U.F, 1978.<br />
Weinrich Harold, « les temps et les personnages », poétique, n° 39, Paris, Seuil,<br />
1979.