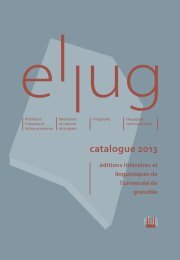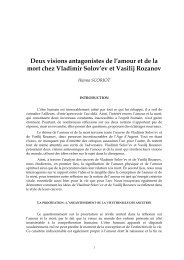You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Manuel de codage<br />
Projet ANR Multimodalité 2005-2009<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
Transcription et annotation<br />
de données multimodales sous ELAN<br />
Rédaction :<br />
Jean-Marc Colletta, Olga Capirci, Carla Cristilli,<br />
Susan Goldin-Meadow, Michèle Guidetti et Susan Levine<br />
Avec la collaboration de :<br />
Magdalena Augustyn, Geneviève Calbris, Valerio De Angelis, Ozlem E. Demir,<br />
Virginie Ducey-Kaufmann, Isabelle Estève, Michel Grandaty, Maria Graziano,<br />
Benedeta Guidarelli, Adam Kendon, Ramona N. Kunene, Lidia Miladi, Agnès Millet,<br />
Saskia Mugnier, Seyda Özçaliskan, Catherine Pellenq, Asela Reig-Alamillo,<br />
Isabelle Rousset, Jean-Pascal Simon et Aurélie Venouil<br />
Contact : Pr. Jean-Marc Colletta,<br />
Laboratoire Lidilem,<br />
Université Stendhal-Grenoble III,<br />
1180, av. centrale, Domaine Universitaire, 38400, St Martin d’Hères, France<br />
Tel : 33.(0)4.76.82.68.43<br />
Mel : jean-marc.colletta@u-grenoble3.fr<br />
Web : http://w3.u-grenoble3.fr/lidilem/labo/web/recherche.php
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
Sommaire<br />
Le projet ANR Multimodalité 03<br />
Publications – Etat au 31 déc. 2010 – 04<br />
Manuel de codage 05<br />
1. Transcription des paroles 06<br />
2. Annotation des faits linguistiques 07<br />
3. Annotation du récit 15<br />
4. Annotation des explications 21<br />
5. Annotation de la gestualité 22<br />
6. Contrôle des annotations gestuelles 31<br />
7. Codages additionnels 34<br />
Références 39<br />
2
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
Le projet ANR Multimodalité<br />
En 2005, l’objectif initial du projet « Multimodalité » est de contribuer à une meilleure connaissance du<br />
développement tardif de la parole dans ses aspects pragmatiques, discursifs et gestuels, chez l’enfant au<br />
développement typique comme chez l’enfant au développement atypique, tout en appréciant l’impact de la langue et<br />
de la culture d’origine sur ce développement.<br />
Les connaissances alors disponibles comprennent les observations des gestualistes concernant la multimodalité de<br />
la communication parlée et la complémentarité des signifiants verbaux et gestuels ainsi que des données des sciences<br />
cognitives et des neurosciences suggérant que le sujet, en production comme en compréhension, intègre les<br />
informations auditives (linguistiques et prosodiques) et les informations visuelles (posturo-mimo-gestuelles). On sait<br />
par ailleurs qu’un système geste-parole se met en place chez l’enfant au cours de la seconde année et que les usages de<br />
la gestualité coverbale accompagnant la parole semblent se développer et se diversifier ensuite. Par contre, la manière<br />
dont évolue ce système geste-parole chez l’enfant plus âgé, son devenir dans les conduites langagières complexes<br />
telles les conduites narratives ou explicatives, le rôle de la gestualité dans les acquisitions langagières tardives,<br />
l’influence de la langue et de la culture en la matière, tout cela reste très largement sous-documenté. Afin de parer ces<br />
lacunes, le projet « Multimodalité » réunit des équipes françaises (l’équipe de Jean-Marc Colletta, coordinateur du<br />
projet, à Grenoble 3, et celle de Michèle Guidetti à Toulouse 2), américaine (l’équipe coordonnée par Susan Goldin-<br />
Meadow et Susan Levine à Chicago) et italiennes (Olga Capirci à Rome, Carla Cristilli à Naples) et comporte quatre<br />
volets.<br />
Volet le plus important du projet, le volet développemental repose sur l’observation d’adultes et d’enfants<br />
français à qui on a proposé des tâches narratives et explicatives. Deux corpus ont été collectés : le premier (protocole<br />
1) auprès de 140 enfants âgés de 3 à 11 ans dont les capacités langagières ont été contrôlées ; le second (protocole 2)<br />
auprès de trois groupes d’âges (6 ans, 10 ans et adultes), couplés avec des populations américaines et italiennes (voir<br />
second volet). Les résultats les plus significatifs viennent pour l’instant de l’exploitation du second corpus (120<br />
sujets), où il a été mis en évidence un double effet de l’âge et de la longueur du récit sur la production gestuelle, ainsi<br />
qu’une co-évolution des ressources linguistiques et gestuelles avec une complexité croissante des récits aux plans<br />
syntaxique et discursif et une évolution de la gestualité vers les fonctions de cohésion textuelle et de cadrage<br />
pragmatique.<br />
Second volet du projet, le volet interlangues repose sur l’observation d’enfants français, italiens et américains à<br />
qui on a proposé la même tâche narrative collectée avec le protocole 2, mieux adapté aux différentes langues-cultures<br />
concernées. Le corpus comporte 160 récits d’enfants âgés de 6 ans et 10 ans (80 français, 40 italiens, 40 américains).<br />
Il s’agit d’étudier l’impact respectif de la langue-culture d’appartenance et de l’âge sur la production discursive et<br />
gestuelle. Les premiers résultats font apparaître un effet de l’âge similaire à celui observé dans le volet 1, mais aussi<br />
un effet de la langue-culture avec une gestualité plus prononcée chez les enfants italiens. Des observations plus fines<br />
laissent penser que les différences enregistrées en matière de gestualité ont aussi à voir avec les acquisitions cognitives<br />
et sociocognitives en matière de représentation et de construction référentielle, de savoir-faire conversationnels et de<br />
cadrage pragmatique de l’activité langagière.<br />
Troisième volet, le volet surdité porte sur des observations d’enfants sourds engagés dans les mêmes tâches<br />
narrative et explicative que celles évoquées précédemment. L’objectif est de mieux comprendre les implications de la<br />
multimodalité dans la dynamique des répertoires langagiers, et d’étudier les interactions entre langue et modalité<br />
puisque les deux modalités expressives (vocale et gestuelle) peuvent être investies par le linguistique comme par le<br />
non verbal. Les résultats font clairement apparaître les spécificités du développement langagier de l’enfant sourd, son<br />
habileté à construire son expression à partir de la totalité des ressources disponibles (langue vocale et langue signée,<br />
signaux vocaux et signaux gestuels), et interrogent la validité des outils de description actuels, les procédures<br />
d’évaluation de ses capacités langagières et les pistes didactiques à explorer.<br />
Dernier volet de ce projet, le volet pathologie a été diversement investi par les équipes. Avec les observations<br />
concernant l’enfant cérébro-lésé, l’équipe de Chicago explore les potentialités du geste en matière d’expression et<br />
d’acquisitions linguistiques. Dans la même optique, l’équipe de Grenoble a collecté des données langagières auprès<br />
d’enfants dysphasiques et entend les exploiter prochainement. Enfin, les collègues italiens poursuivent leurs<br />
observations concernant l’enfant présentant un syndrome de Williams et montrent que la gestualité peut refléter ses<br />
difficultés en matière de cognition visuo-spatiale et praxique. La gestualité : simple reflet ou moteur du<br />
développement et des acquisitions ? Certains de nos résultats plaident en faveur de la seconde hypothèse, mais ils<br />
devront être complétés pour que cette hypothèse soit totalement validée.<br />
3
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
Publications<br />
– état au 31 déc. 2010 –<br />
Capirci, O., Colletta, J.-M., Cristilli, C., Demir, O.E., Guidetti, M. & Levine, S. (2010). L’incidence de la culture et de la langue<br />
dans les récits parlés et les gestes d’enfants français, italiens et américains âgés de 6 et 10 ans. Lidil, 42, “Multimodalité de la<br />
communication chez l’enfant”, 139-158.<br />
Capirci, O., Cristilli, C., De Angelis, V. & Graziano, M. (in press). Developmental aspects of the relationship between speech and<br />
gesture in the construction of narratives. In G. Stam & M. Ishino (eds). Integrating Gestures. John Benjamins.<br />
Colletta, J.-M. (sous presse). Arguments pour une approche paramétrique de l’acte et du texte. Actes du Colloque International<br />
« Enonciation et texte au cœur de la grammaire », Toulouse, 11-13 mars 2009.<br />
Colletta, J.-M. (2010). Unités et structures du texte : l’éclairage de l’étude des textes parlés enfantins. In L.-S. Florea, Ch. Papahagi,<br />
L. Pop & A. Curea (dir.), Directions actuelles en linguistique du texte. Actes du Colloque International « Le Texte : modèles,<br />
méthodes, perspectives», vol. II. Cluj-Napoca, Casa Carti de Stinta : 403-416.<br />
Colletta, J.-M. & Guidetti, M., Eds. (in press). Gesture, special issue on “Multimodality and gesture in communicative<br />
development”.<br />
Colletta, J.-M., Kunene, R.N., Capirci, O., Cristilli, C., Demir, O.E., Guidetti, M. & Levine, S. (in preparation). The effect of<br />
culture, language and age on co-speech gesture production. An investigation on American, Italian and French children’s<br />
narratives.<br />
Colletta, J.M., Kunene, R.,N., Venouil, A., Kaufmann, V. & Simon, J.P. (2009). Multitrack annotation of child language and<br />
gestures, In M. Kipp, J.-C. Martin, P. Paggio, P. & D. Heylen (Eds.), Multimodal Corpora. From Models of Natural<br />
Interaction to Systems and Applications, Springer, LNAI 5509, pp. 54-72.<br />
Colletta, J.-M., Millet, A. & Pellenq, C., Eds. (sous presse). Lidil, 42, « Multimodalité de la communication chez l’enfant ».<br />
Colletta, J.-M., Pellenq, C. & Guidetti, M. (2010). Age-related changes in co-speech gesture and narrative: Evidence from French<br />
children and adults. Speech Communication, 52 : 565-576.<br />
Cristilli, C. (in press). La rilevanza dell'input gestuale in relazione a quello verbale nella comunicazione insegnanti-bambini, in<br />
M.C. Caselli e Emiddia Longobardi (a cura di) Caratteristiche dell’input in condizioni di sviluppo tipico e atipico:<br />
implicazioni per la ricerca e il trattamento, Nucleo monotematico di Psicologia clinica dello sviluppo.<br />
Cristilli, C., Capirci, O. & Graziano, M. (in press). Le funzioni anaforiche della gestualità nel racconto dei bambini. Proceedings of<br />
The 3 rd International Conference “Spoken Communication”, Naples, Italy, 23-25 February, 2009.<br />
Demir, O.E., Levine, S.C. & Goldin-Meadow, S. (in press). Narrative skill in children with early unilateral brain injury. A possible<br />
limit to functional plasticity. Developmental Science.<br />
Estève, I. (2009). Diversité langagière d’une classe d’enfants sourds. In Actes Colloque Enfance et plurilinguisme, 26-27 juin 2008,<br />
Montpellier. http://www.msh-m.fr/article.php3?id_article=709<br />
Estève, I. & Batista, A. (2009). Utilisation et construction de l’espace dans les conduites narratives d’enfants sourds oralisants et<br />
d’enfants entendants. Actes du Colloque pluridisciplinaire Repères et Espace, 27-28-29 avril 2009, Grenoble.<br />
Fantazi, D. (2010). La gestualité cohésive dans les récits d’enfants âgés de 9 à 11 ans. Lidil, 42, “Multimodalité de la<br />
communication chez l’enfant”, 97-112.<br />
Fantazi, D. (2009). Anaphores et chaînes référentielles dans la narration enfantine à l’oral et à l’écrit. Actes du Colloque<br />
AcquisiLyon, 3-4 décembre 2009.<br />
Guidetti, M. & Colletta, J.-M. (2010). Introduction. Gesture, 2 (3), special issue on “Multimodality and gesture in communicative<br />
development”, p.123-128.<br />
Guidetti, M. & Nicoladis, E., Eds. (2008). First Language, 28 (2) “Gestures and communicative development”.<br />
Millet, A. & Estève, I. (2010). Transcribing and annotating multimodality: How deaf children’s productions call into the question<br />
the analytical tools. Gesture, 2 (3), special issue on “Multimodality and gesture in communicative development”, p.298-321.<br />
Millet, A. & Estève, I. (2010). Transcrire et annoter la multimodalité : quand les productions des enfants sourds ré-interrogent les<br />
outils d’analyse. Lidil, 42, “Multimodalité de la communication chez l’enfant”, p.9-34.<br />
Millet, A & Estève, I. (2009). Contacts de langues et multimodalité chez des locuteurs sourds : concepts et outils méthodologiques<br />
pour l’analyse. Journal of language contact Varia 2. 111-133. http://www.jlcjournal.org/.<br />
Reig Alamillo, A. & Colletta, J.-M. (sous presse). Apprendre à raconter, apprendre à commenter. Actes du Colloque International<br />
« Enonciation et texte au cœur de la grammaire », Toulouse, 11-13 mars 2009.<br />
Reig Alamillo, A., Colletta, J.-M. & Kunene, R.N. (2010). Reference tracking in gesture and speech. A developmental study on<br />
French narratives. Rivista di Psicholinguistica Applicata, X, 3: 75-95.<br />
Reig Alamillo, A., Guidetti, M. & Colletta, J.-M. (submitted). Gesture and language in narratives and explanations: the effects of<br />
age and communicative activity on late multimodal discourse development.<br />
Rowe, M. & Goldin-Meadow, S. (2009). Early gesture selectively predicts later language learning. Developmental Science, 12:<br />
182-187.<br />
4
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
Manuel de codage<br />
1. Transcription des paroles et conventions de transcription<br />
2. Annotation des faits linguistiques (6 étapes)<br />
3. Annotation du récit (5 étapes)<br />
4. Annotation des explications (1 étape)<br />
5. Annotation de la gestualité (5 étapes)<br />
6. Contrôle des annotations gestuelles (2 étapes)<br />
7. Codages additionnels (6 étapes)<br />
La transcription et l’annotation des paroles et des mouvements corporels s’effectuent à l’aide du logiciel ELAN<br />
développé par le Max Planck Institute de Nimègue et téléchargeable gratuitement à l’adresse :<br />
http://www.lat-mpi.eu/tools/elan/<br />
Voici un aperçu de l’interface :<br />
5
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
1. Transcription des paroles<br />
• Que ce soit pour la tâche narrative ou pour la tâche explicative, la transcription des paroles des locuteurs apparaît<br />
sur deux pistes :<br />
< adulte > < enfant ><br />
• La transcription des paroles est à saisir proposition par proposition ou en deça, mais pas au delà.<br />
Ex. :<br />
« et après l’œuf il a roulé »<br />
« mmhm »<br />
« il a roulé jusqu’à la maison de la souris »<br />
• La transcription est orthographique et présente l’intégralité des propos des locuteurs.<br />
1.1. Conventions relatives aux faits linguistiques<br />
le *bouton = respecter la prononciation exacte de l’enfant (« sèvre » pour « chèvre » ; « bouton » pour « mouton ») et<br />
la *sèvre faire précéder le phonème ou la syllabe qui ne correspond pas à la forme standard d’une *<br />
le mout/ mouton<br />
il rep/ revient = signaler les mots inachevés (mouton, repart) avec un / à la fin du mot<br />
pa(r)ce que<br />
i(l) faut<br />
j(e) me = signaler les phonèmes ou syllabes élidés par des ( )<br />
[sait / ses] = mettre les termes pour lesquels on hésite entre [ ] ; donner les deux possibilités<br />
heu heum mm = hésitations<br />
(xxxx) = noter les termes ou segments impossibles à identifier par des croix : une x par syllabe<br />
{rire} {soupir} = commentaires du transcripteur<br />
NON = utiliser les majuscules pour noter des paroles fortement accentuées ; pas de maj. pour les noms propres<br />
1.2. Conventions relatives aux faits prosodiques<br />
// = signaler les pauses entre les groupes de souffle<br />
? ! = utiliser exclusivement ces deux signes de ponctuation et uniquement lorsque nécessaire, pour signaler une<br />
question ou une exclamation<br />
i’ va::<br />
ben:: = allongements vocaliques<br />
6
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
2. Annotation des faits linguistiques<br />
Etape 1 : < TDP > segmentation des propos de l’enfant en tours de parole<br />
On annote un nouveau tour de parole lorsque les paroles de l’enfant surviennent :<br />
- lors de la tâche narrative, après une relance de l’adulte ;<br />
- lors de la tâche explicative, après une question (une demande d’explication) ou une relance de l’adulte.<br />
Rappel : dans la tâche de récit, on considère deux types de relances :<br />
1. en cas de silence, de récit trop bref ou de récit synthétique, l’adulte a demandé : « qu’est-il arrivé d’autre ? dis-moi en<br />
plus »<br />
2. lorsque l’enfant est arrivé vers la fin de son récit, l’adulte a demandé : « as-tu fini ? est-il arrivé autre chose ? »<br />
Remarque : dans la tâche de récit, il arrive fréquemment que l’enfant délivre son récit en une seule fois, auquel cas on<br />
annote un seul tour de parole.<br />
7
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
Etape 2 : < Synt.Prop > segmentation des propos de l’enfant en propositions<br />
Le travail est facilité par la saisie préliminaire des paroles proposition par proposition.<br />
On appelle proposition :<br />
- une prédication assortie de un, deux ou trois arguments (approche logique), ou<br />
- une suite de mots comprenant un verbe assorti de ses satellites en fonction sujet et complément(s) (approche<br />
grammaticale).<br />
Des exemples sont donnés à l’étape 3.<br />
Dans le cas d’une proposition incomplète, on annote celle-ci comme proposition seulement si le locuteur en a<br />
formulé le verbe.<br />
En revanche, à cette étape, on normalise les propos pour permettre le traitement linguistique (segmentation en mots)<br />
:<br />
- suppression des signes non linguistiques tels : / ( ) * ? !<br />
- suppression des commentaires du transcripteur entre crochets { }<br />
- suppression des marques d’hésitation et des allongements vocaliques<br />
- suppression des faux départs lorsqu’il s’agit d’une syllabe, d’un mot ou d’un syntagme<br />
- suppression des reprises lorsqu’il s’agit de la répétition d’un mot ou d’un syntagme<br />
Ex (voir illustration ci-après) :<br />
ha parce que // si l'oeuf i(l) n'arrivait pas >>> ha parce que si l'oeuf il n'arrivait pas<br />
y aurait pas de:: d'histoire dans l(e) dessin animé {rire} >>> y aurait pas d'histoire dans le dessin animé<br />
Remarque : maintien des reprises lorsqu’il s’agit de la répétition d’une proposition entière ou d’une reformulation.<br />
Ex :<br />
Après le maître Gromit enfin le maître de Wallace il dit… >>> Après le maître Gromit enfin le maître de Wallace il dit…<br />
8
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
Etape 3 : < Synt.Type.Pr > catégorisation des propositions<br />
Par double clic à l’endroit que l’on souhaite annoter, puis clic sur la valeur choisie dans le menu déroulant :<br />
< Phrase nominale > : annotation d’expressions non prédicatives (n’inclut pas les propositions introduites par un<br />
présentatif comme « c’est » ou « il y a »)<br />
Ex : Pas d’exemple dans le corpus français<br />
< Indépendante > : proposition isolée, entourée ou non par des connecteurs (entre parenthèses)<br />
Ex :<br />
il regarde son réveil<br />
(donc) il part<br />
(et) il laisse l’œuf dans le nid<br />
(et) (en fait) l’œuf (après) il tremble<br />
(et) il fait le tour du nid<br />
< Indépendante Prés > : proposition isolée, entourée ou non par des connecteurs (entre parenthèses), introduite par<br />
un présentatif du type « il y a », « c’est », « voici »<br />
Ex :<br />
y a un mouton<br />
c’est une maman oiseau dans un nid<br />
< Principale > : proposition à laquelle se rattache une proposition complétive ou adverbiale<br />
Ex : voir ci-après<br />
< Principale Prés > : proposition introduite par un présentatif du type « il y a », « c’est », « voici » (en gras), à<br />
laquelle se rattache une proposition complétive ou adverbiale (soul.)<br />
Ex :<br />
y a le mouton [qui veut sortir]<br />
c’est une maman oiseau [qui tricote]<br />
< Ct de verbe > : proposition complétive (soul.) dépendant d’un verbe principal (gras)<br />
Ex :<br />
Il dit [je pars demain]<br />
Le maître de wallace il dit [est-ce que tu as eu faim cette nuit]<br />
Sa maman lui dit [de faire attention]<br />
Il dit [qu’il faut {tirer la porte}] (2 prop. Ct de verbe)<br />
Il veut [que Marie mange]<br />
Il demande [si Wallace va partir]<br />
Il a vu [que y a plein de trucs {qui s’est fait croquer}]<br />
Il a appris [à être chasseur]<br />
Il a réussi [à manger]<br />
Il dit [je pense {qu’on va…}] (2 prop. Ct de verbe)<br />
Elle sait [qu’elle a tout son temps]<br />
Je sais plus [ce que c’est]<br />
Ils appellent quelqu’un [pour qu’ils viennent voir {ce qui se passe}]<br />
9
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
< Ct de phrase > : proposition adverbiale (soul.) dépendant d’une proposition principale (gras)<br />
Ex :<br />
(Et après) [quand il regarde les choses] c’est mangé<br />
(Après) [tellement qu’il a mangé] il s’endort<br />
Je suis sortie [sans qu’il voie]<br />
Elle transporte quelque chose ou je sais pas quoi [pour l’amener à sa grand-mère]<br />
Ils appellent quelqu’un [pour qu’ils viennent voir]<br />
< Ct de Nom > : proposition en fonction épithète ou CDN (soul.) dans un GN sujet ou objet (gras)<br />
Ex :<br />
Les enfants [qui dormaient] n’ont pas entendu…<br />
Il voit quelque chose [qui change]<br />
Ils ont lu le journal [où il y avait marqué l’article]<br />
< Ct de Nom foc. > : proposition en fonction épithète ou CDN (soul.) dans un GN introduit par un présentatif (gras)<br />
Ex :<br />
Il y a le mouton [qui veut sortir]<br />
Il y a le berger avec ses moutons [qui s’arrête au feu]<br />
C’est le loup [qui a gagné]<br />
C’est l’heure [de manger]<br />
Il a vu que y a plein de trucs [qui s’est fait croquer]<br />
< Ct d’adjectif > : proposition en fonction de complément (soul.) d’un adj. attribut (gras)<br />
Ex :<br />
C’était un peu dur (quand-même) [de vérifier]<br />
Je suis content [de te voir]<br />
< Ct d’adverbe > : proposition en fonction de complément (soul.) d’un adverbe (gras)<br />
Ex :<br />
Heureusement [qu’il a été mangé]<br />
< Infinitive > : proposition infinitive (soul.) en fonction de complétive ou d’adverbiale<br />
Ex :<br />
Il est allé dans le ruisseau [chercher une pierre] (infinitive adverbiale)<br />
Il [le] voit [partir] (infinitive complétive)<br />
< Factitive > : proposition infinitive (soul.) en fonction de complétive<br />
Ex :<br />
Il [le] fait [descendre de son lit]<br />
Remarque : on considère qu’on a affaire à une et une seule proposition lorsqu’on a une suite [verbe1 conjugué +<br />
verbe 2 à l’infinitif] (cf. Diessel, 2004) avec :<br />
-emploi d’un auxiliaire d’aspect<br />
Ex :<br />
il va partir du nid<br />
il commence à taper avec son bec<br />
Il se dépêche d’aller à la maison de la grand-mère<br />
- emploi des auxiliaires modaux « pouvoir », « devoir », « vouloir »…<br />
Ex :<br />
elle peut aller manger<br />
le bonhomme pouvait pas attraper ses céréales<br />
l’oiseau veut tout détruire<br />
Elle devait voir sa grand-mère<br />
10
Etape 4 : < Synt.Mots > segmentation en mots<br />
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
En utilisant la commande « tokeniser l’acteur » du menu « acteur » puis en définissant « Acteur source » et<br />
« Acteur de destination » comme suit :<br />
11
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
Etape 5 : < Synt.Cat.gr > identification des indices de complexité syntaxique (subordination)<br />
Par double clic à l’endroit que l’on souhaite annoter, puis clic sur la valeur choisie dans le menu déroulant :<br />
On annote :<br />
< ConjSsub > : les conjonctions de subordination et locutions conjonctives telles :<br />
que, quand, comme, à ce que, de ce que, parce que, afin que, alors que, sans que, tout ce que, etc…<br />
< PrRelatif > : les pronoms relatifs :<br />
qui, que, où, dont, etc…<br />
< Prep > : les prépositions et locutions prépositionnelles introduisant un infinitif :<br />
Ex :<br />
Pour mieux te voir<br />
Je te demande de partir<br />
la souris sort afin de le ramener au nid<br />
< Autres.Sub > : les autres subordonnants tels des adverbes, des locutions adverbiales, etc.<br />
Ex :<br />
il va où la plante a été mangée<br />
…<br />
Remarque : lorsque le mot est en deux segments comme « parce que » ou « afin de », on n’annote qu’à un seul<br />
endroit.<br />
12
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
Etape 6 : < Disc.Cat.gr > identification des connecteurs et des anaphores<br />
Par double clic à l’endroit que l’on souhaite annoter, puis clic sur la valeur choisie dans le menu déroulant :<br />
6.1. Connecteurs : on annote comme < Conn > tous les éléments qui ont un rôle de marqueur de structuration,<br />
d’opérateur logique, chronologique ou spatial, de connecteur argumentatif ou de connecteur reformulatif. Voir des<br />
exemples dans le tableau ci-dessous (extrait de Colletta, 2004).<br />
Les marqueurs de<br />
structuration<br />
Les opérateurs<br />
Les connecteurs<br />
argumentatifs<br />
Les connecteurs<br />
reformulatifs<br />
Ils permettent soit de signaler l'ouverture ou la clôture d'une unité conversationnelle (bon, alors, allez, au fait,<br />
pis, bien, ben, voilà, quoi…), soit d'organiser la progression discursive (d'abord, premièrement, en premier lieu,<br />
pour commencer, deuxièmement, en second lieu, ensuite, dernièrement, en dernier lieu, pour terminer, enfin...).<br />
Ils signalent l'enchaînement des unités dans les séquences explicatives (opérateurs logiques tels si, alors, donc,<br />
parce que, en conséquence…), narratives (opérateurs chronologiques tels et, puis, auparavant, au même<br />
instant, après, ensuite, alors…), descriptives (opérateurs spatiaux tels en haut, au dessus, en bas, au dessous, à<br />
gauche, à droite, plus loin, devant, derrière…).<br />
Ils signalent l'enchaînement des unités dans les séquences oppositives et argumentatives. On distingue les<br />
connecteurs adversatifs (non, par contre, en revanche…), argumentatifs (car, parce que, puisque, en effet,<br />
d'ailleurs…), concessifs (certes, bien sûr, il est vrai que…), contre-argumentatifs (mais, cependant, néanmoins,<br />
pourtant, quand même…), consécutifs (ainsi, aussi, donc, en conséquence…), réévaluatifs (finalement, enfin,<br />
en somme, au fond, bref, décidément…).<br />
Ils signalent l'apparition d'énoncés métadiscursifs (autrement dit, je veux dire, c'est-à-dire, comment dire...).<br />
6.2. Anaphores : on annote tous les éléments qui ont un rôle de reprise d’un référent antérieur. Le fonctionnement<br />
anaphorique (référent en gras, anaphore soulignée) peut être porté par :<br />
< Nom > un nom ou un groupe nominal : la souris… Jerry... la souris Jerry<br />
< Det > un déterminant : un mouton… le mouton… ce mouton<br />
< Pronom > un pronom : un mouton… il ;<br />
il mange les feuilles… et pendant qu’il a fait ça<br />
< PrRelatif > un pronom relatif : y a un mouton qui sort du camion<br />
et là il voit la plante qui a été mangée<br />
< Zero anaphore > : pas d’exemple en français<br />
< Autre > : anaphore portée par un groupe verbal, un adverbe, une proposition, etc.<br />
13
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
Remarque : dans le cas des possessifs, on peut rencontrer des suites comme « l’oiseau… sa maman ». On ne<br />
considère pas « sa » comme anaphore lors de la première mention du référent « maman ». Lorsqu’il y a redoublement<br />
de la co-référence à l’intérieur d’un même proposition (par double marquage ou focalisation), on n’annote que la<br />
première reprise anaphorique (soulignée) et on ignore la seconde (en italiques) :<br />
Ex :<br />
Wallace… Je sais [que Wallace il adore le fromage]<br />
< Nom ><br />
Le mouton… Le mouton il est en train de…<br />
< Det ><br />
L’oiseau… il picore [tout ce qu’il trouve l’oiseau]<br />
< Pronom > < Pronom ><br />
Remarque : lorsqu’on annote les fichiers correspondant aux explications, on annote comme reprise anaphorique la<br />
première mention d’un référent si et seulement si ce référent a été mentionné explicitement dans la question (ou la<br />
relance) de l’adulte.<br />
Ex :<br />
Adulte : pourquoi le bébé oiseau est content de voir la souris?<br />
Enfant : parce qu’il croit que c’est sa maman<br />
< Pronom ><br />
14
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
3. Annotation du récit<br />
Etape 1 : < Narration > reprise de la segmentation des propos de l’enfant en propositions<br />
Il suffit de copier les annotations déjà saisies à l’étape 2.<br />
15
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
Etape 2 : < Episode > catégorisation des propositions en macro-épisodes<br />
Par double clic à l’endroit que l’on souhaite annoter, puis clic sur la valeur choisie dans le menu déroulant :<br />
Liste des macro-épisodes :<br />
Code Description de l’épisode<br />
A<br />
B<br />
C<br />
D<br />
E<br />
F<br />
G<br />
Dans le nid<br />
Du nid au lit<br />
L'éclosion<br />
L'empreinte<br />
Les dégâts<br />
Comment clamer le bébé oiseau<br />
Retour au nid<br />
Remarque : plusieurs propositions peuvent être affectées à un macro-épisode, et inversement, il peut arriver qu’un<br />
macro-épisode ne fasse l’objet d’aucune proposition. Lorsque les propos de l’enfant ne correspondent à aucun macroépisode<br />
identifié : l’enfant évoque des événements hors de l’histoire (cf. ex. ci-après), explique, commente ou<br />
interprète (cf. étape 10), on laisse l’annotation vide en cliquant à l’extérieur du menu déroulant.<br />
Ex :<br />
« ben c’est un pivert enfin une maman pivert qui fait un œuf »<br />
16
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
Etape 3 : < ElementDuScript > catégorisation des propositions en micro-épisodes<br />
Par double clic à l’endroit que l’on souhaite annoter, puis clic sur la valeur choisie dans le menu déroulant :<br />
Liste des micro-épisodes :<br />
Code Description du micro-épisode<br />
A1 La maman tricote<br />
A2 La maman regarde l'oeuf<br />
A3 La maman tricote<br />
A4 La maman regarde l'heure<br />
A5 La maman pose son tricot<br />
A6 La maman borde l'oeuf<br />
A7 La maman contemple l'oeuf<br />
A8 La maman s'en va<br />
B1 L'oeuf saute<br />
B2 L'oeuf tombe dans la toile d'araignée<br />
B3 La toile se rompt<br />
B4 L'oeuf tombe dans la fleur<br />
B5 La fleur dépose l'oeuf sur la feuille<br />
B6 L'oeuf roule sur la feuille jusqu’à la maison<br />
B7 L'oeuf pousse la porte<br />
B8 L'oeuf roule jusqu'au lit<br />
C1 La souris se retourne sur l'oeuf<br />
C2 L'oeuf réveille la souris<br />
C3 La souris découvre l'oeuf<br />
C4 L'oeuf fait tomber la souris du lit<br />
D1 L'oeuf éclot<br />
D2 Le bébé oiseau court avec sa coquille sur la tête<br />
D3 la souris enlève la coquille<br />
D4 le bébé oiseau court en cercle<br />
D5 Le bébé oiseau prend la souris pour sa mère<br />
D6 Le bébé oiseau fait un câlin à la souris<br />
D7 La souris caresse la tête du bébé oiseau<br />
E1 Le bébé oiseau a vu quelque chose<br />
E2 Le bébé oiseau court et grimpe sur la commode<br />
E3 Le bébé oiseau attaque la commode avec son bec<br />
E4 Le bébé oiseau détruit le pied du lampadaire<br />
E5 La souris veut attraper le bébé et reçoit l'abat-jour sur la tête<br />
E6 Le bébé oiseau fait un trou dans le mur avec son bec<br />
E7 La souris bloque l'oiseau par le bec et vibre<br />
17
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
E8 La souris pose l'oiseau<br />
F1 La souris a une idée<br />
F2 La souris va chercher quelque chose à manger<br />
F3 La souris tend un morceau de nourriture<br />
F4 Le bébé oiseau mange<br />
F5 La souris tend un autre morceau de nourriture<br />
F6 Le bébé oiseau mange le morceau de nourriture et le bras de la souris<br />
F7 La souris se libère<br />
F8 L'oiseau se retrouve planté<br />
F9 La souris déplante l'oiseau<br />
F10 La souris s'éponge le front et veut s'asseoir<br />
F11 Le bébé oiseau détruit le tabouret et la souris tombe<br />
G1 La souris regarde l'oiseau avec colère<br />
G2 La souris prend le bébé oiseau dans ses bras<br />
G3 La souris emporte l'oiseau dehors<br />
G4 La souris regarde en l'air et cherche en tournant la tête à droite puis à gauche<br />
G5 La souris a vu quelque chose et sourit<br />
G6 La souris monte sur l'arbre jusqu'au nid<br />
G7 La souris met le bébé oiseau au lit<br />
G8 La souris fait au revoir<br />
G9 La souris s'en va<br />
Remarque : plusieurs propositions peuvent être affectées à un micro-épisode, et inversement, il peut arriver qu’un<br />
micro-épisode ne fasse l’objet d’aucune proposition. Lorsque les propos de l’enfant ne correspondent à aucun microépisode<br />
identifié : l’enfant évoque des événements hors de l’histoire, explique, commente ou interprète (cf. étape 10),<br />
on laisse l’annotation vide en cliquant à l’extérieur du menu déroulant.<br />
Ex :<br />
« ben c’est un pivert enfin une maman pivert qui fait un œuf »<br />
Remarque : lorsque les propos de l’enfant correspondent à un micro-épisode identifié sans reprendre mot pour mot à<br />
la formulation proposée, on sélectionne tout de même le micro-épisode correspondant.<br />
Ex :<br />
« heu ben en fait c'est au début un oiseau il tricote » < A1 > : La maman tricote<br />
« après il (l’oeuf) tremble » < B1 > : L'oeuf saute<br />
« et puis il (l’œuf) fait le tour du nid » < B1 > : L'oeuf saute<br />
« et il glisse jusqu'à une feuille » < B5 > : La fleur dépose l'oeuf sur la feuille<br />
…<br />
18
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
Etape 4 : < ModalitésPragmatiques > catégorisation des propositions en actes de langage<br />
Par double clic à l’endroit que l’on souhaite annoter, puis clic sur la valeur choisie dans le menu déroulant :<br />
On sélectionne :<br />
< raconte > lorsque la proposition reprend le descriptif d’un micro-épisode ou traite de la dimension explicite de ce<br />
micro-épisode : l’enfant raconte l’événement tel qu’il apparaît dans le dessin animé.<br />
DONC : toute proposition ayant été identifiée à l’étape 3 comme correspondant à un micro-épisode est à annoter<br />
avec < raconte ><br />
< explique > lorsque la proposition apporte une précision de nature causale : l’enfant apporte une explication<br />
complémentaire quant à l’événement narré tel qu’il apparaît dans le dessin animé<br />
Ex :<br />
(puis ensuite il essaie de s’asseoir) parce qu’il (Jerry) est fatigué<br />
(il le ramène à son nid) parce qu’il cassait tout<br />
< interprète > lorsque la proposition présente une inférence ou une interprétation concernant la situation ou les<br />
intentions des personnages : l’enfant brode à partir de l’événement, échafaude des hypothèses<br />
Ex :<br />
(puis il regarde son réveil) il s’aperçoit {que c’est l’heure [de partir]} >>> 3 prop. à annoter avec < interprète ><br />
< commente > lorsque la proposition ne traite ni des aspects explicites, ni des aspects implicites du déroulement des<br />
événements mais présente un « commentaire méta-narratif » relatif à un personnage, une action ou un quelconque<br />
aspect de l’histoire, ou un « commentaire para-narratif » relatif à l’action même de raconter l’histoire (jugement,<br />
appréciation personnelle…)<br />
Ex :<br />
il est fou cet oiseau<br />
j’aime bien [quand l’œuf il tombe dans la toile] >>> 2 prop. à annoter avec < commente ><br />
19
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
Etape 5 : < PlanNarratif > catégorisation des propositions au regard du traitement narratif<br />
Par double clic à l’endroit que l’on souhaite annoter, puis clic sur la valeur choisie dans le menu déroulant :<br />
On sélectionne :<br />
< Premier plan > lorsque la proposition traite du plan événementiel de l’histoire : du déroulement des événements<br />
tels qu’ils apparaissent dans le dessin animé<br />
Ex :<br />
puis i(l) regarde son réveil<br />
< Arrière plan > lorsque la proposition traite de l’arrière-plan de l’histoire : ce peut être au début (macro-épisode A,<br />
micro-épisodes A1, A2, A3 principalement), à la fin (macro-épisode G, micro-épisodes G7, G8, G9 principalement),<br />
ou pendant le récit lorsque le narrateur fournit des éléments de description des situations.<br />
Ex :<br />
heu ben en fait c'est au début un oiseau il tricote<br />
Remarque : Deux cas de figure possibles :<br />
1. le récit est au présent : le passage au premier plan est marqué par l’apparition d’un connecteur introducteur<br />
d’événement (soudain, alors, tout-à-coup, puis)<br />
2. le récit est au passé : on s’appuie sur les temps utilisés : imparfait pour l’arrière-plan, passé composé ou passé<br />
simple pour le premier plan. Attention : l’enfant peut commettre des erreurs d’emploi des deux temps.<br />
On laisse l’annotation vide lorsque la proposition a été annotée avec < commente > à l’étape 10, puisque l’enfant n’est<br />
plus alors dans le récit, explicite ou implicite, de l’histoire.<br />
20
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
4. Annotation des explications<br />
Etape 1 : < Rep_explication > reprise partielle de la segmentation des propos de l’enfant<br />
Il suffit d’introduire, après chaque question de l’adulte, une brève annotation qui indique s’il y a ou non une réponse<br />
de l’enfant.<br />
On sélectionne < 0 > dans le menu déroulant s’il n’y a pas de réponse ;<br />
On sélectionne < 1 > dans le menu déroulant s’il y a réponse de l’enfant.<br />
21
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
5. Annotation de la gestualité<br />
Elle est effectuée en parallèle par 2 codeurs indépendants 1 et 2, qui annotent chacun de leur côté<br />
les différentes étapes :<br />
codeur 1<br />
codeur 2<br />
Pour chacune des étapes qui suivent, on trouvera des exemples correspondant aux options des<br />
menus déroulants dans le fichier ELAN « Jonas.CM1.Ma.Tom.eaf ».<br />
On ouvre ce fichier sous ELAN avec les fichiers audio et vidéo correspondants, fichiers qui sont<br />
annexés au présent document dans le dossier « ANR Coding Manual »<br />
22
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
Etape 1 : < Gestes(Phases) > identification des gestes et annotation des phases gestuelles<br />
1.1. Identification des unités gestuelles<br />
Pour identifier les unités gestuelles qu’il s’apprête à annoter, le codeur prend en compte les trois critères<br />
suivants, auxquels il attribue une valeur entre 0 et 2 :<br />
Si le mouvement est :<br />
- bien repérable : de bonne amplitude, bien marqué par sa vitesse 2<br />
- peu repérable : de peu d’amplitude, peu rapide 0<br />
- entre les deux 1<br />
Si l’emplacement est :<br />
- dans l’espace frontal du locuteur, réalisé pour l’interlocuteur 2<br />
- sur un côté, peu ou pas repérable par l’interlocuteur 0<br />
- entre les deux 1<br />
Si la configuration (dans le cas d’un geste manuel) :<br />
- correspond à une forme de la main précise 2<br />
- correspond à une forme imprécise 0<br />
- est entre les deux 1<br />
On identifie le mouvement comme un geste si la somme des valeurs attribuées est > 3<br />
1.2. Annotation des phases gestuelles<br />
Par double clic à l’endroit que l’on souhaite annoter, puis clic sur la valeur choisie dans le menu déroulant :<br />
On sélectionne une des six valeurs suivantes (voir des exemples dans A. Kendon, 2004, chap.7) :<br />
< stroke > = le geste lui-même, qu’il s’agisse d’un geste manuel ou d’un mouvement de la tête, des épaules ou du<br />
buste.<br />
Remarque : tout stroke correspond à un geste : le nombre de strokes qu’on a annoté doit donc correspondre au<br />
nombre de gestes qu’on a identifié dans la séquence.<br />
< préparation > = le mouvement qui précède un stroke manuel, qui amène la ou les main(s) de leur position initiale<br />
au repos à l’endroit ou démarre le geste.<br />
< retour > = le mouvement qui ramène la ou les main(s) de leur position à la fin d’un stroke gestuel à une position de<br />
repos, identique ou non à la position de repos précédent le geste.<br />
23
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
< enchaînement > = le mouvement qui amène la ou les main(s) de leur position initiale à la fin d’un stroke gestuel à<br />
l’endroit ou démarre un nouveau stroke gestuel, sans retour à une position de repos entre les deux strokes.<br />
< tenue > = le maintien de la ou des main(s) dans leur position à la fin d’un stroke gestuel, avant une phase de retour<br />
ou d’enchaînement, ou pendant la phase de préparation.<br />
< mixte > = on n’utilise pas cette annotation.<br />
Remarque : contrairement aux mains, l’emplacement de la tête, du buste ou des épaules est fixe (1 degré de liberté en<br />
moins). Les mouvements de la tête, du buste ou des épaules ne peuvent donc être « préparés » au même titre que les<br />
mouvements manuels, et en conséquence, ne peuvent être annotés que comme des strokes.<br />
24
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
Etape 2 : < Valeur du Geste > attribution d’une fonction au geste<br />
Par double clic à l’endroit que l’on souhaite annoter, puis clic sur la valeur choisie dans le menu déroulant :<br />
On sélectionne parmi les fonctions suivantes :<br />
< Déictique > = geste manuel ou céphalique de pointage dirigé vers un objet présent dans la situation, vers<br />
l’interlocuteur, vers soi-même ou une partie de son corps, ou indiquant la direction dans laquelle se trouve le référent à<br />
partir des coordonnées absolues de la situation.<br />
Ex :<br />
- Le locuteur s’auto-désigne en disant « c’est ce que moi j’ai compris »<br />
Remarque : tous les gestes de pointage n’ont pas de valeur déictique. Un geste de pointage déictique implique nécessairement la<br />
présence du référent ou sa localisation effective à partir de la situation, et ces gestes sont rares dans le corpus. Lorsque le locuteur<br />
pointe en parlant d’un personnage, d’un objet ou d’une localisation interne à l’histoire, le geste n’a pas une valeur déictique, mais<br />
soit une valeur représentationnelle, soit une valeur discursive (plus exactement « anaphorique » dans le cas d’une reprise gestuelle),<br />
cf. les sections < Représentationnelle > et < Discursive >.<br />
Ex :<br />
- Le locuteur pointe devant soi vers le haut en disant : « il (Jerry) monte en haut de l’arbre » (pointage abstrait)<br />
********<br />
< Représentationnelle > = geste de la main ou mimique faciale, associant ou non d’autres parties du corps, qui<br />
représente un objet de l’histoire ou une propriété de cet objet, un lieu, un déplacement, une action, un personnage ou<br />
un attitude, ou qui symbolise, par métaphore ou par métonymie, une idée abstraite.<br />
Ex de gestes représentant des objets, propriétés, lieux, déplacements, actions, personnages du monde concret :<br />
- 2 mains dessinent une forme ovale pour représenter l’œuf<br />
- 2 mains dessinent la forme d’un contenant pour représenter le nid<br />
- Mouvement rapide de la main ou de l’index du haut vers le bas pour représenter la chute de l’œuf (pointage abstrait)<br />
- Mouvement manuel ou céphalique, en direction de la droite, de la gauche, du haut ou du bas pour représenter le -<br />
déplacement d’un objet ou d’un personnage (pointage abstrait)<br />
- Mouvements rapides et répétés de la main en forme de pointe pour représenter le pic-vert en train d’attaquer un objet<br />
- Bras et mains mimant le fait de porter un objet pour représenter Jerry ramenant l’oiseau au nid<br />
- Mouvement rapide d’affaissement de tout le corps pour représenter Jerry tombant par terre<br />
- Regard et mouvement de tête vers le haut pour représenter Jerry cherchant le nid de l’oiseau<br />
…<br />
Ex de gestes symbolisant des idées abstraites :<br />
- Geste manuel ou céphalique de pointage abstrait désignant un point de l’espace sensé représenter un personnage<br />
(l’oiseau, Jerry) ou un objet (le nid, un meuble) de l’histoire (pointage abstrait)<br />
- Mouvement de la main vers la gauche pour symboliser « avant », le passé ou l’accompli, ou vers la droite pour<br />
symboliser « après », le futur ou l’inaccompli<br />
- Mouvement des 2 mains à plat, paumes vers le haut, pour exprimer l’idée de totalité<br />
- Geste céphalique de négation pour exprimer l’ignorance ou l’incapacité d’un personnage<br />
- Geste de la main et des épaules pour exprimer l’impuissance, l’impossibilité d’un personnage de faire quelque chose<br />
...<br />
25
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
< Performative > = geste qui permet la réalisation non verbale d’un acte de langage non assertif (réponse, question,<br />
demande de confirmation, etc.), ou qui renforce ou modifie sa valeur illocutoire lorsqu’il est verbalisé.<br />
Ex de gestes permettant la réalisation non verbale d’un acte de langage :<br />
- Hochement de tête en guise de réponse affirmative<br />
- Geste manuel ou céphalique en guise de réponse négative<br />
- Haussement des épaules, associé ou non à une mimique dubitative, pour exprimer l’ignorance sans passer par la parole<br />
…<br />
Ex de gestes renforçant la valeur de l’acte exprimé verbalement :<br />
- Vigoureux hochement de tête accompagnant une réponse affirmative<br />
- Vigoureux gestes de négation accompagnant une réponse négative<br />
…<br />
Ex de gestes modifiant la valeur de l’acte exprimé verbalement :<br />
- Lorsque le geste ou la mimique contredit la parole : non attesté dans le corpus de Grenoble<br />
…<br />
< Cadrage > = geste réalisé à l’occasion de la narration (pendant le récit d’un événement, en commentant un aspect<br />
de l’histoire, ou en commentant la narration elle-même) et qui exprime un état émotionnel ou un état mental du<br />
locuteur.<br />
Ex :<br />
- Visage prenant les traits de l’amusement pour exprimer le côté comique d’une situation qu’on rapporte<br />
- Visage prenant les traits du dégoût pour exprimer le côté peu attrayant d’une action qu’on rapporte<br />
- Haussement des épaules ou mimique dubitative pour exprimer l’incertitude de ce qu’on asserte<br />
- Haussement des épaules et/ou mimique d’évidence pour exprimer l’évidence de ce qu’on asserte<br />
- Utiliser les guillemets gestuels pour exprimer de la distance par rapport aux termes qu’on emploie<br />
…<br />
< Discursive > = geste généralement bref qui participe à la structuration de la parole et du discours par l’accentuation<br />
ou la mise en relief de certaines unités linguistiques, ou par la segmentation ou le bornage des propositions ou de<br />
constituants discursifs plus larges, ou qui participe à la cohésion discursive par la mise en relation de ces propositions<br />
ou constituants discursifs à l’aide de gestes anaphoriques ou de gestes accompagnant des connecteurs.<br />
Ex de gestes d’accentuation, de mise en relief :<br />
- Mouvements rythmiques (beats) de la tête ou des mains accompagnant l’accentuation de certains mots ou de certaines<br />
syllabes<br />
- Haussement de sourcils accompagnant l’accentuation de certains mots ou de certaines syllabes<br />
Ex de gestes de segmentation, de bornage :<br />
- Mouvement rapide de la main esquissant le geste de chasser quelque chose pour signifier qu’on change d’épisode ou de<br />
plan, qu’on revient au récit après un commentaire ou inversement<br />
Ex de gestes de cohésion discursive :<br />
- Main dessinant la forme d’un contenant pour symboliser le thème ou le titre de l’histoire<br />
- Main dessinant la forme d’un contenant pour symboliser un épisode de l’histoire<br />
- Geste manuel ou céphalique de pointage abstrait ayant une valeur anaphorique de reprise (désignation d’un point de<br />
l’espace frontal pour référer à un personnage ou un objet préalablement référencé et assigné en un point de l’espace)<br />
- Geste représentationnel ayant une valeur anaphorique de reprise (geste qui reproduit fidèlement ou partialement un<br />
geste préalablement accompli pour désigner un même référent de l’histoire)<br />
- Bref geste manuel ou beat produit en accompagnement d’un connecteur<br />
…<br />
< Interactive > = geste et/ ou regard par lequel le locuteur requiert ou vérifie l’attention de son interlocuteur,<br />
manifeste son attention, ou manifeste qu’il a atteint la fin de son tour de parole ou de son récit.<br />
Ex :<br />
- Mouvement rapide de la main ou de la tête, associé à un regard vers l’interlocuteur pour quêter son attention<br />
- Hochement de tête pendant que l’interlocuteur parle<br />
- Orientation de la tête et du regard vers l’interlocuteur à la fin du tour de parole ou du récit<br />
…<br />
< Enonciative > = geste manuel ou expression faciale qui manifeste que le locuteur cherche un mot ou une<br />
expression.<br />
Ex :<br />
- Froncement de sourcils et regard vers le haut tout en cherchant ses mots<br />
- tapotement des doigts, associé ou non à une mimique de réflexion, tout en cherchant ce qu’on va dire<br />
Remarque : si le geste paraît difficile à catégoriser, s’il paraît remplir deux ou plusieurs fonctions à la fois, on peut l’annoter<br />
comme en laissant l’annotation vide. Mais en règle générale, il est préférable de sélectionner une fonction : la fonction qui<br />
parait dominante.<br />
26
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
Etape 3 : < Relation Geste/Parole > définition de la relation du geste aux paroles<br />
correspondantes<br />
Par double clic à l’endroit que l’on souhaite annoter, puis clic sur la valeur choisie dans le menu déroulant :<br />
On sélectionne parmi les valeurs suivantes :<br />
< Redondance > = l’information apportée par le geste est identique à l’information linguistique avec laquelle il est en<br />
relation.<br />
Ex :<br />
Hochement de tête en accompagnement d’un « oui » de réponse affirmative<br />
Haussement des épaules en accompagnement d’un « je ne sais pas » ou d’une réponse dubitative<br />
Geste de pointage déictique vers un objet dénommé explicitement<br />
Remarque : cette annotation ne concerne pas les gestes < représentationnels >, car l’information portée par le geste<br />
dit toujours plus que l’information linguistique.<br />
< Complément > = l’information apportée par le geste fournit un complément nécessaire à l’information linguistique<br />
incomplète avec laquelle il est en relation.<br />
Ex :<br />
Geste de pointage en accompagnement d’un adverbe de localisation tel « ici », « là »<br />
Geste de pointage visant à identifier un objet non dénommé explicitement<br />
Remarque : cette annotation ne concerne que les gestes < déictiques >.<br />
< Elaboration > = l’information apportée par le geste précise celle apportée par la parole en spécifiant la modalité<br />
d’une action, la direction d’un mouvement ou la forme et la dimension d’un objet.<br />
Ex :<br />
« elle part »<br />
****** : déplacement de la main gauche vers la gauche, indique la direction du déplacement<br />
« l’œuf bouge »<br />
********** : oscillation de la main qui représente les vibrations de l’oeuf<br />
« l’oeuf bouge vers le bas »<br />
************** : oscillation de la main, auquel s’ajoute un déplacement de la main vers le bas<br />
Remarque : cette annotation ne concerne que les gestes < représentationnels >.<br />
27
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
< Supplément > = l’information apportée par le geste vient ajouter une signification supplémentaire à celle désignée<br />
par les mots avec lesquels il est en relation.<br />
Ex de geste représentationnel apportant une signification supplémentaire :<br />
- « il essaie d’ sortir »<br />
************ : agite verticalement la main pour représenter le poussin qui bouge à l’intérieur de l’oeuf<br />
- « l’œuf bouge »<br />
********** : oscillation de la main, auquel s’ajoute un déplacement de la main vers le bas<br />
…<br />
Ex de geste performatif apportant une signification supplémentaire :<br />
- Vigoureux hochement de tête accompagnant une réponse affirmative<br />
- Vigoureux gestes de négation accompagnant une réponse négative<br />
…<br />
Ex de geste de cadrage apportant une signification supplémentaire :<br />
- Visage prenant les traits de l’amusement pour exprimer le côté comique d’une situation qu’on rapporte<br />
- Visage prenant les traits du dégoût pour exprimer le côté peu attrayant d’une action qu’on rapporte<br />
- Haussement des épaules ou mimique dubitative pour exprimer l’incertitude de ce qu’on asserte<br />
…<br />
Remarque : tous les gestes de < cadrage > sont à annoter avec < supplément >, sauf s’ils contredisent le message<br />
verbal (cf. annotation suivante).<br />
< Contradiction > = l’information apportée par le geste est non seulement différente de l’information linguistique<br />
avec laquelle il est en relation, mais elle vient contredire celle-ci.<br />
Ex :<br />
Lorsque le geste ou la mimique contredit la parole : non attesté dans le corpus de Grenoble<br />
Remarque : cette annotation ne concerne a priori que les gestes de < cadrage > et les < performatifs >, mais il peut<br />
arriver qu’un geste représentationnel contredise l’information linguistique, comme lorsqu’on parle de trois objets,<br />
mais que le geste symbolise le nombre 2.<br />
< Substitution > = l’information apportée par le geste remplace une information linguistique absente.<br />
Ex :<br />
Hochement de tête en guise de réponse affirmative<br />
Haussement des épaules et mimique en guise d’aveu d’ignorance ou de réponse dubitative<br />
Geste de pointage visant à identifier un objet en l’absence de toute parole<br />
28
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
Etape 4 : < Relation synchronique > indication relative à l’emplacement temporel du geste<br />
par rapport aux paroles correspondantes<br />
Par double clic à l’endroit que l’on souhaite annoter, puis clic sur la valeur choisie dans le menu déroulant :<br />
On sélectionne parmi les valeurs suivantes :<br />
< Synchrone > = le point de départ du stroke (noté *****) se confond avec le point de départ du segment de parole<br />
correspondant (en rouge souligné), qu’il s’agisse d’une syllabe, d’un mot (nom, verbe, adjectif, connecteur…) ou d’un<br />
groupe de mots (la notation *** correspond à la tenue du geste).<br />
Ex :<br />
Elle part<br />
********<br />
< Anticipe > = le point de départ du stroke précède le point de départ du segment de parole correspondant : le locuteur<br />
fait démarrer son geste avant de parler, ou le fait démarrer sur une information linguistique antérieure à celle<br />
correspondant au geste.<br />
Ex :<br />
Et heu – comme ça ça l’ fait sauter à peu près d’ partout<br />
*******<br />
< Suit > = le point de départ du stroke survient après le point de départ du segment de parole correspondant : le<br />
locuteur fait démarrer son geste après avoir fini de parler, ou le fait démarrer sur une information linguistique<br />
postérieure à celle correspondant au geste.<br />
Ex :<br />
Ça tombe – ça va dessus une toile d’araignée<br />
************************************<br />
29
Etape 5 : < Forme du geste ><br />
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
Par double clic à l’endroit que l’on souhaite annoter, puis en saisissant les informations souhaitées dans le bloc<br />
encadré :<br />
On donne une brève description du mouvement annoté en se limitant à ses paramètres saillants :<br />
- origine corporelle du mouvement : tête, buste, épaules, 2 mains, main gauche, main droite, index, sourcils, bouche…<br />
- s’il y a déplacement : sens du déplacement (vers haut, bas, gauche, droite, avant, arrière…)<br />
- s’il y a une configuration manuelle bien nette et visible : forme de la main (main à plat, en tranchant, en poing, en<br />
pronation, en supination, doigts en pince, doigts en cercle…)<br />
- le mouvement lui-même : hochement, battement, cyclique, rapide ou non, répété ou non…<br />
30
Principes<br />
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
6. Contrôle des annotations gestuelles<br />
Le contrôle des annotations gestuelles vise deux objectifs:<br />
- premièrement, examiner les annotations gestuelles réalisées par les deux codeurs indépendants, les valider<br />
ou sélectionner les annotations à valider en cas de désaccord ;<br />
- deuxièmement, mesurer le taux d’accord entre les codeurs.<br />
L’opération de validation ne s’applique qu’aux trois paramètres qui peuvent directement faire l’objet d’une analyse<br />
quantitative : l’identification des gestes, leur valeur ou fonction, et la relation geste/paroles qu’ils manifestent. La<br />
réalisation de cette opération est la tâche d’un troisième codeur, indépendant des deux premiers, qui fixe l’annotation<br />
définitive de ces trois paramètres en utilisant les pistes < Geste(phases)cp >, < Valeur du Geste-cp> et < Relation<br />
Geste/Parole-cp >.<br />
L’opération permettant la mesure du taux d’accord intervient au même moment, et consiste à indiquer s’il y a eu<br />
accord ou désaccord entre les codeurs 1 et 2. On utilise pour cela les pistes < Accord gestes >, < Accord fonction > et<br />
< Accord relation >.<br />
Etape 1 : validation des annotations gestuelles<br />
< Geste(phases)-cp > = Le troisième codeur contrôle et valide l’identification des gestes en recopiant les informations<br />
correspondantes à partir des annotations du premier codeur ou du second codeur.<br />
Annotations du<br />
codeur 1<br />
Annotations du<br />
codeur 2<br />
Validation par<br />
le codeur 3<br />
Deux cas peuvent se présenter :<br />
1. Le codeur 1 et le codeur 2 ont identifié un geste au même endroit de la bande vidéo. Que les frontières des<br />
strokes correspondent totalement ou partiellement (comme dans l’illustration ci-dessus), le codeur 3 recopie<br />
et repositionne les strokes à partir des annotations de l’un ou de l’autre codeur.<br />
2. Seul l’un des deux codeurs a identifié un geste à cet endroit de la bande vidéo (comme pour le premier<br />
stroke annoté par le codeur 1 ci-dessus). Le codeur 3 doit alors arbitrer et décider ou non de la présence d’un<br />
geste. S’il estime qu’un geste a été effectivement produit, il valide l’annotation réalisée par le codeur en<br />
31
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
question en recopiant et repositionnant le stroke correspondant. S’il n’identifie aucun geste, il s’abstient de le<br />
faire et laisse vide l’emplacement correspondant (ou, comme dans l’illustration ci-dessus, la caractérise<br />
comme une phase préparatoire ou autre).<br />
< Valeur du Geste-cp > = Le troisième codeur contrôle et valide la fonction de chacun des gestes identifiés en<br />
sélectionnant dans le menu déroulant celle sélectionnée par le premier codeur et le second codeur. Comme dans le cas<br />
précédent, il arbitre en cas de désaccord entre le codeur 1 et le codeur 2 en sélectionnant la fonction qui lui paraît la<br />
plus appropriée.<br />
Remarque : lorsqu’un geste a été identifié par un seul des deux codeurs et est validé par le troisième codeur, celui-ci<br />
statue sur la fonction à attribuer à ce geste en respectant ou non la sélection opérée par le codeur 1 ou le codeur 2.<br />
< Relation Geste/Parole-cp > = Le troisième codeur contrôle et valide la relation geste/parole pour chacun des gestes<br />
identifiés en sélectionnant dans le menu déroulant celle sélectionnée par premier codeur et le second codeur. Comme<br />
dans le cas précédent, il arbitre en cas de désaccord entre le codeur 1 et le codeur 2 en sélectionnant le type de relation<br />
geste/parole qui lui paraît le plus approprié.<br />
Remarque : lorsqu’un geste a été identifié par un seul des deux codeurs et est validé par le troisième codeur, celui-ci<br />
statue sur le type de relation geste/parole à attribuer à ce geste en respectant ou non la sélection opérée par le codeur 1<br />
ou le codeur 2.<br />
Etape 2 : accords et désaccords inter-codeurs<br />
< Accord gestes > = on vérifie si le codeur 1 et le codeur 2 ont identifié un geste au même endroit (que les frontières<br />
des strokes correspondent exactement ou non) et on sélectionne « accord » dans le menu déroulant, « désaccord » dans<br />
le cas contraire.<br />
Annotations du<br />
codeur 1<br />
Annotations du<br />
codeur 2<br />
Accord/désaccord<br />
(codeur 3)<br />
32
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
< Accord fonction > = on vérifie si le codeur 1 et le codeur 2 ont attribué la même fonction à chaque geste identifié et<br />
on sélectionne « accord » dans le menu déroulant, « désaccord » dans le cas contraire.<br />
Remarque : lorsqu’un geste a été identifié par un seul des deux codeurs puis validé par le troisième codeur, on vérifie<br />
si la fonction attribuée au geste par ce dernier correspond à la sélection opérée par le codeur 1 ou le codeur 2 et on<br />
annote « accord » ou « désaccord » en conséquence.<br />
< Accord relation > = on vérifie si le codeur 1 et le codeur 2 ont attribué le même type de relation geste/parole à<br />
chaque geste identifié et on sélectionne « accord » dans le menu déroulant, « désaccord » dans le cas contraire.<br />
Remarque : lorsqu’un geste a été identifié par un seul des deux codeurs puis validé par le troisième codeur, on vérifie<br />
si le type de relation geste/parole attribuée au geste par ce dernier correspond à la sélection opérée par le codeur 1 ou<br />
le codeur 2 et on annote « accord » ou « désaccord » en conséquence.<br />
33
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
7. Codages additionnels 1<br />
Suivant les propositions de McNeill, Kita, Özyürek et d’autres chercheurs, l’objectif est d’annoter des aspects plus<br />
précis du geste et de la relation geste-parole afin de :<br />
- relever les pointages abstraits ;<br />
- caractériser les gestes représentationnels en fonction de leur référent et du point de vue qu’ils expriment (O-<br />
Vpt / C-Vpt) ;<br />
- étudier le degré de schématisation et d’abstraction présent dans le geste représentationnel : caractériser les<br />
gestes C-Vpt quant au mode d’exécution du mime ; caractériser les gestes O-Vpt quant à la perspective<br />
exprimée ;<br />
- relever les gestes représentationnels et les propositions linguistiques exprimant le déplacement et caractériser<br />
le mode de codage choisi (manner / path ou autre).<br />
Etape 1 : < Pointage abstrait > relevé des pointages abstraits<br />
On annote comme tel tout geste manuel ou céphalique désignant un endroit de l’espace frontal auquel le locuteur fait<br />
correspondre un référent :<br />
- en première mention du référent : geste de localisation dans l’espace frontal, geste indiquant la direction d’un<br />
déplacement ;<br />
- lors du rappel d’un référent : geste à valeur anaphorique ;<br />
- lors d’un pointage sur soi (ma tête, mon bras, etc.) pour représenter un personnage (sa tête, son bras, etc.) :<br />
pointage défini comme « substitutif » ou « par substitution » dans Colletta, 2004.<br />
L’opération s’effectue en cliquant dans le menu déroulant (un seul choix possible).<br />
Remarque : Les gestes de pointage abstrait sont reconnaissables au fait qu’ils ont été préalablement annotés soit<br />
comme ayant une fonction < représentationnelle >, soit comme ayant une fonction < discursive > (dans le cas du<br />
geste anaphorique).<br />
Etape 2 : < Referent > attribution d’un référent à chaque geste représentationnel<br />
On commence par assigner un référent à chaque geste représentationnel : personnage (l’oiseau, l’œuf, la souris…),<br />
action (coudre, rouler, tomber, pousser, percer…), objet (arbre, nid, feuille, maison, lit…) ou autre.<br />
On peut assigner un référent à un geste discursif à condition que celui-ci réalise une anaphore gestuelle (reprise d’un<br />
référent antérieur déjà évoqué gestuellement au cours du même épisode).<br />
1 Dans le cadre du projet Multimodalité qui a servi de cadre à la création de ce manuel d’annotations, ces codages<br />
additionnels ont été décidés a posteriori. Il est parfaitement possible de leur appliquer la même procédure de contrôle<br />
que celle décrite dans la section 6 qui précède.<br />
34
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
Par double clic à l’endroit que l’on souhaite annoter, puis en saisissant les informations souhaitées dans le bloc<br />
encadré :<br />
Remarque : Les codages qui suivent ne concernent que les gestes du concret susceptibles d’exprimer une perspective<br />
(interne ou externe), autrement dit, les gestes ayant pour référent un personnage du dessin animé (l’oiseau, l’œuf ou la<br />
souris).<br />
Etape 3 : < Voice > caractériser le point de vue exprimé par le geste<br />
Par double clic à l’endroit que l’on souhaite annoter, puis clic sur la valeur choisie dans le menu déroulant :<br />
On sélectionne parmi les valeurs suivantes :<br />
- < C-VPT > lorsque le geste exprime un point de vue interne (mime ou représentation d’un personnage, avec<br />
prise de rôle globale de tout le corps, ou prise de rôle partielle du bras ou de la main).<br />
Ex. : geste qui mime l’action de coudre, les mouvements de l’oisillon à l’intérieur de l’œuf, la souris qui attrape le bec de<br />
l’oiseau ou le porte à son nid…<br />
- < O-VPT > lorsque le geste exprime un point de vue externe (pointage exprimant une localisation ou un<br />
déplacement).<br />
Ex. : geste qui pointe vers le haut lorsqu’il est question de la maman oiseau qui s’envole ; geste qui pointe vers le bas pour<br />
exprimer la chute de l’œuf ; geste de pointage localisant un personnage…<br />
- < Mixt > lorsque le geste combine l’expression de deux points de vue (geste combinant O-Vpt et C-vpt, ou<br />
chimère gestuelle (Parrill, 2009) C-vpt + C-vpt).<br />
Ex. : geste qui combine les deux perspectives : la main gauche pointe vers le haut (le nid) tandis que le bras gauche mime la<br />
souris portant l’oiseau ; la main droite trace le déplacement de l’œuf tandis que la gauche en conserve la forme. Chimère<br />
gestuelle : la main gauche représente le bec de l’oiseau tandis que le bras doit représente le bras de la souris.<br />
35
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
Etape 4 : < Voice 2 > caractériser le geste C-Vpt quant au mode d’exécution du mime<br />
Par double clic à l’endroit que l’on souhaite annoter, puis clic sur la valeur choisie dans le menu déroulant :<br />
On sélectionne parmi les valeurs suivantes :<br />
- < Body > lorsqu’un geste C-Vpt réalise une prise de rôle globale, mimétique, de tout le corps.<br />
- < Hand > lorsqu’un geste C-Vpt réalise une prise de rôle partielle, et plus schématique, du bras ou de la main.<br />
Remarque : cette annotation apporte une précision sur les gestes exprimant un point de vue interne, et ne concerne<br />
donc que les gestes annotés < C-VPT > ou < Mixt >.<br />
Etape 5 : < Perspective > caractériser le geste O-Vpt quant à la perspective exprimée<br />
Par double clic à l’endroit que l’on souhaite annoter, puis clic sur la valeur choisie dans le menu déroulant :<br />
36
On sélectionne parmi les valeurs suivantes :<br />
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
- < Inside > lorsque le référent est représenté dans un espace non disjoint des coordonnées spatiales du<br />
locuteur, comme si les référents localisés ou les trajectoires dessinées étaient inclues dans son espace propre.<br />
- < Outside > lorsque le référent est représenté dans un espace disjoint des coordonnées spatiales du locuteur,<br />
comme s’il localisait les référents ou dessinait leurs trajectoires sur un écran placé devant lui ;<br />
Ex. : Un pointage vers le haut pour désigner l’emplacement du nid sera annoté < Outside > si la main reste dans l’espace<br />
frontal du locuteur, mais comme < Inside > si elle s’élève au-dessus de sa tête. Un pointage par substitution vers la tête ou le<br />
bras du locuteur sera aussi annoté comme < Inside >.<br />
Remarque : cette annotation apporte une précision sur les gestes exprimant un point de vue externe, et ne concerne<br />
donc que les gestes annotés < O-VPT > ou < Mixt > (à l’exception des chimères gestuelles).<br />
Etape 6 : relevé des expressions linguistiques et des gestes codant les déplacements des<br />
personnages<br />
< Manner Path Ling > = on annote chaque proposition exprimant le déplacement d’un personnage en sélectionnant<br />
dans le menu déroulant :<br />
- < Path > lorsque la proposition code seulement la direction du déplacement (entrer, sortir, aller dans, aller<br />
vers, monter, descendre, arriver à…) ;<br />
- < Manner > lorsque la proposition code seulement le mode de déplacement (s’envoler, atterrir, rouler,<br />
rebondir, sauter, sautiller, grimper…) ;<br />
- < Both > lorsque la proposition code à la fois la direction et le mode de déplacement (entrer en roulant, rouler<br />
vers, atterrir dans, rebondir sur, marcher vers…) ;<br />
- < Cause > lorsque la proposition code le déplacement d’un personnage comme l’effet d’une cause extérieure<br />
(ramener l’oiseau à son nid, le remettre dans son nid).<br />
37
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
< Manner Path Gst > = on annote chaque geste représentationnel (ou discursif dans le cas d’une anaphore gestuelle)<br />
exprimant le déplacement d’un personnage en sélectionnant dans le menu déroulant :<br />
- < Path > lorsque le geste code seulement la direction du déplacement (geste de pointage) ;<br />
- < Manner > lorsque le geste code seulement le mode de déplacement (geste mimant l’action de s’envoler, de<br />
rouler, de sauter…) ;<br />
- < Both > lorsque le geste code à la fois la direction et le mode de déplacement (geste combinant pointage et<br />
mime d’action) ;<br />
- < Cause > lorsque le geste code le déplacement d’un personnage comme l’effet d’une cause extérieure (mime<br />
impliquant deux personnages).<br />
38
Projet ANR Multimodalité<br />
ANR-05-BLANC-0178-01 et -02<br />
Références<br />
1. Pour les conventions de transcription : utilisation et adaptation des conventions VALIBEL :<br />
http://valibel.fltr.ucl.ac.be/<br />
2. Pour l’annotation des faits linguistiques (définition de la proposition, catégorisation des propositions, connecteurs<br />
et anaphores) appui sur :<br />
Berman, R.A. & Slobin, D.I. (1994). Relating events in narrative : A crosslinguistic developmental study. Hillsdale, NJ :<br />
Lawrence Erlbaum Associates.<br />
Jisa, H. & Kern, S. (1998). Relative clauses in French children’s narrative texts. Journal of Child Language, 25, 623-652.<br />
Colletta, J.-M. (2004). Le développement de la parole chez l’enfant âgé de 6 à 11 ans. Corps, langage et cognition. Hayen,<br />
Mardaga.<br />
Diessel, H. (2004). The acquisition of complex sentences. Cambridge : Cambridge University Press.<br />
3. Pour l’annotation du récit (épisodes, structures, actes…) appui sur :<br />
Labov, W. (1978). Le parler ordinaire. Paris, Minuit.<br />
Berman, R.A. & Slobin, D.I. (1994). Relating events in narrative : A crosslinguistic developmental study. Hillsdale, NJ :<br />
Lawrence Erlbaum Associates.<br />
Laforest, M., Dir. (1996). Autour de la narration. Laval, Québec, Nuit Blanche Editeur.<br />
4. Pour l’annotation de la gestualité (phases, fonctions, relations geste-paroles…) appui sur :<br />
Colletta, J.-M. (2004). Le développement de la parole chez l’enfant âgé de 6 à 11 ans. Corps, langage et cognition. Hayen,<br />
Mardaga.<br />
Kendon, A. (2004). Gesture. Visible action as utterance. Cambridge. Cambridge University Press.<br />
Özcaliskan, S. & Goldin-Meadow, S (2004). Coding manual for gesture-type & gesture-speech relation. Manuscrit<br />
39


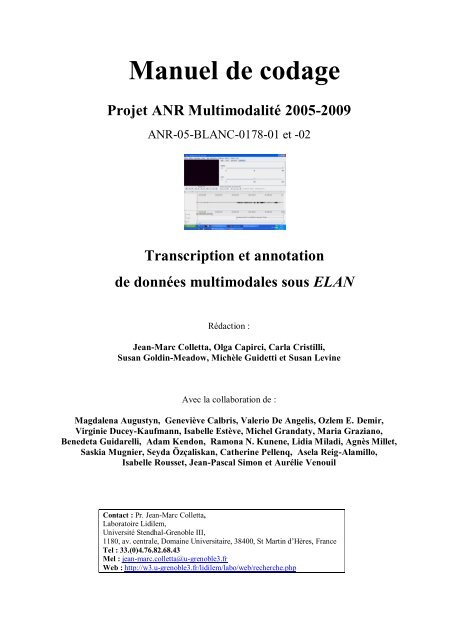


![[Nom de la socit]](https://img.yumpu.com/30885153/1/184x260/nom-de-la-socit.jpg?quality=85)