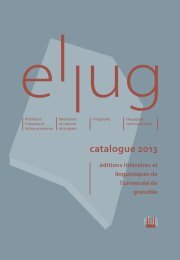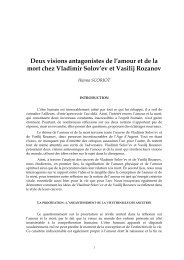téléchargement - Université Stendhal-Grenoble 3
téléchargement - Université Stendhal-Grenoble 3
téléchargement - Université Stendhal-Grenoble 3
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Les représentations sociales de la LSF<br />
ou<br />
Comment penser un sujet Sourd bilingue et biculturel<br />
Agnès Millet - Laboratoire LIDILEM - <strong>Université</strong> <strong>Stendhal</strong> <strong>Grenoble</strong> 3.<br />
Depuis une quinzaine d’années une partie de mes recherches — et de celles des étudiants que<br />
je dirige - ont été consacrées aux représentations sociales qui se développent dans l’espace<br />
social autour de la LSF et de la surdité. Ces représentations confèrent à la langue des statuts<br />
informels qu’il convient d’appréhender, de mettre au jour, pour mieux comprendre les<br />
phénomènes complexes qui peuvent freiner l’expansion de la LSF et donc du bilinguisme<br />
français/LSF chez les Sourds comme chez les entendants. Mais avant d’entrer dans le vif du<br />
sujet, quelques remarques d’ordre théorique et méthodologique s’imposent comme une<br />
manière d’introduction.<br />
1. Remarques introductives<br />
Sans entrer ici dans le détail de la complexité à formaliser ces représentations (MILLET, BILLIEZ,<br />
2001), on précisera simplement qu’elles s’élaborent à propos d’objets sociaux complexes —<br />
et souvent lieux de tensions et d’enjeux symboliques sociaux forts (MOSCOVICI, 1961) — au<br />
sein de groupes socialement différenciés. Les langues étant précisément de tels objets sociaux,<br />
on ne s’étonnera pas que les représentations les concernant soient le plus souvent contrastées<br />
— et spécialement lorsque ladite langue est gestuelle.<br />
Dans la pratique, les représentations sociales circulent dans l’espace et dans le temps par le<br />
biais des discours proférés par des institutions, des pouvoirs, des groupes, des individus. Pour<br />
chacun d’entre nous, elles permettent une certaine forme de connaissance du monde<br />
socialement ancrée, même si cette connaissance procède souvent par transformation,<br />
défalcation ou adjonction de traits (JODELET, 1989) par rapport au savoir, sinon objectif, du<br />
moins objectivé, que serait le savoir savant. On peut résumer en disant qu’elles s’insèrent<br />
dans des formations discursives sociales et dynamiques.<br />
Au plan méthodologique, pour avoir accès aux représentations sociales, il convient donc de<br />
recueillir des discours ou tout au moins du langage. Les psychologues sociaux ont développé<br />
ces dernières années des méthodologies quantitatives (entre autres : GUIMELLI, 1996 ; MOLINER,<br />
1996 ; DOISE, PALMONARI (dir), 1986) dont on a discuté ailleurs (MILLET, BILLIEZ, 2001) l’intérêt.<br />
Néanmoins cette contribution s’appuiera exclusivement sur une méthodologie qualitative, à<br />
partir de discours recueillis par entretiens semi-directifs compréhensifs (KAUFMANN, 1996) —<br />
conduits en LSF avec les Sourds — et analysés (après traduction en français) au moyen de la<br />
traditionnelle technique d’analyse thématique de contenu (entre autres : BARDIN, 1976 ;<br />
D’URUNG, 1976).<br />
Pour terminer ces remarques introductives, on dira que, d’une manière générale, les langues<br />
—et donc, bien sûr, la LSF en particulier — génèrent souvent des représentations construites<br />
sur un socle comparatif en terme de valorisation/dévalorisation 1 . Quand deux langues sont en<br />
présence, il est rare qu’elles soient pensées comme égales, elles seront différenciées par<br />
l’attribution, par les locuteurs — et les non locuteurs ! —, de valeurs et de fonctionnalités<br />
distinctes, selon des facteurs sociaux, économiques et culturels.<br />
1 Sur les implications de ce mouvement voir BILLIEZ (dir), MILLET et al. 2000.<br />
1
Ces valeurs sont, en fait, des jugements de valeurs, des attitudes par rapport aux langues en<br />
présence. Ces attitudes, qui font partie des représentations sociales, n’ont évidemment rien de<br />
linguistique. Du point de vue linguistique — c’est en tout cas le point de vue défendu ici —,<br />
toutes les langues se valent, mais d’un point de vue sociolinguistique — on peut le regretter,<br />
mais c’est ainsi — les langues ne se valent pas : il y en a de “ plus nobles ”, de “ plus belles ”,<br />
de “ plus claires ”, de “ plus synthétiques ”, de “ plus conviviales ”, etc.<br />
Les langues, parce qu’elles sont le ciment de l’identité — tant individuelle que sociale —<br />
sont investies de dimensions qui, en quelque sorte, les dépassent. Ainsi, en cas de présence de<br />
deux langues, lorsqu’elles sont senties comme rivales, une langue se dotera, au niveau<br />
représentationnel, d’un statut supérieur, qui permettra de “ faire des démonstrations ”,<br />
d’argumenter, en sa faveur. Concernant les deux langues, le français et la LSF, ceci est<br />
particulièrement vrai tant dans la sphère familiale que dans la sphère de l’éducation ou dans<br />
celle de la Communauté des Sourds, ce que je vais essayer de montrer dans la suite de cette<br />
contribution. Cette rivalité — ce qu’on pourrait nommer “ conflit linguistique ” — qui est<br />
éminemment sociale, me paraît constituer le cœur du devenir de la LSF — et surtout du<br />
bilinguisme français/LSF —, et je vais essayer de dire pourquoi.<br />
2. Les sphères sociales de l’élaboration des représentations sociales sur la LSF<br />
Comme on l’a vu, les représentations sociales s’élaborent au sein d’espaces sociaux<br />
différenciés. Il convient donc de tenter d’en rendre compte par une typologie, qui, comme<br />
c’est souvent le cas, sera nécessairement une simplification du réel.<br />
Pour ce qui concerne la LSF, on peut, métaphoriquement, se représenter ces espaces comme<br />
des cercles. Au centre, le plus petit cercle est celui de ce qu’on nomme traditionnellement la<br />
“ Communauté Sourde ”. “ Sourd ”, ici, comme c’est maintenant l’usage, prend un S<br />
majuscule qui signifie justement cette appartenance communautaire, s’opposant à “ sourd ”<br />
qui ne renvoie qu’à l’aspect clinique de la surdité.<br />
Un cercle un peu plus grand, figure, en intégrant le premier cercle, ce que j’appellerai le<br />
“ microcosme Sourd ”. Par rapport au premier cercle il intègre toutes les personnes<br />
entendantes convaincues de la réalité de la Communauté Sourde et de la nécessité du<br />
bilinguisme (que ce soit des parents d’enfants sourds, des professionnels du milieu<br />
pédagogique, médical, universitaire, ou autre).<br />
Un cercle encore plus large forme ce qu’on pourrait appeler “ le microcosme surdité ” — avec<br />
un “ s ” minuscule — qui intègre, en plus des deux autres populations, les sourds non intégrés<br />
à la Communauté Sourde et tous les entendants, non spécialement convaincus par la LSF,<br />
gravitant dans le monde de la surdité pour des raisons diverses (professionnelles, familiales,<br />
personnelles).<br />
Enfin, le dernier cercle, le plus vaste, intégrera tous les invidus entendants qui pour des<br />
raisons diverses se forgent des idées, des représentations, sur les Sourds, la LSF, le<br />
bilinguisme et la Communauté Sourde.<br />
Les cercles ne sont évidemment pas étanches : différents discours les traversent, s’influençant<br />
les uns les autres, se recomposant et venant modifier les représentations sociales des uns et<br />
des autres ; cette perméabilité est figurée, dans le schéma ci-dessous, par le fait que les cercles<br />
ne soient pas fermés.<br />
2
Espace social général<br />
Microcosme surdité<br />
Microcosme Sourd<br />
Communauté<br />
Sourde<br />
En terme de dynamique des représentations sociales, les interactions entre les différentes<br />
sphères peuvent être senties comme des intrusions, des formes de mises en danger, ou au<br />
contraire de renforcement — c’est du moins l’hypothèse que nous ferons ici sur les relations<br />
entre les discours.<br />
3. La LSF : ciment d’une identité fragile pour la Communauté Sourde<br />
Après un siècle d’interdiction coercitive, la LSF est sortie de l’ombre il y a une trentaine<br />
d’années. Dans ce laps de temps, les représentations de la Communauté des Sourds se sont<br />
considérablement modifiées. De façon somme toute assez rapide, on est passé d’une langue<br />
un peu honteuse — considérée le plus souvent, non comme une langue, mais comme un vague<br />
moyen d’expression (MILLET, 1993) — à la “ vraie langue ”. On soulignera que c’est souvent<br />
grâce à des formations spécifiques, faites après la sortie du système scolaire, que les Sourds<br />
peuvent élaborer cette représentation positive de la LSF et la penser véritablement comme<br />
langue. Ainsi en témoigne un jeune Sourd de 22 ans :<br />
Avec mes parents on communiquait bien sûr avec la langue des signes mais c’était… c’était<br />
différent quand j’ai fait une formation en langue des signes là vraiment j’ai commencé à avoir un<br />
regard sur ma langue et à comprendre comment ça fonctionnait, etc. Mais avant je n’avais pas de<br />
3
ecul là-dessus, je n’avais pas d’analyse sur la structure de la langue en fait je l’ai découverte<br />
bien plus tard, mais quand j’étais à l’école non absolument pas (in VAMPOUILLE, 1997).<br />
La découverte — souvent tardive — de la LSF, correspond en fait à un parcours identitaire<br />
long et douloureux. Le témoignage d’une femme sourde de 42 ans (in BILLIEZ (dir), MILLET et<br />
al, 2000) est exemplaire de ce parcours en cinq temps que l’on retrouve dans de nombreux<br />
discours.<br />
- Efforts pour s’intégrer aux entendants ;<br />
J’essayais, je disais : “ je vais pouvoir parler ” (...) il fallait que je prenne sur moi (...) je<br />
me disais peut-être que si je portais des appareils, je finirais par entendre et je pourrais parler<br />
très bien.<br />
- Déception due à des difficultés extrêmes de communication rendant plus que périlleuse<br />
l’intégration au groupe majoritaire ;<br />
A mon premier travail, c’était très dur au niveau de la communication, je me sentais vraiment<br />
exclue.<br />
- Eventuellement, période d’isolement ;<br />
A ce moment là, je ne sortais jamais, je ne fréquentais pas du tout les personnes sourdes à<br />
l’extérieur.<br />
- Découverte de la Communauté Sourde et de la langue des signes (souvent un choc) ;<br />
Un Sourd rencontré par hasard m’avait accompagné en voiture à l’association, et alors là, il y<br />
avait plein de Sourds qui s’exprimaient en langue des signes, ça m’avait fichu la chair de poule.<br />
- Stages de formation (formation à la langue)<br />
Quand j’ai fait des stages, là, j’ai vraiment eu un regard extérieur sur la langue des signes, ça<br />
m’a appris plein de chose sur ma langue, sur mon identité en tant que personne sourde.<br />
Ainsi, après plusieurs années de ce qu’on appellera “ errance identitaire ”, la LSF devient le<br />
ciment d’une identité Sourde. Elle est alors pensée comme langue possédant toutes les<br />
capacités linguistiques nécessaires à l’expression de l’individu dans ses dimensions<br />
personnelles, psychologiques et sociales. Le terme qui revient le plus souvent dans les<br />
discours est [RICHE].<br />
Cependant, cette dimension de “ richesse ” peut — toujours dans les discours — prendre une<br />
valeur ambigüe et amener à une ambivalence de position à l’intérieur des différentes sphères<br />
sociales, comme en témoigne le discours d’un jeune Sourd de 20 ans (in VAMPOUILLE, 1997),<br />
dans lequel le terme [RICHE] apparaît tout d’abord à propos des entendants :<br />
Les entendants, ils parlent, ça les rend riches, ils discutent, c’est riche.<br />
Ce trait, attribué aux échanges des entendants, passe ensuite à la LSF<br />
Les Sourds, leur langue est pleine de richesse (...) Mes signes sont riches comme les paroles des<br />
entendants sont riches.<br />
Mais ce jeune Sourd estime par ailleurs que les relations entre Sourds ne sont pas riches :<br />
Il y a de bonnes relations entre Sourds, mais pour ce qui est de la richesse ... y’en a pas vraiment.<br />
4
Autrement dit, sa propre réflexion sur la langue, sa représentation de la LSF comme langue<br />
“ riche ” finit par l’amener à s’exclure en quelque sorte de la Communauté Sourde :<br />
convaincu d’être un être de langage à part entière, il se prend à rêver à une intégration sociale<br />
large et sa représentation des Sourds — dans son discours un “ ils ”, mis typographiquement<br />
en évidence — construit, de façon assez négative, un groupe social étriqué qui ne saurait être<br />
véritablement le sien, ainsi qu’en témoigne l’extrait suivant :<br />
Vraiment ils [les Sourds] n’aiment pas tellement se déplacer vers les entendants parce que... à X<br />
on m’a déjà expliqué ça... parce que les Sourds ont l’habitude des relations... de petites relations<br />
entre eux mais ils ne progressent pas, ça marche bien mais la vie sociale, la communication, c’est<br />
pas possible parce qu’ils... là comme ça en tout petits groupes... des petits groupes, ils pensent pas<br />
aux entendants... ils pensent pas à la société, non, ils pensent pas à tout ça et ils restent en petits<br />
groupes et ils bavardent comme ça... toujours comme ça... toujours comme ça et aussi, du coup,<br />
ils ont un peu peur de s’intégrer aux entendants parce que ces Sourds sont un petit peu coincés et<br />
s’ils s’intègrent aux entendants enfin... c’est pas possible parce que les entendants sont tellement<br />
au-dessus et les Sourds (sourds) c’est vraiment une communication primaire (...)<br />
Ainsi, si la construction d’une représentation positive de la LSF est une avancée objective, les<br />
pratiques peuvent être senties — il s’agit bien ici de représentations de pratiques — comme<br />
n’étant pas à la hauteur des potentialités de la langue. Ces représentations des pratiques<br />
stigmatisent ensuite les individus — et le groupe en l’occurrence —, mettant en porte-à-faux<br />
une construction identitaire déjà difficile.<br />
Si l’étude des représentations sociales peut être d’une quelconque utilité, on serait amené à<br />
dire ici qu’il conviendrait, dans la réalité des pratiques, de réhausser le niveau général<br />
d’utilisation de la LSF ; cela en premier lieu dans la scolarisation des jeunes Sourds, mais<br />
aussi dans l’espace social général. Faute de quoi la “ richesse ” de la LSF affichée dans les<br />
discours ne demeure qu’une arme rhétorique inscrite dans un combat entre deux langues, dans<br />
un conflit — fût-il tu — entre deux communautés : la langue est alors un étendard identitaire,<br />
mais reste — tout comme ses locuteurs — marginalisée socialement.<br />
4. La LSF : de la fascination à l’utilitarisme chez les entendants<br />
C’est, semble-t-il, cette dimension d’étendard identitaire qui est à la source des<br />
représentations sociales élaborées par certains entendants. En effet, les représentations<br />
générales, spécialement dans le plus grand cercle — l’espace social général — se focalisent<br />
sur la matérialité de la langue, son aspect visuel/gestuel, peut-être justement comme trace<br />
d’une identité Sourde. Cet aspect visuel/gestuel intrigue. Ce caractère intriguant peut inquiéter<br />
comme c’était le cas au XIX ème siècle, lorsque les pédagogues récusaient la LSF au nom de la<br />
morale, de la santé et de la religion (MILLET, 2003), il peut aussi fasciner, comme cela semble<br />
être le cas actuellement. En effet, le discours contemporain s’apparente à de la fascination et<br />
paraît donc bien issu du discours de revendication identitaire élaboré au sein de la<br />
Communauté Sourde, dont on trouve un exemple magistral dans la pièce Les enfants du<br />
silence :<br />
Mon langage est aussi valable que le vôtre, plus valable même parce que je peux vous<br />
communiquer en une image une idée plus élaborée que vous pouvez le faire en cinquante mots.<br />
Cette fascination paraît être reliée à l’idée d’une communication en image, corporelle et<br />
évidente. La LSF fascine car elle est représentée comme débordant de la sphère strictement<br />
linguistique, comme glissant a priori et par essence, dans le domaine de l’Art. Ainsi, on<br />
trouve, pour y référer, des termes renvoyant au cinéma, au théâtre ou à la danse. On en<br />
donnera ici deux exemples. Le premier date d’une dizaine d’année, lorsqu’un présentateur de<br />
télévision présentait la LSF “ comme s'exécutant en forme d'arabesques ” (MILLET, 1994). Le<br />
5
second est très récent, il est issu d’une conférence de presse de Jack Lang alors qu’il était<br />
Ministre de l’Education Nationale 2 :<br />
Oui, cette langue gestuelle a une dimension esthétique, elle a une beauté plastique,<br />
chorégraphique indéniable.<br />
Ce type de représentation peut paraître, de prime abord, positif, mais il nous interroge<br />
néanmoins. On se gardera ici de trancher, mais on posera — forme d’invite à une réflexion —<br />
quelques questions, y inscrivant en filigrane notre propre interprétation de ce phénomène de<br />
fascination.<br />
- La LSF est-elle, dans ce type de représentation esthétisante, pensée véritablement comme<br />
une langue ? ou comme tout autre chose — du mime, du théâtre, de la danse, du cinéma 3 ?<br />
- La fascination et la répulsion — telle qu’elle était à l’œuvre au XIX ème siècle — ne sont-elles<br />
pas les deux faces d’une même médaille : l’étrangeté — inquiétante étrangeté bien sûr ?<br />
- La place du corps dans l’espace social ne pourrait-elle alors pas expliquer la valorisation de<br />
l’une ou l’autre face : répulsion lorsque le corps est banni comme au siècle dernier,<br />
fascination lorsqu’il est valorisé comme actuellement ? Si tel était le cas, seraient-ce le corps<br />
du Sourd, sa gestualité, sa dimension spectaculaire qui serait valorisés ou seraient-ce<br />
véritablement sa langue et son identité qui ne sauraient s’y réduire ?<br />
- Cette valorisation esthétique de la LSF ne contient-elle pas une dévalorisation<br />
fonctionnelle ? L’école de sociolinguistique catalane (ARACIL, 1982) a en effet bien montré<br />
que plus une langue est valorisée sur le plan esthétique et/ou affectif (“ la langue du cœur ”,<br />
“ la langue qui chante ”), plus elle est dévalorisée au plan fonctionnel —ses capacités à<br />
pouvoir satisfaire tous les besoins de communication étant alors mises en doute.<br />
Ainsi, il se pourrait, que, comme pour les représentations positives de “ langue riche ”<br />
développées dans la sphère sociale de la Communauté Sourde, la fascination qui semble à<br />
l’œuvre chez les entendants — et spécialement dans l’espace social général — soit un élément<br />
de pure valorisation rhétorique versant positif d’une relégation sociale avérée, dont on<br />
pourrait bien s’accomoder, et ce d’autant que, dans l’espace que l’on a appelé “ microcosme<br />
surdité ”, le plus impliqué et donc le plus influent, les représentations visent effectivement à<br />
une marginalisation de la LSF, par le biais d’une dénégation, d’un refus immédiat ou d’une<br />
instrumentalisation.<br />
En effet, chez les entendants les plus proches de la surdité (parents d’enfants sourds,<br />
orthophonistes, médecins), rare est cette fascination : elle cède très largement le pas à la<br />
méfiance. S’il y a une quinzaine d’années on était souvent dans le déni total (MILLET, 1990 ;<br />
2002)— et spécialement chez les parents d’enfants sourds —, les discours des autres espaces<br />
— ainsi que sans doute, le discours issu des recherches linguistiques développées depuis —<br />
semblent avoir pénétré la sphère du “ microcosme surdité ”. Ainsi le caractère de “ langue à<br />
part entière ” de la LSF ne semble plus mis en doute. Mais si la LSF est bien davantage<br />
pensée comme une langue, elle n’a pas atteint, dans la plupart des représentations sociales, le<br />
même statut que la langue française.<br />
Ainsi pour certains parents, elle est “ la langue pour plus tard ”. L’enfant est supposé pouvoir<br />
choisir, une fois devenu adulte, sa relation à la Communauté Sourde ; les parents ne<br />
souhaitant pas être les promoteurs, en quelque sorte, du bilinguisme et du biculturalisme d’un<br />
adulte dont il ne veulent — ne peuvent ? — vraisemblablement pas projeter la différence<br />
essentielle. On notera d’ailleurs que ce sont souvent ces parents qui évoquent, non plus le<br />
2 Conférence de presse du 13 février 2002.<br />
3 dont on sait qu’ils sont des moyens d’expressions — largement versés sur l’expression individuelle — et non<br />
des systèmes — aux conventions sociales bien établies.<br />
6
caractère trop simple de la LSF comme c’était le cas il y a une dizaine d’années, mais au<br />
contraire son extrême complexité, ses difficultés, la quasi-impossibilité de la maîtriser<br />
vraiment. Les représentations sociales, on le voit, s’emparent de bien des discours, les<br />
intègrent à l’ensemble du système de pensée, en les ré-interprétant pour conforter ce qui, en<br />
l’occurrence, s’apparente vraisemblablement à de la méfiance.<br />
Pour d’autres parents, au contraire, la LSF est “ la langue du début ”. On va l’utiliser avec le<br />
jeune enfant, puis, au fur et à mesure des progrès de l’enfant dans la langue française, on<br />
l’abandonnera. Dans ce cas, la LSF a une pure valeur utilitaire 4 . Cette représentation sociale<br />
utilitariste de la LSF est très présente chez les pédagogues. Elle consiste en une réification,<br />
une dé-socialisation, une dé-culturation de la langue. La LSF devient une technique, un<br />
instrument pédagogique parmi d’autres, évalué à l’aune de sa capacité à amener le Sourd vers<br />
la langue française 5 . Elle est pensée comme une marche vers l’intégration au groupe social<br />
dominant, les autres dimensions langagières (sociales, culturelles, identitaires) étant ressenties<br />
comme des freins à cette intégration.<br />
On le voit, dans toutes ces représentations sociales, ce qui affleure, est la difficulté à penser à<br />
la fois la similitude et l’altérité — l’autre et le même —, la différence construite sur un socle<br />
de ressemblances. Ces représentations de la LSF sont ainsi relativement monolithiques, elles<br />
induisent le monolinguisme : le français ou la LSF 6 . Le Sourd est sommé de choisir son camp,<br />
d’être le “ bon Sourd ” de l’une ou l’autre des parties, d’être “ tout pareil ” (comme un<br />
entendant) ou “ tout différent ” (un “ vrai Sourd ”) ou encore “ deux pareils ” (un Sourd et un<br />
entendant), dans une représentation sociale idéalisante du bilinguisme, que l’on va maintenant<br />
évoquer.<br />
5. Penser le bilinguisme et la biculturalité (manière de plaidoyer non conclusif)<br />
Dans les faits, les Sourds adultes dit “ gestuels ” (les “ tout différents ”) utilisent et la langue<br />
des signes et la langue française à des degrés divers. Ils sont donc bilingues. Par ailleurs, ils<br />
ne vivent pas en ghetto, ils sont en relation avec des entendants, ils sont donc biculturels. Mais<br />
ces pratiques — très variables au demeurant — ne sont pas appréhendées, elles sont hors<br />
champ des représentations qui se construisent souvent sur l’alternative que l’on vient de voir<br />
et qui recoupe partiellement la représentation “ sourd oralisant ”/“ sourd signant ”<br />
D’une façon générale, la tendance est à penser le bilinguisme — toutes les formes de<br />
bilinguismes et pas seulement celui des Sourds — comme devant nécessairement être<br />
équilibré : on se représente l’être bilingue comme ayant une maitrise parfaite de deux langues<br />
et ce dans toutes les situations et selon toutes les modalités langagières. Dans les faits, ce type<br />
de bilinguisme existe sans aucun doute, mais ne représente pas — et loin s’en faut — la<br />
majorité des cas de bilinguisme. On reprendra à notre compte la définition de F. Grosjean<br />
(1993) qui définit en substance comme bilingue tout individu qui utilise, selon les<br />
interlocuteurs ou les situations, deux langues, dans l’une ou l’autre de ses dimensions<br />
(expression ou compréhension, oral ou écrit). Mais le modèle du bilingue idéal reste<br />
surdominant dans les représentations sociales. Il est par exemple remarquable que des Sourds<br />
utilisant le français en permanence (fût-ce dans sa dimension écrite essentiellement) n’arrivent<br />
pas à se définir comme bilingues, et ce sans doute sous le coup d’une double dévalorisation :<br />
4 Ce qui lui confère ce que j’ai appelé ailleurs (MILLET, 1999) un statut de “ langue tremplin ”.<br />
5 Cette conception était déjà présente en filigrane dans les travaux de D. Bouvet (1989) (Cf. MILLET, 2002)<br />
6 Il est d’ailleurs à ce propos remarquable que les filières bilingues dans les Institutions scolaires sont<br />
régulièrement appelées “ filières LSF ”, alors qu’il s’agit bien de projets bilingue.<br />
7
dévalorisation de leurs pratiques de la langue française, et dévalorisation du statut de langue<br />
des signes dans l’espace social. Ainsi lors d’un entretien, alors que je lui expliquai que l’objet<br />
de la recherche était le bilinguisme, une jeune femme sourde de 42 ans m’interrompt (in<br />
BILLIEZ (dir), MILLET et al. 2000) :<br />
D’accord, mais moi je ne me considère pas comme bilingue, je ne suis pas bilingue, pas encore en<br />
tout cas, je ne crois pas être encore bilingue.<br />
L’entretien s’est déroulé durant une heure et voici sa conclusion :<br />
Avant je ne me sentais pas bilingue, mais maintenant oui je peux dire que je me sens bilingue.<br />
Mais avant je n’avais pas conscience de tout ça (...) je me dis que oui je suis bilingue mais avant<br />
je n’avais pas conscience. (...) je ne sais pas, est-ce que je me trompe ?<br />
Le doute persiste certes, mais au moins l’idée de “ bilinguisme ” a-t-elle pu émerger.<br />
Cette prise de conscience, cette représentation émergente de son propre bilinguisme est<br />
pourtant vraisemblablement d’une extrême importance pour la construction sociale et<br />
identitaire du sujet. Le bilinguisme — quelle que soit la pratique des deux langues — doit, à<br />
mon sens être pensé — et spécialement dans les projets didactiques —, faute de quoi les<br />
représentations clivées reliront la réalité en perpétuant la dichotomie “ Sourd oral”/“ Sourd<br />
gestuel ”, extrêmement réductrice en regard des pratiques langagières effectives 7 .<br />
Bien sûr dans ce que j’énonce ici, il faut entendre qu’il faudrait proposer à tous les Sourds une<br />
éducation bilingue, pour éviter les étiquettes hâtives et réductrices, ainsi que les sommations à<br />
être le “ bon Sourd ” ; l’objectif fondamental d’un enseignement bilingue étant au bout de<br />
compte que l’enfant, une fois devenu adulte, puisse se sentir intégré — sans doute à des<br />
degrés divers — dans les deux mondes : celui des Sourds et celui des entendants.<br />
Il conviendrait alors que les représentations sociales — des Sourds, de la surdité, du<br />
bilinguisme et de la LSF — évoluent afin de dépasser l’opposition énoncée plus haut “ tout<br />
pareil ” / “ tout différent ”, sans faire de la LSF l’instrument magique d’une acculturation<br />
rapide à la logique auditive et sans en faire non plus l’étendard d’une différence culturelle<br />
irréductible 8 , et en la prenant pour ce qu’elle est : une langue et non une danse, avec son côté<br />
banal de langue et son côté surprenant — comme toute langue. Une langue ni meilleure, ni<br />
pire pour des individus ni meilleurs, ni pires, des individus — qu’ils soient Sourds ou<br />
entendants — bilingues, bi-culturels, c’est-à-dire un peu pareils, un peu différents, comme<br />
tout le monde.<br />
Références bibliographiques<br />
ARACIL, LL. V.(1982) : Papers de sociolinguistice, Ed. de la Magrana.<br />
BARDIN, L. (1974) : L’analyse de contenu, PUF.<br />
BILLIEZ J. (dir), MILLET A. ET AL. (2000) : Une semaine dans la vie plurilingue à <strong>Grenoble</strong>,<br />
Rapport pour la DGLF, exemplaire photocopié, Lidilem.<br />
BOUVET, D. (1989) : La parole de l’enfant — Pour une éducation bilingue de l’enfant sourd,<br />
Paris, P.U.F., coll. Le fil rouge, première édition 1982..<br />
D’URUNG, M.-C. (1974) : Analyse de contenu, Jean-Pierre Delarge.<br />
DOISE, W.,PALMONARI, A. (dir.) (1986), L’étude des représentations sociales, Delachaux<br />
Niestlé.<br />
7 C’est sans doute cette dichotomie qui, lors du colloque ARILS, à Paris, en mars 2002, a fait que des Sourds,<br />
très impliqués dans la Communauté Sourde, et maitrisant le français écrit, sont montés à la tribune pour<br />
expliquer que le terme de “ bilinguisme ” ne convenait pas pour les Sourds.<br />
8 Je reprend ici ce que j’avais déjà énoncé en 1995 (MILLET, 1995)<br />
8
GROSJEAN, F. (1993) : “ Le bilinguisme et le biculturalisme — essai de définition ”, in Tranel<br />
n° 19, mars 1993, pp. 13-41.<br />
GUIMELLI, CH. (Ed.) (1994) : Structures et transformations des représentations sociales,<br />
Delachaux Niestlé.<br />
JODELET, D. (1989) : “ Représentations sociales, un domaine en pleine expansion ”, in D.<br />
Jodelet (dir.), Les représentations sociales, P.U.F.<br />
KAUFMANN, J.-C. (1996) : L’entretien compréhensif, Nathan, collection 128.<br />
MILLET, A. (1990) : La place de la LSF dans l’intégration scolaire des enfants sourds, Rapport<br />
de recherche Programme 1988 d’action spécifique “ Sciences Humaines et sociales ”,<br />
exemplaire photocopié, <strong>Grenoble</strong>, <strong>Université</strong> <strong>Stendhal</strong>.<br />
MILLET, A. (1993) “ Surdité : déficience sensorielle innée, mutité linguistique acquise ”, in<br />
Tranel N° 19 Bilinguisme et biculturalisme, mars.<br />
MILLET, A., BARRERO, E. (1994) : “ Regards sur les langues, regards sur les êtres ” in Actes du<br />
colloque européen Surdité : nouveaux regards, regards croisés, <strong>Grenoble</strong>, 24-26 novembre<br />
1993 , Greta ed.<br />
MILLET, A. (1995) : “ Surdité et apprentissages linguistiques ”, Voies Livres, Lyon, mars.<br />
MILLET, A. (1999) : Orthographe et écriture - Langage et surdite : Systemes, representations,<br />
variations, Habilitation à Diriger des Recherches, exemplaire photocopié, <strong>Grenoble</strong> 3.<br />
MILLET A., BILLIEZ J. (2001) : “ Représentations sociales : trajets théoriques et méthodologiques<br />
” in Représentations sociales et didactique, Collection Essais, Didier.<br />
MILLET, A. (2002) : “ Représentations sociales de la surdité et de la LSF : quels enjeux<br />
didactiques ? ”, Colloque de Niort L’éducation bilingue et biculturelle pour enfants sourds et<br />
sourds aveugles : une approche transdisciplinaire, février/mars 2002, Actes à paraître.<br />
MILLET, A. (2003) : Que voilent et que dévoilent les représentations sociales de la LSF,<br />
Congrès européen L’éducation bilingue et biculturelle pour enfants sourds et sourds aveugles<br />
: l’approche biculturelle, Poitiers, avril 2003, Actes à paraître.<br />
MOLINER , P. (1996) : Images et représentations sociales, PUG.<br />
MOSCOVICI, P. (1961) : La psychanalyse son image et son public, PUF, 2ème ed. 1976.<br />
VAMPOUILLE, C. (1997) : Langues et communication : représentations sociales d’un public de<br />
jeunes adultes sourds, TER, A. Millet dir., <strong>Grenoble</strong> III.<br />
9





![[Nom de la socit]](https://img.yumpu.com/30885153/1/184x260/nom-de-la-socit.jpg?quality=85)