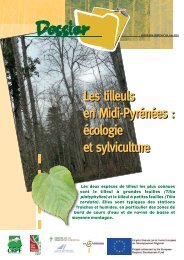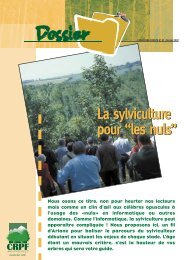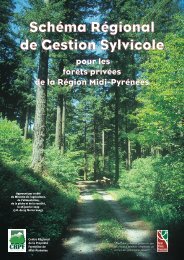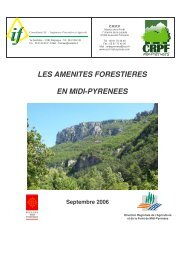Inventaire de Coléoptères saproxyliques - (CRPF) de Midi-Pyrénées
Inventaire de Coléoptères saproxyliques - (CRPF) de Midi-Pyrénées
Inventaire de Coléoptères saproxyliques - (CRPF) de Midi-Pyrénées
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Inventaire</strong> <strong>de</strong> <strong>Coléoptères</strong> <strong>saproxyliques</strong><br />
- Forêt <strong>de</strong> Hèches, Vallée d’Aure, Hautes-<strong>Pyrénées</strong>, France -<br />
Propriété du Groupement Forestier <strong>de</strong>s montagnes particulières <strong>de</strong> Hèches<br />
1/ Introduction<br />
Un organisme saproxylique dépend, pendant tout ou partie <strong>de</strong> son cycle <strong>de</strong> vie, du bois mort ou mourant,<br />
<strong>de</strong>bout ou à terre, ou bien <strong>de</strong>s autres organismes qui utilisent le même milieu (Speight, 1989). L’ensemble<br />
<strong>de</strong> ces organismes constitue un cortège extrêmement varié : il comprend <strong>de</strong>s invertébrés (Insectes,<br />
Arachni<strong>de</strong>s, Collemboles, vers <strong>de</strong> terre ), <strong>de</strong>s champignons (polypores…), <strong>de</strong>s bactéries, mais aussi <strong>de</strong>s<br />
oiseaux (pics, rapaces nocturnes, mésanges…) <strong>de</strong>s mammifères (Mustélidés, Gliridés, Chiroptères…) <strong>de</strong>s<br />
amphibiens (Urodèles, Batraciens), <strong>de</strong>s végétaux (fougères, mousses, lichens…), <strong>de</strong>s reptiles, pour ne<br />
parler que <strong>de</strong>s organismes non aquatiques (Masser et al. 1984, McMinn et Crossley, 1996 ; Dajoz, 1999 ;<br />
…).<br />
Les insectes représentent une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> ce cortège. Les ordres les plus représentés sont les<br />
Diptères, par <strong>de</strong> nombreuses familles dont les Tipulidae, les Syrphidae, les Dolichopodidae, les Asilidae,<br />
… ; (Vaillant, 1978 ; Speight, 1989 ; Sarthou, 1996), et surtout les <strong>Coléoptères</strong>. Ces <strong>de</strong>rniers, dont<br />
l’ensemble représentent en France près du tiers <strong>de</strong>s espèces d’insectes connus (avec environ 10 000<br />
espèces et la moitié associées aux arbres) (Brustel, in De Chatenet, 2000), constitue le groupe le plus<br />
diversifié <strong>de</strong> l’entomofaune, non seulement par leur aspect, mais aussi par la diversité <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vie,<br />
en particulier <strong>de</strong>s types d’alimentation (Brustel in De Chatenet, 2000). La proportion <strong>de</strong>s <strong>saproxyliques</strong> est<br />
souvent estimée en Europe aux alentours <strong>de</strong> 30% <strong>de</strong> la faune <strong>de</strong>s <strong>Coléoptères</strong> forestiers, ce qui<br />
représente environ 500 à 1000 espèces (Geiser, 1983 et Holmzschuch, 1983, in Speight 1989 ;<br />
Sippola, 2001). Brustel (2001) estime que 20 % <strong>de</strong> la faune <strong>de</strong>s coléoptères <strong>de</strong> France est saproxylique,<br />
soit près <strong>de</strong> 2000 espèces ; cette proportion est citée également par <strong>de</strong>s auteurs allemands (Köhler et<br />
Klausnitzer, 1998 et Köhler, 2000 in Brustel, 2001).<br />
Les invertébrés <strong>saproxyliques</strong> peuvent présenter un haut <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> sophistication dans leur mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> vie et<br />
une fidélité quasi exclusive à leur habitat préférentiel (Speight, 1989), ce qui leur confère certes un rôle<br />
primordial, mais en contre partie une sensibilité très forte aux perturbations <strong>de</strong>s milieux, et en particulier à<br />
l’absence (dans le temps ou l’espace) <strong>de</strong>s micro-habitats recherchés.<br />
Les coléoptères <strong>saproxyliques</strong> et la gestion durable <strong>de</strong>s forêts<br />
Les organismes <strong>saproxyliques</strong> sont absolument nécessaires pour le bon fonctionnement <strong>de</strong>s écosystèmes<br />
forestiers.<br />
• Par leur action <strong>de</strong> décomposeurs, ils participent au recyclage <strong>de</strong> la matière organique : les<br />
végétaux retrouvent alors sous <strong>de</strong>s formes assimilables les éléments nutritifs nécessaires à leur<br />
croissance. Ce phénomène est d’autant plus important pour les arbres que le matériau qui produit<br />
le sol par altération (roche ou dépôts superficiels) est chimiquement pauvre et libère <strong>de</strong> faibles<br />
quantités <strong>de</strong> nutriments. Certes, les feuilles qui tombent au sol chaque année représentent la<br />
majorité <strong>de</strong> la matière organique fraîche et les <strong>saproxyliques</strong> n’interviennent pas dans leur<br />
décomposition. Ce rôle est joué en l’occurrence par d’autres groupes d’invertébrés (Acariens,<br />
Collemboles, Myriapo<strong>de</strong>s, Isopo<strong>de</strong>s, Insectes, en particulier <strong>de</strong>s Diptères, et bien sûr <strong>de</strong>s Vers <strong>de</strong><br />
terre), ainsi que <strong>de</strong>s Champignons et <strong>de</strong>s Bactéries (Jabiol et al., 1995 ; Gobat et al., 2003). Mais<br />
on estime que 30 % au moins <strong>de</strong> la biomasse végétale qui est produite chaque année dans un<br />
peuplement forestier est ligneuse (Speight, 1989), et Swift (1997) mentionne que le recyclage <strong>de</strong>s<br />
bois morts par les <strong>saproxyliques</strong> est égal à 50 % du total <strong>de</strong>s nutriments recyclés par la<br />
décomposition <strong>de</strong>s feuilles. De plus, les sources <strong>de</strong> nutriments liées au bois mort sont, par<br />
définition, localisées et l’action <strong>de</strong>s <strong>saproxyliques</strong>, plus ou moins mobiles, assure sa<br />
déconcentration. L’ensemble <strong>de</strong>s décomposeurs <strong>de</strong> bois forestiers est le plus complexe <strong>de</strong> tous<br />
les écosystèmes terrestres (Speight, 1989). La spécialisation parfois extrême <strong>de</strong> ces organismes<br />
permet le recyclage <strong>de</strong> la matière organique sous toutes ses formes : bois mort au sol (chablis,<br />
souches, racines), <strong>de</strong>bout ou en l’air (parties <strong>de</strong> branches, chan<strong>de</strong>lles…) ; même les bois abattus<br />
et partiellement immergés ont leur cortège <strong>de</strong> décomposeurs (Chauvet et al. , 2004). Les différents<br />
auteurs s’accor<strong>de</strong>nt pour distinguer 4 ou souvent 5 sta<strong>de</strong>s <strong>de</strong> saproxylation (cf. annexe 8) (Masser<br />
et al., 1988 ; Sippola, 2001 ; Sittonen, 2001 ; Brustel, 2001 ;...) et on sait que les chan<strong>de</strong>lles et les<br />
bois à terre n’accueillent pas les mêmes éléments du cortège et que l’on peut faire une distinction<br />
Etu<strong>de</strong> Biodiversité Hèches – <strong>Coléoptères</strong> <strong>saproxyliques</strong> – Laurent Larrieu – <strong>CRPF</strong> <strong>Midi</strong>-<strong>Pyrénées</strong> – décembre 2005 5/42<br />
Version scientifique