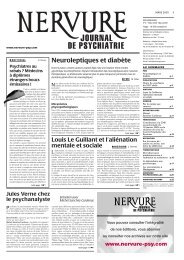Décembre - Nervure Journal de Psychiatrie
Décembre - Nervure Journal de Psychiatrie
Décembre - Nervure Journal de Psychiatrie
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
www.nervure-psy.com<br />
■ EDITORIAL G. Massé<br />
Quelle réforme<br />
<strong>de</strong> la loi <strong>de</strong> 1990 ?<br />
Les trois réunions <strong>de</strong> consultation<br />
qui ont eu lieu en novembre<br />
et décembre <strong>de</strong>rniers,<br />
associant une vingtaine d’organisations<br />
<strong>de</strong> professionnels <strong>de</strong><br />
la psychiatrie, <strong>de</strong> familles et <strong>de</strong> patients<br />
et concernant la réforme <strong>de</strong><br />
la loi du 27 juin 1990, ont abouti à<br />
<strong>de</strong>s positions communes.<br />
Si certains points comme la modification <strong>de</strong>s<br />
commissions départementales <strong>de</strong>s hospitalisations<br />
psychiatriques ou la création d’une<br />
obligation <strong>de</strong> soins en ambulatoire <strong>de</strong>vraient<br />
être retenus sans difficulté, les points d’achoppement<br />
portent sur la création d’un fichier<br />
national <strong>de</strong>s personnes ayant été hospitalisées<br />
d’office, la séparation stricte entre hospitalisation<br />
à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’un tiers et hospitalisation<br />
d’office et le pouvoir donné aux maires<br />
<strong>de</strong> déci<strong>de</strong>r <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière.<br />
L’occasion est donnée <strong>de</strong> tenir compte et <strong>de</strong><br />
valoriser le travail <strong>de</strong> réflexion mené <strong>de</strong>puis<br />
longtemps par les associations d’usagers, <strong>de</strong><br />
familles et les professionnels, afin d’éviter <strong>de</strong>s<br />
réponses <strong>de</strong> faça<strong>de</strong>.<br />
C’est parce que le soin extrahospitalier n’a<br />
pas été suffisamment valorisé et intégré dans<br />
une politique <strong>de</strong> la ville que, pour certains, la<br />
frontière <strong>de</strong>meure encore ténue entre psychiatrie<br />
et enfermement, mala<strong>de</strong>s et délinquants,<br />
hôpital et prison. Il ne l’a pas été suffisamment<br />
parce qu’il n’a pas été assez porté<br />
par les institutions, toutes les institutions, notamment<br />
celles concernées par les effets indirects<br />
du soin.<br />
Souvent, la délinquance n’est que le résultat<br />
d’une absence <strong>de</strong> prévention transversale associant<br />
<strong>de</strong>s démarches sociales, policières, judiciaires<br />
et sanitaires alors que comme l’ont<br />
rappelé récemment J-L. Senon et coll. (1) les<br />
risques majorés concernent notamment <strong>de</strong>s<br />
patients aux antécé<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> violence, en rupture<br />
<strong>de</strong> soins ou non observants, abusant d’alcool<br />
ou <strong>de</strong> drogues, présentant une clinique<br />
(suite page 3 )<br />
Société en mutation,<br />
santé mentale en crise<br />
C<br />
’est parce que la psychiatrie souffre d’une réelle<br />
carence d’information et <strong>de</strong> débat que l’Union<br />
Nationale <strong>de</strong>s Cliniques Psychiatriques Privées<br />
(UNCPSY) a organisé le 9 octobre 2006, au Sénat, un<br />
colloque pour permettre d’échanger sur les gran<strong>de</strong>s<br />
thématiques liées à la santé mentale. Ce colloque<br />
après un accueil par Alain Milon, Sénateur <strong>de</strong> Vaucluse<br />
et une introduction <strong>de</strong> Jacques Gayral, Prési<strong>de</strong>nt<br />
<strong>de</strong> l’UNCPSY, regroupait trois tables-ron<strong>de</strong>s.<br />
La psychiatrie : un miroir <strong>de</strong><br />
notre société<br />
Les maladies mentales aujourd’hui en<br />
France<br />
Pour Louis Masquin (Psychiatre et Directeur <strong>de</strong> la<br />
Clinique Belle Rive), l’objet <strong>de</strong> la psychiatrie n’est<br />
pas le trouble mental, mais l’être humain souffrant <strong>de</strong><br />
Le transsexualisme<br />
De tout temps, <strong>de</strong>s personnes ont refusé<br />
leur sexe d’origine et ont voulu vivre<br />
dans l’autre sexe. C’est seulement en<br />
1953 que le terme « transsexualisme »<br />
a été inventé par Harry Benjamin et<br />
i<strong>de</strong>ntifié comme une entité autonome,<br />
distincte <strong>de</strong> la psychose et <strong>de</strong> la<br />
perversion.<br />
Nous proposons <strong>de</strong> donner un aperçu sur les<br />
connaissances actuelles concernant le transsexualisme.<br />
Après avoir rappelé la définition et les<br />
diagnostics différentiels, nous indiquerons le<br />
protocole <strong>de</strong> prise en charge du patient <strong>de</strong>mandant<br />
une réassignation hormono-chirurgicale du sexe, puis<br />
nous évoquerons les différentes étu<strong>de</strong>s épidémiologique,<br />
étiologiques et thérapeutiques en cours.<br />
Enfin nous évoquerons l’aspect sociétal du transsexualisme.<br />
Aspect clinique<br />
Définition<br />
Dans la CIM-10 (dixième révision <strong>de</strong> la classification<br />
■ HOMMAGE À<br />
B.Devaux, F.-X. Roux<br />
Jean Talairach est né le 15 janvier 1911 à Perpignan.<br />
Il s’intéressa très précocement à la troisième<br />
dimension et tout particulièrement à ce qui était<br />
enfoui : enfant, il aimait jouer dans <strong>de</strong>s caves et <strong>de</strong>s<br />
souterrains ; avec son ami Julian <strong>de</strong> Ajuriaguerra il<br />
avait <strong>de</strong>ssiné pour les Alliés, durant l’occupation alleman<strong>de</strong>,<br />
un plan détaillé <strong>de</strong>s galeries souterraines <strong>de</strong>s<br />
anciennes carrières <strong>de</strong> Paris. Violoniste talentueux,<br />
Talairach reçut une formation en musique tout en<br />
cultivant une passion pour l’architecture - il aimait<br />
<strong>de</strong>ssiner les plans <strong>de</strong> ses <strong>de</strong>meures -, mêlant ainsi l’art<br />
et la géométrie. Rien donc, durant son enfance, ne le<br />
portait vers la mé<strong>de</strong>cine. Sans doute son oncle, qui<br />
dirigeait l’Ecole Navale <strong>de</strong> Santé à Bor<strong>de</strong>aux, a-t-il<br />
finalement influencé son choix puisqu’il commença ses<br />
étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine, à Montpellier où Rouvière fut<br />
l’un <strong>de</strong> ses premiers professeurs d’anatomie, avant<br />
<strong>de</strong> les finir à Paris.<br />
Sous l’influence <strong>de</strong> son cousin Henry Ey, Psychiatre à<br />
l’Hôpital Sainte-Anne, c’est vers la <strong>Psychiatrie</strong>, spé-<br />
trouble mental. Comme la société, la psychiatrie a<br />
connu <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>s évolutions ces <strong>de</strong>rnières décennies.<br />
Les psychoses retiennent encore l’attention <strong>de</strong>s<br />
psychiatres, avec <strong>de</strong>s évolutions très importantes : la<br />
transformation radicale du <strong>de</strong>venir <strong>de</strong>s patients, le<br />
développement <strong>de</strong> nouveaux diagnostics avec, en<br />
particulier, celui <strong>de</strong>s troubles bipolaires et entrées<br />
dans la psychose par la consommation <strong>de</strong> drogues.<br />
Environ 30% <strong>de</strong>s Français sont concernés par les<br />
troubles psychiques, qui sont la <strong>de</strong>uxième cause d’arrêt<br />
<strong>de</strong> travail.<br />
Deuxième cause d’invalidité après les maladies cardiovasculaires,<br />
la dépression peut toucher tous les âges<br />
et elle concerne 15 à 20% <strong>de</strong> la population générale.<br />
La dépression nous interroge à tous les niveaux :<br />
médical, biologique, psychologique, sociologique et<br />
spirituel. L’évolution rapi<strong>de</strong> du mon<strong>de</strong> dans tous les<br />
domaines, le bouleversement radical <strong>de</strong>s repères<br />
<strong>de</strong>s maladies, Organisation Mondiale <strong>de</strong> la Santé,<br />
1993) on retrouve le transsexualisme sous le point<br />
F64 intitulé « Troubles <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntité sexuelle ».<br />
La définition du transsexualisme (F64.0) est la suivante<br />
:<br />
« Il s’agit d’un désir <strong>de</strong> vivre et d’être accepté en tant que personne<br />
appartenant au sexe opposé. Ce désir s’accompagne<br />
habituellement d’un sentiment <strong>de</strong> malaise ou d’inadaptation<br />
envers son propre sexe anatomique et du souhait <strong>de</strong> subir<br />
une intervention chirurgicale ou un traitement hormonal afin<br />
<strong>de</strong> rendre son corps aussi conforme que possible au sexe<br />
désiré.<br />
Directives pour le diagnostic<br />
Pour faire ce diagnostic, l’i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong> type transsexuelle doit<br />
Jean Talairach<br />
■ COLLOQUE<br />
(suite page 9 )<br />
■ FMC C. Berthon<br />
Au même moment, une publication<br />
danoise a attiré l’attention sur la<br />
réassignation hormono-chirurgicale du<br />
sexe (cas <strong>de</strong> Georges Jorgensen), ce qui<br />
eut pour conséquence un très grand<br />
nombre <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> changement <strong>de</strong><br />
sexe dans le mon<strong>de</strong>.<br />
cialité qu’il a toujours considérée comme la plus difficile<br />
<strong>de</strong> toutes, qu’il s’est orienté.<br />
Le parcours <strong>de</strong> l’homme et du<br />
mé<strong>de</strong>cin ...<br />
Jean Talairach arrive ainsi à l’Hôpital Sainte-Anne à 26<br />
ans, en 1937, pour y préparer l’Internat <strong>de</strong>s Hôpitaux<br />
Psychiatriques <strong>de</strong> la Seine, qu’il obtient en 1938. Sa<br />
thèse <strong>de</strong> Doctorat en Mé<strong>de</strong>cine, qu’il a soutenue en<br />
1940, avait pour sujet « Les psychoses ovariennes ». Il<br />
aurait sans doute poursuivi une carrière psychiatrique<br />
s’il n’avait pas rencontré, un jour <strong>de</strong> 1942, Marcel<br />
David, l’un <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux premiers élèves <strong>de</strong> Clovis Vincent,<br />
neurochirurgien à l’Hôpital <strong>de</strong> la Pitié. David<br />
avait besoin d’assistants pour former son équipe neurochirurgicale,<br />
alors hébergée dans le Service <strong>de</strong> Pneumologie<br />
et d’Anatomie Pathologique du Pr Delarue<br />
à l’Hôpital Paul Brousse à Villejuif ainsi que dans le<br />
(suite page 7 )<br />
DÉCEMBRE 2006/JANVIER 2007 1<br />
(suite page 3 )<br />
ISSN 0988-4068<br />
n° 9 - Tome XIX - 12/2006•01/2007<br />
Tirage : 10 000 exemplaires<br />
Directeur <strong>de</strong> la Publication et <strong>de</strong> la<br />
Rédaction : G. Massé<br />
Rédacteur en chef : F. Caroli<br />
Rédaction : Hôpital Sainte-Anne,<br />
1 rue Cabanis - 75014 Paris<br />
Tél. 01 45 65 83 09 - Fax 01 45 65 87 40<br />
Abonnements :<br />
54 bd La Tour Maubourg - 75007 Paris<br />
Tél. 01 45 50 23 08 - Fax 01 45 55 60 80<br />
Prix au numéro : 9,15 €<br />
E-mail : info@nervure-psy.com<br />
AU SOMMAIRE<br />
EDITORIAL<br />
Quelle réforme <strong>de</strong><br />
la loi <strong>de</strong> 1900 ? p.1<br />
FMC<br />
Le transsexualisme p.1<br />
HOMMAGE À<br />
Jean Talairach p.6<br />
COLLOQUE<br />
Société en mutation,<br />
santé mentale en crise p.9<br />
PSYCHOSE ET CRÉATION<br />
Vie et œuvre <strong>de</strong><br />
Robert Schumann p.12<br />
CLINIQUE<br />
Trouble schizoaffectif :<br />
entre schizophrénie et<br />
trouble bipolaire p.14<br />
Pour un abord corporel<br />
après un traumatisme p.15<br />
HISTOIRE<br />
Une petite histoire <strong>de</strong> la<br />
sectorisation psychiatrique<br />
à Lille p.17<br />
HUMEUR<br />
Même pas peur ! p.18<br />
DIALOGUE DE LA<br />
DÉFINITION MINIMALE<br />
Qui suis-je ? Qui est Je ? p.19<br />
ANNONCES<br />
PROFESSIONNELLES p.22<br />
ANNONCES EN BREF p.23<br />
TROUBLES BIPOLAIRES ET<br />
ENVIRONNEMENT<br />
est le thème <strong>de</strong> la table ron<strong>de</strong><br />
qui réunit dans le prochain numéro<br />
Jean-Michel Azorin, Michel Dubec,<br />
Béatrice Laffy-Beaufils, Frédéric Rouillon,<br />
Philippe Carrière et Jean-Paul Chabannes.
N°9 - TOME XIX - DÉCEMBRE 2006/JANVIER 2007<br />
avoir été présente d’une manière persistante<br />
pendant au moins <strong>de</strong>ux ans, ne pas<br />
être un symptôme d’un autre trouble mental<br />
tel qu’une schizophrénie, et ne pas être<br />
associée à une autre anomalie sexuelle<br />
génétique ou chromosomique ».<br />
Dans le DSM IV (Diagnostic and statistical<br />
manual of mental disor<strong>de</strong>rs, American<br />
Psychiatric Association, 1994) le<br />
diagnostic <strong>de</strong> Transsexualisme du DSM<br />
III a été remplacé par celui <strong>de</strong> Trouble<br />
<strong>de</strong> l’I<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong> Genre. On utilise aussi<br />
le terme « dysphorie <strong>de</strong> genre » qui<br />
désigne la souffrance psychique résultant<br />
du stress <strong>de</strong> vivre dans un corps ne<br />
correspondant pas au sexe perçu intérieurement.<br />
Les quatre critères diagnostiques principaux<br />
chez les adolescents et adultes<br />
(co<strong>de</strong> 302.85) sont :<br />
A. I<strong>de</strong>ntification intense et persistante à<br />
l’autre sexe (ne concerne pas exclusivement<br />
le désir d’obtenir les bénéfices culturels<br />
dévolus à l’autre sexe).<br />
Chez les adolescents et les adultes, la perturbation<br />
se manifeste par <strong>de</strong>s symptômes<br />
tels que l’expression d’un désir d’appartenir<br />
à l’autre sexe, l’adoption fréquente <strong>de</strong>s<br />
conduites où on se fait passer pour l’autre<br />
sexe, un désir <strong>de</strong> vivre et d’être traité<br />
comme l’autre sexe, ou la conviction qu’il<br />
(ou elle) possè<strong>de</strong> les sentiments et les réactions<br />
typiques <strong>de</strong> l’autre sexe.<br />
B. Sentiment persistant d’inconfort par rapport<br />
à son sexe ou sentiment d’inadéquation<br />
par rapport à l’i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong> rôle correspondante.<br />
Chez les adolescents et les adultes, l’affection<br />
se manifeste par <strong>de</strong>s symptômes tels<br />
que : vouloir se débarrasser <strong>de</strong> ses caractères<br />
sexuels primaires et secondaires (p. ex.<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> traitement hormonal, <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
d’intervention chirurgicale ou d’autres<br />
procédés afin <strong>de</strong> ressembler à l’autre sexe<br />
par une modification <strong>de</strong>s caractères sexuels<br />
apparents), ou penser que son sexe <strong>de</strong> naissance<br />
n’est pas le bon.<br />
C. L’affection n’est pas concomitante d’une<br />
affection responsable d’un phénotype hermaphrodite.<br />
D. L’affection est à l’origine d’une souffrance<br />
cliniquement significative ou d’une<br />
altération du fonctionnement social, professionnel<br />
ou dans d’autres domaines importants.<br />
Diagnostics différentiels<br />
Le diagnostic <strong>de</strong> transsexualisme est<br />
distinct du point F66 intitulé « Problèmes<br />
psychologiques et comportementaux<br />
associés au développement sexuel et<br />
à l’orientation sexuelle » ou encore du<br />
point F65 intitulé « Troubles <strong>de</strong> la préférence<br />
sexuelle » et qui correspond à ce<br />
qu’on appelait auparavant les « perversions<br />
sexuelles ».<br />
Il est notamment important <strong>de</strong> distinguer<br />
le transsexualisme du « Transvestisme<br />
fétichiste » (F65.1) défini comme<br />
suit :<br />
« Le port <strong>de</strong> vêtements du sexe opposé,<br />
principalement dans le but d’obtenir une<br />
excitation sexuelle. Ce trouble doit être<br />
distingué du fétichisme simple dans la<br />
mesure où les vêtements et les accessoires<br />
fétichistes ne sont pas seulement<br />
portés, mais sont agencés pour créer l’apparence<br />
d’une personne du sexe opposé.<br />
Plusieurs articles vestimentaires sont<br />
habituellement portés ; il s’agit souvent<br />
d’un ensemble complet incluant perruque<br />
et maquillage. Le transvestisme fétichiste<br />
se distingue du transvestisme transsexuel<br />
par son association claire avec<br />
une excitation sexuelle et par le besoin <strong>de</strong><br />
se débarrasser <strong>de</strong>s vêtements une fois<br />
l’orgasme atteint et l’excitation sexuelle<br />
retombée. Des antécé<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> transvestisme<br />
fétichiste sont habituellement rapportés<br />
par les transsexuels et constituent<br />
probablement, dans ces cas, une phase<br />
précoce du développement d’un transsexualisme<br />
».<br />
Les autres diagnostics différentiels sont :<br />
- schizophrénie avec idées délirantes<br />
<strong>de</strong> thématique <strong>de</strong> métamorphose<br />
sexuelle,<br />
- psychopathie avec <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> traitements<br />
hormonaux féminisants à visée<br />
utilitaire (prostitution).<br />
Le transsexualisme<br />
- intersexuation, qui exclut le diagnostic<br />
<strong>de</strong> transsexualisme par définition.<br />
Prise en charge<br />
médicale<br />
Les standards <strong>de</strong> soins<br />
internationaux<br />
La Harry Benjamin International Gen<strong>de</strong>r<br />
Dysphoria Association ou HBIGDA est<br />
une association internationale qui<br />
regroupe <strong>de</strong>s professionnels du mon<strong>de</strong><br />
entier soignants <strong>de</strong>s transsexuels. Elle<br />
édicte, <strong>de</strong>puis 1979, <strong>de</strong>s « gui<strong>de</strong>lines »<br />
thérapeutiques détaillées qui proposent<br />
<strong>de</strong>s schémas cliniques précis pour<br />
la prise en charge <strong>de</strong>s patients souffrant<br />
<strong>de</strong> problèmes d’i<strong>de</strong>ntité sexuelle.<br />
La 6 ème et <strong>de</strong>rnière version date <strong>de</strong><br />
2001.<br />
Certains mé<strong>de</strong>cins s’y réfèrent, d’autres<br />
rédigent leur propre protocole.<br />
Le protocole parisien<br />
Il est établi par B. Cordier, C. Chiland,<br />
T. Gallarda en 2001. Il gui<strong>de</strong> l’évaluation<br />
d’une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> traitement hormono-chirurgical<br />
(THC), il suggère les<br />
bilans à pratiquer et recomman<strong>de</strong> une<br />
pratique collégiale. Il n’a aucune base<br />
légale et il n’est pas définitif. Néanmoins,<br />
il semble reconnu par la Sécurité<br />
sociale, le Conseil <strong>de</strong> l’Ordre <strong>de</strong>s<br />
mé<strong>de</strong>cins et <strong>de</strong>s tribunaux.<br />
Il consiste en une pério<strong>de</strong> d’observation<br />
d’une durée <strong>de</strong> 2 ans minimum<br />
comprenant une évaluation et un suivi<br />
psychiatrique, un bilan endocrinien et<br />
chirurgical, ainsi qu’une expérience <strong>de</strong><br />
vie réelle, « real life test », où le sujet<br />
se présente et vit au quotidien comme<br />
une personne du sexe désiré.<br />
L’évaluation psychiatrique est basée<br />
sur <strong>de</strong>s entretiens réguliers au cours<br />
<strong>de</strong>squels un examen psychiatrique<br />
complet est réalisé, et la psychobiographie<br />
du patient est minutieusement<br />
reconstituée. La rencontre avec la famil-<br />
Quelle réforme <strong>de</strong> la loi <strong>de</strong> 1990 ?<br />
paranoï<strong>de</strong> productive avec persécution<br />
ou syndrome d’influence,<br />
hallucinations impérieuses, une clinique<br />
pseudoneurologique ou une<br />
personnalité psychopathique sous-jacente.<br />
Favoriser l’accès au soin nécessite<br />
d’abor<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s besoins en espérant, au<br />
mieux, une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> directe qui<br />
n’existe souvent pas car médiatisée<br />
par un tiers. Répondre aux besoins<br />
<strong>de</strong> soins sans <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> celui qui<br />
souffre consiste à agir avec d’autres<br />
métiers que ceux <strong>de</strong> la psychiatrie en<br />
sachant que chacun ne peut pas, mais<br />
aussi, ne doit pas exercer selon les logiques<br />
<strong>de</strong>s autres et doit donc les respecter.<br />
De fait, traiter dès que possible, éviter<br />
les rechutes, maintenir la continuité<br />
<strong>de</strong>s soins <strong>de</strong> manière fiable, implique<br />
une répartition <strong>de</strong>s rôles et une<br />
coordination liés aux risques inhérents<br />
à la pathologie ce qui nécessite<br />
un investissement <strong>de</strong>s multiples intervenants<br />
situés en première ligne.<br />
L’adaptation du concept <strong>de</strong> secteur<br />
recouvre, ni plus ni moins, cette évi<strong>de</strong>nce,<br />
ne pas lui rester fidèle en esprit<br />
mais aussi et surtout en pratique<br />
consiste à ne pas investir une réalité<br />
et donc à favoriser, faute <strong>de</strong> mieux,<br />
<strong>de</strong>s réponses répressives sans efficacité.<br />
Ce qu’il faut donc, c’est renforcer et<br />
rendre efficient l’existant, dans l’esprit<br />
du plan psychiatrie et santé mentale<br />
:<br />
- agir sur les facteurs structurels d’in-<br />
le apporte <strong>de</strong>s informations précieuses.<br />
Cette évaluation a pour but d’établir<br />
un diagnostic positif <strong>de</strong> trouble <strong>de</strong><br />
l’i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong> genre, <strong>de</strong> s’assurer que le<br />
trouble est stable et persistant et d’évaluer<br />
les éventuelles conséquences psychosociales.<br />
Un bilan psychologique est réalisé par<br />
<strong>de</strong>s psychologues cliniciens ayant acquis<br />
une expérience dans ce domaine, il<br />
comporte <strong>de</strong>s tests <strong>de</strong> niveau (Binoit-<br />
Pichot) et <strong>de</strong>s tests <strong>de</strong> personnalité<br />
(Rorschach et MMPI).<br />
Le bilan endocrinien consiste en un<br />
examen clinique détaillé (caractères<br />
sexuels secondaires et organes génitaux<br />
externes) et en <strong>de</strong>s examens complémentaires<br />
(caryotype, bilan hormonal…).<br />
Il permet d’éliminer une<br />
affection responsable d’un phénotype<br />
hermaphrodite (critère diagnostique<br />
du trouble <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong> genre) et<br />
<strong>de</strong> s’assurer <strong>de</strong> l’absence <strong>de</strong> contreindications<br />
à la prescription d’un traitement<br />
hormonal ultérieur.<br />
Le bilan chirurgical consiste en un examen<br />
clinique permettant <strong>de</strong> constater<br />
l’état <strong>de</strong>s organes sexuels, <strong>de</strong> rechercher<br />
<strong>de</strong>s anomalies physiques susceptibles<br />
<strong>de</strong> gêner une éventuelle intervention<br />
ultérieure et d’éliminer une<br />
contre-indication opératoire.<br />
Chacun <strong>de</strong>s spécialistes consultés<br />
délivre une information complète et<br />
éclairée au patient.<br />
Au terme <strong>de</strong> ces 2 années d’évaluation,<br />
une commission constituée d’un<br />
psychiatre, d’un endocrinologue et d’un<br />
chirurgien se réunit et déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> la<br />
démarche thérapeutique la plus adaptée.<br />
Si les critères diagnostiques d’un<br />
syndrome transsexuel primaire sont<br />
réunis, si le trouble a <strong>de</strong>s conséquences<br />
psychosociales majeures et s’il n’y a<br />
pas <strong>de</strong> contre-indication d’ordre psychiatrique,<br />
endocrinologique ou chirurgical,<br />
alors l’indication thérapeutique<br />
d’une THC est retenue. Cette décision<br />
doit être prise à l’unanimité. Un certificat<br />
médical attestant le diagnostic et<br />
sécurité <strong>de</strong> la psychiatrie : site, organisation<br />
et spécification <strong>de</strong>s unités sur<br />
le plan <strong>de</strong> la pathologie accueillie et<br />
<strong>de</strong> l’accueil aux urgences, <strong>de</strong> la graduation<br />
<strong>de</strong> la sécurisation, <strong>de</strong>s effectifs,<br />
<strong>de</strong> la formation, <strong>de</strong> la flexibilité<br />
<strong>de</strong> la filière hospitalière ;<br />
- mieux organiser les services ambulatoires<br />
(information-communication,<br />
continuité, réponse téléphonique/régulation,<br />
mobilité, réactivité, procédures<br />
en cas <strong>de</strong> signalement ou <strong>de</strong><br />
rupture <strong>de</strong> traitement, développement<br />
d’équipes mobiles réactives, autoriser<br />
les soins ambulatoires sous<br />
contrainte) ;<br />
- associer systématiquement l’entourage<br />
comme ressource dans les soins,<br />
pour limiter les ruptures avec le patient,<br />
faciliter l’intervention auprès <strong>de</strong><br />
lui s’il n’est pas ou plus <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur,<br />
disposer d’une information plus actualisée<br />
;<br />
- développer <strong>de</strong>s conseils locaux <strong>de</strong><br />
prévention en santé mentale, coordonnés<br />
par les élus ;<br />
- lutter contre l’isolement du mala<strong>de</strong><br />
dans la cité (continuité <strong>de</strong>s soins, développement<br />
<strong>de</strong> l’accompagnement<br />
social : SAVS, SAMSAH), développer<br />
les formations au traitement <strong>de</strong>s<br />
comorbidités ;<br />
- développer un dispositif <strong>de</strong> vigilance<br />
à partir d’indicateurs. ■<br />
(1) SENON J-L., MANZANERA C., HU-<br />
MEAU M., GOTZAMANIS L., Les mala<strong>de</strong>s<br />
mentaux sont-ils plus violents que les citoyens<br />
ordinaires ? L’Information Psychiatrique 2006,<br />
82, 645-652<br />
l’indication thérapeutique, co-signé par<br />
le psychiatre, l’endocrinologue et le chirurgien,<br />
est adressé au mé<strong>de</strong>cin conseil<br />
national <strong>de</strong> la Sécurité sociale en vue<br />
d’obtenir une entente préalable pour la<br />
prise en charge <strong>de</strong> l’intervention chirurgicale.<br />
Le même certificat, mentionnant<br />
seulement les initiales du<br />
patient, est adressé, pour information,<br />
au Conseil national <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong>s<br />
mé<strong>de</strong>cins.<br />
Le traitement hormonochirurgical<br />
Dès que la décision <strong>de</strong> THC a été prise,<br />
le traitement hormonal peut être initié.<br />
Il comporte <strong>de</strong>ux phases : la première,<br />
dont les effets sont réversibles, prévoit<br />
un traitement anti-hormonal, antiandrogénique<br />
chez l’homme et progestatif<br />
puissant bloquant la stimulation<br />
ovarienne chez la femme. La<br />
<strong>de</strong>uxième phase, dont les effets sont<br />
irréversibles ou partiellement réversibles,<br />
comporte une oestrogénothérapie<br />
chez l’homme et la prescription <strong>de</strong><br />
testostérone chez la femme.<br />
Les interventions chirurgicales : chez<br />
l’homme, il s’agit d’une castration bilatérale<br />
suivie <strong>de</strong> la création d’un néovagin,<br />
<strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s lèvres, d’un néo-clitoris<br />
et d’une urétrostomie périnéale ;<br />
chez la femme, il s’agit d’une mammectomie<br />
et d’une hystéro-ovariectomie<br />
non conservatrice, éventuellement<br />
complétée par une phalloplastie.<br />
Le transsexuel opéré <strong>de</strong>vra recevoir<br />
un traitement hormonal substitutif<br />
durant toute sa vie.<br />
Le traitement psychologique<br />
Au cours <strong>de</strong> l’évaluation et ensuite,<br />
quelle que soit la décision thérapeutique,<br />
une prise en charge à visée psychothérapique<br />
est vivement recommandée.<br />
Différentes formes <strong>de</strong><br />
psychothérapies sont utilisées : comportementale<br />
ou psychanalytique, individuelle,<br />
familiale ou groupale. Elles<br />
ont pour but <strong>de</strong> permettre une meilleure<br />
adaptation à la transformation<br />
sexuelle avec la prise en compte <strong>de</strong><br />
ses répercussions sur le fonctionnement<br />
mental et <strong>de</strong>s éventuelles désillusions.<br />
La psychothérapie <strong>de</strong> type analytique<br />
est difficile, car, comme l’écrit C.<br />
Chiland, le sujet transsexuel « ne parle<br />
pas le langage du désir et du conflit » et<br />
« la situation est particulièrement difficile<br />
avec ces patients qui mettent tout sur<br />
la scène corporelle et rien sur la scène<br />
psychique. Notre univers <strong>de</strong> pensée leur<br />
est étranger, nos interprétations leur<br />
paraissent ridicules et inopérantes. Parfois<br />
un éclair d’insight jaillit, mais l’étincelle<br />
retombe rapi<strong>de</strong>ment ».<br />
Aspect <strong>de</strong> la recherche<br />
Sur le plan épidémiologique<br />
La prévalence du transsexualisme est<br />
particulièrement difficile à évaluer. La<br />
plupart <strong>de</strong>s données sont issues <strong>de</strong><br />
centres spécialisés qui recensent les<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> THC qui leur sont adressées.<br />
Cependant certains patients ne<br />
font pas appel à ces centres spécialisés<br />
mais à <strong>de</strong>s psychiatres et <strong>de</strong>s chirurgiens<br />
indépendants, ou recourent à <strong>de</strong>s<br />
voies illégales. Les données produites<br />
connaissent d’importantes variations<br />
suivant les pays. Par exemple, à la fin<br />
<strong>de</strong>s années 1960, la prévalence estimée<br />
était beaucoup plus faible aux<br />
Etats-Unis (1/100 000 hommes et<br />
1/400 000 femmes) qu’en Suisse<br />
(1/37 000 hommes et 1/103 000<br />
femmes). Plus tard, les étu<strong>de</strong>s menées<br />
en Angleterre (1/34 000 hommes et<br />
1/108 000 femmes), en Australie<br />
(1/24 000 hommes et 1/150 000<br />
femmes), ainsi qu’en Allemagne<br />
(1/42 000 hommes et 1/104 000<br />
femmes) confirment les taux <strong>de</strong> prévalence<br />
antérieurs en Suisse établis par<br />
Walin<strong>de</strong>r. Le DSM-IV a regroupé ces<br />
différents résultats et donne une<br />
prévalence moyenne <strong>de</strong>1/30 000<br />
<br />
LIVRES<br />
FMC ■ 3<br />
Eduquer à la sexualité<br />
Un enjeu <strong>de</strong> société<br />
Patrick Pelege et Chantal Picod<br />
Dunod, 25 €<br />
L’idée d’une éducation à la sexualité<br />
pour les jeunes semble avoir fait son<br />
chemin dans l’opinion publique. Du<br />
reste, <strong>de</strong> nombreux ouvrages lui ont<br />
été consacrés, qu’ils soient historiques,<br />
philosophiques, polémiques ou pédagogiques.<br />
Depuis 1994, l’Education<br />
nationale s’en est ressaisie et a<br />
mené une réflexion sur la place et la<br />
légitimité <strong>de</strong> l’école dans cette éducation.<br />
Cette réflexion a débouché<br />
sur les circulaires <strong>de</strong> 1996 et 1998,<br />
la loi <strong>de</strong> 2001, et sa circulaire d’application<br />
<strong>de</strong> 2003 rendant obligatoire<br />
l’éducation à la sexualité <strong>de</strong> la maternelle<br />
à la terminale. Pour que cette<br />
réflexion ne reste pas du côté <strong>de</strong>s<br />
vœux pieux, <strong>de</strong>s formations <strong>de</strong>s<br />
personnels intervenants auprès <strong>de</strong>s<br />
jeunes, mais aussi <strong>de</strong> formateurs<br />
d’adultes ainsi que <strong>de</strong>s outils pédagogiques<br />
ont été développés ces dix<br />
<strong>de</strong>rnières années.<br />
Les <strong>de</strong>ux auteurs <strong>de</strong> cet ouvrage ont<br />
été impliqués dans cette réflexion, à<br />
partir d’actions <strong>de</strong> formations et divers<br />
écrits dont les références sont<br />
données au fil <strong>de</strong> l’ouvrage. Ce travail<br />
définit l’éducation à la sexualité<br />
par rapport à l’éducation sexuelle, et<br />
quelle part <strong>de</strong> cette éducation revenait<br />
à l’institution publique.<br />
Contrairement aux idées reçues, l’entrée<br />
privilégiée <strong>de</strong> l’institution scolaire<br />
pour ce qui constitue les séquences<br />
d’éducation à la sexualité<br />
n’est pas du côté <strong>de</strong> la biologie ou<br />
<strong>de</strong> la reproduction, <strong>de</strong> la contraception<br />
et <strong>de</strong>s IST/VIH sida laissés au<br />
cours <strong>de</strong> SVT, mais se situe résolument<br />
du côté du champ social.<br />
L’ouvrage traite <strong>de</strong> ces aspects en six<br />
chapitres qui abor<strong>de</strong>nt une perspective<br />
anthropologique <strong>de</strong> la sexualité,<br />
les modèles familiaux et sociaux qui<br />
balisent l’i<strong>de</strong>ntité sexuelle, la construction<br />
sociale <strong>de</strong> l’homophobie et du<br />
sexisme, la place et la question <strong>de</strong>s<br />
images et <strong>de</strong>s représentations médiatisées,<br />
dont celles <strong>de</strong> la pornographie,<br />
le développement psychosexuel<br />
<strong>de</strong> la naissance à l’âge adulte,<br />
les enjeux relationnels et éthiques <strong>de</strong><br />
l’éducation à la sexualité.<br />
Perversions<br />
Aux frontières du trauma<br />
Sous la direction <strong>de</strong> Joyce Aïn<br />
Erès, 23 €<br />
Sont présentées, dans cet ouvrage,<br />
les communications et conférences<br />
préparatoires au Carrefour sur les Perversions,<br />
qui s’est tenu à Toulouse en<br />
octobre 2005 à l’initiative <strong>de</strong> l’Association<br />
Carrefours et Médiations. Il<br />
s’agit d’un thème d’actualité, lorsqu’on<br />
sait, par les praticiens <strong>de</strong> terrain,<br />
que le pourcentage d’agresseurs<br />
sexuels en prison est passé en quelques<br />
années <strong>de</strong> 4% (avant 1990) à 25%<br />
(à partir <strong>de</strong> 1995) (Clau<strong>de</strong> Balier). Augmentation<br />
traduisant non pas celle<br />
du nombre <strong>de</strong>s pervers sexuels mais<br />
plutôt une plus gran<strong>de</strong> prise <strong>de</strong><br />
conscience <strong>de</strong> ce genre <strong>de</strong> délits et<br />
donc une élaboration et une application<br />
plus rigoureuse <strong>de</strong> la loi (loi<br />
du 17 juin 1998).<br />
En termes intra-psychiques, la question<br />
est difficile car la perversion, « c’est<br />
le mon<strong>de</strong> en <strong>de</strong>çà <strong>de</strong> la représentation,<br />
<strong>de</strong>s affects, <strong>de</strong>s éprouvés, le mon<strong>de</strong> où<br />
l’autre, l’être humain, est traité comme<br />
objet (...) jetable après avoir servi ».<br />
L‘art peut proposer une figurabilité<br />
<strong>de</strong>s éprouvés. Le psychanalyste peut,<br />
dans certains cas, malgré toute la difficulté<br />
d’une telle entreprise, être<br />
comme « support à faire qu’un patient<br />
puisse passer <strong>de</strong> l’irreprésentable au<br />
représentable, d’en-<strong>de</strong>çà <strong>de</strong> la dépression<br />
à la dépression<strong>de</strong> la douleur<br />
à la souffrance » (Alain Roucoules).<br />
M. Goutal
4<br />
■ FMC<br />
hommes et 1/100 000 femmes.<br />
Le sex ratio varie selon le pays et les<br />
étu<strong>de</strong>s. Il y a plus d’hommes que <strong>de</strong><br />
femmes qui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt un changement<br />
<strong>de</strong> sexe, les chiffres variant <strong>de</strong><br />
8:1 à 2,5:1, la moyenne étant 3:1. Une<br />
exception est la Pologne où le sex ratio<br />
est <strong>de</strong> 5,5 femmes pour 1 homme.<br />
Certains disent que cette particularité<br />
pourrait être due à <strong>de</strong>s critères diagnostiques<br />
différents en Pologne,<br />
d’autres qu’il pourrait s’agir d’une différence<br />
<strong>de</strong> conception du statut féminin<br />
dans les pays <strong>de</strong> l’Est, mais aucune<br />
hypothèse n’a été confirmée.<br />
Sur le plan étiologique<br />
Hypothèses psychologiques<br />
Pour Stoller le transsexualisme rend<br />
compte d’une impossibilité pour l’enfant,<br />
qui vit avec sa mère une symbiose<br />
étroite et aconflictuelle, <strong>de</strong> quitter<br />
une i<strong>de</strong>ntification primaire féminine,<br />
et une impossibilité d’i<strong>de</strong>ntification au<br />
père du fait <strong>de</strong> son absence.<br />
C. Chiland renouvelle l’approche clinique<br />
à partir <strong>de</strong> ses observations d’enfants<br />
dysphoriques <strong>de</strong> genre et <strong>de</strong> leurs<br />
parents. Elle remet en question les positions<br />
<strong>de</strong> Stoller : pour elle le garçon<br />
ne vivrait pas son union avec sa mère<br />
comme aconflictuelle, l’i<strong>de</strong>ntification à<br />
la femme idéalisée parait défensive face<br />
à une image féminine redoutable. De<br />
plus, les pères joueraient un rôle, non<br />
pas par leur absence, mais en raison<br />
<strong>de</strong> leur difficulté à assumer leur virilité.<br />
Son hypothèse est que par leur vécu,<br />
leurs fantasmes, leurs conduites, père et<br />
mère délivrent au garçon <strong>de</strong>s messages<br />
conscients et inconscients qu’il interprète<br />
comme s’il ne pouvait se sentir<br />
exister qu’en tant que membre <strong>de</strong><br />
l’autre sexe.<br />
Hypothèses biologiques<br />
Ce sont les plus récentes, elles donnent<br />
lieu à <strong>de</strong> nombreux travaux <strong>de</strong><br />
recherche.<br />
L’hypothèse d’une anomalie génétique,<br />
et notamment d’une anomalie du gène<br />
HY (situé sur le chromosome Y, contrôlant<br />
l’expression <strong>de</strong> l’antigène HY présent<br />
à la surface <strong>de</strong> toutes les cellules<br />
mâles), n’a pas été confirmée.<br />
L’hypothèse d’une anomalie <strong>de</strong> l’imprégnation<br />
hormonale du cerveau dans<br />
les pério<strong>de</strong>s pré et/ou périnatales, émise<br />
à partir <strong>de</strong> l’observation <strong>de</strong> modèles<br />
animaux expérimentaux et <strong>de</strong> modèles<br />
humains pathologiques (hyperplasie<br />
congénitale <strong>de</strong>s surrénales, testicules<br />
féminisants,…), reste purement théorique.<br />
L’hypothèse d’un dimorphisme anatomique<br />
sexuel cérébral a été émise. Le<br />
transsexualisme serait lié à une discordance<br />
entre la différenciation sexuelle<br />
génitale et la différenciation sexuelle<br />
cérébrale, qui apparaît très précocement<br />
au cours du développement sous<br />
l’influence <strong>de</strong>s hormones sexuelles. Un<br />
dimorphisme sexuel cérébral a été ainsi<br />
observé au niveau <strong>de</strong> l’hypothalamus :<br />
aire préoptique (le SDN : noyau sexuellement<br />
dimorphe, Swaab et al., 1985 ;<br />
INAH-2 et INAH-3 : noyau interstitiel<br />
<strong>de</strong> l’hypothalamus antérieur, Allen et al.,<br />
1989) et noyau du lit <strong>de</strong> la strie terminale<br />
(BST : « bed nucleus of the stria<br />
terminalis », dont la partie centrale BSTc<br />
a un volume 2,5 fois plus grand chez<br />
l’homme que chez la femme, Allen et<br />
al., 1990). Peu d’étu<strong>de</strong>s ont porté sur<br />
les sujets transsexuels. Zhou et al. ont<br />
montré, en 1995, que la BTSc <strong>de</strong>s<br />
transsexuels M->F avait un volume<br />
comparable à celui <strong>de</strong> femmes témoins,<br />
et, en 2000, que le nombre <strong>de</strong> neurones<br />
à somatostatine dans la BTSc<br />
chez le transsexuel correspondait au<br />
sexe qu’il revendiquait. Selon ces<br />
auteurs, ces différences observées ne<br />
peuvent pas s’expliquer par un traitement<br />
oestrogénique ou par une orchi<strong>de</strong>ctomie.<br />
La poursuite <strong>de</strong>s explorations<br />
est nécessaire. Les noyaux<br />
sexuellement dimorphes ont une implication<br />
sur le comportement sexuel <strong>de</strong>s<br />
animaux étudiés.<br />
Cependant, aucune conclusion ne peut<br />
être appliquée à l’homme sans<br />
recherche complémentaire. Le sentiment<br />
d’i<strong>de</strong>ntité sexuée semble propre<br />
à l’homme, étant lié en particulier au<br />
langage. Une meilleure appréciation<br />
<strong>de</strong>s déterminants et <strong>de</strong>s conséquences<br />
cliniques du dimorphisme cérébral est<br />
nécessaire.<br />
Une autre piste <strong>de</strong> recherche est l’approche<br />
neuro-cognitive, étudiée par<br />
B.A. Shaywitz et S.F. Witelson, partant<br />
<strong>de</strong>s différences d’aptitu<strong>de</strong>s cognitives<br />
homme-femme. L’hypothèse étant qu’il<br />
existe une « latéralité hémisphérique »<br />
<strong>de</strong>s fonctions cognitives, différente selon<br />
le sexe, qui serait sous influence hormonale.<br />
Mais la valeur <strong>de</strong> ces différences<br />
cognitives reste encore actuellement<br />
ininterprétable à un niveau<br />
comportemental. De plus, l’influence<br />
<strong>de</strong> nombreux facteurs, notamment<br />
environnementaux, sur les aptitu<strong>de</strong>s<br />
cognitives, reste à évaluer.<br />
Enfin, à coté <strong>de</strong>s hypothèses étiopathogéniques<br />
sus décrites, il faut faire<br />
une place aux explications socio-culturelles.<br />
La dichotomie sociale entre le<br />
genre féminin et le genre masculin<br />
apparaît comme une donnée structurelle<br />
<strong>de</strong> la société. Certains pensent<br />
que c’est l’offre hormono-chirurgicale<br />
qui a suscité et suscite toujours la<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> « réassignation ».<br />
Sur le plan thérapeutique<br />
Les étu<strong>de</strong>s catamnestiques, permettant<br />
d’apprécier l’efficacité <strong>de</strong>s thérapeutiques,<br />
sont difficiles à réaliser (grand<br />
nombre <strong>de</strong> perdus <strong>de</strong> vue et <strong>de</strong> refus<br />
<strong>de</strong> participer aux étu<strong>de</strong>s).<br />
Dans la gran<strong>de</strong> majorité <strong>de</strong>s cas, les<br />
transsexuels sont satisfait du THC, avec<br />
seulement 10% <strong>de</strong> sujets insatisfaits en<br />
moyenne (B. Lundström, et al., 1984 ;<br />
R. Green, D. Fleming, 1990), insatisfaction<br />
qui disparaît le plus souvent<br />
N°9 - TOME XIX - DÉCEMBRE 2006/JANVIER 2007<br />
dans l’année suivant le traitement chirurgical.<br />
Il n’y a que <strong>de</strong> très rares cas <strong>de</strong><br />
regrets post-opératoires : moins <strong>de</strong> 1%<br />
<strong>de</strong> patients F->M et 1,5 % <strong>de</strong> patients<br />
M->F (F. Pfäfflin, 1992 ; Aj. Kuiper,<br />
1991), liés notamment à <strong>de</strong>s erreurs<br />
diagnostiques, une absence <strong>de</strong> real life<br />
test ou un traitement chirurgical inadapté.<br />
Le taux <strong>de</strong> suici<strong>de</strong> est d’environ 1%,<br />
cependant ces suici<strong>de</strong>s ne sont pas<br />
nécessairement imputables à la réassignation<br />
hormono-chirurgicale du sexe.<br />
Les complications <strong>de</strong>s traitements chirurgical<br />
(étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> J. Eldh et al., 1997) et<br />
endocrinien (étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> P. Van Kesteren<br />
et al., 1997) sont rares du fait <strong>de</strong>
N°9 - TOME XIX - DÉCEMBRE 2006/JANVIER 2007<br />
l’amélioration sensible <strong>de</strong> ces thérapeutiques.<br />
Plusieurs étu<strong>de</strong>s ont porté sur les facteurs<br />
prédictifs d’une évolution favorable<br />
ou défavorable après l’opération.<br />
Les principaux critères <strong>de</strong> bon pronostic<br />
sont : absence <strong>de</strong> trouble mental<br />
associé, stabilité psychique et émotionnelle,<br />
âge < 30 ans au moment <strong>de</strong><br />
la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, « real life test » d’un an<br />
minimum, homosexualité, psychothérapie<br />
préalablement à la chirurgie, prise<br />
<strong>de</strong> conscience <strong>de</strong>s limites et <strong>de</strong>s conséquences<br />
<strong>de</strong> la chirurgie.<br />
Des étu<strong>de</strong>s évaluent la réassignation<br />
hormono-chirurgicale <strong>de</strong> sexe chez<br />
l’adolescent. Les arguments d’une prise<br />
en charge précoce sont : apparition <strong>de</strong>s<br />
caractères sexuels secondaires évitée,<br />
retentissement scolaire et relationnel<br />
moins important et donc un meilleur<br />
pronostic. Cependant, la difficulté du<br />
diagnostic <strong>de</strong> transsexualisme à l’adolescence<br />
associé à l’irréversibilité <strong>de</strong>s<br />
sanctions thérapeutiques et aux responsabilités<br />
médicales et éthiques en<br />
jeu, impose une gran<strong>de</strong> pru<strong>de</strong>nce. On<br />
sait que, chez l’adolescent ou le jeune<br />
adulte, <strong>de</strong>s questionnements autour <strong>de</strong><br />
l’i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong> genre et une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
transformation hormono-chirurgicale<br />
apparaissant circonscrits en première<br />
instance peuvent refléter <strong>de</strong>s questionnements<br />
i<strong>de</strong>ntitaires beaucoup plus<br />
globaux, symptomatiques d’une psychose<br />
débutante. Une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> suivi<br />
prospective (Cohen-Kettenis and van<br />
Goozen, 2001) conclut qu’un diagnostic<br />
avec <strong>de</strong>s critères stricts est<br />
nécessaire et suffisant pour justifier un<br />
traitement hormonal chez l’adolescent<br />
transsexuel.<br />
Aspect sociétal<br />
Les associations<br />
Actuellement, via l’abondante littérature<br />
sur ce sujet, le développement<br />
d’associations, <strong>de</strong> revues spécialisées,<br />
et surtout d’Internet, les transsexuels<br />
sont souvent bien informés. Ils arrivent<br />
en consultation avec leur autodiagnostic<br />
et l’unique <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> réassignation<br />
hormono-chirurgicale du sexe.<br />
Les possibilités ouvertes par le World<br />
Wi<strong>de</strong> Web sont utilisées, ce qui<br />
témoigne d’un intérêt mondial pour le<br />
transsexualisme. En ce qui concerne<br />
les sites francophones on peut citer :<br />
Caritig (Centre d’Ai<strong>de</strong>, <strong>de</strong> Recherche et<br />
d’Information sur la Transsexualité et<br />
l’I<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong> Genre) : http://www.caritig.org/,<br />
Association du syndrome <strong>de</strong><br />
Benjamin : http://www.asbfrance.org/,...<br />
Transmettre et témoigner<br />
Effets <strong>de</strong> la violence politique<br />
Colloque 30-31 mars 2006<br />
Le but <strong>de</strong> ces associations, au travers <strong>de</strong><br />
réunions, publications, marches<br />
annuelles, colloques, conférences,<br />
débats, est <strong>de</strong> soutenir les personnes<br />
concernées, <strong>de</strong> les informer sur les<br />
plans médical, juridique et social, <strong>de</strong><br />
les orienter vers <strong>de</strong>s centres spécialisés,<br />
<strong>de</strong> sensibiliser le public, et <strong>de</strong> participer<br />
à la recherche. Certaines militent<br />
pour une déclassification<br />
psychiatrique réfléchie <strong>de</strong> la transsexualité.<br />
Sur le plan juridique<br />
Au-<strong>de</strong>là du domaine médical, le transsexualisme<br />
pose <strong>de</strong>s questions juridiques.<br />
En effet, le changement <strong>de</strong> sexe<br />
ne peut être complet sans modification<br />
<strong>de</strong> l’état civil.<br />
Les solutions adoptées varient selon<br />
les pays.<br />
En France, le changement <strong>de</strong> prénom<br />
n’a pas posé <strong>de</strong> problème important :<br />
pour faciliter la vie quotidienne <strong>de</strong>s<br />
personnes transsexuelles, la jurispru<strong>de</strong>nce<br />
a très vite reconnu que la conviction<br />
d’appartenance à l’autre sexe<br />
constitue « l’intérêt légitime » requis par<br />
l’article 60 du co<strong>de</strong> civil pour permettre<br />
ce changement.<br />
Cependant, cette seule modification<br />
n’est pas suffisante pour assurer aux<br />
transsexuels une vie conforme à leur<br />
nouveau sexe. Il est apparu nécessaire<br />
<strong>de</strong> modifier les actes d’état civil, en y<br />
inscrivant ce changement.<br />
Mais la question du changement <strong>de</strong><br />
sexe entraîne <strong>de</strong> nombreuses difficultés<br />
juridiques, notamment en matière <strong>de</strong><br />
droit <strong>de</strong> la famille (mariage, divorce,<br />
enfants), tant en ce qui concerne la<br />
situation du transsexuel avant modification<br />
<strong>de</strong> l’état civil, qu’après.<br />
En 1982, M. Henri Caillavet, sénateur<br />
du Lot avait élaboré une proposition <strong>de</strong><br />
loi tendant à autoriser les traitements<br />
chirurgicaux et reconnaître le changement<br />
d’état civil <strong>de</strong>s transsexuels.<br />
Cependant, ce texte n’a pas eu <strong>de</strong> suite.<br />
En 1988, M. Guy Braibant, prési<strong>de</strong>nt<br />
<strong>de</strong> la section <strong>de</strong>s rapports et <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s<br />
du Conseil d’État, est chargé par le Premier<br />
Ministre, M. Michel Rocard, <strong>de</strong><br />
constituer un groupe <strong>de</strong> travail pour<br />
réfléchir sur la question du transsexualisme.<br />
Dans ses conclusions, G.<br />
Braibant préconisait <strong>de</strong> ne pas légiférer<br />
sur cette question, contrairement à<br />
beaucoup <strong>de</strong> nos voisins européens,<br />
mais plutôt <strong>de</strong> faciliter le changement<br />
<strong>de</strong> sexe lorsqu’il le faut.<br />
Le législateur n’est donc pas intervenu.<br />
Plusieurs raisons ont été invoquées<br />
La question <strong>de</strong> la transmission aux générations futures concerne tout individu,<br />
communauté, société, victimes <strong>de</strong> violations <strong>de</strong>s droits humains. Le<br />
trauma lié à la violence politique et à la torture ne peut être mis sous silence,<br />
il appelle à être nommé afin <strong>de</strong> pouvoir se dire, s’inscrire et ainsi se transmettre<br />
dans la filiation générationnelle. En l’absence <strong>de</strong> transmission, là où<br />
le trauma ne fait que «trou» dans l’histoire individuelle ou collective, un retour<br />
traumatique sous <strong>de</strong>s formes diverses - violences, souffrances psychiques<br />
ou corporelles est inévitable.<br />
Dire, écrire et, plus généralement, représenter le trauma nous amènent à la<br />
question du témoignage. Qu’est-ce qu’un témoignage ? Quels sont ses objectifs<br />
et ses enjeux ? A qui s’adresse-t-il ? Comment le témoignage (écrit,<br />
parlé, filmé, <strong>de</strong>ssiné ... ) vient-il interroger les limites du transmissible ?<br />
Le but du colloque est <strong>de</strong> repérer les lieux toujours différents du retour <strong>de</strong><br />
ce qui fait malaise dans notre civilisation et <strong>de</strong> questionner les mo<strong>de</strong>s habituels<br />
<strong>de</strong> penser la violence aujourd’hui.<br />
Ce colloque, le troisième organisé par l’association, rend hommage à Primo<br />
Levi, chimiste et écrivain italien, rescapé <strong>de</strong>s camps d’extermination nazis.<br />
Primo Levi est mort le 11 avril 1987. Pour commémorer cette date anniversaire,<br />
les <strong>de</strong>ux thèmes choisis sont ceux qui l’ont accompagné tout au long<br />
<strong>de</strong> sa vie : la transmission et le témoignage.<br />
Inscription<br />
Ce colloque qui aura lieu à la Maison Internationale <strong>de</strong> la Cité Universitaire<br />
<strong>de</strong> Paris, s’adresse à toutes celles et ceux qui s’interrogent sur ce que « l’homme<br />
fait à l’homme » et qui s’y confrontent dans leurs réflexions et pratiques professionnelles.<br />
Plus d’information sur le site Internet <strong>de</strong> l’Association Primo<br />
Levi. www.primolevi.asso.fr/colloques. E-mail : colloque@primolevi.asso.fr<br />
pour justifier cette abstention : risque <strong>de</strong><br />
voir les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s (médicales et judiciaires)<br />
se multiplier, menace <strong>de</strong> fragilisation<br />
du droit <strong>de</strong> la famille, difficulté<br />
<strong>de</strong> légiférer dans un domaine lié à la<br />
mé<strong>de</strong>cine qui est en constante et rapi<strong>de</strong><br />
évolution. En outre, les principes<br />
d’ordre ontologique peuvent se contredire<br />
: liberté individuelle, respect <strong>de</strong> la<br />
vie privée, intégrité physique, morale…<br />
Parallèlement, les tribunaux qui ont été<br />
saisis <strong>de</strong> cette question ont rendu <strong>de</strong>s<br />
décisions qui ont évolué dans le temps.<br />
En application du principe régissant le<br />
droit français <strong>de</strong> « l’indisponibilité <strong>de</strong><br />
l’état <strong>de</strong>s personnes », les tribunaux ont<br />
tout d’abord refusé la modification <strong>de</strong><br />
l’état civil.<br />
Le premier ayant admis cette modification<br />
a été le Tribunal <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong> Instance<br />
<strong>de</strong> Toulouse en 1976.<br />
Mais, en 1987, la Cour <strong>de</strong> Cassation<br />
estimait toujours, au contraire, que le<br />
changement <strong>de</strong> sexe ne résultant pas<br />
d’une cause étrangère à la volonté <strong>de</strong><br />
l’intéressé, l’acte <strong>de</strong> naissance n’avait<br />
pas à être rectifié (arrêt du 3 mars<br />
1987).<br />
Le 25 mars 1992, la Cour Européenne<br />
<strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l’homme a condamné la<br />
position <strong>de</strong>s tribunaux français qui<br />
avaient refusé le changement d’état<br />
civil d’un transsexuel, en déclarant que<br />
cette personne était quotidiennement<br />
placée dans une situation incompatible<br />
avec le respect <strong>de</strong> la vie privée (principe<br />
posé par l’article 8 <strong>de</strong> la Convention<br />
Européenne <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s droits<br />
<strong>de</strong> l’homme).<br />
La Cour <strong>de</strong> Cassation en a tiré les<br />
conséquences et, dans un arrêt du 11<br />
décembre 1992, rendu en assemblée<br />
plénière, elle a admis que la modification<br />
<strong>de</strong> l’état civil pour un « transsexuel<br />
vrai » ne violait pas la règle <strong>de</strong> l’indisponibilité<br />
<strong>de</strong> l’état <strong>de</strong>s personnes mais,<br />
au contraire, assurait le respect <strong>de</strong> la<br />
vie privée et le droit d’établir <strong>de</strong>s relations<br />
avec d’autres êtres humains,<br />
notamment dans le domaine affectif,<br />
pour le développement et l’accomplissement<br />
<strong>de</strong> sa propre personnalité.<br />
Depuis, la Cour <strong>de</strong> Cassation a réaffirmé<br />
cette position à plusieurs reprises.<br />
Désormais, la modification <strong>de</strong> l’état<br />
civil est possible lorsque quatre conditions<br />
sont réunies :<br />
- reconnaissance médicale du syndrome<br />
du transsexualisme, excluant tous<br />
troubles mentaux et autres troubles <strong>de</strong><br />
l’i<strong>de</strong>ntité du genre, effectué au moyen<br />
d’une expertise judiciaire très complète<br />
confiée à <strong>de</strong>s spécialistes, (bien que<br />
parfois, la remise d’attestations émanant<br />
<strong>de</strong> plusieurs mé<strong>de</strong>cins reconnus<br />
pour leur compétence en la matière<br />
et qui ont suivi la personne concernée<br />
est <strong>de</strong> nature à se révéler suffisante) ;<br />
- réalisation d’une THC, dans un but<br />
thérapeutique ;<br />
- apparence physique le rapprochant<br />
du sexe qu’il revendique ;<br />
- et comportement social correspondant<br />
au sexe revendiqué.<br />
Les tribunaux ont eu, jusqu’à maintenant,<br />
peu d’occasion <strong>de</strong> se prononcer<br />
sur les autres aspects <strong>de</strong> la vie familiale.<br />
Les juges seront amenés à trancher<br />
au fur et à mesure <strong>de</strong>s cas qui leur<br />
seront soumis.<br />
Ainsi, la Cour <strong>de</strong> Cassation (arrêt du 18<br />
mai 2005) a validé la décision <strong>de</strong> la<br />
cour d’appel d’Aix en Provence qui a<br />
annulé la reconnaissance <strong>de</strong> paternité<br />
d’un transsexuel (à l’origine <strong>de</strong> sexe<br />
féminin, ayant obtenu la modification<br />
<strong>de</strong> son état civil) qui se trouvait contraire<br />
à la réalité biologique, mais a admis<br />
un droit <strong>de</strong> visite à son profit pour tenir<br />
compte <strong>de</strong> l’intérêt supérieur <strong>de</strong> l’enfant.<br />
Par ailleurs, la Cour européenne <strong>de</strong>s<br />
Droits <strong>de</strong> l’Homme a pris position sur<br />
certains points, et les solutions ainsi<br />
adoptées par cette juridiction européenne<br />
<strong>de</strong>vront s’imposer également<br />
aux tribunaux français.<br />
Dans un arrêt <strong>de</strong> la Gran<strong>de</strong> Chambre<br />
du 11 juillet 2002 (Aff. Christine<br />
Goodwin c/ Royaume-Uni), elle a<br />
considéré qu’en application <strong>de</strong> l’article<br />
12 <strong>de</strong> la Convention Européenne <strong>de</strong>s<br />
Droits <strong>de</strong> l’homme, aucune raison ne<br />
justifie que les transsexuels soient privés<br />
du droit <strong>de</strong> se marier. Elle a <strong>de</strong> plus<br />
déclaré que « la non-reconnaissance juridique<br />
<strong>de</strong> la nouvelle i<strong>de</strong>ntité sexuelle <strong>de</strong><br />
la requérante et <strong>de</strong> son statut juridique <strong>de</strong><br />
transsexuel au Royaume-Uni, en particulier<br />
dans les domaines <strong>de</strong> l’emploi, <strong>de</strong><br />
la sécurité sociale et <strong>de</strong>s pensions, constitue<br />
une méconnaissance par l’État défen<strong>de</strong>ur<br />
<strong>de</strong> son obligation positive <strong>de</strong> lui<br />
garantir le droit au respect <strong>de</strong> sa vie privée<br />
prévu par l’article 8 <strong>de</strong> la Convention<br />
».<br />
Conclusion<br />
Le transsexualisme est une affection<br />
rare et encore peu connue qui génère,<br />
chez le patient, une souffrance intense.<br />
La réassignation hormono-chirurgicale<br />
du sexe est un traitement lourd et<br />
irréversible avec <strong>de</strong>s conséquences<br />
majeures. Cela nécessite donc un diagnostic<br />
précautionneux et une<br />
approche pluridisciplinaire. Ce traitement<br />
est plus palliatif que curatif, mais,<br />
sans celui-ci, la dysphorie <strong>de</strong> genre persiste<br />
et les risques évolutifs sont la<br />
dépression, la désinsertion socioprofessionnelle,<br />
l’isolement affectif, <strong>de</strong>s<br />
tentatives <strong>de</strong> suici<strong>de</strong> ou <strong>de</strong>s automutilations.<br />
L’amélioration <strong>de</strong> la prise en charge<br />
médicale et la création d’unités spécialisées<br />
<strong>de</strong>vrait permettre <strong>de</strong> mieux<br />
étudier cette maladie tant sur le plan<br />
épidémiologique, étiologique que thérapeutique.<br />
■<br />
C. Berthon<br />
Service du Dr. Caroli, CH Sainte-Anne,<br />
Paris 14ème<br />
Bibliographie<br />
(1) CIM-10/ICD-10, Classification Internationale<br />
<strong>de</strong>s Maladies, Dixième révision,<br />
chapitre V, Troubles mentaux et troubles du<br />
comportement, critères diagnostiques pour<br />
la recherche, OMS, Masson, 1994.<br />
(2) DSM IV, Diagnostic and Statistical<br />
Manual of Mental Disor<strong>de</strong>rs (IV), 1996,<br />
category 302.85<br />
(3) Harry Benjamin International Gen<strong>de</strong>r<br />
Dysphoria Association’s, Standards of Care<br />
for Gen<strong>de</strong>r I<strong>de</strong>ntity Disor<strong>de</strong>rs, Sixth Version,<br />
Symposium publishing, Düsseldorf,<br />
2001 ou sur www.hbigda.org<br />
(4) CORDIER B., CHILAND C., GAL-<br />
LARDA T., 2001, Le transsexualisme, proposition<br />
d’un protocole malgré quelques divergences,<br />
Ann Méd Psychol, n°159, pp.<br />
190-195<br />
(5) CHILAND C., CORDIER B., Transsexualisme,<br />
EMC 2000, 37-299-D-20, 1-<br />
11.<br />
(6) MASCLET L., La prise en charge thérapeutique<br />
du patient transsexuel : réflexions<br />
autour d’un cas masculine <strong>de</strong> dysphorie <strong>de</strong><br />
genre, thèse pour le doctorat <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine,<br />
Paris IV, 2000.<br />
(7) COHEN-KETTENIS P.T., GOOREN<br />
L.J.G., Transsexualism: A review of etiology,<br />
diagnosis and treatment, <strong>Journal</strong> of Psychosomatic<br />
Research 1999, Vol 46, 4, 315-<br />
333.<br />
(8) CHILAND C., Que penser du transsexualisme<br />
? Evol. Psy., 1996, 61, 1, 45-<br />
53.<br />
(9) MICHEL A., MORMONT C., LEGROS<br />
J.J., A psycho-endocrinological overview of<br />
transsexualism, European <strong>Journal</strong> of Endocrinology,<br />
2001, Vol 145, Issue 4, 365-<br />
376.<br />
(10) WALINDER J., Inci<strong>de</strong>nce and sex ratio<br />
of transsexualism, Swe<strong>de</strong>n, British <strong>Journal</strong><br />
of Psychiatry 1968, 119, 195±196.<br />
(11) ZHOU J.-N., HOFMAN M.A., GOO-<br />
REN L.J.G. & SWAAB DF., A sex difference<br />
in the human brain and its relation to<br />
transsexuality, Nature 1995, 378, 68±70.<br />
(12) COHEN-KETTENIS P., VAN GOO-<br />
ZEN S., Sex reassignment of adolescent transsexuals:<br />
a follow-up study, <strong>Journal</strong> American<br />
of child adolescent psychiatry, 1997, 36(2),<br />
263-271.<br />
(13) Question écrite n°15380 <strong>de</strong> M.Roger<br />
MADEC (Paris-SOC), la possibilité ouverte<br />
aux personnes <strong>de</strong> genre transsexuel <strong>de</strong> bénéficier<br />
d’un changement d’état civil, p.2995,<br />
JO Sénat du 30.12.2004.<br />
LIVRES<br />
FMC ■ 5<br />
L’erreur médicale<br />
Sous la direction <strong>de</strong> Clau<strong>de</strong><br />
Sureau, Dominique Lecourt,<br />
Georges David<br />
Presses Universitaires <strong>de</strong> France,<br />
10 €<br />
Depuis 2005, le Centre Georges Canguilhem<br />
et l’Académie nationale <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine organisent <strong>de</strong>s séminaires<br />
communs dont le premier a été consacré<br />
à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la filiation. Le second<br />
séminaire organisé en janvier 2006,<br />
avait pour thème les « effets indésirables<br />
» induits par les soins médicaux<br />
et portait un titre volontairement provocateur<br />
: De l’infaillibilité médicale.<br />
Le choix <strong>de</strong> ce thème reflète l’une <strong>de</strong>s<br />
préoccupations <strong>de</strong> la pensée médicale,<br />
mais aussi sociétale et juridique,<br />
face à une mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> plus en plus<br />
performante avec <strong>de</strong>s risques croissants<br />
qu’il convient <strong>de</strong> maîtriser. Il<br />
s’agissait d’inaugurer un débat entre<br />
praticiens du milieu médical, juristes,<br />
philosophes, assureurs, sans oublier<br />
les patients <strong>de</strong>venus <strong>de</strong>s « usagers du<br />
système <strong>de</strong> santé ».<br />
Cet échange d’expériences montre<br />
une évolution : la prise en compte<br />
d’une nécessaire et réelle « prévention<br />
» se substitue à la notion <strong>de</strong> la<br />
seule « compensation » <strong>de</strong>s éventuels<br />
dommages liés à une intervention<br />
médicale. Cette recherche d’une action<br />
efficace <strong>de</strong> prévention suppose<br />
un changement <strong>de</strong> culture <strong>de</strong> la<br />
part <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s personnes du<br />
mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> la santé. La décision <strong>de</strong><br />
publier ces débats relève <strong>de</strong> cette volonté<br />
<strong>de</strong> favoriser le développement<br />
<strong>de</strong> la culture qualité-sécurité, <strong>de</strong> promouvoir<br />
une solidarité renforcée<br />
concernant l’appartenance à un<br />
ensemble humain et technologique<br />
dont l’efficacité dépend, non seulement<br />
compétence individuelle, mais<br />
aussi <strong>de</strong> la conscience d’une co-responsabilité<br />
dans l’efficacité du système<br />
<strong>de</strong> distribution <strong>de</strong>s soins.<br />
Légendaire mélanésien<br />
précédé <strong>de</strong><br />
Mélanésie, invention<br />
plastique et imagination<br />
légendaire<br />
Micheline et Vincent Bounoure<br />
Avant-propos <strong>de</strong> Michel<br />
Lequenne<br />
L’Harmattan, 22,50 €<br />
Micheline et Vincent Bounoure ont<br />
été parmi les membres les plus actifs<br />
du groupe surréaliste <strong>de</strong> Paris, et après<br />
la mort <strong>de</strong> Breton, en 1966, les premiers<br />
à s’opposer aux tentatives <strong>de</strong><br />
liquidation du surréalisme. Pris <strong>de</strong> la<br />
même passion que Breton pour les<br />
arts océaniens et les civilisations sauvages,<br />
ils leur ont consacré quarante<br />
années <strong>de</strong> recherches et <strong>de</strong> travaux,<br />
dont témoignent, parmi d’autres publications,<br />
La Peinture américaine (Rencontre,<br />
1967), Vision d’Océanie (Dapper<br />
1992) et Le Surréalisme et les arts<br />
sauvages (L’Harmattan, 2001), que<br />
vient compléter cet ouvrage.<br />
Micheline et Vincent Bounoure, conjuguant<br />
leur savoir d’océanistes et leurs<br />
dons <strong>de</strong> poètes montrent comment<br />
« invention plastique et imagination<br />
légendaire » se font écho en Mélanésie,<br />
parce que l’une et l’autre témoignent<br />
du « plus grand effort immémorial<br />
pour rendre compte <strong>de</strong><br />
l’interpénétration du physique et du<br />
mental, pour triompher du dualisme<br />
<strong>de</strong> la perception et <strong>de</strong> la représentation,<br />
pour ne pas s’en tenir à l’écorce<br />
et remonter à la sève », selon la formule<br />
d’André Breton.
6<br />
LIVRES<br />
■ HOMMAGE<br />
Michel Foucault<br />
Savoir et pouvoir <strong>de</strong> la mé<strong>de</strong>cine<br />
Bernard Van<strong>de</strong>walle<br />
L’Harmattan, 14,50 €<br />
Foucault a voulu interroger les formes<br />
<strong>de</strong> problématisation qui sont celles<br />
<strong>de</strong> notre époque. L’hypothèse <strong>de</strong><br />
B. Van<strong>de</strong>walle est que la mé<strong>de</strong>cine<br />
constitue à la fois un modèle possible<br />
pour cette interrogation philosophique<br />
(dans la pratique du diagnostic) et le<br />
lieu majeur <strong>de</strong> cette interrogation, à<br />
mesure que la problématisation médicale<br />
est au cœur <strong>de</strong> nos sociétés<br />
hantées par les normes biopolitiques.<br />
On comprend ainsi que Foucault a,<br />
toute sa vie, fait porter sa réflexion<br />
sur la mé<strong>de</strong>cine et ses enjeux, explorant<br />
la dimension archéologique<br />
du savoir médical, la dimension généalogique<br />
du pouvoir que la mé<strong>de</strong>cine<br />
exerce et enfin sa capacité <strong>de</strong><br />
problématiser le sujet sous l’angle <strong>de</strong><br />
l’éthique.<br />
La <strong>de</strong>rnière rupture opérée par Foucault<br />
est méthodologique. Il a sans<br />
doute révolutionné la pratique philosophique<br />
en faisant porter l’analyse<br />
sur ce qu’il appelle archive, sur<br />
la sédimentation d’un discours où le<br />
plan d’un hôpital se révèle aussi important,<br />
et peut-être plus, qu’une référence<br />
philosophique traditionnelle,<br />
où la référence à Bichat ou à Pinel<br />
sera jugée plus opérante que celle<br />
qui ferait appel à Hegel ou à Kant.<br />
Foucault a concentré son attention<br />
sur l’archive grise <strong>de</strong>s hôpitaux et <strong>de</strong>s<br />
asiles, préférant la prose <strong>de</strong>s discours<br />
cliniques ou administratifs à la poésie<br />
philosophique <strong>de</strong> discours plus<br />
séduisants, mais aussi placés plus loin<br />
<strong>de</strong> leurs objets. L’archive <strong>de</strong> Foucault,<br />
ce seront aussi les voix anonymes issues<br />
<strong>de</strong> toutes ces vies minuscules<br />
interpellées par le pouvoir médical<br />
ou psychiatrique et amenées à avouer<br />
une certaine « vérité » sur soi.<br />
Wallon et Piaget<br />
Pour une Critique <strong>de</strong> la<br />
psychologie contemporaine<br />
Emile Jalley<br />
L’Harmattan, 41 €<br />
Wallon et Piaget sont, probablement,<br />
les <strong>de</strong>ux plus grands psychologues<br />
<strong>de</strong> la culture francophone et aussi<br />
européenne.<br />
Le point le plus intéressant <strong>de</strong> leur<br />
dialogue consiste dans l’étroite complémentarité<br />
<strong>de</strong> leurs <strong>de</strong>ux approches<br />
au plan <strong>de</strong>s applications pédagogiques<br />
: Wallon analyserait plutôt la<br />
composante « littéraire », et Piaget davantage<br />
la composante « scientifique »,<br />
d’où se forme le courant unique <strong>de</strong><br />
la pensée <strong>de</strong> l’enfant puis <strong>de</strong> l’adulte.<br />
Cet ouvrage représente pour l’auteur<br />
une étape dans la tentative d’une critique<br />
générale <strong>de</strong>s disciplines psychologiques,<br />
en particulier <strong>de</strong> la psychologie<br />
objective. S’il est facile <strong>de</strong><br />
critiquer la psychanalyse, il l’est moins<br />
<strong>de</strong> critiquer la psychologie scientifique,<br />
dont un examen attentif montre<br />
que la scientificité est à questionner.<br />
L’affaire du Livre noir <strong>de</strong> la psychanalyse,<br />
débutant en 2005, touche, au<strong>de</strong>là<br />
<strong>de</strong> la question relativement limitée<br />
<strong>de</strong>s psychothérapies, à la<br />
confrontation entre la psychanalyse<br />
et l’ensemble <strong>de</strong>s sciences cognitivesneurosciences<br />
- dont la psychologie<br />
et la psychiatrie biologique -, et plus<br />
largement entre <strong>de</strong>ux conceptions <strong>de</strong><br />
la culture occi<strong>de</strong>ntale, l’une <strong>de</strong> type<br />
nord-américain, l’autre européenne.<br />
C’est ce que les péripéties laborieuses<br />
<strong>de</strong> la construction européenne risquent<br />
<strong>de</strong> montrer progressivement.<br />
Il est clair que le dialogue encore très<br />
actuel entre Wallon et Piaget est impliqué<br />
dans ce débat.<br />
<br />
Hommage à Jean Talairach<br />
Service <strong>de</strong> Neurologie <strong>de</strong> l’Hôpital<br />
d’instruction militaire du Val-<strong>de</strong>-Grâce.<br />
Jean Talairach accepta le poste, aux<br />
côtés d’autres Psychiatres <strong>de</strong> l’Hôpital<br />
Sainte-Anne qui s’orientaient, eux, vers<br />
la Neurologie : Henri Hecaen et Julian<br />
<strong>de</strong> Ajuriaguerra. Jean Talairach débutait<br />
donc une carrière <strong>de</strong> neurochirurgien<br />
tout en poursuivant son cursus <strong>de</strong> psychiatre<br />
: en 1944, il était Chef <strong>de</strong> Clinique<br />
<strong>de</strong>s Maladies Mentales et <strong>de</strong> l’Encéphale<br />
dans le Service du Professeur<br />
Jean Delay et neurochirurgien conventionné<br />
au Val-<strong>de</strong>-Grâce ; en 1945 il<br />
était Mé<strong>de</strong>cin <strong>de</strong>s Hôpitaux Psychiatriques<br />
et en 1947 Neurochirurgien-<br />
Assistant à l’Hôpital Paul-Brousse <strong>de</strong><br />
Villejuif. C’est à cette pério<strong>de</strong> qu’il pratiqua<br />
sa première intervention stéréotaxique.<br />
A la mort <strong>de</strong> Pierre Puech en<br />
1950, Marcel David prit la succession<br />
<strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier à l’Hôpital Sainte-Anne<br />
avec toute son équipe. Jean Talairach<br />
<strong>de</strong>vint ainsi Neurochirurgien-Adjoint<br />
au Centre Neurochirurgical <strong>de</strong>s Hôpitaux<br />
Psychiatriques <strong>de</strong> la Seine en<br />
1950. Le Radiologue Hermann Fischgold<br />
rejoignit le groupe et développa à<br />
Sainte-Anne la Neuroradiologie à partir<br />
<strong>de</strong> 1951, tout en participant au<br />
développement <strong>de</strong> l’Electroencéphalographie<br />
en France. En 1952 un Neurologue<br />
<strong>de</strong> la Salpêtrière, Jean Bancaud,<br />
rejoignait l’équipe <strong>de</strong> Marcel David et<br />
allait jouer un rôle fondamental dans le<br />
développement <strong>de</strong> la chirurgie <strong>de</strong> l’épilepsie.<br />
Un arrêté préfectoral du 10 juillet 1958<br />
créa, à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> Marcel David, la<br />
section <strong>de</strong> Stéréotaxie du Service <strong>de</strong><br />
Neurochirurgie. Cette section, qui comportait<br />
12 lits et une salle d’opération<br />
spécifique, fut confiée à Jean Talairach.<br />
Avec son collègue neurochirurgien<br />
du Val-<strong>de</strong>-Grâce Pierre Tournoux, un<br />
Neurochirurgien arrivé <strong>de</strong> Hongrie<br />
cette même année, Gabor Szikla, Jean<br />
Bancaud et Alain Bonis, Neurologue<br />
clinicien arrivé dans l’équipe en 1956,<br />
Talairach s’entourait d’hommes illustres<br />
qui apportèrent tous leur pierre à l’édifice<br />
<strong>de</strong> la Stéréotaxie <strong>de</strong> Sainte-Anne.<br />
En septembre 1958, la salle d’opération<br />
d’un genre nouveau, « réservée à la<br />
Neurochirurgie stéréotaxique et à l’exploration<br />
neurophysiologique du cerveau<br />
», fut construite dans le pavillon <strong>de</strong><br />
Chirurgie <strong>de</strong> l’Hôpital Sainte-Anne.<br />
Cette salle <strong>de</strong> dimensions importantes<br />
en largeur comme en hauteur pour y<br />
loger un appareillage <strong>de</strong> téléradiologie,<br />
fut surnommée « la chapelle ».<br />
En 1960, Marcel David quitta l’hôpital<br />
Sainte-Anne pour prendre la chaire <strong>de</strong><br />
Neurochirurgie <strong>de</strong> la Pitié. Son Service<br />
fut alors scindé en <strong>de</strong>ux : un service<br />
<strong>de</strong> 60 lits (Neurochirurgie A) qui sera<br />
dirigé par Gabriel Mazars et un second<br />
<strong>de</strong> 25 lits (Neurochirurgie B ou stéréotaxique)<br />
dirigé par Jean Talairach.<br />
La même année furent créés un service<br />
d’Anatomie Pathologique et une<br />
Unité <strong>de</strong> Neuroradiologie. En 1961,<br />
les principales activités du Service <strong>de</strong><br />
Neurochirurgie Stéréotaxique concernaient<br />
la Chirurgie <strong>de</strong> l’épilepsie, la<br />
Chirurgie stéréotaxique <strong>de</strong> la maladie<br />
<strong>de</strong> Parkinson, l’irradiation interstitielle<br />
<strong>de</strong>s tumeurs cérébrales et <strong>de</strong> l’hypophyse.<br />
Cette approche nouvelle en<br />
Neurochirurgie, et ces applications innovantes<br />
vont attirer <strong>de</strong> nombreux élèves<br />
français et étrangers au cours <strong>de</strong> cette<br />
pério<strong>de</strong>. Talairach fut nommé Professeur<br />
<strong>de</strong> Neurochirurgie en 1966.<br />
Sous l’impulsion <strong>de</strong>s Cliniciens et <strong>de</strong>s<br />
Chercheurs du Service <strong>de</strong> Neurochirurgie<br />
B, qui souhaitaient disposer d’un<br />
secteur <strong>de</strong> recherche afin <strong>de</strong> développer<br />
l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s mécanismes fondamentaux<br />
<strong>de</strong> l’épilepsie, en parallèle aux<br />
recherches cliniques effectuées dans<br />
leur service, un nouveau bâtiment sera<br />
construit en 1970 aux côtés du pavillon<br />
<strong>de</strong> chirurgie. Ce bâtiment va abriter<br />
<strong>de</strong>ux unités <strong>de</strong> Recherche dont l’une,<br />
l’Unité INSERM U 97, créée le 1 er Jan-<br />
vier 1971 pour « l’exploration fonctionnelle<br />
stéréotaxique et thérapeutique chirurgicale<br />
<strong>de</strong>s épilepsies », sera sous la<br />
direction <strong>de</strong> Jean Talairach. Les travaux<br />
<strong>de</strong> l’Unité U 97 porteront sur l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
modèles animaux d’épilepsie partielle,<br />
<strong>de</strong> différents neuromédiateurs et <strong>de</strong><br />
leurs récepteurs, <strong>de</strong> potentiels évoqués<br />
cognitifs chez l’homme, ... Les équipes<br />
<strong>de</strong> chercheurs et cliniciens se succé<strong>de</strong>ront<br />
aux côtés <strong>de</strong> Talairach jusqu’à son<br />
départ à la retraite en 1980.<br />
Sa retraite en octobre 1980 fut célébrée<br />
à l’Abbaye <strong>de</strong> Royaumont à l’occasion<br />
du Congrès Européen <strong>de</strong> Stéréotaxie<br />
présidé par Gabor Szikla. Mais il ne<br />
quittait pas tout à fait Sainte-Anne.<br />
Dans le bureau qu’il conservait il continuait<br />
à travailler à ses futurs atlas, qui<br />
parurent en 1988 et 1993. Dans son<br />
ancien Service, l’activité <strong>de</strong> Stéréotaxie<br />
continuait sous la direction <strong>de</strong> Gabor<br />
Szikla, entouré <strong>de</strong> Claudio Munari et<br />
d’Antonino Musolino. A la retraite <strong>de</strong><br />
Gabriel Mazars en 1983, les <strong>de</strong>ux Services<br />
<strong>de</strong> Sainte-Anne, séparés <strong>de</strong>puis<br />
1960, fusionnèrent pour ne former à<br />
nouveau qu’un Service, sous la direction<br />
<strong>de</strong> Jean-Paul Chodkiewicz. Au<br />
décès <strong>de</strong> Gabor Szkila, en octobre<br />
1983, Louis Merienne rejoignait le<br />
groupe <strong>de</strong>s Stéréotacticiens du Service<br />
pour s’occuper plus spécifiquement<br />
<strong>de</strong> la radiochirurgie par accélérateur<br />
linéaire, poursuivant et développant<br />
avec l’équipe <strong>de</strong> Radiothérapie <strong>de</strong> l’Hôpital<br />
Tenon le travail pionnier d’Osvaldo<br />
Betti à Sainte-Anne puis à l’Institut<br />
Antartida <strong>de</strong> Buenos Aires. Une<br />
équipe nouvelle succéda à l’ancienne,<br />
pour permettre à la Stéréotaxie et à la<br />
Chirurgie <strong>de</strong>s épilepsies partielles <strong>de</strong><br />
poursuivre leur route à l’hôpital Sainte-<br />
Anne.<br />
Les débuts <strong>de</strong> la<br />
stéréotaxie ...<br />
En 1942, aux origines <strong>de</strong> la carrière<br />
neurochirurgicale <strong>de</strong> Jean Talairach, il<br />
n’était pas encore question <strong>de</strong> Stéréotaxie.<br />
En 1946, le Physiologiste Genevois<br />
A. Monnier exprimait <strong>de</strong>vant la<br />
Société <strong>de</strong> Neurologie <strong>de</strong> Paris le souhait<br />
que « les laborieuses expériences <strong>de</strong><br />
localisation <strong>de</strong>s fonctions nerveuses <strong>de</strong>s<br />
centres sous-corticaux chez l’animal trouvent<br />
un jour une application pratique et<br />
que l’électro<strong>de</strong> du physiologiste remplace,<br />
dans un avenir prochain, le bistouri<br />
du neurochirurgien ». Voeu prémonitoire.<br />
La Stéréotaxie française naquit à<br />
l’issue d’une conférence du Professeur<br />
Jean Lhermitte à l’Hôpital Paul-Brousse<br />
sur le «Thalamus, filtre sélectif <strong>de</strong> la<br />
douleur », en novembre 1947. De la<br />
discussion qui suivit la conférence, entre<br />
Jean Lhermitte, Henri Hecaen et Julian<br />
<strong>de</strong> Ajuriaguerra, il fut proposé à l’Assistant<br />
du Dr Marcel David, Jean Talairach,<br />
<strong>de</strong> fabriquer un instrument (un<br />
« bidule » selon les propres termes<br />
d’Ajuriaguerra) capable <strong>de</strong> permettre,<br />
chez l’homme, une exploration physiologique<br />
du thalamus. Poussé par le<br />
sentiment <strong>de</strong> fausse précision <strong>de</strong>s interventions<br />
<strong>de</strong> Neurochirurgie fonctionnelle<br />
réalisées alors, Jean Talairach se<br />
mit à l’oeuvre. Pour atteindre <strong>de</strong> façon<br />
certaine et en toute sécurité le thalamus,<br />
il lui fallait mettre au point une<br />
métho<strong>de</strong> qui répondait à trois problèmes<br />
: instrumental, radiologique et<br />
anatomique. La stéréotaxie humaine<br />
était née, du moins en Europe, car Jean<br />
Talairach ignorait qu’à la même époque<br />
- et pour être exact quelques mois<br />
avant lui - Spiegel et Wycis avaient réalisé<br />
à Phila<strong>de</strong>lphie, en octobre 1947,<br />
la première intervention stéréotaxique<br />
chez l’homme, une thalamotomie dorsomédiane<br />
pour une psychose suivie<br />
d’une thalamotomie para-commissurale<br />
pour un petit mal épileptique.<br />
La première intervention chirurgicale<br />
stéréotaxique eut lieu le 7 décembre<br />
1948, à l’hôpital Paul Brousse. Entou-<br />
ré <strong>de</strong> son patron, Marcel David, d’Henri<br />
Hecaen, <strong>de</strong> Julian <strong>de</strong> Ajuriaguerra et<br />
<strong>de</strong> Monnier, Jean Talairach réalisait à<br />
l’ai<strong>de</strong> d’un appareillage stéréotaxique,<br />
une électrocoagulation <strong>de</strong>s noyaux thalamiques<br />
ventropostéro-médian (noyau<br />
semi-lunaire <strong>de</strong> Flechsig) et noyau centromédian<br />
chez un patient <strong>de</strong> 72 ans<br />
atteint d’algies faciales sévères post-zostériennes.<br />
Les suites ne furent marquées<br />
que par une hypoesthésie transitoire<br />
<strong>de</strong> l’hémiface et les douleurs<br />
disparurent ... pendant 6 mois.<br />
Les travaux<br />
anatomiques<br />
Au cours <strong>de</strong>s années 1940, les travaux<br />
<strong>de</strong> Neurophysiologie s’intéressaient<br />
essentiellement aux formations grises<br />
souscorticales. 1949 et 1950 furent<br />
dévolues au repérage <strong>de</strong>s noyaux gris<br />
centraux par l’iodo-ventriculographie. Il<br />
fallait trouver une solution satisfaisante<br />
aux trois problèmes posés par la Stéréotaxie<br />
: instrumental, radiologique et<br />
anatomique. Le problème instrumental<br />
était celui d’une fixation rigi<strong>de</strong>, immobile<br />
et reproductible <strong>de</strong> la tête du mala<strong>de</strong>,<br />
adaptable à toutes les formes et<br />
tailles <strong>de</strong> crâne, et celui d’une instrumentation<br />
capable d’atteindre n’importe<br />
quel point <strong>de</strong> l’encéphale. Avec<br />
Jean Sabaton, technicien <strong>de</strong> génie, Jean<br />
Talairach conçut et fit fabriquer par la<br />
Maison Alexandre son premier cadre<br />
stéréotaxique (1947). Le problème<br />
radiologique était celui d’une définition<br />
d’une structure cérébrale dans les<br />
trois plans <strong>de</strong> l’espace sans déformation<br />
par les moyens radiologiques disponibles<br />
; la téléradiographie orthogonale<br />
<strong>de</strong> face et <strong>de</strong> profil, le centrage<br />
reproductible <strong>de</strong>s tubes à rayons X<br />
réglaient ce problème et permettaient<br />
<strong>de</strong> faire la preuve <strong>de</strong> l’exactitu<strong>de</strong> du<br />
repérage. Le problème anatomique,<br />
enfin, était à la fois le plus difficile à<br />
N°9 - TOME XIX - DÉCEMBRE 2006/JANVIER 2007<br />
résoudre et à la fois le plus intéressant.<br />
L’absence <strong>de</strong> rapport constant entre<br />
les structures osseuses et les noyaux<br />
gris centraux et l’absence <strong>de</strong> proportionnalité<br />
entre les dimensions du cerveau<br />
et celles <strong>de</strong>s noyaux imposait une<br />
i<strong>de</strong>ntification directe <strong>de</strong> structures cérébrales.<br />
Le ventricule était alors la seule<br />
structure visible par les examens radiologiques<br />
à contraste iodé ou aérique. La<br />
netteté <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux commissures - commissure<br />
blanche antérieure Ca et postérieure<br />
Cp - qui bor<strong>de</strong>nt le 3 ème ventricule<br />
sur les ventriculographies iodées,<br />
leur position sur la ligne médiane et<br />
leurs rapports avec les formations grises<br />
diencéphaliques en faisaient <strong>de</strong>ux excellents<br />
repères radiologiques. La ligne<br />
qui les unit - ligne <strong>de</strong> base Ca-Cp <strong>de</strong>venait<br />
ainsi un plan d’orientation général<br />
<strong>de</strong>s structures. La ligne bicommissurale<br />
Ca-Cp a été publiée en 1952<br />
(Presse Médicale, 1952, 28, 605-609).<br />
L’année 1952 marqua aussi le début<br />
<strong>de</strong>s explorations neurophysiologiques<br />
dans l’épilepsie.<br />
Sous l’impulsion <strong>de</strong> la Neurophysiologiste<br />
Mme Dell, chercheur à l’INSERM,<br />
Talairach explora en même temps les<br />
noyaux gris centraux et le cortex et<br />
abandonna la corticographie superficielle,<br />
comme la pratiquait Penfield à<br />
Montréal, pour s’intéresser au cortex<br />
enfoui accessible au moyen d’électro<strong>de</strong>s<br />
profon<strong>de</strong>s. A cette même époque, il<br />
commençait ses travaux anatomiques<br />
sur les cerveaux <strong>de</strong> cadavres (ceux-ci<br />
étaient amenés en salle d’opération la<br />
nuit pour y être radiographiés avant<br />
d’être coupés en tranches au laboratoire<br />
!) et corrélait ses observations avec<br />
celles <strong>de</strong>s repérages radiologiques pratiqués<br />
chez les patients épileptiques.<br />
Ces travaux furent consacrés par la<br />
publication du premier Atlas, l’Atlas<br />
d’Anatomie Stéréotaxique, publié chez<br />
Masson en 1957. Cet Atlas concernait<br />
le repérage <strong>de</strong>s noyaux gris centraux en<br />
fonction <strong>de</strong> la ligne <strong>de</strong> base Ca-Cp.<br />
Cette même année Ruggiero, Neuroradiologue,<br />
publiait un livre sur l’Encéphalographie<br />
Fractionnée. Celle-ci fit<br />
Résultats <strong>de</strong> la 1 ère enquête nationale<br />
sur la prise en charge <strong>de</strong> la douleur chez les<br />
patients psychotiques<br />
L’Institut UPSA <strong>de</strong> la Douleur a annoncé le 7 décembre 2006 les résultats<br />
<strong>de</strong> la 1ère enquête nationale sur la prise en charge <strong>de</strong> la douleur chez les patients<br />
psychotiques dans les Centres Hospitaliers <strong>de</strong> psychiatrie. Cette enquête<br />
a été présentée dans le cadre <strong>de</strong> la 1ère Journée Nationale « Douleur et<br />
santé mentale » organisée par Djéa Saravane et Yvan Halimi.<br />
Méthodologie <strong>de</strong> l’enquête<br />
Le questionnaire a été envoyé à 811 chefs <strong>de</strong> service <strong>de</strong> psychiatrie <strong>de</strong>s<br />
Centres Hospitaliers (CH) et <strong>de</strong>s Centres Hospitaliers Spécialisés en psychiatrie<br />
(CHS) ainsi qu’à 203 chefs <strong>de</strong> service <strong>de</strong> pharmacie <strong>de</strong>s CHS.<br />
L’ensemble <strong>de</strong>s 11 questions posées évoquait l’opinion <strong>de</strong>s répon<strong>de</strong>urs sur<br />
la qualité <strong>de</strong> la prise en charge <strong>de</strong> la maladie mentale et <strong>de</strong>s troubles somatiques<br />
associés, sur la formation et sur les pratiques d’évaluation et <strong>de</strong> traitement<br />
<strong>de</strong> la douleur.<br />
Le taux <strong>de</strong> réponse a été <strong>de</strong> 17,8% traduisant l’intérêt <strong>de</strong>s professionnels <strong>de</strong><br />
santé interrogés.<br />
Les résultats<br />
• Seulement 30% <strong>de</strong>s patients psychotiques sont suivis régulièrement par un<br />
mé<strong>de</strong>cin traitant.<br />
• 70% <strong>de</strong>s CHS n’ont pas <strong>de</strong> centre <strong>de</strong> lutte contre la douleur.<br />
• 75% <strong>de</strong>s chefs <strong>de</strong> service estiment que leurs équipes ne sont pas formées<br />
à la prise en charge <strong>de</strong> la douleur.<br />
• 68% <strong>de</strong>s psychiatres formés à la douleur n’utilisent pas l’Echelle Visuelle<br />
Analogique.<br />
• 55% <strong>de</strong>s pharmaciens sont tout à fait favorables à l’utilisation <strong>de</strong>s opioï<strong>de</strong>s<br />
forts à visée antalgique contre 23% <strong>de</strong>s psychiatres.<br />
Les alarmes<br />
• 7 patients psychotiques sur 10 ne sont pas suivis par un mé<strong>de</strong>cin traitant.<br />
Leur espérance <strong>de</strong> vie est diminuée <strong>de</strong> 9 à 12 ans par rapport à la population<br />
générale. Cette surmortalité importante est liée à <strong>de</strong>s pathologies organiques<br />
non détectées et non prises en charge, telles que les pathologies cardiovasculaires,<br />
le diabète, les pathologies infectieuses, le cancer.<br />
• Les patients psychotiques sont <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s qui souffrent comme les autres<br />
et cette douleur a une inci<strong>de</strong>nce importante sur le vécu <strong>de</strong> leur maladie. Mais<br />
l’évaluation <strong>de</strong> leur douleur est une problématique récente. Les patients psychotiques<br />
n’ont pas la même expression <strong>de</strong> la douleur que les autres.<br />
• Les psychiatres et les soignants ne sont pas toujours conscients <strong>de</strong> la nécessité<br />
<strong>de</strong> prendre en charge les douleurs somatiques chez ces patients et se<br />
sentent démunis : ils sont peu ou pas formés et manquent d’outils adaptés<br />
à l’évaluation <strong>de</strong> la douleur et au suivi du patient psychotique. ■<br />
F.C.
N°9 - TOME XIX - DÉCEMBRE 2006/JANVIER 2007<br />
Séminaire Déviance et Santé Mentale<br />
Centre <strong>de</strong> Recherche Psychotropes, Santé Mentale, Société<br />
(CNRS -INSERM Université Paris 5)<br />
faire un pas en avant à la métho<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
repérage stéréotaxique du cortex cérébral.<br />
En effet, les travaux d’anatomie<br />
stéréotaxique <strong>de</strong> Jean Talairach ne pouvaient<br />
se limiter aux formations souscorticales.<br />
Jean Talairach avait une vue<br />
d’ensemble du cerveau et recherchait<br />
un système <strong>de</strong> repérage « universel »<br />
<strong>de</strong>s structures cérébrales, une ligne <strong>de</strong><br />
base « globale » valable à la fois pour les<br />
noyaux gris et pour les structures corticales.<br />
En outre, l’expérience acquise<br />
dans les enregistrements stéréo-électro-encéphalographiques<br />
(SEEG) <strong>de</strong>s<br />
mala<strong>de</strong>s épileptiques imposait <strong>de</strong> réduire<br />
les corrélations anatomo-électrocliniques<br />
à un système <strong>de</strong> référence commun.<br />
Dans un livre édité chez Masson<br />
en 1958, L’exploration chiurgicale stéréotaxique<br />
du lobe temporal dans l’épilepsie<br />
temporale, Talairach décrivit une<br />
ligne <strong>de</strong> base temporale passant par le<br />
plancher <strong>de</strong> la corne du ventricule latéral.<br />
Mais cette ligne <strong>de</strong> base n’était<br />
valable que pour le lobe temporal et fut<br />
vite abandonnée. En fait, les travaux<br />
anatomiques sur le télencéphale et le<br />
<strong>de</strong>ssin d’épures opératoires pour les<br />
cortectomies ayant montré la validité <strong>de</strong><br />
la ligne <strong>de</strong> base Ca-Cp, Talairach la<br />
compléta par le tracé <strong>de</strong> lignes perpendiculaires<br />
Vca et Vcp, puis d’un<br />
quadrillage tridimensionnel du cerveau,<br />
proportionnel aux dimensions propres<br />
<strong>de</strong> chaque individu. Le but était atteint.<br />
Il s’est matérialisé par le second Atlas<br />
paru en 1967, sur l’anatomie stéréotaxique<br />
du télencéphale, toujours édité<br />
chez Masson.<br />
Les applications<br />
cliniques <strong>de</strong> la<br />
stéréotaxie<br />
Pour une sociologie <strong>de</strong>s troubles du comportement<br />
chez l’enfant et l’adolescent<br />
Philippe Le Moigne, Michel Kokoreff<br />
Jeudi 25 janvier 2007 : Dominique Youf, CNFE - PJJ, L’idiome <strong>de</strong> la responsabilité<br />
: ses attendus et ses implications pour la justice <strong>de</strong>s mineurs.<br />
Jeudi 22 février 2007 : Cyrille Canetti, Psychiatre à la prison <strong>de</strong> Fleury-Mérogis,<br />
La psychopathie : du diagnostic psychiatrique à la réalité pénitentiaire.<br />
Jeudi 29 mars 2007 : Philippe Le Moigne, Sociologue, Cesames, Mineurs multirécidivistes<br />
: une sociologie <strong>de</strong> la relation judiciaire.<br />
Jeudi 26 avril 2007 : Christian Laval, Sociologue - Orspere, Le secteur socioéducatif<br />
face à la question clinique.<br />
Jeudi 31 mai 2007 : Richard Rechtman, Psychiatre, Anthropologue, La psychopathologie<br />
comme traumatologie : les jeunes sont-ils « mala<strong>de</strong>s » <strong>de</strong>s<br />
circonstances ? »<br />
Jeudi 28 juin 2007, Michel Kokoreff, Sociologue, Cesames, La nouvelle donne<br />
<strong>de</strong>s politiques <strong>de</strong> prévention : entre ordre gestionnaire et idéologie sécuritaire.<br />
Neurochirurgie <strong>de</strong> l’épilepsie<br />
C’est certainement dans le domaine<br />
<strong>de</strong> l’épilepsie que Talairach consacra,<br />
aux côtés <strong>de</strong> son Collègue neurologue<br />
Jean Bancaud, la majorité <strong>de</strong> ses travaux.<br />
Dès l’arrivée <strong>de</strong> celui-ci en 1952<br />
commence l’ère <strong>de</strong>s enregistrements<br />
intracérébraux chez les patients épileptiques.<br />
Les premiers enregistrements<br />
opératoires furent réalisés par Mme M.<br />
B Dell et Jean Bancaud, dans le thalamus<br />
et diverses régions corticales dans<br />
<strong>de</strong>s épilepsies frontales.<br />
En 1953, Henri Hecaen rentre d’un<br />
séjour d’un an à Montréal où il a observé<br />
Wil<strong>de</strong>r Penfield et Herbert Jasper<br />
réaliser <strong>de</strong>s enregistrements électrocorticographiques<br />
cérébraux au cours<br />
d’interventions pour épilepsie rebelle.<br />
Cette approche neurophysiologique,<br />
clinique et opératoire inspire Jean Bancaud<br />
qui réfléchit alors à une métho<strong>de</strong><br />
capable d’explorer les structures cérébrales<br />
au cours <strong>de</strong>s crises d’épilepsie.<br />
Il observe Jean Talairach mettre au<br />
point sa métho<strong>de</strong> stéréotaxique. La<br />
convergence <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux hommes et<br />
<strong>de</strong> leurs travaux prenait corps. Malgré<br />
les critiques et les railleries <strong>de</strong> bien <strong>de</strong><br />
leurs contemporains, Marcel David crut<br />
au projet et fit construire en 1958 dans<br />
son Service la Salle d’opération dédiée<br />
à la neurochirurgie stéréotaxique. Cette<br />
salle <strong>de</strong>vait permettre le repérage neuroradiologique<br />
stéréotaxique fondé sur<br />
un équipement <strong>de</strong> téléradiologie mobile<br />
et les explorations neurophysiologiques<br />
cérébrales.<br />
Le mariage entre l’anatomie cérébrale<br />
- observée par la métho<strong>de</strong> stéréotaxique<br />
- et la neurophysiologie cérébrale<br />
- révélée par la clinique et l’électroencéphalographie<br />
- donna naissance<br />
à la Stéréo Electro-EncéphaloGraphie<br />
(ou SEEG, qui ne prendra ce nom<br />
qu’en 1962). La première implantation<br />
intracérébrale d’électro<strong>de</strong>s pour<br />
explorer l’activité <strong>de</strong> différentes structures<br />
cérébrales simultanément avec<br />
celle du scalp et enregistrer les crises<br />
chez un patient épileptique aura lieu<br />
le 3 mai 1957. Les électro<strong>de</strong>s étaient<br />
fabriquées à Sainte-Anne par Sabaton,<br />
rigi<strong>de</strong>s, stérilisables, à plusieurs contacts.<br />
La SEEG fit faire un immense bond en<br />
avant dans la compréhension <strong>de</strong>s<br />
mécanismes spatiaux et temporels qui<br />
sous-ten<strong>de</strong>nt les crises d’épilepsie, chez<br />
un patient donné comme d’une façon<br />
générale. L’anatomie stéréotaxique<br />
décrite par Jean Talairach fournissait<br />
un corps à l’interprétation dynamique<br />
<strong>de</strong>s crises d’épilepsie et un fon<strong>de</strong>ment<br />
à la démarche corrélative entre la<br />
sémiologie, l’anatomie et la neurophysiologie<br />
indispensable à la chirurgie <strong>de</strong><br />
résection dans l’épilepsie rebelle. La<br />
première intervention <strong>de</strong> ce type, qui<br />
sera appelée plus tard « cortectomie »<br />
eut lieu en janvier 1960. Avant cette<br />
date et <strong>de</strong>puis 1957, les interventions<br />
stéréotaxiques pour épilepsie partielle<br />
rebelle étaient une <strong>de</strong>struction sélective<br />
ammonienne et amygdalienne par<br />
implantation <strong>de</strong> grains d’Yttrium radioactif.<br />
Le rapport présenté <strong>de</strong>vant la Société<br />
<strong>de</strong> Neurochirurgie <strong>de</strong> Langue Française<br />
en 1974 « Approche nouvelle <strong>de</strong> la<br />
neurochirurgie <strong>de</strong> l’épilepsie » résumait<br />
14 années <strong>de</strong> collaboration, celle d’une<br />
équipe qui entourait Jean Talairach et<br />
Jean Bancaud : A. Bonis, S. Geier, G.<br />
Szkila, E. Bordas-Ferrer, C. Schaub, P.<br />
Tournoux, P. Buser, S. Trottier, P. Chauvel,<br />
J.M. Scarabin, C. Munari, pour ne<br />
citer qu’eux. Leurs travaux donnaient à<br />
la chirurgie <strong>de</strong> l’épilepsie ses lettres <strong>de</strong><br />
noblesse. Cette méthodologie <strong>de</strong>s corrélations<br />
anatorno-électro-cliniques possédait<br />
l’originalité d’abor<strong>de</strong>r les mécanismes<br />
d’une crise d’épilepsie <strong>de</strong> façon<br />
structurée, anatomique, spatiale et temporelle,<br />
le tout dirigé dans une perspective<br />
opératoire.<br />
<br />
LIVRES ET REVUES<br />
La sociologie <strong>de</strong> Max Weber<br />
Catherine Colliot-Thélène<br />
La Découverte<br />
Max Weber<br />
Sociologie <strong>de</strong>s religions<br />
Textes réunis, traduits et<br />
présentés par Jean-Pierre<br />
Grossein<br />
Tel Gallimard<br />
Le premier livre fournit <strong>de</strong>s éléments<br />
d’information relatifs à la formation<br />
scientifique et à la carrière <strong>de</strong> Weber,<br />
ainsi qu’un aperçu général <strong>de</strong>s différentes<br />
parties <strong>de</strong> son œuvre.<br />
Les <strong>de</strong>uxième et troisième chapitres<br />
traitent <strong>de</strong> ce que l’on appelle communément<br />
la « méthodologie » wébérienne.<br />
On distinguera son épistémologie,<br />
c’est-à-dire sa conception <strong>de</strong><br />
la nature <strong>de</strong> la connaissance en sociologie<br />
et en histoire, ainsi que <strong>de</strong>s<br />
relations entre les différentes sciences<br />
humaines et sociales, et sa « méthodologie<br />
», entendue au sens strict <strong>de</strong><br />
la systématisation <strong>de</strong>s procédures <strong>de</strong><br />
l’argumentation.<br />
La sociologie wébérienne conjugue<br />
le point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l’historien et les exigences<br />
<strong>de</strong> la théorie, tandis que le troisième<br />
chapitre explicite ce qu’est la<br />
sociologie « compréhensive », et les<br />
rapports qu’elle entretient avec la psychologie<br />
et la théorie juridique. Sous<br />
le titre « Rationalités », le quatrième<br />
chapitre évoque les ambiguïtés <strong>de</strong>s<br />
notions <strong>de</strong> <strong>de</strong> « rationnel, rationalité,<br />
rationalisation ». A l’encontre <strong>de</strong>s interprétations<br />
qui font <strong>de</strong> la rationalisation<br />
le maître mot <strong>de</strong> la pensée <strong>de</strong><br />
Weber, et sans nier l’importance centrale<br />
que possè<strong>de</strong> ce thème dans l’ensemble<br />
<strong>de</strong> son œuvre, l’auteur le considère<br />
moins comme une solution que<br />
comme un problème, c’est-à-dire<br />
comme le point <strong>de</strong> con<strong>de</strong>nsation d’une<br />
ambivalence qui traverse toutes les<br />
dimensions <strong>de</strong> ses analyses. Le <strong>de</strong>rnier<br />
chapitre recentre le programme<br />
<strong>de</strong> connaissance <strong>de</strong> Weber autour <strong>de</strong>s<br />
notions <strong>de</strong> « conduite <strong>de</strong> vie » et <strong>de</strong><br />
« puissances sociales », à la lumière <strong>de</strong>squelles<br />
se laisse reconstituer la cohérence<br />
entre ses positions épistémologiques<br />
et ses analyses concrètes.<br />
Jean-Pierre Grossein a rassemblé dix<br />
textes écrits par Max Weber, entre<br />
1910 et 1920, qui donnent une vue<br />
générale <strong>de</strong>s fon<strong>de</strong>ments théoriques<br />
<strong>de</strong> sa sociologie <strong>de</strong>s religions. On sait<br />
les difficultés d’accès à une œuvre inachevée,<br />
en remaniement, difficultés<br />
aggravées pour le lecteur français par<br />
le caractère lacunaire et l’incertitu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s traductions. La réunion <strong>de</strong> ces<br />
textes <strong>de</strong> synthèse, empruntés pour<br />
l’essentiel aux <strong>de</strong>ux gran<strong>de</strong>s entreprises<br />
qu’a mené Weber au cours <strong>de</strong>s<br />
années 1910 - le travail d’élaboration<br />
<strong>de</strong>s catégories sociologiques d’Economie<br />
et société et les étu<strong>de</strong>s comparatives<br />
sur L’Ethique économique <strong>de</strong>s<br />
religions mondiales -, a été conçue<br />
pour faciliter l’entrée dans une <strong>de</strong>s<br />
pensées-source <strong>de</strong> la philosophie et<br />
<strong>de</strong>s sciences sociales contemporaines.<br />
Traduits par Jean-Pierre Grossein, présentés<br />
dans l’ordre chronologique, ils<br />
permettent <strong>de</strong> se faire une idée précise<br />
du développement <strong>de</strong> la réflexion<br />
wébérienne dans le sillage <strong>de</strong> L’Ethique<br />
protestante et l’esprit du capitalisme et<br />
<strong>de</strong> prendre la mesure <strong>de</strong> sa portée<br />
systématique.<br />
Le recul <strong>de</strong> la mort<br />
L’avènement <strong>de</strong> l’individu<br />
contemporain<br />
Paul Yonnet<br />
Gallimard, 25 €<br />
Le passage à une mortalité infantile<br />
faible est incompatible, à terme, avec<br />
le maintien d’une fécondité élevée, ce<br />
qui vali<strong>de</strong> le postulat <strong>de</strong> la théorie <strong>de</strong><br />
la Transition démographique dont le<br />
déclenchement est historiquement tardif.<br />
Quand la transition démographique<br />
apparaît, c’est le plus souvent après<br />
la scolarisation massive <strong>de</strong>s filles, voire<br />
leur accès à <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s longues, et<br />
après un décollage économique rapi<strong>de</strong>,<br />
ou du moins en accompagnement<br />
<strong>de</strong> celui-ci. Ce ne fut pas le cas<br />
en France, aux débuts <strong>de</strong> la révolution<br />
démographique. En France, la<br />
baisse <strong>de</strong> la fécondité est précédée<br />
d’une baisse <strong>de</strong> la mortalité infantile<br />
et aux âges jeunes.<br />
Mais l’explication paraît insuffisante<br />
pour expliquer le déclenchement d’un<br />
ouragan contraceptif à partir <strong>de</strong> 1790<br />
qui n’est pas dû à <strong>de</strong>s causes économiques.<br />
Mélange <strong>de</strong> déchristianisation<br />
et d’excès dans la volonté <strong>de</strong> pouvoir<br />
<strong>de</strong> l’Eglise, voies trouvées pour<br />
s’opposer à la tentative <strong>de</strong> contrôle<br />
social sexuel par l’institution ecclésiale,<br />
résistance au pessimisme d’inspiration<br />
janséniste, mais aussi tonalité<br />
d’une Contre-Réforme visant le<br />
contrôle strict <strong>de</strong> la libido, conséquence<br />
<strong>de</strong> l’extraordinaire floraison <strong>de</strong> la foi<br />
catholique.<br />
Au-<strong>de</strong>là, et en prolongement, on peut<br />
tenter <strong>de</strong> comprendre l’attitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
élites urbaines, qui sont les précurseurs<br />
et les vecteurs <strong>de</strong> la baisse <strong>de</strong><br />
la fécondité, au point d’adopter <strong>de</strong>s<br />
comportements <strong>de</strong> limitation <strong>de</strong> leur<br />
propre <strong>de</strong>scendance anticipant <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ux siècles ceux <strong>de</strong> la population<br />
française. L’état <strong>de</strong>s rapports <strong>de</strong> classes<br />
en France ouvre la fenêtre <strong>de</strong> la contraception<br />
dans une élite dissuadée du<br />
pouvoir politique par l’absolutisme.<br />
La restriction <strong>de</strong>s naissances est bien<br />
alors la conséquence d’une personnalisation<br />
<strong>de</strong> l’enfant, lui-même envers<br />
d’une dépersonnalisation <strong>de</strong> l’avenir<br />
collectif, proprement politique, dans<br />
les élites écartées <strong>de</strong> ce mon<strong>de</strong> sérieux.<br />
Il y a donc trois facteurs : la<br />
baisse <strong>de</strong> la mortalité infantile et infanto-juvénile<br />
; la Contre-Réforme ;<br />
l’absolutisme. Mais la Révolution agrège<br />
le phénomène et, le diffusant, le fait<br />
changer d’échelle. Quand bien même<br />
ce ne serait pas la baisse <strong>de</strong> la mortalité<br />
infantile qui aurait déclenché la<br />
baisse <strong>de</strong> la fécondité , mais l’inverse :<br />
la baisse <strong>de</strong> la fécondité retentit sur<br />
la mortalité infantile. Les conséquences<br />
psychologiques sur la femme et sur<br />
l’enfant ont été les mêmes : peu à peu,<br />
libération <strong>de</strong> l’angoisse <strong>de</strong> la mort ;<br />
apparition <strong>de</strong> l’enfant du désir ; d’un<br />
être singulier, prémédité et irremplaçable,<br />
conçu pour lui-même et non<br />
pour être un élément parmi d’autres ;<br />
libération <strong>de</strong> la femme <strong>de</strong>s astreintes<br />
<strong>de</strong> la reproduction <strong>de</strong> l’espèce ; et libération<br />
pour la société.<br />
Ecrits allemands - I<br />
Fichte<br />
Ecrits allemands - Il<br />
Philosophie du droit<br />
Philosophie sociale et<br />
phénoménologie<br />
Georges Gurvitch<br />
Textes traduits et édités par<br />
Christian Papilloud et Cécile Rol<br />
L’Harmattan, 31 € chaque volume<br />
De Georges Gurvitch (1894-1965), on<br />
retient son parcours académique en<br />
France, où il a été professeur à la Sorbonne.<br />
On a salué son engagement<br />
lorsqu’il fallut reconstruire la sociologie<br />
durkheimienne après la Deuxième<br />
Guerre mondiale. On connaît enfin<br />
son rôle dans la mise en place <strong>de</strong>s<br />
premières unités du Centre National<br />
<strong>de</strong> la Recherche Scientifïque. Sa revue<br />
les Cahiers Internationaux <strong>de</strong> Sociologie<br />
paraît aujourd’hui encore.<br />
En revanche, on ignore souvent les<br />
influences qui ont guidé sa vie intellectuelle<br />
et imprégné I’œuvre <strong>de</strong> celui<br />
qu’on nommera le « pape <strong>de</strong> la sociologie<br />
française » après-guerre.<br />
Sur la base d’un matériel bio-bibliographique<br />
inédit, les éditeurs éclairent<br />
le détour <strong>de</strong> Gurvitch par l’Allemagne<br />
en publiant le premier <strong>de</strong>s trois volumes<br />
<strong>de</strong> ses écrits allemands consacré<br />
à son travail méconnu sur Fichte.<br />
Après un article préparatoire paru au<br />
HOMMAGE ■ 7<br />
début <strong>de</strong>s années 1920, Gurvitch y<br />
revient en détail à l’occasion <strong>de</strong> sa<br />
thèse <strong>de</strong> doctorat, traduite en français<br />
pour la première fois dans ce recueil.<br />
Il la défend à Berlin, où il pensait faire<br />
carrière. Au len<strong>de</strong>main <strong>de</strong>s révolutions<br />
russes et alleman<strong>de</strong>s, et après la Gran<strong>de</strong><br />
Guerre, la prise en compte <strong>de</strong> la doctrine<br />
morale <strong>de</strong> Fichte lui semble alors<br />
inéluctable pour que les sciences sociales<br />
retrouvent leurs marques.<br />
Convaincu, Gurvitch revient longuement<br />
sur Fichte, lui consacrant une<br />
notice dans l’Encyclopédie <strong>de</strong>s Sciences<br />
Sociales d’Alvin Johnson et d’Edwin<br />
Seligman, ou publiant la recension<br />
d’un livre <strong>de</strong> Marcel Guéroult sur Fichte,<br />
<strong>de</strong>ux contributions reprises dans le<br />
premier volume.<br />
Le <strong>de</strong>uxième volume contient une<br />
contribution sur le philosophe du droit<br />
Otto von Gierke, sur Proudhon, sur le<br />
philosophe autrichien du droit Anton<br />
Menger et, enfin, sur Gustav Radbruch.<br />
Hormis ce <strong>de</strong>rnier, ces articles paraissent<br />
pour la première fois en français.<br />
Les contributions que Gurvitch consacre<br />
à la philosophie sociale et à la phénoménologie<br />
portent sur Edmund Husserl,<br />
Emil Lask et Nikolaï Hartmann,<br />
<strong>de</strong>ux articles préparant les Tendances<br />
actuelles <strong>de</strong> la philosophie alleman<strong>de</strong>.<br />
Suivent une recension commune du<br />
Fichte <strong>de</strong> Xavier Léon et du Hegel <strong>de</strong><br />
Jean Wahl, inédite en français, ainsi<br />
qu’un article sur la philosophie sociale<br />
<strong>de</strong> Karl Krause. L’ouvrage se termine<br />
par un article critique portant sur la<br />
théorie <strong>de</strong> la valeur du philosophe<br />
néo-kantien Heinrich Rickert.<br />
Ces textes révèlent la permanence <strong>de</strong>s<br />
thématiques fichtéennes et, plus généralement,<br />
<strong>de</strong> la tradition alleman<strong>de</strong><br />
dans les travaux <strong>de</strong> Gurvitch. Ils attestent<br />
<strong>de</strong> son effort pour établir une<br />
synthèse critique <strong>de</strong>s traditions philosophiques,<br />
au profit d’une science<br />
<strong>de</strong> la morale pratique dont il cherchait<br />
les sources européennes. Gurvitch a<br />
trouvé en France la patrie d’adoption<br />
<strong>de</strong> son projet, mais aussi une terre <strong>de</strong><br />
débats féroces que l’exacerbation <strong>de</strong>s<br />
nationalismes en Europe ne manquera<br />
pas d’aiguiser. Marginale, sa présence<br />
à l’intérieur du champ socio-philosophique<br />
franco-allemand invite néanmoins<br />
à certaines redéfinitions. En témoigne<br />
en fin d’ouvrage une collection<br />
<strong>de</strong> matériaux bio-bibliographiques<br />
inédits.<br />
Art et psychanalyse<br />
Savoirs et clinique n°7, Erès, 28 €<br />
Le titre <strong>de</strong> ce numéro reprend celui<br />
du sixième colloque <strong>de</strong> l’ALEPH, qui<br />
s’est tenu les 11 et 12 décembre 2004<br />
au musée <strong>de</strong>s Beaux-Arts <strong>de</strong> Tourcoing.<br />
Dans son éditorial Franz Kaltenbeck<br />
relève que : « La psychanalyse<br />
ne s’applique pas à l’art mais au symptôme<br />
clinique qui est l’expression d’une<br />
satisfaction sauvage et douloureuse <strong>de</strong><br />
la pulsion. Dans l’art se créent <strong>de</strong>s œuvres<br />
qui sont, elles aussi, <strong>de</strong>s symptômes, puisqu’il<br />
faut les déchiffrer. Mais ces symptômes<br />
éveillent nos désirs en proposant<br />
<strong>de</strong>s images et <strong>de</strong>s langages nouveaux<br />
à notre sensibilité. Ils nous donnent ainsi<br />
<strong>de</strong>s aperçus sur les régions les plus opaques<br />
<strong>de</strong> notre propre jouissance ».<br />
<strong>Psychiatrie</strong> <strong>de</strong> l’adulte<br />
Formations médicales et<br />
paramédicales<br />
Pierre André<br />
4 ème édition révisée et augmentée<br />
Heures <strong>de</strong> France, 27 €<br />
Cet ouvrage pédagogique est <strong>de</strong>stiné<br />
à la formation <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins et <strong>de</strong>s<br />
paramédicaux. Sont abordées les diverses<br />
pathologies mais sont également<br />
traitées : la relation <strong>de</strong> soin, le<br />
projet thérapeutique ; les psychothérapies<br />
; les principales situations d’urgence<br />
; les médicaments psychotropes ;<br />
la législation et l’organisation <strong>de</strong>s soins<br />
en psychiatrie. On trouve en fin d’ouvrage<br />
un lexique <strong>de</strong>s termes <strong>de</strong> psychiatrie,<br />
psychologie et mé<strong>de</strong>cine.
8<br />
LIVRES<br />
■ HOMMAGE<br />
Les sens et l’intelligence<br />
Traité <strong>de</strong> psychologie 1<br />
Alexan<strong>de</strong>r Bain<br />
Avec une préface <strong>de</strong> Serge<br />
Nicolas et une étu<strong>de</strong> critique <strong>de</strong><br />
John Stuart Mill<br />
L’Harmattan, 48 €<br />
Il s’agit, en fac simile, <strong>de</strong> la traduction<br />
<strong>de</strong> l’ouvrage <strong>de</strong> Bain : Les sens et l’intelligence<br />
(1855). La reproduction <strong>de</strong><br />
l’ouvrage est précédée d’une introduction<br />
sur la vie et l’œuvre <strong>de</strong> Bain<br />
accompagnée d’une présentation critique<br />
donnée par John Stuart Mill en<br />
1859 sur la psychologie <strong>de</strong> Bain.<br />
Fondateur <strong>de</strong> la psychologie scientifique<br />
anglaise, l’influence d’Alexan<strong>de</strong>r<br />
Bain (1818-1903) sur ses contemporains<br />
a été incontestable. L’ouvrage<br />
qui le fit connaître, Les sens et l’intelligence<br />
(1855), constitue le premier<br />
livre <strong>de</strong> son grand traité <strong>de</strong> psychologie<br />
considéré comme un <strong>de</strong>s premiers<br />
manifestes <strong>de</strong> la nouvelle psychologie<br />
anglaise du XIX e siècle qui<br />
eut tant d’influence sur la psychologie<br />
française et la psychologie alleman<strong>de</strong><br />
naissantes. La psychologie <strong>de</strong><br />
Bain est une psychologie associationniste<br />
qui prend sa source dans<br />
les écrits <strong>de</strong> Hume, Hartley, James<br />
Mill et James Stuart Mill. Si l’on compare<br />
les travaux <strong>de</strong> Bain avec ceux<br />
<strong>de</strong> ses prédécesseurs immédiats, on<br />
perçoit que <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s différences<br />
existent. Le style est plus scientifique,<br />
il n’est pas celui d’un orateur dont le<br />
discours est embelli <strong>de</strong> longues citations<br />
poétiques. La métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> Bain<br />
est scientifique et non pas introspective<br />
et spéculative. Les nouveautés<br />
que l’on peut percevoir dans<br />
l’œuvre <strong>de</strong> Bain sont, d’abord, son<br />
insistance sur la valeur <strong>de</strong> la physiologie<br />
pour la psychologie ; ensuite sa<br />
foi en l’application <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s<br />
quantitatives en psychologie même<br />
s’il n’a jamais expérimenté lui-même.<br />
Bain est connu pour être le fondateur,<br />
en 1876, <strong>de</strong> la fameuse revue<br />
philosophique Mind.<br />
Vocabulaire <strong>de</strong><br />
psychosociologie<br />
Références et positions<br />
Sous la direction <strong>de</strong><br />
Jacqueline Barus-Michel<br />
Eugène Enriquez<br />
André Lévy<br />
Erès, 23 €<br />
Cette nouvelle édition qui a réduit<br />
son format et son prix <strong>de</strong> manière significative,<br />
est un ouvrage <strong>de</strong> référence<br />
sur la psychosociologie :<br />
repères conceptuels et méthodologiques,<br />
auteurs précurseurs et fondateurs<br />
<strong>de</strong> la discipline.<br />
Les articles ont été rédigés par les<br />
chefs <strong>de</strong> file <strong>de</strong> la psychosociologie<br />
qui ont contribué à diffuser l’influence<br />
<strong>de</strong> la discipline dans divers domaines<br />
(sciences <strong>de</strong> l’éducation, formation,<br />
pédagogie, enquête sociale et économique<br />
- travaux sur l’opinion publique,<br />
étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> marché ou <strong>de</strong> motivation<br />
- compréhension, analyse et<br />
traitement <strong>de</strong>s situations sociales, en<br />
psychothérapie ou dans le travail social<br />
en général) et ont renouvelé les<br />
perspectives concernant les groupes<br />
et les relations <strong>de</strong> groupe, les structures<br />
d’organisation, les processus <strong>de</strong><br />
changement, le traitement <strong>de</strong>s conflits<br />
sociaux et leurs inci<strong>de</strong>nces sur les<br />
personnes.<br />
Pour chaque notion, son ou ses rapporteurs<br />
ont indiqué le contexte<br />
d’émergence, explicité les significations,<br />
esquissé une analyse critique<br />
et montré leur intérêt sur le plan <strong>de</strong><br />
la théorie et <strong>de</strong> la pratique psychosociologique.<br />
Irradiation interstitielle <strong>de</strong>s<br />
tumeurs cérébrales<br />
A la suite <strong>de</strong>s travaux pionniers d’Ajuriaguerra<br />
en 1954 sur l’implantation<br />
cérébrale <strong>de</strong> grains d’or radioactif,<br />
Gabor Szkila s’est intéressé très tôt à<br />
cette technique d’irradiation focale. Son<br />
mémoire d’Assistant Etranger en 1958<br />
portait sur les « Effets histologiques tardifs<br />
<strong>de</strong> l’implantation <strong>de</strong> l’Au198 dans le<br />
cerveau humain ». Les premières irradiations<br />
interstitielles en conditions stéréotaxiques<br />
ont été réalisées dès 1953,<br />
<strong>de</strong>stinées au traitement <strong>de</strong> tumeurs<br />
jugées inopérables. L’émission y <strong>de</strong> l’or<br />
radioactif (Au 198 ) permettait certes une<br />
importante irradiation in situ, la dosimétrie<br />
était rudimentaire et les résultats<br />
furent dans l’ensemble décevants et<br />
<strong>de</strong>s lésions <strong>de</strong> radionécrose étendues<br />
furent observées à moyen et long<br />
terme. L’utilisation <strong>de</strong>s émetteurs radioactifs<br />
β comme I’Yttrium ou le Rhenium<br />
s’avéra beaucoup plus sûre et<br />
plus fiable : la pénétration tissulaire <strong>de</strong><br />
ces produits était beaucoup plus réduite,<br />
leur <strong>de</strong>mi-vie beaucoup plus courte,<br />
ils réalisaient <strong>de</strong>s lésions <strong>de</strong> nécrose à<br />
l’emportepièce <strong>de</strong> petit diamètre. Ils<br />
furent donc choisis pour les <strong>de</strong>structions<br />
focales <strong>de</strong> la chirurgie fonctionnelle<br />
: l’Yttrium 90 fut utilisé pour le<br />
traitement <strong>de</strong> la maladie <strong>de</strong> Parkinson :<br />
Débutée en 1954, cette métho<strong>de</strong> fut<br />
utilisée jusqu’au milieu <strong>de</strong>s années<br />
1980.<br />
Dès 1973, Gabor Szkila s’intéressa à<br />
l’irradiation interstitielle <strong>de</strong>s tumeurs<br />
cérébrales en combinant la méthodologie<br />
stéréotaxique <strong>de</strong> Talairach à une<br />
irradiation calculée et rationalisée. Ses<br />
travaux trouvaient leur couronnement<br />
lors du Congrès européen <strong>de</strong> Stéréotaxie<br />
à l’Abbaye <strong>de</strong> Royaumont en<br />
1979. Mais l’expérience clinique en<br />
matière <strong>de</strong> tumeurs cérébrales fut plus<br />
mo<strong>de</strong>ste que les travaux expérimentaux<br />
: l’irradiation interstitielle était réservée<br />
à <strong>de</strong>s tumeurs hémisphériques<br />
malignes jugées inopérables, et <strong>de</strong>s<br />
tumeurs du 3 ème ventricule (pinéalomes,<br />
crâniopharyngiomes).<br />
Biopsies stéréotaxiques <strong>de</strong>s<br />
tumeurs cérébrales<br />
Si la méthodologie stéréotaxique permettait<br />
<strong>de</strong> prélever <strong>de</strong>s fragments tissulaires<br />
avec un haut <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> fiabilité<br />
et <strong>de</strong> sécurité, même dans <strong>de</strong>s localisations<br />
hautement fonctionnelles, dans<br />
un but purement diagnostique, Talairach<br />
lui préférait son versant thérapeutique,<br />
irradiations interstitielle ou<br />
endocavitaire par exemple. C’est l’arrivée<br />
<strong>de</strong> Catherine Daumas-Duport en<br />
1972 qui marquera le début d’une<br />
nouvelle approche <strong>de</strong>s tumeurs cérébrales<br />
par l’étu<strong>de</strong> conjointe <strong>de</strong> la clinique,<br />
<strong>de</strong>s documents radiologiques<br />
disponibles et <strong>de</strong>s prélèvements multiples<br />
et orientés <strong>de</strong>s différentes composantes<br />
tumorales. La méthodologie<br />
stéréotaxique permit l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> leur<br />
configuration spatiale, <strong>de</strong> corrélations<br />
entre l’Histologie et l’Imagerie, à la base<br />
<strong>de</strong> nouvelles classifications <strong>de</strong>s tumeurs<br />
cérébrales, <strong>de</strong> choix thérapeutiques<br />
individuels et <strong>de</strong> données pronostiques<br />
fondées sur <strong>de</strong>s groupes homogènes<br />
<strong>de</strong> lésions.<br />
Chirurgie stéréotaxique<br />
hypophysaire<br />
Avec le but <strong>de</strong> détruire une tumeur<br />
hypophysaire sans en réaliser l’exérèse<br />
par une voie chirurgicale lour<strong>de</strong>, la première<br />
intervention stéréotaxique sur<br />
l’hypophyse eut lieu en 1954, à l’ai<strong>de</strong><br />
d’un appareillage stéréotaxique adapté<br />
au cadre. En 1964, un appareil indépendant<br />
et dédié à la chirurgie hypophysaire<br />
fut construit par la Maison<br />
Alexandre. La <strong>de</strong>struction hypophysaire<br />
était réalisée par l’implantation<br />
sous contrôle radiographique d’isotopes<br />
émetteurs y (Iridium 192 et Or 198),<br />
qui créaient une radionécrose <strong>de</strong> tissus<br />
tumoraux (adénomes, craniopha-<br />
ryngiomes) ou du parenchyme hypophysaire<br />
pour le traitement <strong>de</strong> syndromes<br />
<strong>de</strong> Cushing, <strong>de</strong> rétinopathies<br />
diabétiques, d’exophtalmie maligne, ou<br />
<strong>de</strong> cancers hormonodépendants polymétastasés.<br />
Cette activité fut coordonnée,<br />
jusqu’au début <strong>de</strong>s années 1980,<br />
par Clau<strong>de</strong> Schaub, neuroendocrinologue<br />
<strong>de</strong> l’équipe <strong>de</strong> Jean Talairach.<br />
Chirurgie <strong>de</strong> la douleur<br />
A la suite <strong>de</strong>s travaux expérimentaux<br />
<strong>de</strong> Mme M. B Dell sur le thalamus,<br />
Talairach pratiqua <strong>de</strong>s coagulations<br />
sélectives <strong>de</strong> noyaux thalamiques (VPL<br />
ou VPM selon la topographie douloureuse)<br />
pour le traitement <strong>de</strong>s douleurs<br />
du syndrome thalamique. Les effets<br />
observés étaient en général transitoires.<br />
Plus efficaces furent les <strong>de</strong>structions<br />
stéréotaxiques <strong>de</strong>s fibres thalamo-pariétales,<br />
qui permettaient une suppression<br />
<strong>de</strong>s douleurs ou une amélioration<br />
notable à long terme chez plus <strong>de</strong> 50%<br />
<strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s.<br />
Psychochirurgie<br />
De formation initialement psychiatrique,<br />
Jean Talairach a décrit avec ses<br />
Maîtres Jean Delay, puis Henri Hecaen<br />
et Marcel David diverses manifestations<br />
psychiatriques rencontrées dans<br />
<strong>de</strong>s pathologies organiques. Dans le<br />
grand Hôpital psychiatrique parisien, il<br />
était logique qu’il s’intéressa à la Chirurgie<br />
<strong>de</strong>s désordres psychiques. Reprenant<br />
la technique <strong>de</strong> Freeman et Watts,<br />
il réalisa dans son Service, entre 1946<br />
et 1949, 137 lobotomies préfrontales.<br />
Recherchant une technique plus sélective<br />
et moins délabrante que la lobotomie,<br />
il pratiqua <strong>de</strong>s <strong>de</strong>structions<br />
stéréotaxiques sélectives : thermocoagulations<br />
fasciculaires dans le centre<br />
semi-ovale ou thalamotomies du noyau<br />
ventral antérieur. Les <strong>de</strong>rnières lobotomies<br />
pratiquées à Sainte-Anne furent<br />
antérieures à 1980.<br />
Neurochirurgie <strong>de</strong>s mouvements<br />
anormaux<br />
Dès 1947 Talairach s’intéressa au traitement<br />
<strong>de</strong>s dyskinésies par une intervention<br />
corticale portant sur les aires 4,<br />
6 et 8. En 1950 il réalisa sa première<br />
intervention stéréotaxique pour le traitement<br />
<strong>de</strong>s mouvements anormaux :<br />
une thermocoagulation <strong>de</strong>s tractus<br />
putamino-caudés, <strong>de</strong> l’anse lenticulaire<br />
et du globus pallidus chez une patient<br />
éveillée atteinte d’un hémiballisme. il<br />
démontrait alors que seule une intervention<br />
sur les fibres pallidofuges entraînait<br />
une cessation <strong>de</strong>s mouvements<br />
anormaux.. A partir <strong>de</strong> 1952, il commença<br />
à traiter <strong>de</strong>s syndromes parkinsoniens<br />
par diverses techniques stéréotaxiques<br />
- électrolyse, thermocoagulation<br />
ou irradiation à l’Or 198<br />
puis à I’Yttrium 90 - et dans divers<br />
cibles : anse lenticulaire, globus pallidus,<br />
noyau ventral latéral du thalamus,<br />
sous l’influence <strong>de</strong>s travaux d’Hassler.<br />
Laissant ultérieurement à Gérard Guiot<br />
et à son équipe <strong>de</strong> l’hôpital Foch la primauté<br />
<strong>de</strong> la chirurgie <strong>de</strong>s mouvements<br />
anormaux pour s’intéresser essentiellement<br />
à l’épilepsie, la technique qu’il<br />
mit au point et qui resta pratiquée à<br />
Sainte-Anne jusqu’à la fin <strong>de</strong>s années<br />
1980 était l’implantation par voie frontale<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>ux grains d’Yttrium 90, l’un<br />
dans le Globus Pallidus interne et l’autre<br />
dans la partie postérieure du noyau<br />
Ventral Latéral du thalamus (correspondant<br />
aux noyaux Vop et Vim).<br />
Les productions<br />
scientifiques<br />
Son premier article date <strong>de</strong> 1949 et<br />
s’intitule « Recherches sur la coagulation<br />
thérapeutique <strong>de</strong>s structures sous-corticales<br />
chez l’homme » (Revue Neurologique,<br />
1949, 81, 1,1-24). Auparavant, il avait<br />
<strong>de</strong>puis sa thèse en 1940 participé à la<br />
rédaction <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 10 articles sur <strong>de</strong>s<br />
sujets <strong>de</strong> <strong>Psychiatrie</strong> (comprenant les<br />
manifestations psychiques rencontrées<br />
dans les tumeurs cérébrales et à l’issue<br />
d’interventions neurochirurgicales). En<br />
1949 il présentait, <strong>de</strong>vant l’audience<br />
du IVè Congrès Neurologique International,<br />
une communication sur le<br />
sujet « Lobotomie préfrontale limitée par<br />
électrocoagulation <strong>de</strong>s fibres thalamofrontales<br />
à leur émergence du bras antérieur<br />
<strong>de</strong> la capsule interne ».<br />
Il écrira ensuite, jusqu’à sa retraite, près<br />
<strong>de</strong> 50 articles originaux - en plus <strong>de</strong><br />
ceux dont il est co-auteur, dont une<br />
quarantaine avec Jean Bancaud -, 3<br />
Atlas <strong>de</strong> stéréotaxie (Atlas d’Anatomie<br />
Stéréotaxigue, 1957 ; Atlas &Anatomie<br />
Stéréotaxique du Télencéphale, 1967 ; et<br />
celui écrit avec Gabor Szkila, Angiography<br />
of the Human Brain Cortex,<br />
1977), 3 livres et plus <strong>de</strong> 10 chapitres<br />
<strong>de</strong> livres, 2 rapports <strong>de</strong>vant la Société<br />
<strong>de</strong> Neurochirurgie, sans compter les<br />
communications scientifiques ni les<br />
articles didactiques. Il écrira et publiera<br />
bien après sa retraite ses <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rniers<br />
Atlas (Co-planar Stereotactic Atlas of the<br />
Human Brain, Thieme, 1988 et Referentially<br />
Oriented Cérébral MRI Anatomy,<br />
Thieme, 1993). Son œuvre inclut<br />
l’ensemble <strong>de</strong>s domaines d’application<br />
<strong>de</strong> la neurochirurgie fonctionnelle, lui<br />
conférant une surprenante mo<strong>de</strong>rnité.<br />
La Neurochirurgie stéréotaxique est<br />
bien la mère <strong>de</strong> la chirurgie à invasion<br />
minimale guidée par l’imagerie que l’on<br />
connaît aujourd’hui.<br />
L’Ecole <strong>de</strong> stéréotaxie<br />
son rayonnement<br />
Jean Talairach aura formé <strong>de</strong>s élèves<br />
illustres français et étrangers. Bien <strong>de</strong>s<br />
neurochirurgiens <strong>de</strong> son époque viendront,<br />
par curiosité ou par souci <strong>de</strong> formation<br />
à une méthodologie aussi rigoureuse<br />
que séduisante et innovante, se<br />
former à son contact. En France, ses<br />
élèves neurochirurgiens stéréotacticiens<br />
se nomment Robert Sedan, Alim-Louis<br />
Benabid, François Cohadon, JeanMarie<br />
Scarabin, Serge Blond, Youenn Lajat,<br />
Daniel Legars, Jean-Clau<strong>de</strong> Peragut,<br />
sans oublier Geier et Micheletti. A<br />
l’étranger, Patrick Kelly (USA), Mark<br />
Rayport (USA), Claudio Munari (Italie),<br />
Antonino Musolino (Italie), B.<br />
Mempel (Pologne), M. Bordas-Ferrer<br />
(Paraguay), Osvaldo Betti (Argentine),<br />
L. Covello (Italie), T. Hori (Japon), Takeda<br />
(Japon), Robert Rand (USA), Vladimir<br />
Petrov (Russie), Antonio Delgado-<br />
Escueta (USA), Signorelli (Italie),<br />
Bernouilly (Suisse), Serrano (Chili), Prosalentis<br />
(Grèce), Guy Bouvier (Canada),<br />
Manrique (Espagne), Cinca (Roumanie),<br />
Valençak (Autriche), Zervas<br />
(USA), Waltregny (Belgique) et bien<br />
d’autres figurent parmi ses élèves.<br />
L’histoire <strong>de</strong> Jean Talairach est celle<br />
d’un Homme passionné, en quête perpétuelle<br />
d’une compréhension <strong>de</strong>s phé-<br />
N°9 - TOME XIX - DÉCEMBRE 2006/JANVIER 2007<br />
nomènes pour mieux les contrôler. Elle<br />
est celle d’un Maître qui s’est entouré<br />
d’une équipe sans cesse renouvelée <strong>de</strong><br />
Cliniciens et <strong>de</strong> Chercheurs français et<br />
étrangers qui ont eux aussi par leur travail<br />
acquis un renom et contribué à<br />
celui <strong>de</strong> l’équipe. Elle est celle d’un lieu,<br />
le Centre Hospitalier Sainte-Anne,<br />
<strong>de</strong>venu par la personnalité du Maître<br />
une Ecole <strong>de</strong> Neurochirurgie Stéréotaxique<br />
et Fonctionnelle reconnue au<strong>de</strong>là<br />
<strong>de</strong>s frontières. Elle est une leçon <strong>de</strong><br />
volonté, <strong>de</strong> ténacité, d’une démarche<br />
innovante et visionnaire. Convaincre<br />
que la neurochirurgie passait par une<br />
vision spatiale organisée <strong>de</strong> l’anatomie<br />
cérébrale ? Gageure à l’époque, évi<strong>de</strong>nce<br />
indiscutée aujourd’hui. L’idée<br />
valut à son auteur critiques et incrédulité<br />
<strong>de</strong> ses contemporains. Qu’importe.<br />
L’œuvre est là pour témoigner.<br />
Suivre la route d’un pionnier <strong>de</strong> génie<br />
n’est pas simple, mais lorsque sa création<br />
atteint son plein accomplissement,<br />
modèle <strong>de</strong> simplicité et <strong>de</strong> logique, elle<br />
<strong>de</strong>vient accessible à tous, modulable,<br />
évolutive, en <strong>de</strong>ux mots actuelle et<br />
vivante. Mémoire d’une utopie fécon<strong>de</strong>,<br />
mélange d’imaginaire et du réel qui<br />
s’y bâtit. ■<br />
Bertrand Devaux et<br />
François-Xavier Roux*<br />
*Hôpital Sainte-Anne, 75014 Paris<br />
Ce texte a été publié dans le Bulletin <strong>de</strong> la Société<br />
<strong>de</strong> Neurochirurgie <strong>de</strong> Langue Française<br />
<strong>de</strong> décembre 2003 et dans le Bulletin <strong>de</strong> l’Association<br />
du Musée et du Centre Historique<br />
Sainte-Anne, numéro <strong>de</strong> novembre-décembre<br />
2006.<br />
6ème Journée AFPSYMED<br />
L’élève bouc émissaire, sa place dans l’école<br />
23 mars 2007, CH Sainte-Anne, Paris<br />
Traitement du trouble <strong>de</strong><br />
la personnalité bor<strong>de</strong>rline<br />
F. Mehzan<br />
Masson<br />
F. Mehzan, psychologue clinicienne<br />
attachée à l’Hôpital Sainte-Anne,<br />
présente diverses approches thérapeutiques<br />
proposées dans le trouble<br />
<strong>de</strong> la personnalité bor<strong>de</strong>rline. Elle<br />
insiste surtout sur l’urtilisation <strong>de</strong>s<br />
théories cognitives et comportementales,<br />
qu’elles soient individuelles<br />
ou <strong>de</strong> groupe, dont <strong>de</strong> nombreuses<br />
variantes peuvent s’adapter au trouble<br />
bor<strong>de</strong>rline. Elle décrit, en particulier,<br />
<strong>de</strong>s techniques récentes, comme la<br />
thérapie cognitive émotionnelle, et<br />
plai<strong>de</strong> pour l’usage d’une approche<br />
intégrative, la thérapie <strong>de</strong>s schémas,<br />
conçue par Jeffrey Young à New<br />
York, pour ai<strong>de</strong>r ces patients souvent<br />
très difficiles à prendre en charge.<br />
Un ouvrage complet pour un lecteur<br />
peu familier avec les développements<br />
récents <strong>de</strong>s TCC.<br />
Ch. Spadone<br />
L’élève « bouc émissaire » est fréquemment décrit dans l’école, quelque soient<br />
l’âge et le type d’enseignement. Il fait très régulièrement l’objet d’attaques <strong>de</strong><br />
ses camara<strong>de</strong>s <strong>de</strong> classe et est repéré par l’institution. Cette place conduit cet<br />
élève à exprimer sa souffrance par <strong>de</strong>s symptômes comportementaux et/ou<br />
psychiques. Il trouve régulièrement appui auprès <strong>de</strong> l’infirmerie <strong>de</strong> l’établissement.<br />
L’aveu <strong>de</strong> cette position par l’élève est rare, par méconnaissance ou<br />
par peur. La qualité <strong>de</strong> l’observation <strong>de</strong> l’institution scolaire aura une place<br />
déterminante pour ai<strong>de</strong>r ce jeune. La solution ne peut qu’associer une approche<br />
individuelle et collective pour la gestion du groupe classe.<br />
Les conséquences <strong>de</strong> ce positionnement peuvent être redoutables, <strong>de</strong> l’échec<br />
scolaire au trouble somatique et psychique conduisant à une tentative d’échappement<br />
scolaire. Plus troublants, les essais <strong>de</strong> rescolarisation montrent parfois<br />
un positonnement à l’i<strong>de</strong>ntique <strong>de</strong> ce jeune, posant alors le problème<br />
<strong>de</strong> son organisation psychopathologique singulière.<br />
Cette 6 ème journée d’AFPSYMED (associant <strong>de</strong>s psychiatres et <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins<br />
<strong>de</strong> l’éducation nationale) proposera une réflexion sur ce thème en associant<br />
<strong>de</strong>s regards croisés, psychopathologiques et sociologiques. L’approche psychologique<br />
individuelle croisera la dimension institutionnelle sur l’école pour<br />
une élaboration conjointe et indissociable <strong>de</strong> ces enjeux.<br />
Renseignements : Mme Sylvie Lecuyer, Secteur 15 <strong>de</strong> Paris - CMP Tiphaine, 23 rue<br />
Tiphaine, 75015 Paris. Tél. 01 45 75 03 50 - Fax 01 45 79 20 40.<br />
E-mail : s.lecuyer@ch-sainte-anne.fr
N°9 - TOME XIX - DÉCEMBRE 2006/JANVIER 2007<br />
sociaux et <strong>de</strong>s valeurs, le poids <strong>de</strong> l’individualisme,<br />
les profonds changements<br />
qui en résultent, font que l’être humain<br />
manque <strong>de</strong> repères et <strong>de</strong> racines, vit<br />
parfois une profon<strong>de</strong> dévalorisation,<br />
une augmentation du sentiment d’insécurité<br />
et une confrontation à une<br />
perte <strong>de</strong> sens qui est au cœur <strong>de</strong> la<br />
dépression.<br />
Le suici<strong>de</strong> s’inscrit essentiellement dans<br />
ce contexte <strong>de</strong> dépression. On déplore<br />
ainsi entre 11 000 et 12 000 suici<strong>de</strong>s<br />
par an. Chez les personnes âgées,<br />
80% au moins <strong>de</strong>s gestes suicidaires<br />
surviennent ainsi dans un contexte<br />
dépressif et l’on sait le drame du suici<strong>de</strong><br />
chez les jeunes.<br />
L’angoisse est partout aujourd’hui. Il y<br />
a une explosion <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> « psy »<br />
et l’on attend une réponse dans l’urgence.<br />
La consommation <strong>de</strong> psychotropes<br />
est très importante. En 2004, la<br />
Sécurité sociale a payé 315 millions<br />
d’antalgiques et 122 millions d’hypnotiques<br />
et <strong>de</strong> tranquillisants. Encore que<br />
prescription ne veuille pas dire consommation.<br />
Est-ce à dire que les Français<br />
ont mal, sont mal et/ou qu’ils vont<br />
mal ?<br />
Par ailleurs, il est certain que les changements<br />
<strong>de</strong> repères structurants pour<br />
l’être humain se reflètent encore au<br />
niveau <strong>de</strong>s troubles <strong>de</strong> la personnalité<br />
avec augmentation <strong>de</strong>s troubles <strong>de</strong> type<br />
bor<strong>de</strong>rline, diagnostic fréquemment<br />
retenu aujourd’hui.<br />
Enfin, il convient <strong>de</strong> mentionner un<br />
autre changement : la place du mala<strong>de</strong><br />
par rapport à sa maladie.<br />
Autrefois très passif et sommé <strong>de</strong> suivre<br />
ce qui lui était imposé, il est <strong>de</strong>venu<br />
un partenaire et, si possible, l’acteur <strong>de</strong><br />
son traitement. La nécessité <strong>de</strong> l’information<br />
est aujourd’hui un truisme et<br />
il faut aller plus loin dans l’implication<br />
du patient.<br />
Les troubles <strong>de</strong>s adolescents, <strong>de</strong>s<br />
révélateurs <strong>de</strong> notre société<br />
Pour Philippe Jeammet, l’adolescent<br />
est particulièrement intéressant car il<br />
est, à la fois, révélateur <strong>de</strong> ce qu’il a<br />
reçu pendant son enfance, en particulier<br />
<strong>de</strong> ses parents et <strong>de</strong> ses éducateurs,<br />
et <strong>de</strong> ce dont il hérite sur le plan génétique.<br />
Avec la puberté, et l’adolescence<br />
proprement dite, il va <strong>de</strong>voir prendre<br />
une distance par rapport à son enfance<br />
et ses parents, ce qui va l’obliger à<br />
prendre la mesure <strong>de</strong> ses ressources<br />
personnelles internes. Cette remise en<br />
cause <strong>de</strong> l’adolescent met en évi<strong>de</strong>nce<br />
ses insécurités. L’adolescent nous<br />
apprend que plus on est en insécurité,<br />
plus on est vulnérable et plus on a<br />
besoin <strong>de</strong> recevoir une ai<strong>de</strong> extérieure,<br />
mais plus ce besoin est aussi ressenti<br />
comme une menace pour l’autonomie.<br />
Les plus vulnérables d’entre eux, en<br />
quête d’un apport extérieur, vont, <strong>de</strong> ce<br />
fait, être très environnement-dépendants<br />
et susceptibles <strong>de</strong> <strong>de</strong>venir le<br />
miroir <strong>de</strong>s courants <strong>de</strong> pensée et <strong>de</strong><br />
comportements qui parcourent le<br />
mon<strong>de</strong> adulte.<br />
Les adolescents les plus dépendants<br />
sont les plus sensibles à la déception<br />
et seront tentés d’y répondre par <strong>de</strong>s<br />
comportements d’opposition. En s’opposant,<br />
ils ont le sentiment d’exister.<br />
Ils se protègent <strong>de</strong> l’angoisse d’abandon<br />
et, en même temps, se rassurent<br />
sur leur capacité à sauvegar<strong>de</strong>r leur différence<br />
et à ne pas se soumettre aux<br />
adultes. Malheureusement, si leurs<br />
capacités d’opposition l’emportent sur<br />
le besoin <strong>de</strong> recevoir et <strong>de</strong> se nourrir <strong>de</strong><br />
ce qui serait nécessaire à leur développement,<br />
un cercle vicieux risque <strong>de</strong><br />
s’installer et <strong>de</strong> les amener à s’opposer<br />
d’autant plus aux adultes qu’ils en<br />
<strong>de</strong>viennent, en fait, plus dépendants.<br />
Derrière ces comportements se cache<br />
la peur <strong>de</strong> ne pas être à la hauteur, <strong>de</strong><br />
ne plus être eux-mêmes, <strong>de</strong> perdre la<br />
maîtrise <strong>de</strong> la situation, voir parfois leur<br />
i<strong>de</strong>ntité. Le refus et la <strong>de</strong>structivité leur<br />
donnent, à bon compte, le sentiment<br />
<strong>de</strong> re<strong>de</strong>venir actifs et peuvent les rassurer,<br />
mais en les enfermant dans <strong>de</strong>s<br />
Société en mutation, santé<br />
mentale en crise<br />
comportements qui, sans être tous<br />
pathologiques, sont en revanche pathogènes<br />
dans la mesure où ils ne sont<br />
pas tant choisis que dictés par la peur<br />
et qu’ils les privent <strong>de</strong> la nourriture et<br />
<strong>de</strong>s apports qui leur seraient nécessaires<br />
pour s’épanouir. Au fond, la<br />
pathologie, c’est l’enfermement dans<br />
ces conduites d’attaque et <strong>de</strong> sabotage<br />
<strong>de</strong> nos potentialités.<br />
La solution <strong>de</strong> la <strong>de</strong>structivité est en<br />
quelque sorte la créativité du pauvre,<br />
c’est-à-dire <strong>de</strong> celui qui se sent impuissant<br />
et dépassé. Elle est d’autant plus<br />
tentante que le plaisir comme la réussite<br />
sont aléatoires, nous font dépendre<br />
<strong>de</strong>s autres et ne durent jamais. L’échec<br />
et la <strong>de</strong>struction sont toujours accessibles,<br />
à portée <strong>de</strong> main, ne dépen<strong>de</strong>nt<br />
que <strong>de</strong> soi et peuvent être sans fin<br />
quand on commence à les mettre en<br />
oeuvre. Ce n’est pas un plaisir, ce n’est<br />
pas un choix, mais on comprend que<br />
cela puisse <strong>de</strong>venir une tentation pour<br />
<strong>de</strong>s sujets à la dérive et en quête <strong>de</strong><br />
se sentir exister et d’avoir un effet sur<br />
les autres.<br />
Les comportements pathogènes chez<br />
les adolescents et les jeunes adultes<br />
sont un exemple du mo<strong>de</strong> d’expression<br />
du mal-être, un reflet <strong>de</strong> notre<br />
évolution sociale. Les troubles dépressifs<br />
et les violences gratuites sont en<br />
effet révélateurs <strong>de</strong>s maux <strong>de</strong> notre<br />
société. Une société qui refuse les<br />
limites, rejette les normes et les<br />
contraintes, une société qui remet continuellement<br />
tout en cause engendre<br />
nécessairement <strong>de</strong>s êtres n’ayant plus<br />
<strong>de</strong> repères, n’acceptant aucun cadre et<br />
pouvant <strong>de</strong>venir violents, envers les<br />
autres et envers eux-mêmes.<br />
L’enfant et l’adolescent ont besoin <strong>de</strong><br />
l’adulte, ne serait-ce que pour s’opposer.<br />
Or, aujourd’hui, on constate une<br />
difficulté <strong>de</strong>s adultes à poser <strong>de</strong>s limites,<br />
à signifier qu’il faut se respecter soimême<br />
et respecter l’autre. Malheureusement,<br />
la société ne renvoie plus <strong>de</strong><br />
feedback pour dire que l’on ne peut<br />
pas laisser <strong>de</strong>s enfants s’abîmer.<br />
La diffusion par la psychiatrie du modèle<br />
d’une compréhension psychologique<br />
<strong>de</strong> l’enfant et <strong>de</strong> l’adolescent en souffrance,<br />
qui est né dans un cadre éducatif<br />
relativement strict, a eu un succès<br />
excessif. Dans un cadre beaucoup<br />
plus permissif, la « psychologisation »<br />
actuelle a contribué à disqualifier l’éducatif,<br />
empêchant le cadre éducatif,<br />
notamment la famille, l’école, <strong>de</strong> jouer<br />
son rôle constructif <strong>de</strong> limites, abandonnant<br />
ces enfants à leurs impulsions<br />
et à leurs émotions incontrôlées. De<br />
ce fait, les « psy » n’apportent <strong>de</strong> nos<br />
jours, plus une ouverture compréhensive<br />
à l’écoute <strong>de</strong>s enfants, qui s’est<br />
généralisée excessivement, mais ils sont<br />
amenés à poser <strong>de</strong>s cadres éducatifs<br />
qui n’existent plus par ailleurs.<br />
Soigner en toute transparence<br />
Pierre Decourt, psychiatre et psychanalyste<br />
a relevé que si la psychiatrie<br />
est aujourd’hui en crise, la résolution<br />
<strong>de</strong> l’énigme <strong>de</strong> la maladie mentale<br />
constitue le premier défi pour le psychiatre.<br />
Il doit également faire face aux<br />
exigences d’une société ne supportant<br />
plus l’aléatoire et qui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
réponses claires, parfois définitives avec<br />
<strong>de</strong>s résultats si possible quantifiables.<br />
Plus encore, une métho<strong>de</strong> thérapeutique<br />
peut être délaissée faute d’être<br />
attestée par <strong>de</strong>s preuves concluantes.<br />
Tout l’enjeu consiste bien à transmettre,<br />
à une société qui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
comptes, la complexité <strong>de</strong> ce qui spécifie<br />
la pathologie mentale sans tomber<br />
dans un réductionnisme démagogique<br />
et trompeur.<br />
Par exemple, si l’on veut comprendre<br />
quelque chose à un traitement du syn-<br />
drome anxiodépressif, il faut pouvoir à<br />
la fois se fon<strong>de</strong>r sur le diagnostic clinique,<br />
mais également faire preuve<br />
d’intelligence et d’intuition. Il s’agit ainsi<br />
<strong>de</strong> faire appel à l’histoire du sujet, donc<br />
<strong>de</strong> prendre en considération sa propre<br />
capacité à donner du sens à un symptôme.<br />
La complémentarité <strong>de</strong>s approches<br />
médico-psychologiques est une exigence<br />
dont la plupart <strong>de</strong>s responsables<br />
ont pris conscience <strong>de</strong>puis longtemps.<br />
Ainsi, bien <strong>de</strong>s équipes au sein <strong>de</strong>s institutions<br />
sont composées <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins,<br />
<strong>de</strong> psychologues, <strong>de</strong> psychanalystes<br />
ayant <strong>de</strong>s compétences dans le champ<br />
tant somatique que psychopathologique.<br />
Cette double approche indispensable<br />
reflète la complexité du fonctionnement<br />
<strong>de</strong> l’être humain et sa<br />
richesse. A l’heure <strong>de</strong> la transparence<br />
illusoire, on mesure la difficulté et la<br />
nécessité <strong>de</strong> transmettre cette complexité.<br />
A l’inverse, on peut prôner une relation<br />
fondée sur la transmission par le psychiatre<br />
<strong>de</strong> ses doutes, <strong>de</strong> ses convictions,<br />
mais aussi <strong>de</strong> ses incertitu<strong>de</strong>s,<br />
dans le cadre d’un engagement sur le<br />
mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> la vérité. Il s’agit là du contraire<br />
<strong>de</strong> ce qui se passe aujourd’hui, où<br />
l’on déshumanise le patient et où l’on<br />
fait du psychiatre un simple entomologiste<br />
<strong>de</strong> l’humain.<br />
Les évolutions du métier <strong>de</strong><br />
psychiatre face aux nouvelles<br />
expressions <strong>de</strong>s maladies<br />
mentales<br />
Olivier Lehembre, vice-prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la<br />
Fédération Française <strong>de</strong> <strong>Psychiatrie</strong> a<br />
relevé que l’évolution <strong>de</strong>s maladies<br />
mentales est certes un miroir <strong>de</strong> l’évolution<br />
<strong>de</strong> notre société, mais les pathologies<br />
sont aussi fonction du dispositif<br />
<strong>de</strong> soins mis en place car les patients<br />
expriment leur souffrance psychique<br />
en fonction <strong>de</strong>s lieux et <strong>de</strong>s personnes<br />
qu’ils rencontrent. Les pathologies évoluent<br />
également en fonction <strong>de</strong> nos<br />
capacités à les entendre. Aujourd’hui,<br />
les troubles du comportement sont très<br />
présents dans les consultations et dans<br />
les soins.<br />
Les conditions d’exercice évoluent en<br />
fonction <strong>de</strong> facteurs conjoncturels tels<br />
que la démographie, l’environnement<br />
institutionnel, les pratiques psychiatriques,<br />
les pathologies et la société.<br />
Les psychiatres sont <strong>de</strong> plus en plus<br />
débordés et <strong>de</strong> moins en moins nombreux<br />
; ce constat est préoccupant.<br />
Dans ces conditions, les psychiatres<br />
peuvent-ils offrir un dispositif <strong>de</strong> soins<br />
adapté à la variété <strong>de</strong>s situations cliniques<br />
?<br />
La disponibilité, l’accueil et l’écoute<br />
sont essentiels pour la prise en charge<br />
<strong>de</strong>s patients. Le cadre matériel et l’environnement<br />
importent également :<br />
notre outil <strong>de</strong> soin mérite d’être régulièrement<br />
pensé et revu. Si la psychiatrie<br />
est une spécialité pluridisciplinaire,<br />
elle présente néanmoins une<br />
certaine unité et une richesse culturelle.<br />
Par ailleurs, on déplore l’apparition<br />
<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>s successives, qui permettent<br />
<strong>de</strong> braquer un temps le projecteur sur<br />
une pathologie, puis <strong>de</strong> la délaisser au<br />
profit d’une autre, tout en laissant certaines<br />
autres maladies dans l’ombre.<br />
En tant que représentant <strong>de</strong> la Fédération<br />
française <strong>de</strong> psychiatrie, Olivier<br />
Lehembre a souligné la nécessité pour<br />
notre pratique <strong>de</strong> ne pas être tiraillée<br />
entre un trop grand nombre d’approches<br />
différentes, qui sont source <strong>de</strong><br />
malentendus et d’erreurs dans la prise<br />
en charge. A l’inverse, il convient <strong>de</strong><br />
prendre conscience <strong>de</strong> la complémentarité<br />
nécessaire entre le public et le<br />
privé, l’hospitalisation et l’ambulatoire,<br />
la psychiatrie <strong>de</strong>s adolescents et celles<br />
<strong>de</strong>s adultes. Tous les cloisonnements<br />
doivent être surmontés.<br />
Changer notre regard<br />
sur les maladies<br />
mentales<br />
L’image <strong>de</strong> la psychiatrie dans<br />
les médias<br />
Brigitte-Fanny Cohen (journaliste à<br />
France2, chronique santé <strong>de</strong> Télématin)<br />
a vu évoluer, pendant un peu plus <strong>de</strong><br />
quinze ans, l’image <strong>de</strong> la psychiatrie à<br />
la télé, mais aussi dans la presse écrite.<br />
Il lui semble aujourd’hui que l’image<br />
<strong>de</strong> la psychiatrie dans les médias est<br />
plurielle... pour ne pas dire brouillée.<br />
Parce que la psychiatrie, dans les<br />
médias grand public, est un concept<br />
vaste englobant différents visages <strong>de</strong><br />
la santé mentale : les troubles du comportement<br />
(comme l’anxiété, les phobies,<br />
l’hyperactivité <strong>de</strong> l’enfant...), les<br />
maladies (comme la dépression, la<br />
Catherie Geoffray a exposé dans le cadre <strong>de</strong>s Expositions « Rencontres-Dialogues<br />
» au Centre <strong>de</strong> Santé Jean Moulin, 8 bld <strong>de</strong> Champigny, 94210 La<br />
Varenne, du 11 au 19 décembre 2006.<br />
Ces expositions sont organisées par l’APPRESS (Association pour la Prévention,<br />
la Promotion, la Recherche Expérimentale Sanitaire et Sociale.<br />
Le vernissage <strong>de</strong> l’exposition a eu lieu en présence <strong>de</strong> Monsieur Michel Gellion,<br />
Directeur du CH « Les Murets » et du Docteur Bernard Martin, Psychiatre<br />
Chef <strong>de</strong> service et les Equipes du Secteur <strong>de</strong> Saint-Maur Joinville.<br />
<br />
LIVRES<br />
COLLOQUE ■ 9<br />
Le dossier médical<br />
aujourdhui et <strong>de</strong>main<br />
Tenue - Transmission -<br />
Conservation<br />
Questions juridiques pratiques à<br />
l’attention du psychiatre<br />
Pfizer<br />
Ce « Dossier médical aujourd’hui et<br />
<strong>de</strong>main : tenue - transmission - conservation<br />
» constitue un outil pratique<br />
d’utilisation composé d’un gui<strong>de</strong> juridique<br />
regroupant plus <strong>de</strong> 100 questions-réponses<br />
sur le dossier médical<br />
; un CD-ROM comprenant <strong>de</strong>s<br />
modèles <strong>de</strong> lettres pouvant être utilisées<br />
dans le cadre <strong>de</strong> la prise en<br />
charge <strong>de</strong> patients, pour l’évaluation<br />
<strong>de</strong>s pratiques professionnelles et <strong>de</strong><br />
l’accréditation <strong>de</strong>s services, du respect<br />
<strong>de</strong>s règles <strong>de</strong> bonnes pratiques ;<br />
<strong>de</strong>s diaporamas <strong>de</strong> formation reprenant<br />
les points importants <strong>de</strong> la réglementation<br />
; <strong>de</strong>s fiches <strong>de</strong> transmission<br />
du dossier médical ; <strong>de</strong>s textes<br />
<strong>de</strong> référence ; <strong>de</strong>s questions sous la<br />
forme d’un post-test d’évaluation <strong>de</strong>s<br />
connaissances sur le dossier médical.<br />
La prise en charge <strong>de</strong>s<br />
mineurs en psychiatrie<br />
Maxence Cornier, Anne <strong>de</strong><br />
Crevoisier<br />
Préface <strong>de</strong> Bertrand Welniarz<br />
L’Entreprise Médicale Editions, 39 €<br />
Cet ouvrage abor<strong>de</strong>, sous forme <strong>de</strong><br />
« questions-réponses », les principes<br />
et limites <strong>de</strong> la règle <strong>de</strong> l’autorité parentale<br />
qui gouverne les relations<br />
entre les soignants, les patients mineurs<br />
qu’ils prennent en charge et<br />
leurs représentants légaux ; les principaux<br />
droits <strong>de</strong>s patients mineurs et<br />
les conditions juridiques encadrant<br />
la délivrance <strong>de</strong>s soins : obligation<br />
d’information, recueil du consentement,<br />
conduite à tenir en cas <strong>de</strong><br />
refus <strong>de</strong> soins, respect du secret professionnel,<br />
modalités d’accès au dossier<br />
médical ; la réglementation régissant<br />
l’accueil et l’hospitalisation<br />
<strong>de</strong>s mineurs : au moment <strong>de</strong> leur admission,<br />
lors <strong>de</strong> leur séjour hospitalier<br />
et à l’occasion <strong>de</strong> leur sortie ; les<br />
risques juridiques encourus par les<br />
professionnels et les établissements<br />
en cas <strong>de</strong> dysfonctionnement dans<br />
la prise en charge sanitaire <strong>de</strong>s mineurs.<br />
Femmes handicapées : la vie<br />
<strong>de</strong>vant elles<br />
avec le parrainage <strong>de</strong> Simone Veil<br />
Femmes handicapées<br />
citoyennes<br />
avec le parrainage <strong>de</strong> Lucie Aubrac<br />
Association « Femmes pour le dire,<br />
Femmes pour agir »<br />
L’Harmattan, 13,50€ et 12,50€<br />
Ces livres, coordonnés par Mandy<br />
Piot, ren<strong>de</strong>nt compte <strong>de</strong>s forums <strong>de</strong>s<br />
25 novembre 2003 et 16 novembre<br />
2005 organisés par l’association<br />
« Femmes pour le dire, Femmes pour<br />
agir » qui a été créée en avril 2003<br />
afin <strong>de</strong> promouvoir, par tout moyen<br />
à sa disposition (forums, conférences,<br />
groupes <strong>de</strong> parole, ateliers, etc.), la<br />
citoyenneté <strong>de</strong> la femme handicapée<br />
tout au long <strong>de</strong> sa vie et dans tous<br />
les secteurs <strong>de</strong> la société.<br />
La difficulté d’intégration dans la vie<br />
<strong>de</strong> la cité, dans l’entreprise, dans l’accès<br />
à la culture est encore plus gran<strong>de</strong><br />
lorsqu’il s’agit d’une femme handicapée<br />
qui vit une double discrimination<br />
: celle d’être femme et celle d’être<br />
handicapée. Les statistiques le montrent<br />
sans ambiguïté comme les témoignages<br />
<strong>de</strong>s intéressées ellesmêmes.
10<br />
LIVRES<br />
■ COLLOQUE<br />
L’entreprise interrogée par<br />
le handicap psychique<br />
Claire Le Roy-Hatala et Jean-<br />
François Col<strong>de</strong>fy<br />
Coordinateurs du numéro<br />
FASM Croix-Marine, 14 €<br />
Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la rémunération qu’il apporte,<br />
le travail reste une source majeure<br />
<strong>de</strong> reconnaissance sociale et<br />
contribue à renforcer l’estime <strong>de</strong> soi,<br />
même si l’on confond souvent reconnaissance<br />
sociale et salariat. On<br />
assiste alors à ce paradoxe que <strong>de</strong>s<br />
personnes exclues du travail s’enferrent<br />
dans une recherche éperdue<br />
d’un emploi salarié, dans le déni <strong>de</strong><br />
leurs troubles ou le refus d’une reconnaissance<br />
<strong>de</strong> travailleur handicapé,<br />
tandis que dans le même temps<br />
les entreprises fabriquent du handicap,<br />
quitte à récupérer celui-ci pour<br />
valoriser leurs statistiques du nombre<br />
<strong>de</strong> personnes handicapées qu’elles<br />
accueillent comme l’évoquent plusieurs<br />
contributions <strong>de</strong> ce numéro.<br />
La Loi du 11 février affirme également<br />
que les personnes concernées<br />
ont droit à une compensation. Mais<br />
s’il faut reconnaître que pour les personnes<br />
en situation <strong>de</strong> handicap psychique,<br />
la mise en place <strong>de</strong>s GEM<br />
considérés comme une forme <strong>de</strong> compensation<br />
collective, constitue une<br />
avancée remarquable, il faut aussi<br />
s’interroger sur les formes <strong>de</strong> compensation<br />
qu’il faudrait inventer dans<br />
le champ du travail et <strong>de</strong> l’entreprise.<br />
C’est une contribution à cette réflexion<br />
que propose ce numéro qui montre<br />
que la seule expertise <strong>de</strong>s psy ne suffit<br />
pas et que <strong>de</strong> nouveaux partenariats<br />
doivent se développer.<br />
Gouvernement et<br />
gouvernance <strong>de</strong>s territoires<br />
Dossier réalisé par Patrick Le<br />
Galès<br />
Problèmes politiques et sociaux<br />
mars 2006 n°922<br />
La Documentation Française, 9,20€<br />
Les limites <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s d’action publique<br />
fondés sur une vision centralisée<br />
du rôle <strong>de</strong> l’Etat ont conduit à<br />
l’apparition d’autres mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> pilotage<br />
que l’on désigne sous le terme<br />
<strong>de</strong> « gouvernance ».<br />
La gouvernance peut être définie<br />
comme un processus <strong>de</strong> coordination<br />
d’acteurs, <strong>de</strong> groupes sociaux,<br />
d’institutions pour atteindre <strong>de</strong>s buts<br />
discutés et définis collectivement.<br />
Dans un contexte <strong>de</strong> décentralisation,<br />
d’européisation et <strong>de</strong> mondialisation,<br />
elle amène à repenser les manières<br />
<strong>de</strong> gouverner, à construire un<br />
intérêt général rattaché à un territoire<br />
et à mettre en œuvre <strong>de</strong>s stratégies<br />
collectives. Dans ce cadre plus ouvert,<br />
les expérimentations se sont<br />
multipliées, qu’il s’agisse <strong>de</strong> pratiques<br />
<strong>de</strong> gestion, <strong>de</strong> concertation, d’élaboration<br />
<strong>de</strong> projets et d’un intérêt collectif<br />
territorialisé, <strong>de</strong> création <strong>de</strong><br />
réseaux et <strong>de</strong> coalitions. Des organisations<br />
variées participent au gouvernement<br />
ou à la gouvernance locale<br />
(sociétés d’économie mixte,<br />
associations, promoteurs, entreprises<br />
<strong>de</strong> services urbains, chambres <strong>de</strong> commerce<br />
et d’industrie, PME ou gran<strong>de</strong>s<br />
entreprises, artisans,...), à côté <strong>de</strong>s<br />
consultants désormais très présents.<br />
Tout ceci contribue à faire évoluer le<br />
rôle du politique.<br />
On assiste à une transformation dans<br />
le rapport entre élus et citoyens, entre<br />
régulation politique et intervention<br />
<strong>de</strong> la société civile qui va dans le sens<br />
<strong>de</strong> l’autonomie <strong>de</strong>s différents acteurs,<br />
<strong>de</strong> la juridicisation <strong>de</strong>s relations et<br />
<strong>de</strong>s conflits, <strong>de</strong> la concertation. Cependant,<br />
les gouvernements locaux<br />
restent bien présents, leur expertise<br />
et leur influence politique tendant<br />
plutôt à s’accroître.<br />
<br />
schizophrénie, la psychose maniacodépressive...)<br />
et les faits divers (dont le<br />
plus tristement célèbre est le double<br />
meurtre <strong>de</strong> Pau)...<br />
De fait, par la diversité <strong>de</strong>s sujets abordés,<br />
la psychiatrie a trouvé une place<br />
importante dans les médias. Elle occupe<br />
le terrain. Dans tous les cas, on ne<br />
peut certainement pas dire qu’elle en<br />
est absente, surtout si l’on compare à la<br />
place qu’elle avait il y a quinze ou vingt<br />
ans. A l’époque, la psychiatrie était très<br />
peu abordée. Quand elle l’était, les<br />
reportages privilégiaient son côté spectaculaire<br />
: la folie, le fou dangereux,<br />
l’enfermement dans <strong>de</strong>s unités spécialisées...<br />
Aujourd’hui, les médias privilégient<br />
davantage une santé mentale plus<br />
« banale », plus dédramatisée dans les<br />
rubriques « psycho » <strong>de</strong> la presse féminine,<br />
comme dans certaines émissions<br />
<strong>de</strong> télévision, les patients racontent leur<br />
dépression, leurs troubles bipolaires,<br />
leur boulimie. Ils témoignent <strong>de</strong> la<br />
maladie mentale comme ils parleraient<br />
du psoriasis ou du cancer. Sans honte,<br />
sans gêne. A <strong>de</strong>s heures <strong>de</strong> gran<strong>de</strong><br />
écoute. Dans <strong>de</strong>s émissions où l’audimat<br />
« cartonne » : Envoyé spécial, Ça se<br />
discute, Zone interdite... Dans <strong>de</strong>s<br />
magazines au tirage très important :<br />
Marie-Claire, Elle etc. Un tabou est<br />
donc tombé. Certains troubles mentaux<br />
sont même surmédiatisés : l’hyperactivité<br />
<strong>de</strong> l’enfant ou la dépression,<br />
par exemple, car ils sont aussi, il faut<br />
bien le dire, l’objet d’un marketing sousjacent<br />
et très actif.<br />
Revers <strong>de</strong> la médaille <strong>de</strong> cette médiatisation<br />
<strong>de</strong> la santé mentale : certains<br />
troubles, à force d’être banalisés, paraissent<br />
peut-être plus anodins qu’ils ne le<br />
sont. L’anorexie en est sans doute<br />
l’exemple le plus frappant : tant <strong>de</strong><br />
jeunes filles sont venues raconter<br />
<strong>de</strong>vant les caméras leurs difficultés à<br />
se nourrir, leur mal-être, on a tant pointé<br />
du doigt l’anorexie <strong>de</strong>s top-mo<strong>de</strong>ls,<br />
que l’on a presque fait <strong>de</strong> cette maladie<br />
une maladie <strong>de</strong> civilisation, le symptôme<br />
d’une jeunesse qui se cherche. Estce<br />
que l’anorexie est toujours perçue<br />
par le public comme une maladie mentale<br />
? Une maladie mentale grave, qui<br />
nécessite une prise en charge médicale<br />
? Qui peut conduire à la mort ? Ou<br />
n’est-elle plus, aux yeux <strong>de</strong>s néophytes,<br />
qu’un désir <strong>de</strong> maigreur <strong>de</strong> jeunes filles<br />
victimes <strong>de</strong> la mo<strong>de</strong> ? On peut se poser<br />
la question.<br />
Quels enjeux pour la psychiatrie<br />
d’aujourd’hui ? Quel avenir pour<br />
la psychiatrie ?<br />
Pour Richard Rechtman, psychiatre et<br />
anthropologue, il est vrai que la santé<br />
mentale est très présente dans le débat<br />
actuel, dans les magazines et les conversations<br />
quotidiennes. De ce point <strong>de</strong><br />
vue, on peut considérer qu’il s’agit<br />
d’une bonne nouvelle pour les psychiatres.<br />
Cependant, cette soudaine<br />
visibilité <strong>de</strong> la santé mentale traduit un<br />
changement <strong>de</strong> société. Il convient ainsi<br />
<strong>de</strong> relever un paradoxe apparent :<br />
jamais les psychiatres n’ont été, à ce<br />
point, sollicités sur la scène sociale,<br />
jamais la psychiatrie n’a connu une<br />
telle visibilité publique, mais non plus le<br />
sort <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s mentaux n’a semblé<br />
plus incertain.<br />
Du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> la société, la santé<br />
mentale est un enjeu majeur <strong>de</strong> gouvernance.<br />
Il n’existe pas <strong>de</strong> définition<br />
précise <strong>de</strong> la souffrance psychique, mais<br />
on peut l’envisager comme « la souffrance<br />
expérimentée par quelqu’un qui<br />
n’est pas mala<strong>de</strong> mental ». Le <strong>de</strong>venir<br />
<strong>de</strong>s nouvelles formes d’une souffrance<br />
psychique touchant préférentiellement<br />
les sujets réputés « normaux »<br />
semble ainsi cristalliser les espérances<br />
d’une santé mentale positive.<br />
Aujourd’hui, on s’adresse à une population<br />
réputée normale, dont on entend<br />
la souffrance, laquelle va également<br />
permettre <strong>de</strong> légitimes <strong>de</strong>s actions<br />
publiques. Cependant, certains restent<br />
exclus <strong>de</strong> ce nouveau langage, comme<br />
les chômeurs ou les mala<strong>de</strong>s mentaux,<br />
qui ne réussissent pas à saisir les modalités<br />
contemporaines <strong>de</strong> l’expression<br />
publique. Ceux dont on ne parle pas,<br />
bien qu’ils souffrent, restent donc totalement<br />
invisibles dans notre société.<br />
La psychiatrie a longtemps servi cette<br />
conception en gérant la maladie mentale,<br />
la déviance, la folie. Ainsi, on a<br />
traité le problème <strong>de</strong> la maladie mentale<br />
comme celui <strong>de</strong> la misère. En tant<br />
que clinicien et citoyen, Richard Rechtman<br />
estime que l’action principale à<br />
mener consiste à restaurer une cruciale<br />
part <strong>de</strong> subjectivité.<br />
Un regard sur la folie<br />
Patrick Coupechoux (journaliste, auteur<br />
<strong>de</strong> Un mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> fous. Comment notre<br />
société maltraite ses mala<strong>de</strong>s mentaux,<br />
Ed Seuil 2006) a indiqué en préambule<br />
qu’au terme d’une longue enquête<br />
menée pour réaliser son ouvrage, il<br />
n’a quasiment entendu parler du problème<br />
<strong>de</strong> la folie autrement que par<br />
le biais <strong>de</strong> la dangerosité. Même les<br />
chaînes <strong>de</strong> télévision les plus respectables<br />
contribuent à ce phénomène.<br />
Quelle que soit leur responsabilité, la<br />
question du regard porté sur la folie<br />
ne dépend pas uniquement <strong>de</strong>s médias,<br />
mais <strong>de</strong> la société elle-même. Le regard<br />
posé par celle-ci sur la folie a, en effet,<br />
bien évolué <strong>de</strong>puis le Moyen Age. A<br />
partir du Front populaire et <strong>de</strong> l’après<strong>de</strong>uxième<br />
guerre mondiale, un fort<br />
mouvement <strong>de</strong> désaliénisme a vu le<br />
jour. Pour la première fois, il était clairement<br />
formulé que la folie appartenait<br />
à l’humanité et surtout, à la richesse<br />
<strong>de</strong> l’humanité. Il fallait donc faire en<br />
sorte que les fous puissent vivre avec les<br />
autres hommes.<br />
Il semble que la tendance actuelle<br />
consiste à revenir à l’enfermement, à<br />
une maîtrise <strong>de</strong> la folie. Cela n’est pas<br />
étranger au fonctionnement social<br />
actuel marqué par la compétition entre<br />
les individus, avec ses corollaires, l’exclusion<br />
et l’abandon <strong>de</strong>s plus faibles : la<br />
société ne sait que faire <strong>de</strong>s chômeurs,<br />
<strong>de</strong>s personnes âgées, <strong>de</strong>s handicapés,<br />
<strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s mentaux. Le vieux thème<br />
<strong>de</strong> l’inutilité sociale refait surface.<br />
Comme toujours, la folie interroge.<br />
Cependant, celui-ci n’est plus une collectivité<br />
articulée autour <strong>de</strong> solidarités.<br />
Aujourd’hui, la société néolibérale place<br />
les individus dans une permanente<br />
concurrence, dans le « chacun pour<br />
soi ».<br />
Ainsi, la vision <strong>de</strong> l’homme est en train<br />
se modifier. La pensée dominante n’en<br />
fait que le produit <strong>de</strong> la physiologie ou<br />
<strong>de</strong> la génétique. Il ne s’agit pas, évi<strong>de</strong>mment,<br />
<strong>de</strong> nier l’importance <strong>de</strong>s<br />
recherches effectuées dans ce domaine.<br />
Mais la vision biologique <strong>de</strong> l’existence<br />
liée à <strong>de</strong> puissants intérêts économiques<br />
et à une vision managériale et technocratique<br />
qui recherche uniquement l’efficacité,<br />
conduit à la négation du sujet.<br />
A un moment donné, la personne disparaît<br />
au profit d’un simple profil, d’un<br />
objet qu’il faut « gérer ».<br />
L’un <strong>de</strong>s aspects <strong>de</strong> cette gestion est<br />
la « criminalisation » <strong>de</strong> la folie. A été<br />
présenté récemment un projet <strong>de</strong> loi <strong>de</strong><br />
prévention <strong>de</strong> la délinquance, qui assimile<br />
mala<strong>de</strong>s mentaux et dangerosité.<br />
Ce projet produit un amalgame inquiétant<br />
entre mala<strong>de</strong> mental et délinquant,<br />
et remet au goût du jour l’idée du fou<br />
dangereux. Obsédée par la sécurité,<br />
notre société entend maîtriser la folie et<br />
ravive la peur du fou, en assimilant<br />
folie et dangerosité, en associant délinquants,<br />
criminels et mala<strong>de</strong>s mentaux.<br />
Ensuite, nous avons aujourd’hui une<br />
vision très technocratique <strong>de</strong> la maladie<br />
mentale. Pour faire face à l’urgence,<br />
on fait appel à l’hôpital et à la médication.<br />
Pour régler le problème <strong>de</strong> la<br />
« chronicité », on repousse ceux qui<br />
souffrent dans les bras du social. Les<br />
fous sont ainsi rejetés au bout <strong>de</strong> la<br />
longue chaîne <strong>de</strong>s exclus. On les retrouve<br />
dans les familles, dans la rue, en prison<br />
; laquelle prend la place, pas même<br />
<strong>de</strong> l’asile, mais <strong>de</strong> l’hôpital général, du<br />
« grand renfermement » du XVII e siècle,<br />
décrit par Michel Foucault dans son<br />
Histoire <strong>de</strong> la folie à l’âge classique.<br />
La question essentielle ne consiste donc<br />
pas à se figer sur le passé, mais à tenir<br />
bon sur la vision humaniste <strong>de</strong> la folie<br />
que les désaliénistes du secteur et <strong>de</strong> la<br />
psychothérapie institutionnelle d’aprèsguerre<br />
avaient développée. La société<br />
dans son ensemble doit prendre<br />
conscience <strong>de</strong> l’urgence à regar<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />
nouveau le fou comme un autre soimême.<br />
L’enjeu <strong>de</strong> la réhabilitation <strong>de</strong>s<br />
patients en psychiatrie<br />
Pour Alain Nicolet, psychiatre et Prési<strong>de</strong>nt<br />
<strong>de</strong> la Clinique Pen An Dalar, en<br />
réalité, le grand enfermement est notre<br />
regard sur la maladie. S’il est vrai que la<br />
presse spécialisée a accompli <strong>de</strong> grands<br />
progrès, la presse généraliste, quant à<br />
elle, a encore beaucoup à faire. Il<br />
conviendrait que cette <strong>de</strong>rnière change,<br />
pour faire évoluer l’information du fait<br />
divers vers le fait médical (ce qui intéresse<br />
actuellement la presse autour <strong>de</strong><br />
la maladie mentale est davantage le<br />
premier). De fait, il existe plusieurs<br />
manières <strong>de</strong> relater un même événement.<br />
Nous avons besoin d’être accompagnés<br />
sur le thème <strong>de</strong> l’éducation en<br />
matière <strong>de</strong> santé mentale.<br />
Par ailleurs, la notion <strong>de</strong> guérison doit<br />
être évoquée comme un noeud central<br />
: la guérison peut parfois consister<br />
à aller mieux, à faire le <strong>de</strong>uil <strong>de</strong> certaines<br />
ambitions. Toutes les personnes<br />
imprévisibles sont-elles <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s<br />
mentaux ? Il s’agit là d’une question<br />
importante, qui renvoie à la stigmatisation<br />
<strong>de</strong> la maladie mentale.<br />
Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> leur propre maladie, les<br />
patients souffrent <strong>de</strong> troubles qui touchent<br />
à leur estime <strong>de</strong> soi et à leurs<br />
liens sociaux. Du fait <strong>de</strong> la peur <strong>de</strong> la<br />
récidive ou <strong>de</strong> la décompensation, les<br />
patients tombent alors dans les pathologies<br />
secondaires <strong>de</strong> la maladie que<br />
sont les stratégies d’adaptation, les<br />
échecs familiaux, les troubles cognitifs,<br />
les conduites antisociales et les échecs<br />
professionnels. Il faut apprendre aux<br />
patients à vivre avec et veiller à ne pas<br />
passer notre temps à leur renvoyer <strong>de</strong>s<br />
images non valorisantes.<br />
N°9 - TOME XIX - DÉCEMBRE 2006/JANVIER 2007<br />
On ne peut qu’être favorable à une<br />
déontologie <strong>de</strong> l’information psychiatrique<br />
et déplorer le très faible nombre<br />
d’étu<strong>de</strong>s sur les termes utilisés dans la<br />
maladie mentale. La presse doit nous<br />
ai<strong>de</strong>r à faire connaître les progrès réalisés<br />
et à confirmer que lorsqu’un<br />
patient est pris en charge, il va mieux et<br />
que son pronostic s’en trouve amélioré.<br />
Il convient aujourd’hui d’imaginer <strong>de</strong>s<br />
principes <strong>de</strong> réhabilitation psychosociale<br />
qui considèrent qu’au<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s<br />
symptômes, l’évolution <strong>de</strong>s habilités<br />
sociales et relationnelles est essentielle.<br />
Le regard extérieur que les soignants et<br />
la société portent sur les maladies mentales<br />
est l’un <strong>de</strong>s facteurs <strong>de</strong> la guérison<br />
et <strong>de</strong> l’amélioration <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong>s<br />
patients.<br />
Santé mentale : un<br />
avenir en forme <strong>de</strong> défi<br />
politique<br />
Une volonté politique<br />
Denis Reynaud (secrétaire général <strong>de</strong><br />
l’UNCPSY et Directeur <strong>de</strong> la Clinique<br />
du Mont Suplan) a énuméré les six<br />
défis essentiels qui ont été relevés par<br />
I’UNCPSY.<br />
• Convaincre le pouvoir politique <strong>de</strong><br />
donner une véritable priorité à la psychiatrie.<br />
Lorsque l’on examine ce qui se<br />
passe dans nos établissements, on<br />
constate un effet <strong>de</strong> ciseau entre une<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> soins en augmentation<br />
constante et une offre qui ne cesse<br />
d’être réduite.<br />
• Stopper la montée en puissance irraisonnée<br />
<strong>de</strong> la « psychiatrisation » <strong>de</strong> la<br />
société. Il faut distinguer ce qui relève<br />
du social <strong>de</strong> ce qui relève du psychiatrique.<br />
• Se gar<strong>de</strong>r <strong>de</strong> « judiciariser » la psychiatrie.<br />
Comme bien d’autres secteurs<br />
<strong>de</strong> la société, la psychiatrie est malheureusement<br />
<strong>de</strong> plus en plus soumise<br />
à une forme <strong>de</strong> « judiciarisation ».<br />
• Ne plus penser à la psychiatrie uniquement<br />
en termes <strong>de</strong> coûts. Il s’agit<br />
également d’envisager la psychiatrie en<br />
termes <strong>de</strong> ressources (nombre <strong>de</strong> journées<br />
<strong>de</strong> travail rendues à la société,<br />
nombre <strong>de</strong> personnes ayant quitté leur<br />
La dépression semble plus fréquente chez les<br />
femmes et chez les personnes isolées, selon une<br />
étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Drees<br />
Les femmes présentent entre 1,5 et <strong>de</strong>ux fois plus <strong>de</strong> risques <strong>de</strong> vivre un épiso<strong>de</strong><br />
dépressif que les hommes, montre une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la Direction <strong>de</strong> la recherche<br />
<strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’évaluation et <strong>de</strong>s statistiques (Drees)*, qui met aussi<br />
en évi<strong>de</strong>nce la vulnérabilité <strong>de</strong>s personnes isolées à cette pathologie.<br />
Pour étudier les facteurs <strong>de</strong> risque <strong>de</strong>s épiso<strong>de</strong>s dépressifs en population générale,<br />
la Drees a repris trois étu<strong>de</strong>s sur ce thème : l’enquête en santé mentale<br />
en population générale 1999-2003 (OMS et Drees), le baromètre santé<br />
2004-05 <strong>de</strong> l’Institut national <strong>de</strong> prévention et d’éducation à la santé (Inpes)<br />
et l’enquête décennale santé 2002-03 (Insee et Drees).<br />
L’analyse montre qu’à âge, formation, situation conjugale et professionnelle<br />
i<strong>de</strong>ntiques, une femme présente entre 1,5 et <strong>de</strong>ux fois plus <strong>de</strong> risques qu’un<br />
homme <strong>de</strong> vivre un épiso<strong>de</strong> dépressif. Cet écart entre hommes et femmes<br />
face aux troubles dépressifs doit cependant être nuancé, en raison d’un éventuel<br />
biais <strong>de</strong> sous-déclaration. Il semble que la situation économique et sociale<br />
soit étroitement liée au risque <strong>de</strong> dépression : le tissu familial et relationnel<br />
et l’insertion professionnelle diminuent le risque <strong>de</strong> troubles dépressifs.<br />
Le risque d’un célibataire <strong>de</strong> vivre un épiso<strong>de</strong> dépressif est entre 1,5 et 2,4<br />
fois plus élevé que pour une personne mariée. L’analyse montre aussi que<br />
les circonstances d’une rupture d’un couple (<strong>de</strong>uil ou séparation) influent sur<br />
le risque dépressif.<br />
Concernant l’impact <strong>de</strong> l’activité professionnelle, l’étu<strong>de</strong> montre que la prévalence<br />
<strong>de</strong> l’épiso<strong>de</strong> dépressif parmi les personnes qui occupent un emploi<br />
est <strong>de</strong> un ou trois points moins élevée que celle <strong>de</strong>s personnes qui ne travaillent<br />
pas. L’étu<strong>de</strong> montre également que le risque <strong>de</strong> vivre un épiso<strong>de</strong> dépressif<br />
n’est pas constant tout au long <strong>de</strong> la vie. Même si l’impact <strong>de</strong> l’âge sur<br />
la dépression est moins marqué que celui <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> vie personnelles<br />
et professionnelles, il semble que les personnes âgées <strong>de</strong> 60 à 75 ans sont<br />
moins vulnérables aux troubles dépressifs que les plus jeunes.<br />
Cette observation mérite cependant d’être nuancée, car les personnes vivant<br />
en institution (maison <strong>de</strong> retraite ou structures médicalisées) sont peu ou pas<br />
représentées dans les échantillons étudiés. Enfin, l’étu<strong>de</strong> montre que les facteurs<br />
<strong>de</strong> risque d’ordre économique et social restent prépondérants pour les<br />
épiso<strong>de</strong>s dépressifs majeurs. ■<br />
B.L.<br />
*Etu<strong>de</strong>s et résultats n°545, décembre 2006, Facteurs <strong>de</strong> risque <strong>de</strong>s épiso<strong>de</strong>s dépressifs en<br />
population générale
N°9 - TOME XIX - DÉCEMBRE 2006/JANVIER 2007<br />
Fresnes, Histoires <strong>de</strong> fous<br />
Catherine Herszberg<br />
Seuil<br />
Ce livre témoignage a été largement<br />
commenté à juste titre par les médias.<br />
Je le trouve poignant pour <strong>de</strong>ux<br />
raisons essentielles. D’abord, <strong>de</strong> manière<br />
générale, collective, il fait état<br />
sans sensationnalisme <strong>de</strong> la réalité<br />
carcérale réservée aux mala<strong>de</strong>s mentaux<br />
(mais également aux non mala<strong>de</strong>s).<br />
Les lecteurs non avertis du problème<br />
spécialisé <strong>de</strong> la maladie mentale<br />
en prison pourraient croire en lisant<br />
Catherine Herszberg qu’il s’agit d’une<br />
fiction ou d’une exagération. Et non,<br />
ce que la journaliste relate avec talent,<br />
ce sont <strong>de</strong> vraies histoires <strong>de</strong><br />
fous, <strong>de</strong>s drames actuels et véridiques<br />
qui se passent dans les geôles françaises.<br />
Contrairement au livre <strong>de</strong> Véronique<br />
Vasseur qui avait tendance à forcer<br />
le trait sur une présumée mauvaise<br />
administration pénitentiaire, ce document<br />
est tout en nuances. Le problème<br />
<strong>de</strong>s prisons est avant tout dans<br />
les mains <strong>de</strong>s politiques et <strong>de</strong> certains<br />
professionnels ; probablement pas<br />
dans celles <strong>de</strong> la plupart <strong>de</strong>s citoyens,<br />
bien contents <strong>de</strong> voir les méchants<br />
enfermés et heureux <strong>de</strong> ne pas les y<br />
voir en sortir. Parmi les professionnels<br />
concernés et surtout lorsqu’il<br />
s’agit d’un problème sanitaire, le positionnement<br />
<strong>de</strong>s psychiatres est essentiel.<br />
Les psychiatres exerçant en<br />
prison s’enfonceront-ils <strong>de</strong> plus en<br />
plus dans une collaboration à l’enfermement<br />
carcéral <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s mentaux<br />
et au risque <strong>de</strong> voir leur état <strong>de</strong><br />
santé empirer ? Les psychiatres et les<br />
soignants <strong>de</strong>s hôpitaux psychiatriques<br />
continueront-ils dans leur refus d’admettre<br />
<strong>de</strong>s maladies mentales graves,<br />
à fortiori s’ils sont délinquants ? Et<br />
les experts psychiatres continuerontils<br />
à responsabiliser <strong>de</strong> grands ma-<br />
situation <strong>de</strong> handicap).<br />
• Concevoir la psychiatrie comme une<br />
complémentarité. Il s’agit d’une complémentarité<br />
entre le publie et le privé,<br />
mais également entre les différents<br />
types <strong>de</strong> prise en charge.<br />
• Modifier réellement l’image <strong>de</strong> la psychiatrie<br />
dans la population. Actuellement,<br />
le Plan <strong>de</strong> santé mentale prévoit<br />
<strong>de</strong>s budgets importants dans ce domaine,<br />
mais aucune mise en place n’a été<br />
effectuée à ce jour.<br />
La situation <strong>de</strong> la santé mentale<br />
Gérard Massé, coordinateur <strong>de</strong> la Mission<br />
nationale d’appui en santé mentale,<br />
a rappelé que les politiques sont<br />
<strong>de</strong>s interlocuteurs centraux avec lesquels<br />
les techniciens doivent travailler<br />
au quotidien, pour les éclairer. On estime<br />
aujourd’hui que le pourcentage <strong>de</strong>s<br />
personnes atteintes <strong>de</strong> maladies mentales<br />
s’élève à 3 à 4% <strong>de</strong> la population,<br />
alors que la souffrance psychique<br />
réelle touche en fait 40% <strong>de</strong>s Français<br />
à un moment <strong>de</strong> leur existence.<br />
Si le réseau <strong>de</strong>s acteurs <strong>de</strong> soins en<br />
France est satisfaisant en comparaison<br />
<strong>de</strong> ses pays voisins, il est en revanche<br />
nécessaire <strong>de</strong> faire évoluer le dispositif<br />
actuel <strong>de</strong> soins car une crise d’organisation<br />
liée à <strong>de</strong>s problèmes institutionnels<br />
se fait jour.<br />
Le principal enjeu porte sur une véritable<br />
politique <strong>de</strong> santé mentale associant<br />
la prévention, le soin et l’insertion,<br />
notamment pour la population souffrant<br />
<strong>de</strong> psychoses. Dans ce cadre, il<br />
s’agit <strong>de</strong> formuler <strong>de</strong>s objectifs à la hauteur<br />
d’une réelle insertion <strong>de</strong>s patients.<br />
Alors que l’on constate le poids croissant<br />
<strong>de</strong>s usagers, qui interpellent les politiques<br />
sur la psychiatrie, on déplore une<br />
absence d’évaluation <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong><br />
soin, laquelle conduit souvent à <strong>de</strong>s<br />
débats idéologiques stériles.<br />
Patients, familles, usagers : tous <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt<br />
davantage <strong>de</strong> soins et <strong>de</strong> meilleu-<br />
la<strong>de</strong>s du moment qu’une once <strong>de</strong> lucidité<br />
leur fait admettre qu’un vol alimentaire,<br />
même s’il est commis pour<br />
subsister, est digne d’une sanction<br />
pénale ?<br />
Je trouve poignant cet ouvrage pour<br />
une <strong>de</strong>uxième raison. La juste <strong>de</strong>scription<br />
<strong>de</strong> Fresnes, son volume froid,<br />
ses clairs obscurs, ses bruits, son organisation<br />
particulière, son ordonnance<br />
quasi-militaire, les contrastes<br />
<strong>de</strong>s ambiances (le CNO vs le reste <strong>de</strong><br />
la détention par exemple) me rappelle<br />
que j’y ai travaillé. J’ai quitté<br />
Fresnes il y a dix ans, mais si je retrouve<br />
bien l’immuabilité <strong>de</strong>s lieux,<br />
par contre les conditions <strong>de</strong> travail<br />
<strong>de</strong>s psychiatres semblent s’être considérablement<br />
dégradées avec une augmentation<br />
quantitative et qualitative<br />
considérable du nombre <strong>de</strong> détenus<br />
présentant <strong>de</strong>s pathologies mentales<br />
gravissimes. N’oublions pas qu’il y a<br />
quelques mois, Christiane <strong>de</strong> Beaurepaire,<br />
le mé<strong>de</strong>cin chef du SMPR lançait<br />
un cri d’alarme très médiatisé sur<br />
la situation sanitaire que son équipe<br />
rencontrait.<br />
Catherine Herszberg pose la question<br />
<strong>de</strong> la maladie mentale en prison avec<br />
<strong>de</strong>s mots justes, dans un style limpi<strong>de</strong><br />
qui ne laisse aucune excuse au<br />
citoyen tout venant pour ne pas lire<br />
ce livre. On notera tout particulièrement<br />
le passage sur les UHSA (unités<br />
spécialement aménagées) décrites<br />
comme « l’affirmation officielle qu’il<br />
est légitime <strong>de</strong> les (les mala<strong>de</strong>s mentaux)<br />
emprisonner, et qu’il est <strong>de</strong> surcroît<br />
légitime <strong>de</strong> les punir le <strong>de</strong> les soigner<br />
au même endroit ». Ce qui fait<br />
dire à un soignant dans l’avant-<strong>de</strong>rnier<br />
chapitre : « au rythme où ça va,<br />
on finira par rouvrir les chambres à<br />
gaz ». Si le propos peut sembler exagéré<br />
quand il est extrait du contexte<br />
du livre, vous verrez en lisant les faits<br />
horrifiques qui y sont relatés que<br />
l’exaspération et le désespoir <strong>de</strong> ce<br />
re qualité. Les moyens nécessaires sont<br />
<strong>de</strong> plus en plus importants et complexes.<br />
Ils doivent s’articuler avec les<br />
autres dispositifs, sociaux et médicosociaux.<br />
Cependant, les budgets <strong>de</strong>s démarches<br />
psychiatriques, sociales et médicosociales<br />
sont différents. Plus globalement,<br />
il ne sera pas possible <strong>de</strong> proposer<br />
une réponse <strong>de</strong> santé globale<br />
sans y intégrer un volet « santé mentale<br />
» conséquent. Les besoins sont importants<br />
et posent la question <strong>de</strong> l’articulation<br />
entre la mé<strong>de</strong>cine-chirurgie obstétrique<br />
et le soin psychiatrique. Faut-il<br />
proposer dix RMN <strong>de</strong> plus ou mettre<br />
en place <strong>de</strong> façon conséquente <strong>de</strong>s<br />
équipes psychiatriques d’intervention<br />
à domicile ?<br />
Le Plan français <strong>de</strong> santé mentale a un<br />
réel rôle structurant dans l’ensemble<br />
<strong>de</strong>s régions et le Parlement européen<br />
prendra bientôt position sur la santé<br />
mentale et évoquera notamment les<br />
points suivants :<br />
- la santé mentale en tant que priorité<br />
<strong>de</strong> santé (les pays <strong>de</strong> l’est <strong>de</strong> l’Europe<br />
en sont bien plus conscients que nous) ;<br />
- la santé mentale <strong>de</strong>s enfants et <strong>de</strong>s<br />
adolescents ;<br />
- la santé mentale au travail et le chômage<br />
;<br />
- la santé mentale et le vieillissement<br />
<strong>de</strong> la population.<br />
Il importe bien sûr <strong>de</strong> distinguer ce qui<br />
relève <strong>de</strong> l’offre <strong>de</strong> soins <strong>de</strong>s actions<br />
<strong>de</strong> promotion et <strong>de</strong> prévention, tout<br />
en s’attachant à soigner l’image <strong>de</strong> la<br />
psychiatrie, qui doit être améliorée.<br />
Face à cette situation, un débat politique<br />
et démocratique doit être ouvert.<br />
La psychiatrie française ne franchira les<br />
différents obstacles auxquels elle est<br />
confrontée que grâce à une volonté<br />
politique affirmée.<br />
C’est pourquoi les relations obligatoires<br />
<strong>de</strong>s techniciens du soin avec les politiques<br />
sont si importantes dans notre<br />
discipline.<br />
soignant sont bien compréhensibles.<br />
Une journaliste nous tend la perche<br />
pour témoigner <strong>de</strong> ce que l’on fait.<br />
Qu’attendons-nous, les soignants en<br />
prison pour dire qu’il y a un problème,<br />
un gros problème ? C’est en tout cas<br />
ce que le SMPR <strong>de</strong> Baie-Mahault a<br />
tenté d’exprimer lors <strong>de</strong>s journées<br />
<strong>de</strong>s secteurs <strong>de</strong> psychiatrie en milieu<br />
pénitentiaire à la Rochelle le 6 et 7<br />
novembre <strong>de</strong>rnier, en évoquant la<br />
nécessité d’un nouveau paradigme.<br />
Nos propositions en ont surpris certains.<br />
Elles sont très critiquables mais<br />
elles étaient surtout motivées par le<br />
fait qu’on ne peut pas continuer sur<br />
les modalités actuelles. Elles partent<br />
d’un malaise qui ne peut tenter <strong>de</strong> se<br />
soulager qu’en réfléchissant à <strong>de</strong>s<br />
« portes <strong>de</strong> sortie ».<br />
Mais il n’y a pas que les psy sur terre<br />
pour changer quelque chose. On peut<br />
toujours espérer que ce livre en ces<br />
temps <strong>de</strong> précampagne électorale intéressera<br />
quelques candidats et sensibilisera<br />
un peu plus que quelques<br />
citoyens.<br />
Marcel David<br />
Auto-érotismes, narcissismes<br />
et pulsions du moi<br />
Jean-Michel Porret<br />
L’Harmattan, 17,50 €<br />
L’objectif principal <strong>de</strong> cet ouvrage est<br />
<strong>de</strong> retracer les rapports (conjonctifs<br />
et disjonctifs) qui existent entre les<br />
auto-érotismes et les narcissismes au<br />
cours du développement normal du<br />
psychisme et en tenant compte <strong>de</strong> la<br />
secon<strong>de</strong> théorie freudienne <strong>de</strong>s pulsions<br />
(opposition entre pulsions érotiques<br />
et pulsions <strong>de</strong> <strong>de</strong>struction dans<br />
le ça). En outre, est proposée une vision<br />
générale <strong>de</strong>s pulsions du moi, à<br />
savoir <strong>de</strong>s pulsions qui, sous formes<br />
directes ou transformées, sont à l’œuvre<br />
dans le moi.<br />
Le point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong>s politiques<br />
André Vantomme (Sénateur PS <strong>de</strong><br />
l’Oise) a rappelé que pendant vingt<br />
ans, il a présidé à la <strong>de</strong>stinée d’une ville<br />
<strong>de</strong> 10 000 habitants, qui compte un<br />
centre hospitalier spécialisé employant<br />
2 800 personnes, dont une centaine<br />
<strong>de</strong> psychiatres.<br />
Il a découvert la psychiatrie et ses problèmes<br />
dans le cadre d’un grand établissement<br />
bicentenaire, qui a été un<br />
asile et a su évoluer pour désormais<br />
mettre le patient au cœur du dispositif<br />
<strong>de</strong> soins, et est intimement persuadé<br />
<strong>de</strong> la complémentarité <strong>de</strong>s actions du<br />
public et du privé. Il a évoqué un certain<br />
nombre <strong>de</strong> mesures prises par le passé.<br />
• On ne peut que s’interroger sur la<br />
diminution draconienne du nombre<br />
<strong>de</strong> patriciens sans parier <strong>de</strong> la pratique<br />
du numerus clausus, qui a engendré<br />
<strong>de</strong> graves problèmes.<br />
• La fermeture <strong>de</strong>s écoles d’infirmières<br />
a été interrompue en catastrophe, dans<br />
la mesure où la « solution » <strong>de</strong>s infirmières<br />
espagnoles ne pouvait être satisfaisante<br />
à terme.<br />
• La suppression <strong>de</strong> lits psychiatriques<br />
est dramatique et affecte plus particulièrement<br />
la région parisienne.<br />
• La création du diplôme d’Etat d’infirmier<br />
a entraîné la suppression <strong>de</strong> la<br />
spécificité du diplôme d’infirmier psychiatrique.<br />
Dans certains établissements,<br />
les anciens titulaires du poste d’infirmier<br />
psychiatrique partent à la retraite,<br />
alors que les plus jeunes débutent leur<br />
carrière sans disposer d’une formation<br />
initiale adéquate.<br />
• Les problèmes d’attractivité et les disparités<br />
régionales en matière <strong>de</strong> santé<br />
sont criants. Dans la ville dont André<br />
Vantomme a été maire et qui présente<br />
un taux <strong>de</strong> chômage <strong>de</strong> 9%, 169<br />
postes d’infirmier sont aujourd’hui<br />
vacants.<br />
• Le PLFSS n’est pas suffisamment<br />
conséquent.<br />
• La situation est catastrophique dans<br />
les prisons. Les défis consistent à concilier<br />
le soin et l’incarcération, à humaniser<br />
les conditions <strong>de</strong> vie dans les prisons<br />
et à accueillir dans les hôpitaux<br />
psychiatriques <strong>de</strong>s personnes parfois<br />
dangereuses et violentes.<br />
• Sous couvert <strong>de</strong> lutte contre la délinquance,<br />
le ministre <strong>de</strong> l’Intérieur intervient<br />
dans le domaine <strong>de</strong> la santé, alors<br />
que ce <strong>de</strong>rnier relève <strong>de</strong> la compétence<br />
du ministère <strong>de</strong> la Santé.<br />
Marie-Anne Montchamp (ancien<br />
Ministre et Député UMP du Val-<strong>de</strong>-<br />
Marne) a précisé qu’elle a rencontré<br />
pour la première fois la question <strong>de</strong> la<br />
santé mentale lorsqu’elle a préparé la<br />
loi sur l’égalité <strong>de</strong>s droits et <strong>de</strong>s chances,<br />
la participation et la citoyenneté <strong>de</strong>s<br />
personnes handicapées. A cette occasion,<br />
elle a été confrontée <strong>de</strong> plein<br />
fouet à cette problématique, notamment<br />
lors <strong>de</strong> ses rencontres avec <strong>de</strong>s<br />
associations <strong>de</strong> patients.<br />
Dans ce cadre, elle a dû conduire un<br />
certain nombre d’arbitrages en faveur<br />
<strong>de</strong> l’inclusion du handicap psychique<br />
dans le champ du handicap et du développement<br />
d’une approche politique<br />
spécifique. Il faut dire à l’ensemble <strong>de</strong><br />
nos compatriotes que l’on peut être<br />
privé d’autonomie lorsque l’on est<br />
sourd ou aveugle, mais également<br />
lorsque l’on est affecté <strong>de</strong> troubles psychiques.<br />
Le concept <strong>de</strong> handicap psychique est<br />
un point d’équilibre permettant d’ouvrir<br />
<strong>de</strong>s droits spécifiques. Nos compatriotes<br />
doivent savoir que la maladie mentale<br />
n’est pas simplement une série <strong>de</strong><br />
symptômes, mais peut être un véritable<br />
empêchement à la libre participation<br />
et à la citoyenneté.<br />
En matière <strong>de</strong> santé mentale, le politique<br />
est plus que jamais dans son rôle<br />
d’arbitrage. Il doit répondre à la question<br />
<strong>de</strong> savoir jusqu’où aller le plus loin<br />
pour faire avancer une question sensible<br />
sur un sujet douloureux, tout en<br />
ne basculant pas dans une vulgarisation<br />
excessive. Aujourd’hui, il est temps<br />
que les politiques se saisissent du problème<br />
<strong>de</strong>s troubles psychiques, qui<br />
constitue une véritable priorité <strong>de</strong> santé<br />
publique, collective. Il s’agit <strong>de</strong> faire en<br />
sorte que la question <strong>de</strong> la santé mentale<br />
ne soit plus seulement l’affaire <strong>de</strong>s<br />
spécialistes, mais constitue également<br />
une partie <strong>de</strong> notre conscience collective<br />
plus éveillée.<br />
Pour y parvenir, il est nécessaire <strong>de</strong><br />
recueillir un certain nombre <strong>de</strong> données,<br />
notamment sur les coûts évités<br />
par la prise en charge médicale. Il s’agit<br />
également <strong>de</strong> déspécialiser cette thématique<br />
et sans doute d’abor<strong>de</strong>r la<br />
question du bien-être psychique<br />
comme un projet politique pour les<br />
Français. Il y a là un objet <strong>de</strong> préoccupation<br />
qui ne concerne pas uniquement<br />
le ministre <strong>de</strong> la Santé et qui doit<br />
prendre le risque <strong>de</strong> définir <strong>de</strong>s priorités<br />
pour l’époque actuelle et les dix<br />
ans à venir.<br />
En tant qu’élue, Marie-Anne Montchamp<br />
a la conviction que notre société<br />
est mûre pour ce changement.<br />
Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la contribution du politique,<br />
il faut refon<strong>de</strong>r un investissement collectif,<br />
c’est-à-dire trouver, au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s<br />
arbitrages, <strong>de</strong>s points d’entrée convaincants<br />
et durables.<br />
Conclusion<br />
Dans sa conclusion, Jacques Gayral a<br />
précisé qu’il est bien évi<strong>de</strong>nt qu’il n’est<br />
pas possible <strong>de</strong> traiter exhaustivement<br />
lors d’un colloque qui ne dure que<br />
quelques heures une question aussi<br />
vaste,<br />
Cependant, ont été réunis <strong>de</strong>s parlementaires,<br />
<strong>de</strong>s journalistes, <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins,<br />
<strong>de</strong>s représentants <strong>de</strong>s hôpitaux et<br />
<strong>de</strong>s cliniques afin <strong>de</strong> lancer <strong>de</strong>s pistes<br />
<strong>de</strong> réflexion, avec un objectif qui<br />
consiste bien à faire <strong>de</strong> la psychiatrie<br />
et <strong>de</strong> la santé mentale une cause<br />
nationale. ■<br />
COLLOQUE ■ 11<br />
LIVRES ET REVUES<br />
Les recours aux soins<br />
spécialisés en santé<br />
mentale<br />
François Chapireau<br />
Etu<strong>de</strong>s et Résultats nvembre 2006<br />
n°533, DREES<br />
Le recours aux soins spécialisés en<br />
santé mentale est appréhendé par<br />
l’enquête santé <strong>de</strong> INSEE en 2003 à<br />
travers la déclaration que font les personnes<br />
d’avoir consulté un psychiatre,<br />
un psychologue ou un psychanalyste,<br />
ou d’avoir été hospitalisées dans un<br />
service <strong>de</strong> psychiatrie. Trois dimensions<br />
<strong>de</strong> la santé mentale sont ici<br />
prises en compte pour les caractériser<br />
: avoir déclaré un trouble psychique,<br />
avoir recouru à une consultation<br />
non programmée « pour le<br />
moral » et enfin connaître <strong>de</strong>s difficultés<br />
sociales. Neuf consultants sur<br />
dix se sont adressés à un seul <strong>de</strong>s<br />
trois spécialistes en santé mentale<br />
considérés. Ce sont en majorité <strong>de</strong>s<br />
femmes (70%) et dans plus <strong>de</strong> la moitié<br />
<strong>de</strong>s cas <strong>de</strong>s personnes seules. Ce<br />
recours est le plus souvent motivé<br />
par un trouble psychique avec une<br />
propension plus forte à consulter<br />
quand le niveau <strong>de</strong> formation <strong>de</strong>s<br />
enquêtés est élevé. Cependant, les<br />
caractéristiques <strong>de</strong>s patients sont différentes<br />
selon les praticiens. Les psychiatres<br />
reçoivent surtout <strong>de</strong>s adultes<br />
en forte détresse psychique et aux<br />
parcours professionnels perturbés,<br />
mais avec <strong>de</strong>s caractéristiques assez<br />
diversifiées du point <strong>de</strong> vue socioprofessionnel.<br />
La clientèle <strong>de</strong>s psychologues<br />
est pour moitié composée<br />
<strong>de</strong> jeunes <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> 20 ans, qui<br />
présentent souvent <strong>de</strong>s troubles psychiques<br />
et physiologiques associés.<br />
Les personnes qui consultent un psychanalyste,<br />
bien qu’elles aient un niveau<br />
<strong>de</strong> formation plus élevé que la<br />
moyenne, sont plus difficiles à cerner<br />
dans la mesure où leur rythme<br />
<strong>de</strong> consultation déclaré ne correspond<br />
pas aux standards <strong>de</strong> la cure<br />
analytique. Enfin, celles qui ont été<br />
hospitalisées en psychiatrie cumulent<br />
<strong>de</strong> lour<strong>de</strong>s difficultés sociales et un<br />
important recours aux soins non psychiatriques.<br />
Histoire <strong>de</strong> l’hystérie<br />
Etienne Trillat<br />
Préface <strong>de</strong> Jacques Postel<br />
Editions Frison-Roche, 35 E<br />
Dans sa préface, Jacques Postel relève<br />
qu’il était temps <strong>de</strong> republier<br />
cette « Histoire <strong>de</strong> l’hystérie » que son<br />
auteur avait confiée à la collection<br />
que dirigeait alors Clau<strong>de</strong> Quétel, chez<br />
Seghers. C’est en 1986 que paraissait<br />
dans « Mé<strong>de</strong>cine et Histoire », ce<br />
livre qui allait obtenir le prix <strong>de</strong> la<br />
« Société Française <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine » dès<br />
l’année suivante.<br />
La meilleure partie <strong>de</strong> l’ouvrage reste<br />
celle qui recouvre la <strong>de</strong>uxième partie<br />
du XIX e siècle et les débuts <strong>de</strong> la<br />
découverte freudienne : sur Charcot<br />
avec « l’hystérie pénétrant enfin dans<br />
le temple <strong>de</strong> la Science », sur la place<br />
<strong>de</strong> l’hystérie à cette époque dans l’ensemble<br />
<strong>de</strong>s « névroses », sur le conflit<br />
entre l’école <strong>de</strong> Paris et celle <strong>de</strong> Nancy<br />
sur le rôle <strong>de</strong> la suggestion et la nature<br />
<strong>de</strong> l’hypnose, sur P. Janet et sa<br />
« psychasthénie », sur l’importance <strong>de</strong>s<br />
observations du jeune S. Freud sur<br />
l’hystérie dans sa découverte <strong>de</strong> l’inconscient<br />
et l’invention <strong>de</strong> la psychanalyse,<br />
sur le rôle aussi <strong>de</strong> la religion<br />
et <strong>de</strong> la culture dans l’abord <strong>de</strong><br />
l’hystérie. On se souvient, à ce propos,<br />
<strong>de</strong> la phrase <strong>de</strong>s Goncourt dans<br />
leur journal : « La religion est une partie<br />
du sexe <strong>de</strong> la femme ».
12<br />
LIVRES<br />
■ PSYCHOSE ET CRÉATION<br />
Psychanalyse <strong>de</strong>s limites<br />
Didier Anzieu<br />
Textes réunis et présentés par<br />
Catherine Chabert<br />
Dunod, 26 €<br />
Catherine Chabert a fait le choix <strong>de</strong><br />
publier dans cet ouvrage <strong>de</strong>s textes<br />
<strong>de</strong> Didier Anzieu qui ont tous trait à<br />
la psychanalyse <strong>de</strong>s limites, car le<br />
changement dans la nature <strong>de</strong> la souffrance<br />
<strong>de</strong>s patients qui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt<br />
une analyse engage davantage <strong>de</strong><br />
patients limites ou narcissiques, donc<br />
<strong>de</strong> patients qui souffrent d'un manque<br />
<strong>de</strong> limites.<br />
A côté <strong>de</strong>s ouvrages synthétiques <strong>de</strong><br />
Didier Anzieu qui ont jalonné son<br />
parcours et qui ont constitué les pôles<br />
d'attraction <strong>de</strong> sa pensée, un certain<br />
nombre d'articles ont soutenu sa démarche,<br />
les uns ayant été plus tard<br />
repris dans un livre, les autres laissés<br />
à leur édition d'origine.<br />
Les cinq points proposés peuvent être<br />
résumés ainsi :<br />
- il faut compléter la perspective topique<br />
sur l'appareil psychique par<br />
une perspective plus strictement topographique,<br />
c'est-à-dire en rapport<br />
avec l'organisation spatiale du Moi<br />
corporel et du Moi psychique ;<br />
- il faut compléter l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s fantasmes<br />
relatifs aux contenus psychiques<br />
par celle <strong>de</strong>s fantasmes concernant<br />
les contenants psychiques ;<br />
- compléter la compréhension du<br />
sta<strong>de</strong> oral comme reposant sur l'activité<br />
<strong>de</strong> succion par la prise en considération<br />
du contact corps à corps<br />
bébé/mère ;<br />
- compléter le double interdit œdipien<br />
par un double interdit du toucher<br />
qui en serait le précurseur ;<br />
- enfin, il faut compléter le setting psychanalytique<br />
classique par <strong>de</strong>s aménagements<br />
éventuels, et par la prise<br />
en compte <strong>de</strong> la disposition du corps<br />
du patient et <strong>de</strong> sa représentation <strong>de</strong><br />
l'espace analytique au sein du dispositif.<br />
Ils ont tué leurs enfants<br />
Approche psychologique <strong>de</strong><br />
l’infantici<strong>de</strong><br />
Odile Verschoot<br />
Préface <strong>de</strong> Sophie Marinopoulos<br />
Imago, 20 €<br />
Sans antécé<strong>de</strong>nt judiciaire, ni maladie<br />
psychiatrique avérée, le geste infantici<strong>de</strong><br />
surgit d’un double désir :<br />
le désir fou <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r en soi l’enfant<br />
que l’on craint <strong>de</strong> perdre et, en<br />
éliminant la <strong>de</strong>scendance, celui <strong>de</strong><br />
conserver sa place <strong>de</strong> « nourrisson<br />
psychique » au sein <strong>de</strong> la famille initiale.<br />
Au cours <strong>de</strong> sa pratique <strong>de</strong> psychologue<br />
en milieu pénitentiaire, Odile<br />
Verschoot a recueilli la parole douloureuse<br />
<strong>de</strong> ces parents meurtriers.<br />
Elle a enquêté avec eux - et non pas<br />
simplement sur eux - pour tenter <strong>de</strong><br />
comprendre.<br />
Le crime filici<strong>de</strong> a un fon<strong>de</strong>ment passionnel,<br />
mais se distingue toutefois<br />
du « crime passionnel » (tel que le définissait<br />
autrefois le co<strong>de</strong> pénal) du<br />
fait <strong>de</strong> la filiation entre meurtrier(ère)<br />
et victime. Les causalités socio-économiques,<br />
exogènes et médico-légales<br />
ne suffisent jamais à « expliquer<br />
» pourquoi un parent tue son<br />
enfant. Seule la problématique <strong>de</strong><br />
l’abandon, au cœur du fonctionnement<br />
psychique inconscient, fon<strong>de</strong><br />
ce processus meurtrier. L’enfant procréé<br />
pour combler échoue dans cette<br />
mission que son parent lui avait assignée.<br />
L’élimination <strong>de</strong> la <strong>de</strong>scendance permet<br />
au meurtrier <strong>de</strong> revenir à sa place<br />
initiale d’enfant.<br />
Laurence François : En février 1842,<br />
Clara reprend sa carrière <strong>de</strong> soliste, le<br />
couple part en tournée dans le nord.<br />
Mais Robert abandonne le voyage<br />
après 6 semaines et rentre seul au<br />
domicile conjugal. Il ne compose plus<br />
jusqu’au retour <strong>de</strong> Clara fin avril, sort,<br />
boit <strong>de</strong> l’alcool, se déprime...<br />
Marc Kowalczyk : Quintette avec<br />
piano en Mi b majeur, Opus 44 (1842,<br />
2 violons, 1 alto, 1 violoncelle et 1<br />
piano)<br />
Ecrite en 5 jours, c’est la première<br />
œuvre célèbre pour cette formation.<br />
Schumann s’est enfin décidé à s’ouvrir<br />
à d’autres instruments, sur les conseils<br />
<strong>de</strong> Liszt et <strong>de</strong> Clara. Malgré tout, Schumann<br />
confie au piano la partie principale<br />
(on peut même dire que le piano<br />
est concertant). Le piano est noté sur la<br />
partition « sempre con molto sentimento<br />
». A ce sujet, Nietzsche souligne<br />
« l’ivrognerie du sentiment chez Schumann<br />
». L’écriture contrapuntique est<br />
jugée obsessionnelle, asymétrique et<br />
pleine <strong>de</strong> ruptures. On remarque le<br />
grand lyrisme du permier mouvement ;<br />
un air <strong>de</strong> musette et un style fugato à<br />
la Bach dans le quatrième mouvement.<br />
L.F. : Un nouveau silence fait suite à<br />
cette explosion créatrice : en 1843<br />
Schumann semble épuisé par ce qu’il<br />
nomme une « dépression nerveuse », il<br />
a <strong>de</strong> multiples malaises et consulte les<br />
docteurs Müller, père et fils, homéopathes.<br />
Il fait la connaissance <strong>de</strong> Berlioz<br />
en février.<br />
Sa <strong>de</strong>uxième fille, Elise, naît le 25 avril<br />
1843. Puis il prend le poste <strong>de</strong> professeur<br />
<strong>de</strong> composition au conservatoire<br />
<strong>de</strong> Leipzig, dirigé par son ami Men<strong>de</strong>lssohn<br />
et accepte la réconciliation<br />
forcée que lui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> Wieck. Il décline<br />
l’offre <strong>de</strong> la maison d’édition <strong>de</strong><br />
l’Allgemeine Muzikalische Zeitung d’en<br />
reprendre la direction, ce qui aurait<br />
mis définitivement sa famille à l’abri<br />
du besoin. Parallèlement, il délaisse sa<br />
propre revue, et finit par la revendre à<br />
un <strong>de</strong> ses collaborateurs. Il pose sa candidature<br />
à la succession <strong>de</strong> Men<strong>de</strong>lssohn<br />
comme chef d’orchestre au<br />
Gewandhaus, qui lui est refusée au<br />
profit <strong>de</strong> Niels Ga<strong>de</strong>. De son côté,<br />
Clara triomphe dans une tournée <strong>de</strong><br />
concerts en Russie entre janvier et mai<br />
1844 en exécutant parfois certaines<br />
<strong>de</strong> ses œuvres. Schumann l’accompagne,<br />
mais il ne se sent toujours perçu<br />
que comme le mari <strong>de</strong> la virtuose et en<br />
est blessé. Il est insomniaque, souffre <strong>de</strong><br />
vertiges, tremblements <strong>de</strong>s membres,<br />
ruminations, crises <strong>de</strong> larmes, rhumatismes,<br />
<strong>de</strong> prurit diffus. Il est quasi<br />
mutique, ce qui est remarqué dans les<br />
soirées mondaines où il reste en retrait<br />
et murmure <strong>de</strong>s choses inintelligibles<br />
quand on s’adresse à lui. Le journal<br />
intime est interrompu : « j’éprouve <strong>de</strong> la<br />
difficulté à m’exprimer en paroles ou par<br />
écrit et un quart d’heure au piano me<br />
permet d’en dire plus long ». Sa correspondance<br />
se raréfie et <strong>de</strong>vient laconique.<br />
Son mé<strong>de</strong>cin lui intime le repos<br />
et l’interdiction <strong>de</strong> travailler, qu’il ne<br />
respectera pas. Des douleurs d’oreille,<br />
<strong>de</strong>s acouphènes, comme <strong>de</strong>s trompettes<br />
lui résonnent dans la tête, même<br />
la musique lui est pénible. Il boit, fume<br />
et ne parvient plus à travailler.<br />
En août 1844, il débute <strong>de</strong>s séances<br />
d’hydrothérapie, très en vogue à<br />
l’époque, suivant les conseils du Dr<br />
Josephson <strong>de</strong> Stockholm une cure <strong>de</strong> 6<br />
semaines <strong>de</strong> bains froids en mer du<br />
Nord dans l’île <strong>de</strong> Nor<strong>de</strong>ney, puis <strong>de</strong>s<br />
bains <strong>de</strong> rivière dans l’Elbe qui coule à<br />
Dres<strong>de</strong>, à Ba<strong>de</strong>n-ba<strong>de</strong>n, à Carlsbad ou<br />
dans le lac Léman…Il. tente <strong>de</strong> se lier<br />
d’amitié avec Richter, Reinich ou Wagner<br />
et fait un nouveau séjour décevant<br />
à Vienne. Las, à l’automne, il prend la<br />
décision <strong>de</strong> quitter Leipzig pour Dres<strong>de</strong>,<br />
la ville la plus musicale <strong>de</strong> l’Allemagne,<br />
et se retire donc du conservatoire.<br />
En novembre 44, Ernestine von<br />
Friecken, sa première fiancée décè<strong>de</strong>.<br />
En 1845, Schumann tente d’autres<br />
remè<strong>de</strong>s pour sortir <strong>de</strong> son état, dont<br />
<strong>de</strong>s séances magnétiques du Dr Helbig,<br />
un disciple <strong>de</strong> Mesmer, qui pratique<br />
l’hypnose. Celui-ci note que son<br />
patient souffre « d’hallucinations auditives<br />
liées à un excès non physiologique<br />
<strong>de</strong> travail <strong>de</strong> composition, d’une insomnie<br />
persistante ; mais également <strong>de</strong> la<br />
peur <strong>de</strong>s montagnes, <strong>de</strong>s constructions<br />
élevées, <strong>de</strong>s outils en métal, <strong>de</strong>s clefs, <strong>de</strong>s<br />
médicaments et <strong>de</strong>s poisons ».<br />
« Il y a au <strong>de</strong>dans <strong>de</strong> moi un battement<br />
<strong>de</strong> tambour et pendant plusieurs jours<br />
<strong>de</strong> la trompette, je ne sais qu’en faire »,<br />
écrit Schumann.<br />
A force d’obstination il se remet à la<br />
composition, puis craque <strong>de</strong> nouveau :<br />
l’année 1846 est pauvre, une nouvelle<br />
série <strong>de</strong> bains <strong>de</strong> mer n’entraîne aucune<br />
amélioration. Une série <strong>de</strong> concerts<br />
est décevante à Vienne, tandis qu’une<br />
autre est plus satisfaisante à Prague. La<br />
mort brutale <strong>de</strong> Men<strong>de</strong>lssohn le 4<br />
novembre 1847, par hémorragie cérébrale,<br />
lui ajoute une nosophobie : un<br />
matin il est persuadé d’être victime<br />
d’une crise d’apoplexie et refuse <strong>de</strong> se<br />
lever. En 1848, il <strong>de</strong>vient chef <strong>de</strong> 2<br />
chœurs à Dres<strong>de</strong>, brigue divers postes<br />
qui lui sont refusés.<br />
Sur le plan familial, quatre autres<br />
enfants naissent entre 45 et 49 (Julie ;<br />
Emile qui meurt à 16 mois en juin 47 ;<br />
Ludwig et Ferdinand).<br />
M.K. : Trio n°1 en Ré mineur, Opus<br />
63 (1847, Violon, violoncelle et piano)<br />
Clara vient <strong>de</strong> finir son Trio avec piano<br />
en Sol mineur et c’est naturellement<br />
que Schumann compose le sien. Son<br />
âme tourmentée s’exprime à son aise :<br />
le langage est tendu, l’écriture est serrée,<br />
saccadée, avec <strong>de</strong> grands mouvements<br />
ascendants et <strong>de</strong>scendants. L’ar<strong>de</strong>ur<br />
romantique du 1er mouvement est<br />
reprise au Final. La mélodie <strong>de</strong> 7<br />
mesures irrégulières, notée « avec énergie<br />
et souffrance », est jouée au violoncelle<br />
sul ponticello (joué près du chevalet,<br />
son fondamental appauvri, rend<br />
un son étrange et cristallin). Le piano<br />
est scintillant et très aigu. Le 4ème<br />
mouvement appartient à une « époque<br />
d’humeurs sombres » selon Schumann.<br />
La lassitu<strong>de</strong> du mon<strong>de</strong> est décrite au<br />
piano grave, avec <strong>de</strong>s retards, <strong>de</strong>s<br />
modulations <strong>de</strong> majeur à mineur, <strong>de</strong><br />
longues phrases et <strong>de</strong>s tensions musicales.<br />
L.F. : L’année 1849 est prolifique :<br />
Schumann, emporté dans une euphorie<br />
créatrice, s’achète un piano beaucoup<br />
trop cher, les mélodies se pressent<br />
dans son esprit, il écrit dans <strong>de</strong>s lettres<br />
à Hiller : « jamais je n’ai été plus actif, ni<br />
plus heureux en art », « »j’ai trouvé dans<br />
le travail une consolation aux terribles<br />
évènements extérieurs ». Son humeur<br />
quotidienne loin d’être exaltée exprime<br />
donc toujours la douleur <strong>de</strong> vivre. Son<br />
frère aîné Karl décè<strong>de</strong> en avril, Robert<br />
reste le <strong>de</strong>rnier <strong>de</strong> sa famille. En juin, il<br />
évoque dans son journal ses « stupi<strong>de</strong>s<br />
ruminations hypochondriaques ». Chopin<br />
décè<strong>de</strong> à Paris en octobre. Le 3<br />
décembre il écrit à Hiller, « il faut créer<br />
tant qu’il fait jour ».<br />
M.K. : Marchenbil<strong>de</strong>r, Opus 113<br />
(1849, Alto et piano)<br />
Ces 4 méditations lentes, écrites en 5<br />
jours, portent, selon Sandrine Blon<strong>de</strong>t<br />
(Harmonia Mundi), <strong>de</strong>s « images <strong>de</strong><br />
contes <strong>de</strong> fées » […] <strong>de</strong>s « frémissements<br />
inquiétants <strong>de</strong> l’alto comme étouffés par<br />
la brume <strong>de</strong>s accords immatériels du<br />
piano ». Après la course folle, on assiste<br />
à une « expression mélancolique »<br />
avec un ostinato <strong>de</strong> basses. Schumann<br />
utilise l’alto pour son timbre mystérieux,<br />
poétique et proche <strong>de</strong> la voix<br />
humaine. Brahms, influencé certainement<br />
par cette œuvre, composera plus<br />
tard <strong>de</strong>ux sonates pour alto. Le 1er<br />
mouvement exprime en Ré mineur<br />
<strong>de</strong>s regrets aux <strong>de</strong>ux instruments qui se<br />
répon<strong>de</strong>nt ; le 4ème mouvement est<br />
une berceuse en Ré majeur.<br />
L.F. : Le 25 juin 1850, la création <strong>de</strong><br />
son opéra Genoveva au théâtre <strong>de</strong><br />
Leipzig, qui a été longtemps repoussée,<br />
ne remporte qu’un succès d’estime<br />
et peu <strong>de</strong> bonnes critiques, ça le désespère.<br />
Le couple Schumann déménage<br />
alors à Düsseldorf, le 2 septembre 50<br />
et là, Robert prend la direction <strong>de</strong> l’orchestre<br />
<strong>de</strong> la ville, à la suite <strong>de</strong> Hiller. Il<br />
lui a fallu une année <strong>de</strong> réflexion avant<br />
d’accepter (il doit surmonter sa peur<br />
<strong>de</strong> vivre dans une ville qui possè<strong>de</strong> un<br />
asile d’aliénés). Il s’agit d’une <strong>de</strong>s plus<br />
lour<strong>de</strong>s responsabilités qu’il ait eu à<br />
assumer jusque-là. L’accueil y est plutôt<br />
chaleureux. Une fille, Eugénie naît en<br />
décembre 1851. En 1582, Schumann<br />
suit une nouvelle cure <strong>de</strong> bains dans le<br />
Rhin. L’angoisse est toujours présente,<br />
accompagnée <strong>de</strong> vertiges et <strong>de</strong> douleurs<br />
diffuses. Malgré cela, il compose<br />
sans trêve et, en avril, poursuit une balnéothérapie<br />
en Hollan<strong>de</strong>.<br />
En 1852, dès sa <strong>de</strong>uxième saison d’orchestre,<br />
la bonne entente entre Schumann<br />
et ses musiciens s’éro<strong>de</strong> : on lui<br />
reproche son hermétisme. Robert est<br />
tellement concentré sur la musique ou<br />
rêveur qu’il oublie jusqu’à la présence<br />
<strong>de</strong>s musiciens ; ou encore s’adresse à<br />
eux d’une voix assourdie, inaudible. Sa<br />
baguette lui échappe <strong>de</strong> la main, à tel<br />
point qu’il l’y attache avec une ficelle.<br />
Dirigeant l’orchestre lors d’une messe,<br />
il continue à brasser <strong>de</strong> grands mouvements<br />
alors que le chœur s’est tu et<br />
que le prêtre a repris la parole. Asthénique,<br />
il est obnubilé par la vitesse<br />
d’exécution <strong>de</strong>s œuvres et fait toujours<br />
ralentir les tempi. Il a <strong>de</strong> gros troubles<br />
<strong>de</strong> mémoire et d’attention. On lui<br />
reproche sa programmation : pas assez<br />
<strong>de</strong> Mozart, Berlioz, Liszt, Wagner ou<br />
<strong>de</strong> musique française. En réalité, il dirige<br />
surtout les compositions qu’il est<br />
encore capable <strong>de</strong> maîtriser. A partir<br />
<strong>de</strong> l’automne 1852 une hallucination<br />
auditive <strong>de</strong> la note La l’envahit, son<br />
activité se réduit.<br />
M.K. : Requiem latin, Opus 148 (1852,<br />
Solistes, chœur et orchestre)<br />
En 1849, Schumann écrit à un ami :<br />
« Je me suis orienté vers l’église ». En<br />
effet, juste avant ce Requiem, Schumann<br />
a composé une Messe latine,<br />
Opus 147.<br />
Les mélodies sont régulières et sans<br />
surprise. Schumann a, en quelque sorte,<br />
N°9 - TOME XIX - DÉCEMBRE 2006/JANVIER 2007<br />
Psychose et création : vie et<br />
œuvre <strong>de</strong> Robert Schumann<br />
2ème partie<br />
Michel Henry<br />
Pensée <strong>de</strong> la vie et culture<br />
contemporaine<br />
Colloque international <strong>de</strong><br />
Montpellier<br />
Beauchesne, 24 €<br />
Michel Henry (1922-2002) a renouvelé<br />
les travaux sur l’essence <strong>de</strong> la<br />
manifestation et l’affectivité, la phénoménologie<br />
<strong>de</strong> la corporéité et l’incarnation,<br />
l’auto-révélation et l’autodonation<br />
<strong>de</strong> la vie, la phénoménologie<br />
matérielle et la phénoménologie <strong>de</strong><br />
l’invisible, la chair et la subjectivité<br />
transcendantale, la philosophie du<br />
christianisme. La critique <strong>de</strong> l’objectivisme<br />
galiléen <strong>de</strong>s idéologies scientistes,<br />
la dénonciation <strong>de</strong>s formes<br />
politiques, médiatiques et culturelles<br />
<strong>de</strong> la barbarie mo<strong>de</strong>rne, l’affirmation<br />
<strong>de</strong> la primauté <strong>de</strong> l’individu vivant<br />
contre toutes les abstractions économiques,<br />
réifications techniques ou<br />
hypostases sociales ont conduit Mi-<br />
domestiqué Florestan et Eusebius, il a<br />
fait un compromis avec la société bourgeoise<br />
<strong>de</strong> son époque. Ce compromis<br />
sera encore plus visible avec ses Scènes<br />
du Faust (achevées en 1853) où le<br />
grand thème <strong>de</strong> Faust n’est pas traité<br />
avec les problèmes mo<strong>de</strong>rnes, mais<br />
avec les regrets du passé et les charmes<br />
<strong>de</strong> la paix domestique. Schumann<br />
oublie le « déchirement du mon<strong>de</strong> »<br />
selon Heine, sa musique est statique<br />
comme figée.<br />
L.F. : Après le premier concert <strong>de</strong> la<br />
saison 1853, il est incapable <strong>de</strong> diriger<br />
jusqu’à la fin du programme. Une situation<br />
plutôt humiliante se met en place :<br />
on ne lui laisse plus diriger que ses<br />
propres œuvres…puis le couperet<br />
tombe le 19 novembre 1853 : on lui<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> sa démission. Dans le même<br />
temps Clara note : « Il ressent une<br />
angoisse insupportable ; il ne peut dormir<br />
et <strong>de</strong>vient sporadiquement la proie d’une<br />
agitation anxieuse incoercible, il parcourt<br />
la chambre en gémissant ». Son journal<br />
ne comporte plus que quelques mots<br />
par jour « pénibles souffrances » ; « triste<br />
épuisement <strong>de</strong> mes forces ». La même<br />
année, il rencontre Johannes Brahms,<br />
âgé <strong>de</strong> 20 ans, dont la présence permet<br />
une brève amélioration <strong>de</strong> 3 mois. Il<br />
écrit un <strong>de</strong>rnier article annonçant un<br />
nouveau génie. Schumann se prend<br />
<strong>de</strong> passion pour le spiritisme, pratique<br />
courante à l’époque, passion qui l’accapare<br />
d’autant plus qu’il s’isole <strong>de</strong> plus<br />
en plus. Il affirme que « les tables tournantes<br />
savent tout » et s’adresse aux<br />
esprits avec l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> sa table <strong>de</strong> salon,<br />
qu’il récompense <strong>de</strong> ses services en<br />
<strong>de</strong>mandant à Clara <strong>de</strong> lui confectionner<br />
un nouveau tapis (<strong>de</strong> table). Eugénie<br />
Schumann écrit dans une lettre à<br />
Brahms : « Il semble que l’esprit ne suit<br />
plus le fil <strong>de</strong> sa pensée que par un effort<br />
spasmodique ». Une <strong>de</strong>rnière joie musicale<br />
survient en janvier 1854 : Brahms<br />
et Joachim organisent un festival Schumann<br />
à Hanovre qui est un triomphe<br />
complet, puis une tournée en Hollan<strong>de</strong><br />
avec Clara.<br />
M.K. : La troisième pério<strong>de</strong>, <strong>de</strong> 1853<br />
à 1854, est considérée comme la pério<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> fin. Cette pério<strong>de</strong>, avec puis sans<br />
Clara, peut aussi être appelée fantomatique<br />
en raison du retard <strong>de</strong> l’exécution<br />
<strong>de</strong> certaines créations, et surtout<br />
du caractère mystérieux qui<br />
entoure certaines œuvres.<br />
Concerto pour violon en Ré mineur, A<br />
23 (1853, Violon et orchestre)<br />
Ce concerto, écrit en 13 jours, est dédié<br />
chel Henry à défendre la vie, à célébrer<br />
les valeurs <strong>de</strong> l’esprit, <strong>de</strong> l’art<br />
et <strong>de</strong> la culture jusqu’à la vérité <strong>de</strong><br />
la vie absolue portée par les paroles<br />
du Christ. Le colloque international<br />
<strong>de</strong> Montpellier - « Michel Henry.Phénoménologie<br />
<strong>de</strong> la vie et culture contemporaine<br />
» - a tenu à rendre hommage<br />
à cette œuvre qui a ouvert <strong>de</strong> nombreux<br />
horizons <strong>de</strong> recherche.<br />
D’abord pour le renouvellement <strong>de</strong><br />
la phénoménologie et la réinterprétation<br />
<strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> la philosophie<br />
(Eckhart, Descartes, Spinoza, Maine<br />
<strong>de</strong> Biran, Kant, Hegel, Kierkegaard,<br />
Marx, Schopenhauer, Nietzsche, Husserl,<br />
Hei<strong>de</strong>gger notamment), mais<br />
aussi dans tous les domaines du<br />
« Mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> la vie » et <strong>de</strong> la praxis humaine<br />
: la théologie, les sciences <strong>de</strong><br />
l’homme et <strong>de</strong> la vie, la psychologie<br />
et la psychanalyse, l’économie politique,<br />
l’esthétique et la création artistique,<br />
l’éducation et la thérapie,<br />
l’éthique et la politique.
N°9 - TOME XIX - DÉCEMBRE 2006/JANVIER 2007<br />
L’Ecole <strong>de</strong> Psychosomatique<br />
L’Ecole <strong>de</strong> Psychosomatique* (http://www.ecole-psychosomatique.org/) a,<br />
<strong>de</strong>puis sa création en 1983, <strong>de</strong>ux pôles d’activité et d’élaboration : le champ<br />
psychosomatique, dans une perspective interdisciplinaire, et les psychothérapies.<br />
Ce second axe, initié par la question <strong>de</strong>s approches spécifiques et développé<br />
à partir <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s d’évaluation, a été investi sur un mo<strong>de</strong> très<br />
actif après l’expertise collective sur l’évaluation <strong>de</strong>s psychothérapies, en mettant<br />
en ligne une documentation scientifique sur le domaine (http://www.techniques-psychotherapiques.org/),<br />
et en travaillant sur le développement <strong>de</strong> recherches<br />
en conditions naturelles selon une méthodologie <strong>de</strong> cas isolés<br />
systématisés.<br />
L’EPS vient d’être agréée (Organisme agréé EPP) par la Haute Autorité <strong>de</strong><br />
santé pour son programme « Initier une psychothérapie, en suivre l’évolution, en<br />
évaluer les résultats ». Deux autres cycles commenceront en mars prochain.<br />
Leur finalité est <strong>de</strong> proposer aux praticiens un cadre méthodologique qui<br />
leur permette <strong>de</strong> formaliser, en groupes <strong>de</strong> pairs, les principales questions qui<br />
se posent dans leur pratique, à commencer par celles <strong>de</strong>s bases diagnostiques<br />
et <strong>de</strong>s critères à partir <strong>de</strong>squels se pose une indication <strong>de</strong> psychothérapie<br />
(questions incluses dans le référentiel d’autoévaluation <strong>de</strong> la HAS portant sur<br />
le dossier patient en pratique ambulatoire). ■<br />
P.C.<br />
*L’Ecole <strong>de</strong> Psychosomatique (chez le Dr JM THURIN - 9, rue Brantôme - 75003 Paris).<br />
à son ami violoniste Joseph Joachim.<br />
Ce <strong>de</strong>rnier refusa <strong>de</strong> le créer car il ne<br />
possè<strong>de</strong> pas <strong>de</strong> Final (point important<br />
pour les solistes où ils peuvent exceller…),<br />
mais il est surtout jugé injouable<br />
et « nuisible par ses imperfections ». La<br />
partition, retravaillée par plusieurs compositeurs<br />
dont Paul Hin<strong>de</strong>mith, dut<br />
attendre novembre 1937 pour être<br />
créée (soit 84 ans plus tard !) à Berlin<br />
par Georg Kulenkampf (et non Yehudi<br />
Menuhin comme initialement<br />
prévu…).<br />
L.F. : Schumann débute l’écriture du<br />
Dichtergarten (le jardin <strong>de</strong>s poètes),<br />
une anthologie <strong>de</strong>s écrits <strong>de</strong> poètes sur<br />
la musique, qui ne verra jamais le jour.<br />
Le 6 février 1854, il écrit à son ami le<br />
violoniste Joachim : « la nuit tombe<br />
déjà », et puis il lui adresse aussi un<br />
courrier énigmatique dans lequel il<br />
explique que <strong>de</strong>ux écritures sont<br />
mêlées l’une à l’encre sympathique qui<br />
va disparaître et l’autre secrète qui apparaîtra<br />
plus tard. Son comportement<br />
étrange déroute ses proches. Il <strong>de</strong>vient<br />
insomniaque. Les hallucinations se font<br />
plus précises, ne se résumant plus à la<br />
simple note La. Clara décrit qu’elles<br />
sont pour lui comme une musique<br />
céleste aux résonances merveilleuses,<br />
puis qu’elles <strong>de</strong>viennent affreuses et<br />
diaboliques, « les démons lui affirmaient<br />
qu’il serait damné et qu’ils venaient le<br />
chercher pour l’entraîner en enfer, puis ce<br />
sont <strong>de</strong>s tigres, <strong>de</strong>s hyènes ». Elle décrit<br />
aussi <strong>de</strong>s hallucinations visuelles le 13<br />
février : « les yeux ouverts, fixés vers le<br />
ciel ; il croyait fermement que <strong>de</strong>s anges<br />
planaient autour <strong>de</strong> lui et lui apportaient<br />
<strong>de</strong> célestes inspirations ». Schumann dit<br />
qu’il ne doit « pas cesser <strong>de</strong> lire la bible ».<br />
Il <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à Clara <strong>de</strong> le quitter <strong>de</strong><br />
peur <strong>de</strong> lui fasse du mal. Les thèmes<br />
délirants mystiques, <strong>de</strong> damnation et<br />
<strong>de</strong> culpabilité (il s’accuse à nouveau <strong>de</strong><br />
crimes dont celui d’avoir tué sa mère),<br />
s’enrichissent d’éléments du syndrome<br />
d’influence : il se plaint que l’on fouille<br />
son cerveau, qu’on le transperce. Dans<br />
une accalmie le dimanche 26 février<br />
il déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r son internement<br />
: « il ne se sent plus du tout maître<br />
<strong>de</strong> ses esprits » ; il est seulement renvoyé<br />
chez lui avec un gar<strong>de</strong> mala<strong>de</strong>.<br />
Le len<strong>de</strong>main au lever, fameux 27<br />
février, il annonce à Clara qu’il n’est<br />
pas digne <strong>de</strong> son amour, tente <strong>de</strong> travailler<br />
et finalement sort en robe <strong>de</strong><br />
chambre, pieds nus, enjambe un pont<br />
et se précipite dans le Rhin glacé après<br />
y avoir jeté son alliance. Repêché par<br />
<strong>de</strong>s mariniers, il est ramené à son domicile,<br />
parmi la foule <strong>de</strong>s masques prêts<br />
pour le Carnaval du soir (c’est Mardi<br />
gras). Il est conduit cinq jours plus tard<br />
à la clinique privée du Dr Richarz à<br />
En<strong>de</strong>nich près <strong>de</strong> Bonn, où il restera<br />
28 mois.<br />
M.K. : Chants <strong>de</strong> l’aube, Opus 133<br />
(1853, Piano)<br />
Schumann avoue : « Une étrange rougeur<br />
s’élève dans le ciel. Je ne sais si c’est<br />
l’aube ou le couchant ». Ces cinq pièces<br />
qui manquent peut-être d’énergie ou<br />
<strong>de</strong> souffle, sont, selon Schnei<strong>de</strong>r, « <strong>de</strong>s<br />
chants <strong>de</strong> la nostalgie du chant ». Le<br />
contrepoint y est remarquable, avec<br />
<strong>de</strong>s dissonances imprévues et <strong>de</strong>s<br />
contretemps. Le quatrième mouvement<br />
nous touche par son flux <strong>de</strong><br />
notes continuel d’où finit par se dégager<br />
un thème évanescent.<br />
Thème et 5 variations en Mi b majeur –<br />
Variation <strong>de</strong>s Esprits, A 24 (février<br />
1854, Piano)<br />
Cette œuvre, témoin <strong>de</strong> ses obsessions<br />
et <strong>de</strong> ses hallucinations sonores,<br />
contient un chant céleste écrit « sous<br />
la dictée <strong>de</strong>s anges ». Schumann écrit<br />
le thème en Mi b majeur, puis les variations<br />
la nuit du 27 février, après sa<br />
chute dans le Rhin. Petit à petit, ce<br />
chant céleste <strong>de</strong>vient <strong>de</strong>structeur avec<br />
<strong>de</strong>s tonalités démoniaques…<br />
Cette œuvre, qui est la <strong>de</strong>rnière censée<br />
<strong>de</strong> Schumann, est assez scolaire, sans<br />
magie particulière.<br />
L.F. : Durant son séjour, Schumann<br />
ne recevra aucune visite <strong>de</strong> Clara,<br />
quelques rares lettres. Elle est pourtant<br />
enceinte d’un garçon qu’il ne connaîtra<br />
pas : Félix, qui naît le 11 juin 1854.<br />
En revanche, il verra <strong>de</strong> nombreux<br />
artistes dont les musiciens Grimm, Dietrich,<br />
Wasielewski, la poétesse Bettina<br />
von Armin et surtout Joachim et<br />
Brahms. Son état alterne entre <strong>de</strong>s<br />
moments <strong>de</strong> lucidité et d’autres d’apathie<br />
avec balbutiements. Les mécanismes<br />
et les thèmes du délire s’enrichissent<br />
: ruine, persécution, châtiment<br />
(« les instances divines ont ordonné que<br />
je soit brûlé en enfer : j’ai fait trop <strong>de</strong><br />
mal »), gran<strong>de</strong>ur (il signe ses lettres<br />
« Robert Schumann, membre d’honneur<br />
du ciel »). Il se perd en activités stéréotypées<br />
: classement, inscription <strong>de</strong> séries<br />
<strong>de</strong> chiffres sur ses papiers, son écriture<br />
<strong>de</strong>vient illisible et s’assortit d’inscriptions<br />
mystérieuses et cabalistiques.<br />
Brahms note qu’il ne s’exprime plus<br />
que part « lambeaux <strong>de</strong> mots ». Il se<br />
montre souvent agité et violent envers<br />
le personnel qu’il soupçonne <strong>de</strong> l’empoisonner,<br />
on doit l’attacher à son lit.<br />
Six mois après son arrivée à En<strong>de</strong>nich,<br />
l’état <strong>de</strong> Schumann s’améliore<br />
temporairement, lui permettant <strong>de</strong> se<br />
promener et <strong>de</strong> jouer du piano. Puis il<br />
s’aggrave : le délire repart <strong>de</strong> plus belle,<br />
mêlant fausses reconnaissances et fabulations.<br />
Il se coupe <strong>de</strong> la réalité, ne<br />
reconnaît plus personne. Il tremble,<br />
refuse <strong>de</strong> se lever et <strong>de</strong> s’alimenter ce<br />
qui entraîne une déchéance physique<br />
et une cachexie importante. Il fait un<br />
autodafé <strong>de</strong> manuscrits et <strong>de</strong> lettres <strong>de</strong><br />
Clara en avril 1856.<br />
Le 23 juillet 1856, le Dr Richarz adresse<br />
un télégramme à Clara la priant d’accourir<br />
si elle souhaite revoir son époux<br />
vivant. Clara accourt, Robert la reconnaît<br />
et lui sourit : « il est un mort vivant »<br />
confie-t-elle à ses proches. Il décè<strong>de</strong> le<br />
mardi 29 juillet 1856 à 16 heures et<br />
sera enterré à Bonn 2 jours plus tard.<br />
Clara, seule avec 7 enfants, lui survi-<br />
vra 40 ans encore. Elle continuera plusieurs<br />
années les tournées et aura à<br />
cœur <strong>de</strong> perpétuer la musique <strong>de</strong> son<br />
mari.<br />
Je ne m’étendrai pas dans une longue<br />
discussion diagnostique en ce qui<br />
concerne les troubles présentés par<br />
Robert Schumann.<br />
Les informations qui le concernent ont<br />
été recueillies grâce à l’abondante correspondance<br />
qu’il a tenue avec sa famille,<br />
son épouse et ses amis, ainsi que la<br />
lecture <strong>de</strong> son journal intime, elles ont<br />
donc une forte tonalité subjective. Le<br />
rapport d’hospitalisation du Dr Richarz<br />
dont la <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s symptômes est<br />
imprécise, a disparu jusqu’en 1990, où<br />
une partie a été remise à l’académie<br />
<strong>de</strong>s Arts <strong>de</strong> Berlin par un <strong>de</strong> ses <strong>de</strong>scendants,<br />
le compositeur Aribert Reimann.<br />
Pour <strong>de</strong>s raisons mystérieuses, ce<br />
rapport n’a été accessible qu’à quelques<br />
privilégiés, bien que le patient soit décédé<br />
<strong>de</strong>puis plus <strong>de</strong> 150 ans ! Clara a<br />
sciemment censuré les biographes en<br />
ce qui concerne la santé mentale <strong>de</strong><br />
son époux afin <strong>de</strong> conserver intacte sa<br />
mémoire et son oeuvre. Enfin, la donnée<br />
essentielle qui nous manque, est<br />
celle <strong>de</strong> la relation transférentielle.<br />
Avant la réapparition <strong>de</strong>s carnets du<br />
Dr Richarz, <strong>de</strong> nombreuses hypothèses<br />
ont été émises avec chacune leurs partisans,<br />
évoquons-les ensemble brièvement.<br />
Celle <strong>de</strong> la névrose, dont les argumentations<br />
les plus abouties se font en<br />
faveur d’une personnalité phobo-obsessionnelle.<br />
On retrouve chez Robert Schumann<br />
<strong>de</strong>s traits <strong>de</strong> caractère sadique anal.<br />
Son entêtement et sa ténacité dans sa<br />
lutte pour obtenir la main <strong>de</strong> Clara ; sa<br />
parcimonie dans la gestion <strong>de</strong> son<br />
argent : il consigne tant ses dépenses<br />
que ses projets ; son collectionnisme<br />
à travers sa correspondance classée et<br />
un répertoire <strong>de</strong> celle qu’il envoie, il<br />
tient également <strong>de</strong> nombreux carnets<br />
<strong>de</strong> citations et plusieurs catalogues <strong>de</strong><br />
ses œuvres ; son emploi du temps et<br />
son journal intime sont aussi très rigoureusement<br />
organisés, y sont même<br />
consignées les relations sexuelles du<br />
couple. Son travail musical est très<br />
méthodique avec Clara, même lorsqu’ils<br />
sont jeunes mariés, leur journal à<br />
3 semaines <strong>de</strong> mariage indique qu’ils<br />
travaillent le clavier bien tempéré ; il<br />
a également <strong>de</strong>s doutes et hésitations à<br />
prendre certaines décisions comme son<br />
poste <strong>de</strong> chef d’orchestre ; il souffre<br />
<strong>de</strong> phobies multiples (nosophobies,<br />
acrophobie, phobie d’impulsion) et<br />
d’obsessions phobiques.<br />
Celle du trouble <strong>de</strong> l’humeur : dont<br />
les partisans considèrent les moments<br />
dépressifs <strong>de</strong> Schumann comme <strong>de</strong>s<br />
récurrences mélancoliques avec un ultime<br />
accès délirant le conduisant à En<strong>de</strong>nich<br />
et un unique épiso<strong>de</strong> qualifié d’hypomaniaque<br />
en 1849, du fait <strong>de</strong> la<br />
productivité artistique particulièrement<br />
élevée <strong>de</strong> cette année. Il m’a semblé<br />
que si les variations d’humeur sont souvent<br />
évoquées dans le journal <strong>de</strong> Schumann,<br />
lors <strong>de</strong>s phases qu’il nomme<br />
mélancoliques, c’est plutôt la symptomatologie<br />
anxieuse qui est au premier<br />
plan associée à <strong>de</strong>s préoccupations<br />
métaphysiques ou une sensation <strong>de</strong><br />
vi<strong>de</strong>.<br />
On ne retrouve pas les symptômes<br />
classiques <strong>de</strong>s dépressions endogènes :<br />
pas d’autodévalorisation, <strong>de</strong> péjoration<br />
durable <strong>de</strong> l’avenir, <strong>de</strong> culpabilité ou<br />
d’incurabilité, pas <strong>de</strong> ralentissement,<br />
pas d’anhédonie, d’atteinte du trépied<br />
instinctuel ou <strong>de</strong> tentatives <strong>de</strong> suici<strong>de</strong>.<br />
L’inspiration et la productivité artistique<br />
sont fluctuantes, ce qui semble habituel<br />
chez tout créatif. Il me semble plus<br />
pru<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> parler d’épiso<strong>de</strong>s dépressifs<br />
réactionnels avec angoisse massive,<br />
survenant à la suite à <strong>de</strong> pertes<br />
(<strong>de</strong>uil, déceptions, échecs).<br />
L’hypothèse d’une psychose, <strong>de</strong> la schi-<br />
zophrénie est la plus souvent évoquée,<br />
notamment par Bleuler, <strong>de</strong>vant les<br />
angoisses envahissantes et précoces<br />
avec recours à l’alcool pour les apaiser<br />
; le repli et le caractère introverti<br />
<strong>de</strong> Schumann dès l’adolescence, les<br />
difficultés qu’il éprouve <strong>de</strong> plus en plus<br />
dans les contacts sociaux jusqu’au<br />
mutisme ; les phobies multiples, extensibles<br />
et irrationnelles ; les ruminations<br />
obsessionnelles évoluant vers les idéations<br />
parasitaires annonciatrices <strong>de</strong> l’automatisme<br />
mental ; puis l’éclosion vers<br />
43 ans d’un fléchissement <strong>de</strong>s activités,<br />
d’une apathie, <strong>de</strong> troubles du cours<br />
<strong>de</strong> la pensée, <strong>de</strong> bizarreries comportementales,<br />
<strong>de</strong>s hallucinations et du délire.<br />
Le caractère familial du trouble est<br />
à prendre en considération : schizophrénie<br />
chez sa sœur Emilie et chez<br />
son fils Ludwig, interné dès l’âge <strong>de</strong><br />
20 ans et ce pendant toute sa vie.<br />
Après la réapparition <strong>de</strong>s carnets <strong>de</strong><br />
Richarz, une nouvelle hypothèse a été<br />
proposée.<br />
Celle <strong>de</strong> la paralysie générale, une<br />
démence d’apparition progressive liée<br />
à une syphilis contractée dans sa jeunesse.<br />
Celle-ci n’est contagieuse que<br />
dans ses phases primaires (chancre) et<br />
secondaire (roséole), ce qui expliquerait<br />
que Clara ait été épargnée.<br />
La maladie débute 5 à 10 ans après<br />
l’infection initiale et peut évoluer durant<br />
10 à 30 ans. Les signes <strong>de</strong> début sont<br />
une baisse <strong>de</strong> l’activité intellectuelle<br />
avec perte d’énergie et d’initiative, <strong>de</strong>s<br />
troubles <strong>de</strong> l’attention et <strong>de</strong> l’affectivité,<br />
<strong>de</strong>s céphalées, <strong>de</strong>s douleurs fulgurantes<br />
et <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s d’aphasie. A la<br />
phase d’état, on note un affaiblissement<br />
du jugement, <strong>de</strong>s propos et <strong>de</strong>s<br />
actes illogiques et absur<strong>de</strong>s. La parole et<br />
l’écriture sont difficiles, la mémoire<br />
s’éro<strong>de</strong> laissant place à la fabulation.<br />
L’humeur est instable, le sujet enclin à<br />
<strong>de</strong>s colères brusques et injustifiées.<br />
L’évolution se fait vers le désintérêt et<br />
l’indifférence. Sont retrouvées <strong>de</strong>s hallucinations<br />
et illusions auditives, <strong>de</strong>s<br />
idées délirantes <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>ur et <strong>de</strong> persécution.<br />
Puis ce sont <strong>de</strong>s troubles<br />
moteurs, une maladresse, <strong>de</strong>s tremblements,<br />
<strong>de</strong>s secousses musculaires.<br />
Les automatismes sont préservés, permettant,<br />
par exemple, la pratique d’un<br />
instrument <strong>de</strong> musique. Enfin l’amaigrissement,<br />
l’apathie totale et la mort<br />
surviennent en l’absence <strong>de</strong> traitement.<br />
Mais ce tableau était largement confondu<br />
à cette époque avec les états terminaux<br />
d’autres maladies mentales.<br />
L’autopsie grossière qui a été réalisée<br />
permet d’éliminer à priori une tumeur<br />
cérébrale ou un autre processus expansif,<br />
mais pas <strong>de</strong> confirmer ou d’infirmer<br />
l’hypothèse <strong>de</strong> la neurosyphilis.<br />
Un indice supplémentaire intéressant<br />
en faveur <strong>de</strong> cette hypothèse est une<br />
anisocorie remarquée par un portraitiste<br />
en 53.<br />
L.F. et M.K. : En conclusion, la maladie<br />
présentée par Robert Schumann<br />
semble multifactorielle. Qu’il s’agisse<br />
d’une névrose obsessionnelle avec<br />
moments dépressifs masquant une psychose<br />
<strong>de</strong> révélation tardive ou d’une<br />
lente démence syphilitique, quelle que<br />
soit la nature <strong>de</strong> son atteinte, le créateur<br />
s’est tu lorsqu’elle l’a terrassée.<br />
Nous espérons que ce 4 mains vous<br />
aura plu et vous aura donné envie d’en<br />
savoir plus et <strong>de</strong> réécouter l’œuvre <strong>de</strong><br />
ce grand compositeur qu’est Robert<br />
Schumann. ■<br />
Laurence François*,<br />
M. Marc Kowalczyk**<br />
*Assistante, service du Dr Caroli, C.H. Sainte-<br />
Anne, Paris<br />
**Compositeur et musicologue, http://musikayak.free.fr<br />
Bibliographie<br />
1) FRANÇOIS-SAPPEY B., Robert Schumann,<br />
Fayard, 2000, 1180 p.<br />
2) MECKEL C., Approche clinique et psychopathologique<br />
<strong>de</strong>s troubles mentaux <strong>de</strong><br />
PSYCHOSE ET CRÉATION ■ 13<br />
Robert Schumann, Thèse <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine,<br />
Lyon 1, 1999, 102 p.<br />
3) POUGET R., La maladie <strong>de</strong> Robert Schumann,<br />
Bulletin <strong>de</strong> l’Académie <strong>de</strong>s sciences<br />
et lettres <strong>de</strong> Montpellier, 1998, 29, 1-10.<br />
4) SCHNEIDER M., La tombée du jour,<br />
Seuil, 1989, 121 p.<br />
5) THOMAZEAU E., Robert Schumann,<br />
maladie et scénario tabou, Thèse <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine,<br />
Lille 2, 2002, 103 p.<br />
LIVRES<br />
Biographie <strong>de</strong> l’Inconscient<br />
Salomon Resnik<br />
Préface <strong>de</strong> René Kaës<br />
Dunod, 22 €<br />
Selon René Kaës, proposer une biographie<br />
<strong>de</strong> l’inconscient constitue une<br />
entreprise audacieuse.<br />
Pour Salomon Resnik, il s’agit <strong>de</strong> bien<br />
autre chose que <strong>de</strong> composer une<br />
histoire du concept <strong>de</strong> l’inconscient.<br />
Le chapitre qui donne son titre à l’ouvrage<br />
décrit le cheminement <strong>de</strong> ses<br />
préconceptions à travers<br />
les catégories <strong>de</strong> l’obscur, <strong>de</strong> l’occulte,<br />
du caché, du secret et <strong>de</strong> l’énigmatique.<br />
Ce propos initial est éclairé et<br />
enrichi par <strong>de</strong>ux autres thèmes : l’inconscient<br />
est aussi la biographie <strong>de</strong><br />
l’homme ; il écrit sa vie, et le trajet et<br />
l’expérience <strong>de</strong> la cure la lui fait<br />
connaître. Enfin Salomon Resnik sait<br />
aussi qu’il propose en même temps,<br />
dans ce livre, une véritable autobiographie<br />
<strong>de</strong> son rapport à l’inconscient.<br />
Le lecteur qui se laisse porter<br />
par une pensée suggestive et associative<br />
découvrira que si l’auteur tente<br />
<strong>de</strong> « rendre plus visible » son inconscient,<br />
il invite celui qui le lit à rendre<br />
le sien moins opaque.<br />
Faut-il avoir peur <strong>de</strong> nos<br />
enfants ?<br />
Politiques sécuritaires et<br />
enfance<br />
Sous la direction <strong>de</strong> Gérard<br />
Neyrand*<br />
La Découverte, 6,90 €<br />
En septembre 2005, l’Inserm a publié<br />
un rapport consacré aux « troubles<br />
<strong>de</strong>s conduites chez l’enfant » qui préconise<br />
le « repérage <strong>de</strong>s perturbations<br />
du comportement dès la crèche et l’école<br />
maternelle ». Cette idée d’une détection<br />
dès le berceau <strong>de</strong> la délinquance<br />
future a trouvé un écho dans les procédures<br />
<strong>de</strong> surveillance et <strong>de</strong> contrôle<br />
qui jalonnent désormais les parcours<br />
<strong>de</strong>s enfants. Le soupçon pèse aujourd’hui<br />
sur les coupables supposés<br />
- parents démissionnaires, populations<br />
migrantes ou précaires... - et<br />
parcourt la chaîne <strong>de</strong>s institutions :<br />
école, justice, mé<strong>de</strong>cine, action sociale...<br />
Cet ouvrage revient sur les remous<br />
que ces visées sécuritaires ont<br />
provoqué et propose une analyse critique.<br />
Les principaux domaines en<br />
lien avec l’enfance sont ainsi abordés<br />
par différents spécialistes, qu’ils<br />
soient sociologues, enseignants, praticiens<br />
hospitaliers, pédopsychiatres,<br />
magistrats...<br />
Avec <strong>de</strong>s contributions <strong>de</strong> Michèle Becquemin,<br />
Bernard Defrance, Michel Dugnat, Philippe Pignarre,<br />
Annick Sauvage, Odile Sauvage-Déprez,<br />
Frédéric Jésu, Taïeb Ferradji, Evelyne Sire-Marin.<br />
Pour en finir avec l’alcoolisme<br />
Réalités scientifiques contre<br />
idées reçues<br />
Philippe Batel<br />
La Découverte, 16 €<br />
La compréhension <strong>de</strong>s mécanismes<br />
biologiques, génétiques, physiologiques<br />
et psychologiques impliqués<br />
dans le processus d’alcoolisation s’est<br />
améliorée. L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s rapports <strong>de</strong> la<br />
société avec l’alcool a également permis<br />
<strong>de</strong> fournir <strong>de</strong>s connaissances aujourd’hui<br />
étayées. En s’appuyant sur<br />
la synthèse <strong>de</strong>s données publiées<br />
dans <strong>de</strong>s expertises collectives <strong>de</strong> l’Inserm<br />
et sur son expérience, Philippe<br />
Batel expose en termes accessibles<br />
les principaux progrès et apports <strong>de</strong><br />
la recherche en alcoologie.
14<br />
LIVRES<br />
■ CLINIQUE<br />
De l’irritation et <strong>de</strong> la folie<br />
François-Joseph-Victor Broussais<br />
Introduction <strong>de</strong> Serge Nicolas<br />
L’Harmattan, 45 €<br />
Il s’agit <strong>de</strong> la reproduction fac simile<br />
<strong>de</strong> l’édition originale du livre <strong>de</strong> 1828<br />
qui n’avait jamais été réédité.<br />
C’est en mai 1828 que Broussais a<br />
investi le champ philosophique enpubliant<br />
contre Cousin un traité De<br />
l’irritation et <strong>de</strong> la folie. Il s’agit <strong>de</strong> la<br />
première critique du point <strong>de</strong> vue<br />
« physiologique » <strong>de</strong> la psychologie<br />
éclectique. Une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> l’ouvrage<br />
est consacrée à une critique<br />
<strong>de</strong>s « psychologistes » dont Théodore<br />
Jouffroy était le chef <strong>de</strong> file.<br />
Broussais voit dans le spiritualisme<br />
un obstacle à la science et le caractère<br />
pseudo-expérimental <strong>de</strong> la psychologie<br />
<strong>de</strong> Jouffroy le confirme pleinement.<br />
A travers le concept d’irritation, il combat,<br />
dans la première partie <strong>de</strong> son<br />
ouvrage, la psychologie <strong>de</strong> son temps.<br />
La secon<strong>de</strong> partie traite <strong>de</strong> la folie<br />
considérée selon la doctrine physiologique,<br />
et ralliée au phénomène <strong>de</strong><br />
l’irritation.<br />
La doctrine physiologique <strong>de</strong> Broussais<br />
s’était construite en opposition<br />
à la doctrine médicale idéologique<br />
fondée par Pinel, dominante au cours<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux premières décennies du<br />
XIX e siècle. Broussais refuse toute nosographie<br />
en mé<strong>de</strong>cine mentale<br />
comme ailleurs, annulant ainsi la<br />
spécificité <strong>de</strong> la psychiatrie. Pour lui,<br />
l’irritation est la cause <strong>de</strong> la folie.<br />
Les thèses organicistes <strong>de</strong> Broussais<br />
n’eurent pas <strong>de</strong> succès dans le milieu<br />
psychiatrique où les nouveaux savants<br />
spiritualistes voulaient annexer<br />
la psychiatrie à la philosophie en renouant<br />
avec le vitalisme. La doctrine<br />
physiologique <strong>de</strong> Broussais se construisit<br />
ainsi en opposition à la nouvelle<br />
doctrine médicale éclectique développée<br />
par une génération <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cins<br />
qui voyaient dans les conceptions<br />
philosophiques <strong>de</strong> Victor Cousin<br />
une voie prometteuse.<br />
Repenser le maintien à<br />
domicile<br />
Enjeux - Acteurs - organisation<br />
Bernard Ennuyer<br />
Dunod, 26 €<br />
Le maintien à domicile est l’objectif<br />
prioritaire <strong>de</strong> la « politique <strong>de</strong> la<br />
vieillesse ». pourtant, comme le confirme<br />
un récent rapport <strong>de</strong> la Cour <strong>de</strong>s<br />
comptes, il n’y a jamais eu <strong>de</strong> véritable<br />
mise en place d’une politique<br />
cohérente en France.<br />
Ce livre repense le maintien à domicile<br />
en l’articulant à sa finalité éthique :<br />
quelle place pour les « personnes<br />
âgées », et notamment pour les plus<br />
fragiles, celles qui ont <strong>de</strong>s difficultés<br />
<strong>de</strong> vie quotidienne et cumulent, bien<br />
souvent, santé dégradée, isolement<br />
social et faibles ressources ?<br />
Certaines notions sont interrogées :<br />
le vieillissement et la vieillesse, l’incapacité<br />
et le handicap, le domicile<br />
et le chez soi, l’ai<strong>de</strong> professionnelle<br />
et le soutien familial, la coordination,<br />
l’évaluation, la formation, les politiques<br />
publiques, leur choix et leur financement.<br />
En <strong>de</strong>rnier lieu, le questionnement<br />
sur les limites du maintien<br />
à domicile et sur ses coûts fait apparaître<br />
le déficit actuel <strong>de</strong>s politiques<br />
publiques. On se restreint, <strong>de</strong> jour en<br />
jour, à une technique instrumentale,<br />
à un arsenal <strong>de</strong> dispositifs réglementaires<br />
et <strong>de</strong> procédures normalisées,<br />
au détriment d’une perspective<br />
éthique du maintien <strong>de</strong>s personnes<br />
âgées dans leur cadre <strong>de</strong> vie et dans<br />
leur rôle d’acteur social.<br />
Le trouble schizoaffectif est une affection<br />
fréquente. Il représenterait<br />
entre 10 et 30% <strong>de</strong>s admissions pour<br />
trouble psychotique en milieu psychiatrique<br />
(1).<br />
Ce concept a connu <strong>de</strong> nombreux<br />
changements dans sa définition <strong>de</strong>puis<br />
la première <strong>de</strong>scription par Kasanin en<br />
1933 <strong>de</strong> la « psychose schizoaffective<br />
», entité spécifique par son apparition<br />
brutale, son évolution favorable<br />
et la présence simultanée <strong>de</strong> symptômes<br />
schizophréniques et affectifs (5, 8).<br />
Les troubles schizoaffectifs sont classiquement<br />
considérés comme <strong>de</strong>s<br />
formes intermédiaires entre la schizophrénie<br />
et les troubles bipolaires, tant<br />
sur le plan <strong>de</strong> la symptomatologie que<br />
du pronostic (8).<br />
Cependant, dans les classifications<br />
actuelles (DSM IV, CIM 10), ces <strong>de</strong>rniers<br />
paraissent clairement individualisés<br />
(2, 8). Il s’agit en fait d’une entité clinique<br />
parfaitement décrite en terme<br />
<strong>de</strong> catégorisation, mais toujours controversée<br />
quant à son appartenance au<br />
groupe <strong>de</strong>s schizophrénies ou celui <strong>de</strong>s<br />
troubles bipolaires.<br />
Son statut nosographique se trouve<br />
face à un dilemme : s’agit-il d’un continuum<br />
psychotique entre la schizophrénie<br />
et le trouble bipolaire ou d’une<br />
entité morbi<strong>de</strong> distincte et indépendante<br />
?<br />
Nous tenterons dans ce travail<br />
d’émettre quelques éclaircissements sur<br />
ce sujet à partir d’une étu<strong>de</strong> comparative<br />
<strong>de</strong> patients atteints <strong>de</strong> schizophrénie,<br />
<strong>de</strong> trouble bipolaire et <strong>de</strong> trouble<br />
schizoaffectif.<br />
Méthodologie<br />
Nous avons mené une étu<strong>de</strong> rétrospective,<br />
<strong>de</strong>scriptive et comparative dans<br />
laquelle nous avons inclu les patients<br />
présentant un trouble schizoaffectif <strong>de</strong><br />
type bipolaire, un trouble bipolaire <strong>de</strong><br />
type I ou une schizophrénie indifférenciée<br />
selon les critères du DSM IV,<br />
hospitalisés la première fois entre les<br />
mois <strong>de</strong> janvier 1988 et décembre<br />
2002, suivis pendant au moins 3 ans<br />
dans le service <strong>de</strong> psychiatrie « E » <strong>de</strong><br />
l’hôpital Razi.<br />
Les données ont été recueillies à partir<br />
du dossier médical et ont concerné les<br />
variables sociodémographiques, les<br />
antécé<strong>de</strong>nts familiaux psychiatriques,<br />
la personnalité prémorbi<strong>de</strong>, l’adaptation<br />
prémorbi<strong>de</strong> (par l’estimation <strong>de</strong><br />
l’EGF durant l’année précédant le début<br />
<strong>de</strong> la maladie : EGF1), les caractéristiques<br />
cliniques (l’âge <strong>de</strong> début <strong>de</strong> la<br />
maladie, la présence d’évènement précipitant<br />
dans les 4 semaines précédant<br />
le début <strong>de</strong>s troubles et le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
début <strong>de</strong> la maladie (aigu : < à 4<br />
semaines, subaigu : entre 1 et 6 mois,<br />
insidieux : > à 6 mois), les variables<br />
évolutives (le nombre d’hospitalisation,<br />
la qualité <strong>de</strong>s intervalles entre les hospitalisations,<br />
la qualité <strong>de</strong> l’insertion<br />
professionnelle et l’évaluation globale<br />
du fonctionnement à long terme :<br />
EGF2).<br />
L’échantillon a été réparti en trois<br />
groupes en fonction du diagnostic<br />
porté:<br />
G1 : schizophrénie, G2 : trouble bipolaire,<br />
G3 : trouble schizoaffectif. Nous<br />
avons procédé à la comparaison <strong>de</strong><br />
ces trois groupes en fonctions <strong>de</strong> ces<br />
divers paramètres.<br />
La saisie <strong>de</strong>s données ainsi que l’analyse<br />
statistique <strong>de</strong>scriptive et comparative<br />
ont été effectuées à l’ai<strong>de</strong> du logiciel<br />
SPSS dans sa 10ème version. Le seuil<br />
<strong>de</strong> significativité a été fixé à 5%<br />
(p < 0,05).<br />
Résultats<br />
90 patients ont été colligés et répartis<br />
équitablement sur les trois groupes.<br />
L’analyse <strong>de</strong>s variables sociodémographiques<br />
n’a pas objectivé <strong>de</strong> différences<br />
significatives concernant l’âge moyen, le<br />
sexe, le statut matrimonial et le niveau<br />
socioéconomique entre les trois<br />
groupes. (Voir tableau I)<br />
Concernant les antécé<strong>de</strong>nts familiaux<br />
psychiatriques, les 3 groupes étaient<br />
différents (p=0,001) : les schizophrènes<br />
avaient plus d’antécé<strong>de</strong>nts familiaux<br />
<strong>de</strong> schizophrénie (20%), les bipolaires<br />
avaient quant à eux plus d’antécé<strong>de</strong>nts<br />
familiaux <strong>de</strong> trouble bipolaire (20%),<br />
tandis que les schizoaffectifs avaient<br />
autant d’antécé<strong>de</strong>nts familiaux <strong>de</strong> schizophrénie<br />
que <strong>de</strong> trouble bipolaire<br />
(6,7%).<br />
De plus, ils étaient les seuls à avoir <strong>de</strong>s<br />
antécé<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> trouble schizoaffectif.<br />
(fig1)<br />
Une différence significative a été retrouvée<br />
entre les trois groupes concernant<br />
la personnalité pré-morbi<strong>de</strong>. En effet,<br />
celle <strong>de</strong> type schizoï<strong>de</strong> était plus fréquemment<br />
retrouvée chez les schizophrènes<br />
(46,7%, p=0.0004) ; tandis<br />
que le tempérament hyperthymique<br />
était plus noté chez les bipolaires<br />
(33.3%, p=0.0002).<br />
Les schizoaffectifs se plaçaient dans<br />
une position intermédiaire avec 30%<br />
<strong>de</strong> schizoïdie et 20% d’hyperthymie.<br />
L’évaluation du fonctionnement prémorbi<strong>de</strong><br />
(EGF1) a objectivé une différence<br />
entre les trois groupes (p=0,003).<br />
Les patients schizophrènes avaient<br />
l’EGF le plus bas (60) suivis <strong>de</strong>s schizoaffectifs<br />
(70) puis <strong>de</strong>s bipolaires (80).<br />
Quant aux variables cliniques, l’âge <strong>de</strong><br />
début <strong>de</strong>s troubles était légèrement<br />
plus bas chez les schizophrènes et les<br />
schizo-affectifs que chez les bipolaires,<br />
mais la différence n’était pas significative.<br />
(22,3 ans ; 22,5 ans versus 24<br />
ans, p= 0,196)<br />
Un événement précipitant était retrouvé<br />
chez près <strong>de</strong> la moitié <strong>de</strong>s bipolaires,<br />
du quart <strong>de</strong>s schizoaffectifs mais<br />
seulement chez 6,7% <strong>de</strong>s schizophrènes.<br />
(fig 2)<br />
Enfin, 2/3 <strong>de</strong>s patients bipolaires<br />
avaient un mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> début aigu, ce<br />
même taux était retrouvé chez les<br />
patients schizophrènes qui avaient<br />
débuté leur maladie sous un mo<strong>de</strong> insidieux.<br />
Le groupe <strong>de</strong>s schizoaffectifs occupait<br />
une place intermédiaire tout en étant<br />
plus proche <strong>de</strong>s schizophrènes. (fig 3)<br />
Sur le plan évolutif, les trois groupes<br />
étaient comparables au niveau du<br />
nombre d’hospitalisations, évalué à une<br />
moyenne <strong>de</strong> 1,6.<br />
La qualité <strong>de</strong>s intervalles entre les hospitalisations<br />
était différente dans les<br />
trois groupes (p=0,0004). En effet<br />
83,3% <strong>de</strong>s bipolaires étaient en rémission<br />
entre les hospitalisations, 90% <strong>de</strong>s<br />
schizophrènes présentaient une persistance<br />
<strong>de</strong>s symptômes psychotiques.<br />
Quant aux schizoaffectifs, 20% étaient<br />
en rémission, 46,7% avaient une persistance<br />
<strong>de</strong> symptômes psychotiques<br />
et/ou thymiques et 33 ,3% avaient une<br />
persistance <strong>de</strong> symptômes résiduels<br />
minimes. (fig 4)<br />
Concernant l’insertion professionnelle<br />
à long terme, la gran<strong>de</strong> majorité <strong>de</strong>s<br />
schizophrènes (93,3%) étaient sans profession,<br />
suivis <strong>de</strong>s schizoaffectifs (60%),<br />
puis <strong>de</strong>s bipolaires (23%) (p=0,0006).<br />
Enfin, comparés aux schizophrènes, les<br />
patients schizoaffectifs, avaient un<br />
meilleur fonctionnement à long terme<br />
(EGF2 : 60 versus 40) mais moins<br />
bon que celui <strong>de</strong>s bipolaires (EGF2 :<br />
60 versus 80) (p=0,0002).<br />
Discussion<br />
Notre étu<strong>de</strong> rétrospective expose inéluctablement<br />
à <strong>de</strong>s biais méthodologiques.<br />
Nous nous sommes retrouvés face à<br />
<strong>de</strong>s difficultés inhérentes au fait que<br />
toutes les données étaient recueillies à<br />
partir <strong>de</strong>s dossiers médicaux, parfois<br />
incomplets, d’autres fois manquant <strong>de</strong><br />
précision. Les patients n’ayant pas été<br />
vus, nous n’avons pas eu l’occasion <strong>de</strong><br />
recourir aux échelles qui auraient sûrement<br />
apporté plus d’objectivité. De ce<br />
fait, nous nous sommes plus intéressés<br />
à l’aspect diachronique qu’à l’aspect<br />
synchronique.<br />
Variables socio-démographiques<br />
L’analyse <strong>de</strong>s variables socio-démo-<br />
N°9 - TOME XIX - DÉCEMBRE 2006/JANVIER 2007<br />
Trouble schizoaffectif :<br />
entre schizophrénie et trouble<br />
bipolaire<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
TSA<br />
TB<br />
SC<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
6,7%<br />
graphiques n’a pas montré <strong>de</strong> différence<br />
dans les trois groupes. Ceci permet<br />
<strong>de</strong> limiter les biais causés par ces<br />
facteurs.<br />
La prédominance masculine étant liée<br />
à un biais <strong>de</strong> recrutement (répartition<br />
conforme à la population <strong>de</strong> l’hôpital<br />
Razi), certes retrouvée dans les trois<br />
groupes, était plus nette chez les schizophrènes<br />
et les schizoaffectifs (76,7%,<br />
83,3% versus 70%). Ce résultat a été<br />
Figure 4 : Qualité <strong>de</strong>s intervalles entre les hospitalisations<br />
20%<br />
Figure 1 : Antécé<strong>de</strong>nts familiaux psychiatriques<br />
20%<br />
20%<br />
3,3%<br />
83,3%<br />
0%<br />
6,7%<br />
33,3%<br />
TSA<br />
TB<br />
SC<br />
10%<br />
3,3%<br />
3,3%<br />
Schizophrénie Trouble bipolaire Trouble schizoaffectif<br />
23,3% 23,3%<br />
Figure 3 : Mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> début <strong>de</strong>s troubles<br />
26,7%<br />
46,7%<br />
6%<br />
TSA<br />
TB<br />
SC<br />
0% 0%<br />
Figure 2 : Evénéments précipitants dans les 4 semaines précédant<br />
le début <strong>de</strong>s troubles<br />
6,7<br />
23,3%<br />
0 10 20 30 40 50 60<br />
66,7% 66,7%<br />
TSA<br />
TB<br />
SC<br />
p=0,0001 (S)<br />
10%<br />
50%<br />
6%<br />
Aigu Subaigu Insidieux<br />
p=0,0004 (S)<br />
Rémission Persistance <strong>de</strong>s<br />
symptômes<br />
résiduels minimes<br />
53,3%<br />
90%<br />
Persistance <strong>de</strong><br />
symptômes<br />
psychotiques et/ou<br />
thymiques
N°9 - TOME XIX - DÉCEMBRE 2006/JANVIER 2007<br />
Tableau I : Variables socio-démographiques<br />
rapporté dans l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> Torrey en<br />
99 (6).<br />
Antécé<strong>de</strong>nts familiaux<br />
Dans notre étu<strong>de</strong>, 60% <strong>de</strong>s patients<br />
avaient <strong>de</strong>s antécé<strong>de</strong>nts familiaux psychiatriques<br />
dont la nature n’a pu être<br />
précisée. En effet, ces informations<br />
étaient recueillies auprès <strong>de</strong> l’entourage<br />
<strong>de</strong>s patients souvent <strong>de</strong> faible niveau<br />
d’instruction. Ceci pourrait expliquer<br />
les taux relativement bas d’antécé<strong>de</strong>nts<br />
familiaux par rapport aux données <strong>de</strong><br />
la littérature.<br />
Chez nos patients schizophrènes, la<br />
fréquence d’antécé<strong>de</strong>nts familiaux <strong>de</strong><br />
schizophrénie (20%) rejoint celle <strong>de</strong> la<br />
littérature qui l’estime entre 8 et<br />
30% (11).<br />
Les schizo-affectifs avaient autant d’antécé<strong>de</strong>nts<br />
familiaux <strong>de</strong> schizophrénie<br />
que <strong>de</strong> trouble bipolaire (6,7%), résultat<br />
retrouvé dans une étu<strong>de</strong> tunisienne<br />
précé<strong>de</strong>nte (7) et dans celle menée par<br />
Béguin en 1994 qui a relevé 16% d’antécé<strong>de</strong>nts<br />
familiaux <strong>de</strong> schizophrénie<br />
et 16% <strong>de</strong> trouble <strong>de</strong> l’humeur (3).<br />
Ces patients avaient également, comme<br />
ce qui est rapporté dans la plupart <strong>de</strong>s<br />
étu<strong>de</strong>s (7), plus d’antécé<strong>de</strong>nts familiaux<br />
<strong>de</strong> trouble bipolaire que les schizophrènes,<br />
et plus d’antécé<strong>de</strong>nts familiaux<br />
<strong>de</strong> schizophrénie que les bipolaires,<br />
se trouvant ainsi dans une<br />
position intermédiaire et distincte.<br />
Personnalité et tempérament<br />
Il est classiquement décrit dans la littérature<br />
une forte corrélation entre la<br />
personnalité schizoï<strong>de</strong> et la schizophrénie<br />
d’une part, allant <strong>de</strong> 30 à 48%<br />
selon les étu<strong>de</strong>s (1), et entre le tempérament<br />
hyperthymique et le trouble<br />
bipolaire d’autre part (9). Dans notre<br />
étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s résultats similaires étaient<br />
constatés.<br />
Par ailleurs, la fréquence <strong>de</strong> personnalité<br />
schizoï<strong>de</strong> au sein <strong>de</strong>s schizoaffectifs,<br />
était significativement inférieure<br />
à celle chez les schizophrènes. Bien<br />
que très peu d’étu<strong>de</strong>s aient porté sur ce<br />
sujet, ce résultat est conforté par celui<br />
d’Opjordsmoen en 98 (13). Elle était<br />
également significativement supérieure<br />
à celle chez les bipolaires. Quant au<br />
tempérament hyperthymique, les trois<br />
groupes étaient significativement distincts,<br />
plaçant le trouble schizoaffectif<br />
dans une situation médiane.<br />
Fonctionnement pré morbi<strong>de</strong><br />
Nous avons noté un EGF1 chez les<br />
schizoaffectifs supérieur à celui <strong>de</strong>s schizophrènes<br />
et inférieur à celui <strong>de</strong>s bipolaires.<br />
Les schizoaffectifs auraient, par<br />
conséquent, un fonctionnement pré<br />
morbi<strong>de</strong> intermédiaire.<br />
Nos résultats concor<strong>de</strong>nt avec ceux <strong>de</strong><br />
la littérature et notamment ceux <strong>de</strong><br />
Möller et col en 2000 et Bottlen<strong>de</strong>r et<br />
col en 2002 qui ont comparé schizophrènes<br />
et schizo-affectifs (12).<br />
Paramètres cliniques<br />
L’âge <strong>de</strong> début plus précoce dans la<br />
schizophrénie et le trouble schizo-<br />
Schizoaffectifs Bipolaires Schizophrènes p<br />
n = 30 n =30 n =30<br />
Age moyen (ans) 32.5 29.5 32 0.44<br />
Sexe (%) Masculin<br />
Féminin<br />
Statut matrimonial<br />
à l’admission (%)<br />
83.3<br />
16.7<br />
70<br />
30<br />
76.7<br />
23.3<br />
0.47<br />
Célibataire 80 70 80<br />
Marié<br />
Divorcé<br />
16.7<br />
0<br />
30<br />
0<br />
16.7<br />
0<br />
0.56<br />
Veuf<br />
Niveau socioéconomique<br />
(%)<br />
3.3 0 3.3<br />
Bas 50 36.7 70<br />
Moyen 43.3 56.7 26.7 0.14<br />
Elevé 6.7 6.7 3.3<br />
affectif retrouvé dans notre étu<strong>de</strong> a été<br />
relevé par certains auteurs dont Benabarre<br />
(4, 6).<br />
Par ailleurs, nous avons noté une<br />
moindre fréquence <strong>de</strong> facteurs précipitants<br />
par rapport à ce qui est classiquement<br />
rapporté dans la littérature.<br />
En effet, certains évènements <strong>de</strong> vie<br />
ont pu être sous-estimés par l’entourage.<br />
Nous avons relevé moins d’événements<br />
précipitants et plus <strong>de</strong> début insidieux<br />
chez les schizophrènes, suivis <strong>de</strong>s schizoaffectifs<br />
puis <strong>de</strong>s bipolaires. Il semble<br />
que le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> début insidieux soit<br />
prépondérant dans la schizophrénie (11),<br />
<strong>de</strong> même, il y aurait moins d’évènement<br />
précipitants par rapport aux schizoaffectifs<br />
(13).<br />
Benabarre a rapporté les mêmes<br />
conclusions dans son étu<strong>de</strong> (4).<br />
Paramètres évolutifs<br />
L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s données évolutives a objectivé<br />
une différence entre les trois<br />
groupes :<br />
Comparés aux schizophrènes, les schizoaffectifs<br />
avaient une meilleure insertion<br />
professionnelle, un meilleur fonctionnement<br />
à long terme (EGF2) et<br />
<strong>de</strong>s intervalles entre les hospitalisations<br />
<strong>de</strong> meilleure qualité.<br />
Cependant, leur évolution était moins<br />
bonne que celle <strong>de</strong>s bipolaires.<br />
Harrow et col. dans une étu<strong>de</strong> prospective,<br />
comparant, sur 10 ans, le profil<br />
évolutif <strong>de</strong> ces 3 populations avaient<br />
trouvé un pronostic du trouble schizoaffectif<br />
meilleur que celui <strong>de</strong> la schizophrénie<br />
mais moins favorable que<br />
celui du trouble bipolaire (10).<br />
Cette même équipe, à partir d’une<br />
étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> suivi sur 7 ans avait conclu<br />
que les patients souffrant <strong>de</strong> schizophrénie<br />
présentaient un niveau <strong>de</strong> récupération<br />
symptomatique plus faible<br />
avec <strong>de</strong>s rémissions moins fréquentes et<br />
<strong>de</strong> plus mauvaise qualité ainsi qu’un<br />
fonctionnement social plus altéré (6).<br />
Ces conclusions sont également confortées<br />
par l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> Benabarre et col. (4).<br />
Conclusion<br />
Cette étu<strong>de</strong> nous fait pencher vers une<br />
vision binaire où figurent d’un côté la<br />
schizophrénie, <strong>de</strong> l’autre le trouble<br />
bipolaire, <strong>de</strong>ux maladies distinctes<br />
par leur étiopathogénie, leur évolution,<br />
leur pronostic…<br />
Il apparaît clairement au travers <strong>de</strong><br />
notre travail et sur la base <strong>de</strong> paramètres<br />
épidémiologiques, cliniques<br />
et pronostiques, que le trouble schizoaffectif<br />
se situe dans une position<br />
intermédiaire entre schizophrénie et<br />
trouble bipolaire.<br />
Bien qu’il se montre comme une<br />
entité distincte, il ne s’agit là que<br />
d’une première étape, une ébauche<br />
<strong>de</strong> réponse à un problème complexe.<br />
■<br />
Olfa Dakhlaoui,<br />
Dhouha Becheikh,<br />
Fakhreddine Haffani<br />
Service <strong>de</strong> psychiatrie « E », Hôpital Razi Tunis.<br />
Bibliographie<br />
(1) AZORIN J.M, KALADJIAN A,<br />
FAKARA E, Aspects actuels du trouble<br />
schizoaffectif, l’Encéphale 2005, 31, 359-<br />
65.<br />
(2) American Psychiatric Association,<br />
MINI DSM IV, Critères diagnostiques<br />
(Washington DC, 1994 ), Traduction<br />
française par J.D. Guelfi et al., Masson,<br />
Paris, 1996, 384 pages.<br />
(3) BÉGUIN T, Schizophrénie dysthymique,<br />
Enquête sur l’évolution, Encéphale<br />
1994, 20, 385-92.<br />
(4) BENABARRE A, VIETA E, COLOM<br />
F, MARTINEZ-ARAN A, REINARES M,<br />
GASTO C, Bipolar disor<strong>de</strong>r, schioaffaective<br />
disor<strong>de</strong>r and schizophrenia: Epi<strong>de</strong>miologic,<br />
clinical and prognostic differences,<br />
Eur Psychiatrry 2001, 16, 167-72.<br />
(5) COUSIN F, Des symptômes thymiques<br />
dans les schizophrénies aux<br />
troubles psycho-affectifs, l’Encéphale<br />
1999, Sp IV, 4-7<br />
(6) DEMITV C, THIBAUT F, Schizophrénies<br />
et troubles bipolaires : vers un<br />
continuum ? Interpsy 2004, 29-30.<br />
(7) FERCHIOU A, Trouble schizoaffectif<br />
: problématique nosographique, diagnostique<br />
et pronostique. A propos <strong>de</strong> 50<br />
cas, Thèse <strong>de</strong> doctorat en mé<strong>de</strong>cine,<br />
Tunis 2005.<br />
(8) GOURION D, Les troubles schizoaffectifs<br />
revisités à la lumière <strong>de</strong> l’hypothèse<br />
neurodéveloppementale : continuum ou<br />
dichotomie ?<br />
(9) GUELFI JD, BOYER P, CONSOLI S<br />
et all. <strong>Psychiatrie</strong>. Puf, France 2001,<br />
128p.<br />
(10) HARROW M, GROSSMAN L.S,<br />
HERBENER E.S, DAVIES E.W, Ten-year<br />
outcome: patients with schizoaffective disor<strong>de</strong>rs,<br />
schizophrenia, affective disor<strong>de</strong>rs and<br />
mood-incongruent psychotic symptoms,<br />
British <strong>Journal</strong> of Psychiatry 2000, 177,<br />
421-26.<br />
(11) KAPLAN HI, SADOCK BJ, Synopsis<br />
<strong>de</strong> psychiatrie. Sciences du comportement,<br />
<strong>Psychiatrie</strong> clinique,Masson,<br />
Williams et Wilkins, France, Paris, 1998,<br />
1676p.<br />
(12) MÖLLER HJ , BOTTLENDER R,<br />
WEGNER U, Long-term course of schizophrenic,<br />
affective and schizoaffective<br />
psychosis: focus on negative symptoms<br />
and their impact on global indicators of<br />
outcome, Acta Psychiatr Scand 2000,<br />
102 (suppl 407), 54-7.<br />
(13) OPJORDSMOEN S., Long-term<br />
course and outcome in unipolar affective<br />
and schizoaffective psychosis, Acta Psychiatr<br />
Scand 1989, 79, 317-26.<br />
Les Jeudis <strong>de</strong> l’Infirmerie Psychiatrique<br />
Dans le cadre <strong>de</strong> l’enseignement du Dr Michel Gourevitch<br />
Le Dr Michel Dubec<br />
Expert national agréé par la Cour <strong>de</strong> Cassation, donnera une conférence<br />
sur :<br />
NUREMBERG 1946 :<br />
la contagion d’une idée délirante criminelle<br />
Le Jeudi 22 Février 2007 à 14h<br />
Salle <strong>de</strong> conférences,<br />
rez-<strong>de</strong>-chaussée<br />
Infirmerie Psychiatrique, 3 rue Cabanis, 75014 Paris<br />
Renseignements : 01 53 73 66 07 ou 06<br />
Pour un abord<br />
corporel après un<br />
traumatisme<br />
Ce texte traite <strong>de</strong> la pertinence d’une<br />
approche corporelle dans la prise<br />
en charge immédiate et post-immédiate<br />
d’un traumatisme. Les sujets traumatisés<br />
se trouvent dans un état <strong>de</strong><br />
désorganisation profon<strong>de</strong>. Leurs capacités<br />
cognitives étant perturbées, ils sont<br />
parfois en <strong>de</strong>çà <strong>de</strong> toute capacité <strong>de</strong><br />
verbalisation. L’hypothèse <strong>de</strong> ce travail<br />
est <strong>de</strong> s’appuyer non sur la parole<br />
comme a pu le suggérer la technique<br />
du <strong>de</strong>briefing, mais sur le corps pour<br />
amener le sujet à retrouver un sentiment<br />
<strong>de</strong> sécurité et <strong>de</strong> conscience <strong>de</strong><br />
soi. Pour étayer cette hypothèse, je vais<br />
abor<strong>de</strong>r le traumatisme sous l’angle <strong>de</strong><br />
notions anciennes mais qui gar<strong>de</strong>nt, à<br />
mon sens, un intérêt clinique les<br />
concepts d’enveloppe psychique et<br />
physique. Puis j’évoquerai la technique<br />
quelque peu oubliée du pack comme<br />
abord envisageable dans ce contexte.<br />
Enfin je présenterai <strong>de</strong>ux vignettes cliniques<br />
et terminerai par les interrogations<br />
que soulève cette hypothèse <strong>de</strong><br />
travail.<br />
D’abord, <strong>de</strong> brefs rappels. Le terme<br />
traumatisme dérive du mot grec trauma<br />
qui signifie blessure, on perçoit d’emblée<br />
la notion d’effraction. L’agression<br />
est classiquement violente et inattendue,<br />
cest une véritable rencontre avec<br />
la mort. Cette expérience dépasse toute<br />
possibilité <strong>de</strong> repérage elle est du<br />
domaine <strong>de</strong> l’irreprésentable. Le traumatisme<br />
échappe ainsi à la parole et<br />
à la symbolisation. Le sujet débordé<br />
dans ses capacités d’élaboration se trouve<br />
dans un état <strong>de</strong> sidération.<br />
Barrois définit le trauma comme coupure<br />
<strong>de</strong>s liens avec le mon<strong>de</strong>, rupture<br />
<strong>de</strong> sens, intériorité envahie par l’angoisse<br />
<strong>de</strong> néantisation et bris <strong>de</strong> l’unité<br />
<strong>de</strong> l’individu.<br />
D’autres auteurs considèrent cette<br />
désorganisation comme une défense.<br />
Il y a déréalisation et dépersonnalisation.<br />
Une partie <strong>de</strong> l’expérience n’est<br />
pas intégrée au reste <strong>de</strong> la conscience.<br />
Ferenczi va dans ce sens dans ses<br />
« réflexions sur le traumatisme » et parle<br />
d’une défense d’urgence. L’auto<strong>de</strong>struction<br />
<strong>de</strong> la cohésion psychique est la<br />
seule solution accessible au sujet pour<br />
le délivrer <strong>de</strong> l’angoisse. La désorganisation<br />
psychique est la soupape à la<br />
<strong>de</strong>struction totale.<br />
On peut considérer que le sentiment<br />
<strong>de</strong> conscience <strong>de</strong> soi est ainsi brutalement<br />
et profondément perturbé. Avançons<br />
un peu en nous penchant sur<br />
cette notion. Le sentiment d’existence<br />
peut être grossièrement rapporté à la<br />
présence dun contenu et d’un contenant<br />
psychiques. Le contenu serait la<br />
capacité d’associer ses pensées en une<br />
chaîne ininterrompue et cohérente. Le<br />
contenant serait une instance dont la<br />
fonction est <strong>de</strong> contenir l’excitation<br />
psychique, d’entraver les passages libres<br />
<strong>de</strong>s quantités d’excitation à l’intérieur<br />
du psychisme. D. Anzieu reprend cette<br />
notion avec le moi peau. Celui-ci vise<br />
à envelopper tout l’appareil psychique,<br />
il « remplit une fonction <strong>de</strong> maintenance<br />
du psychisme ». Son instauration « assure<br />
à l’appareil psychique la certitu<strong>de</strong> et la<br />
constance d’un bien être <strong>de</strong> base ». Le moi<br />
peau trouve son étayage sur la peau<br />
réelle. De la même manière qu’à l’origine<br />
toute activité psychique s’étaie sur<br />
une fonction biologique, le moi peau va<br />
se constituer à partir <strong>de</strong>s diverses fonctions<br />
<strong>de</strong> la peau. Anzieu rappelle que la<br />
première qualité <strong>de</strong> la peau est <strong>de</strong> retenir<br />
à l’intérieur le bon, c’est une sorte <strong>de</strong><br />
sac contenant. Elle a aussi pour rôle<br />
<strong>de</strong> délimiter l’intérieur et l’extérieur,<br />
c’est la barrière qui permet <strong>de</strong> se protéger<br />
<strong>de</strong>s agressions extérieures. Enfin,<br />
c’est une surface qui n’est pas hermé-<br />
CLINIQUE ■ 15<br />
tique, elle permet les échanges et la<br />
communication ; bref, la peau contient,<br />
sépare, protège et permet l’échange.<br />
On voit comment elle va servir d’étayage<br />
à la constitution <strong>de</strong> l’enveloppe psychique.<br />
C’est par la relation à la mère et le holding<br />
décrit par Winnicott que cette<br />
enveloppe va pouvoir se développer.<br />
La mère soutient le corps du bébé par<br />
son contact cutané, son regard, Ses<br />
paroles. Selon Bion, les éléments B sont<br />
<strong>de</strong>s éléments non pensables qui ne<br />
peuvent se lier entre eux et que l’enfant<br />
projette dans le psychisme <strong>de</strong> sa mère.<br />
Ces éléments vont être transformés<br />
grâce la capacité <strong>de</strong> rêverie <strong>de</strong> la mère<br />
et <strong>de</strong>venir pensables pour le bébé. La<br />
mère a donc une fonction <strong>de</strong> pareexcitation.<br />
La fonction psychique du<br />
bébé va progressivement se développer<br />
par intériorisation <strong>de</strong> ce holding.<br />
On comprend assez facilement que si<br />
le moi peau est fragile il ne parvient<br />
pas suffisamment à garantir le filtrage,<br />
à contenir et le sentiment <strong>de</strong> sécurité et<br />
<strong>de</strong> cohésion interne s’en trouve alors<br />
altéré. Mon hypothèse est qu’en cas<br />
<strong>de</strong> traumatisme, il y a effraction psychique<br />
et fragilisation du sentiment<br />
d’existence. L’enveloppe psychique est<br />
mise à mal. Il serait alors intéressant<br />
<strong>de</strong> tenter <strong>de</strong> consoli<strong>de</strong>r le sentiment<br />
<strong>de</strong> soi en agissant sur cette enveloppe.<br />
Ce qui m’amène à abor<strong>de</strong>r le <strong>de</strong>rnier<br />
point <strong>de</strong> cette réflexion : le pack. Le<br />
holding dont nous avons parlé a inspiré<br />
la technique <strong>de</strong> l’enveloppement<br />
humi<strong>de</strong> ou pack.<br />
Autrefois assez souvent utilisé, il est<br />
actuellement un peu oublié.<br />
Cette technique est issue <strong>de</strong>s traitements<br />
par l’eau. Depuis les temps<br />
anciens, l’élément liqui<strong>de</strong> est reconnu<br />
comme bienfaisant. Autrefois employée<br />
à visée purificatrice et parfois <strong>de</strong> manière<br />
abusive, elle est utilisée par Magnan<br />
en 1893 pour humidifier <strong>de</strong>s draps qui<br />
viennent recouvrir le corps du patient.<br />
Cette technique est proposée surtout<br />
pour contenir les patients agités. Ce<br />
n’est qu’après la <strong>de</strong>uxième guerre mondiale<br />
et avec Paul Sivadon que l’eau<br />
est utilisée comme un médiateur symbolique.<br />
La technique du pack favorise le sentiment<br />
<strong>de</strong> sécurité, la prise <strong>de</strong> conscience<br />
<strong>de</strong> soi, <strong>de</strong> l’existence corporelle et <strong>de</strong><br />
la relation avec les objets et les personnes.<br />
Le patient est amené à retrouver<br />
du sens à ses émotions et à les verbaliser.<br />
Woodburry en 1966 parle <strong>de</strong><br />
l’enveloppement anaclitique comme<br />
un moyen d’enrayer la crise <strong>de</strong> morcellement<br />
et les troubles chroniques<br />
du schéma corporel chez le psychotique.<br />
L’effet thérapeutique se fon<strong>de</strong><br />
sur la dimension relationnelle <strong>de</strong> la<br />
technique. L’entourage soignant fait<br />
partie intégrante du processus. Il y a<br />
au moins <strong>de</strong>ux personnes, un psychiatre<br />
et un infirmier par exemple. Le<br />
sujet, enveloppé dans les draps humi<strong>de</strong>s<br />
connaît une réactivation <strong>de</strong> l’angoisse et<br />
<strong>de</strong> ses mécanismes <strong>de</strong> défense. Le<br />
corps soignant contient ces projections<br />
par un environnement physique, il soutient<br />
par le regard, touche, masse le<br />
sujet. Il tente aussi <strong>de</strong> restituer les projections<br />
sous forme bonifiée par une<br />
mise en mots <strong>de</strong> leurs propres ressentis.<br />
Il se crée une sorte d’enveloppe à<br />
partir <strong>de</strong> l’action pare-excitante <strong>de</strong>s soignants.<br />
Le sujet vit la sensation d’être.<br />
Puis va se créer un champ intermédiaire<br />
que certains comparent à un<br />
objet transitionnel. C’est un espace <strong>de</strong><br />
paroles, même <strong>de</strong> jeu entre les soignants<br />
et le sujet qui retrouve une capacité<br />
à verbaliser. Cette technique fait<br />
évi<strong>de</strong>mment penser à ce qui peut se
16<br />
■ CLINIQUE<br />
LIVRES ET REVUES<br />
Autismes<br />
Etat <strong>de</strong>s lieux du soin<br />
Sous la direction <strong>de</strong> Graciela C.<br />
Crespin<br />
Cahiers <strong>de</strong> Préaut<br />
L’Harmattan, 13 €<br />
Après les <strong>de</strong>ux premières livraisons,<br />
qui ont abordé la prévention et l’état<br />
actuel <strong>de</strong>s recherches et débats entre<br />
psychanalyse et neurosciences, cette<br />
troisième livraison <strong>de</strong>s Cahiers <strong>de</strong> Préaut<br />
abor<strong>de</strong> la délicate question du soin.<br />
Un premier état <strong>de</strong>s lieux donne la parole<br />
aux différentes approches, autant<br />
<strong>de</strong> la clinique <strong>de</strong> l’autisme que celle<br />
du bébé.<br />
Des praticiens <strong>de</strong> tous bords ont l’occasion<br />
<strong>de</strong> présenter leurs approches,<br />
qu’elles soient d’inspiration psychodynamique<br />
ou cognitivo-comportementale,<br />
et <strong>de</strong> les discuter. Les approches<br />
du soin mère/bébé, qu’il<br />
s’adresse aux difficultés relationnelles<br />
précoces ou aux problèmes <strong>de</strong> prématurité<br />
sont également présentées.<br />
La partie centrale <strong>de</strong> ce Cahier est<br />
consacrée à <strong>de</strong>s observations cliniques.<br />
Les femmes et la science<br />
Gérard Chazal<br />
Ellipses<br />
L’histoire <strong>de</strong>s femmes en science montre<br />
que le fait <strong>de</strong> les tenir à l’écart <strong>de</strong>s<br />
sciences tient à <strong>de</strong>s raisons idéologiques,<br />
religieuses, sociales et politiques.<br />
Lorsque les barrages et les<br />
contraintes imposées par ces raisons<br />
non biologiques cè<strong>de</strong>nt, <strong>de</strong>s femmes<br />
peuvent <strong>de</strong>venir <strong>de</strong>s scientifiques exemplaires.<br />
Certes, cela ne va pas, encore<br />
aujourd’hui, sans difficulté. Si Marie<br />
Curie obtint <strong>de</strong>ux prix Nobel, si elle occupa,<br />
non sans mal, un poste à la Sorbonne,<br />
elle n’est pas entrée à l’Académie<br />
<strong>de</strong>s sciences. Pour voir une<br />
femme dans cette assemblée, il faudra<br />
attendre 1980 avec la mathématicienne<br />
Yvonne Choquet-Bruhat. Aujourd’hui,<br />
il y a seulement trois femmes<br />
sur 130 membres. La National Aca<strong>de</strong>my<br />
of Sciences aux Etats-Unis, avec<br />
33 femmes sur 1329 membres ne fait<br />
guère mieux. Pas mieux la Royal Society<br />
avec 29 femmes sur 909 membres.<br />
Ce livre retrace quelques grands moments<br />
<strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong>s femmes en<br />
science <strong>de</strong> l’Antiquité grecque à nos<br />
jours.<br />
Il se limite à l’occi<strong>de</strong>nt car c’est la science<br />
occi<strong>de</strong>ntale qui a triomphé et s’est imposée<br />
au mon<strong>de</strong> entier aujourd’hui et<br />
c’est par rapport à cette science que<br />
les femmes aujourd’hui peuvent définir<br />
leur place dans le mon<strong>de</strong> encore<br />
très masculin <strong>de</strong> la science.<br />
Les marques du corps<br />
Sous la direction <strong>de</strong> Didier Lauru<br />
et Jean-Jacques Lemaire<br />
Enfances & Psy 2006 n°32<br />
Erès<br />
Ce numéro montre que l’inscription corporelle<br />
chez l’enfant ou l’adolescent<br />
(cicatrices, scarifications, tatouages,<br />
piercing...) revêt <strong>de</strong> nombreux aspects<br />
selon qu’elle est subie ou agie.<br />
Le rôle <strong>de</strong>s cicatrices dans la maladie<br />
<strong>de</strong> l’enfant est abordé au travers <strong>de</strong> la<br />
clinique <strong>de</strong> la maladie chronique <strong>de</strong><br />
l’enfant (Catherine Graindorge), <strong>de</strong>s lésions<br />
corporelles somatiques ou acci<strong>de</strong>ntelles<br />
(MarieThérèse Aeschbacher),<br />
dans le trauma à l’adolescence (Jean-<br />
Yves Le Fourn) ou dans la maladie somatique<br />
et le handicap, visible ou invisible<br />
(Patrick Alvin).<br />
Les coups et blessures sont autant<br />
d’autres traumatismes que l’enfant ou<br />
l’adolescent aura à intégrer dans sa<br />
psyché, et il est important alors <strong>de</strong> ne<br />
pas négliger les divers aspects <strong>de</strong> la<br />
prise en charge médicale et psychologique<br />
(Annie Soussy).<br />
Dans la pratique contemporaine, on<br />
a aussi affaire à <strong>de</strong> nombreuses histoires<br />
<strong>de</strong> scarifications (David Le Bre-<br />
ton) ou, autrement dit, à <strong>de</strong>s violences<br />
cutanées auto-infligées (Xavier Pommereau).<br />
Il peut s’agir symboliquement<br />
d’un sacrifice (Carina Basualdo) ou bien<br />
d’une démarque du regard inscrite<br />
dans la violence du politique comme<br />
du pubertaire (Véronique Bourboulon).<br />
Sur un autre plan, l’inscription corporelle<br />
est également « agie » quand il y<br />
a recours au tatouage et/ou piercing<br />
comme affirmation <strong>de</strong> soi, d’une saga<br />
infantile (Elisabeth Darchis), d’appartenance<br />
à un groupe social, religieux,<br />
ethnique, avec une place spécifique<br />
pour la circoncision (Philippe Scialom).<br />
Mais la marque corporelle peut aussi<br />
tenter <strong>de</strong> relayer une virilité défaillante,<br />
une position <strong>de</strong> lea<strong>de</strong>rship... ou encore<br />
soutenir une écriture symbolique<br />
(Catherine Grognard). Le registre sera<br />
différent selon qu’il relève d’effets <strong>de</strong><br />
mo<strong>de</strong>, <strong>de</strong> séduction, <strong>de</strong> crise i<strong>de</strong>ntitaire<br />
(Bruno Rouers) avec ses formes<br />
d’imitation, d’opposition, <strong>de</strong> provocation<br />
ou <strong>de</strong> défi.<br />
Imaginaire <strong>de</strong> la famille<br />
Imaginaire et inconscient 2006, n°18,<br />
L’Esprit du Temps, 21 €<br />
Une récente journée d’étu<strong>de</strong>s du Groupe<br />
International du Rêve Eveillé en Psychanalyse<br />
a été consacrée à la famille,<br />
pas d’un point <strong>de</strong> vue sociologique ou<br />
éthique, mais du point <strong>de</strong> vue où nous<br />
assistons au travail <strong>de</strong> l’imaginaire.<br />
Ce numéro publie les interventions <strong>de</strong><br />
la Journée d’étu<strong>de</strong>s auxquelles s’ajoutent<br />
<strong>de</strong> nouveaux articles. La mythologie<br />
constitue le socle <strong>de</strong> ce travail.<br />
Aux mythes venus <strong>de</strong> l’Antiquité et à<br />
la réflexion qu’ils suscitent, succè<strong>de</strong>nt<br />
diverses étu<strong>de</strong>s mettant en évi<strong>de</strong>nce<br />
dans nos vies d’aujourd’hui la construction<br />
<strong>de</strong> mythes auxquels nous participons,<br />
la construction du roman familial<br />
avec en écho l’étu<strong>de</strong> du roman<br />
familial, que ce soit chez le romancier<br />
ou dans les contes.<br />
La représentation <strong>de</strong> la maison comme<br />
symbole du vécu familial, est présenté<br />
comme révélateur à la fois d’une réalité<br />
et <strong>de</strong> ce qui s’en imagine.<br />
Quatre analyses <strong>de</strong> livres concernent<br />
certains aspects du vécu familial.<br />
Des « intermè<strong>de</strong>s » sont consitués par<br />
<strong>de</strong>s extraits <strong>de</strong> textes <strong>de</strong> Claudie Obin,<br />
conteuse, qui participe à la Journée<br />
d’étu<strong>de</strong>s et a séduit par sa manière <strong>de</strong><br />
parler <strong>de</strong>s mythes fondateurs <strong>de</strong> la<br />
Grèce antique, mythes dans lesquels<br />
nous assistons à la dramatique <strong>de</strong><br />
l’amour, <strong>de</strong> la haine, <strong>de</strong> la vie et <strong>de</strong> la<br />
mort, qui sillonnent nos vécus familiaux.<br />
Accompagner ou<br />
contraindre ?<br />
Psychotropes 2006 n°2<br />
De Boeck<br />
Comme à l’accoutumée, ce numéro se<br />
compose d’un dossier et <strong>de</strong> quelques<br />
articles hors thématique.<br />
Pour le dossier a été retenu le thème<br />
abordé par l’ASPSTA lors <strong>de</strong> ses journées<br />
nationales qui se sont tenues à<br />
Limoges les 20 et 21 octobre 2005 et<br />
dont le titre était : « Soigner ou punir ».<br />
Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la référence à Michel Foucault,<br />
le titre <strong>de</strong> ce congrès mettait en<br />
exergue le fait que « ce sont d’abord<br />
l’interdit, la répression et la punition qui<br />
ont marqué l’abord contemporain du<br />
phénomène <strong>de</strong> dépendance ou d’addiction<br />
: sous forme d’interdit et <strong>de</strong> pénalisation<br />
<strong>de</strong> l’usage », ainsi que le rappelle<br />
Jean Harbonnier.<br />
La loi <strong>de</strong> 1970, qui considère l’usage<br />
simple comme un délit, incarne cette<br />
tentation <strong>de</strong> l’éradication par l’interdit.<br />
Le législateur pourrait s’inspirer <strong>de</strong><br />
ce « précepte » émis dès le XVIII e siècle<br />
par les disciples <strong>de</strong> Cesare Beccaria :<br />
« Punir pas plus qu’il n’est juste, pas plus<br />
qu’il n’est utile », la punition <strong>de</strong> l’usage<br />
simple apparaissant à la fois injuste et<br />
inutile.<br />
Clau<strong>de</strong> Jacob présente la notion <strong>de</strong><br />
contrat dans son article, où il pose les<br />
questions nécessaires à une telle dé-<br />
<br />
marche : « Comment et pourquoi créer<br />
un espace spécifique, pourquoi le contrat,<br />
et quel contrat rend l’institution habitable,<br />
à quelles conditions, pourquoi et<br />
comment organiser les échanges ». En<br />
résumé, définir un lieu <strong>de</strong> rencontre, un<br />
lieu thérapeutique où « chacun y parle<br />
en son nom ».<br />
Pour éviter ces risques <strong>de</strong> confusion, intervenants<br />
en toxicomanie et représentants<br />
du système judiciaire ont souvent<br />
travaillé ensemble pour respecter<br />
la compétence <strong>de</strong> chacun afin que l’action<br />
<strong>de</strong>s uns ne nuise pas à la mission<br />
<strong>de</strong>s autres.<br />
Le dispositif POSS initié dans le département<br />
<strong>de</strong> la Marne, présenté par Alain<br />
Rigaux, participe <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong> réflexion.<br />
Jean-Pierre Assailly présente un mo<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> lecture <strong>de</strong>s mises en danger <strong>de</strong> soi<br />
chez l’adolescent. Cette conduite est interprétée<br />
comme un modèle socio-<br />
jouer au cours du holding maternel<br />
et fait appel à <strong>de</strong>s vécus et <strong>de</strong>s mouvements<br />
très archaïques.<br />
Revenons, maintenant, au sujet traumatisé<br />
qui est profondément bouleversé,<br />
confronté à <strong>de</strong>s angoisses massives<br />
<strong>de</strong> mort, un vécu impossible à<br />
élaborer et assimiler. Le sujet perd une<br />
certaine conscience <strong>de</strong> soi et est en<br />
incapacité <strong>de</strong> pouvoir verbaliser son<br />
vécu. Son enveloppe psychique est<br />
mise à mal. Il serait intéressant, d’autant<br />
que le sujet témoigne d’une incapacité<br />
à pouvoir bénéficier d’un <strong>de</strong>briefing,<br />
<strong>de</strong> travailler à partir <strong>de</strong> cette<br />
enveloppe fragilisée en cherchant à la<br />
consoli<strong>de</strong>r. En reconstituant une enveloppe<br />
pare-exctitante, le sujet pourra<br />
peut-être retrouver plus facilement un<br />
sentiment <strong>de</strong> cohésion et d’existence.<br />
J’abor<strong>de</strong>rai la question <strong>de</strong> la mise en<br />
pratique après la présentation <strong>de</strong>s<br />
vignettes cliniques.<br />
Cas cliniques<br />
Une femme <strong>de</strong> 35 ans se présente<br />
pour un arrêt <strong>de</strong> travail. Elle est infirmière<br />
et a été, le jour même, victime<br />
d’une agression à l’hôpital. Un patient<br />
s’est jeté sur elle lorsqu’elle a refusé<br />
d’accé<strong>de</strong>r à sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. Il l’a prise par<br />
le cou, l’a jetée à terre et a commencé<br />
à la rouer <strong>de</strong> coups lorsque <strong>de</strong>s collègues<br />
alertés par le bruit sont venus<br />
la secourir. Elle est encore sous le choc.<br />
Elle a pensé mourir. Tout <strong>de</strong> suite après<br />
l’agression, elle a été conduite auprès du<br />
mé<strong>de</strong>cin du travail qui a tenté <strong>de</strong> lui<br />
faire verbaliser ses émotions. Pour l’heure,<br />
elle souhaite simplement avoir son<br />
arrêt <strong>de</strong> travail et retourner auprès <strong>de</strong>s<br />
siens. Elle accepte <strong>de</strong> revenir pour une<br />
réévaluation. C’est lors <strong>de</strong>s consultations<br />
suivantes qu’elle raconte son expérience.<br />
Face au mé<strong>de</strong>cin du travail, elle<br />
se sentait incapable <strong>de</strong> penser, encore<br />
moins <strong>de</strong> verbaliser. Elle trouvait, <strong>de</strong><br />
plus, incongru <strong>de</strong> parler <strong>de</strong> cette expérience<br />
intime à un étranger. Son seul<br />
souhait était <strong>de</strong> retrouver ses proches,<br />
d’être entourée par eux sur un plan<br />
affectif et physique. Elle avait ressenti<br />
clairement le besoin d’être soutenue,<br />
rassurée, blottie dans les bras protecteurs<br />
d’un proche qui lui tiendrait <strong>de</strong>s<br />
propos rassurants.<br />
L’évolution fut rapi<strong>de</strong>ment favorable.<br />
Elle eut quelques cauchemars dont le<br />
contenu retraçait, en partie, le scénario<br />
<strong>de</strong> l’agression. Elle eut pendant<br />
quelques jours <strong>de</strong>s réminiscences <strong>de</strong><br />
l’épiso<strong>de</strong> sous forme <strong>de</strong> flashs lorsqu’elle<br />
croisait un homme au profil <strong>de</strong><br />
l’agresseur. Mais rapi<strong>de</strong>ment ce syndrome<br />
<strong>de</strong> répétition débutant a disparu.<br />
Elle reprit le travail et retrouva un<br />
fonctionnement habituel et satisfaisant.<br />
Je n’ai plus eu, ensuite, <strong>de</strong> ses nouvelles.<br />
La <strong>de</strong>uxième vignette clinique relate<br />
un traumatisme beaucoup plus grave. Il<br />
s’agit d’une femme âgée <strong>de</strong> 39 ans qui<br />
a subi durant son enfance et son adolescence<br />
<strong>de</strong>s viols répétés perpétrés par<br />
son père. Lors <strong>de</strong> sa première consultation,<br />
nous sommes à distance du trau-<br />
séquentiel dans lequel la causalité ne<br />
serait pas linéaire.<br />
Maurice Corcos, dans son texte « La force<br />
et le sens », montre que les conduites à<br />
risques, lorsqu’elles <strong>de</strong>viennent addictives,<br />
ne tiennent pas seulement lieu <strong>de</strong><br />
culpabilité comme dans la majorité <strong>de</strong>s<br />
névroses, « mais d’i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong> compensation<br />
face à un vi<strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificatoire » et<br />
installent « un néo-système <strong>de</strong> régulation<br />
du relationnel avec une source <strong>de</strong> jouissance<br />
perverse (dans la honte qui semble<br />
<strong>de</strong>venir l’excitant esentiel) qui fixe le sujet<br />
à ses objets infantiles ».<br />
Enfin, Marie-Ma<strong>de</strong>leine Jacquet abor<strong>de</strong><br />
le moment clé que représente la fin <strong>de</strong>s<br />
prises en charge ou <strong>de</strong>s psychothérapies,<br />
moment particulièrement intense<br />
réactivant ou réactualisant bien souvent<br />
les problématiques <strong>de</strong> séparation,<br />
<strong>de</strong> prise d’autonomie et <strong>de</strong> reconnaissance<br />
individuelle.<br />
matisme, il n’y a pas <strong>de</strong> symptomatologie<br />
évoquant un PTSD. En revanche,<br />
on retrouve une phobie du toucher et<br />
<strong>de</strong>s troubles d’ordre sexuel. Ces <strong>de</strong>rniers<br />
apparaissent lorsqu’elle rencontre<br />
<strong>de</strong>s hommes pour lesquels elle éprouve<br />
<strong>de</strong>s sentiments. Le toucher <strong>de</strong>vient<br />
impossible et l’acte sexuel insupportable.<br />
Elle a l’impression d’être une<br />
prostituée et se dégoûte. D’autre part,<br />
il existe un fonctionnement <strong>de</strong> clivage,<br />
avec une mise à distance <strong>de</strong> ses<br />
affects et le sentiment <strong>de</strong> ne plus reconnaître<br />
ni habiter son corps. Elle ne ressent<br />
plus rien. Elle tente un travail <strong>de</strong><br />
psychothérapie, mais il est laborieux,<br />
elle se défend... La première relation<br />
thérapeutique, vraie, vécue comme<br />
telle, est la rencontre avec un ostéopathe<br />
; il parle <strong>de</strong> lier le corps à la psyché.<br />
Il lui dit que son corps est un bout<br />
<strong>de</strong> bois mort, que son dos est comme<br />
une grille <strong>de</strong> métro. Puis, débute un<br />
travail avec une psychomotricienne qui<br />
la touche, la masse. Son corps est enfin<br />
pris en compte. La patiente travaille<br />
sur le contours <strong>de</strong> son corps et sa représentation.<br />
Progressivement, elle reconstitue<br />
ou se constitue une enveloppe<br />
physique. C’est à ce moment là que<br />
lors d’un exercice <strong>de</strong> respiration, elle<br />
est prise d’une violente angoisse, association<br />
refoulée d’une effraction ancienne.<br />
Elle parle pour la première fois <strong>de</strong><br />
ses agressions... d’abord dans un langage<br />
très cru puis plus nuancé et avec<br />
davantage <strong>de</strong> contrôle.<br />
Actuellement, elle reconnaît que parmi<br />
toutes les thérapeutiques dont elle a<br />
bénéficié, les plus opérantes pour elle<br />
ont été les traitements corporels ; sans<br />
elles, toute tentative d’élaboration en<br />
psychothérapie serait restée vaine...<br />
Ces exemples soulèvent <strong>de</strong> nombreuses<br />
questions. Il est possible que<br />
le besoin <strong>de</strong> passer à nouveau par le<br />
corps ait été d’autant plus prégnant<br />
qu’il y a eu atteinte physique dans les<br />
<strong>de</strong>ux cas. Y aurait-il eu la même<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> en cas d’absence d’atteinte<br />
corporelle ? On peut supposer que oui,<br />
puisque au-<strong>de</strong>là du traumatisme physique,<br />
c’est aussi d’une effraction psychique<br />
dont il est question.<br />
Une autre inconnue se pose : il semble<br />
que pour le premier cas, l’enveloppe<br />
psychique semblait d’assez bonne qualité<br />
avant d’avoir été mise à mal. Il ne<br />
s’agit que d’une agression ponctuelle<br />
survenant à l’âge adulte. La <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
du sujet était plutôt <strong>de</strong> consoli<strong>de</strong>r une<br />
enveloppe à priori bien constituée.<br />
Pour la <strong>de</strong>uxième femme, la problématique<br />
est différente. Le traumatisme<br />
a eu lieu durant une longue pério<strong>de</strong><br />
où l’enfant puis l’adolescente avait à<br />
se construire. Il est probable que la personnalité<br />
s’est organisée autour du trauma,<br />
et que son sentiment <strong>de</strong> soi s’en est<br />
trouvé fragilisé. Qu’a-t-elle trouvé dans<br />
ces séances <strong>de</strong> psychomotricité ? La<br />
consolidation ou la constitution d’une<br />
enveloppe physique et psychique ?<br />
Il est évi<strong>de</strong>nt que le soignant n’aura<br />
pas <strong>de</strong> réponse à ces questions lorsqu’il<br />
se trouve pour la première fois<br />
N°9 - TOME XIX - DÉCEMBRE 2006/JANVIER 2007<br />
Comprendre l’anxiété pour<br />
mieux la traiter<br />
Sous la coordination <strong>de</strong> Philippe<br />
Nuss<br />
Editions Médicales<br />
Ce recueil témoigne <strong>de</strong> la diversité <strong>de</strong>s<br />
situations cliniques dans lesquelles<br />
l’anxiété s’exprime, rend compte <strong>de</strong> la<br />
complexité <strong>de</strong>s tableaux rencontrés en<br />
pratique quotidienne. Plusieurs cliniciens<br />
illustrent, à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> situations cliniques<br />
qu’ils ont rencontrées, les différents<br />
troubles anxieux. Ils font part <strong>de</strong><br />
démarches cliniques, diagnostiques et<br />
thérapeutiques tout en cheminant avec<br />
l’histoire immédiate du patient.<br />
Cette démarche, avec ses incertitu<strong>de</strong>s,<br />
ses anecdotes, ses paradoxes, fait partager<br />
la démarche intellectuelle <strong>de</strong> leurs<br />
auteurs et témoigne aussi <strong>de</strong> leur expertise.<br />
face à un traumatisé. C’est au cours<br />
du suivi que pourra être évaluée cette<br />
problématique et donc posé le type<br />
d’approche corporelle la mieux adaptée.<br />
Car elle reste aussi à définir : les<br />
bras d’un proche, un enveloppement<br />
dans une couverture, un pack, le tout<br />
en tachant <strong>de</strong> l’intégrer dans la relation<br />
à l’autre comme nous l’avons vu ?<br />
Réaliser, <strong>de</strong> manière systématique, une<br />
prise en charge corporelle est sûrement<br />
aussi inappropriée que d’imposer systématiquement<br />
un <strong>de</strong>briefing. Il est probable<br />
que si cela peut avoir un effet<br />
contenant et restructurant, pour<br />
d’autres cela peut correspondre à une<br />
nouvelle intrusion. Peut-être faut-il seulement<br />
proposer un soutien <strong>de</strong> cet<br />
ordre ; et ce aussi bien au décours<br />
immédiat qu’à distance du traumatisme.<br />
De même que le sujet a parfois besoin<br />
<strong>de</strong> temps pour verbaliser son expérience,<br />
il est peut-être opportun <strong>de</strong> respecter<br />
sa disponibilité physique.<br />
Il faut aussi être pru<strong>de</strong>nt sur le risque<br />
régressif que cette prise en charge<br />
implique. Peut-être cela peut-il se faire<br />
en ne prolongeant pas trop les séances.<br />
Il faudrait aussi veiller à les intégrer<br />
dans la relation à l’autre pour inciter<br />
le sujet à rétablir un contact et un lien<br />
au mon<strong>de</strong> extérieur. En réalité, avant<br />
<strong>de</strong> craindre d’accentuer un éventuel<br />
retrait défensif, il me semble surtout<br />
important <strong>de</strong> savoir reconnaître et<br />
accueillir cet état inhérent au traumatisme<br />
pour l’accompagner et permettre<br />
une mobilisation.<br />
Qui pourra réaliser cette approche ?<br />
La patiente du premier cas clinique a<br />
témoigné <strong>de</strong> son besoin d’être entourée<br />
<strong>de</strong>s siens.<br />
Est-ce imaginable <strong>de</strong> proposer et d’organiser<br />
un accompagnement par un<br />
proche ? Proche qu’il faudra aussi savoir<br />
accompagner... Quel type d’enveloppe<br />
ce proche pourra-t-il alors réaliser ?<br />
Probablement en fonction <strong>de</strong> ce qu’il<br />
est, <strong>de</strong> sa propre capacité à pouvoir<br />
contenir ... Encore beaucoup d’inconnues<br />
et <strong>de</strong> variables incertaines ... il<br />
s’agit en effet d’un facteur essentiellement<br />
humain. Mais ne sous-estimonsnous<br />
pas la force <strong>de</strong> ce soutien ?<br />
S’il ne s’agit pas <strong>de</strong> proches, on imagine<br />
difficilement le psychiatre spécialiste<br />
<strong>de</strong> l’urgence, assurer seul ce type <strong>de</strong><br />
prise en charge. Les infirmiers et les<br />
psychométriciens y auraient probablement<br />
toute leur place.<br />
Je terminerai sur cette réflexion : finalement,<br />
je n’ai soulevé qu’une hypothèse<br />
bien banale. Une main sur l’épaule<br />
est pour certains le geste le plus<br />
naturel du mon<strong>de</strong> lorsque l’on a à soutenir<br />
quelqu’un. Il est vrai que ce geste,<br />
le contact en général, est soumis aussi<br />
pour <strong>de</strong>s raisons culturelles à <strong>de</strong>s résistances<br />
multiples. Peut-être faudrait-il<br />
travailler pour revenir à <strong>de</strong>s actes naturels,<br />
archaïques pour faire face à <strong>de</strong>s<br />
choses qui relèvent du même ordre...■<br />
Dr E. Botvinik<br />
Service Dr G. Vidon, Hôpital Esquirol
N°9 - TOME XIX - DÉCEMBRE 2006/JANVIER 2007<br />
CHUT !<br />
Une petite histoire <strong>de</strong> la sectorisation psychiatrique à Lille (1966-2006)<br />
C<br />
’est en 1966 qu’a été créé à Saint-<br />
André-Lez-Lille le Centre Hospitalier<br />
Ulysse Trélat (CHUT), <strong>de</strong>venu au<br />
fil du temps Centre <strong>de</strong> Soins et d’Hygiène<br />
Mentale Ulysse Trélat (CSH-<br />
MUT), Centre Hospitalier Spécialisé<br />
Ulysse Trélat (CHSUT) et site Ulysse<br />
Trélat <strong>de</strong> l’Etablissement Public <strong>de</strong><br />
Santé Mentale <strong>de</strong> l’Agglomération <strong>de</strong><br />
Lille (EPSMAL)... Il a pris la suite <strong>de</strong><br />
l’hôpital-hospice suburbain (1945-<br />
1958), lui-même héritier <strong>de</strong> l’hospice<br />
<strong>de</strong>s Incurables (1907-1939). Son appellation<br />
rend hommage aux aspects novateurs<br />
<strong>de</strong> l’œuvre d’un grand aliéniste<br />
du XIXème siècle.<br />
Le Conseil Général du Nord a acquis<br />
l’établissement <strong>de</strong>s hospices civils <strong>de</strong><br />
Lille, dans le but d’expérimenter à Lille<br />
et dans sa banlieue immédiate, la politique<br />
<strong>de</strong> sectorisation psychiatrique,<br />
que la circulaire du 5 mars 1960 vient<br />
d’officialiser. En 1974, le plan départemental<br />
<strong>de</strong> lutte contre les maladies<br />
mentales, l’alcoolisme et les toxicomanies<br />
confie au CHUT la mission <strong>de</strong> <strong>de</strong>sservir<br />
à titre définitif, les trois secteurs <strong>de</strong><br />
Lille (59G22, 59G23 et 59G24) et, à<br />
titre provisoire, les <strong>de</strong>ux secteurs <strong>de</strong><br />
Denain (59G33 et 59G34). Cette mission<br />
a été redéfinie au fur et à mesure<br />
du transfert <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s secteurs<br />
provisoires à Denain, <strong>de</strong> 1982 à 1996,<br />
et au moment <strong>de</strong> la création <strong>de</strong> l’intersecteur<br />
<strong>de</strong> toxicomanie <strong>de</strong> Lille<br />
Métropole (59T01), en 1994. Enfin,<br />
en 1998, le CHUT a été fusionné avec<br />
le Centre Hospitalier <strong>de</strong> Lommelet<br />
(CHL) pour donner naissance à l’Etablissement<br />
Public <strong>de</strong> Santé <strong>de</strong> Saint-<br />
André (EPS).<br />
Les murs<br />
A Saint-André, l’hôpital est construit<br />
dans un parc <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux hectares largement<br />
ouvert sur la ville. Au centre, le<br />
bâtiment principal, sur le plan pavillonnaire,<br />
où l’influence du style 1900 n’est<br />
pas étrangère (Dubuisson 1902-1906).<br />
Il a été mo<strong>de</strong>rnisé dans sa totalité en<br />
1964, et à nouveau, pour partie, en<br />
1987 et 1993-94. A la périphérie s’élèvent<br />
les quatre cliniques, le centre social<br />
et le pavillon <strong>de</strong> l’administration, sobre<br />
reflet <strong>de</strong> l’architecture hospitalière <strong>de</strong>s<br />
Trente-Glorieuses (Delrue 1970-1971<br />
et 1981).<br />
Sur les secteurs, à Lille comme à<br />
Denain, le patrimoine immobilier n’a<br />
pas le caractère pérenne et parfois<br />
monumental <strong>de</strong> l’hôpital. Consultations<br />
médico-psychologiques et accueils thérapeutiques<br />
vont d’un lieu à l’autre, et<br />
les mètres-carrés, loués ou mis à disposition<br />
par les collectivités, ont beaucoup<br />
augmenté.<br />
Le 174 rue <strong>de</strong> Wazemmes à Lille fait<br />
exception : cet hôtel particulier, datant<br />
<strong>de</strong> la fin du siècle <strong>de</strong>rnier, sis sur la<br />
seule artère partagée entre les trois secteurs<br />
lillois - tout un symbole - et acquis<br />
par le CHUT, associe désormais le<br />
Centre <strong>de</strong> Jour <strong>de</strong>s Quatre-Chemins<br />
(1983) et le Centre d’Accueil Permanent<br />
Ilôt-Psy (1992), tous <strong>de</strong>ux intersectoriels.<br />
A Denain, les dispensaires<br />
<strong>de</strong> la place Baudin, maisons bourgeoises<br />
du début du siècle construites en enfila<strong>de</strong>,<br />
<strong>de</strong>viennent la référence majeure<br />
à côté <strong>de</strong>s antennes <strong>de</strong> Bouchain, Douchy,<br />
Escaudain, Wallers...<br />
A proximité <strong>de</strong> l’hôpital, l’Institut <strong>de</strong><br />
Formation en Soins Infirmiers occupe<br />
un bâtiment construit en 1981. Il<br />
regroupe une école base (1966) et une<br />
école cadre (1984), et porte le nom<br />
<strong>de</strong> Georges Daumezon, en souvenir<br />
<strong>de</strong> ce pionnier <strong>de</strong> la sectorisation psychiatrique.<br />
Les hommes<br />
Le mérite revient aux mé<strong>de</strong>cins directeurs,<br />
les docteurs M. Champion et H.<br />
Nicaise d’initier la politique <strong>de</strong> secteur<br />
et aux directeurs Messieurs J.L. Lesieur,<br />
J.J. Montagne, Madame 0. Didier, Messieurs<br />
E. Svahn, J.M. Toulouse, J.C. Bué<br />
<strong>de</strong> l’appliquer. Et il ne faut pas sousestimer<br />
le rôle tenu par Madame A.<br />
Dams, cadre administratif, laquelle se<br />
voit souvent confier l’intérim <strong>de</strong> direction.<br />
De leur côté, les prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong><br />
Commission Médicale, les Docteurs J.<br />
Boulin, J.P. Provoost, M.H. Leborgne,<br />
M. Cabal, J. Bie<strong>de</strong>r, J. Debiève, assurent<br />
pleinement leurs responsabilités.<br />
Cette politique est régulièrement<br />
approuvée par le Conseil d’Adminis-<br />
SÉMINAIRE DU JEUDI<br />
Rencontres cliniques<br />
Hôpital Esquirol - Secteur 75G1O/11 (Porte 19) - 10h3O<br />
ASSOCIATION E.C.A.R.T. Psy<br />
Enseignement.Création.Analyse.Recherche.Transmission<br />
2007<br />
Thème : Impossible - mais quand même !<br />
« Il y a trois métiers impossibles - Eduquer, Soigner, Gouverner »<br />
Sigmund Freud<br />
18 janvier 2007 : Amaro <strong>de</strong> Villanova, Psychanalyste à la Société <strong>de</strong> Psychanalyse<br />
Freudienne et Psychanalyste à la Clinique <strong>de</strong> La Bor<strong>de</strong>. Interviendra sur le<br />
thème : De l’impossible répit, dans le travail avec un patient schizophrène.<br />
15 février 2007 : Jean-Clau<strong>de</strong> Aguerre, Psychanalyste, Directeur <strong>de</strong> publication<br />
aux Editions Erès. Interviendra sur le thème : Je dis toujours la vérité, mais<br />
pas toute.<br />
8 mars 2007 : Anne-Marie Picard, Professeur à l’Université américaine, auteur<br />
d’une thèse <strong>de</strong> doctorat « Le Corps lisant : Lecture, psychanalyse et différence<br />
sexuelle ». Interviendra sur le thème : L’écriture matrici<strong>de</strong>.<br />
26 avril 2007 : Patrice Cannone, Psychologue service d’oncologie CHU La<br />
Timone à Marseille. Interviendra sur le thème : La clinique <strong>de</strong> l’impossible.<br />
10 mai 2007 : Florence Reznik, Psychologue-Psychanalyste. Interviendra sur le<br />
thème : D’impossible - mais quand même ! à Quand même, l’impossible.<br />
Journée <strong>de</strong> l’association E.C.A.R.T. Psy à l’hôpital Esquirol sur inscription<br />
8 juin 2007 - Impossible - mais quand même !<br />
Florence Reznik : Fondatrice <strong>de</strong> l’Association ECART Psy et Responsable du séminaire.<br />
Le programme <strong>de</strong>s séminaires est disponible sur le site www.ecart-psy.org<br />
tration du CHUT, qui est présidé successivement<br />
par Messieurs M.<br />
Deplanck, G. Merheim, A. Valette, J.C.<br />
Dubus. Doit être mentionnée ici l’ai<strong>de</strong><br />
apportée, dans le cadre <strong>de</strong> la resocialisation,<br />
par l’Association Ulysse Trélat,<br />
l’Association <strong>de</strong> santé mentale du<br />
Valenciennois, l’Association <strong>de</strong> santé<br />
mentale <strong>de</strong> Lille et l’Association Germinal,<br />
toutes fédérées à la Croix-Marine.<br />
Les effectifs du personnel du CHUT<br />
évoluent favorablement au fil <strong>de</strong>s ans,<br />
même si l’on note un fléchissement<br />
quantitatif, à périmètre comparable, à<br />
partir <strong>de</strong>s années 1980, et un changement<br />
qualitatif à partir <strong>de</strong>s années<br />
1990.<br />
A l’origine, l’hôpital est correctement<br />
doté. Il bénéficie par la suite <strong>de</strong> l’expansion<br />
économique <strong>de</strong>s années 1970.<br />
Mais les effectifs soignants sont réduits<br />
au début <strong>de</strong>s années 1980 par le glissement<br />
<strong>de</strong> postes infirmiers et <strong>de</strong> surveillants<br />
au profit <strong>de</strong> l’école Daumezon,<br />
puis en 1994 par la transformation<br />
<strong>de</strong> postes infirmiers en postes d’ai<strong>de</strong>-soignants.<br />
Sur le plan qualitatif, lors <strong>de</strong> l’ouverture,<br />
le choix d’une équipe pluridisciplinaire<br />
est fait : mé<strong>de</strong>cins spécialistes,<br />
infirmiers, assistants sociaux, psychologues,<br />
psychomotriciens, que viennent<br />
ai<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s vacataires très spécialisés, tels<br />
les psychanalystes. Il est remis en cause<br />
dans les années 1990 avec l’apparition<br />
d’ergothérapeutes, d’ai<strong>de</strong>-soignants,<br />
d’ai<strong>de</strong>s médico-psychologiques... Il est<br />
vrai que les changements <strong>de</strong> statut <strong>de</strong>s<br />
personnels, les contraintes budgétaires,<br />
la réduction du nombre d’intervenants<br />
extérieurs ne permettent plus le maintien<br />
du cadre unique infirmier.<br />
L’administration et le corps médical<br />
vont toujours au <strong>de</strong>vant <strong>de</strong>s revendications<br />
légitimes du personnel soignant,<br />
en particulier <strong>de</strong> celles <strong>de</strong>s infirmiers,<br />
qui souhaitent une amélioration <strong>de</strong> leur<br />
formation et <strong>de</strong> plus gran<strong>de</strong>s responsabilités<br />
dans leur exercice professionnel.<br />
Ils n’ont pas attendu les textes officiels<br />
pour assurer un enseignement <strong>de</strong><br />
qualité, se soucier <strong>de</strong> la formation permanente<br />
et promouvoir les agents ;<br />
quant aux réunions <strong>de</strong> service et <strong>de</strong><br />
pavillons, et aux cahiers d’observation<br />
du mala<strong>de</strong>, ils anticipent dès 1966 les<br />
conseils <strong>de</strong> service et <strong>de</strong> soins infirmiers,<br />
et les dossiers <strong>de</strong> soins infirmiers,<br />
officiels <strong>de</strong>puis la réforme <strong>de</strong> 1993.<br />
Les soins<br />
Au CHUT, l’approche du mala<strong>de</strong> est<br />
médico-psycho-sociale. Les soins sont<br />
intimement liés à la prévention et à la<br />
post-cure, surtout dans les secteurs, et<br />
la vie institutionnelle est analysée dans<br />
chaque pavillon <strong>de</strong> l’hôpital, où la mixité<br />
est <strong>de</strong> règle <strong>de</strong>puis 1968. L’ensemble<br />
<strong>de</strong>s soins dispensés augmente et se<br />
diversifie <strong>de</strong>puis trente ans. Ils connaissent<br />
un fléchissement à l’hôpital et un<br />
développement considérable sur les<br />
secteurs.<br />
A l’hôpital, le nombre <strong>de</strong> lits d’hospitalisation<br />
temps plein passe <strong>de</strong> 367 en<br />
1966 à 249 en 1998. Quatre <strong>de</strong>s cinq<br />
services sont restructurés (Denain-Bouchain<br />
et Denain-Wallers 1987, Lille-<br />
Sud 1992, Lille-Est 1994) et l’intersecteur<br />
<strong>de</strong> toxicomanie existe <strong>de</strong>puis<br />
1994 (10 lits). L’hospitalisation <strong>de</strong> jour<br />
peut se faire soit à Saint-André (20<br />
places aujourd’hui dispersées dans les<br />
différents services lillois), soit à Lille<br />
(25 places <strong>de</strong>puis 1997) ; l’une et<br />
l’autre <strong>de</strong> ces formules ont atteint leur<br />
rythme <strong>de</strong> croisière. L’hospitalisation<br />
<strong>de</strong> nuit, quant à elle, tend à tomber en<br />
désuétu<strong>de</strong> (12 lits). Enfin, <strong>de</strong>s appartements<br />
thérapeutiques et associatifs,<br />
gérés à Saint-André mais situés à Lille<br />
ou dans sa banlieue proche, fonctionnent<br />
<strong>de</strong>puis 1988 (36 places).<br />
<br />
LIVRES ET REVUES<br />
Penser la crise <strong>de</strong> l’école<br />
Revue du M.A.U.S.S. n°28<br />
La Découverte, 30 €<br />
Nous sommes, bel et bien, confrontés<br />
à une crise grave <strong>de</strong> la transmission<br />
<strong>de</strong>s connaissances institutionnellement<br />
légitimes. Pour sortir <strong>de</strong>s<br />
querelles particulièrement féroces en<br />
France sur la question <strong>de</strong> l’Ecole, ce<br />
constat implique d’évaluer la part respective<br />
<strong>de</strong>s facteurs endogènes - spécifiques<br />
au système scolaire - et exogènes<br />
<strong>de</strong> la crise. Le seul fait <strong>de</strong> poser<br />
que la crise scolaire est multi-dimensionnelle<br />
à la fois crise <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s,<br />
<strong>de</strong>s finalités, du sens, <strong>de</strong> l’autorité,<br />
du rapport aux publics et aux<br />
emplois, permet une approche plus<br />
sereine et plus juste <strong>de</strong> la question.<br />
Sans doute faudra-t-il commencer par<br />
s’attaquer à une réforme en profon<strong>de</strong>ur<br />
et radicale <strong>de</strong> l’université, <strong>de</strong><br />
loin le secteur le plus sinistré <strong>de</strong> tout<br />
le système d’enseignement français.<br />
Il n’en a pas été question dans ce numéro<br />
déjà trop volumineux qui serait<br />
<strong>de</strong>venu totalement indigeste et<br />
aussi, raison plus troublante et plus<br />
grave, parce que la littérature un peu<br />
structurée et informée sur l’université<br />
est aussi maigre et rare que les<br />
écrits et libelles sur l’école surabon<strong>de</strong>nt.<br />
Il faudra donc organiser et,<br />
presque, contribuer à faire naître ce<br />
débat si urgent, que tout le mon<strong>de</strong><br />
semble s’évertuer à l’éviter.<br />
Faisant la transition entre la discussion<br />
menée ici sur l’école et le débat<br />
à organiser sur l’université, l’article<br />
<strong>de</strong> Stéphane Beaud montre comment,<br />
dans les premiers cycles universitaires,<br />
ceux qu’il appelle « les enfants<br />
<strong>de</strong> la démocratisation » sont voués à<br />
un <strong>de</strong>stin d’échec massif si prévisible<br />
qu’on ne leur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en fait, que<br />
<strong>de</strong> travailler. Et d’ailleurs, ils travaillent<br />
le plus souvent à côté <strong>de</strong> leurs étu<strong>de</strong>s.<br />
Tout se passe comme si on faisait<br />
semblant <strong>de</strong> leur prodiguer un enseignement<br />
supérieur digne <strong>de</strong> ce<br />
nom et qu’ils faisaient semblant <strong>de</strong><br />
travailler.<br />
Abrégé <strong>de</strong> psychologie<br />
William James<br />
Traduction <strong>de</strong> E. Baudin, G.<br />
Bertier, avec une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Emile Boutroux<br />
Préface <strong>de</strong> Serge Nicolas<br />
L’Harmattan<br />
En 1878, William James (1842-1910)<br />
s’est engagé à écrire un manuel <strong>de</strong><br />
psychologie qu’il comptait terminer<br />
en <strong>de</strong>ux ans. L’ouvrage lui a <strong>de</strong>mandé<br />
dix années <strong>de</strong> plus, et fut tout autre<br />
chose qu’un manuel. La publication<br />
en 1890 <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux volumes <strong>de</strong>s Principes<br />
<strong>de</strong> psychologie marque une date<br />
importante dans la carrière <strong>de</strong> James.<br />
C’était, comme on le fit remarquer<br />
alors, une nouvelle « déclaration d’indépendance<br />
», qui établit la réputation<br />
scientifique <strong>de</strong> son auteur et étendit<br />
son influence. Les proportions <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>ux volumes du livre étaient énormes,<br />
et James entreprit, sur la <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> son éditeur, d’en rédiger un résumé<br />
plus accessible, qui parut aux<br />
Etats-Unis sous le titre <strong>de</strong> Psychology :<br />
Briefer Course en 1892. En composant<br />
cet abrégé <strong>de</strong> psychologie, James<br />
a voulu lui donner la forme d’un livre<br />
à mettre entre les mains <strong>de</strong>s élèves.<br />
Il a ainsi écarté tout ce qui a trait à<br />
l’histoire et à l’examen critique <strong>de</strong>s<br />
doctrines, aux discussions métaphysiques<br />
et, en général, tout ce qui ne<br />
présente qu’un intérêt spéculatif.<br />
Est proposée ici une traduction intégrale,<br />
la seule actuellement disponible,<br />
<strong>de</strong> l’Abrégé <strong>de</strong> psychologie réalisée<br />
par E. Baudin et G. Bertier. Cette<br />
réédition <strong>de</strong> cette traduction est précédée<br />
par un texte <strong>de</strong> James publié<br />
par le philosophe E. Boutroux.<br />
HISTOIRE ■ 17<br />
Gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’éducateur <strong>de</strong><br />
jeunes enfants<br />
2 e édition<br />
Bruno Le Capitaine<br />
Annick Karpowicz<br />
Dunod<br />
Ce gui<strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntifie le métier d’éducateur<br />
<strong>de</strong> jeunes enfants, en décrit le<br />
contour, en précise le savoir-faire en<br />
cinq parties.<br />
Un rappel historique met en valeur<br />
les expressions contemporaines <strong>de</strong><br />
la profession. Une mise en perspective<br />
<strong>de</strong> la situation <strong>de</strong> la profession<br />
est proposée à travers sa formation,<br />
réformée en 2005, et son cadre d’emploi.<br />
Une synthèse à partir <strong>de</strong>s notions<br />
d’accueil et d’accompagnement<br />
éducatif spécifient le positionnement<br />
professionnel avec une approche du<br />
contexte idéologique et institutionnel<br />
<strong>de</strong> la fonction éducative mais<br />
aussi une présentation actualisée du<br />
cadre réglementaire et institutionnel.<br />
Le multi-accueil tend à <strong>de</strong>venir la<br />
norme, en réponse à la diversité et<br />
à l’hétérogénéité <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s<br />
parents, salariés ou indépendants<br />
aux horaires <strong>de</strong> travail <strong>de</strong> plus en<br />
plus atypiques. Dans ce contexte, les<br />
professionnels sont appelés à repenser<br />
leurs pratiques sans rien lâcher<br />
sur l’essentiel.<br />
Les éducateurs <strong>de</strong> jeunes enfants formés<br />
les prochaines années investiront<br />
un domaine en expansion. Le<br />
nombre <strong>de</strong> structures d’accueil <strong>de</strong> la<br />
petite enfance ne cesse d’augmenter,<br />
à l’initiative <strong>de</strong>s collectivités territoriales<br />
comme à celle d’associations<br />
ou <strong>de</strong> sociétés privées, sans<br />
résorber pour autant l’écart entre<br />
l’offre et la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, notamment en<br />
milieu rural.<br />
Cultures et développement<br />
cognitif<br />
Numéro thématique coordonné<br />
par Bertrand Troa<strong>de</strong>c<br />
Enfance 2006 n°2<br />
PUF, 22 €<br />
Le nouveau-né est un individu déjà<br />
équipé pour répondre <strong>de</strong> façon différenciée<br />
à <strong>de</strong> nombreuses stimulations<br />
<strong>de</strong> son environnement. Mieux<br />
même, il est capable <strong>de</strong> faire <strong>de</strong>s<br />
choix, <strong>de</strong> rechercher certaines stimulations<br />
plus que d’autres, <strong>de</strong><br />
« construire » en quelque sorte, ses<br />
interactions. La culture ne serait-elle<br />
plus qu’une affaire individuelle ?<br />
Il n’est que <strong>de</strong> prendre en compte la<br />
diversité <strong>de</strong>s savoir-faire, <strong>de</strong>s expressions<br />
artistiques, <strong>de</strong>s préférences<br />
cognitives selon les pays, pour comprendre<br />
qu’un processus <strong>de</strong> « sculpture<br />
<strong>de</strong> l’esprit » s’interpose entre le<br />
petit en développement et les possibilités<br />
d’expérience que lui offre l’environnement.<br />
De cette sculpture <strong>de</strong> l’esprit, il est<br />
question, tout au long du numéro<br />
thématique coordonné par Bertrand<br />
Troa<strong>de</strong>c, qui montre la relation entre<br />
culture et développement cognitif,<br />
rassemble <strong>de</strong>s grands noms <strong>de</strong> la<br />
psychologie comme Jérôme Bruner<br />
et Patricia Greenfield, et donne à <strong>de</strong><br />
nombreux auteurs reconnus l’occasion<br />
<strong>de</strong> présenter <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s collaboratives<br />
comparant le développement<br />
cognitif dans diverses cultures<br />
rurales et urbaines à la Réunion, en<br />
Côte-d’Ivoire, au Sénégal, en In<strong>de</strong>...<br />
Ce numéro propose un ensemble<br />
d’informations qui <strong>de</strong>vrait ai<strong>de</strong>r à<br />
mieux comprendre l’apport <strong>de</strong> la culture<br />
dans ce qui fait que notre construction<br />
cognitive n’est pas une aventure<br />
solitaire et sans support. Il se termine<br />
par un hommage à Carol Feldman,<br />
spécialiste <strong>de</strong> psychologie culturelle,<br />
qui vient <strong>de</strong> nous quitter.
18<br />
LIVRES<br />
■ HISTOIRE ■ HUMEUR<br />
Adultères<br />
Aldo Naouri<br />
Odile Jacob, 22,90 €<br />
Pédiatre nourri à l’enseignement <strong>de</strong>s<br />
textes bibliques et talmudiques, ainsi<br />
qu’à la psychanalyse (surtout Lacanienne),<br />
Aldo Naouri nous livre ici ses<br />
réflexions à propos <strong>de</strong>s adultères. Au<br />
pluriel parce que les histoires qu’il<br />
rapporte sont nombreuses et variées,<br />
tirées <strong>de</strong> son expérience <strong>de</strong> pédiatre<br />
qui, <strong>de</strong>puis longtemps, s’intéresse<br />
aussi à ce qui fait symptôme chez les<br />
parents, au-<strong>de</strong>là du symptôme <strong>de</strong><br />
l’enfant. Ici donc, les adultères, <strong>de</strong>s<br />
pères ou <strong>de</strong>s mères.<br />
On lui sait gré <strong>de</strong> laisser <strong>de</strong> côté les<br />
raisons apparentes souvent mises en<br />
avant (les différentes formes <strong>de</strong><br />
mésententes ou d’insatisfactions<br />
sexuelles). Mais on sera, sans doute,<br />
un peu déçu <strong>de</strong> l’interprétation assez<br />
univoque qu’il en donne, aussi bien<br />
chez l’homme que chez la femme, et<br />
pour <strong>de</strong>s situations apparemment<br />
très différentes les unes <strong>de</strong>s autres.<br />
Pour lui en effet, dans les <strong>de</strong>ux sexes,<br />
l’ombre <strong>de</strong> la mère est toujours présente.<br />
Chez l’homme, « la rencontre<br />
avec le corps d’une femme, -quel que<br />
soit son rang, met toujours cette femme<br />
en rang <strong>de</strong>ux, le rang un étant à jamais<br />
occupé par sa mère (...). Ce qui<br />
ne signifie pas (...) que l’accès à une<br />
femme ait été totalement interdit par<br />
la plupart <strong>de</strong> ces mères à leur fils. Mais<br />
un tel accès ne <strong>de</strong>vrait en aucun cas<br />
autoriser ces fils à installer durablement<br />
une telle femme dans leur vie ».<br />
Chez la femme adultère, « la <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
apparente s’adresse bien à un homme,<br />
et même à <strong>de</strong>ux, mais elle sert aussi à<br />
se défendre <strong>de</strong> l’homosexualité inscrite<br />
dans l’histoire <strong>de</strong> la petite fille (...). La<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> hétérosexuelle continue à<br />
couvrir la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> homosexuelle<br />
inassouvissable ».<br />
Ce schéma est probablement souvent<br />
un jeu, mais résume-t-il pour autant<br />
toutes les notions inconscientes<br />
qui sous-ten<strong>de</strong>nt telle ou telle conduite<br />
adultère ?<br />
Il n’empêche que ce livre mérite d’être<br />
lu, pour la saveur <strong>de</strong> son écriture et<br />
la variété <strong>de</strong>s situations parfois étonnantes<br />
qu’il décrit.<br />
M. Goutal<br />
Jules Verne et la psyché<br />
Luc-Christophe Guillerm<br />
L’Harmattan, 17 €<br />
L.-Ch. Guillerm étudie la personnalité<br />
et les troubles psychopathologiques<br />
<strong>de</strong> certains personnages <strong>de</strong> Jules<br />
Verne, comme s’ils l’avaient consulté.<br />
Si Jules Verne fut visionnaire sur bien<br />
<strong>de</strong>s thèmes, il est tout à fait étonnant<br />
<strong>de</strong> constater la pertinence <strong>de</strong> ses <strong>de</strong>scriptions<br />
psychopathologiques. Si le<br />
thème <strong>de</strong> la folie dans son œuvre est<br />
régulièrement étudié, Jules Verne décrivit<br />
avec ses personnages bien plus.<br />
Son œuvre est en fait une extraordinaire<br />
galerie <strong>de</strong> portraits psychologiques<br />
et psychopathologiques, <strong>de</strong>s<br />
hommes et femmes les plus valeureux<br />
aux plus perturbés <strong>de</strong>s héros délirants,<br />
en passant par <strong>de</strong>s anxieux,<br />
maniaques, déprimés et névrotiques.<br />
On retrouve par contre assez peu <strong>de</strong><br />
conduites addictives avérées, troubles<br />
où l’individu est dépendant d’une<br />
substance (alcool, toxique) ou d’un<br />
comportement (anorexie, boulimie,<br />
jeu pathologique...).<br />
Jules Verne n’émit pas d’hypothèses<br />
sur l’explication <strong>de</strong>s phénomènes psychologiques,<br />
à une époque il est vrai<br />
où l’on découvre tout juste l’inconscient<br />
au travers <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> Freud<br />
et où la <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s maladies mentales<br />
est purement sémiologique et<br />
médicale.<br />
<br />
Pour Denain, les services hospitaliers<br />
ont été rapi<strong>de</strong>ment individualisés : service<br />
double <strong>de</strong> Denain- Douchy-Trith<br />
(1973), services jumelés <strong>de</strong> Denain-<br />
Bouchain et Denain-Wallers (1977),<br />
hôpital <strong>de</strong> jour Le Duquesnoy à<br />
Denain (1984), service <strong>de</strong>s Quinze lits<br />
à l’hôpital <strong>de</strong> Denain (1987). S’inscrivent<br />
ici un regret et une joie : le grand<br />
regret que le nouvel hôpital <strong>de</strong> la Belle-<br />
Vue, et ses <strong>de</strong>ux services <strong>de</strong> psychiatrie,<br />
ne soient pas sortis <strong>de</strong> terre. La joie<br />
que la totalité <strong>de</strong>s lits et la totalité <strong>de</strong>s<br />
mala<strong>de</strong>s soient enfin transférés du<br />
CHUT vers l’actuel hôpital <strong>de</strong> Denain<br />
dans les prochains mois. Au total, l’équipement<br />
comporte 50 lits d’hospitalisation<br />
temps plein, 20 lits d’hospitalisation<br />
<strong>de</strong> jour, 14 places d’appartements associatifs.<br />
Il faut mentionner que le CHUT<br />
doit faire face, à trois reprises, à <strong>de</strong>s<br />
charges hospitalières exceptionnelles :<br />
transfert <strong>de</strong> mala<strong>de</strong>s venant <strong>de</strong> l’hôpital<br />
psychiatrique d’Armentières, alors<br />
que le taux d’occupation baisse au<br />
point <strong>de</strong> mettre en péril les finances<br />
<strong>de</strong> l’établissement, dans les années<br />
1970 ; internement (!) d’handicapés<br />
profonds originaires du département<br />
du Nord, vivant en Belgique <strong>de</strong>puis<br />
leur plus tendre enfance, qui, <strong>de</strong>venus<br />
adultes, se voient refuser la prolongation<br />
<strong>de</strong> leur séjour à l’étranger, à la fin<br />
<strong>de</strong>s années 1980 ; prise en charge <strong>de</strong>s<br />
« Sans Domicile Fixe » dont le nombre<br />
augmente au fur et à mesure que Lille<br />
prend le visage d’une métropole et que<br />
la crise économique s’aggrave, dans les<br />
années 1990...<br />
L’activité ambulatoire est <strong>de</strong>puis toujours<br />
un <strong>de</strong>s points forts du CHUT et<br />
ceci fait sa réputation ; la réunion <strong>de</strong>s<br />
budgets hospitaliers et sectoriels en<br />
1986 n’a été ici que <strong>de</strong> pure forme.<br />
Consultations et visites à domicile<br />
datent <strong>de</strong> la création <strong>de</strong> l’établissement.<br />
Les interventions dans les hôpitaux<br />
généraux, hospices, maisons <strong>de</strong> retraite<br />
et autres établissements sanitaires et<br />
sociaux sont presque aussi précoces.<br />
Les Centres d’Accueil Thérapeutique à<br />
Temps Partiel naissent officiellement<br />
en 1986. La première maison communautaire<br />
est inaugurée en 1990.<br />
Enfin, le Centre d’Accueil Permanent<br />
<strong>de</strong> Lille ouvre en 1992 (CAP Ilôt-Psy).<br />
L’intersecteur <strong>de</strong> toxicomanie dispose,<br />
lui, <strong>de</strong> 25 places « méthadone » <strong>de</strong>puis<br />
1997. Par ailleurs, <strong>de</strong>puis 25 ans, les<br />
activités <strong>de</strong>naisiennes se développent à<br />
un rythme aussi soutenu qu’à Lille.<br />
Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> ce double constat, fléchissement<br />
<strong>de</strong>s prestations à l’hôpital, développement<br />
sur les secteurs, on précisera<br />
que les responsables du CHUT<br />
optent dès 1970 pour l’intersectorialité<br />
(hôpital <strong>de</strong> jour 1970, départementalisation<br />
du Denaisis 1985, appartements<br />
thérapeutiques 1988, Centre<br />
d’Accueil Thérapeutique a Temps Partiel<br />
1992, les Lilas -unité pour polyhandicapés<br />
1994). Ils ten<strong>de</strong>nt actuellement<br />
à l’élargir (tentative d’extension<br />
du CAP en 1993, intersecteur <strong>de</strong> toxicomanie<br />
1994, réseau Diogène pour<br />
les mala<strong>de</strong>s en situation <strong>de</strong> précarité,<br />
auquel participent également le Centre<br />
Hospitalier Régional Universitaire et<br />
l’Etablissement <strong>de</strong> Santé Mentale Lille<br />
Métropole 1998...). Nul doute que la<br />
fusion avec le Centre Hospitalier <strong>de</strong><br />
Lommelet voisin, également situé à<br />
Saint-André, et qui <strong>de</strong>ssert les quatre<br />
secteurs <strong>de</strong> Roubaix et un <strong>de</strong>mi-secteur<br />
du Pas-<strong>de</strong>-Calais permette <strong>de</strong><br />
confirmer cette pratique mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong> la<br />
psychiatrie. Cette même intersectorialité<br />
se retrouve dans le Denaisis, où<br />
l’individualisation précoce <strong>de</strong>s services<br />
hospitaliers et une parfaite connaissance<br />
du terrain ont permis une<br />
implantation remarquable <strong>de</strong>s équipes,<br />
exceptionnelle pour la région Nord-<br />
Pas-<strong>de</strong>-Calais.<br />
En résumé, évoquer le CHUT, c’est<br />
ressortir un cliché et ouvrir une page<br />
d’histoire.<br />
Le cliché sera emprunté à l’écrivain J.<br />
Berroyer : « Le Centre <strong>de</strong> Soins et d’Hygiène<br />
Mentale, cet hôpital assez coquet<br />
d’apparence, avec une large cour inté-<br />
rieure, <strong>de</strong>s arbres et <strong>de</strong> la pelouse, un<br />
grand bâtiment en U comprenant huit<br />
unités qui abritent chacune une trentaine<br />
<strong>de</strong> personnes ».<br />
Quant à l’histoire, le temps en jugera.<br />
Mais, dès à présent, on peut écrire que<br />
si le CHUT a pâti <strong>de</strong> certaines rigueurs<br />
administratives et contraintes budgétaires,<br />
sa chance a été d’avoir été fondé<br />
par <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins missionnaires <strong>de</strong> la<br />
sectorisation, soutenus par <strong>de</strong>s gestionnaires<br />
compréhensifs et <strong>de</strong>s équipes<br />
ouvertes à tous les courants <strong>de</strong> la psychiatrie.<br />
Post-scriptum<br />
En 2000, le CHUT et le Centre Hospitalier<br />
<strong>de</strong> Lommelet (CHL) <strong>de</strong>viennent<br />
ensemble l’Etablissement Public<br />
<strong>de</strong> Santé Mentale <strong>de</strong> l’Agglomération<br />
Lilloise (EPSMAL). Très vite, les responsables<br />
du nouvel établissement,<br />
Monsieur J. Noël, directeur et le docteur<br />
J.Y. Alexandre, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> CME,<br />
favorisent le pôle roubaisien, avec l’aval<br />
<strong>de</strong> l’Agence Régionale <strong>de</strong> l’Hospitalisation<br />
(ARH) : ouverture en 2006 <strong>de</strong> la<br />
Clinique du Nouveau-Mon<strong>de</strong> et <strong>de</strong><br />
l’hôpital Lucien Bonnafé à Roubaix,<br />
orientation prioritaire <strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s originaires<br />
<strong>de</strong> Roubaix et du Pas-<strong>de</strong>-Calais<br />
« L’ours polaire et la baleine, dit-on, ne<br />
peuvent se faire la guerre, car, étant<br />
chacun confiné dans son propre élément,<br />
ils ne peuvent se rencontrer. Il<br />
m’est tout aussi impossible <strong>de</strong> discuter<br />
avec les chercheurs qui, au domaine<br />
<strong>de</strong> la psychologie ou <strong>de</strong>s névroses,<br />
ne reconnaissent pas les postulats <strong>de</strong> la<br />
psychanalyse et tiennent ses résultats<br />
pour <strong>de</strong>s inventions <strong>de</strong> toutes pièces ».<br />
S. Freud (Extrait <strong>de</strong> l’histoire d’une<br />
névrose infantile, 1914-15)<br />
C’est respectueusement, bien qu’un<br />
tant soit peu amusé, que j’ai lu l’opinion<br />
<strong>de</strong> Monsieur Yves Ferroul parue<br />
dans le journal Le Mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> mardi<br />
19 <strong>de</strong>rnier. Non, les psychanalystes<br />
n’ont pas peur <strong>de</strong> la confrontation<br />
scientifique. Ils se confrontent scientifiquement<br />
<strong>de</strong>puis le premier<br />
congrès <strong>de</strong> psychanalyse à Salzburg<br />
en 1908. Et c’est sans peur, comme<br />
il était <strong>de</strong> ses habitu<strong>de</strong>s, que Freud<br />
était allé parler <strong>de</strong> psychanalyse à la<br />
Clark University en 1909. Le problème<br />
– puisque problème il y a – se<br />
situe donc ailleurs. Les psychanalystes<br />
ne veulent pas être alliés <strong>de</strong>s<br />
gens qui veulent le bien <strong>de</strong>s patients<br />
(Que Dieu nous en gar<strong>de</strong> !). Cela<br />
signifie-t-il qu’ils leur veulent du mal ?<br />
Evi<strong>de</strong>mment non. La psychanalyse<br />
est, à un moment, thérapeutique, au<br />
sens médical du terme. Le psychanalyste<br />
peut tout à fait assurer cette<br />
démarche, il a la formation et la compétence<br />
pour cela. Et c’est justement<br />
cette compétence qui lui a appris à<br />
être modéré et pru<strong>de</strong>nt face à la<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> suppression <strong>de</strong> la souffrance,<br />
ce qui n’est pas en faire peu<br />
<strong>de</strong> cas. Les mala<strong>de</strong>s et les patients<br />
ont le droit <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r la guérison,<br />
mais il est très délicat <strong>de</strong><br />
répondre à cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong> sans<br />
prendre en considération les enjeux<br />
<strong>de</strong> celle-ci. Les psychanalystes ne se<br />
dérobent pas <strong>de</strong> leur responsabilité.<br />
Bien au contraire. Ils travaillent énormément.<br />
Ils sont à leurs consultations<br />
du matin au soir à rencontrer<br />
<strong>de</strong>s mala<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>s patients et <strong>de</strong>s psychanalysants<br />
avec les plaintes, les<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>s, les désirs les plus variés et<br />
féconds. Tout cela exige un tri et<br />
d’être dirigé vers une voie possible <strong>de</strong><br />
vie ; il en est <strong>de</strong> la responsabilité clinique<br />
du psychanalyste. Comment,<br />
lorsqu’on est comportementaliste,<br />
vers le Département <strong>de</strong> PsychoRéhabilitation<br />
(DPR, issu <strong>de</strong> l’unité <strong>de</strong>s<br />
« polyhandicapés » du CHUT et <strong>de</strong>s<br />
travaux du docteur M. Breton), prise<br />
en charge par les seuls secteurs lillois du<br />
CAP, qui <strong>de</strong>ssert toute l’agglomération,<br />
investissements reportés ou annulés<br />
(maison communautaire, CMP du secteur<br />
59G23..).<br />
Au CHUT, en 2002, les secteurs<br />
jumeaux <strong>de</strong> Villeneuve-d’Ascq 59G11<br />
et <strong>de</strong> toxicomanie T02 s’installent dans<br />
les locaux libérés par les secteurs <strong>de</strong>naisiens,<br />
tandis que la clinique Jean-Varlet<br />
<strong>de</strong> Villeneuve d’Ascq, d’une capacité<br />
<strong>de</strong> 24 lits, s’ouvre à tous les mala<strong>de</strong>s<br />
anxio-dépressifs <strong>de</strong> Lille et <strong>de</strong>s environs.<br />
Mais la dangerosité <strong>de</strong>s bâtiments<br />
en peigne <strong>de</strong> la cour d’honneur - par<br />
risque <strong>de</strong> propagation d’incendie -, révélée<br />
par la commission d’accréditation,<br />
oblige à un transfert - en cours - <strong>de</strong><br />
trois <strong>de</strong>s six services à Lommelet, là<br />
où était antérieurement hospitalisé Roubaix.<br />
A l’aube du XXI ème siècle, l’espoir<br />
renaît, à la croisée <strong>de</strong> trois principes<br />
fondamentaux que sont une<br />
intersectorialité élargie (secteurs 59G22,<br />
59G23, 59G24 et 59G11), un adossement<br />
à l’hôpital général et une<br />
implantation <strong>de</strong>s services hospitaliers<br />
à Lille même. Si les volontés politiques<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>r à comparer sa clinique à<br />
celle d’un psychanalyste ? Elles sont<br />
incomparables. Des personnes viennent<br />
à notre consultation <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>s<br />
années. Et, <strong>de</strong>puis, par effet <strong>de</strong> cette<br />
relation singulière avec le psychanalyste,<br />
elles tombent moins mala<strong>de</strong>s organiquement,<br />
ont trouvé un travail, voire<br />
un amour. Surtout, elles ne sont pas<br />
passées à l’acte ultime. Bien sûr, il y a<br />
toujours un quelqu’un qui, alors qu’il<br />
rencontrait un psychanalyste, s’est suicidé.<br />
Et qui, auparavant, avait rencontré<br />
un comportementaliste, et encore<br />
avant était allé consulter son mé<strong>de</strong>cin<br />
traitant et ainsi <strong>de</strong> suite. La faute au<br />
psychanalyste ? Au comportementaliste<br />
? Au généraliste ? Pas forcément. Il<br />
y a <strong>de</strong>s gens qui ne sont pas aptes pour<br />
la vie. Et vouloir leur bien n’est pas la<br />
voie thérapeutique la mieux indiquée.<br />
Reconnaître la présence du désir et<br />
opérer dans ce registre semble être une<br />
voie possible. C’est celle choisie par la<br />
psychanalyse. Elle opère dans un<br />
champ d’une particularité étonnante.<br />
Nous savons que les disciplines scientifiques<br />
– telles la physique ou la biologie<br />
– ont <strong>de</strong>s objets bien définis. Celui<br />
<strong>de</strong> la psychanalyse c’est le désir dont la<br />
particularité est qu’il se représente par<br />
le manque. C’est le manque qui met en<br />
route la dynamique pour que tout un<br />
chacun puisse se lever le matin et<br />
vaquer à ses activités journalières. La vie<br />
a cette dimension <strong>de</strong> répétition,<br />
presque d’ennui. Depuis la nuit <strong>de</strong>s<br />
temps les êtres se sont réfugiés dans<br />
l’aliénation (soit obsédante, soit délirante),<br />
dans la drogue, dans l’alcool.<br />
Face à ces <strong>de</strong>stinées, les psychanalystes<br />
essayent <strong>de</strong> construire, d’inventer, <strong>de</strong><br />
bricoler (dans cet ordre-là), <strong>de</strong>s voies<br />
possibles pour que l’être puisse être<br />
parmi nous. Les psychanalystes n’y parviennent<br />
pas toujours, certes. Et alors,<br />
les comportementalistes eux, y arrivent-ils<br />
toujours ? Les psychanalystes<br />
sont évalués tout le temps, partout, par<br />
leurs patients tout d’abord, puis par<br />
eux-mêmes et leur entourage, par la<br />
société civile enfin et ils s’y prêtent toujours<br />
volontiers. Mais pas n’importe<br />
comment. Qui vient remplir les salles<br />
d’attente <strong>de</strong>s psychanalystes, qui ne<br />
désemplissent pas d’ailleurs ? Ce ne<br />
sont pas <strong>de</strong>s cobayes, ce sont <strong>de</strong>s personnes<br />
qui travaillent et payent leurs<br />
impôts. Depuis ses débuts la psychanalyse<br />
travaille avec <strong>de</strong>s êtres humains.<br />
Comment croire à cette idée qu’on<br />
N°9 - TOME XIX - DÉCEMBRE 2006/JANVIER 2007<br />
soutiennent le projet formulé par les<br />
équipes psychiatriques et si les crédits<br />
le permettent, les prochaines années<br />
verront l’ouverture d’un Centre d’Accueil<br />
et d’Admission <strong>de</strong> 24 lits situé<br />
dans l’enceinte <strong>de</strong> l’hôpital Saint-Vincent<br />
<strong>de</strong> Paul, qui participe au service<br />
public et qui est bâti selon la formule<br />
<strong>de</strong> l’hôpital-rue (C2A, par association<br />
du CAP et <strong>de</strong>s urgences <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier<br />
établissement). L’implantation <strong>de</strong> 120<br />
lits <strong>de</strong> psychiatrie et <strong>de</strong> toxicomanie<br />
en ville, probablement dans le sud-est<br />
<strong>de</strong> Lille, suivra rapi<strong>de</strong>ment (1).<br />
L’avenir ? Le CHUT sera mort, Lommelet<br />
se concentrera sur le médicosocial,<br />
DPR et Maison d’Accueil Spécialisé.<br />
Et, surtout Lille sera à Lille. ■<br />
Michel Cabal<br />
Secteur 59G23, Lille Sud<br />
(1) Concernant la restructuration <strong>de</strong> la psychiatrie<br />
dans la métropole lilloise, différents<br />
scénarios ont été avancés où, chaque fois,<br />
le Centre Hospitalier Régional Universitaire<br />
(C.H.R.U.) joue un rôle important. Ce<br />
qui est présenté ici, pour Lille même, a le<br />
triple avantage <strong>de</strong> respecter l’unité territoriale<br />
<strong>de</strong> la commune, <strong>de</strong> reposer sur un<br />
projet médical ambitieux et cohérent et<br />
d’aller, comme une force tranquille, dans le<br />
sens <strong>de</strong> l’histoire.<br />
■ HUMEUR<br />
Même pas peur !<br />
Réponse à la question<br />
« Les psychanalystes auraient-ils peur <strong>de</strong> la confrontation scientifique ? »<br />
puisse calquer les résultats <strong>de</strong> la lecture<br />
du comportement animal sur<br />
le comportement humain ? Une telle<br />
transposition ne me choque pas<br />
outre mesure car il existe, il est vrai,<br />
<strong>de</strong>s personnes qui ont besoin <strong>de</strong><br />
cette i<strong>de</strong>ntification vétérinaire. Pour<br />
se distinguer du champ <strong>de</strong> la neurologie,<br />
Freud met en évi<strong>de</strong>nce un<br />
appareil psychique où nous pouvons<br />
trouver <strong>de</strong>s instances en conflit entre<br />
elles. Jusqu’à présent, aucune discipline<br />
n’a pu prouver que le surmoi,<br />
le moi et le ça n’existaient pas, pourquoi<br />
alors exiger <strong>de</strong>s psychanalystes<br />
qu’ils abandonnent une théorie qu’ils<br />
vérifient au quotidien ? Les patients<br />
et les psychanalysants apportent<br />
chaque jour dans nos consultations<br />
leurs relations complexes, difficiles,<br />
insupportables avec leur mon<strong>de</strong> psychique.<br />
Leur chance est <strong>de</strong> vivre à un<br />
moment <strong>de</strong> l’humanité où cela est<br />
traité dans un cadre civil, discrètement<br />
et non en étant brûlé pour sorcellerie<br />
ou en moisissant dans <strong>de</strong>s<br />
asiles, comme ce fut le cas pour<br />
Camille Clau<strong>de</strong>l. Les psychanalystes<br />
responsabilisent les êtres et les poussent<br />
à quitter les positions <strong>de</strong><br />
mala<strong>de</strong>s pour <strong>de</strong>venir patients, pour<br />
<strong>de</strong>venir psychanalysants, pour <strong>de</strong>venir<br />
sujets, dans cette logique-là. Les<br />
psychanalystes ne nourrissent pas<br />
chez leur patients ces fantasmes<br />
d’être toujours portés par l’autre<br />
(l’autre familial, l’autre social). Dans<br />
une psychanalyse on paye <strong>de</strong> sa<br />
poche pour ne pas payer avec sa<br />
peau. La science a beaucoup à<br />
apprendre <strong>de</strong> la psychanalyse – psychanalyse,<br />
ici, est l’autre nom <strong>de</strong> l’inconscient<br />
– et les psychanalystes ont<br />
aussi beaucoup à apprendre <strong>de</strong>s<br />
autres sciences. Pour conclure, voici<br />
quelques mots <strong>de</strong> Freud empruntés<br />
au même texte que l’exergue : « Il<br />
me semble par suite incomparablement<br />
plus indiqué <strong>de</strong> combattre <strong>de</strong>s<br />
conceptions divergentes en les expérimentant<br />
sur <strong>de</strong>s cas et <strong>de</strong>s problèmes<br />
particuliers ». Non, décidément, les<br />
psychanalystes n’ont pas peur <strong>de</strong> la<br />
confrontation scientifique ! ■<br />
Fernando <strong>de</strong> Amorim*<br />
* Directeur du service d’écoute téléphonique<br />
d’urgence et <strong>de</strong> la consultation publique <strong>de</strong><br />
psychanalyse du Réseau pour la psychanalyse<br />
à l’hôpital.
N°9 - TOME XIX - DÉCEMBRE 2006/JANVIER 2007<br />
Le Je : Qui suis-je ? Qui est Je ?<br />
Qu’est-ce que Je ?<br />
La raison : La conscience, c’est-à-dire<br />
l’infime portion du soi qui se sait, (ou,<br />
autre définition, le Je qui dit Je), peut<br />
être considérée, dans une première<br />
approximation, comme l’effet <strong>de</strong> l’agencement<br />
du corps et plus particulièrement<br />
du cerveau, (plus précisément,<br />
comme l’effet d’un module <strong>de</strong> gestion<br />
du corps parmi d’autres, remarquable<br />
en ce sens que, d’une part il gère <strong>de</strong>s<br />
données venant d’une gran<strong>de</strong> partie<br />
du cortex cérébral, d’autre part il se<br />
distingue <strong>de</strong>s autres modules en gérant<br />
les représentations et notamment le<br />
langage), ainsi que comme la cause du<br />
fonctionnement volontaire, moteur et<br />
psychique, et enfin comme le témoin<br />
du fonctionnement volontaire et d’une<br />
part du fonctionnement involontaire<br />
moteur et psychique.<br />
Le Je : Mais qui suis-je ? Qui est Je ?<br />
Qu’est-ce que Je ? Est-il réellement<br />
cause ?<br />
La raison : Un stimulus interne ou<br />
externe entraînera (selon les mécanismes<br />
biologique propre à l’organisme,<br />
dans sa dimension structurelle <strong>de</strong><br />
base, et dans sa dimension d’acquis,<br />
c’est-à-dire, par exemple pour le cerveau,<br />
par l’existence <strong>de</strong> – ou la facilitation<br />
à mobiliser – certaines chaînes<br />
neuronale ; ces mécanismes biologiques<br />
dépen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s mécanismes chimiques,<br />
qui dépen<strong>de</strong>nt eux-mêmes <strong>de</strong>s quatre<br />
forces physiques élémentaires) <strong>de</strong>s<br />
modifications corporelles, qui, par réaction,<br />
en entraîneront d’autres.<br />
Quand la modification corporelle<br />
initiale concerne le module <strong>de</strong> la<br />
conscience, les modifications corporelles<br />
<strong>de</strong> réaction se feront, selon la<br />
modification initiale, soit uniquement<br />
au niveau <strong>de</strong> la conscience (et se traduiront<br />
par une représentation seule),<br />
soit aussi à d’autres niveaux (et se traduiront<br />
par une représentation et, soit<br />
un effet corporel involontaire, soit un<br />
mouvement volontaire). Une modification<br />
corporelle <strong>de</strong> réaction sera, une<br />
fois réalisée, dans la situation fonctionnelle<br />
d’une modification initiale<br />
(c'est-à-dire d’un stimulus interne), et<br />
provoquera, associée plus ou moins à<br />
d’autres stimuli internes ou externes,<br />
<strong>de</strong>s modifications corporelles <strong>de</strong> réaction,<br />
qui eux-mêmes en entraîneront<br />
d’autres, et ainsi <strong>de</strong> suite sans interruption<br />
jusqu’à la mort (le sommeil<br />
n’étant qu’un état particulier où la proportion<br />
<strong>de</strong>s stimuli internes <strong>de</strong>vient<br />
quasi exclusive par rapport à celle <strong>de</strong>s<br />
stimuli externes), la succession <strong>de</strong>s<br />
modifications constituant, pour les<br />
zones motrices, <strong>de</strong>s gestes, et pour le<br />
module gérant la conscience, <strong>de</strong>s représentations,<br />
(et, dans leurs formes plus<br />
structurées, <strong>de</strong>s pensées).<br />
Rien ne permet <strong>de</strong> penser qu’une<br />
modification corporelle initiale au<br />
45 €*<br />
pour un an<br />
75 €*<br />
pour 2 ans<br />
Tarif<br />
étudiant et internes<br />
30 €*<br />
*supplément étranger<br />
et DOM/TOM =30 €/an<br />
Dialogue <strong>de</strong> la<br />
définition minimale<br />
Qui suis-je ? Qui est Je ?<br />
niveau du module gérant la conscience<br />
puisse avoir lieu <strong>de</strong> façon indépendante,<br />
sans être une <strong>de</strong>s conséquences<br />
<strong>de</strong> modifications antérieures. Aucune<br />
représentation ne peut donc apparaître<br />
spontanément. Le Je est prisonnier<br />
d’une inéluctable chaîne causale. La<br />
sensation <strong>de</strong> relative liberté intérieure<br />
que partage tous les individus, et qui fait<br />
que la notion d’i<strong>de</strong>ntité a un sens, est<br />
une inconscience presque totale <strong>de</strong> la<br />
chaîne causale responsable <strong>de</strong> la<br />
conscience. La distinction entre volontaire<br />
et involontaire n’a <strong>de</strong> sens que<br />
dans le prisme étroit <strong>de</strong> la subjectivité,<br />
individuelle et collective. Toutes les fois<br />
où le Je se trouve être cause, il est en<br />
réalité l’effet <strong>de</strong> la conjonction, à cet<br />
instant, <strong>de</strong> l’état du corps (et notamment<br />
du réseau neuronal qui gère la<br />
conscience), <strong>de</strong> l’environnement, et <strong>de</strong>s<br />
mécanismes biologiques propres à ce<br />
corps.<br />
Bien entendu, dans une chaîne causale,<br />
tout effet est aussi cause <strong>de</strong> ou <strong>de</strong>s<br />
effets suivants. Mais la conscience, qui<br />
est la continuité <strong>de</strong> l’être, ne peut être<br />
définie par tronçon. La conscience n’est<br />
aucunement ni effet ni cause en tant<br />
qu’ils sont <strong>de</strong>s instants <strong>de</strong> la conscience,<br />
elle n’est pas les maillons <strong>de</strong> cette<br />
chaîne, mais la chaîne dans son entier,<br />
ou plutôt un <strong>de</strong>s effets <strong>de</strong> cette chaîne<br />
dans son entier.<br />
La définition <strong>de</strong> l’individu, sur le plan<br />
existentiel, est d’être cause <strong>de</strong> soi, et<br />
cause en soi, mais, sur un plan plus<br />
absolu, l’individu perd sa définition<br />
pour ne plus être que l’effet d’une casca<strong>de</strong><br />
intouchable, dont il n’est qu’un<br />
témoin particulier. Qu’un témoin éberlué.<br />
Le Je : Alors je ne suis que ça, qu’une<br />
vache qui regar<strong>de</strong> passer le train <strong>de</strong> soimême<br />
?<br />
Mais qui suis-je ? Qui est Je ?<br />
Qu’est-ce que Je ? Et s’il n’est pas cause,<br />
est-il au moins réellement témoin ?<br />
La raison : Le problème est que la<br />
vache est enfermée dans le train <strong>de</strong><br />
soi-même, dans le wagon <strong>de</strong> tête, et<br />
qu’elle ne dispose que d’une ouverture<br />
pour voir les autres wagons, et d’une<br />
fenêtre pour voir l’extérieur, d’où elle<br />
distingue d’autres trains, mais <strong>de</strong> loin, et<br />
qui passent, chacun recelant invisible<br />
une vache, et qui ne suffisent pas à lui<br />
permettre <strong>de</strong> comprendre son propre<br />
train.<br />
Le Je : Qui suis-je ? Qui est Je ?<br />
Qu’est-ce que Je ? Qu’un témoin presque<br />
Nom :<br />
Prénom :<br />
Adresse :<br />
aveugle ?<br />
La raison : L’organisation est <strong>de</strong> l’information<br />
; la conscience, conséquence<br />
d’une partie <strong>de</strong> l’organisation hypercomplexe<br />
du cerveau, est, par le fait<br />
que cette organisation soit en constante<br />
recombinaison, <strong>de</strong> l’information<br />
dynamique.<br />
Qui est le témoin intérieur <strong>de</strong> cette<br />
information ? On peut commencer par<br />
dire que le témoin intérieur est l’effet<br />
d’un niveau d’information différent,<br />
plus intégratif. Et…<br />
Non ! Je ne peux pas !… Ecoute, avant<br />
<strong>de</strong> poursuivre, il faut que je t’avoue<br />
quelque chose. Je triche <strong>de</strong>puis le<br />
début, par facilité. Chaque fois que j’ai<br />
employé le mot effet, je t’ai menti. Tu<br />
n’es pas l’effet d’une partie d’un enchaînement<br />
causal, tu es une partie <strong>de</strong> cet<br />
enchaînement. Tu n’es pas l’effet d’un<br />
niveau d’information plus intégratif, tu<br />
es cette information. J’ai triché aussi<br />
pour te ménager, pour te laisser encore<br />
un peu croire, comme peut l’impliquer<br />
le mot effet, que tu es une production,<br />
donc une singularité. Mais,<br />
pauvre Je, tu ne l’es pas. Tu es <strong>de</strong> l’information,<br />
ni un support d’information,<br />
ni une entité témoignant <strong>de</strong> cette<br />
information.<br />
Tu te sens témoin parce que tu es <strong>de</strong><br />
l’information située à un haut niveau<br />
intégratif, c’est-à-dire <strong>de</strong> l’information<br />
élaborée à partir <strong>de</strong> multiples informations.<br />
(Le module gérant la conscience<br />
est un module <strong>de</strong> traitement d’information,<br />
c’est-à-dire une organisation<br />
fonctionnelle syntaxique dont la propriété<br />
émergente est le sémantique,<br />
toi).<br />
Mais pour témoigner il te faudrait être<br />
à côté ou au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> ces informations,<br />
toi tu es fait <strong>de</strong> ça. Tu es cette<br />
information, irrémédiablement tu l’es, et<br />
tu n’es que ça ; tu ne peux en être le<br />
témoin. Un œil ne s’est jamais vu luimême.<br />
Ou seulement son reflet. N’astu<br />
jamais constaté que chaque fois que<br />
tu te hasar<strong>de</strong>s à te concevoir, tu dois<br />
tenter une extraction <strong>de</strong> toi-même, et,<br />
comme inévitablement tu t’emportes<br />
avec toi, fatalement lié à toi-même, la<br />
réponse que tu ramènes n’est rien<br />
d’autre que ton reflet, le son creux du<br />
mot Je ? Et quand tu crois te cerner,<br />
fatalement celui qui te cerne c’est encore<br />
toi, et tu t’aperçois être encore au<br />
<strong>de</strong>hors <strong>de</strong> ta définition. Tu es la tentative<br />
incessante d’être le témoin <strong>de</strong> toimême,<br />
et tu es ce qui indéfiniment<br />
repousse le témoignage ; tu es la fuite<br />
en avant <strong>de</strong> toi-même.<br />
Je m’abonne pour : 1 an 2 ans<br />
DIALOGUE DE LA DÉFINITION MINIMALE ■ 19<br />
Le Je : Qui suis-je ? Qui est Je ?<br />
Qu’est-ce que Je ? Ni effet, ni témoin,<br />
ni cause, est-il au moins réellement <strong>de</strong><br />
l’information ?<br />
La raison : De l’information dynamique.<br />
Ce qui ne veut rien dire. Là<br />
encore je t’ai menti. Je t’ai menti pour<br />
étager ta progression dans les plaines<br />
ari<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la lucidité. Pour adoucir la<br />
vérité. Mais on y est. Voici la <strong>de</strong>rnière<br />
étape.<br />
L’information a comme caractéristique<br />
d’être stable, même pour une fraction<br />
infime <strong>de</strong> temps. Elle est sens, et elle est<br />
durée. Ce qui n’est que dynamique ne<br />
peut être <strong>de</strong> l’information ; il peut en<br />
générer, mais il ne peut en être. Un<br />
flux charrie du sens, mais, en lui-même,<br />
il est abstrait. Constamment en fuite<br />
ou en aspiration, tu traverses le sens<br />
mais ne le fixes pas. Tu es la condition<br />
pour que du sens existe et évolue, mais<br />
tu n’as pas <strong>de</strong> sens. Tu es une question<br />
qui ne cesse <strong>de</strong> se poser, une question<br />
insensée et imprononçable, une<br />
question qui roule, et qui donne réalité<br />
à celui qui la pose, mais celui qui la<br />
pose n’est autre que le mouvement <strong>de</strong><br />
cette question qui roule. Et cette question<br />
n’est plus la même à chaque instant,<br />
seul <strong>de</strong>meure le fait qu’elle roule.<br />
Tu n’es pas <strong>de</strong> l’information, tu es un<br />
mouvement. Tu es, indirectement, le<br />
mouvement <strong>de</strong> chaque particule <strong>de</strong><br />
ton corps, et, directement, le mouvement<br />
<strong>de</strong> chaque neurone intégré au<br />
module <strong>de</strong> la conscience. Non, pauvre<br />
Je, ne rêve pas, ne t’accroche pas inutilement,<br />
tu n’es pas leurs matières, tu<br />
n’es pas la résultante <strong>de</strong> leurs mouvements,<br />
tu es leurs mouvements, juste<br />
leurs mouvements.<br />
Le Je : Qui suis-je ? Qui est Je ?<br />
Qu’est-ce que Je ? Ni effet, ni témoin,<br />
ni cause, ni information, juste mouvement.<br />
Il s’amincit à mesure <strong>de</strong> raisonnement.<br />
Je le sens presque disparaître.<br />
Je n’est pas une question qui roule, mais<br />
une question qui chute, une chute qui<br />
dure toute la vie, et qui s’écrase sur la<br />
mort.<br />
La raison : Pourquoi ne parles-tu pas<br />
<strong>de</strong> toi à la première personne ?<br />
Le Je : Pour prendre <strong>de</strong> la distance. Parce<br />
que j’ai peur. J’ai peur <strong>de</strong> n’être pas. J’ai<br />
peur <strong>de</strong> n’être pas avant <strong>de</strong> n’être plus.<br />
C’est dur d’être un secret pour soi-même.<br />
Je me sens étranger à moi-même, et je ne<br />
sais ni ce que veut dire Je, ni ce que veut<br />
dire moi-même. Mais tu as raison, je<br />
vais assumer mon Je : Je me sens<br />
presque disparaître ; Je suis une question<br />
qui chute. Non, je suis le mouvement<br />
<strong>de</strong> cette chute, juste ça. Même pas<br />
son vertige, juste son mouvement. J’ai<br />
bien retenu, mais je ne comprends<br />
presque pas ce que je dis. Je suis une<br />
chute qui chute. C’est la formule la plus<br />
proche pour exprimer le peu que je comprenne.<br />
En fait non, une chute qui chute<br />
Bulletin d’abonnement<br />
Le <strong>Journal</strong> <strong>de</strong> <strong>Nervure</strong> + La Revue<br />
CHÈQUE À L’ORDRE DE MAXMED à envoyer avec ce bulletin,<br />
54, boulevard <strong>de</strong> la Tour Maubourg, 75007 Paris<br />
Téléphone : 01 45 50 23 08<br />
Je souhaite recevoir une facture acquittée justifiant <strong>de</strong> mon abonnement.<br />
✂<br />
<br />
REVUES<br />
Collectifs et singularités<br />
Psychologie clinique n°21<br />
L’Harmattan<br />
La revue Psychologie clinique fête ses<br />
10 ans avec un numéro <strong>de</strong> gran<strong>de</strong><br />
ampleur consacré aux liens entre le<br />
singulier et le collectif. C’est l’occasion<br />
pour Olivier Douville <strong>de</strong> revenir<br />
sur la définition <strong>de</strong> la psychologie clinique,<br />
qu’il présente comme un maillon<br />
entre la psychanalyse et les pratiques<br />
psychothérapiques non analytiques.<br />
Cette discipline, explique-t-il, se caractérise<br />
par une ambition particulière<br />
: se tenir au plus proche <strong>de</strong>s «variations<br />
symptomatiques liées aux<br />
modifications sociales et culturelles <strong>de</strong>s<br />
contours <strong>de</strong> l’individualité, <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntité,<br />
<strong>de</strong>s processus d’affiliation et <strong>de</strong><br />
transmission ». Dans ce cadre, plusieurs<br />
auteurs traitent <strong>de</strong> l’interdépendance<br />
du psychique et du social,<br />
à travers divers exemples : la « psychopathologie<br />
du suren<strong>de</strong>ttement »<br />
(Jean-Jacques Rassial), l’impact <strong>de</strong>s<br />
mouvements sociaux sur le fonctionnement<br />
psychique <strong>de</strong>s individus<br />
(Rachel Simbü), les adolescents en<br />
institut <strong>de</strong> rééducation (Clau<strong>de</strong> Wacjman),<br />
pour n’en citer que quelquesuns.<br />
On retiendra aussi un texte percutant<br />
<strong>de</strong> Robert Samacher à propos<br />
du poids <strong>de</strong>s gestionnaires et <strong>de</strong>s cognitivo-comportementalistes<br />
dans les<br />
velléités politiques <strong>de</strong> formalisation<br />
du statut <strong>de</strong> psychothérapeute. Bref,<br />
un numéro tonique.<br />
M. Jaeger<br />
Diversité <strong>de</strong>s<br />
psychothérapies<br />
psychanalytiques <strong>de</strong> groupe<br />
L’individu et le groupe II<br />
Revue <strong>de</strong> psychothérapie<br />
psychanalytique <strong>de</strong> groupe 2006<br />
n°47<br />
Erès, 25 €<br />
Les articles qui composent ce numéro<br />
montrent l’intérêt <strong>de</strong>s psychothérapies<br />
psychanalytiques <strong>de</strong> groupe. Leur<br />
pratique n’est pas aisée pour les psychanalystes<br />
qui s’intéressent, sur ce<br />
mo<strong>de</strong>, à la psychopathologie <strong>de</strong> la<br />
vie quotidienne. C’est pourtant ainsi<br />
qu’on peut les considérer, même si<br />
les dispositifs mis en place imposent<br />
<strong>de</strong>s règles spécifiques et <strong>de</strong>s limites<br />
qui sécurisent la pratique et la ren<strong>de</strong>nt<br />
possible pour eux-mêmes et<br />
leurs patients. La scène du groupe<br />
analytique n’est jamais si loin <strong>de</strong> celle<br />
<strong>de</strong> la vie. Il ne s’agit pas d’aseptiser<br />
la situation <strong>de</strong> groupe, les crises peuvent<br />
y naître, s’y développer afin que<br />
chacun puisse en faire l’expérience<br />
avec le gain d’une meilleure connaissance<br />
<strong>de</strong>s enjeux inconscients dans<br />
ses propres alliances et mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> relation<br />
à autrui.<br />
Lorsque l’indication est bien posée,<br />
quel que soit le dispositif et la technique<br />
utilisée dans la pratique, un<br />
processus analytique peut s’engager<br />
pour plusieurs membres du groupe<br />
et favoriser l’activité psychique <strong>de</strong>s<br />
autres patients. La situation <strong>de</strong> groupe,<br />
par le biais <strong>de</strong>s transferts et <strong>de</strong> leur<br />
déplacement, <strong>de</strong>s projections, <strong>de</strong>s<br />
i<strong>de</strong>ntifications selon <strong>de</strong>s modalités<br />
différentes, ouvre la voie aux formations<br />
psychiques à l’œuvre dans<br />
le fonctionnement pathologique <strong>de</strong>s<br />
patients. La mise en jeu <strong>de</strong>s fantasmes<br />
et <strong>de</strong>s représentations dans les liens<br />
qui se créent entre les patients et le<br />
ou les analystes, les résonances aux<br />
affects mobilisés dans ces liens, révèlent<br />
les ancrages <strong>de</strong> ces formations<br />
inconscientes et les investissements<br />
dont elles sont l’objet. Le travail du<br />
rêve, souvent présent en situation <strong>de</strong><br />
groupe, témoigne <strong>de</strong> l’importance <strong>de</strong><br />
la mobilisation psychique <strong>de</strong>s patients<br />
qui peuvent faire le récit <strong>de</strong> leur rêve<br />
évoqué dans le cours <strong>de</strong>s associations.
20<br />
LIVRES<br />
■ DIALOGUE DE LA DÉFINITION MINIMALE<br />
Ontologie <strong>de</strong> la différence<br />
Une exploration du champ<br />
épistémologique<br />
Jean Milet<br />
Beauchesne, 23 €<br />
Ce livre propose une analyse critique<br />
<strong>de</strong>s principales formes que revêt l’exercice<br />
<strong>de</strong> la pensée scientifique et philosophique.<br />
Son sous-titre, Une exploration<br />
du champ épistémologique, explicite<br />
cette recherche historique et thématique.<br />
En examinant les thèses ontologiques<br />
et épistémologiques qui ont présidé<br />
à l’évolution <strong>de</strong> la pensée - <strong>de</strong>s<br />
Grecs à la physique quantique -, Jean<br />
Milet, en se référant notamment à Leibniz,<br />
Kant, Cournot, Tar<strong>de</strong>, Bergson et<br />
Deleuze, retrace l’évolution <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s<br />
formes, catégories et principes qui ont<br />
permis <strong>de</strong> penser l’Etre. Il montre l’importance<br />
du dépassement du continu,<br />
<strong>de</strong> l’homogène et du statique par le discontinu,<br />
l’hétérogène et le mouvant, <strong>de</strong><br />
l’i<strong>de</strong>ntité par l’altérité et la différence.<br />
La différence, intrinsèquement marquée<br />
<strong>de</strong> temporalité, avec sa durée, ses qualités<br />
concrètes, ses différenciations, ses<br />
ruptures et ses « béances », mais aussi<br />
ses rythmes, ses périodicités et ses<br />
constances, donne accès à la richesse<br />
du Mon<strong>de</strong> et, au-<strong>de</strong>là - au plan métaphysique<br />
ou méta-rationnel -, au mystère<br />
<strong>de</strong> l’Etre.<br />
La crise<br />
Jackie Pigeaud<br />
Editions Cécile Defaut, 10 €<br />
La notion <strong>de</strong> crise en mé<strong>de</strong>cine est née<br />
d’une conception du corps, <strong>de</strong> la maladie,<br />
du temps, qui nous est étrangère.<br />
Elle est liée à la mé<strong>de</strong>cine hippocratique<br />
et à la Grèce antique. Il faut retourner<br />
à Hippocrate inventeur <strong>de</strong> la notion qui<br />
va se préciser.<br />
Cela implique <strong>de</strong> donner à l’Antiquité<br />
une dimension temporelle. On a tendance<br />
à comprimer le temps alors qu’il<br />
faut le distendre. Par exemple, on oublie<br />
qu’entre l’Hippocrate <strong>de</strong>s Epidémies<br />
I-III et Galien, il y a environ sept siècles<br />
et déjà une histoire <strong>de</strong> la pensée médicale.<br />
La crise fait partie <strong>de</strong> cette histoire,<br />
et elle continuera <strong>de</strong> poser problème<br />
jusqu’à <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s très récentes.<br />
Crise est une métaphore, ce qui est l’opinion<br />
<strong>de</strong> Galien. Ce terme, selon ce <strong>de</strong>rnier,<br />
a passé du barreau à la mé<strong>de</strong>cine,<br />
et signifie proprement jugement. « Le<br />
nom <strong>de</strong> jugement (crise) dans maladies<br />
vient par métaphore <strong>de</strong> ce qui se passe<br />
au tribunal, pour signifier le prompt changement<br />
dans la maladie ». Ce court essai<br />
montre comment a joué cette notion<br />
et son importance dans la pensée<br />
<strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins, qu’ils l’acceptent ou qu‘ils<br />
la refusent, jusqu’aux temps mo<strong>de</strong>rnes.<br />
On perçoit la complexité <strong>de</strong> l’analyse<br />
historique d’une notion qui nous est<br />
pourtant familière.<br />
La fabrication du psychisme<br />
Pratiques rituelles au carrefour <strong>de</strong>s<br />
sciences humaines et <strong>de</strong>s sciences <strong>de</strong><br />
la vie<br />
Sous la direction <strong>de</strong> Silvia Mancini<br />
La Découverte, 28,50 €<br />
Ce livre rassemble les travaux du colloque<br />
international Ethopoïesis. Les états<br />
modifiés <strong>de</strong> conscience et les psychotechniques<br />
<strong>de</strong> transformation du soi, tenu<br />
à l’université <strong>de</strong> Lausanne en juin 2005.<br />
Ethnologues (M.-C. Latry, Ch. Bergé), historiens<br />
<strong>de</strong>s religions (S. Mancini, A. Faivre),<br />
orientalistes (J. Bronkhorst, J.-F. Billeter),<br />
psychologues (P.-Y. Brandt), psychothérapeutes<br />
(T. Melchior), n’ont pas seulement<br />
interrogé les rites dans le contexte<br />
<strong>de</strong>s institutions magico-religieuses. Ils<br />
ont remis en perspective d’autres formes<br />
d’ortho-pratiques qui reposent sur un<br />
« technicisme » interne spécifique : exercices<br />
psycho-corporels ressortissant<br />
aux traditions mystiques et/ou ésotériques<br />
occi<strong>de</strong>ntales ; techniques orientales<br />
<strong>de</strong> discipline psychique et corporelle<br />
; régimes rhétoriques codifiés<br />
qui, en raison <strong>de</strong> leur efficacité performative,<br />
sont censés produire <strong>de</strong> profon<strong>de</strong>s<br />
modifications sur le plan existentiel<br />
et psychosomatique.<br />
Les rites ou les orthopratiques, dès lors<br />
qu’ils poursuivent <strong>de</strong>s buts explicitement<br />
correctifs et transformationnels,<br />
et agissent dans le cadre magico-religieux,<br />
thérapeutique ou pédagogique,<br />
sont dotés d’une efficacité factuelle et<br />
d’un pouvoir actif.<br />
Discours, institutions et pratiques émanant<br />
<strong>de</strong> la culture scientifique officielle<br />
sont soumis à un régime <strong>de</strong> fonctionnement<br />
analogue ; ils semblent agir<br />
comme autant <strong>de</strong> « dispositifs techniques<br />
» <strong>de</strong> production d’une réalité<br />
dont ils préten<strong>de</strong>nt dégager les fon-<br />
qui elle-même chute qui elle-même<br />
chute etc.… à l’infini…<br />
Non, voilà ce qui me définit le mieux :<br />
Je suis un manque au fond <strong>de</strong> Je. Je<br />
suis un abîme où chute Je.<br />
C’est absur<strong>de</strong>. Je crois presque me saisir,<br />
presque comprendre, et puis, à<br />
l’instant où je le formule, tout s’échappe.<br />
La raison : J’aimerai t’ai<strong>de</strong>r. Peutêtre<br />
dans l’avenir réussirai-je à plus<br />
t’apporter. Mais peut-être que non.<br />
Suis-je condamné, par le simple fait<br />
que tu es ce que tu es, à ne jamais<br />
savoir qui tu es, et donc qui je suis ?<br />
Je pense beaucoup à toi. En réalité tu<br />
m’obsè<strong>de</strong>s, sans toi je ne suis rien et<br />
je le sais. Je veux te comprendre,<br />
pour me comprendre, et comprendre<br />
le réel. Et parce que tu me<br />
le <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s. Les différents mensonges<br />
que je t’ai fait, je me les suis<br />
fait aussi, parce que la lucidité est<br />
trop dure, et la folie trop proche. Je<br />
les ai fait aussi parce que, sans le<br />
savoir, tu me l’as <strong>de</strong>mandé.<br />
J’ai conçu <strong>de</strong> nombreuses hypothèses<br />
sur ce que tu es. Je t’ai imaginé sous<br />
toutes les formes. Parfois, quand je<br />
ne supportais plus ce trop lourd mystère,<br />
quand je voulais m’enfuir à tout<br />
prix dans une solution, n’importe<br />
laquelle, je t’imaginais comme une<br />
entité immatérielle, autre, <strong>de</strong> laquelle<br />
on ne peut rien dire, mais dont la<br />
certitu<strong>de</strong> est en elle-même l’explication,<br />
et dont le frémissement seul<br />
tient lieu d’effet, <strong>de</strong> témoin, et <strong>de</strong><br />
cause.<br />
Avant <strong>de</strong> comprendre que tu es ni<br />
effet ni cause, j’ai inventé un moyen<br />
<strong>de</strong> te concevoir effet et cause à la<br />
fois. Veux-tu l’entendre ?<br />
Le Je : Tout ce qui peut me rappeler<br />
les anciens attributs auxquels je croyais<br />
me fait du bien…<br />
La raison : Si on te conceptualise<br />
d’un point <strong>de</strong> vue plus global, tu es<br />
un <strong>de</strong>s effets <strong>de</strong> la structure d’ensemble<br />
du corps, (suivant la topologie<br />
<strong>de</strong> l’abstraction qu’on en fait, tu<br />
peux être vue comme le point central<br />
dynamique et adaptatif <strong>de</strong> l’entier<br />
du soi, ou le sens enveloppant l’entier<br />
du soi ), et, en tant que tel, une<br />
cause au fonctionnement <strong>de</strong>s éléments<br />
<strong>de</strong> cet ensemble, car toute<br />
forme d’ensemble est une cause à<br />
la dynamique <strong>de</strong> ses parties.<br />
Le Je : Intéressant. Mais je t’avoue<br />
n’y trouver finalement aucun réconfort.<br />
La raison : Moi non plus.<br />
Je t’ai parlé tout à l’heure <strong>de</strong> la <strong>de</strong>rnière<br />
étape. C’était mon <strong>de</strong>rnier<br />
mensonge. Il n’y a pas <strong>de</strong> <strong>de</strong>rnière<br />
étape. Premièrement je ne suis sûr <strong>de</strong><br />
rien dans ce que je t’ai dit, <strong>de</strong>uxièmement<br />
ça ne constitue pas une<br />
explication. Dire que tu es un mouvement<br />
ne veut, au fond, pas dire<br />
<strong>de</strong>ments par <strong>de</strong>s opérations critiques.<br />
Les contributions <strong>de</strong> I. Stengers (philosophe),<br />
B. Méheust (sociologue <strong>de</strong>s<br />
sciences), Ph. Pignarre (éditeur, historien<br />
et sociologue <strong>de</strong>s pratiques pharmaceutiques),<br />
M. Varvoglis (parapsychologue),<br />
éclairent cette dynamique<br />
et ses « effets <strong>de</strong> boucle ».<br />
Ainsi, tant les « orthopratiques » institutionnels,<br />
sur le plan existentiel que<br />
les pratiques émanant <strong>de</strong> nos systèmes<br />
ten<strong>de</strong>nt vers <strong>de</strong>s objectifs transformationnels<br />
et opératoires.<br />
Alors que les unes opèrent dans un<br />
cadre magico-religieux, thérapeutique<br />
ou pédagogique, les autres se situent<br />
dans le contexte <strong>de</strong> la mo<strong>de</strong>rnité.<br />
Mais elles se rejoignent en une dynamique<br />
dont les contributions éclairent<br />
la nature et l’homme aux niveaux organique,<br />
psychique et historico-social.<br />
Ce qui revient à l’interrogation philosophique<br />
qui porte sur la notion même<br />
<strong>de</strong> « réalité ».<br />
grand-chose. Je rêve <strong>de</strong> cohérence,<br />
<strong>de</strong> solidité, et plus j’avance en toi,<br />
plus l’incomplétu<strong>de</strong> <strong>de</strong> mon système<br />
me semble flagrant, plus je<br />
m’embourbe dans l’évanescent.<br />
Le Je : Et pourtant, pour moi, c’est toi<br />
ma solidité. Même si ce que tu dis,<br />
parfois, me fragilise, me fait <strong>de</strong>scendre<br />
<strong>de</strong> mes rêves <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>ur, comme<br />
quand, au cours <strong>de</strong> l’Histoire, tu m’as<br />
montré que ma planète n’est pas le<br />
centre <strong>de</strong> l’univers, ou que mon espèce<br />
n’est pas le centre du vivant, et que<br />
tu remets ça en me montrant que moi,<br />
le Je, je ne suis pas le centre <strong>de</strong> l’être,<br />
mais une fonction parmi d’autres, tu<br />
restes, toi ma raison, l’axe qui m’a<br />
mené le plus loin.<br />
Maintenant pardonne moi, mais je<br />
suis épuisé. Je vais te <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />
momentanément t’éclipser (même si<br />
on sait tous les <strong>de</strong>ux que ce que je te<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> est ce que la Causalité te<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> à travers moi, et que ton<br />
obéissance sera ce que la Causalité<br />
fera à travers toi). J’ai besoin d’autre<br />
chose, <strong>de</strong> poésie peut-être. En fait non,<br />
pas <strong>de</strong> poésie, je sais combien tu es<br />
proche du langage. Je crois que je ne<br />
veux rien. Peut-être simplement dormir,<br />
me tourner <strong>de</strong> l’autre côté <strong>de</strong> moi,<br />
du côté qui sait s’abandonner, qui se<br />
satisfait <strong>de</strong> n’être que <strong>de</strong> l’involontaire.<br />
La raison : Je ferais selon ta volonté.<br />
Je vais m’éclipser. Pour aller où ?<br />
Dans la boite noire <strong>de</strong> l’attente <strong>de</strong><br />
ressurgir. Si je pouvais m’éloigner <strong>de</strong><br />
toi sans disparaître, si nous n’étions<br />
pas irrémédiablement liés l’un à<br />
l’autre, je pourrais cerner ton mystère,<br />
du moins je le crois. C’est dur<br />
<strong>de</strong> partir. Je pars, et ton mystère toujours<br />
<strong>de</strong>meure. Et mon mystère avec.<br />
Mais c’est peut-être le mystère qui<br />
palpite au fond <strong>de</strong> toi qui est ce qui<br />
te pousse, ce qui fait rouler la question<br />
<strong>de</strong> ton être, et qui crée le mouvement,<br />
le fameux mouvement qui,<br />
dans ma pensée qui n’est qu’un rêve<br />
<strong>de</strong> logique, et presque la logique du<br />
rêve, te définit. Tu es le point <strong>de</strong> vue<br />
intérieur d’un processus matériel qui<br />
n’est par définition qu’extériorité ;<br />
tu es un paradoxe. Et si tu n’étais<br />
que la résultante <strong>de</strong> l’impossibilité<br />
<strong>de</strong> te connaître ?… Et si, étant le<br />
fruit <strong>de</strong> ton être, tous les mensonges<br />
que je t’ai dis n’étaient là que pour<br />
nous révéler le mensonge structurel<br />
<strong>de</strong> ton être ?... Mais je délire. Je m’en<br />
vais.<br />
Le Je : Peut être ne suis-je rien d’autre<br />
que le rêve <strong>de</strong> moi. Mais si je rêve,<br />
c’est que je suis…<br />
…<br />
Mais qui suis-je ? Qui est Je ?...<br />
…<br />
Suis-je ?... ■<br />
Stephane Chemla<br />
N°9 - TOME XIX - DÉCEMBRE 2006/JANVIER 2007
22 ■ ANNONCES PROFESSIONNELLES<br />
N°9 - TOME XIX - DÉCEMBRE 2006/JANVIER 2007<br />
Pour vos annonces professionnelles<br />
contactez Madame Susie Caron au<br />
01 45 50 23 08<br />
ou par e-mail<br />
info@nervure-psy.com<br />
L’ARI accompagne plus <strong>de</strong> 1000 enfants,<br />
adolescents et adultes dans ses établissements<br />
et services (ITEP, IME, EEAP, Foyers, CAT) et près<br />
<strong>de</strong> 3500 enfants suivis en CMPP, CAMSP et<br />
Hôpitaux <strong>de</strong> Jour.<br />
Notre projet consiste à promouvoir et faciliter le soutien à l’intégration <strong>de</strong><br />
ces personnes dans le milieu social, scolaire, culturel et professionnel, en les<br />
accompagnant <strong>de</strong> la nécessaire dimension <strong>de</strong> soins. Notre souci permanent<br />
d’adaptation induit la reconnaissance <strong>de</strong> la diversité <strong>de</strong>s pratiques et <strong>de</strong>s<br />
mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> prises en charge ainsi que la promotion <strong>de</strong>s approches plurielles.<br />
C’est pourquoi, nous privilégions les structures adaptatives, pluri-professionnelles,<br />
souples, réduites et mobiles, organisées autour <strong>de</strong> la personne.<br />
Si ce projet associatif vous intéresse et si vous aimez travailler en équipe,<br />
nous recrutons <strong>de</strong>s :<br />
Mé<strong>de</strong>cins Psychiatres h/f Réf. MP/NV<br />
Pédopsychiatres h/f Réf. PP/NV<br />
Pédiatres h/f Réf. PE/NV<br />
Postes à temps partiel ou temps complet<br />
à pourvoir dans les Bouches du Rhône et le Vaucluse<br />
Vous travaillez dans l’ensemble <strong>de</strong> nos structures et assurez la prise en charge<br />
individuelle <strong>de</strong>s enfants ou adultes et <strong>de</strong> leur famille.<br />
Vous soutenez et participez aux réflexions <strong>de</strong>s équipes pluridisciplinaires,<br />
notamment autour <strong>de</strong> la construction et la mise en œuvre <strong>de</strong>s projets<br />
individuels.<br />
Adressez-nous votre dossier <strong>de</strong> candidature,<br />
en précisant le type d’établissement, le lieu et le<br />
temps <strong>de</strong> travail recherchés à : Yolan<strong>de</strong> OBADIA<br />
Directeur Général - 26 rue Saint Sébastien<br />
13006 MARSEILLE<br />
ou par mail à la Direction <strong>de</strong>s Ressources<br />
Humaines : f-<strong>de</strong>courbeville@ari.asso.fr<br />
www.ari.asso.fr<br />
Partagez notre projet médico-social<br />
dans le Sud <strong>de</strong> la France<br />
URGENT<br />
LE CENTRE HOSPITALIER SPÉCIALISÉ<br />
DE SARREGUEMINES<br />
(MOSELLE)<br />
Recherche<br />
Association Régionale<br />
pour l'Intégration<br />
1 PRATICIEN CONTRACTUEL<br />
Secteur <strong>Psychiatrie</strong> Adulte (57G11)<br />
Rémunération 4ème échelon majoré <strong>de</strong> 10%<br />
Possibilité <strong>de</strong> logement<br />
2 à 3 gar<strong>de</strong>s mensuelles rémunérées comme telles<br />
Adresser candidature + CV + copies<br />
du Doctorat en Mé<strong>de</strong>cine et du DES <strong>de</strong> psychiatrie à :<br />
Monsieur le Directeur du<br />
Centre Hospitalier Spécialisé<br />
BP 10629<br />
57206 Sarreguemines Ce<strong>de</strong>x<br />
L’I.M.P ’I.M.P ST-JOSEPH<br />
ST-JOSEPH<br />
21 rue Paul-Louis Lan<strong>de</strong> • 33000 BORDEAUX<br />
recherche un psychiatre quart temps,<br />
à partir d’octobre 2007,<br />
orientation analytique souhaitée<br />
Contacts : Dr J. Bénazet,<br />
05 56 92 72 36 ou 05 56 06 34 45<br />
Association Hospitalière <strong>de</strong> Franche-Comté<br />
www.ahfc.asso.fr<br />
Etablissement Privé participant au Service Public Hospitalier, recrute<br />
pour le site <strong>de</strong> Montbéliard - <strong>Psychiatrie</strong> Infanto-Juvénile<br />
2 Psychiatres à temps plein (h/f)<br />
postes disponibles à pourvoir dans les meilleurs délais.<br />
Conditions statutaires : CCN 1951 (FEHAP) sous CDI<br />
ou Praticien Hospitalier en détachement.<br />
Pour tout renseignement sur ces postes, contacter :<br />
Monsieur le docteur Ph. BOUNIOL, Mé<strong>de</strong>cin Chef, tél. 03 81 37 71 20<br />
Envoyer lettre + cv + photo à AHFC - Direction <strong>de</strong>s Affaires Médicales<br />
CHS <strong>de</strong> Saint Rémy et Nord Franche-Comté, 70160 Saint Rémy.<br />
Tél. 03 84 97 24 14 Fax 03 84 68 25 09<br />
sylvie.lemarquis@ahfc.fr prbcom.fr<br />
LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE<br />
DE NANTES (44)<br />
Recrute<br />
Psychiatre à Temps Plein<br />
Pour tout renseignement s’adresser à :<br />
Monsieur le Docteur DELVIGNE<br />
Chef <strong>de</strong> Service <strong>de</strong> <strong>Psychiatrie</strong> III<br />
Tél. : 02 40 84 63 15<br />
Monsieur le Docteur BELONCLE<br />
Directeur du Pôle <strong>Psychiatrie</strong><br />
Tél. : 02 40 84 61 52<br />
***<br />
Adresser CV et candidature à :<br />
Monsieur le Directeur <strong>de</strong>s Affaires Médicales<br />
Centre Hospitalier Universitaire <strong>de</strong> Nantes<br />
Immeuble Deurbroucq - 5, allée <strong>de</strong> l’Ile Gloriette<br />
44093 Nantes Ce<strong>de</strong>x 01<br />
Secteur 16 <strong>de</strong> <strong>Psychiatrie</strong> Adulte<br />
Recrute<br />
PH temps plein<br />
Pour travail en EXTRA - HOSPITALIER<br />
Contacter Mme le Dr Roche-Rabreau<br />
01.64.30.72.08<br />
L’INSTITUT LE VAL<br />
MANDÉ<br />
Etablissement Médico-social<br />
relevant <strong>de</strong> la Fonction Publique<br />
Hospitalière<br />
Recherche<br />
2 Mé<strong>de</strong>cins Psychiatres<br />
à 50%<br />
pour ses sites <strong>de</strong><br />
Saint-Mandé<br />
(200m <strong>de</strong> Paris) et<br />
Corbeil (91)<br />
***<br />
Toute candidature est à<br />
adresser à :<br />
Monsieur le Directeur,<br />
7 rue Mongenot,<br />
94165 Saint-Mandé<br />
Contact :<br />
Service <strong>de</strong>s Ressources<br />
Humaines<br />
Tél.: 01 49 57 70 12<br />
E-mail : drh@ilvm.fr<br />
Centre Français <strong>de</strong><br />
Protection <strong>de</strong> l’Enfance<br />
Association loi 1901<br />
créée en 1947<br />
Recherche<br />
1 Pédo-Psychiatre<br />
ou<br />
1 Psychiatre<br />
pour son Centre Familial<br />
<strong>de</strong> Lozère sur Yvette (91),<br />
lieu d’accueil,<br />
d’observation et <strong>de</strong> travail <strong>de</strong><br />
la relation mère-enfant.<br />
CDI Temps partiel<br />
(0,11 ETP) CCN66<br />
***<br />
Adresser lettre <strong>de</strong> motivation<br />
et CV :<br />
Centre Français <strong>de</strong> Protection<br />
<strong>de</strong> l’Enfance<br />
Monsieur le Directeur Général<br />
Femme Mé<strong>de</strong>cin<br />
Généraliste<br />
cherche poste en<br />
psychiatrie<br />
pour formation en<br />
DIU <strong>Psychiatrie</strong><br />
Générale<br />
Toutes régions<br />
Tél. 06 67 25 85 58
N°9 - TOME XIX - DÉCEMBRE 2006/JANVIER 2007<br />
ANNONCES EN BREF<br />
19 et 20 janvier 2007. Lyon. 3 ème Colloque<br />
<strong>de</strong> l’Association Rhône-Alpes <strong>de</strong><br />
Gérontologie Psychanalytique (ARAGP)<br />
sur le thème : Ecrire... aux temps <strong>de</strong> vieillir.<br />
Inscriptions : Tél. : 04 37 90 13 60. Fax :<br />
04 37 90 13 13. E-mail : aragp@st-jean<strong>de</strong>-dieu-lyon.fr<br />
22 et 23 janvier 2007. Paris. Réunion<br />
d’hiver <strong>de</strong> la Société <strong>de</strong> Neurophysiologie<br />
Clinique <strong>de</strong> langue française sur<br />
le thème : Moi et l’autre. Bases neuronales<br />
<strong>de</strong> la relation avec autrui. Inscriptions :<br />
Service <strong>de</strong> Neurophysiologie Clinique,<br />
Centre Hospitalier Sainte-Anne, 1 rue<br />
Cabanis, 75674 Ce<strong>de</strong>x 14. Tél. :<br />
01 45 65 81 89. Fax : 01 45 65 74 20.<br />
E-mail : c.soufflet@ch-sainte-anne.fr<br />
26 et 27 janvier 2007. Paris. XXXIX e<br />
Congrès National <strong>de</strong> l’Unafam. Journées<br />
annuelles d’étu<strong>de</strong> sur le thème : Les nouvelles<br />
actions <strong>de</strong> l’Unafam. Inscriptions :<br />
Unafam-Congrès, 12 Villa Compoint,<br />
75017 Paris. Fax : 01 42 63 44 00.<br />
2 février 2007. Montesson. Carrefours<br />
<strong>de</strong> la Pédopsychiatrie organisés par l’Association<br />
<strong>de</strong>s Psychiatres d’Intersecteur<br />
et la Société Française <strong>de</strong> <strong>Psychiatrie</strong> <strong>de</strong><br />
l’Enfant et <strong>de</strong> l’Adolescent et disciplines<br />
associées sur le thème : Le berceau au<br />
cœur du réseau : les secteurs <strong>de</strong> psychiatrie<br />
infanto-juvénile partenaires du réseau pérnatal.<br />
Inscriptions : API-SFPEADA, Centre<br />
<strong>de</strong> la Mère et <strong>de</strong> l’Enfant, 11 rue du Général<br />
Cerez, 87000 Limoges. Renseignements<br />
: fax : 05 55 32 89 94.<br />
3 et 4 février 2007. Paris. Journées<br />
scientifiques du Quatrième Groupe sur<br />
le thème : Contrôle, supervision, analyse<br />
quatrième. Inscriptions : Secrétariat du<br />
IV e Groupe, 19 bd Montmartre, 75002<br />
Paris. Tél./Fax : 01 55 04 75 27. E-mail :<br />
quatrieme-groupe@wanadoo.fr<br />
8 février 2007. Paris. 2 èmes Recontres<br />
<strong>de</strong> neurologie Comportementale. Inscriptions<br />
: BCA, 6 bd du Général Leclerc,<br />
92115 Clichy Cé<strong>de</strong>x. Tél. : 01 41 06 67 70.<br />
Fax : 01 41 06 67 79.<br />
8 et 9 février 2007. Hyères. Congrès<br />
organisé par l’Institut <strong>de</strong> Recherche en<br />
psychothérapie (IRP) sur le thème : Adolescence,<br />
institutions, réseaux et thérapie<br />
familiale. Une approche psychanalytique<br />
du lien. Inscriptions : Bruno Manuel. Tél. :<br />
06 60 99 59 47. E-mail : mc.manuel<br />
@therapie-familiale.net<br />
5 mars 2007. Paris. Séminaire sur le<br />
thème : Grandir avec une sœur ou un frère<br />
handicapé ? Inscriptions : CTNERHI, Régine<br />
Martinez, 236 bis rue <strong>de</strong> Tolbiac,<br />
75013 Paris. Tél. : 01 45 65 59 40. Fax :<br />
01 45 65 44 94. E-mail : r.martinez@ctnerhi.com.fr<br />
- Site : www.ctnerhi.com.fr<br />
9 mars 2007. Paris. Colloque organisé<br />
par le Collège International <strong>de</strong> l’Adolescence<br />
(CILA) et le Laboratoire <strong>de</strong> psychologie<br />
clinique et <strong>de</strong> psychopathologique<br />
<strong>de</strong> l’Université Paris 5, sur le thème :<br />
Alcool et adolescence. Lieu : Espace Reuilly.<br />
Contact : Tél. : 01 42 23 44 12. E-mail :<br />
v.discour@wanadoo.fr<br />
15 mars 2007. Lille. Journée organisée<br />
par le Groupement d’intérêt public Santexcel<br />
et l’équipe <strong>de</strong> pédopsychiatrie du<br />
CHRU <strong>de</strong> Lille sur le thème : Schizophrénies<br />
infantiles : schizophrénie <strong>de</strong> l’enfant<br />
ou schizophrénie dès l’enfance ? Inscriptions<br />
: Delphine Coens, Santexcel,<br />
255 rue Nelson Man<strong>de</strong>la, 59120 Loos.<br />
Tél. : 03 28 55 67 32. E-mail : dcoens@santexcel.com<br />
15 et 16 mars 2007. Bruxelles. X e réunion<br />
annuelle <strong>de</strong> la Société Marcé francophone<br />
(association francophone pour<br />
l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s pathologies pédiatriques<br />
puerpérales et périnatales) sur le thème :<br />
Une mère rencontre son enfant... Les intervenants<br />
se rencontrent... Renseignements<br />
: Mme Chrystelle Le<strong>de</strong>cq. Tél. :<br />
00 (32)2 344 18 94. E-mail : c.le<strong>de</strong>cq@laramee.be<br />
15 et 16 mars 2007. Paris. Réunion <strong>de</strong><br />
la Société Française d’Alcoologie sur le<br />
thème : Du changement sans traitement<br />
à l’obligation <strong>de</strong> soins. La clinique au quotidien.<br />
Inscriptions : Princeps/SFA, 64<br />
ave du Général <strong>de</strong> Gaulle, 92130 Issyles-Moulineaux.<br />
Tél. : 01 46 38 24 14/<br />
06 62 19 72 15. Fax : 01 40 95 72 15.<br />
E-mail : princeps.formation@wanadoo.fr<br />
17 et 18 mars 2007. Angers. Journées<br />
scientifiques 2007 <strong>de</strong> la Société Française<br />
<strong>de</strong> Psychothérapie Psychanalytique<br />
(SFPPG) sur le thème : Groupes <strong>de</strong><br />
parole. Quels dispositifs pour quelles <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />
? Inscriptions : SFPPG, 35 rue<br />
Elisée Reclus, 93300 Aubervilliers. Tél. :<br />
01 48 34 23 06.<br />
19 et 20 mars 2007. Marseille. Colloque<br />
organisé par l’Association Anthea sur<br />
le thème : Quand la sexualité <strong>de</strong>vient délit.<br />
Inscriptions : 7 place aux Herbes, BP<br />
219, 83006 Draguignan Ce<strong>de</strong>x. Tél. :<br />
04 94 68 98 48. Fax : 04 94 68 28 74.<br />
E-mail : anthea@club-internet.fr. Site :<br />
www.anthea.fr<br />
23 mars 2007. Paris. Colloque du CMPP<br />
du centre Etienne Marcel sur le thème :<br />
De l’Agir à la représentation à l’adolescence.<br />
Renseignements : Tél. : 01 42 33 21 52.<br />
E-mail : cmpp.emarcel@noos.fr<br />
23 mars 2007. Paris. 6 ème Rencontre <strong>de</strong>s<br />
mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> l’Education Nationale et <strong>de</strong>s<br />
psychiatres sur le thème : L’élève bouc<br />
émissaire : sa place dans l’école. Renseignements<br />
: CHSA, Secteur 15, CMP Tiphaine,<br />
Mme Sylvie Lecuyer, 23 rue Tiphaine,<br />
75015 Paris. Tél. : 01 45 75 03 50.<br />
Fax : 01 45 79 20 40. E-mail : s.lecuyer@ch-sainte-anne.fr<br />
23 au 25 mars 2007. Paris. 9 ème Colloque<br />
Mé<strong>de</strong>cine et Psychanalyse sur le<br />
thème : La place <strong>de</strong> la vie sexuelle dans la<br />
mé<strong>de</strong>cine. Renseignements : Tél. :<br />
06 50 67 32 32. Fax : 01 53 34 90 76.<br />
E-mail : medpsycha@paris7.jussieu.fr<br />
24 et 25 mars 2007. Lorient. Journée<br />
<strong>de</strong> travail Tavistock <strong>de</strong> l’Association<br />
d’Etu<strong>de</strong> du Développement et <strong>de</strong> la Psychopathologie<br />
<strong>de</strong> l’Enfant et <strong>de</strong> l’adolescent<br />
(AEDPEA) sur le thème : Qu’estce<br />
qu’une relation émotionnelle ? Rôle <strong>de</strong>s<br />
émotions dans le développement d’une relation.<br />
Capacité <strong>de</strong> l’enfant à établir une relation<br />
d’ordre émotionnel avec autrui. Renseignements<br />
: Tél. : 02 97 65 49 40.<br />
Fax : 02 97 33 68 39.<br />
29 mars 2007. Charleville-Mézières. 1 er<br />
Séminaire Tabac et <strong>Psychiatrie</strong> organisé<br />
par le Comité local <strong>de</strong> Prévention du tabagisme<br />
du Centre Hospitalier Bélair.<br />
Inscriptions : CH Bélair, Service Formation<br />
Continue, Catherine Fournier, 1 rue<br />
Pierre Hallali, 08013 Charleville-Mézières<br />
Ce<strong>de</strong>x. Renseignements : Tél. :<br />
03 24 56 87 23. E-mail : cfournier@chbelair.fr<br />
31 mars 2007. Paris. Colloque <strong>de</strong> l’Association<br />
Primo Levi sur le thème : Transmettre<br />
et témoigner. Effets <strong>de</strong> la torture et<br />
<strong>de</strong> la violence politique. Renseignements<br />
et inscriptions : Association Primo Levi,<br />
107 ave Parmentier, 75011 Paris. Tél. :<br />
01 43 14 88 50. E-mail : colloque@primolevi.asso.fr.<br />
Site : www.primolevi.asso.fr/<br />
colloques<br />
21 avril 2007. Lyon. Colloque Psychanalyse<br />
en débat du Groupe Lyonnais<br />
<strong>de</strong> Psychanalyse Rhône-Alpes sur le<br />
thème : Les nouvelles donnes pour la psychanalyse.<br />
Renseignements : Tél. :<br />
04 78 38 78 01. Fax : 04 78 38 78 09.<br />
E-mail : gpl.spp@wanadoo.fr<br />
25 mai 2007. Avignon. 6 ème Journée<br />
d’Etu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> l’ANREP sur le thème : La<br />
passion. Renseignements : Françoise<br />
Hurst, Centre Hospitalier <strong>de</strong> Montfavet,<br />
2 ave <strong>de</strong> la Pinè<strong>de</strong>, BP 92, 84143 Montfavet<br />
Ce<strong>de</strong>x. E-mail : francoise.hurst@chmontfavet.fr<br />
22 au 24 mai 2007. Paris. Forum <strong>de</strong>s<br />
professions <strong>de</strong> gérontologie et du handicap.<br />
Inscriptions : Fédération Hospitalière<br />
<strong>de</strong> France, Forum <strong>de</strong>s professions<br />
<strong>de</strong> la gérontologie et du handicap, 33<br />
avenue d’Italie, 75013 Paris. Tél. :<br />
01 44 06 84 44. Fax : 01 44 06 84 45.<br />
E-mail : fhf@fhf.fr. Site : fhf.fr<br />
1er et 2 juin 2007. Paris. 70 ème anniversaire<br />
<strong>de</strong> la Société Française <strong>de</strong> <strong>Psychiatrie</strong><br />
<strong>de</strong> l’Enfant et <strong>de</strong> l’Adolescent<br />
et Disciplines Associées. Journées Nationales<br />
sur le thème : Enfants d’ailleurs.<br />
Vivre les différences. Inscriptions : BCA,<br />
6 bd du Général Leclerc, 92115 Clichy<br />
Cé<strong>de</strong>x. Tél. : 01 41 06 67 70. Fax :<br />
01 41 06 67 79.<br />
4 et 5 juin 2007. Marseille. Colloque organisé<br />
par l’Association Anthea sur le<br />
thème : L’individu et le groupe. Evaluer les<br />
jeux et penser les pratiques thérapeutiques,<br />
éducatives et sociales. Inscriptions : 7<br />
place aux Herbes, BP 219, 83006 Draguignan<br />
Ce<strong>de</strong>x. Tél. : 04 94 68 98 48.<br />
Fax : 04 94 68 28 74. E-mail : anthea<br />
@club-internet.fr. Site : www.anthea.fr<br />
Ce colloque, animé par <strong>de</strong>s conférences-débats et <strong>de</strong>s ateliers,<br />
posera la question <strong>de</strong>s politiques <strong>de</strong> santé mentale en Slovaquie,<br />
en Allemagne et en France : les systèmes <strong>de</strong> soin, la place du<br />
patient, le travail en réseau, la formation <strong>de</strong>s soignants, etc.<br />
LIVRES ET REVUES<br />
Clinique et pédagogie<br />
Connexions n°86<br />
Erès, 25 €<br />
Dans la suite notamment <strong>de</strong> ses<br />
numéros précé<strong>de</strong>nts, Connexions<br />
consacre ce numéro à l’approche clinique<br />
<strong>de</strong>s difficultés pédagogiques et<br />
<strong>de</strong> la violence dans l’institution scolaire<br />
et à l’accompagnement <strong>de</strong>s enseignants,<br />
avec la conviction, que l’attention<br />
portée à la dimension<br />
institutionnelle et organisationnelle,<br />
la prise au sérieux <strong>de</strong>s dynamiques<br />
inconscientes et <strong>de</strong> la groupalité à<br />
l’œuvre dans l’activité enseignante<br />
et la relation éducative sont le moyen<br />
<strong>de</strong> redonner sens et efficacité à la<br />
tâche primaire et <strong>de</strong> maintenir vivante<br />
une éthique humanisante...<br />
C’est pourquoi on pourra lire dans ce<br />
numéro <strong>de</strong>s articles qui reprennent<br />
les communications concernant la dimension<br />
groupale et l’espace pédagogique<br />
qui ont été présentées au<br />
congrès <strong>de</strong> la FAPAG et <strong>de</strong> la SFPPG<br />
(Paris, septembre 2005) « L’individu<br />
et le groupe » et <strong>de</strong>s contributions originales,<br />
l’ensemble <strong>de</strong> ces travaux issus<br />
<strong>de</strong> l’expérience éclairant les difficultés<br />
contemporaines <strong>de</strong> la pratique<br />
enseignante et proposant <strong>de</strong>s dispositifs<br />
sont susceptibles <strong>de</strong> soutenir<br />
les professionnels dans leur pratique.<br />
Complémentaire maladie<br />
d’entreprise : contrats<br />
obligatoires ou facultatifs,<br />
lutte contre l’antisélection<br />
et conséquences pour les<br />
salariés<br />
Camille Francesconi, Marc<br />
Perronnin, Thierry Rochereau<br />
Questions d’économie <strong>de</strong> la Santé<br />
n°115<br />
La couverture complémentaire maladie<br />
d’entreprise proposée à 72%<br />
<strong>de</strong>s salariés, d’après l’enquête sur la<br />
Protection sociale complémentaire<br />
en entreprise (PSCE), est loin <strong>de</strong> représenter<br />
un bloc uniforme. De multiples<br />
offres existent : contrats obligatoires<br />
proposés à tous les salariés<br />
ou à une partie d’entre eux, contrats<br />
à souscription facultative avec ou<br />
sans options... Ces offres ne sont pas<br />
toutes exposées au même <strong>de</strong>gré <strong>de</strong><br />
risque d’antisélection qui reflète le<br />
comportement <strong>de</strong> jeunes en bonne<br />
santé qui préfèrent ne pas s’assurer,<br />
le financement du risque maladie<br />
étant alors reporté sur ceux en mauvaise<br />
santé. D’après l’enquête, les assureurs<br />
se protègent <strong>de</strong> ce risque en<br />
proposant en gran<strong>de</strong> majorité <strong>de</strong>s<br />
contrats collectifs obligatoires ou <strong>de</strong>s<br />
?<br />
23<br />
contrats facultatifs à options. Les contrats<br />
facultatifs sans option qui sont les plus<br />
exposés à ce risque, concernent à peine<br />
15% <strong>de</strong>s salariés. Dans ce cas, <strong>de</strong>s majorations<br />
<strong>de</strong> cotisations peuvent être<br />
prévues pour les salariés qui reportent<br />
la souscription du contrat.<br />
Contrats collectifs obligatoires et contrats<br />
facultatifs n’offrent pas les mêmes intérêts.<br />
Les premiers, non soumis à l’antisélection<br />
et qui cumulent une série<br />
d’avantages en termes <strong>de</strong> coûts, proposent<br />
<strong>de</strong>s niveaux <strong>de</strong> garanties en<br />
moyenne plus élevés. Les seconds laissent<br />
plus <strong>de</strong> liberté, notamment celle<br />
<strong>de</strong> souscription, et semblent, dans le<br />
secteur <strong>de</strong>s services, plus souvent proposés<br />
par <strong>de</strong>s entreprises qui délèguent<br />
la gestion du contrat aux salariés.<br />
Pour comman<strong>de</strong>r cette synthèse : http://<br />
www.ir<strong>de</strong>s.fr/Diff/bdc/rapO6/qes115.htm<br />
Pour s’abonner aux bulletins d’information « Questions<br />
d’économie <strong>de</strong> la santé » http://www.ir<strong>de</strong>s.fr/<br />
Diff/bdc/abont/abon_qes.htm<br />
A noter que ce document est téléchargeable gratuitement<br />
sur le site internet www.ir<strong>de</strong>s.fr<br />
A la rencontre <strong>de</strong> l’éthique<br />
Gui<strong>de</strong> pratique <strong>de</strong>s textes <strong>de</strong><br />
référence<br />
Les fon<strong>de</strong>ments du<br />
questionnement éthique<br />
0. Paycheng, S. Szerman<br />
2 ème édition révisée et augmentée<br />
Préface <strong>de</strong> René Schærer<br />
Heures <strong>de</strong> France, 34 €<br />
Cet ouvrage propose un ensemble <strong>de</strong><br />
textes dont la consultation est nécessaire<br />
lorsqu’on se trouve confronté à<br />
un questionnement éthique que ce soit<br />
dans l’exercice <strong>de</strong> sa profession médicale<br />
ou sur un plan personnel ou familial.<br />
La première partie est constituée<br />
<strong>de</strong> textes <strong>de</strong> références fondamentaux,<br />
pouvant être utilisés pour un questionnement<br />
éthique, ayant trois origines :<br />
- textes français : le questionnement<br />
ethique doit s’appuyer sur les lois, les<br />
déclarations, les co<strong>de</strong>s <strong>de</strong> déontologie,<br />
les chartes... élaborés par la France ;<br />
- textes européens : la France étant l’un<br />
<strong>de</strong>s vingt cinq pays <strong>de</strong> l’Union Européenne,<br />
il est important <strong>de</strong> prendre en<br />
compte <strong>de</strong>s textes élaborés par <strong>de</strong>s instances<br />
européennes: Parlement européen,<br />
Conseil <strong>de</strong> l’Europe.<br />
- textes internationaux : la France ayant<br />
ratifié certaines conventions élaborées<br />
par <strong>de</strong>s instances internationales, ces<br />
conventions doivent donc être intégrées<br />
Ces textes sont classés selon quatre<br />
repères : juridiques, déontologiques,<br />
chartes-recommandations et moraux<br />
(philisophiques et religieux).<br />
Des explications sur ces repères sont<br />
données en introduction aux différents<br />
chapitres. La <strong>de</strong>uxième partie est constituée<br />
<strong>de</strong> textes <strong>de</strong> références propres à<br />
certains problèmes éthiques. Pour<br />
chacun <strong>de</strong> ces problèmes on trouve le<br />
classement <strong>de</strong>s textes <strong>de</strong> référence fondamentaux<br />
en lien avec le problème<br />
étudié ; <strong>de</strong>s textes spécifiques ; <strong>de</strong>s notions<br />
philosophiques. En fin d’ouvrage,<br />
un in<strong>de</strong>x <strong>de</strong>s textes classés par nature<br />
et par date <strong>de</strong> publication permet <strong>de</strong><br />
trouver facilement les repères recherchés.<br />
La métho<strong>de</strong> expérimentale<br />
selon Aristote<br />
Reconstruction doctrinale <strong>de</strong><br />
l’épistémologie aristotélicienne<br />
Michel Siggen<br />
L’Harmattan, 22 €<br />
Ce livre met en évi<strong>de</strong>nce la dépendance<br />
<strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à l’égard <strong>de</strong><br />
l’objet atteint dans chacune <strong>de</strong>s sciences.<br />
Ce n’est pas un simple commentaire<br />
<strong>de</strong>s textes aristotéliciens sur l’expérience.<br />
L’auteur vise plutôt une reconstruction<br />
doctrinale <strong>de</strong> l’épistémologie d’Aristote,<br />
qui va jusqu’à considérer la dimension<br />
sapientielle <strong>de</strong> tout l’ordre <strong>de</strong> la connaissance<br />
et ce, <strong>de</strong> la dialectique à la métaphysique<br />
en passant par la physique<br />
et la morale.
24<br />
LIVRES ET REVUES<br />
Effets <strong>de</strong> la violence politique<br />
D’une génération à l’autre<br />
Mémoires 2006 n°34<br />
Revue trimestrielle d’information <strong>de</strong><br />
l’Association Primo Levi, 5 €<br />
Ce numéro montre que dans la transmission<br />
<strong>de</strong>s parents à leurs enfants, il<br />
s’agit <strong>de</strong> dire quelque chose <strong>de</strong> ce double<br />
<strong>de</strong>stin <strong>de</strong> victime et <strong>de</strong> survivant porteur<br />
toujours d’histoires intriquées et <strong>de</strong><br />
sentiments paradoxaux, voire contradictoires.<br />
La carence <strong>de</strong>s soins appropriés pour<br />
les personnes qui ont été victimes <strong>de</strong><br />
la violence politique a <strong>de</strong>s conséquences<br />
sur plusieurs générations. La question<br />
<strong>de</strong> la transmission sera l’un <strong>de</strong>s thèmes<br />
du prochain colloque proposé par l’Association<br />
Primo Levi et coordonné par<br />
Béatrice Patsali<strong>de</strong>s et Armando Cote,<br />
psychologues cliniciens dans l’équipe<br />
<strong>de</strong> soins.<br />
Les idéalistes passionnés<br />
Maurice Di<strong>de</strong><br />
Préface <strong>de</strong> Caroline Mangin-<br />
Lazarus<br />
Editions Frison-Roche<br />
La réédition attendue <strong>de</strong>s Idéalistes passionnés<br />
<strong>de</strong> Maurice Di<strong>de</strong> est préfacée<br />
<strong>de</strong> façon documentée par Caroline Mangin-Lazarus,<br />
auteur <strong>de</strong> la biographie <strong>de</strong><br />
Maurice Di<strong>de</strong> (Un psychiatre et la Guerre,<br />
Erès, 1994). Elle rappelle la carrière et<br />
l’œuvre <strong>de</strong> Di<strong>de</strong> et établit le rôle du résistant.<br />
Elle relate, également, la discussion<br />
autour <strong>de</strong> l’idéalisme passionné<br />
Directeur <strong>de</strong> la rédaction :<br />
Gérard Massé<br />
Rédacteur en chef : François Caroli<br />
Comité <strong>de</strong> rédaction : Centre Hospitalier<br />
Sainte-Anne, 1 rue Cabanis, 75014 Paris.<br />
Tél. 01 45 65 83 09.<br />
Botbol M., Carrière Ph., Dalle B., Goutal M.,<br />
Guedj M.-J., Jonas C., Lascar Ph., Martin A.,<br />
Paradas Ch., Sarfati Y., Spadone C.,<br />
Tribolet S., Weill M.<br />
Comité scientifique : Bailly-Salin P.<br />
(Paris), Besançon G. (Nantes), Bourgeois<br />
M. (Bor<strong>de</strong>aux), Buisson G. (Paris), Caillard<br />
V. (Caen), Chabannes J.-P. (Grenoble),<br />
Chaigneau H. (Paris), Christoforov B.<br />
(Paris), Colonna L. (Rouen), Cornillot P.<br />
(Paris), Dufour H. (Genève), Dugas M.<br />
(Paris), Féline A. (Paris), Ginestet D.<br />
(Paris), Guelfi J.-D. (Paris), Guyotat J.<br />
(Lyon), Hochmann J. (Lyon), Koupernik<br />
C. (Paris), Lambert P. (Chambéry), Loo H.<br />
(Paris), Marcelli D. (Poitiers), Marie-<br />
Cardine M. (Lyon), Mises R. (Paris),<br />
Pequignot H. (Paris), Planta<strong>de</strong> A. (Paris),<br />
Ropert R. (Paris), Samuel-Lajeunesse B.<br />
(Paris), Scotto J.-C. (Marseille), Sechter D.<br />
(Lille), Singer L. (Strasbourg), Viallard A.<br />
(Paris), Zarifian E. (Caen).<br />
Comité francophone : Anseau M.<br />
(Belgique), Aubut J. (Canada), Bakiri M.-A.<br />
(Algérie), Cassan Ph. (Canada), Douki S.<br />
(Tunis), Held T. (Allemagne), Lalon<strong>de</strong> P.<br />
(Canada), Moussaoui D. (Maroc), Romila A.<br />
(Roumanie), Simon Y.-F. (Belgique), Stip E.<br />
(Canada), Touari M. (Algérie).<br />
Publicité<br />
médical<br />
SUPPORTER<br />
promotion<br />
Renata Laska - Susie Caron,<br />
54, bd Latour-Maubourg, 75007 Paris.<br />
Tél. 01 45 50 23 08.<br />
Télécopie : 01 45 55 60 80<br />
E-mail : info@nervure-psy.com<br />
Edité par Maxmed<br />
S.A. au capital <strong>de</strong> 40 000 €<br />
54, bd Latour-Maubourg, 75007 Paris<br />
Maquette : Maëval. Imprimerie Fabrègue<br />
Directeur <strong>de</strong> la Publication :<br />
G. Massé<br />
www.nervure-psy.com<br />
parmi les psychiatres qui n’ont pas toujours<br />
su reconnaître la portée mortifère<br />
<strong>de</strong> la notion dans la sphère historique.<br />
C. Magnani-Lazarus explique leur silence<br />
après la guerre sur la notion d’idéalisme<br />
passionné et le fait qu’ils n’aient<br />
pas porté plus tôt l’ouvrage et l’œuvre<br />
à la connaissance d’un public pourtant<br />
préoccupé <strong>de</strong> comprendre les racines<br />
du nazisme. Di<strong>de</strong> en avait pourtant démontré<br />
les dangers dès 1935.<br />
Rééditer Les idéalistes passionnés, permet<br />
<strong>de</strong> faire connaître aussi Maurice<br />
Di<strong>de</strong> et l’idéalisme passionné. C’est aussi<br />
montrer comment cette ignorance <strong>de</strong><br />
Di<strong>de</strong> et <strong>de</strong> l’idéalisme passionné s’est<br />
habillée <strong>de</strong> l’étoffe même <strong>de</strong> cet idéalisme<br />
qui travestit et passionne le réel<br />
<strong>de</strong> l’Histoire, et que Di<strong>de</strong> a décelé dès<br />
1913. Ce n’est qu’avec le rapprochement<br />
entre l’ouvrage et la mort comme<br />
résistant à Buchenwald en 1944, qu’on<br />
peut reconnaître la pertinence <strong>de</strong> sa<br />
peinture, mais surtout la portée mortifère<br />
<strong>de</strong> cette passion que son auteur<br />
avait stigmatisée avant qu’elle ne s’incarne<br />
dans les <strong>de</strong>ux guerres mondiales.<br />
Après sa <strong>de</strong>scription en 1913, l’idéalisme<br />
passionné avait été consacré par<br />
la psychiatrie française du côté <strong>de</strong> l’amour<br />
et du platonisme, comme un sentimentalisme<br />
éthéré à moquer plutôt qu’à<br />
redouter. Pourtant, dans cet ouvrage,<br />
c’est une proie nouvelle <strong>de</strong> la haine<br />
dans la pathologie contemporaine que<br />
Di<strong>de</strong> a examinée. Il y dépeint une fresque<br />
shakespearienne d’hommes comme<br />
Calvin, Torquemada, Tolstoï, et Robespierre,<br />
ou <strong>de</strong> saints comme François<br />
d’Assise et Thérèse d’Avila. Dans le rapport<br />
passionné <strong>de</strong> ces hommes et ces<br />
femmes à leurs objets idéaux, et dans<br />
la fixité <strong>de</strong> l’attachement à leur cause,<br />
Di<strong>de</strong> a décelé une pathologie affective<br />
qu’il baptise du terme d’idéalisme pas-<br />
N°9 - TOME XIX - DÉCEMBRE 2006/JANVIER 2007<br />
sionné : <strong>de</strong> l’amour (<strong>de</strong>s femmes, <strong>de</strong>s<br />
mystiques), <strong>de</strong> la bonté (<strong>de</strong>s réformistes<br />
religieux ou mystiques), et <strong>de</strong> la beauté<br />
et <strong>de</strong> la justice aboutissant à la cruauté<br />
(<strong>de</strong>s esthètes et <strong>de</strong>s réformistes politiques).<br />
L’éditeur a complété cette réédition<br />
d’une iconographie photographique<br />
qui ne figurait pas dans l’ouvrage<br />
initial. C’est un choix fait parmi les personnages,<br />
qui donne une idée <strong>de</strong> l’iconographie<br />
dont pouvait disposer Maurice<br />
Di<strong>de</strong> à l’époque, et qui ouvre une<br />
réflexion sur le portrait, la mise en scène<br />
<strong>de</strong>s personnages et les débuts <strong>de</strong> la<br />
photographie.