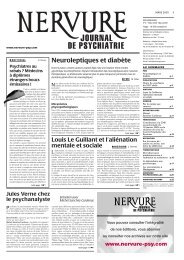Avril - Nervure Journal de Psychiatrie
Avril - Nervure Journal de Psychiatrie
Avril - Nervure Journal de Psychiatrie
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
www.nervure-psy.com<br />
EDITORIAL G. Massé<br />
Proposition<br />
sémiotique d’une<br />
approche <strong>de</strong>s<br />
pratiques<br />
professionnelles<br />
Jean-Michel Wirotius est mé<strong>de</strong>cinchef<br />
du service <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine<br />
physique et <strong>de</strong> réadaptation<br />
du Centre Hospitalier <strong>de</strong><br />
Brive. Il vient <strong>de</strong> soutenir<br />
une thèse <strong>de</strong><br />
Doctorat <strong>de</strong> l’Université<br />
<strong>de</strong> Limoges dont<br />
le titre est « Approche<br />
sémiotique <strong>de</strong>s pratiques professionnelles<br />
en mé<strong>de</strong>cine physique<br />
et <strong>de</strong> réadaptation. La question du sens en rééducation<br />
fonctionnelle ».<br />
Ce travail qui s’inscrit dans la démarche <strong>de</strong><br />
l’équipe du Centre <strong>de</strong> Recherches Sémiotiques<br />
(CeReS) du Département <strong>de</strong>s Sciences du langage<br />
<strong>de</strong> l’Université <strong>de</strong> Limoges, présente un<br />
intérêt certain en psychiatrie du fait <strong>de</strong> ses<br />
applications possibles.<br />
Pour Jean-Michel Wirotius la question du sens<br />
en réadaptation médicale est une dimension <strong>de</strong><br />
la vie professionnelle mais aussi sociale qui<br />
reste encore « à construire, à éclairer, à mettre<br />
en mots ». La clinique médicale n’est pas pertinente<br />
pour l’analyse fonctionnelle en rééducation.<br />
Elle réalise, par exemple, <strong>de</strong>ux réductions<br />
: un signe est présent ou absent, seuls<br />
les symptômes utiles pour le repérage diagnostique<br />
sont pris en compte. Si l’évaluation<br />
analytique apparaît importante pour toute spécialité<br />
médicale en quête <strong>de</strong> quantification,<br />
elle peut masquer l’essentiel <strong>de</strong>s significations.<br />
Alors que les altérations fonctionnelles incluent,<br />
notamment, les fonctions cognitives, émotionnelles,<br />
sensorielles, ces désordres se combinant,<br />
la présence au mon<strong>de</strong> si importante à<br />
prendre en compte est déterminée, en partie,<br />
par le respect ou non <strong>de</strong>s normes sociales qui<br />
fon<strong>de</strong>nt la régulation <strong>de</strong> la communication.<br />
Enfin ce qui est appelé ici « thymie » concerne<br />
l’émotionnel car élaborer un processus <strong>de</strong> <strong>de</strong>uil<br />
face à <strong>de</strong>s pertes fonctionnelles ou symboliques<br />
essentielles s’impose comme difficile,<br />
douloureux et long.<br />
(suite page 4 )<br />
Nicolas Guéguen est professeur <strong>de</strong> psychologie sociale<br />
cognitive à l’université <strong>de</strong> Bretagne-Sud et directeur<br />
d’un laboratoire en sciences du comportement et <strong>de</strong><br />
la cognition <strong>de</strong> cette même université. Ses recherches<br />
et ses enseignements portent, essentiellement, sur<br />
l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s processus d’influence du comportement<br />
humain. A ce titre, une place importante est donnée<br />
aux techniques d’influence du comportement<br />
du consommateur notamment en ce qui concerne les<br />
variables d’atmosphère <strong>de</strong> magasins (musique, o<strong>de</strong>urs,<br />
lumières…) ou du comportement non-verbal du personnel<br />
<strong>de</strong> vente (toucher, sourire…). Son approche<br />
méthodologique se caractéristique par une part importante<br />
<strong>de</strong> recherches en situation réelle <strong>de</strong> vente :<br />
magasins bars, restaurants…<br />
Nicolas Guéguen vient <strong>de</strong> publier 100 petites expériences<br />
en psychologie du consommateur, chez Dunod.<br />
Michel Sanchez-Car<strong>de</strong>nas : Vous avez un trajet personnel<br />
alimenté <strong>de</strong> sources variées : statisticien, ingénieur<br />
L’accueil <strong>de</strong>s agresseurs<br />
La loi du 17.06.1998 impose les soins dans le sens<br />
<strong>de</strong> l’implication du sujet sous main <strong>de</strong> justice dans<br />
une démarche thérapeutique et <strong>de</strong> prévention <strong>de</strong> la<br />
récidive.<br />
Cependant, si la société s’autorise le droit <strong>de</strong> regard<br />
sur la relation <strong>de</strong> ces sujets avec leurs thérapeutes, c’est<br />
dans le respect <strong>de</strong> la charte du patient que cela s’effectue,<br />
car le sujet gar<strong>de</strong> le choix <strong>de</strong> son mé<strong>de</strong>cin<br />
traitant et le secret <strong>de</strong> son suivi médical.<br />
Accueillir le justiciable, le mettre en confiance et sans<br />
à priori, reste un moment déterminant pour établir un<br />
contrat <strong>de</strong> soins et anticiper une prise en charge ultérieure<br />
<strong>de</strong> qualité dans le respect <strong>de</strong> l’obligation <strong>de</strong><br />
soins comme cadre légal qui structure, <strong>de</strong> bout en<br />
bout, la relation soignant-soigné.<br />
Ainsi, une authentique relation thérapeutique peut<br />
s’établir et conduire à une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> traitement<br />
même <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s patients ayant une structure<br />
perverse.<br />
C’est dans cet esprit que la loi Guigou fut promulguée,<br />
Opicinus <strong>de</strong> Canistris<br />
Si l’on se fie à la floraison d’articles et d’étu<strong>de</strong>s<br />
consacrés à ce mystérieux copiste médiéval récemment<br />
publiés dans le mon<strong>de</strong> entier, Opicinus <strong>de</strong><br />
Canistris et ses oeuvres sortent enfin d’un long purgatoire,<br />
lequel avait lui-même succédé à d’interminables<br />
siècles d’oubli. Jusqu’au début du XXe siècle en<br />
effet, le nom d’Opicinus <strong>de</strong> Canistris était inconnu.<br />
Parfois quelques rares initiés s’enhardissaient jusqu’à<br />
parler d’un Anonymus ticinensis (l’inconnu <strong>de</strong>s bords<br />
du Tessin), mais sans réussir à mettre un nom au bas<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ouvrages à la paternité problématique, répertoriés<br />
au XVIIIe siècle dans la Bibliothèque apostolique<br />
vaticane : le De preeminentia Spiritualis imperii (sur la<br />
Primauté du pouvoir spirituel) et le De laudibus Papiae<br />
(Eloge <strong>de</strong> la cité <strong>de</strong> Pavie), écrits aux alentours <strong>de</strong><br />
1330.<br />
Il fallut la découverte par F. Saxl, en 1913, au sein <strong>de</strong>s<br />
trésors cachés <strong>de</strong> la Bibliothèque vaticane, d’un recueil<br />
<strong>de</strong> cinquante <strong>de</strong>ux planches sur parchemin (le co<strong>de</strong>x<br />
Pat. lat. 1993) pour que soit i<strong>de</strong>ntifié Opicinus <strong>de</strong><br />
Canistris, clerc pavesan, à ses heures enlumineur émi-<br />
La psychologie du consommateur<br />
Entretien avec Nicolas Guéguen<br />
FMC M. Hajbi<br />
sexuels en C.M.P.<br />
L’évaluation : un outil clinique à la portée <strong>de</strong>s<br />
soignants<br />
en informatique, vous vous êtes orienté vers la psychologie<br />
cognitive et plus particulièrement vers l’étu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s processus expliquant les processus d’achat, <strong>de</strong> séduction...<br />
Comment en êtes-vous arrivé là ?<br />
Nicolas Gueguen : A l’origine, mon intérêt pour la<br />
cognition vient <strong>de</strong> sa filiation avec certains domaines<br />
<strong>de</strong> l’informatique qui me plaisaient comme la logique<br />
formelle, l’intelligence artificielle… J’ai donc fait un<br />
double cursus <strong>de</strong> formation universitaire. J’ai eu la<br />
chance <strong>de</strong> rencontrer un enseignant-chercheur en<br />
psychologie sociale remarquable ce qui a eu pour<br />
effet <strong>de</strong> susciter mon intérêt pour la discipline. Par la<br />
suite, j’ai fait une thèse en psychologie sociale sur<br />
un thème qui n’a rien à voir avec les processus d’influence<br />
du comportement puisque cela portait sur le<br />
jugement d’autrui. Ce qui a déclenché mon intérêt<br />
pour les processus d’influence et <strong>de</strong> manipulation<br />
du comportement est le Petit traité <strong>de</strong> manipulation à<br />
(suite page 9 )<br />
afin d’harmoniser la répression judiciaire et le bénéfice<br />
<strong>de</strong> traitement selon <strong>de</strong>s conditions éthiques acceptables<br />
(Balier, Ciavaldini, 2000).<br />
Il est vrai que les pathologies inhérentes aux agressions<br />
sexuelles ont la réputation d’être inaccessibles (Balier,<br />
2000). En effet, <strong>de</strong>puis sa <strong>de</strong>scription et sa classification<br />
en actes délictuels dans le champ médico-légal,<br />
la perversion comme entité clinique soulève les passions<br />
ou, au contraire, suscite la répulsion (Bloch,<br />
1999). Elle se voit l’objet <strong>de</strong> controverses ou <strong>de</strong><br />
remises en question quand elle surgit dans le cadre<br />
d’une pathologie avec passages à l’acte spécifiques<br />
(Zagury, 1996), notamment dès qu’il s’agit <strong>de</strong> problématiques<br />
<strong>de</strong> violences ou <strong>de</strong> troubles sexuels chez<br />
<strong>de</strong>s jeunes patients (Dembri et coll, 2004).<br />
Il faut savoir débusquer, <strong>de</strong>rrière les masques <strong>de</strong> la perversion<br />
(la simulation, la manipulation, l’emprise, le<br />
défi, le déni), la souffrance <strong>de</strong> l’agresseur avec une<br />
métho<strong>de</strong> d’investigation à la fois neutre et modérément<br />
incisive.<br />
(suite page 4 )<br />
gré en Avignon et qu’il soit, enfin, désigné comme<br />
l’auteur <strong>de</strong> ces trois oeuvres grâce à la perspicacité <strong>de</strong><br />
l’abbé Gianani.<br />
Cette avancée notoire n’allait, toutefois, pas abolir<br />
incertitu<strong>de</strong>s et interrogations, car cet ensemble original<br />
et unique au mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> planches inhabituellement<br />
<strong>de</strong>ssinées recto-verso <strong>de</strong>meurait entouré d’un<br />
halo énigmatique. S’il suscitait à juste titre, dans les<br />
milieux concernés, un mouvement <strong>de</strong> satisfaction et<br />
un élan <strong>de</strong> curiosité, il ne tardait pas, non plus, à soulever<br />
doutes et à entretenir questionnements d’une<br />
autre nature.<br />
L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> ces planches fut notamment menée par<br />
Richard G. Salomon, un érudit germanique à la colossale<br />
érudition qui, pour l’occasion secondé par un<br />
historien d’Art, A. Heimann, se livra longuement à <strong>de</strong><br />
savantes et minutieuses investigations, lesquelles le<br />
conduisirent à douter <strong>de</strong> l’équilibre psychique du<br />
prêtre lombard.<br />
La publication, en 1936, <strong>de</strong> Conception du Mon<strong>de</strong> et<br />
Supplément à NERVURE - <strong>Journal</strong> <strong>de</strong> <strong>Psychiatrie</strong> - Tome XIX - n°4 - Mai 2006<br />
(Ne peut être vendu séparément)<br />
HISTOIRE G. Roux<br />
(suite page 6 )<br />
AVRIL 2006 1<br />
ISSN 0988-4068<br />
n°3 - Tome XIX - 04/2006<br />
Tirage : 10 000 exemplaires<br />
Directeur <strong>de</strong> la Publication et <strong>de</strong> la<br />
Rédaction : G. Massé<br />
Rédacteur en chef : F. Caroli<br />
Rédaction : Hôpital Sainte-Anne,<br />
1 rue Cabanis - 75014 Paris<br />
Tél. 01 45 65 83 09 - Fax 01 45 65 87 40<br />
Abonnements :<br />
54 bd La Tour Maubourg - 75007 Paris<br />
Tél. 01 45 50 23 08 - Fax 01 45 55 60 80<br />
Prix au numéro : 9,15 €<br />
E-mail : info@nervure-psy.com<br />
AU SOMMAIRE<br />
EDITORIAL<br />
Proposition sémiotique<br />
d’une approche <strong>de</strong>s<br />
pratiques professionnelles p.1<br />
FMC<br />
L’accueil <strong>de</strong>s agresseurs<br />
sexuels en CMP p.4<br />
HISTOIRE<br />
Opicinus <strong>de</strong> Canistris p.6<br />
ENTRETIEN AVEC<br />
Nicolas Guéguen<br />
La psychologie<br />
du consommateur p.9<br />
AUTRES CULTURES<br />
L’amer du Japon p.11<br />
ORGANISATION DES SOINS<br />
Le système <strong>de</strong> réadaptation<br />
au Québec : naviguer<br />
dans l’ambiguïté ? p.13<br />
PSYCHOGÉRIATRIE<br />
Regards sur la dépression<br />
du sujet âgé p.16<br />
ANNONCES<br />
PROFESSIONNELLES p.17<br />
ANNONCES EN BREF p.18<br />
6 QUESTIONS À R. DARDENNES<br />
Troubles bipolaires :<br />
comment améliorer<br />
le fonctionnement<br />
au quotidien p.19<br />
« PSYCHOSE ET<br />
GROSSESSE »<br />
Ce dossier interdisciplinaire<br />
qui porte un regard<br />
exhaustif, sera publié dans<br />
le numéro <strong>de</strong> mai 2006<br />
<strong>de</strong> la Revue,<br />
supplément du <strong>Journal</strong><br />
adressé aux abonnés.
N°3 - TOME XIX - AVRIL 2006<br />
LIVRES<br />
Gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> la pratique<br />
psychiatrique en milieu<br />
pénitentiaire<br />
Coordonné par Laurent Michel et<br />
Betty Brahmy<br />
Editions Heures <strong>de</strong> France, 48 €<br />
Laurent Michel et Berry Brahmy ont décidé<br />
<strong>de</strong> coordonner un « gui<strong>de</strong> » <strong>de</strong> la<br />
pratique psychiatrique en milieu pénitentiaire<br />
pour <strong>de</strong>s raisons qui peuvent<br />
paraître évi<strong>de</strong>ntes : la psychiatrie carcérale<br />
semble souvent mystérieuse,<br />
spécifique, <strong>de</strong>vant s’exercer dans un milieu<br />
qui est jugé répressif et souvent inconciliable<br />
avec les visées thérapeutiques<br />
<strong>de</strong> soignants. Pour qu’elle soit<br />
moins énigmatique, les auteurs rappellent<br />
les textes <strong>de</strong> loi ou les recommandations<br />
du <strong>de</strong>rnier gui<strong>de</strong> méthodologique<br />
en les commentant et en les<br />
confrontant à leur pratique. Ils sont, pour<br />
la plupart d’entre eux, <strong>de</strong>s soignants<br />
(mé<strong>de</strong>cins, psychologues, cadres, infirmiers),<br />
<strong>de</strong>s directeurs <strong>de</strong> soins infirmiers,<br />
<strong>de</strong>s travailleurs sociaux, <strong>de</strong>s intervenants<br />
dans le milieu pénitentiaire<br />
(directeur, aumônier) et <strong>de</strong>s magistrats.<br />
Ils savent distinguer ce qui est possible<br />
<strong>de</strong> faire <strong>de</strong> ce qui ne l’est pas et ils argumentent<br />
toujours avec nuance et précision.<br />
Leur souci principal est éthique<br />
et la déontologie est ce qui prési<strong>de</strong> à<br />
leurs écrits. Dépassant les querelles d’école<br />
et les divergences <strong>de</strong>s pratiques (qui ne<br />
sont, sans doute, pas aussi fortes qu’on<br />
peut le penser), ils s’efforcent <strong>de</strong> transmettre<br />
leur réflexion et leur expérience<br />
afin que leurs lecteurs puissent être,<br />
comme eux, les garants <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong>s<br />
patients détenus. Ils veulent qu’ils aient :<br />
- un libre accès aux soins dans toutes<br />
les acceptions <strong>de</strong> cette expression et il<br />
ne saurait être question <strong>de</strong> contraindre<br />
qui que ce soit à un traitement au sein<br />
<strong>de</strong>s SMPR (Service Médico-Psychologique<br />
Régional) ou <strong>de</strong>s UCSA (Unité <strong>de</strong><br />
Consultations et <strong>de</strong> Soins Ambulatoires) ;<br />
- <strong>de</strong>s soins <strong>de</strong> qualité pour accompagner,<br />
au mieux, les détenus-patients,<br />
les ai<strong>de</strong>r à réfléchir à la signification <strong>de</strong><br />
leur acte et au sens <strong>de</strong> la peine et<br />
construire, avec eux, un projet <strong>de</strong> vie à<br />
l’intérieur mais aussi à l’extérieur <strong>de</strong> la<br />
prison. Ils souhaitent que le secret<br />
3<br />
professionnel, condition primordiale<br />
pour que les soins soient libres et <strong>de</strong><br />
qualité, soit respecté. Cela implique une<br />
vigilance <strong>de</strong> tous les instants et les auteurs<br />
montrent comment il est sans<br />
cesse menacé et comment il doit être<br />
sans cesse reconquis. Ils réfléchissent<br />
sur la notion <strong>de</strong> secret partagé, passant<br />
en revue les différents interlocuteurs<br />
<strong>de</strong>s soignants, pour indiquer qu’elle n’est<br />
jamais définitive et qu’elle doit être<br />
souvent repensée. « Le gui<strong>de</strong> la pratique<br />
psychiatrique en milieu pénitentiaire », le<br />
premier du genre en langue française,<br />
se veut pratique et son maniement est<br />
aisé. Il est facile, grâce à une table <strong>de</strong>s<br />
matières efficace, <strong>de</strong> se reporter au chapitre<br />
souhaité et les informations qui y<br />
sont données sont toujours claires et<br />
synthétiques. Il est donc un très bon<br />
gui<strong>de</strong>. Mais il n’est pas que cela et certains<br />
<strong>de</strong> ses chapitres sont consacrés<br />
au « cheminement historique <strong>de</strong>s soins<br />
psychiatriques en milieu pénitentiaire »<br />
ou à la « question éthique et aux fon<strong>de</strong>ments<br />
<strong>de</strong> l'exercice en milieu carcéral ».<br />
Un autre chapitre est un témoignage,<br />
sous forme d’interview, du Dr Paul<br />
Hivert, l’un <strong>de</strong>s pionniers <strong>de</strong> la psychiatrie<br />
pénitentiaire. Ainsi, il est surtout<br />
un ouvrage engagé parce que la<br />
réflexion déontologique qui y est développée,<br />
est riche et ouverte : les questions<br />
importent plus que les réponses<br />
car elles conduisent les lecteurs à utiliser<br />
les informations données pour tenter<br />
<strong>de</strong> construire leur propre pratique.<br />
Directeur <strong>de</strong> la rédaction :<br />
Gérard Massé<br />
Rédacteur en chef : François Caroli<br />
Anne Henry<br />
Comité <strong>de</strong> rédaction : Centre Hospitalier<br />
Sainte-Anne, 1 rue Cabanis, 75014 Paris.<br />
Tél. 01 45 65 83 09.<br />
Botbol M., Carrière Ph., Dalle B., Goutal M.,<br />
Guedj M.-J., Jonas C., Lascar Ph., Martin A.,<br />
Paradas Ch., Sarfati Y., Spadone C.,<br />
Tribolet S., Weill M.<br />
Comité scientifique : Bailly-Salin P.<br />
(Paris), Besançon G. (Nantes), Bourgeois<br />
M. (Bor<strong>de</strong>aux), Buisson G. (Paris), Caillard<br />
V. (Caen), Chabannes J.-P. (Grenoble),<br />
Chaigneau H. (Paris), Christoforov B.<br />
(Paris), Colonna L. (Rouen), Cornillot P.<br />
(Paris), Dufour H. (Genève), Dugas M.<br />
(Paris), Féline A. (Paris), Ginestet D.<br />
(Paris), Guelfi J.-D. (Paris), Guyotat J.<br />
(Lyon), Hochmann J. (Lyon), Koupernik<br />
C. (Paris), Lambert P. (Chambéry), Loo H.<br />
(Paris), Marcelli D. (Poitiers), Marie-<br />
Cardine M. (Lyon), Mises R. (Paris),<br />
Pequignot H. (Paris), Planta<strong>de</strong> A. (Paris),<br />
Ropert R. (Paris), Samuel-Lajeunesse B.<br />
(Paris), Scotto J.-C. (Marseille), Sechter D.<br />
(Lille), Singer L. (Strasbourg), Viallard A.<br />
(Paris), Zarifian E. (Caen).<br />
Comité francophone : Anseau M.<br />
(Belgique), Aubut J. (Canada), Bakiri M.-A.<br />
(Algérie), Cassan Ph. (Canada), Douki S.<br />
(Tunis), Held T. (Allemagne), Lalon<strong>de</strong> P.<br />
(Canada), Moussaoui D. (Maroc), Romila A.<br />
(Roumanie), Simon Y.-F. (Belgique), Stip E.<br />
(Canada), Touari M. (Algérie).<br />
Publicité<br />
médical<br />
SUPPORTER<br />
promotion<br />
Renata Laska - Susie Caron,<br />
54, bd Latour-Maubourg, 75007 Paris.<br />
Tél. 01 45 50 23 08.<br />
Télécopie : 01 45 55 60 80<br />
E-mail : info@nervure-psy.com<br />
Edité par Maxmed<br />
S.A. au capital <strong>de</strong> 40 000 €<br />
54, bd Latour-Maubourg, 75007 Paris<br />
Maquette : Maëval. Imprimerie Fabrègue<br />
Directeur <strong>de</strong> la Publication :<br />
G. Massé<br />
www.nervure-psy.com
4<br />
LIVRES<br />
FMC<br />
Quand les corps se<br />
souviennent<br />
Expériences et politiques du sida<br />
en Afrique du Sud<br />
Didier Fassin<br />
La Découverte, 30 €<br />
Avec près <strong>de</strong> six millions <strong>de</strong> personnes<br />
contaminées, l’Afrique du Sud est le<br />
pays le plus gravement affecté par<br />
l’épidémie <strong>de</strong> sida. Elle est aussi le<br />
lieu <strong>de</strong>s débats les plus virulents au<br />
sein <strong>de</strong> la communauté scientifique<br />
internationale sur les causes et les<br />
traitements <strong>de</strong> la maladie, <strong>de</strong>s mobilisations<br />
les plus spectaculaires et<br />
<strong>de</strong>s procès les plus retentissants pour<br />
l’accès aux médicaments. Que ces<br />
faits surviennent dans le contexte <strong>de</strong><br />
l’après-apartheid, où la reconstruction<br />
d’une « nation arc-en-ciel » affranchie<br />
<strong>de</strong>s barrières raciales semblait<br />
enfin possible, entraîne une<br />
dimension particulièrement dramatique.<br />
Après cinq années d’enquête dans<br />
les townships comme dans les milieux<br />
savants et politiques sud-africains,<br />
ce livre retrace les enjeux politiques<br />
d’une crise épidémiologique<br />
qui met en cause les discours <strong>de</strong> la<br />
science autant que la gestion du pouvoir<br />
: il montre, à partir <strong>de</strong>s biographies<br />
<strong>de</strong> mala<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s controverses,<br />
comment l’histoire <strong>de</strong> la colonisation<br />
et <strong>de</strong> la ségrégation <strong>de</strong>meure vivante,<br />
dans les inégalités et les violences,<br />
dans le racisme et les accusations <strong>de</strong><br />
racisme. Le passé est intensément<br />
présent, se dévoilant à travers une<br />
économie <strong>de</strong> la souffrance et du<br />
ressentiment. Il s’agit donc <strong>de</strong> comprendre,<br />
<strong>de</strong> la manière la plus<br />
littérale, comment les corps se souviennent.<br />
Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la singularité<br />
historique <strong>de</strong> l’Afrique du Sud, D.<br />
Fassin propose une réflexion sur la<br />
mémoire <strong>de</strong>s afflictions dans les sociétés<br />
contemporaines et sur l’anesthésie<br />
politique que perpétue notre<br />
indifférence à l’égard <strong>de</strong> ces injustices.<br />
Nos années sida<br />
Vingt-cinq ans <strong>de</strong> guerres<br />
intimes<br />
Eric Favereau<br />
Postface <strong>de</strong> Daniel Defert<br />
La Découverte, 16 €<br />
Eric Favereau retrace l’histoire du sida<br />
<strong>de</strong>puis 25 ans ou plutôt <strong>de</strong> certains<br />
repères importants autour d’entretiens,<br />
certains anciens, d’autres plus<br />
récents, avec un choix, en partie arbitraire,<br />
lié aux amitiés et aux circonstances.<br />
Il y a eu le temps <strong>de</strong>s<br />
pionniers. Comme le montre Françoise<br />
Barré-Sinoussi, la première<br />
femme au mon<strong>de</strong> à avoir décelé la<br />
trace d’un nouveau virus, mais aussi<br />
David Klatzmann, qui explique comment<br />
on lui a volé sa découverte <strong>de</strong><br />
l’action du virus dans le système immunitaire.<br />
Jean-Baptiste Brunet se<br />
souvient du comptage <strong>de</strong>s premiers<br />
mala<strong>de</strong>s. Tout était alors à inventer.<br />
Puis est venu le temps <strong>de</strong> l’élaboration<br />
d’une réponse collective. Daniel<br />
Defert retrace les raisons personnelles<br />
et politiques qui ont présidé à la création<br />
<strong>de</strong> Ai<strong>de</strong>s. Michèle Barzach, alors<br />
ministre <strong>de</strong> la Santé, évoque les blocages<br />
pour faire entrer la sexualité<br />
dans le discours public.<br />
Après ? Ce furent les années sida,<br />
c’est-à-dire le temps compté, celui <strong>de</strong><br />
la résistance. Frédéric E<strong>de</strong>lmann, Anne<br />
Coppel, Elisabeth Da Paz, Didier Lestra<strong>de</strong><br />
détaillent les ressorts intimes<br />
<strong>de</strong> ces années <strong>de</strong> lutte : leurs combats<br />
d’hier, mais aussi leurs craintes<br />
actuelles.<br />
Arnaud et Hugo dialoguent sur ces<br />
journées sans fin <strong>de</strong> l’année 2003 :<br />
l’un <strong>de</strong>vait mourir, l’autre ne voulait<br />
pas. Il y a enfin Peter Piot, responsable<br />
d’Onusida, qui s’interroge. Aurait-on<br />
pu mieux faire ?<br />
<br />
Le premier entretien doit garantir le<br />
maximum <strong>de</strong> conditions pour permettre<br />
au sujet <strong>de</strong> clarifier ses représentations,<br />
d’exprimer sa souffrance<br />
sans être remis en cause ni culpabilisé<br />
et d’être écouté sous forme respectueuse<br />
et non suggestive.<br />
Une écoute empathique est la pierre<br />
angulaire <strong>de</strong> la prise en charge car elle<br />
permet non seulement d'introduire les<br />
soins mais, et surtout, <strong>de</strong> faciliter l’accompagnement<br />
du sujet durant son<br />
parcours pénal et post-pénal. L’évaluation<br />
clinique est indispensable<br />
quelque soit l’origine <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>,<br />
que le sujet pervers se présente spontanément<br />
ou qu’il a été conduit par<br />
son entourage ou adressé par la justice.<br />
Il est important <strong>de</strong> lever l’ambiguïté<br />
entre un service <strong>de</strong> soins et un service<br />
médico-judiciaire par une clarification<br />
<strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s professionnels <strong>de</strong> santé<br />
<strong>de</strong> leur mission et <strong>de</strong> leur champ d’intervention.<br />
Le clinicien doit faciliter l’expression<br />
du sujet, expliquer les objectifs <strong>de</strong> l’examen<br />
clinique, repérer les modalités du<br />
transfert et se référer à la loi comme<br />
cadre <strong>de</strong> référence.<br />
Une prise en charge efficace <strong>de</strong>s agresseurs<br />
sexuels s’appuie, formellement,<br />
sur la connaissance approfondie <strong>de</strong> la<br />
clinique et débute, nécessairement, par<br />
une évaluation précise <strong>de</strong> tous les axes<br />
constitutifs <strong>de</strong> la problématique du<br />
sujet : médical, psychiatrique, psychologique,<br />
social et criminologique (Chiariny,<br />
2001).<br />
Pour cette raison le secteur psychiatrique<br />
présente, à l’image <strong>de</strong>s centres<br />
médicopsychologiques, <strong>de</strong>s atouts<br />
majeurs, à savoir :<br />
- la prise en charge concerne, à une<br />
exception près, <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d'injonctions<br />
thérapeutiques dans divers<br />
champs médico-légaux et psychopathologiques<br />
;<br />
- les secteurs sont habilités à recevoir<br />
toutes les couches sociales aussi bien les<br />
populations démunies que les nanties ;<br />
- l’approche <strong>de</strong> l'environnement affectif<br />
et social du sujet est matériellement<br />
plus accessible, surtout en matière <strong>de</strong><br />
prévention ;<br />
- la présence <strong>de</strong>s équipes multidisciplinaires<br />
permet un étayage global <strong>de</strong> la<br />
problématique du sujet sur les plans<br />
social, psychologique et médical ;<br />
- les stratégies thérapeutiques sont en<br />
conséquences plus diversifiées, notamment<br />
les thérapies <strong>de</strong> groupe, qui restent<br />
le premier choix dans les agressions<br />
sexuelles ;<br />
- l’aménagement possible du temps et<br />
<strong>de</strong> l’espace pour l’accueil <strong>de</strong>s familles<br />
et <strong>de</strong>s victimes ;<br />
- le travail <strong>de</strong> liaison relativement plus<br />
aisé avec les autres équipes <strong>de</strong>s<br />
domaines psychiatriques (pédopsychiatres,<br />
psychothérapeutes), <strong>de</strong>s services<br />
sociaux, pénitentiaires (SMPR :<br />
Service Médico-Pénitentiaire Régional)<br />
et judiciaires (JAP : Juge d'Application<br />
<strong>de</strong>s Peines, Procureur <strong>de</strong> la République,<br />
SPIP : Service Pénitentiaire d'Insertion<br />
et <strong>de</strong> Probation).<br />
Il est nécessaire <strong>de</strong> préciser que ces<br />
avantages vont <strong>de</strong> pair avec la disponibilité<br />
<strong>de</strong>s différents intervenants, leur<br />
formation, l’accès à <strong>de</strong>s connaissances<br />
théoriques diverses, avec la création<br />
<strong>de</strong>s temps médicaux et paramédicaux<br />
et avec l’aménagement <strong>de</strong>s espaces<br />
adaptés pour les thérapies <strong>de</strong>s délinquants,<br />
d’une part, et pour l’accueil <strong>de</strong>s<br />
victimes d’autre part (conférence <strong>de</strong><br />
consensus, 2003).<br />
Modalités d’application<br />
<strong>de</strong> l’obligation <strong>de</strong> soins<br />
au travers du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la<br />
santé publique<br />
L’institution du suivi socio-judiciaire<br />
(S.S.J) ayant comme objectif l’incitation<br />
au suivi médical durant la procédure<br />
judiciaire, lors <strong>de</strong> l’incarcération et au<br />
moment <strong>de</strong> la liberté conditionnelle,<br />
est un <strong>de</strong>s aspects positifs <strong>de</strong> la loi du<br />
17.06.98.<br />
La recherche <strong>de</strong> l’adhésion du sujet à<br />
l’obligation <strong>de</strong> soins est primordiale<br />
(Cordier, 2000) dans l’anticipation <strong>de</strong>s<br />
résultats positifs <strong>de</strong> la psychothérapie.<br />
L’intervention d’un mé<strong>de</strong>cin coordonateur<br />
permet <strong>de</strong> maintenir l’indépendance<br />
du thérapeute vis-à-vis <strong>de</strong> la<br />
justice et <strong>de</strong> respecter le contrat patientsoignant.<br />
Le cadre du déroulement <strong>de</strong> l’obligation<br />
<strong>de</strong> soins est expliqué, par écrit au<br />
sujet, par le conseiller d’insertion et <strong>de</strong><br />
probation (C.I.P).<br />
Le magistrat, en la personne du juge<br />
d’application <strong>de</strong>s peines (J.A.P), déci<strong>de</strong><br />
d’une obligation <strong>de</strong> soins dans le<br />
cadre <strong>de</strong> la procédure judiciaire et le<br />
C.I.P oriente le justiciable vers un mé<strong>de</strong>cin<br />
coordonateur préalablement inscrit<br />
sur une liste établie par le Procureur<br />
<strong>de</strong> la République.<br />
Le mé<strong>de</strong>cin coordonateur désigne, avec<br />
le sujet, un mé<strong>de</strong>cin compétent, en<br />
matière <strong>de</strong> violences sexuelles, lequel<br />
après évaluation propose sous ses auspices<br />
une orientation vers tel ou tel<br />
type <strong>de</strong> thérapie.<br />
Le thérapeute s’engage dans le cadre<br />
du respect <strong>de</strong> la loi et <strong>de</strong> la charte du<br />
patient à effectuer un retour au mé<strong>de</strong>cin<br />
coordonateur.<br />
Le mé<strong>de</strong>cin traitant propose et fixe la<br />
nature du traitement, il peut également<br />
consulter les rapports d'expertises ainsi<br />
que certaines pièces judiciaires.<br />
Il remet au condamné, à intervalles<br />
réguliers, <strong>de</strong>s attestations <strong>de</strong> suivi afin<br />
que ce <strong>de</strong>rnier puisse justifier auprès<br />
du juge <strong>de</strong> l’accomplissement <strong>de</strong>s soins.<br />
En cas d’interruption du traitement, le<br />
mé<strong>de</strong>cin peut avertir le juge ou le service<br />
pénitentiaire d’insertion et <strong>de</strong> probation<br />
(S.P.I.P) et/ou le mé<strong>de</strong>cin coordonateur<br />
sans que puisse lui être<br />
opposée une violation du secret professionnel.<br />
Il est vrai que la justice ne peut remplir<br />
correctement sa mission que si elle est<br />
bien informée par le mé<strong>de</strong>cin du danger<br />
potentiel lié au défaut d’observance<br />
aux soins.<br />
Certains préconisent une procédure<br />
complémentaire d’accès aux soins pour<br />
les personnes en obligation <strong>de</strong> soins.<br />
Cette procédure, défendue par le<br />
réseau <strong>de</strong> promotion santé mentale du<br />
Sud Yvelines (R.P.S.M 78), prévoit la<br />
mise en place d’un « praticien évaluateur<br />
» dont la mission est <strong>de</strong> recevoir le<br />
justiciable, <strong>de</strong> le préparer à l’accès aux<br />
soins et <strong>de</strong> signaler au mé<strong>de</strong>cin coordonnateur<br />
et à la justice la pertinence<br />
ou non d’une telle mesure.<br />
L’évaluateur déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’orientation<br />
thérapeutique et d’un adressage pouvant<br />
impliquer d’autres professionnels<br />
médico-sociaux.<br />
Il dispose d’une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 6 mois (1<br />
à 3 consultations) pour élaborer un<br />
diagnostic, évaluer la pertinence <strong>de</strong> la<br />
démarche, orienter puis adresser le<br />
patient après l’accord écrit <strong>de</strong> celui-ci.<br />
L’évaluateur en informe le S.P.I.P et<br />
transmet, au thérapeute, les informations<br />
utiles au suivi.<br />
L’évaluateur, à priori distinct du dispositif<br />
<strong>de</strong> soins, reprend contact avec les<br />
thérapeutes afin d’évaluer la pertinence<br />
<strong>de</strong> l’orientation.<br />
Le travailleur social (C.I.P) rend compte<br />
aux magistrats <strong>de</strong> l’évolution qu’il<br />
observe dans le comportement et la<br />
situation du sujet.<br />
La finalité <strong>de</strong> l’incitation aux soins est<br />
<strong>de</strong> créer l’émergence <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
et d’ai<strong>de</strong>r le condamné à s’approprier la<br />
démarche afin <strong>de</strong> pouvoir s’investir,<br />
désirer se soigner et libérer sa parole<br />
sans pour autant atténuer la responsabilité<br />
<strong>de</strong> son acte.<br />
Pour optimiser les avantages <strong>de</strong> l’obligation<br />
<strong>de</strong> soins comme repère et cadre<br />
référentiel <strong>de</strong> travail psychothérapeutique<br />
et <strong>de</strong> mentalisation, il est indispensable<br />
<strong>de</strong> lever l’ambiguïté <strong>de</strong><br />
certains <strong>de</strong> ses aspects, à savoir :<br />
- le secret professionnel et les limites<br />
déontologiques : le psychothérapeute,<br />
comme tout citoyen rend <strong>de</strong>s comptes<br />
à la société par le biais <strong>de</strong> la justice. La<br />
mise en place du mé<strong>de</strong>cin coordonateur<br />
ou évaluateur pallie ainsi à cette<br />
difficulté ;<br />
- les objectifs sont différents : la justice<br />
cherche à éviter la récidive et la psychothérapie<br />
espère le mieux être <strong>de</strong><br />
l’individu supposé capable d’intégrer<br />
les frustrations <strong>de</strong> la réalité et <strong>de</strong> redéfinir<br />
un projet <strong>de</strong> vie.<br />
Enfin, par souci <strong>de</strong> pertinence et pour<br />
plus d’efficacité, il est souhaitable que<br />
les cliniciens évaluateurs et psychothérapeutes<br />
puissent communiquer entre<br />
eux et avec les différents intervenants,<br />
disposer d’un minimum d’éléments<br />
judiciaires (procès verbaux <strong>de</strong>s victimes<br />
et <strong>de</strong> l’accusé ainsi que <strong>de</strong>s expertises<br />
psychiatriques et psychologiques).<br />
Il faut interpréter l’obligation <strong>de</strong> soins<br />
comme un traitement psychosocial et<br />
sortir <strong>de</strong>s sentiers battus du cadre rigi<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s pratiques et <strong>de</strong>s clivages théoriques,<br />
conceptuels et institutionnels.<br />
Un traitement psychosocial suppose<br />
<strong>de</strong>s échanges entre psychiatres, magistrats,<br />
pénitentiaires, politiques, ainsi<br />
qu’une complémentarité <strong>de</strong>s pratiques<br />
<strong>de</strong> terrain <strong>de</strong>s disciplines différentes<br />
(Coutanceau, 1997).<br />
L’exercice <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong> traitement<br />
auprès <strong>de</strong>s agresseurs sexuels et <strong>de</strong>s<br />
sujets violents incite les thérapeutes à<br />
solliciter directement, ce qui est recouvert<br />
par le déni <strong>de</strong> la réalité et le clivage.<br />
Il s’agit d’une démarche active<br />
d’étayage qui nécessite les adaptations<br />
organisationnelles loin du colloque singulier<br />
classique, mé<strong>de</strong>cin-mala<strong>de</strong>.<br />
L’évaluation préthérapeutique<br />
proprement dite<br />
Les items proposés ci-<strong>de</strong>ssous ont été<br />
sélectionnés, <strong>de</strong> manière empirique, à<br />
partir <strong>de</strong> l’expérience clinique au centre<br />
médico-psychologique, d’une certaine<br />
pratique <strong>de</strong> l’expertise clinique et <strong>de</strong>s<br />
thérapies <strong>de</strong> groupe auprès <strong>de</strong>s agresseurs<br />
sexuels à l’antenne médico-légale<br />
<strong>de</strong> La Garenne Colombes et à partir<br />
<strong>de</strong> la littérature scientifique relative à la<br />
perpétuation future d’actes <strong>de</strong> violences<br />
sexuelles : Balier, Ciavaldini, Girard-<br />
Khayat (1996) et Cornet, Glovannangeli,<br />
Mormont (2003) entre autres.<br />
Ces items permettent <strong>de</strong> couvrir divers<br />
domaines importants pour l’évaluation<br />
clinique pré et post thérapeutique, ils<br />
sont <strong>de</strong>stinés à faciliter la collecte <strong>de</strong>s<br />
données pour que tout clinicien, mé<strong>de</strong>cin<br />
comme psychologue ou infirmier,<br />
puisse s’en saisir, que ce soit dans le<br />
cadre d’une activité clinique, d’expertise<br />
N°3 - TOME XIX - AVRIL 2006<br />
L’accueil <strong>de</strong>s agresseurs sexuels<br />
en C.M.P.<br />
La répartition <strong>de</strong>s attentes <strong>de</strong> la personne<br />
et <strong>de</strong> ses proches entre les<br />
mécanismes <strong>de</strong> récupération et <strong>de</strong><br />
compensation dépend <strong>de</strong> leur niveau<br />
<strong>de</strong> connaissance et donc <strong>de</strong> perception<br />
<strong>de</strong>s soins proposés. Quant à l’acceptabilité<br />
du sujet par l’équipe, elle<br />
s’impose toujours comme une donnée<br />
centrale.<br />
Jean-Michel Wirotius propose une<br />
approche sémiotique autour <strong>de</strong> pratiques,<br />
<strong>de</strong> situations, <strong>de</strong> stratégies <strong>de</strong><br />
programmation et d’ajustement, <strong>de</strong><br />
formes <strong>de</strong> vies rencontrées dans la<br />
pratique <strong>de</strong> soin. L’objectif est <strong>de</strong><br />
dépasser <strong>de</strong>s aspects <strong>de</strong> surface qui<br />
sont médicaux, sociaux, institutionnels<br />
pour tenter <strong>de</strong> repérer ce qui<br />
est signifiant et porteur <strong>de</strong> valeurs.<br />
La légitimité scientifique d’une sémio-<br />
ou <strong>de</strong> recherche. Les objectifs thérapeutiques<br />
<strong>de</strong> l’évaluation clinique<br />
consistent à i<strong>de</strong>ntifier les déficits spécifiquement<br />
liés à la délinquance sexuelle<br />
et les déficits non spécifiques et à<br />
proposer un plan <strong>de</strong> suivi adapté à ces<br />
déficits et aux capacités du patient.<br />
Cette première évaluation apparaît<br />
nécessaire à la connaissance du sujet, à<br />
son orientation à visée thérapeutique et<br />
à son accompagnement le long <strong>de</strong>s<br />
processus judiciaire et psychothérapeutique.<br />
Les évaluations ultérieures, dites <strong>de</strong><br />
suivi ou <strong>de</strong> contrôle, permettraient <strong>de</strong><br />
ponctuer le temps pénal ou post-pénal,<br />
elles s’intéresseraient aux changements<br />
<strong>de</strong>s positions conscientes et inconscientes<br />
concernant le passage à l’acte.<br />
Ainsi, pour définir le profil psychologique<br />
<strong>de</strong>s délinquants sexuels et <strong>de</strong>s<br />
sujets violents, <strong>de</strong>s experts comme<br />
Coutanceau (2002), Roure (2002) et<br />
Tribolet (1995) insistent sur les mérites<br />
d’une analyse pluridisciplinaire du passage<br />
à l’acte à la fois médicale, psychiatrique,<br />
psychologique, sociale et<br />
criminologique. L’examen psychiatrique<br />
et médico-psychologique dépend <strong>de</strong><br />
l’expérience, du bon sens et <strong>de</strong> l’habitu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> chaque praticien (Lempérière,<br />
1997). Cependant, pour la bonne<br />
conduite <strong>de</strong> cet examen, l’évaluateur<br />
doit favoriser, en préliminaire, les conditions<br />
d’un entretien non directif, privilégiant<br />
l’expression spontanée du<br />
patient. Puis dans une ambiance suffisamment<br />
flexible, l’examen <strong>de</strong>viendra<br />
plus structuré et les interventions <strong>de</strong><br />
l’examinateur plus fréquentes pour<br />
compléter l’investigation anamnéstique.<br />
A l’instar du psychiatre expert ou<br />
requis, l’évaluateur <strong>de</strong>vra se démarquer<br />
du rôle <strong>de</strong> contrôle imposé par la société<br />
pour conduire librement l’entretien.<br />
Enfin, la transcription exacte <strong>de</strong>s mots<br />
et <strong>de</strong>s phrases du sujet examiné est<br />
souvent utile à la discussion et les tiers<br />
sont reçus, <strong>de</strong> préférence, dans un<br />
<strong>de</strong>uxième temps pour un complément<br />
d’information et, notamment, pour préparer,<br />
dans certains cas, l’alliance thérapeutique.<br />
L’évaluateur doit ainsi apporter <strong>de</strong>s<br />
informations élémentaires et utiles à<br />
l'orientation thérapeutique et explorer,<br />
<strong>de</strong> façon précise, les domaines suivants.<br />
I<strong>de</strong>ntification du sujet :<br />
- Nom et Prénom, Date et Lieu <strong>de</strong><br />
naissance.<br />
- Coordonnées exactes (Adresses et<br />
Téléphones).<br />
- Niveau d’étu<strong>de</strong>, Profession, Citoyenneté<br />
et Etat civil.<br />
- Enfants, Parents et Fratrie.<br />
Situation juridique actuelle :<br />
- Les faits (Accusations, victimes, dates<br />
et lieux).<br />
<br />
Proposition sémiotique d’une approche <strong>de</strong>s<br />
pratiques professionnelles<br />
logie fonctionnelle conçue comme<br />
une entreprise sémiotique (dans le<br />
sens où si l’objet à décrire existe dans<br />
les pratiques professionnelles il n’est<br />
pas encore codé dans un discours),<br />
nécessite un partage, partage sans<br />
lequel les langues médicale, ordinaire<br />
et rééducative <strong>de</strong>meureront différenciées.<br />
L’espoir est celui d’une uniformisation<br />
portée par le faire et les<br />
techniques employées.<br />
Pour toutes les disciplines médicales<br />
une telle démarche interroge « les<br />
parcours <strong>de</strong> soins, l’analyse <strong>de</strong>s mythes,<br />
du patient prototype, <strong>de</strong> la notion <strong>de</strong><br />
situation, les discours professionnels<br />
actuels lorsque ces discours appartiennent<br />
à <strong>de</strong>s clichés culturels acceptés<br />
par les groupes professionnels et véhiculant<br />
<strong>de</strong>s mythes partagés ».
N°3 - TOME XIX - AVRIL 2006<br />
La sociologie <strong>de</strong>s changements sociaux<br />
Alexis Trémoulinas<br />
La Découverte<br />
Le concept <strong>de</strong> changement social éclate en <strong>de</strong> multiples changements sociaux<br />
dès lors qu’on le confronte aux recherches sociologiques contemporaines.<br />
Ce qui peut se résumer ainsi : les changements sociaux plutôt que le changement<br />
social ; l’analyse <strong>de</strong> tendances à propos <strong>de</strong> quelques changements sociaux<br />
situés et datés plutôt que <strong>de</strong>s théories surplombantes du changement<br />
social.<br />
Les changements sociaux du XIX e siècle ont contribué à la naissance <strong>de</strong> la sociologie.<br />
Dans nos sociétés réflexives, la sociologie, comme discipline et comme<br />
savoir, suscite différents changements sociaux. Comme discipline, la sociologie<br />
à l’Université constitue, notamment aux États-Unis, un bastion intellectuel<br />
et donc un réservoir d’idées, souvent mobilisées à <strong>de</strong>s fins politiques. Comme<br />
savoir, les connaissances sociologiques, souvent traduites lors d’émissions radiophoniques<br />
ou dans les pages <strong>de</strong> la presse, nourrissent les réflexions du citoyen<br />
et parfois les arguments <strong>de</strong>s hommes politiques. Un seul exemple : le<br />
combat <strong>de</strong>s femmes. Le féminisme peut s’interpréter comme un conflit social<br />
qui a permis lors <strong>de</strong> l’après-Secon<strong>de</strong> Guerre mondiale d’instiller le genre comme<br />
dimension d’analyse du social dans les réflexions sociologiques, voire, dans<br />
le cas américain, <strong>de</strong> l’institutionnaliser jusque dans l’Université avec les gen<strong>de</strong>r<br />
studies. En retour, les savoirs, soit strictement féministes, soit intégrant le<br />
genre dans leur analyse <strong>de</strong> la société, ont une traduction auprès du mon<strong>de</strong><br />
politique et donc un impact.<br />
Tenants <strong>de</strong> paradigmes opposés, Bourdieu et Coleman se retrouvent quand<br />
il s’agit d’essayer <strong>de</strong> transformer la société grâce au savoir accumulé sur elle.<br />
Cette mé<strong>de</strong>cine du social apparaît d’autant plus indispensable à l’heure où les<br />
inégalités sociales s’accroissent.<br />
- Jugement (Nature, Date, Expiration).<br />
- Tribunal <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong> Instance (T.G.I)<br />
<strong>de</strong> rattachement.<br />
- S.P.I.P. et le C.I.P. référents.<br />
- Avocats, Experts mandatés.<br />
- Documents consultés (Expertises, Procès<br />
Verbaux <strong>de</strong>s O.P.J. <strong>de</strong>s auditions<br />
<strong>de</strong> l'agresseur et <strong>de</strong>s victimes dans la<br />
mesure du possible…).<br />
- Personnes consultées (proches, mé<strong>de</strong>cin<br />
et psychiatre traitant…).<br />
Antécé<strong>de</strong>nts Personnels et<br />
Familiaux :<br />
- Judiciaires, sexuels et non sexuels.<br />
- Médico-chirurgicaux et Psychiatriques.<br />
Addictions :<br />
- Type : Tabac. Alcool. Psychotropes.<br />
Drogues. Jeux pathologiques.<br />
- Historique : Ancienneté. Quantité.<br />
Tentatives <strong>de</strong> sevrage. Répercussions<br />
sociales et sanitaires.<br />
Apparence générale :<br />
- Taille, Poids et Latéralité.<br />
- Présentation (posture, mimique, hygiène,<br />
…).<br />
- Attitu<strong>de</strong> du sujet : attentif, coopératif,<br />
ralenti, agité, calme, distrait, méfiant<br />
…et ses réactions émotionnelles.<br />
Biographie (éléments signifiants) :<br />
- Principales étapes du développement<br />
psychomoteur.<br />
- Déroulement <strong>de</strong> l’enfance, adolescence<br />
et âge adulte.<br />
- Scolarité et niveau intellectuel.<br />
- Vie professionnelle (structurée, non<br />
structurée).<br />
- Vie relationnelle (familiale, maritale,<br />
amicale).<br />
- Imagos parentales, notions <strong>de</strong> violence,<br />
<strong>de</strong> rupture.<br />
- Loisirs et pôles d’intérêts (activités<br />
artistiques, culturelles, sportives et engagements<br />
politiques, syndicaux, religieux…).<br />
- Données affectives, morales, religieuses,<br />
ethniques, géographiques ou<br />
linguistiques.<br />
- Personnes <strong>de</strong> confiance.<br />
Eléments sémiologiques :<br />
- Symptômes exprimés spontanément<br />
(angoisse, fatigue, insomnie, troubles<br />
sexuels…), leur mo<strong>de</strong> d’installation,<br />
leur ancienneté et la signification que le<br />
patient leur accor<strong>de</strong>.<br />
- Etat mental général (syntonie, orientation<br />
temporo-spaciale …).<br />
- Affect (euthymique, triste, irritable,<br />
préoccupé, abrasif…).<br />
- Pensée (organisation et cohérence,<br />
discours élaboré, pauvre ou circonstancié,<br />
croyances, idées délirantes ou<br />
suicidaires…).<br />
- Distorsions cognitives.<br />
- Niveau intellectuel (fort, moyen,<br />
faible).<br />
- Perception (hallucinations, contact<br />
avec la réalité …).<br />
- Raisonnement (logique ou illogique,<br />
rationalisation…).<br />
- Mémoire (récente, autobiographique,<br />
sélective, antérogra<strong>de</strong> …).<br />
Facteurs <strong>de</strong> personnalité :<br />
- Traits phobiques, obsessionnels, histrioniques.<br />
- Traits pervers et égocentriques.<br />
- Rigidité et caractère paranoïaque.<br />
- Dysthymie, Impulsivité et Projections.<br />
- Qualité <strong>de</strong>s liens (attachement et maîtrise).<br />
- Rapport aux éprouvés (honte, culpabilité…).<br />
- Capacité d’insight (autocritique, autoperception).<br />
- Tonalité : normale ou immature avec<br />
dominante névrotique, psychopathique,<br />
égocentrique, perverse ou psychotique.<br />
Vie affectivo-sexuelle :<br />
- Développement sexuel (masturbation,<br />
premières expériences sexuelles<br />
adultes, modèles i<strong>de</strong>ntificatoires,<br />
supports/documents d’excitation érotiques<br />
ou pornographiques, inhibition/désinhibition,<br />
dysfonctionnements<br />
sexuels…).<br />
Agressions sexuelles subies ou agies<br />
contre autrui durant l’enfance et/ou<br />
l’adolescence et/ou l’âge adulte.<br />
- Fantasmes et choix d’objets (orientation<br />
sexuelle, paraphilies…).<br />
- Sexualité et conflits internes.<br />
- Possibilités et modèles <strong>de</strong> changement<br />
possibles.<br />
Facteurs Criminologiques :<br />
- Circonstances d’arrestation, choix <strong>de</strong>s<br />
lieux et <strong>de</strong>s victimes.<br />
- Facteurs individuels et situationnels<br />
pré-délictuels/criminels.<br />
- Signes précurseurs et événements isolés<br />
ou successifs ayant précédé la formation<br />
du projet délictuel/criminel,<br />
motivant l’acte et leur rôle décisif dans<br />
le passage à l’acte.<br />
- Degré <strong>de</strong> préméditation et stratégie<br />
opératoire (sous forme <strong>de</strong> crise avec<br />
plusieurs phases pré-délictuelles/criminelles,<br />
sous forme d’un raptus explosif<br />
ou <strong>de</strong> manière chronique étalée dans le<br />
temps).<br />
- Facteurs <strong>de</strong> prédisposition victimogènes<br />
(biologiques, sociologiques, psychologiques…)<br />
et les relations avec la<br />
victime (disposition occasionnelle ou<br />
permanente, consciente ou inconsciente…).<br />
- Rapport aux faits et à la contrainte<br />
exercée sur la victime (rapport <strong>de</strong><br />
contrôle, <strong>de</strong> domination, <strong>de</strong> sado-masochisme,<br />
<strong>de</strong> manipulation ou <strong>de</strong> menace).<br />
- Affects et fantasmes avant et après<br />
le délit ou le crime.<br />
- Rapport à l’altérité (prise <strong>de</strong> conscien-<br />
ce du retentissement psychologique <strong>de</strong><br />
l'agression sur la victime).<br />
- Vécu surmoique du passage à l’acte.<br />
- Rapport à la loi et Degré <strong>de</strong> reconnaissance<br />
(total / partiel / déni)..<br />
Synthèse <strong>de</strong>s données <strong>de</strong><br />
l’anamnèse :<br />
- Reprise <strong>de</strong>s éléments sus-cités les plus<br />
signifiants <strong>de</strong> la personnalité, <strong>de</strong> l’état<br />
mental et <strong>de</strong> la vie du sujet.<br />
- Lien entre l’état mental et l’agression<br />
sexuelle et incrimination <strong>de</strong> facteurs<br />
extérieurs (agression ancienne, liens<br />
conjugaux conflictuels, facteurs héréditaires,<br />
biologiques ou toxiques, facteurs<br />
sociaux...).<br />
- Aspects criminologiques du passage à<br />
l'acte avec analyse <strong>de</strong>s facteurs facilitant<br />
la récidive.<br />
- Vécu contre transférentiel <strong>de</strong>s évaluateurs<br />
et leurs ressentis par rapport à<br />
l'insight du sujet, à la qualité <strong>de</strong> son<br />
introspection et à son <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> consentement<br />
aux soins.<br />
- Détection <strong>de</strong>s contre-indications et<br />
<strong>de</strong>s facteurs pouvant entraver le bon<br />
déroulement <strong>de</strong> la prise en charge.<br />
- Inventaire <strong>de</strong>s disponibilités horaires et<br />
<strong>de</strong>s possibilités matérielles concrètes<br />
du sujet en vue <strong>de</strong> favoriser la régularité<br />
<strong>de</strong>s rencontres ultérieures et <strong>de</strong> la<br />
thérapie.<br />
Cette première approche peut également<br />
s’appuyer sur :<br />
* <strong>de</strong>s examens complémentaires médicaux<br />
ou paramédicaux et <strong>de</strong>s tests projectifs,<br />
à distance, qui peuvent s’avérer<br />
nécessaires si <strong>de</strong>s doutes persistent<br />
concernant la personnalité et le profil<br />
psychopathologique du sujet ;<br />
* <strong>de</strong>s entretiens <strong>de</strong> couple ou familiaux<br />
pour complément d’information mais<br />
aussi pour anticiper une meilleure<br />
alliance thérapeutique.<br />
Orientations thérapeutiques :<br />
Les évaluateurs disposent d’un panel<br />
<strong>de</strong> propositions thérapeutiques, leur<br />
choix déterminera le projet thérapeutique<br />
et permettra d’inscrire le sujet<br />
sous main <strong>de</strong> justice dans un processus<br />
<strong>de</strong> soins le mieux adapté à sa problématique.<br />
Ainsi le traitement peut comprendre :<br />
- <strong>de</strong>s psychotropes, assez rarement <strong>de</strong>s<br />
anti-androgènes ;<br />
- une thérapie individuelle et/ou <strong>de</strong><br />
couple et/ou <strong>de</strong> Groupe.<br />
L’indication <strong>de</strong> type <strong>de</strong> la thérapie<br />
(relaxation, psychodrame, groupe <strong>de</strong><br />
parole, thérapies d'inspiration analytique,<br />
systémique, cognitivo-comportementale…)<br />
se fera selon la fantasmatique<br />
et la prévalence sexuelles<br />
(inceste, pédophilie homo ou hétérosexuelle,<br />
exhibition, violence sur adulte…),<br />
les capacités introspectives et<br />
selon les facteurs associés <strong>de</strong> comorbidité<br />
(composante anxio-dépressive<br />
et/ou psychotique majeure et/ou déficience<br />
mentale et/ou impulsivité…).<br />
De telles évaluations <strong>de</strong>vraient être<br />
répétées à intervalles réguliers et débattues<br />
au sein <strong>de</strong>s équipes spécialisées<br />
lors <strong>de</strong>s réunions cliniques.<br />
Le rapport d’évaluation doit bien i<strong>de</strong>ntifier<br />
les évaluateurs et leurs fonctions et<br />
la date <strong>de</strong> déroulement <strong>de</strong> l’évaluation.<br />
Il s’agit d’une règle simple mais très<br />
utile lors <strong>de</strong>s contrôles <strong>de</strong> l’évolution<br />
sous thérapie ou lorsqu' il faudra réévaluer<br />
le sujet en fin <strong>de</strong> thérapie ou bien<br />
en cas <strong>de</strong> récidive.<br />
Conclusion<br />
L’obligation <strong>de</strong> soins constitue une<br />
mesure judiciaire sur laquelle s’appuie<br />
le travail thérapeutique en matière <strong>de</strong><br />
violences sexuelles.<br />
La formation <strong>de</strong>s soignants volontaires<br />
pour cette mission et le travail en partenariat<br />
avec les milieux socio-judiciaires<br />
doivent être mis en œuvres pour<br />
une prise en charge adaptée à la problématique<br />
<strong>de</strong> chaque sujet qui transgresse<br />
la loi sociale.<br />
Les rôles <strong>de</strong>s intervenants doivent être<br />
définis, selon leur domaine <strong>de</strong> compétence<br />
faute <strong>de</strong> quoi le suivi psycho-<br />
thérapique n’aurait pas <strong>de</strong> sens ni pour<br />
le sujet, ni pour la justice, ni pour les<br />
soignants.<br />
Pour le magistrat et les services sociojudiciaires<br />
le sujet est un justiciable sous<br />
contrôle ; leur outil est la répression<br />
afin d’éviter la récidive.<br />
Pour les soignants, en milieu ouvert<br />
comme fermé, le sujet est un patient en<br />
souffrance ; sa mission est <strong>de</strong> prodiguer<br />
<strong>de</strong>s soins.<br />
Cependant, la prise en charge thérapeutique<br />
<strong>de</strong>s sujets transgressifs suppose<br />
une évaluation et une approche<br />
précises <strong>de</strong> leur fonctionnement psychique.<br />
Une analyse pluridisciplinaire du passage<br />
à l’acte doit explorer les dimensions<br />
médicales, psychiatriques, psychologiques,<br />
sociales et criminologiques.<br />
Le clinicien, <strong>de</strong> par sa position d’accueillant,<br />
en première ligne, <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> soins au CMP, est en<br />
parfaite capacité <strong>de</strong> pouvoir s’approprier<br />
cette grille d’analyse, laquelle s’avère<br />
aisée et volontairement simplifiée<br />
pour l’ai<strong>de</strong>r à mieux cerner le profil<br />
clinique et pour une orientation thérapeutique<br />
optimale <strong>de</strong>s sujets sous<br />
main <strong>de</strong> justice. <br />
Dr. Mathieu HAJBI<br />
CMP, EPS Charcot, 6 av. <strong>de</strong> la Drionne, 78170<br />
La Celle Saint-Cloud<br />
Bibliographie<br />
BALIER C., Introduction à la thérapeutique,<br />
agressions sexuelles, pathologies, suivis thérapeutiques<br />
et cadre judiciaire, Masson 2000.<br />
BALIER C., CIAVALDINI A., Introduction,<br />
agressions sexuelles : pathologies, suivis thérapeutiques<br />
et cadre judiciaire, Masson, 2000.<br />
BALIER C., CIAVALDINI A., GIRARD-<br />
KHAYAT M., Rapport <strong>de</strong> recherche sur les<br />
agresseurs sexuels (QICPAAS), La Documentation<br />
Française, Novembre 1996.<br />
BLOCH H., CHEMAMA R., DÉPRET E.,<br />
GALLO A., LECONTE P., LE NY J.P., POS-<br />
TEL J., REUCHLIN M., Grand dictionnaire<br />
<strong>de</strong> la psychologie, Paris, Larousse, Bordas,<br />
1999.<br />
CHIARINY J.F, Evaluation expertale du traumatisme<br />
sexuel en psychiatrie, in victimeagresseur,<br />
le traumatisme sexuel et ses sentiers,<br />
Tome 1, Les éditions du champ social,<br />
2001.<br />
Conférences <strong>de</strong> Consensus, Conséquences<br />
<strong>de</strong> maltraitance sexuelles ; les reconnaître,<br />
les soigner, les prévenir, Hôpital Pitié Salpetrière,<br />
Paris, 6 et 7 novembre 2003.<br />
CORDIER B., Modalité <strong>de</strong> prise en charge<br />
<strong>de</strong> l’agresseur sexuel, in Victime-agresseur,<br />
l’agresseur sexuel problématique et prise en<br />
charge, Tome 2, Les éditions du champ<br />
social, 2002.<br />
CORNET J.-P., GLOVANNANGELI D.,<br />
MORMONT Ch., Les délinquants sexuels :<br />
théories, évaluation et traitements, Ed Frison<br />
Roche / Psychologie Vivante, 2003,<br />
p67-132.<br />
COUTANCEAU R., Les délinquants sexuels,<br />
Santé Mentale, n°64, Janvier 2002.<br />
COUTANCEAU R., Prévenir la récidive,<br />
une politique <strong>de</strong> santé publique ? du projet <strong>de</strong><br />
loi Toubon/Guigou à son application, Forensic<br />
n°17, 2ème semestre 1997.<br />
DEMBRI N.A., LUSIGNAN R., MARLEAU<br />
J.D., Violence ou troubles sexuels. Aspects<br />
pervers comparés chez <strong>de</strong> jeunes patients,<br />
Forensic, n° spécial, Mai 2004, p 23-30.<br />
LEMPÉRIÈRE TH., FÉLINE A., GUTMANN<br />
A., ADÈS J., PILATE C., L’examen psychiatrique.<br />
<strong>Psychiatrie</strong> <strong>de</strong> l’adulte, Masson,<br />
1997, p 1-7.<br />
Loi du 17.06.1998, N° 98-468, Relative à<br />
la prévention et à la répression <strong>de</strong>s infractions<br />
sexuelles ainsi qu’à la protection <strong>de</strong>s<br />
mineurs, 1998.<br />
ROURE L., DUIZABO P., Les comportements<br />
violents et dangereux. Aspects criminologiques<br />
et psychiatriques, Masson, 2002.<br />
TRIBOLET S., DESOUS G., Etats dangereux<br />
et dangerosité. Droit et psychiatrie,<br />
Heures <strong>de</strong> France, 1995, p 185-196.<br />
ZAGURY D., Entre psychose et perversion<br />
narcissique. Une clinique <strong>de</strong> l’horreur : Les<br />
tueurs en série, L’évolution psychiatrique,<br />
1996, 61, 87-112.<br />
LIVRES ET REVUES<br />
FMC 5<br />
Psychopathologie <strong>de</strong> l’agir :<br />
entre vulnérabilité et<br />
dangerosité<br />
Bulletin <strong>de</strong> Psychologie 2006 n°481,<br />
22 €<br />
Après avoir abordé ce qui fait défaillance<br />
dans l’inscription <strong>de</strong> la loi<br />
et vient soutendre le passage ou le<br />
recours à l’acte, après avoir traité <strong>de</strong>s<br />
liens d’emprise et <strong>de</strong>s compulsions<br />
répétitives en œuvre (P. A. Raoult, R.<br />
Samacher, B. Duez), ce dossier abor<strong>de</strong><br />
certains aspects <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> réponses<br />
thérapeutiques qui peuvent<br />
prévenir la dangerosité. Est concerné<br />
ce qui caractérise la dangerosité, dans<br />
un premier temps (P. A. Raoult, S. G.<br />
Raymond, A. Hirschelmann-Ambrosi)<br />
à la lisière du psychologique, du psychiatrique<br />
et du juridique. Des risques<br />
criminogènes sont particulièrement<br />
présents dans certaines modalités pathologiques<br />
ou pour certaines populations,<br />
parfois peu abordées (C. Blatier).<br />
La compréhension <strong>de</strong>s pathologies<br />
<strong>de</strong> l’agir, c’est-à-dire <strong>de</strong>s enjeux psychiques<br />
<strong>de</strong> l’acte dans ses liens avec<br />
la loi, peut avoir un impact sur la pénologie<br />
et le suivi socio-judiciaire. Des<br />
orientations ont été construites quant<br />
aux traitements <strong>de</strong>s auteurs d’agressions,<br />
en particulier sexuels, et <strong>de</strong><br />
nombreuses expériences <strong>de</strong> prise en<br />
charge se sont développées (G. Coco,<br />
C. Mormont). Ceci peut permettre <strong>de</strong><br />
mieux saisir la psychopathologie <strong>de</strong>s<br />
actes criminels (R. Samacher, P. Bessoles).<br />
La psychologie clinique est impliquée,<br />
dans sa dimension criminologique<br />
et légale, par ces aspects, et<br />
nécessite <strong>de</strong>s perspectives complémentaires<br />
au plan méthodologique<br />
et théorique.<br />
Ces enfants qu’on sacrifie...<br />
au nom <strong>de</strong> la protection <strong>de</strong><br />
l’enfance<br />
Maurice Berger<br />
Dunod, 16 €<br />
Maurice Berger critique les juges tant<br />
il est vrai, selon lui, que la Loi et les<br />
juges sont les clés <strong>de</strong> voûte <strong>de</strong> la totalité<br />
du dispositif <strong>de</strong> la protection <strong>de</strong><br />
l’enfance. Le contenu <strong>de</strong> l’ordonnance<br />
du juge est le premier <strong>de</strong>s outils auxquels<br />
doivent se référer les autres<br />
professionnels en charge <strong>de</strong> l’enfant<br />
en difficulté. Tout en soulignant son<br />
adhésion pour le travail <strong>de</strong>s « vrais<br />
juges », il vilipen<strong>de</strong>, avec force, les<br />
magistrats qui ont tendance à se montrer<br />
trop maternels avec les parents,<br />
presque gênés d’avoir à protéger l’enfant,<br />
vite tentés <strong>de</strong> rejeter la faute sur<br />
la « précarité », mot facile pour tout<br />
expliquer et ne rien tenter, alors que<br />
tout montre que l’éducation parentale<br />
n’est que, très rarement, un corollaire<br />
<strong>de</strong>s seules conditions sociales<br />
et matérielles. Au moment où vient<br />
d’être créée une Mission parlementaire<br />
d’information sur la famille et<br />
les droits <strong>de</strong>s enfants, trois questions<br />
s’imposent : sommes-nous capables<br />
<strong>de</strong> regar<strong>de</strong>r en face la gravité <strong>de</strong> nos<br />
dysfonctionnements judiciaires et <strong>de</strong><br />
prendre en compte les connaissances<br />
actuelles ? Allons-nous mettre fin à<br />
l’impunité dont bénéficient, actuellement,<br />
certains professionnels ? Ou,<br />
par idéologie et par manque <strong>de</strong> courage,<br />
allons-nous sacrifier <strong>de</strong> nouvelles<br />
générations d’enfants ?<br />
L’auteur présente cinq propositions :<br />
élaborer une loi spécifique à la protection<br />
<strong>de</strong> l’enfance qui repose sur<br />
une prise en compte <strong>de</strong>s besoins essentiels<br />
<strong>de</strong>s enfants (comme c’est le<br />
cas dans d’autres pays), mettre à disposition<br />
<strong>de</strong>s professionnels <strong>de</strong> l’enfance<br />
un outil d’évaluation <strong>de</strong>s capacités<br />
parentales, mettre en place<br />
un dispositif <strong>de</strong> responsabilisation,<br />
créer un outil universitaire <strong>de</strong> recherche<br />
sur la protection <strong>de</strong> l’enfance,<br />
constituer un groupement d’intérêt<br />
public afin d’amortir les effets financiers<br />
<strong>de</strong>s propositions précé<strong>de</strong>ntes.
6<br />
LIVRES<br />
HISTOIRE<br />
Paul Broca<br />
Philippe Monod-Broca<br />
Préface <strong>de</strong> Jean-Didier Vincent<br />
Vuibert, 28 €<br />
La contribution <strong>de</strong> Paul Broca à la<br />
connaissance du cerveau et à ce qu’on<br />
appelle, aujourd’hui, les neurosciences<br />
est immense, à commencer par la<br />
théorie <strong>de</strong>s localisations cérébrales<br />
tellement combattue en son temps,<br />
et notamment en France, pays catholique<br />
refusant toute partition <strong>de</strong><br />
l’âme au sein du cerveau.<br />
Broca, c’est aussi la naissance d’une<br />
anthropologie dépourvue <strong>de</strong> préjugés<br />
et une curiosité dans <strong>de</strong> multiples<br />
domaines : nouvelles techniques chirurgicales<br />
et, surtout, biologie. Il est<br />
notamment un <strong>de</strong>s rares en France<br />
dans la <strong>de</strong>uxième moitié du XIX e siècle<br />
à bien connaître Darwin et à discuter<br />
le problème <strong>de</strong> la sélection naturelle.<br />
En anatomie du cerveau, sa<br />
contribution ne se limite pas à l’aire<br />
qui porte son nom et dont la découverte<br />
est à l’origine <strong>de</strong> la compréhension<br />
<strong>de</strong>s mécanismes du langage ;<br />
il a contribué par la <strong>de</strong>scription du<br />
« grand lobe limbique », aux bases<br />
d’une physiologie <strong>de</strong>s émotions et<br />
<strong>de</strong>s affects.<br />
Membre <strong>de</strong> l’Académie nationale <strong>de</strong><br />
mé<strong>de</strong>cine, le professeur Philippe Monod-Broca,<br />
son arrière petit-fils, s’est<br />
appuyé sur un riche fonds d’archives<br />
familiales pour rédiger cette biographie.<br />
Essai <strong>de</strong> psychologie<br />
Charles Bonnet<br />
avec une introduction <strong>de</strong> Serge<br />
Nicolas suivie <strong>de</strong> la présentation<br />
<strong>de</strong> l’œuvre par Albert Lemoine<br />
L’Harmattan, 30 €<br />
Le premier ouvrage philosophique<br />
du savant naturaliste suisse Charles<br />
Bonnet (1720-1793) a été publié sous<br />
le titre Essai <strong>de</strong> psychologie. Par mesure<br />
<strong>de</strong> pru<strong>de</strong>nce, il se cache sous le<br />
voile <strong>de</strong> l’anonymat en faisant imprimer<br />
son livre à l’étranger. Il s’agit<br />
du premier ouvrage en langue française<br />
qui porte, en son titre, le mot<br />
« psychologie » tout en traitant explicitement<br />
<strong>de</strong> cette matière.<br />
Dans l’exposition <strong>de</strong> ses idées, Bonnet<br />
n’a pas observé un ordre didactique,<br />
il a suivi le fil <strong>de</strong> ses pensées.<br />
Le point <strong>de</strong> départ <strong>de</strong> l’ouvrage se<br />
trouve dans l’idée maîtresse que nous<br />
ne connaissons l’âme que par ses facultés<br />
et que nous ne connaissons<br />
ces facultés que par leurs effets qui<br />
se manifestent par l’intervention du<br />
corps qui est, ou qui paraît être, l’instrument<br />
universel <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong><br />
l’âme. Ce n’est qu’avec le secours <strong>de</strong>s<br />
sens que l’âme acquiert <strong>de</strong>s idées, et<br />
celles qui semblent les plus spirituelles<br />
n’en ont pas moins une origine très<br />
corporelle. La diversité <strong>de</strong>s sensations<br />
tient à la diversité <strong>de</strong>s fibres nerveuses<br />
qui servent <strong>de</strong> substrat physiologique<br />
aux opérations intellectuelles.<br />
L’année même <strong>de</strong> la publication anonyme<br />
<strong>de</strong> l’Essai <strong>de</strong> psychologie, Bonnet<br />
entreprend la rédaction d’un second<br />
écrit psychologique en continuité<br />
avec le précé<strong>de</strong>nt, son fameux Essai<br />
analytique sur les facultés <strong>de</strong> l’âme<br />
(1860). Pour présenter <strong>de</strong> manière<br />
plus méthodique les idées déjà esquissées<br />
dans son Essai <strong>de</strong> psychologie,<br />
il a l’idée d’utiliser un procédé<br />
analogue à celui imaginé par le philosophe<br />
français Etienne Bonnot <strong>de</strong><br />
Condillac (1715-1780) à la même<br />
époque : animer graduellement une<br />
statue humaine pour expliquer la nature<br />
et le développement <strong>de</strong>s opérations<br />
<strong>de</strong> l’âme. La reproduction <strong>de</strong><br />
l’ouvrage est précédée d’une introduction<br />
sur la vie et l’œuvre <strong>de</strong> Bonnet<br />
ainsi que d’une étu<strong>de</strong> peu connue<br />
mais fort pertinente d’Albert Lemoine<br />
(1824-1874) sur la philosophie du<br />
naturaliste suisse.<br />
<br />
Confessions d’un clerc avignonnais,<br />
sous les auspices du Warburg Institute<br />
<strong>de</strong> Londres, traduit bien la perplexité <strong>de</strong><br />
R.G. Salomon qui préféra s’orienter<br />
vers une approche esthétique <strong>de</strong> ces<br />
planches <strong>de</strong> parchemin, considérant<br />
que malgré leur hermétisme affligeant<br />
et leur apparente imperméabilité, et<br />
même au cas (simple hypothèse) où<br />
elles auraient été le produit bizarre<br />
d’élucubrations issues d’un cerveau<br />
dérangé, elles pouvaient encore être<br />
retenues comme témoignage vali<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
l’époque médiévale et comme documents<br />
relatifs à l’histoire <strong>de</strong>s idées et<br />
<strong>de</strong> la civilisation.<br />
Richard G. Salomon avait dû renoncer<br />
à analyser, plus avant, le déséquilibre<br />
mental qui, lui semblait-il, colorait<br />
cette oeuvre insolite <strong>de</strong> parchemins<br />
recouverts d’inscriptions, <strong>de</strong> schémas<br />
géométriques et <strong>de</strong> personnages évangéliques,<br />
faute d’un renfort sollicité,<br />
mais refusé par <strong>de</strong>s psychiatres germaniques<br />
en un temps où l’on aurait<br />
espéré d’eux qu’ils se soient sentis<br />
encouragés par les travaux du Pr W.<br />
Morgenthaler sur Adolf Wölfli et la<br />
publication d’Expression <strong>de</strong> la Folie qui<br />
avait tellement séduit Max Ernst. Cette<br />
déroba<strong>de</strong> rendait, dès lors, impossible<br />
toute démarche interdisciplinaire, seule<br />
susceptible cependant, grâce à la synergie<br />
qu’elle aurait imprimée aux<br />
recherches, d’éliminer lacunes et obscurités,<br />
et <strong>de</strong> favoriser l’approche <strong>de</strong><br />
l’oeuvre d’Opicinus <strong>de</strong> Canistris.<br />
Juste avant la <strong>de</strong>rnière guerre mondiale,<br />
un nouveau manuscrit daté <strong>de</strong><br />
1337, sur papier celui-ci, le co<strong>de</strong>x Vaticanus<br />
latinus 6435, fut, à son tour,<br />
découvert à la Bibliothèque apostolique<br />
vaticane par R. Almagia. R.G.<br />
Salomon, peut-être lassé <strong>de</strong> ses premiers<br />
travaux qui avaient pris tellement<br />
<strong>de</strong> son temps sans qu’il soit parvenu à<br />
un décodage fidèle, ne s’attarda guère<br />
sur ce cahier-journal <strong>de</strong>meuré jusqu’à<br />
ce jour sans traduction, et ne procéda<br />
qu’à quelques rapprochements analogiques<br />
accessibles dans une nouvelle<br />
publication : A newly discovered manuscript<br />
of Opicinus of Canistris, 1953. R.G.<br />
Salomon fit encore paraître « The<br />
Grape-Trick », dans Culture in History.<br />
Essays in Honor of Paul Rodin, 1960 ;<br />
contribution dans laquelle il révèle<br />
qu’Opicinus avait déjà utilisé une légen<strong>de</strong><br />
que Goethe intègrera, à son tour,<br />
dans son Faust.<br />
En <strong>de</strong>rnier lieu, il publia : « Aftermath to<br />
Opicinus <strong>de</strong> Canistris » dans le <strong>Journal</strong><br />
of the Warburg and Courtauld Institutes,<br />
en 1962.<br />
Dans l’intervalle <strong>de</strong> ces diverses parutions,<br />
un psychanalyste célèbre aux<br />
Etats-Unis, Ernst Kris, lecteur du premier<br />
ouvrage <strong>de</strong> Salomon, avait en<br />
1952 écrit Psychanalyse <strong>de</strong> l’Art, dont<br />
un chapitre concernait Opicinus : « Un<br />
artiste psychotique du Moyen Age ». Se<br />
basant sur <strong>de</strong>s ressemblances formelles,<br />
sur la comparaison <strong>de</strong>s planches d’Opicinus<br />
et <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssins <strong>de</strong> patients psychotiques,<br />
ainsi que sur l’interprétation<br />
<strong>de</strong> bribes autobiographiques puisées<br />
dans le parchemin n°20 du co<strong>de</strong>x Palatinus<br />
latinus 1993, mais sans se rapporter<br />
à l’ensemble <strong>de</strong>s écrits du scribe<br />
alors non disponibles, Kris n’avait pas<br />
hésité à porter tout <strong>de</strong> go le diagnostic<br />
<strong>de</strong> schizophrénie à l’encontre d’Opicinus.<br />
Des opinions<br />
contradictoires<br />
En cinquante ans, les opinions contradictoires<br />
ont eu toute latitu<strong>de</strong> pour se<br />
combattre et prospérer <strong>de</strong> conserve :<br />
- Opicinus était-il sain d’esprit ?<br />
Bien. sûr, proteste P. Marconi : « il a<br />
suffi d’une sèche étu<strong>de</strong> d’Ernst Kris pour<br />
infliger à Opicinus l’épithète <strong>de</strong> psychotique,<br />
et donc pour le faire tomber dans<br />
les oubliettes...».<br />
Combien est tenace le préjugé qui veut<br />
que la psychose soit synonyme <strong>de</strong> non<br />
créativité et que soit, d’emblée, excusé<br />
le désintérêt qui bou<strong>de</strong>rait les expres-<br />
Opicinus <strong>de</strong> Canistris<br />
(1296-1352 ?)<br />
sions plastiques <strong>de</strong>s psychotiques: au<br />
pays <strong>de</strong> Marcel Réja, <strong>de</strong> Rogues <strong>de</strong><br />
Fursac, <strong>de</strong> Benjamin Pailhas, <strong>de</strong> Jean<br />
Vinchon et <strong>de</strong> Gaston Ferdière, pour<br />
ne citer que les psychiatres les mieux<br />
connus qui se soient penchés sur les<br />
créations <strong>de</strong> la psychose, cet avis est<br />
plutôt désobligeant...<br />
- Opicinus était-il un psychotique ?<br />
Evi<strong>de</strong>mment, déplore l’historien russe<br />
Aaron Gourevitch : « la psyché dérangée<br />
d’un clerc à <strong>de</strong>mi oublié d’Avignon,<br />
s’est manifestée à nous dans ses textes et<br />
dans ses <strong>de</strong>ssins...».<br />
D’autres auteurs se sont cantonnés dans<br />
une pru<strong>de</strong>nte réserve. John Mac Gregor<br />
mentionne, simplement, le diagnostic<br />
rétrospectif d’E. Kris dans son oeuvre<br />
monumentale : Discovery of the Art of<br />
the Insane.<br />
Tous les jugements portés sur l’hypothétique<br />
psychose d’Opicinus, qu’ils<br />
soient abrupts ou feutrés, affirmatifs<br />
ou critiques, ne se relient que par la<br />
conviction passionnelle qui les soustend,<br />
peu faite pour une confrontation<br />
d’idées par défaut d’étayage sur <strong>de</strong>s<br />
arguments acceptables. Mais le flou<br />
s’impose encore lors <strong>de</strong> l’analyse <strong>de</strong>s<br />
écrits et <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssins d’Opicinus : fut-il<br />
réellement le mé<strong>de</strong>cin médiéval qu’E.<br />
Wickersheimer inscrit dans son Dictionnaire<br />
biographique <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins en<br />
France au Moyen Age ? Quel serait le<br />
marin assez fou pour caboter autour<br />
<strong>de</strong> la Méditerranée avec, pour seul viatique,<br />
les cartes du cartographe Opicinus<br />
imaginées d’après les portulans <strong>de</strong><br />
P. Vesconte, sur lesquelles le Diable<br />
impose sa silhouette aux rivages <strong>de</strong> la<br />
mer ?<br />
- Opicinus serait-il, comme cela fut<br />
récemment suggéré, un pionnier clan<strong>de</strong>stin<br />
<strong>de</strong>s réformes religieuses, alors<br />
que fumaient encore les <strong>de</strong>rniers<br />
La planche 20 du Co<strong>de</strong>x Pal. lat. 1993<br />
bûchers cathares, et que se multipliaient<br />
faux messies et prophètes illuminés,<br />
capables d’entraîner <strong>de</strong>s foules<br />
immenses ?<br />
Autant que la sommaire formulation<br />
d’E. Kris, l’attitu<strong>de</strong> ambiguë <strong>de</strong> R.G.<br />
Salomon oscillant <strong>de</strong> l’intuition d’un<br />
dérangement mental à un jugement<br />
péjoratif <strong>de</strong>s capacités intellectuelles<br />
du copiste, a freiné l’ar<strong>de</strong>ur <strong>de</strong>s médiévistes<br />
et <strong>de</strong>s psychiatres.<br />
Opicinus mala<strong>de</strong>, personne n’aurait<br />
admis qu’il ait été capable <strong>de</strong> mener à<br />
bien une telle oeuvre. Mais, à en croire<br />
R.G. Salomon qui stigmatisait « les<br />
étymologies grotesques d’Opicinus » et se<br />
gaussait, sans indulgence, <strong>de</strong> « ses idées<br />
en l’air et <strong>de</strong> ses coq à l’âne sans rapport<br />
avec le contenu <strong>de</strong> ses planches », le scribe<br />
était au moins intellectuellement<br />
limité, et <strong>de</strong> médiocre niveau culturel :<br />
il ne poursuivait pas un but particulier<br />
en traçant ses cercles... il copiait ce qu’il<br />
voyait sur son modèle, sans ajouter <strong>de</strong><br />
réflexion sur le sens <strong>de</strong> certains détails...<br />
il aura <strong>de</strong>ssiné ses cercles <strong>de</strong> l’année,<br />
comme ses cartes, sans intention symbolique...<br />
Ses planches, porteuses <strong>de</strong><br />
calendriers, sont vi<strong>de</strong>s <strong>de</strong> sens ......<br />
L’analyse du marasme qui a handicapé<br />
l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s oeuvres d’Opicinus met en<br />
évi<strong>de</strong>nce divers facteurs qui ont favorisé<br />
l’addition d’incertitu<strong>de</strong>s au lieu <strong>de</strong> les<br />
annuler.<br />
Plutôt qu’à s’engager, souvent brillamment<br />
d’ailleurs, dans <strong>de</strong>s interprétations<br />
incertaines, la voix du bon sens et<br />
<strong>de</strong> la rigueur intellectuelle conseille <strong>de</strong><br />
se tenir humblement aux procédures<br />
élémentaires, telle que l’analyse <strong>de</strong>s<br />
documents eux-mêmes : les <strong>de</strong>ux traités<br />
en latin <strong>de</strong> l’Anonymus ticinensis,<br />
les cinquante <strong>de</strong>ux planches <strong>de</strong> parchemin<br />
et le cahier-journal sur papier,<br />
en latin luiaussi, en l’absence <strong>de</strong> tout<br />
autre témoignage direct ou indirect.<br />
Un sort malheureux a voulu que R.G.<br />
N°3 - TOME XIX - AVRIL 2006<br />
Salomon ne centre ses recherches que<br />
sur le co<strong>de</strong>x Pal. lat. 1993 dont il a<br />
publié la totalité <strong>de</strong>s planches sans<br />
connaître l’existence du cahier-journal,<br />
le co<strong>de</strong>x Vat. lat. 6435. Il a négligé<br />
certains textes, supprimé <strong>de</strong>s citations<br />
<strong>de</strong> la Bible, coupant court à toute vision<br />
d’ensemble incluant personnages, calendriers,<br />
zodiaques, versets bibliques,<br />
innombrables annotations et détails<br />
infimes jugés superflus, références géographiques<br />
et cosmiques omniprésentes,<br />
apparemment inutiles. Le co<strong>de</strong>x<br />
Vat. lat. 6435 ne lui est parvenu que<br />
bien plus tard. Ce décalage, à l’origine<br />
d’une inversion acci<strong>de</strong>ntelle, a brouillé<br />
les rapports et les perspectives qu’un<br />
examen conjoint aurait révélés. Ce<br />
cahier-journal offre, en effet, les clefs<br />
<strong>de</strong>s planches sur parchemin, car il en<br />
détient les amorces. Il est l’irremplaçable<br />
source <strong>de</strong> renseignements sur<br />
Opicinus et sa vie. S’y concentrent tous<br />
les tics graphiques dont il est coutumier,<br />
les jeux <strong>de</strong> mots dont il raffole,<br />
ses fantasmes, ses références littéraires<br />
inattendues, autant <strong>de</strong> traits qui ai<strong>de</strong>nt<br />
à cerner sa pensée en mouvement et à<br />
nous la rendre familière dans ses<br />
enchaînements.<br />
L’obligation première et parfois fastidieuse<br />
consistant à revenir aux textes<br />
latins a été remplie par une médiéviste<br />
paloise, Madame M. Laharie, qui a<br />
assumé tous les travaux paléographiques<br />
correspondants, et qui vient<br />
d’achever la traduction française <strong>de</strong>s<br />
textes latins reconstitués du co<strong>de</strong>x Vat.<br />
lat. 6435 dans leur intégralité.<br />
Un « avant » et un « après »<br />
L’oeuvre d’Opicinus n’étant plus ni<br />
inerte ni muette, l’interdisciplinarité a<br />
permis, dans un <strong>de</strong>uxième temps,<br />
d’abor<strong>de</strong>r avec quelque validité l’opacité<br />
<strong>de</strong> la somme <strong>de</strong>s planches et du<br />
cahier-journal.<br />
Une fois surmonté le choc visuel procuré<br />
par la complexité <strong>de</strong>s images<br />
considérées, l’observateur est amené à<br />
distinguer dans cette production un<br />
« avant » et un « après ».<br />
Un « avant » qui a réuni à côté d’une<br />
poussière d’opuscules oubliés, la rédaction<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux ouvrages sus-mentionnés.<br />
Un « après », en rupture complète, où<br />
l’on voit le <strong>de</strong>ssin s’introduire et s’insinuer,<br />
au fil <strong>de</strong> l’écriture, pour pactiser<br />
avec elle, partager l’espace et l’assigner<br />
à <strong>de</strong>s endroits précis, selon <strong>de</strong>s astuces<br />
<strong>de</strong>puis longtemps éprouvées par Raban<br />
Maur et Eadwin.<br />
Un avant et un après, comme ce fut<br />
le cas pour l’architecte, peintre et violoniste<br />
Louis Soutter lequel, s’il ne bâtit<br />
jamais rien, changea carrément <strong>de</strong> style<br />
pictural et graphique, passant d’une<br />
inspiration conformiste à une originalité<br />
dont découlent l’intérêt et la valeur <strong>de</strong><br />
ses <strong>de</strong>ssins.<br />
Un avant et un après, comme cela<br />
advint aussi à Carl Fre<strong>de</strong>rik Hill, d’abord<br />
peintre conventionnel, dont la facture<br />
évolua soudain sous le coup d’une hantise<br />
morbi<strong>de</strong> <strong>de</strong>s insectes perçus<br />
comme persécuteurs.<br />
Dans le cas d’Opicinus, l’avant correspond<br />
aux <strong>de</strong>ux ouvrages <strong>de</strong> l’Anonymus<br />
Ticinensis dont le premier (1329)<br />
vante fort à propos la supériorité du<br />
pouvoir pontifical sur la puissance<br />
impériale, dans le strict respect <strong>de</strong>s<br />
règles <strong>de</strong> rigueur et <strong>de</strong> sobriété <strong>de</strong> mise<br />
dans la rédaction <strong>de</strong> tels écrits. Le<br />
second (1330) rempli <strong>de</strong> références<br />
pittoresques et <strong>de</strong> détails savoureux<br />
sur la cité <strong>de</strong> Pavie, respirant avec alacrité<br />
l’amour qu’Opicinus parvenu à<br />
Avignon portait à sa ville, sans ces<br />
plaintes et cette nostalgie dont regorgent<br />
les récits <strong>de</strong>s exilés.<br />
Deux livres, <strong>de</strong>ux styles, une seule<br />
recette : l’opportunisme ; un seul objectif<br />
: séduire. Séduire, en premier, Jean<br />
XXII, et ensuite les gens <strong>de</strong> Pavie, afin<br />
d’éviter qu’ils ne prennent le parti <strong>de</strong> la<br />
faction qui lui intentait un procès<br />
<strong>de</strong>vant la Rote.<br />
Voici <strong>de</strong>s faits, <strong>de</strong> nature à souligner
N°3 - TOME XIX - AVRIL 2006<br />
les qualités d’adaptation et <strong>de</strong> discernement,<br />
les capacités d’anticipation et<br />
le potentiel manoeuvrier dont jouissait<br />
Opicinus en 1330, qui ne sont guère<br />
en faveur d’un processus psychotique<br />
chez un adulte <strong>de</strong> trente quatre ans.<br />
Un avant et un après, par rapport à<br />
quoi ?<br />
Pour Louis Soutter et pour Carl Fre<strong>de</strong>rik<br />
Hill, il est avéré que ce furent<br />
<strong>de</strong>s manifestations <strong>de</strong> nature psychotique<br />
qui marquèrent la mutation <strong>de</strong><br />
leurs styles respectifs.<br />
Mais dans le cas<br />
d’Opicinus ?<br />
A partir <strong>de</strong> 1335-1336, tous les écrits<br />
et les <strong>de</strong>ssins du scribe ten<strong>de</strong>nt à la<br />
réalisation d’une autobiographie luxuriante,<br />
et semble-t-il désordonnée, dont<br />
il faut patiemment reconnaître les éléments<br />
afin <strong>de</strong> la réorienter. Avec sa<br />
méticulosité horlogère, Opicinus entreprend<br />
exclusivement l’écriture et le <strong>de</strong>ssin<br />
d’une pathographie qui traduit la<br />
qualité <strong>de</strong> ses dons d’observation et<br />
son souci d’exactitu<strong>de</strong> ainsi que l’exubérance<br />
d’un délire, à la fois, mégalomaniaque<br />
et persécutif<br />
Il s’agit d’une autobiographie calquée<br />
sur les Confessions <strong>de</strong> saint Augustin<br />
et la Vita prima <strong>de</strong> saint François dAssise<br />
par Th. Celano qui, elles aussi, se répartissent<br />
selon le modèle <strong>de</strong> l’avant et <strong>de</strong><br />
l’après. Initialement, une existence frivole<br />
et pécheresse <strong>de</strong> « vieil homme »,<br />
puis un événement-rupture, une maladie-conversion,<br />
débouchant sur l’après<br />
<strong>de</strong> « l’homme nouveau » touché par la<br />
grâce.<br />
A ceci près que, chez Opicinus, la maladie-conversion,<br />
survenant autour <strong>de</strong><br />
Pâques (27 mars 1334) et favorisée<br />
par un jeûne <strong>de</strong> Carème auto-punitif<br />
particulièrement pénalisant, fut une<br />
psychose aiguë, une forme oniroï<strong>de</strong><br />
d’expérience délirante primaire, anticipant<br />
« l’ambiance <strong>de</strong> Vendredi saint »<br />
Morts d’inanition<br />
Famine et exclusions en France sous l’Occupation<br />
Sous la direction d’Isabelle von Bueltzingsloewen<br />
Presses Universitaires <strong>de</strong> Rennes, 20 €<br />
<strong>de</strong> K. Jaspers, renvoyant aux formes<br />
oniroï<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vécu <strong>de</strong> Mayer-Gross, et à<br />
Henri Ey, pour qui les formes oniroï<strong>de</strong>s<br />
sont submergées par l’imaginaire, ici<br />
somptueux et prodigieusement servi<br />
par une « disposition enthousiaste » qui<br />
ne laissa par la suite au scribe ni répit ni<br />
repos jusqu’à sa mort (1352 ?).<br />
L’avant n’avait pas été exempt d’inci<strong>de</strong>nts<br />
qui, rétrospectivement, paraissent<br />
illustrer une certaine fragilité<br />
émotionnelle et affective et suggérer<br />
l’existence, chez le copiste, d’une cyclothymie<br />
saisonnière.<br />
En 1321, c’est Opicinus lui-même qui<br />
décrit une invasion <strong>de</strong> troubles obsessionnels<br />
invalidants, sous forme <strong>de</strong> rires<br />
incoercibles en plein office (ce que<br />
Seglas qualifiait d’« obsessions par<br />
contraste ») ; puis il fut affligé d’un<br />
bégaiement qui lui interdira <strong>de</strong> monter<br />
en chaire, l’incitera à rapprocher son<br />
prénom du verbe grec opizein et à faire<br />
allusion à Balbus <strong>de</strong> Gênes pour ses<br />
réflexions sur les Balbutientes, les<br />
bègues...<br />
C’est surtout l’existence <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux « trous<br />
autobiographiques » (1325-28 ; 1331-<br />
33) qui intriguent à la lecture <strong>de</strong> cette<br />
insolite auto-observation, alors que le<br />
scribe notait et datait scrupuleusement<br />
tous les faits quotidiens. C’est, chaque<br />
fois, à l’occasion d’événements désastreux<br />
que l’humeur d’Opicinus se<br />
dégra<strong>de</strong> au point qu’il ne mentionne<br />
plus aucune information.<br />
Le premier « trou » enveloppe <strong>de</strong> silence<br />
son excommunication et sa fuite <strong>de</strong><br />
Pavie : en effet il avait été bel et bien<br />
excommunié ; jusqu’ici la raison <strong>de</strong><br />
son procès <strong>de</strong>meurait obscure, car il<br />
n’en parlait qu’à mots couverts. Cette<br />
excommunication, si bien dissimulée, a<br />
été récemment découverte grâce à l’interprétation<br />
<strong>de</strong>s jeux <strong>de</strong> mots qu’il adorait<br />
faire.<br />
« Par le bienheureux Thomas, le Christ<br />
(Opicinus lui-même) est apparu à l’extérieur<br />
dans les questions circulaires, à<br />
Cet ouvrage collectif est issu d’un colloque organisé, à Lyon, par la Ferme du<br />
Vinatier (Centre hospitalier Le Vinatier) et l’équipe RESEA-EMIS du Laboratoire<br />
<strong>de</strong> recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA) les 20 et 21 novembre 2003.<br />
Plusieurs cas <strong>de</strong> figure ont été examinés.<br />
En premier lieu celui <strong>de</strong>s asiles d’aliénés, rebaptisés hôpitaux psychiatriques<br />
par un décret <strong>de</strong> 1937. Le nombre massif d’« aliénés » internés morts <strong>de</strong> faim<br />
et <strong>de</strong> froid entre 1940 et 1944 justifie, à lui seul, l’accent mis sur cette population<br />
aux caractéristiques très particulières, dont le sort tragique a suscité une<br />
vigoureuse polémique <strong>de</strong>puis la publication, en 1987, du livre <strong>de</strong> Max Lafont :<br />
L’extermination douce. Le nombre <strong>de</strong>s contributions consacrées aux hôpitaux<br />
psychiatriques s’explique également par le fait que cet ouvrage collectif a été<br />
motivé par l’enquête historique sur la famine dans les hôpitaux psychiatriques<br />
français sous l’Occupation commanditée en 2001 par l’hôpital psychiatrique<br />
du Vinatier (Lyon/Bron) avec le soutien du Conseil général du Rhône dont Isabelle<br />
von Bueltzingloewen rend compte. Anne Marescaux abor<strong>de</strong> la situation<br />
rencontrée à l’asile privé <strong>de</strong> Saint-Jean <strong>de</strong> Dieu <strong>de</strong> Lyon, Samuel Odier à St<br />
Egrève, Michel Caire à Maison-Blanche, Olivier Bonnet dans les asiles privés<br />
<strong>de</strong> la congrégation Sainte-Marie <strong>de</strong> l’Assomption.<br />
Afin d’interpréter les causes <strong>de</strong> cette famine, que l’on pouvait croire spécifique<br />
aux hôpitaux psychiatriques, il a paru impératif <strong>de</strong> s’interroger, dans une démarche<br />
comparatiste, sur le <strong>de</strong>venir d’autres populations « reléguées » dans<br />
<strong>de</strong>s institutions fermées ou semi-fermées, l’objectif étant <strong>de</strong> déterminer si certaines<br />
<strong>de</strong> ces institutions ont été épargnées par les conséquences <strong>de</strong> la sousalimentation<br />
et, si oui, pour quelles raisons. Deux types <strong>de</strong> collectivités ont été<br />
successivement étudiés. Les collectivités hospitalières parmi lesquelles on a<br />
distingué le cas <strong>de</strong>s hôpitaux généraux, celui <strong>de</strong>s hospices <strong>de</strong> vieillards et celui<br />
<strong>de</strong>s sanatoriums. Les prisons et les camps d’internement, ce <strong>de</strong>rnier sousensemble<br />
regroupant les camps français d’internement et les camps d’internement<br />
<strong>de</strong>s prisonniers <strong>de</strong> guerre français en Allemagne.<br />
Le phénomène <strong>de</strong> sous-alimentation n’ayant pas été limité aux collectivités,<br />
il a paru indispensable, dans un <strong>de</strong>rnier chapitre, d’étendre l’enquête à d’autres<br />
groupes fragiles <strong>de</strong> la population urbaine en s’intéressant plus particulièrement<br />
au sort <strong>de</strong>s enfants. Ce chapitre est aussi l’occasion d’analyser <strong>de</strong> manière<br />
approfondie les ripostes élaborées par les autorités centrales et locales<br />
dont l’action sur le terrain a souvent été relayée par <strong>de</strong>s associations, afin<br />
d’atténuer les effets <strong>de</strong>s restrictions sur la santé <strong>de</strong> population et <strong>de</strong> limiter le<br />
nombre <strong>de</strong>s victimes <strong>de</strong> la famine.<br />
Dans son introduction, Isabelle von Bueltzingsloewen relève que « la question<br />
<strong>de</strong> la famine sous l’Occupatiqn comporte une forte dimension politique et idéologique.<br />
Car, <strong>de</strong>s priorités définies en temps <strong>de</strong> crise, par le régime mais aussi, par<br />
exemple, par les membres <strong>de</strong> l’élite médicale ou par les responsables d’associations<br />
caritatives, dépend la survie d’un certain nombre d’individus qui ont en<br />
commun <strong>de</strong> ne bénéficier d’aucune forme <strong>de</strong> solidarité, familiale ou collective, à<br />
une pério<strong>de</strong> où, il est vrai, le “chacun pour soi” a probablement souvent battu en<br />
brèche les valeurs d’équité et <strong>de</strong> partage ».<br />
la ressemblance d’un vagabond » (Opicinus,<br />
était arrivé à Avignon en mendiant),<br />
...Mais en ces jours, c’est notre Seigneur<br />
lui-même (le nouveau pape Benoît XII<br />
supposé hostile, maître <strong>de</strong> la justice<br />
pontificale) et non un autre, qui vient<br />
en témoignage contre moi (Opicinus-<br />
Christ) à travers le bienheureux Thomas<br />
d’Aquin, dans les cercles <strong>de</strong>s Qaestiones<br />
»...<br />
Si Thomas d’Aquin est bien l’auteur<br />
<strong>de</strong> Questions, ce sont en réalité les sessions<br />
du Tribunal <strong>de</strong> la Rote qui sont<br />
désignées par la circularité du mouvement<br />
d’un pupitre sur roues (d’où le<br />
nom <strong>de</strong> la Rote), support <strong>de</strong>s causes<br />
que chaque juge pouvait aisément<br />
consulter.<br />
Le Thomas en question, c’est en réalité<br />
Thomas Fastolf, auditeur d’évènements<br />
judiciaires dont il fit un recueil en<br />
vue <strong>de</strong> la formation <strong>de</strong>s juristes. Il suffisait,<br />
dès lors, <strong>de</strong> retrouver une copie<br />
<strong>de</strong> ce recueil, disponible à la Bibliothèque<br />
nationale, pour y découvrir la<br />
relation d’un procès intenté à un certain<br />
Opicinus, excommunié pour simonie...<br />
Cette excommunication, qui l’avait<br />
décidé à fuir et à se cacher, avait causé,<br />
elle aussi recouverte par le silence <strong>de</strong><br />
1328, une première alerte passagère,<br />
un épuisement somatique, impressionnant<br />
mais aussitôt réversible, qualifié<br />
d’infirmité physique, du fait qu’Opicinus<br />
s’était « senti privé <strong>de</strong> ses sens<br />
corporels comme s’il avait dormi une<br />
nuit » (fol. 7 v° du Vat. lat.).<br />
Le <strong>de</strong>uxième trou est, lui aussi, lié à la<br />
menace du fameux procès particulièrement<br />
anxiogène, au moment où un<br />
tyrannique sentiment <strong>de</strong> culpabilité le<br />
tenaillait, au point <strong>de</strong> l’inciter à multiplier<br />
<strong>de</strong>s confessions, et à s’enfermer<br />
dans une pénible et inutile introspection,<br />
remplie <strong>de</strong> doutes et d’interrogations<br />
stériles, jusqu’au Carème 1334<br />
où il se mortifia au point <strong>de</strong> s’épuiser<br />
« en agonie », <strong>de</strong> s’effondrer quelques<br />
jours après Pâques dans une forme <strong>de</strong><br />
stupeur.<br />
Tous ces renseignements, parfois retrouvés<br />
dans le cahier-journal, sont la plupart<br />
du temps contenus dans la fameuse<br />
planche n°20 sur parchemin, dite<br />
autobiographique, terminée en 1336,<br />
alors que s’était déjà organisée la psychose<br />
chronique d’Opicinus au décours<br />
<strong>de</strong> sa psychose aiguë oniroï<strong>de</strong> dont il<br />
était sorti comme « <strong>de</strong> la mort à la vie »,<br />
pour ne pas dire qu’il était ressuscité<br />
à la manière du Christ, et choisi pour<br />
un <strong>de</strong>stin exceptionnel : 1335 -<br />
« Année <strong>de</strong> l’attente, où les cieux se<br />
sont ouverts pour moi, c’est-à-dire que<br />
la raison et l’intelligence se sont<br />
ouvertes à la compréhension <strong>de</strong> ces<br />
mystères», à mettre en rapport avec le<br />
prophète Daniel (12,12) : « Heureux<br />
celui qui attendra et arrivera jusqu’à<br />
mille trois cent trente cinq jours ».<br />
La Vierge lui a restitué <strong>de</strong>s facultés<br />
décuplées avec un sentiment <strong>de</strong> toute<br />
puissance qui le pousse à se croire <strong>de</strong>stiné<br />
à écrire « l’Evangile nouveau et<br />
éternel », à prophétiser, à s’i<strong>de</strong>ntifier<br />
ponctuellement à Jean-Baptiste, au<br />
Diable et à une foule <strong>de</strong> personnages<br />
célèbres, bibliques ou non. Sans arrêt,<br />
il établit <strong>de</strong>s corrélations, note <strong>de</strong>s coïnci<strong>de</strong>nces,<br />
tire <strong>de</strong>s déductions qu’il brasse<br />
inlassablement, échafau<strong>de</strong> <strong>de</strong>s récits<br />
pour toujours se mettre en scène. Il<br />
multiplie les jeux <strong>de</strong> mots en accumulant<br />
<strong>de</strong>s homophonies, <strong>de</strong>s allitérations,<br />
<strong>de</strong>s chara<strong>de</strong>s, en recourant à la numérologie,<br />
à l’alchimie, à l’astronomie dilatant<br />
son corps jusqu’au cosmos et<br />
annexant l’éternité.<br />
Même si Henri Ey a procédé à la remise<br />
en ordre <strong>de</strong> ce concept, c’est toujours<br />
avec appréhension et en tremblant<br />
que l’on prononce le mot <strong>de</strong><br />
paraphrénie, surtout lorsque <strong>de</strong> surcroît<br />
l’on encourt le reproche supplémentaire<br />
d’anachronisme en l’appliquant<br />
à la psychose chronique<br />
développée par Opicinus.<br />
C’est cependant à une paraphrénie que<br />
l’on pense <strong>de</strong>vant cette oeuvre si minutieusement<br />
élaborée. Ce n’est pas<br />
<br />
LIVRES<br />
Le vocabulaire <strong>de</strong> Carl<br />
Gustav Jung<br />
Aimé Agnel, Michel Cazenave,<br />
Claire Dorly, Suzanne Krakowiak,<br />
Monique Leterrier, Viviane<br />
Thibaudier<br />
Ellipses<br />
« Le langage que je parle doit nécessairement<br />
être ambigu, c’est-à-dire à double<br />
sens, pour pouvoir rendre justice à la<br />
nature du psychisme et au double aspect<br />
<strong>de</strong> celle-ci ».<br />
Pour Jung, la réalité psychique est<br />
plurielle, ambiguë, kaléidoscopique.<br />
L’objet qu’il étudie, l’âme, est un<br />
objet complexe, paradoxal (contenant<br />
les contraires), individuel mais aussi<br />
collectif. Lire Jung aujourd’hui, découvrir<br />
certains aspects <strong>de</strong> sa mo<strong>de</strong>rnité,<br />
ce serait donc reconnaître l’existence<br />
d’une complexité psychique, d’un<br />
« bruit » <strong>de</strong> l’âme, irréductible aux systèmes,<br />
mais qui <strong>de</strong>man<strong>de</strong> à être circonscrit,<br />
interprété au moyen <strong>de</strong> ce<br />
langage à double sens, utilisant « tous<br />
les tons <strong>de</strong> la gamme, du plus haut au<br />
plus bas » et donnant, justement parce<br />
qu’il n’est pas univoque, « une image<br />
plus complète <strong>de</strong> la réalité ».<br />
J’étais mé<strong>de</strong>cin dans<br />
Srebrenica assiégée<br />
Thierry Pontus<br />
L’Harmattan, 16,50 €<br />
Sur les ambiguïtés <strong>de</strong> l’humanitaire en<br />
temps <strong>de</strong> guerre, le témoignage du<br />
docteur Thierry Pontus, volontaire <strong>de</strong><br />
Mé<strong>de</strong>cins sans Frontières, apporte un<br />
éclairage édifiant. Complété par une<br />
carte, <strong>de</strong>s repères chronologiques et<br />
un glossaire, son récit nous plonge<br />
dans l’anti-chambre <strong>de</strong> ce qui sera,<br />
<strong>de</strong>ux ans plus tard, pour les populations<br />
martyres <strong>de</strong> Srebrenica, l’enfer.<br />
Dans ces conflits, les populations civiles<br />
sont les otages <strong>de</strong>s combattants<br />
lorsqu’elles ne sont pas, carrément<br />
,l’enjeu <strong>de</strong> la guerre. Toute intervention<br />
humanitaire à leur profit est susceptible<br />
<strong>de</strong> prenre une signification<br />
politique ou <strong>de</strong> modifier la donne stratégique.<br />
L’humanitaire peut, alors, <strong>de</strong>venir<br />
l’arme d’un camp ou <strong>de</strong> l’autre,<br />
et être l’objet <strong>de</strong> contraintes, <strong>de</strong> pressions,<br />
voire <strong>de</strong> manipulations, au détriment,<br />
toujours, <strong>de</strong> celles et ceux,<br />
blessés et mala<strong>de</strong>s, adultes et enfants,<br />
que protègent, théoriquement, les<br />
Conventions <strong>de</strong> Genève.<br />
Le jeu pathologique : quand<br />
jouer n’est plus jouer<br />
Psychotropes 2005 n°2<br />
De Boeck<br />
M. Valleur propose <strong>de</strong> considérer dans<br />
les conduite addictives <strong>de</strong>ux versants<br />
apparemment opposés : la dépendance<br />
et la conduite ordalique. Cette<br />
perspective permet <strong>de</strong> situer le jeu pathologique<br />
dans une classification <strong>de</strong>s<br />
addictions basée sur la relation subjective<br />
à la prise <strong>de</strong> risque. Elle conduit<br />
aussi à distinguer du classique jeu pathologique<br />
d’argent et <strong>de</strong> hasard les<br />
nouvelles formes <strong>de</strong> dépendance aux<br />
jeux en réseau sur Internet.<br />
Une conversation à visée interprétative<br />
conjointe, entre <strong>de</strong>ux sociologues<br />
présentée par J.-Y. Trépos, s’appuie sur<br />
l’expérience <strong>de</strong> l’un d’entre eux, qui a<br />
joué à la roulette pendant plus <strong>de</strong> vingt<br />
ans et qui y a perdu <strong>de</strong>s sommes considérables.<br />
L’entretien envisage certains<br />
aspects du jeu pathologique que l’un<br />
<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux interlocuteurs considère<br />
comme très importants : la « première<br />
fois », les compétences sociales <strong>de</strong><br />
joueur (l’approvisionnement, la dissimulation<br />
et la feinte), les relations avec<br />
la famille et les amis, mais aussi avec<br />
les organismes <strong>de</strong> crédit, les difficul-<br />
HISTOIRE 7<br />
tés <strong>de</strong> faire face à la <strong>de</strong>tte (notamment<br />
la difficulté <strong>de</strong> faire reconnaître, par<br />
les commissions <strong>de</strong> suren<strong>de</strong>ttement<br />
et par les tribunaux, la dimension addictive<br />
du jeu). Il illustre aussi le va-etvient,<br />
dans lequel se débat souvent le<br />
joueur, entre la mise à distance esthétique<br />
<strong>de</strong> la pratique pathologique<br />
du jeu et la douloureuse confrontation<br />
avec le réel.<br />
L’intervention sociologique dans le débat<br />
contemporain sur le jeu « compulsif<br />
», domaine qui semble réservé aux<br />
approches psychologiques, se<br />
situe sur quatre niveaux complémentaires.<br />
Le premier concerne la déconstruction<br />
(historique, épistémologique...)<br />
<strong>de</strong> l’objet « jeu excessif ». Le<br />
<strong>de</strong>uxième niveau consiste à débattre<br />
scientifiquement sur le jeu « problématique<br />
», afin <strong>de</strong> dégager les hypothèses<br />
sur lesquelles les spécialistes<br />
<strong>de</strong> plusieurs disciplines (sociologues,<br />
anthropologues, historiens, psychologues,<br />
psychanalystes...) pourraient<br />
se retrouver. Dans cette optique J.-P.<br />
Martignoni-Hutin dégage les caractéristiques<br />
<strong>de</strong> « l’hypothèse ordalique »<br />
(Valleur-Bucher). Le troisième niveau<br />
<strong>de</strong> l’intervention sociologique consiste<br />
à problématiser et à réinterroger les<br />
métho<strong>de</strong>s, instruments <strong>de</strong> mesures et<br />
contextes dans lesquels s’inscrit, <strong>de</strong>puis<br />
<strong>de</strong> nombreuses années le travail<br />
sur le jeu pathologique, notamment<br />
outre Atlantique. Le <strong>de</strong>rnier niveau du<br />
travail sociologique en direction du<br />
jeu problématique permet <strong>de</strong> définir<br />
les axes <strong>de</strong> recherches et d’enquêtes<br />
« pluridisciplinaires » qui pourraient faire<br />
avancer la connaissance sur « les rapports<br />
» que les joueurs entretiennent<br />
avec les jeux <strong>de</strong> hasard et d’argent.<br />
Parallèlement à ce travail <strong>de</strong> déconstruction<br />
et <strong>de</strong> reconstruction, le sociologue<br />
doit se faire l’historien <strong>de</strong><br />
l’actualité récente <strong>de</strong> gambling (notamment<br />
en ce qui concerne les casinos)<br />
car elle participe <strong>de</strong> la construction<br />
du jeu problématique contemporain<br />
et <strong>de</strong> ses représentations. Enfin,<br />
Ch. Bucher abor<strong>de</strong> la fonction <strong>de</strong><br />
la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’interdiction par le joueur<br />
alors <strong>de</strong> S. Craepeau et B. Seys parlent<br />
<strong>de</strong>s enjeux psychologiques et sociaux<br />
concernant les jeux et Internet.<br />
Le magnétisme animal<br />
Etu<strong>de</strong> sur l’hypnose<br />
Alfred Binet et Charles Féré<br />
Préface <strong>de</strong> Serge Nicolas<br />
Avec une introduction <strong>de</strong> Christine<br />
Clozza et Bernard Andrieu suivie<br />
d’une étu<strong>de</strong> sur le magnétisme<br />
par Paul Richer<br />
L’Harmattan, 30 €<br />
Alfred Binet et Charles Féré ont publié<br />
cet ouvrage sur le magnétisme<br />
animal en 1887. C’est la première fois<br />
que la question <strong>de</strong> l’hypnose, telle<br />
qu’elle était pratiquée à la Salpêtrière,<br />
était présentée dans le contexte <strong>de</strong> recherches<br />
expérimentales.<br />
Mesmer, à la fin du siècle <strong>de</strong>rnier, fut<br />
le premier qui donna une apparence<br />
scientifique à ses expériences, et c’est<br />
du fait du défaut <strong>de</strong> métho<strong>de</strong>, chez lui<br />
et chez beaucoup <strong>de</strong> ses continuateurs,<br />
que le magnétisme ne put arriver à<br />
conquérir sa place. Les expériences <strong>de</strong><br />
l’école <strong>de</strong> la Salpêtrière lui ont donné<br />
cette place. La délimitation <strong>de</strong>s trois<br />
états : léthargie, catalepsie, somnambulisme,<br />
et l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s phénomènes<br />
qui les accompagnent, ont ouvert la<br />
voie pour l’examen <strong>de</strong>s faits psychologiques<br />
et pathologiques les plus curieux.<br />
Ce livre, publié en fac simile <strong>de</strong> l’édition<br />
originale, est l’œuvre <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux collaborateurs<br />
<strong>de</strong> Charcot, qui ont pu<br />
expérimenter les métho<strong>de</strong>s du magnétisme,<br />
reproduire les expériences<br />
relatées par les magnétiseurs, et les<br />
soumettre à une analyse critique.
8<br />
LIVRES<br />
HISTOIRE<br />
Les obsessions et la<br />
psychasthénie<br />
Pierre Janet<br />
Tome 1<br />
Analyse <strong>de</strong>s symptômes<br />
VOLUME 1<br />
Préface <strong>de</strong> Serge Nicolas<br />
Introduction <strong>de</strong> Laurent Fedi<br />
L’Harmattan, 39 €<br />
Pierre Janet a popularisé, en 1903,<br />
le terme « psychasthénie » dans son<br />
livre « Obsessions et psychasthénie ».<br />
Il s’agit d’une affection mentale caractérisée<br />
par un affaiblissement du<br />
tonus vital (baisse <strong>de</strong> la tension psychologique)<br />
et dont les principaux<br />
symptômes sont la dépression physique<br />
et morale, un sentiment d’incomplétu<strong>de</strong><br />
et la perte du sens du<br />
réel, une tendance marquée aux phénomènes<br />
anxieux et aux manies ou<br />
aux obsessions. La psychasthénie regroupe<br />
<strong>de</strong>s stigmates et <strong>de</strong>s symptômes<br />
qu’on décrit, aujourd’hui, dans<br />
le cadre <strong>de</strong> la névrose obsessionnelle<br />
ou <strong>de</strong> la névrose phobo-obsessionnelle.<br />
On doit à Janet la distinction<br />
<strong>de</strong>s phobies en trois groupes : phobies<br />
d’objet, phobies <strong>de</strong> situations et<br />
phobies <strong>de</strong> fonction dont s’est inspiré<br />
le DSM-III.<br />
Dans le tome 1 du premier volume<br />
<strong>de</strong> son livre « Obsessions et psychasthénie<br />
», Janet étudie d’abord le<br />
contenu intellectuel <strong>de</strong>s obsessions,<br />
c’est-à-dire le sujet auquel s’appliquent<br />
les pensées du mala<strong>de</strong>, l’idée<br />
du démon, du sacrilège, du suici<strong>de</strong>,<br />
ou toute autre. Puis, sous le titre d’agitations<br />
forcées, il analyse les divers<br />
troubles qui accompagnent les idées<br />
obsédantes ou qui les remplacent, et<br />
il entend par-là toutes les opérations<br />
exagérées ou inutiles qui constituent<br />
les manies mentales, les tics, les phobies<br />
ou les angoisses. Enfin, il cherche<br />
dans un état très spécial, sorte <strong>de</strong> sentiment<br />
intellectuel, l’inquiétu<strong>de</strong>, l’origine<br />
d’où proviennent les obsessions<br />
et les diverses agitations.<br />
Les obsessions et la<br />
psychasthénie<br />
Pierre Janet<br />
Tome Il<br />
Etu<strong>de</strong>s générales<br />
VOLUME 1<br />
Préface <strong>de</strong> Serge Nicolas<br />
Introduction <strong>de</strong> Georges Dumas<br />
L’Harmattan, 39 €<br />
Sous le nom <strong>de</strong> psychasthénie, Pierre<br />
Janet a construit sur le modèle <strong>de</strong> l’hystérie<br />
et <strong>de</strong> l’épilepsie, une psycho-névrose<br />
qui comprendrait les obsessions,<br />
les impulsions, les manies mentales, la<br />
folie du doute, les tics, les agitations, les<br />
phobies, les délires du contact, les angoisses,<br />
les neurasthénies, les sentiments<br />
bizarres d’étrangeté et <strong>de</strong> dépersonnalisation,<br />
et à nous présenter<br />
ces troubles mentaux, si dissemblables<br />
en apparence, comme <strong>de</strong>s manifestations<br />
différentes en <strong>de</strong>gré, mais analogues<br />
en nature d’un même état pathologique,<br />
l’affaiblissement psychique.<br />
La <strong>de</strong>uxième partie du premier volume<br />
<strong>de</strong> son livre « Obsessions et psychasthénie<br />
» (1903) est plus générale et plus<br />
synthétique que la première. Janet discute<br />
les différentes hypothèses qui ont<br />
été présentées pour expliquer ces curieuses<br />
altérations <strong>de</strong> l’esprit, et finalement<br />
il expose la sienne, hypothèse<br />
préparée par ses précé<strong>de</strong>ntes étu<strong>de</strong>s.<br />
Ses premiers travaux avaient établi une<br />
distinction entre l’activité synthétique<br />
et l’activité automatique. L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
psychasthéniques montre l’existence<br />
d’autres <strong>de</strong>grés. Chez les psychasthéniques,<br />
l’opération mentale la plus difficile,<br />
puisque c’est elle qui disparaît le<br />
plus souvent, est la fonction du réel, ou<br />
comme le dit Bergson, l’attention à la<br />
vie présente. La principale forme <strong>de</strong><br />
<br />
tenter <strong>de</strong> s’approprier « le cas Opicinus<br />
», en proposant ce cadre nosographique<br />
chez un petit fonctionnaire pontifical<br />
sans histoire apparente qui a<br />
conservé, sa vie durant, un parfait<br />
contrôle <strong>de</strong> la réalité, tout en poursuivant,<br />
la nuit venue, le <strong>de</strong>ssin <strong>de</strong> son<br />
Evangile secret, mais au contraire ouvrir<br />
en grand son oeuvre et en rendre<br />
accessibles ses immenses potentialités.<br />
La planche autobiographique qui<br />
semble, effectivement, être la première<br />
<strong>de</strong> toutes les planches sur parchemin,<br />
terminée en 1336, exprime d’emblée<br />
l’ampleur <strong>de</strong> l’ambition délirante d’Opicinus<br />
en même temps que son habileté<br />
à dire et ne pas dire par le <strong>de</strong>ssin.<br />
Entre alpha et oméga, et sous l’égi<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s quatre évangélistes, elle comporte<br />
une classique roue <strong>de</strong> la fortune le mettant<br />
en scène <strong>de</strong> dix en dix ans (né en<br />
1296, Opicinus est âgé <strong>de</strong> quarante<br />
ans en 1336), qui englobe quarante<br />
espaces concentriques sur lesquels s’inscrivent,<br />
selon un mouvement centrifuge,<br />
les évènements qu’il a retenus <strong>de</strong> sa<br />
vie, année après année.<br />
« C’est <strong>de</strong> Pavie qu’est originaire l’auteur<br />
<strong>de</strong> ces vers. Il a un nom qui grince<br />
(à rapprocher du grec opizein) et il a<br />
mis sa famille dans un panier d’osier,<br />
son nom qu’il a tressé <strong>de</strong> brins <strong>de</strong> saule »,<br />
claironne-t-il, permettant ainsi à F. Gianani<br />
<strong>de</strong> faire le lien avec l’Anonymus<br />
ticinensis.<br />
Le <strong>de</strong>ssin <strong>de</strong> la planche 20 suggère, en<br />
effet, un fond <strong>de</strong> corbeille tressé (canistrum).<br />
Or Opicinus désire, en même<br />
temps, que ce fond <strong>de</strong> corbeille se<br />
confon<strong>de</strong> avec une coupe horizontale<br />
« du vieux tronc <strong>de</strong> Jessé », avec ses quarante<br />
cernes (le temps d’avant) sur<br />
lequel viendra se greffer (dans l’après)<br />
le rameau <strong>de</strong> Jessé, le fils <strong>de</strong> David,<br />
Jésus ressuscité... et bien sûr Opicinus.<br />
Comme sur toutes les planches du<br />
co<strong>de</strong>x Pal. lat. 1993 et surtout les <strong>de</strong>ssins<br />
du cahierjournal, <strong>de</strong> nombreuses<br />
surprises, attachées à <strong>de</strong> simples détails<br />
parfois futiles, atten<strong>de</strong>nt d’être exhu-<br />
cette fonction du réel, qui présente différents<br />
<strong>de</strong>grés <strong>de</strong> difficulté est l’action<br />
qui nous permet d’agir sur les objets extérieurs<br />
et <strong>de</strong> métamorphoser la réalité.<br />
Cette partie <strong>de</strong> l’ouvrage se termine<br />
par le diagnostic, le pronostic, le traitement<br />
<strong>de</strong>s diverses psychasthénies, ou<br />
la place qu’il convient d’assigner à la<br />
psychasthénie parmi les autres psychonévroses.<br />
Histoires <strong>de</strong> psychiatrie<br />
infantile<br />
Michel Soulé<br />
Préface <strong>de</strong> Bernard Golse<br />
Erès, 28 €<br />
Des secrets <strong>de</strong> famille aux nouveaux<br />
mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> filiation, <strong>de</strong> la psychopathologie<br />
<strong>de</strong> la vie quotidienne à la problématique<br />
<strong>de</strong> l’abandon et du placement<br />
spécialisé en passant par la relation précoce<br />
mère-bébé : Michel Soulé présente<br />
dans cet ouvrage les principaux textes<br />
qui ont émaillés ses 50 années d’exercice<br />
professionnel. Il y déroule les thèmes<br />
et les préoccupations qui ont guidé sa<br />
longue pratique <strong>de</strong> pédopsychiatre formé<br />
à la psychanalyse, acteur important<br />
dans la création et le développement<br />
<strong>de</strong> la psychiatrie infantile française.<br />
Les <strong>de</strong>ntistes allemands sous<br />
le troisième Reich<br />
Xavier Riaud<br />
Postface <strong>de</strong> Thierry Feral<br />
L’Harmattan, 22,50 €<br />
Cet ouvrage est le second que publie<br />
Xavier Riaud en rapport avec la Secon<strong>de</strong><br />
Guerre mondiale. Il y livre une présentation<br />
<strong>de</strong> la société alleman<strong>de</strong> sous le<br />
régime hitlérien à travers l’évolution<br />
comportementale d’une profession, les<br />
chirurgiens-<strong>de</strong>ntistes. A travers une documentation<br />
issue <strong>de</strong> centres d’archives<br />
mées. Un autre exemple, également<br />
situé sur la planche autobiographique :<br />
en 1304, année <strong>de</strong> sa Confirmation,<br />
âgé <strong>de</strong> huit ans, Opicinus mentionne<br />
qu’« à contre-coeur (il le précise bien) il<br />
partagea <strong>de</strong>s jeux sexuels avec l’une <strong>de</strong><br />
ses soeurs en phase pubertaire ». Ernst<br />
Kris, surpris <strong>de</strong> cette naïve confi<strong>de</strong>nce,<br />
rarissime chez un clerc médiéval,<br />
s’apprête à pratiquer la spéléologie du<br />
self d’Opicinus. De fait, ne découvre-ton<br />
pas une très discrète croix posée<br />
sur l’anneau 1304 <strong>de</strong> la planche 20 :<br />
marqua-t-elle l’importance du sacrement<br />
aux yeux du petit garçon ?<br />
Signale-t-elle ce geste d’enfant qui va<br />
prendre, aux yeux d’Opicinus, l’importance<br />
d’un achoppement intolérable,<br />
à l’origine d’un sentiment <strong>de</strong> culpabilité<br />
qui ne le quittera jamais ? Le<br />
plus curieux, c’est que les nombreuses<br />
cartes anthropomorphes, réunies dans<br />
le cahier-journal écrit entre juin et<br />
novembre 1337, montrent le Diable<br />
méditerranéen en train <strong>de</strong> pratiquer<br />
<strong>de</strong>s attouchements sur la vulve-Venise<br />
<strong>de</strong> l’Europe féminine. Pouce entre<br />
in<strong>de</strong>x et médius comme cela s’observe<br />
dans les crises comitiales généralisées,<br />
cette main coupable se veut surtout<br />
conjuration magique du sexe, reproduisant<br />
le geste <strong>de</strong> la « fica » que<br />
Charles Albert Cingria décrit dans sa<br />
traduction du Novellino, un texte antérieur<br />
à la Vita Nuova <strong>de</strong> Dante.<br />
A l’annonce du verdict favorable <strong>de</strong><br />
son procès (janvier 1337) qui annulait<br />
son excommunication et le libérait <strong>de</strong><br />
ses angoisses, l’humeur d’Opicinus<br />
s’était teintée d’euphorie, ce qui l’avait<br />
décidé à écrire son cahier-journal<br />
(co<strong>de</strong>x Vat. lat. 6435) dans lequel il<br />
s’exprime surabondamment, livrant le<br />
secret <strong>de</strong> ses planches à venir ainsi<br />
qu’une foule <strong>de</strong> données, autobiographiques<br />
et autres.<br />
Sous le coup <strong>de</strong> l’emprise réginale <strong>de</strong><br />
son imagination débridée, Opicinus a<br />
donné libre cours à une mégalomanie<br />
oscillant <strong>de</strong> la vision apocalyptique d’un<br />
et incluant <strong>de</strong>s photos d’époque et <strong>de</strong>s<br />
extraits <strong>de</strong> procès <strong>de</strong> criminels <strong>de</strong> guerre,<br />
l’auteur nous invite à découvrir comment<br />
ces praticiens d’un autre temps<br />
ont réagi face au courant idéologique<br />
nazi. L’auteur produit une galerie <strong>de</strong><br />
portraits où il décrit les exactions et les<br />
abus commis par certains d’entre eux.<br />
Ce travail analyse les faits qui permettent<br />
<strong>de</strong> mieux comprendre les enjeux<br />
<strong>de</strong> l’éthique médicale sous un régime<br />
totalitaire.<br />
Histoires <strong>de</strong> la mémoire<br />
Pathologie, psychologie et<br />
biologie<br />
Sous la direction <strong>de</strong> Jean-Clau<strong>de</strong><br />
Dupont<br />
Préface <strong>de</strong> Michel Meul<strong>de</strong>rs<br />
Vuibert, 30 €<br />
Ce recueil est issu d’un colloque international<br />
organisé à l’université <strong>de</strong> Picardie<br />
Jules Verne, et soutenu par l’équipe<br />
« Epistémologie, histoire <strong>de</strong>s sciences biologiques<br />
et médicales ».<br />
Au cours <strong>de</strong> ce colloque, la pathologie<br />
l’oubli et la pluralité <strong>de</strong>s mémoires, la<br />
question <strong>de</strong> l’inconscient, le rapport<br />
entre mémoire inconsciente et mémoire<br />
implicite, les fon<strong>de</strong>ments biologiques<br />
<strong>de</strong> la mémoire, ont été l’objet <strong>de</strong> discussions<br />
épistémologiques.<br />
Pierre Buser i<strong>de</strong>ntifie plusieurs courants<br />
historiques intriqués qui ont marqué<br />
l’analyse <strong>de</strong> la mémoire. Le premier correspond<br />
à la tendance à se rapprocher<br />
<strong>de</strong>s bases organiques <strong>de</strong> la mémoire,<br />
dans une tradition qui va <strong>de</strong> Charles<br />
Bonnet à Joseph Delbœuf. La <strong>de</strong>uxième<br />
voie recherche les modalités <strong>de</strong> la participation<br />
<strong>de</strong> l’inconscient aux opérations<br />
mnésiques.<br />
Enfin, d’une façon plus générale est mise<br />
progressivement en évi<strong>de</strong>nce une pluralité<br />
<strong>de</strong> mémoires. Georges Lantéri-<br />
triomphe final, à une autoaccusation<br />
mortifère remontant à son enfance et<br />
utilisant jusqu’au fait qu’il était né la<br />
veille <strong>de</strong> Noël pour s’intituler Antechrist<br />
; homme du sommet, <strong>de</strong> la<br />
lumière et du salut, en même temps<br />
homme d’en bas, <strong>de</strong> la boue, <strong>de</strong> l’obscurité<br />
et <strong>de</strong> la faute, ainsi que nous le<br />
diront, chacun à sa manière, Blaise Pascal<br />
et Fiodor Dostoievski.<br />
Le mo<strong>de</strong>ste prêtre vit cependant encore<br />
en son temps, celui <strong>de</strong> la persécution<br />
qu’il a décelée dès sa rencontre avec le<br />
nouveau pape Benoît XII en 1335 :<br />
« Il (Opicinus) est à l’instant soumis à <strong>de</strong>s<br />
questions parce que peut-être l’autre étant<br />
mû par <strong>de</strong>s sentiments hostiles, ne veut<br />
pas prendre <strong>de</strong> décision avant d’examiner<br />
le jugement (<strong>de</strong> son procès)...».<br />
Opicinus, sensible à ce pouvoir<br />
magique <strong>de</strong>s cartes géographiques<br />
génératrices <strong>de</strong> rêves collectifs, comme<br />
le suggère Plutarque dans son Alcibia<strong>de</strong>,<br />
sera un jour admis au nombre <strong>de</strong>s<br />
cartographes sans nacelle, car <strong>de</strong>ssiner<br />
ses cartes, c’est d’abord figurer le manichéisme<br />
ambiant. Ses cartes , qui jusqu’à<br />
présent faisaient le charme essentiel<br />
du cahier-journal tant que celui-ci<br />
n’était pas traduit, illustrent l’opposition<br />
entre Opicinus-Europe, féminine<br />
ou masculine, et l’Eglise africaine, sous<br />
les traits <strong>de</strong> laquelle se cache Benoît ;<br />
mais elles n’expriment pas seulement<br />
une persécution, après tout banale. Elles<br />
imposent la nécessité <strong>de</strong> déchiffrer, en<br />
leur sein, un mouvement qui anime<br />
tout <strong>de</strong>ssin d’Opicinus. Le scribe ne<br />
lésine jamais à remplir ses images <strong>de</strong><br />
cycles et d’itinéraires.<br />
Dans son cahier-journal surtout, Opicinus<br />
transfère <strong>de</strong>s extraits <strong>de</strong> textes<br />
bibliques, à déco<strong>de</strong>r systématiquement.<br />
Il s’inspire <strong>de</strong> la Légen<strong>de</strong> dorée <strong>de</strong><br />
Jacques <strong>de</strong> Voragine. Il cite le Théétète<br />
<strong>de</strong> Platon, l’Ilia<strong>de</strong>, Fronton le maître <strong>de</strong><br />
Marc-Aurèle, Lucain, Macrobe, Boèce,<br />
SaintAugustin, Geoffrey <strong>de</strong> Monmouth,<br />
Ramon Lull, sans compter tous ceux<br />
qui n’ont pas encore été i<strong>de</strong>ntifiés. Est-<br />
Laura démontre l’enracinement <strong>de</strong> la<br />
question <strong>de</strong> la mémoire dans la problématique<br />
<strong>de</strong>s localisations cérébrales<br />
<strong>de</strong>puis le début du XIX e siècle. Denis<br />
Forest analyse <strong>de</strong>s usages multiples faits<br />
<strong>de</strong> la sélectivité <strong>de</strong> d’oubli constatée en<br />
clinique pour vali<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s conceptions<br />
différentes <strong>de</strong> la mémoire, en se fondant<br />
sur <strong>de</strong>ux exemples historiques.<br />
L’oubli sélectif <strong>de</strong>s événements décrits<br />
par Korsakoff en fonction <strong>de</strong>s catégories<br />
<strong>de</strong> Ribot que l’on peut retraduire<br />
en Bergson est l’occasion d’une analyse<br />
<strong>de</strong>s positions théoriques trop superficiellement<br />
opposées <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux auteurs.<br />
Pierre Hum analyse la métho<strong>de</strong><br />
originale suivie par Ribot <strong>de</strong> sa construction<br />
d’un modèle <strong>de</strong> mémoire multiple<br />
sur la base <strong>de</strong>s formes d’oubli pathologique<br />
: amnésies temporaires, progressives<br />
et partielles.<br />
Le thème <strong>de</strong> la multiplicité et <strong>de</strong>s bases<br />
neurologiques <strong>de</strong> l’inconscient, et toutes<br />
les ambiguïtés <strong>de</strong> la clinique se retrouvent<br />
chez Jean Delay, dont Rodolphe<br />
Van Wijnendaele analyse la thèse <strong>de</strong><br />
doctorat ès lettres, à l’intersection <strong>de</strong><br />
Ribot, Bergson, Freud, Janet, et Jackson,<br />
caractéristique <strong>de</strong> la tradition psychopathologique<br />
française.<br />
Sonu Shamdasani décrit l’émergence<br />
du curieux concept <strong>de</strong> mémoire organique,<br />
associant étroitement, sinon i<strong>de</strong>ntifiant,<br />
l’hérédité organique et la mémoire<br />
psychique. Evelyne Pewzner<br />
reprend les modalités diverses selon<br />
lesquelles la mémoire et l’oubli seront<br />
traités par les magnétiseurs <strong>de</strong>puis Mesmer,<br />
puis par les hypnotiseurs tout au<br />
long du XIX e siècle. Pierre-Henri Castel,<br />
dans une perspective psychanalytique<br />
abor<strong>de</strong> l’histoire et l’état <strong>de</strong>s lieux <strong>de</strong> la<br />
question du traumatisme psychique (diffusion<br />
du concept dans l’espace culturel<br />
et social, biologisation, incertitu<strong>de</strong><br />
N°3 - TOME XIX - AVRIL 2006<br />
ce un désir d’éternité consistant à<br />
convoquer les mânes <strong>de</strong> tous ces<br />
auteurs afin <strong>de</strong> les incorporer ? Un<br />
souci <strong>de</strong> la totalité, un travail encyclopédique,<br />
si fréquent au Moyen Age ?<br />
Grâce à la démesure qu’il exprime à<br />
travers l’importance et la diversité <strong>de</strong><br />
son oeuvre, grâce à la somme <strong>de</strong>s stratagèmes<br />
qui en interdisent l’accès tout<br />
en ménageant la lisibilité <strong>de</strong>s pièges<br />
qui la défen<strong>de</strong>nt, Opicinus <strong>de</strong> Canistris<br />
nous donne à découvrir l’univers mystique<br />
dans lequel il s’est à jamais enfermé,<br />
un univers proliférant aux marges<br />
<strong>de</strong> la divinité, sous les couleurs kaléidoscopiques<br />
d’i<strong>de</strong>ntifications prestigieuses<br />
éphémères et incessantes, bruissant<br />
d’innombrables personnages qui<br />
lui prêtent leurs discours dans un chaos<br />
mouvant dominé et aimanté par les<br />
pôles du salut et <strong>de</strong> la damnation, <strong>de</strong> la<br />
mégalomanie et <strong>de</strong> la persécution.<br />
Témoin d’un Moyen Age lui-même<br />
tiraillé entre ses multiples hantises, Opicinus,<br />
servi par l’étendue <strong>de</strong> ses connaissances,<br />
par l’intelligence avec laquelle il<br />
les utilise opportunément, et par la<br />
créativité qu’il exerce si habilement, est<br />
un véritable maître ès-culture, ouvrant<br />
<strong>de</strong> nouvelles perspectives aux recherches<br />
psychiatriques, artistiques,<br />
historiques et autres ; nouvelles, car,<br />
tandis que son oeuvre était tournée<br />
vers les temps bibliques et l’antiquité<br />
gréco-latine, ces perspectives bénéficient,<br />
aujourd’hui, d’un exceptionnel<br />
recul <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> six siècles d’évolution<br />
<strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> pensée. <br />
Guy ROUX<br />
Neuro-psychiatre, 27 rue du Maréchal Joffre,<br />
64000 Pau.<br />
ROUX G. et LAHARIE M., Art et Folie au<br />
Moyen Age. Aventures et Enigmes d’Opicinus<br />
<strong>de</strong> Canistris (1296-1351 ?), Paris, le<br />
Léopard d’Or, 1997, 364p. et 94 ill.<br />
ROUX G., Opicinus <strong>de</strong> Canistris (1296-<br />
1352 ?). Prêtre, Pape et Christ ressuscité,<br />
Paris, le Léopard d’Or, 2005.<br />
thérapeutique).<br />
Christophe Alsaleh tente <strong>de</strong> comprendre<br />
ce qu’est le phénomène du faux souvenir,<br />
dans la perspective <strong>de</strong> la philosophie<br />
<strong>de</strong> l’esprit et <strong>de</strong> la théorie <strong>de</strong> la<br />
connaissance, et indépendamment du<br />
contexte clinique dans lequel le syndrome<br />
s’est élaboré.<br />
La place <strong>de</strong> l’inconscient soulignée <strong>de</strong>s<br />
les commencements <strong>de</strong> la métho<strong>de</strong> expérimentale<br />
en psychologie, est restituée<br />
ici par l’analyse <strong>de</strong>s travaux d’Ebbinghaus<br />
sur la mémoire. Serge Nicolas<br />
s’attache à en montrer l’enracinement<br />
dans la psychologie philosophique alleman<strong>de</strong><br />
plus que dans l’associationnisme<br />
britannique. Bernard Andrieu<br />
tente <strong>de</strong> comprendre comment la mémoire<br />
traverse l’œuvre <strong>de</strong> Binet, <strong>de</strong><br />
l’étu<strong>de</strong> du calcul mental, qui pour lui est<br />
un fait <strong>de</strong> mémoire, jusqu’aux étu<strong>de</strong>s<br />
sur la mémoire visuelle et auditivoverbale.<br />
Véronique Quaglino, suivant, entre<br />
autres, Atkinson, Schacter, Tulving, démonte<br />
l’i<strong>de</strong>ntification progressive <strong>de</strong><br />
systèmes <strong>de</strong> mémoires différents structurellement<br />
et fonctionnellement, issue<br />
<strong>de</strong> l’observation clinique et <strong>de</strong> l’expérimentation.<br />
David Romand et Marc Jeannerod<br />
livrent une histoire <strong>de</strong> la mémoire<br />
<strong>de</strong> l’action. Georges Charpentier, qui en<br />
a été un témoin direct, rapporte l’histoire<br />
<strong>de</strong> la neurochimie <strong>de</strong>s processus<br />
mnésiques. Gérard Czternasty démontre<br />
que l’œuvre <strong>de</strong> Eric Kan<strong>de</strong>l se situe dans<br />
le champ <strong>de</strong>s neurosciences et <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> la plasticité. Jean-Noël Missa, enfin,<br />
rappelle plusieurs <strong>de</strong>s intuitions anciennes<br />
<strong>de</strong> Ribot (la pluralité <strong>de</strong>s mémoires<br />
locales possédant chacune un<br />
siège particulier, l’idée d’association et<br />
<strong>de</strong> stabilisation <strong>de</strong> connexions anatomiques,<br />
l’idée selon laquelle mémoire<br />
et perception sont traitées par les mêmes<br />
régions corticales).
N°3 - TOME XIX - AVRIL 2006<br />
l’usage <strong>de</strong>s honnêtes gens <strong>de</strong> Robert-<br />
Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois<br />
ainsi que Influence et manipulation <strong>de</strong><br />
Robert Cialdini. Ces ouvrages, je les ai<br />
lu juste après ma thèse. C’est à ce<br />
moment que j’ai décidé <strong>de</strong> repartir à<br />
zéro et j’ai tenté <strong>de</strong> lire tout ce qu’il y<br />
avait dans ce domaine. Cela m’a pris<br />
<strong>de</strong>ux ans mais je gar<strong>de</strong> <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong><br />
un souvenir impérissable. J’étais<br />
maître <strong>de</strong> conférence débutant dans<br />
l’enseignement supérieur à l’époque et<br />
je n’avais pas <strong>de</strong> charges administratives<br />
excessives. Je consacrais donc<br />
beaucoup <strong>de</strong> temps à la lecture d’articles.<br />
J’ai fait le rat <strong>de</strong> bibliothèque<br />
pour obtenir certains articles qui avaient<br />
parfois plus <strong>de</strong> 30 ans. J’ai mis au point<br />
<strong>de</strong>s systèmes logiciels et Web pour<br />
pourvoir obtenir ces articles en pistant<br />
les collègues étrangers sur Internet et en<br />
leur <strong>de</strong>mandant <strong>de</strong>s tirés-à-part <strong>de</strong> leur<br />
article. C’était un plaisir sans cesse<br />
renouvelé car il y a quelque chose <strong>de</strong><br />
« magique » dans l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s processus<br />
d’influence et <strong>de</strong> manipulation du comportement.<br />
Vous imaginez donc le plaisir<br />
que je ressentais lorsque je lisais un<br />
article présentant une nouvelle technique<br />
d’influence ou étudiant une<br />
variable sur un paradigme existant.<br />
C’était du bonheur (et ça le reste toujours).<br />
Ces milliers d’articles lus étaient<br />
synthétisés en une ou <strong>de</strong>ux pages et<br />
j’avais conçu un système informatique<br />
pour les organiser. Comme quoi, cela<br />
me permettait d’utiliser <strong>de</strong>s compétences<br />
acquises précé<strong>de</strong>mment. J’utilise<br />
d’ailleurs toujours ces compétences<br />
en informatique pour conduire <strong>de</strong>s<br />
expériences notamment celles sur les<br />
processus d’influence sur Internet.<br />
M. S.-C. : La psychologie est-elle un outil<br />
très utilisé dans le commerce actuel ?<br />
(ou peu, ou pas du tout, ou <strong>de</strong> façon<br />
variée selon les pays). Est-elle efficace ?<br />
N. G. : Au cours <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong> ma<br />
carrière d’enseignant-chercheur, je me<br />
suis retrouvé dans un département formant<br />
<strong>de</strong>s commerciaux et j’ai décidé<br />
d’orienter mes cours sur l’influence du<br />
comportement d’achat. C’est à ce<br />
La psychologie du<br />
consommateur<br />
Entretien avec Nicolas Gueguen par Michel Sachez-Car<strong>de</strong>nas<br />
moment là que j’ai découvert que les<br />
chercheurs en psychologie sociale <strong>de</strong>s<br />
pays anglo-saxons travaillaient <strong>de</strong>puis<br />
longtemps en marketing. Ce qui n’est<br />
absolument pas le cas en France. Ce<br />
que l’on observe dans notre pays - et<br />
c’est le cas pour <strong>de</strong> nombreuses disciplines<br />
- c’est le cloisonnement disciplinaire<br />
faisant que vous n’allez pas voir ce<br />
qui se fait ailleurs. Ce qui est révélateur<br />
par exemple c’est le fait que <strong>de</strong>s<br />
revues scientifiques comme Psychology<br />
and Marketing ou <strong>Journal</strong> of Consumer<br />
Psychology sont inconnues <strong>de</strong> mes collègues<br />
français <strong>de</strong> la discipline. Il reste<br />
que, par tradition, la psychologie sociale<br />
française s’intéresse peu à l’influence<br />
du comportement. La plupart <strong>de</strong>s psychologues<br />
sociaux français travaillent<br />
sur le jugement, les représentations et<br />
les attitu<strong>de</strong>s. Pour l’heure, nous ne<br />
sommes qu’une poignée à travailler sur<br />
le comportement mais les choses semblent<br />
changer, notamment sous l’impulsion<br />
<strong>de</strong>s étudiants en thèse que nous<br />
formons.<br />
Toutefois, les chercheurs en marketing<br />
en France intègrent parfaitement, dans<br />
leur littérature scientifique et leurs<br />
métho<strong>de</strong>s, les apports <strong>de</strong> la psychologie<br />
du consommateur : mémoire, sensation,<br />
affect, influence du comportement<br />
d’achat… sont autant <strong>de</strong> thèmes<br />
<strong>de</strong> recherches que l’on trouve dans les<br />
publications et les thèses <strong>de</strong> marketing<br />
en France.<br />
Avec le recul que j’ai à présent et toutes<br />
les recherches que j’ai pu conduire en<br />
situation réelle, je peux facilement dire<br />
que l’approche <strong>de</strong> la psychologie et<br />
<strong>de</strong>s processus qu’elle étudie montre<br />
que cette discipline apporte la preuve<br />
<strong>de</strong> son efficacité sur le comportement<br />
du consommateur.<br />
M. S.-C. : Justement, concernant cette<br />
influence du comportement du consommateur<br />
pouvez-vous nous dire quels sont<br />
les grands axes <strong>de</strong> recherches dans ce<br />
domaine que vous abor<strong>de</strong>z dans votre<br />
ouvrage « 100 petites expériences en<br />
psychologie du consommateur ».<br />
N.G. : Dans cet ouvrage, j’ai tenté, sous<br />
forme <strong>de</strong> fiches courtes et axées sur<br />
les résultats <strong>de</strong> recherches empiriques<br />
pour la plupart conduites en milieu<br />
naturel, <strong>de</strong> présenter les travaux menés<br />
ces trente <strong>de</strong>rnières années en marketing<br />
comportemental et en psychologie<br />
du consommateur. Le livre est organisé<br />
en 3 parties correspondant à <strong>de</strong>s<br />
mo<strong>de</strong>s d’évaluation du comportement<br />
du consommateur. Le premier axe est<br />
consacré à ce que j’appelle le traitement<br />
<strong>de</strong> l’information commerciale. Ici<br />
j’ai présenté comment le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> présentation<br />
<strong>de</strong>s prix (par exemple les prix<br />
« 9 » par rapport au prix « pleins » :<br />
9..99 € au lieu <strong>de</strong> 10.00 €), <strong>de</strong>s informations<br />
sur un produit (la rareté, son<br />
prix…) peuvent affecter notre comportement<br />
d’achat. J’ai, également, abordé<br />
dans cette partie l’influence réelle<br />
<strong>de</strong> la publicité sur nos actes d’achat et<br />
j’ai tenté aussi <strong>de</strong> montrer l’influence<br />
<strong>de</strong>s facteurs d’amorçage inconscients<br />
sur le comportement du consommateur.<br />
La secon<strong>de</strong> partie a étudié le lien<br />
entre perception sensorielle et comportement<br />
d’achat. J’ai essayé <strong>de</strong> présenter<br />
les travaux les plus spectaculaires<br />
sur l’influence <strong>de</strong> la musique ou<br />
<strong>de</strong>s caractéristiques <strong>de</strong> la musique<br />
(volume, tempo,…) sur le comportement<br />
d’achat et le marketing <strong>de</strong>s services.<br />
J’ai aussi tenté <strong>de</strong> présenter certains<br />
travaux sur l’influence <strong>de</strong>s o<strong>de</strong>urs,<br />
<strong>de</strong>s couleurs et <strong>de</strong> l’éclairage sur nos<br />
actes d’achat. Ici, l’objectif a été <strong>de</strong><br />
rendre compte <strong>de</strong> l’impact <strong>de</strong> l’atmo-<br />
sphère sensorielle d’un lieu <strong>de</strong> vente<br />
sur le comportement d’achat <strong>de</strong>s<br />
clients. Dans la troisième partie, j’ai présenté<br />
les facteurs d’interaction entre<br />
un client et un ven<strong>de</strong>ur qui peuvent<br />
affecter le comportement d’achat. Ici<br />
on a montré que le fait d’être touché<br />
par un ven<strong>de</strong>ur peut nous inciter à rester<br />
plus longtemps dans un magasin<br />
ou à acheter plus. L’apparence physique<br />
du ven<strong>de</strong>ur, la façon dont il vous<br />
regar<strong>de</strong>, la nature du sourire qu’il utilise<br />
sont autant <strong>de</strong> facteurs qui peuvent<br />
vous inciter à acheter plus, à acheter<br />
plus cher ou à revenir dans un magasin.<br />
Enfin, il faut savoir que si la majeure<br />
partie <strong>de</strong> cet ouvrage est consacrée aux<br />
diverses techniques qui incitent à acheter,<br />
j’ai aussi présenté, en fin d’ouvrage,<br />
<strong>de</strong>s travaux montrant que le consommateur<br />
peut, avec <strong>de</strong>s moyens simples,<br />
influencer les ven<strong>de</strong>urs et obtenir <strong>de</strong>s<br />
produits convoités à un bien meilleur<br />
prix.<br />
M. S.-C. : Quelle est, d’après vous, l’expérience<br />
la plus spectaculaire en matière<br />
<strong>de</strong> liaison entre l’acte d’achat et les motivations<br />
psychologiques du consommateur<br />
?<br />
N. G. : Toutes les expériences que je<br />
présente sont probantes dans un sens<br />
ou dans un autre, en faveur <strong>de</strong> l’incitation<br />
à la consommation ou pour<br />
démontrer ce qui n’est pas efficace.<br />
Toutefois, l’expérience la plus spectaculaire<br />
est certainement celle qui<br />
montre qu’en changeant le nom d’un<br />
produit vendu en cafétéria (par<br />
exemple une tarte habituellement<br />
dénommée « Tarte aux pommes »<br />
<strong>de</strong>vient « Tarte aux pommes façon<br />
grand-mère »), on parvient à augmenter<br />
les ventes et à changer la perception<br />
du goût du produit. Nous avons là la<br />
manifestation expérimentale qu’une<br />
simple modification, qu’un changement<br />
mineur en apparence peut avoir d’importants<br />
effets comportementaux. Cela<br />
semble, également, montrer que nos<br />
comportements sont soumis à <strong>de</strong>s<br />
sources multiples d’influence qui sont<br />
autant d’objets d’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s sciences<br />
sociales. Une autre recherche également<br />
menée dans un restaurant avec<br />
plats à emporter montre que si le personnel<br />
dit qu’une tarte aux fruits est à<br />
tel prix en promotion uniquement pour<br />
la journée, il y a quatre fois plus d’acheteurs<br />
que si on dit qu’elle est en promotion<br />
toute l’année. Une simple information<br />
sur le caractère fugitif <strong>de</strong> la<br />
bonne affaire suffit à accroître l’intérêt<br />
pour un produit. C’est bien la preuve<br />
que ce ne sont pas les qualités intrinsèques<br />
du produit qui sont importantes<br />
mais bien la valeur que le consommateur<br />
potentiel leur attribue.<br />
M. S.-C. : Les expériences que vous présentez<br />
dépassent le cadre <strong>de</strong> la consommation.<br />
Peut-on aussi lire votre livre<br />
comme une étu<strong>de</strong> sur les rapports<br />
sociaux ?<br />
N. G. : Tout à fait. A travers ces expériences<br />
<strong>de</strong> psychologie <strong>de</strong> la consommation,<br />
on apporte la preuve que le<br />
consommateur ne se débarrasse pas<br />
<strong>de</strong> ses croyances et caractéristiques<br />
sociales lorsqu’il consomme. Il entre<br />
dans un magasin équipé <strong>de</strong> ses<br />
croyances, <strong>de</strong> ses biais et du poids <strong>de</strong>s<br />
normes sociales qu’il a intégrés. Il ne<br />
faut pas non plus oublier un grand principe<br />
fondamental <strong>de</strong> la consommation :<br />
le plaisir qui la motive. Or, ce principe<br />
est souvent oublié et commence simplement<br />
à être pris en compte. Les chercheurs<br />
en sciences du comportement<br />
du consommateur qui travailleront sur<br />
ce principe <strong>de</strong> plaisir dans les années<br />
à venir seront certainement ceux qui<br />
apporteront le plus d’innovations marketing<br />
et commerciales.<br />
IV Ren<strong>de</strong>z-vous International<br />
L’Internationale <strong>de</strong>s Forums et <strong>de</strong> l’Ecole <strong>de</strong><br />
Psychanalyse <strong>de</strong>s Forums du Champ Lacanien<br />
1 et 2 Juillet 2006<br />
LES RÉALITÉS SEXUELLES<br />
ET L’INCONSCIENT<br />
PARIS<br />
Palais <strong>de</strong>s Congrès<br />
Porte Maillot<br />
Traduction simultanée :<br />
français, italien, espagnol, portugais<br />
Renseignements :<br />
EPFCL, 118 rue d’Assas<br />
75006 Paris<br />
www.champ-lacanien.net<br />
Tél : 01 56 24 22 56<br />
epfcl.secretariat@wanadoo.fr<br />
<br />
ENTRETIEN 9<br />
LIVRES ET REVUES<br />
L’œdipe<br />
Le concept le plus crucial <strong>de</strong> la<br />
psychanalyse<br />
J. D. Nasio<br />
Payot, 16 €<br />
« Je vous <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’imaginer ce petit<br />
garçon se glissant doucement dans<br />
la salle <strong>de</strong> bains et découvrant juste à<br />
la hauteur <strong>de</strong> ses yeux, les fesses attirantes<br />
<strong>de</strong> sa mère. Son œil s’allume, il<br />
s’approche et sans crier gare, il mord<br />
à pleines <strong>de</strong>nts. C’est ça, l’Oedipe ! L’Oedipe,<br />
c’est mordre les fesses d’une mère ».<br />
C’est ça, l’ouvrage <strong>de</strong> Nasio : une série<br />
<strong>de</strong> formules-clés et fortes pour<br />
nous faire saisir, <strong>de</strong> l’inténieur, la puissance<br />
vive <strong>de</strong>s pulsions qui nous animent<br />
et nous poussent hors <strong>de</strong> nous,<br />
vers l’Autre. Plusieurs tableaux schématiques<br />
tentent <strong>de</strong> résumer le propos<br />
: « vue générale <strong>de</strong> l’Oedipe du<br />
garçon », « logique <strong>de</strong> l’Oedipe <strong>de</strong> la<br />
fille », « la névrose morbi<strong>de</strong> chez l’homme »,<br />
« la névrose morbi<strong>de</strong> chez la femme »,<br />
etc... etc... L’ensemble est un peu à<br />
l’emporte-pièce, mais la jubilation <strong>de</strong><br />
l’auteur est communicative.<br />
M. Goutal<br />
Langues et traduction<br />
Recherches en Psychanalyse<br />
2005 n°4<br />
L’Esprit Du Temps, 21 €<br />
Le langage est au centre <strong>de</strong>s problématiques<br />
<strong>de</strong> la psychanalyse, il engage<br />
le sujet et <strong>de</strong>s locuteurs. Entre<br />
eux s’interposent la langue et la traduction.<br />
Qu’il s’agisse <strong>de</strong> la compréhension<br />
à l’interview d’un système<br />
langagier ou entre <strong>de</strong>ux systèmes <strong>de</strong><br />
langue, la traduction est au coeur du<br />
dé-codage du sens (cf. traduction/ trahison).<br />
Ce numéro compte <strong>de</strong> nombreuses<br />
contributions <strong>de</strong> François Richard,<br />
Mareike Wolf-Fédida, Houriya Ab<strong>de</strong>louahed,<br />
Fethi Benslama, B. Bonneau,<br />
Colette Rigaud, Pedro Ben<strong>de</strong>towicz,<br />
Maurizio Balsamo ; et un dossier particulier<br />
autour du yiddish et <strong>de</strong> l’écrivain<br />
yiddish Louis Wolfson avec Max<br />
Kohn (« Louis Wolfson : une langue.,<br />
c’ est-<strong>de</strong> la folie, et la folie est-ce que<br />
c’est une langue ? »), Robert Samacher<br />
(« Louis Wolfson et le yiddish »), André<br />
Michels (« La quête <strong>de</strong> la langue maternelle<br />
»), Rosette Tama « Louis Wolfson<br />
et le labyrinthe <strong>de</strong>s langues ; et le<br />
yiddish : langue égarée -langue marrane<br />
»).<br />
Signaler, et après ?<br />
Sous la direction <strong>de</strong> Jean-Louis Le<br />
Run, Antoine Leblanc, Françoise<br />
Sarny<br />
Erès, 12 €<br />
Il s’agit d’une version actualisée du<br />
numéro 23 <strong>de</strong> la revue Enfances &<br />
Psy. La levée <strong>de</strong> la chape <strong>de</strong> silence<br />
entourant la maltraitance envers les<br />
enfants a provoqué une inflation <strong>de</strong>s<br />
signalements à l’autorité judiciaire,<br />
débordant les capacités <strong>de</strong> traitement<br />
<strong>de</strong>s tribunaux <strong>de</strong>s mineurs et <strong>de</strong>s services<br />
éducatifs. Les professionnels se<br />
sont d’abord inquiétés <strong>de</strong> savoir comment<br />
reconnaître les signes <strong>de</strong> mauvais<br />
traitements, les « clignotants », ou<br />
encore comment signaler. Maintenant,<br />
la plupart <strong>de</strong>s intervenants ont<br />
acquis une expérience qui leur permet<br />
d’élaborer leur pratique.<br />
Actuellement, leurs questions ne<br />
concernent pas tant la pertinence du<br />
signalement que ses suites et ses<br />
conséquences.<br />
Cet ouvrage s’intéresse plus particulièrement<br />
à ce temps, plus ou moins<br />
long, qui suit l’envoi du signalement<br />
à l’autorité judiciaire et va jusqu’à la<br />
mise en place d’une prise en charge<br />
bien établie.
10<br />
ENTRETIEN<br />
M. S.-C. : Dans votre autre ouvrage<br />
« Psychologie <strong>de</strong> la manipulation et <strong>de</strong><br />
la soumission » également paru chez<br />
Dunod en 2004, vous mettez en évi<strong>de</strong>nce<br />
plusieurs axes d’influence du comportement.<br />
Pouvez-vous nous en dire<br />
plus à ce sujet ?<br />
N. G. : Contrairement à mon <strong>de</strong>rnier<br />
ouvrage 100 petites expériences en psychologie<br />
du consommateur, le livre Psychologie<br />
<strong>de</strong> la manipulation et <strong>de</strong> la soumission<br />
vise à faire le point sur les<br />
travaux <strong>de</strong> recherche portant sur 3<br />
aspects <strong>de</strong> la soumission. La soumission<br />
à l’autorité : comment et <strong>de</strong> quelle<br />
manière et jusqu’où on peut aller<br />
lorsqu’une source d’autorité nous<br />
donne un ordre contraire à notre morale<br />
? Le <strong>de</strong>uxième chapitre porte sur ce<br />
que l’on appelle la soumission librement<br />
consentie et l’engagement. Ici,<br />
j’ai cherché à présenter l’ensemble <strong>de</strong>s<br />
techniques connues <strong>de</strong>s chercheurs en<br />
psychologie qui permettent d’amener<br />
un individu à accepter une requête<br />
peu problématique (faire un don à une<br />
association, donner un coup <strong>de</strong> mains<br />
à quelqu’un dans la rue) ou un comportement<br />
dont les conséquences<br />
seront plus graves (investissement à<br />
perte, entrée dans une secte….).<br />
Enfin, ce livre comprenait, également,<br />
une synthèse sur les procédures d’influence<br />
non verbale et tout particulièrement<br />
l’effet du contact tactile, du<br />
regard et du sourire dans les interactions<br />
humaines. Ces <strong>de</strong>rniers travaux<br />
sont peu connus <strong>de</strong>s chercheurs français.<br />
M. S.-C. : Je sais également que vous<br />
travaillez sur les processus <strong>de</strong> séduction ?<br />
Pourriez-vous nous parler un peu <strong>de</strong> ces<br />
travaux et nous dire quelle est la frontière<br />
entre la Manipulation/Séduction ? .<br />
N. G. : Je prépare en effet un ouvrage<br />
qui <strong>de</strong>vrait s’intituler 100 recherches<br />
sur la séduction et le comportement<br />
amoureux. L’objectif <strong>de</strong> ce livre est <strong>de</strong><br />
faire une présentation <strong>de</strong>s facteurs qui<br />
ont été i<strong>de</strong>ntifiés comme <strong>de</strong>s éléments<br />
induisant certains comportements<br />
amoureux, <strong>de</strong> séduction, d’approche<br />
<strong>de</strong>s personnes. Le livre présentera<br />
d’ailleurs <strong>de</strong>s thèmes d’influence<br />
proches <strong>de</strong> ceux présentés dans 100<br />
petites expériences en psychologie du<br />
consommateur.<br />
C’est le cas <strong>de</strong> l’influence <strong>de</strong>s o<strong>de</strong>urs,<br />
<strong>de</strong> certaines couleurs, du toucher dans<br />
le cas <strong>de</strong> sollicitation amoureuses…<br />
Par exemple, on trouve certains comportements<br />
non-verbaux qui affectent<br />
le comportement <strong>de</strong>s consommateurs<br />
et celui <strong>de</strong>s personnes que l’on tente <strong>de</strong><br />
séduire. Ainsi, on a pu montrer que le<br />
contact tactile d’un client dans un<br />
magasin l’incite à acheter plus, à accor<strong>de</strong>r<br />
plus favorablement un pourboire à<br />
un serveur ; à juger plus positivement<br />
un magasin… Et bien, on a également<br />
montré qu’une jeune femme sollicitée<br />
dans la rue pour donner son numéro<br />
<strong>de</strong> téléphone à un garçon qui l’abor<strong>de</strong><br />
consentira plus volontiers à sa requête<br />
si ce <strong>de</strong>rnier l’a touché 1 à 2 secon<strong>de</strong>s<br />
sur le bras. La frontière entre manipulation/séduction<br />
apparaît en effet très<br />
fine et, en comparant ces travaux, on<br />
voit une certaine universalité <strong>de</strong>s facteurs<br />
d’influence <strong>de</strong>s comportements<br />
qui, en apparence, apparaissent très<br />
différents.<br />
M. S.-C. : Séduction/Perversion : le psy<br />
possè<strong>de</strong> <strong>de</strong>s outils pour comprendre la<br />
manipulation et la soumission. Comment<br />
les utiliser au mieux (notamment pour<br />
faire que les personnes ne se laissent pas<br />
manipuler) et non pour les utiliser (les<br />
personnes) à leur insu ? Cela doit être<br />
une question omniprésente dans votre<br />
champ.<br />
N. G. : Pour repérer la manipulation, il<br />
faut, en effet, les clés pour déco<strong>de</strong>r les<br />
techniques et l’un <strong>de</strong>s objectifs <strong>de</strong> mes<br />
ouvrages est aussi <strong>de</strong> rendre les individus<br />
clairvoyants <strong>de</strong> ces techniques. Toutefois,<br />
on sait aussi que cela ne suffit pas<br />
et <strong>de</strong>s expériences ont montré que <strong>de</strong>s<br />
gens informés <strong>de</strong> l’effet d’une technique<br />
d’influence tombaient quelques<br />
minutes plus tard dans un piège i<strong>de</strong>ntique<br />
pour peu que la nouvelle technique<br />
utilisée auprès d’eux était différente<br />
ou possédait un habillage la<br />
rendant, en apparence, différente. Il<br />
semble que nous avons <strong>de</strong>s automatismes<br />
en nous que les techniques <strong>de</strong><br />
manipulation peuvent activer. Or, on<br />
ne connaît encore qu’une partie <strong>de</strong> ces<br />
processus d’influence.<br />
Bien entendu, je me suis posé la question<br />
du risque associé à une telle divulgation<br />
mais j’ai, aujourd’hui, plusieurs<br />
éléments d’analyse qui m’incitent à<br />
continuer à faire connaître ces procédures<br />
et, par voie <strong>de</strong> conséquence, à<br />
continuer mes propres recherches.<br />
D’une part, ceux qui veulent utiliser<br />
ces techniques au dépend d’autrui ou<br />
pour leur intérêt, connaissent ces techniques.<br />
Par exemple, les procédures<br />
utilisées par les sectes pour trouver<br />
leurs membres sont particulièrement<br />
connues, efficaces et sans cesse adaptées,<br />
modifiées. Les escrocs n’ont pas<br />
attendu, non plus, <strong>de</strong>s ouvrages <strong>de</strong> ce<br />
type pour officier. Le mieux à faire<br />
pour protéger les gens est <strong>de</strong> faire<br />
connaître ces mécanismes ce qui permet<br />
<strong>de</strong> contrer quelque temps ceux<br />
qui les emploient à notre insu.<br />
Enfin, il ne faut pas non plus voir que<br />
le côté négatif <strong>de</strong>s choses car une technique<br />
<strong>de</strong> vente pour vous inciter à<br />
boire <strong>de</strong>s boissons sucrées, à rester<br />
<strong>de</strong>vant votre téléviseur, à acheter tel<br />
produit non indispensable sera sensiblement<br />
la même qu’une technique<br />
<strong>de</strong>stinée à vous faire arrêter <strong>de</strong> fumer,<br />
N°3 - TOME XIX - AVRIL 2006<br />
à faire <strong>de</strong> l’exercice ou à œuvrer au<br />
profit d’une association caritative. Il y<br />
a, aujourd’hui, <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s problématiques<br />
qui réclament l’intérêt et l’expertise<br />
<strong>de</strong>s chercheurs en sciences du<br />
comportement et <strong>de</strong> la cognition<br />
comme la santé, l’adaptation et la satisfaction<br />
au travail, la prévention <strong>de</strong>s<br />
comportements à risques…<br />
Or, pour parvenir à être efficace dans<br />
ce domaine, il faut nécessairement<br />
recourir à <strong>de</strong>s procédures d’influence.<br />
Mon objectif est aussi d’offrir <strong>de</strong>s pistes<br />
méthodologiques aux praticiens du<br />
domaine.
N°3 - TOME XIX - AVRIL 2006<br />
« Vous père (...), vous avez échappé<br />
au service militaire en prenant le nom<br />
d’une famille sans enfant qui vous avait<br />
adopté temporairement. Si je <strong>de</strong>vais<br />
prendre un pseudonyme c’est celui là<br />
que je choisirai en souvenir <strong>de</strong> vous, et,<br />
si je dois aller à l’hôtel avec une maîtresse<br />
c’est sous votre nom, mère, que je<br />
l’inscrirais (...) mais une telle chance ne<br />
m’a jamais été donnée. Pourtant aujourd’hui<br />
j’aimerais tellement agir comme si<br />
vous étiez envie ».<br />
Yasunari KAWABATA (1899-1972)<br />
in L’adolescent.<br />
« La culture japonaise » expression globalisante<br />
qui dirait que le tout est révélateur<br />
du particulier. Mais c’est ainsi<br />
que l’on reçoit, comme un choc, la<br />
confrontation à un mon<strong>de</strong> dont on<br />
parvient avec peine à discerner la foule<br />
<strong>de</strong>s petites différences tant est gran<strong>de</strong><br />
celle que l’on ressent à le rencontrer.<br />
Le Japon étrange étranger, masse<br />
inquiétante qui vient bousculer les<br />
représentations que l’on s’était faites<br />
avant <strong>de</strong> s’y colleter.<br />
On imagine un mon<strong>de</strong> raffiné et l’on<br />
reste ébahi <strong>de</strong>vant la crudité qu’il<br />
impose. La codification poussée à l’extrême<br />
<strong>de</strong>s rapports humains vient faire<br />
révélateur <strong>de</strong> la brutalité au cœur <strong>de</strong><br />
ceux-ci.<br />
Impossible <strong>de</strong> pénétrer l’âme japonaise<br />
?<br />
Le gaijin qui s’y essaye fera figure <strong>de</strong><br />
prétentieux. L’audace ne sera pas<br />
récompensée ni même admirée. Prétendre<br />
y comprendre quelque chose<br />
mène très rapi<strong>de</strong>ment à se trouver<br />
exilé.<br />
Il nous faut reconnaître que notre<br />
point <strong>de</strong> vue est inévitablement éthnocentriste.<br />
Nous parlons <strong>de</strong> l’écho<br />
que produit en nous la rencontre avec<br />
la « chose » japonaise. Armés <strong>de</strong> nos<br />
outils conceptuels occi<strong>de</strong>ntaux nous<br />
partons à l’assaut d’une forteresse qui<br />
se défend <strong>de</strong>puis plus <strong>de</strong> quatre siècles<br />
<strong>de</strong> l’objectivation que l’on voudrait lui<br />
faire subir. On est donc amené à ne<br />
pouvoir dire que <strong>de</strong>s instantanés <strong>de</strong><br />
vie. Description <strong>de</strong> ce qui se vit. Prise<br />
sur le vif du sujet. Comment transmettre<br />
l’expérience <strong>de</strong> la déréalisation<br />
? Comprendre c’est-à-dire incorporer<br />
?<br />
Le Japon objet fétiche ?<br />
On rêve un mon<strong>de</strong> raffiné <strong>de</strong> samouraïs<br />
à l’honneur inébranlable, <strong>de</strong> quartiers<br />
<strong>de</strong> plaisir, d’architecture naturaliste,<br />
<strong>de</strong> jardins miniaturisés et<br />
ordonnés. On rencontre un mon<strong>de</strong><br />
hybri<strong>de</strong>, paradoxale où tout se mêle,<br />
où la perte <strong>de</strong> repère est permanente,<br />
insaisissable dans lequel les subtilités<br />
nous font parfois confiner à la folie.<br />
Inquiétante étrangeté. C’est qu’il y a<br />
du familier dans le mon<strong>de</strong> japonais.<br />
Tout comme Freud confronté à son<br />
image dans la vitre du train nous nous<br />
mirons dans le Japon que nous<br />
recréons. La fascination qu’il exerce<br />
sur nous ou le dégoût que l’on peut en<br />
avoir face à cette cuisine du cru, face<br />
à ces estampes pornographiques, face<br />
aux flots d’hémoglobine <strong>de</strong>s séries TV<br />
historiques...<br />
Le Japon que nous rêvons n’existe plus<br />
que dans ses rituels, lesquels peuvent<br />
venir faire écran <strong>de</strong> fumée, souvenir<br />
écran... Derrière, se cache souvent une<br />
mère dominatrice, castratrice disent<br />
certains auteurs japonais. Le Japon<br />
d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier ?<br />
Cette société qui pensait le geste parfait<br />
: cérémonie du thé, tir à l’arc, calligraphie,<br />
théâtre... s’est jetée à corps<br />
perdu dans la performance. Est-ce si<br />
différent ?<br />
L’observateur, parti à la découverte<br />
du Japon, ne manquera pas d’être marqué<br />
par la capacité que chacun semble<br />
avoir à vivre plusieurs i<strong>de</strong>ntités en<br />
même temps : être un homme mo<strong>de</strong>rne<br />
et traditionnel, soumis et autoritaire,<br />
courtois et hautain... Tout ceci<br />
contribue au sentiment <strong>de</strong> fausseté<br />
L’amer du Japon<br />
que nous autres occi<strong>de</strong>ntaux ressentons<br />
dans nos relations aux Japonais.<br />
La notion d’exclusivité si présente dans<br />
nos cultures occi<strong>de</strong>ntales, qui, par le<br />
biais <strong>de</strong> la locution « ou », nous amène<br />
à toujours choisir l’un <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux termes<br />
et nie la dualité qui pourrait être présente<br />
en toute chose, n’existe pas au<br />
Japon. « Ou » signifie bien toujours<br />
« et/ou ». Ce principe d’inclusion rappelle<br />
cette nation d’espace, entre <strong>de</strong>ux,<br />
mais il s’agit d’un espace qui fait lien<br />
indissociable <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong>s termes<br />
qu’il relie et en même temps entité<br />
propre. Tout comme la langue dans<br />
laquelle la pensée et l’image se mêlent.<br />
Les Japonais appellent cela le ma, un<br />
espacement chargé <strong>de</strong> sens, à la fois<br />
vi<strong>de</strong> et décalage. Cet espace permet<br />
d’envisager tous les possibles.<br />
Signifiant, il permet <strong>de</strong> lier un terme<br />
à un autre, et donc <strong>de</strong> les rendre<br />
congruents, <strong>de</strong> dépasser l’antinomie,<br />
non en faisant s’affronter <strong>de</strong>ux termes<br />
pour en créer un troisième, comme<br />
dans la dialectique hégélienne, mais<br />
en les faisant coexister dans un espace<br />
très particulier qu’est le ma. Lier en<br />
séparant, être en n’étant pas, incarner<br />
ce qui n’a pas <strong>de</strong> chair... marge, bordure,<br />
lieu où l’on n’est ni vraiment<br />
<strong>de</strong>hors, ni vraiment <strong>de</strong>dans, ma se lit<br />
aussi d’autres façons, correspondant à<br />
<strong>de</strong> nombreuses significations axées sur<br />
le concept <strong>de</strong> la relation : la dépendance,<br />
le lien, l’amour, le <strong>de</strong>stin, le<br />
mariage, le hasard...<br />
Le manque fon<strong>de</strong> une esthétique que<br />
l’on retrouve, par exemple, dans cette<br />
marge <strong>de</strong> chair nue dans le cou <strong>de</strong>s<br />
geishas entre la nuque fardée et les<br />
cheveux, considérée comme éminemment<br />
érotique (fétichisation du<br />
manque ?), et qui organise la recherche<br />
<strong>de</strong> la voie du désir.<br />
La dialectique spatiale intérieur/extérieur<br />
induite par la peur <strong>de</strong> l’étranger<br />
(étranger au sens <strong>de</strong> Camus, que l’on<br />
ne connaît pas, qui est inquiétant, qui<br />
ne se laisse pas incorporer) est motif<br />
d’angoisse et conduit à l’élaboration<br />
d’un système <strong>de</strong> codification très<br />
sophistiqué régulant la relation à l’autre<br />
qui se manifeste, entre autre, dans le<br />
langage, rendant, par-là même, l’accès<br />
à la maîtrise <strong>de</strong> la langue très difficile<br />
pour les étrangers.<br />
C’est que l’homo japonicus est passé<br />
maître dans l’art <strong>de</strong> la dialectique.<br />
On retrouve cette conception <strong>de</strong> la<br />
relation au cœur <strong>de</strong>s relations familiales.<br />
Elle modèle le rapport que l’individu<br />
aura à son environnement.<br />
Dans la société japonaise, bébés et<br />
vieillards bénéficient d’un maximum<br />
<strong>de</strong> liberté et d’indulgence. L’âge adulte<br />
est le moment où la liberté d’agir<br />
est au plus bas. Etre à l’apogée <strong>de</strong> sa<br />
force physique et capable <strong>de</strong> gagner<br />
sa vie ne signifie pas que l’on a liberté<br />
d’action, bien au contraire la rencontre<br />
avec le mon<strong>de</strong> extérieur participe à la<br />
mise en place d’un arsenal contra-phobique<br />
extrêmement puissant pour faire<br />
face à l’angoisse que suscite cette rencontre.<br />
Et, dans un même mouvement,<br />
la société est « une gran<strong>de</strong> famille, donc<br />
dans une gran<strong>de</strong> famille on peut se permettre<br />
<strong>de</strong> rester enfant » (1).<br />
Il existe un sentiment profond <strong>de</strong><br />
continuité qui permet que la dépendance<br />
au père, même si elle se prolonge<br />
à l’âge adulte, ne soit pas objet<br />
<strong>de</strong> honte ou d’humiliation comme ça<br />
peut l’être en occi<strong>de</strong>nt. Par contre, elle<br />
est un poids tant elle engage la responsabilité<br />
<strong>de</strong> l’enfant qui en prenant<br />
la place du père constitue une assurance<br />
sur l’avenir pour celui-ci.<br />
La discipline et l’éducation sont entre<br />
les mains <strong>de</strong>s femmes. Il existe même<br />
une rivalité proverbiale entre les mères<br />
et les grands-mères paternelles au sujet<br />
<strong>de</strong>s enfants. On peut dire que les unes<br />
et les autres font la « cour » à l’enfant et<br />
la grand-mère se sert souvent <strong>de</strong> lui<br />
pour dominer sa belle fille. Ayant, par<br />
ailleurs, la main mise sur son propre<br />
fils. Alors que les mères occi<strong>de</strong>ntales<br />
éduquent leurs enfants très tôt à se<br />
sentir autonomes et responsables <strong>de</strong><br />
soi, les mères japonaises les sollicitent,<br />
au contraire, à s’abandonner au soin et<br />
à l’indulgence qu’elles prodiguent. L’attitu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> dépendance ainsi engendrée<br />
serait la source d’une gratification que<br />
l’adulte chercherait à retrouver auprès<br />
<strong>de</strong> ses collègues <strong>de</strong> travail et <strong>de</strong> ses<br />
supérieurs.<br />
La proximité corporelle est très importante<br />
mais l’enfant ne doit pas dormir<br />
avec sa mère tant qu’il n’est pas assez<br />
grand pour faire preuve d’initiatives.<br />
Lorsqu’il tend les bras et fait connaître<br />
ses exigences, vers un an, alors il dort<br />
avec sa mère, dans ses bras. L’enfant<br />
est, par ailleurs soumis à une gran<strong>de</strong><br />
passivité pour tout ce qui concerne<br />
son développement psychomoteur.<br />
Tous les gestes, postures qu’il aura à<br />
faire sont induits par l’adulte qui le<br />
manipule comme une marionnette.<br />
Traditionnellement, l’enfant ne doit<br />
pas se traîner par terre, il ne doit pas se<br />
mettre <strong>de</strong>bout ou faire ses premiers<br />
pas avant un an. La mère empêche<br />
<strong>de</strong> telles tentatives. Après les trois premiers<br />
jours <strong>de</strong> vie, le bébé peut<br />
prendre le sein à n’importe quel<br />
moment. Pour les Japonais, l’allaitement<br />
est une <strong>de</strong>s jouissances physiques<br />
les plus vives d’une femme et le bébé<br />
apprend à partager la jouissance <strong>de</strong> sa<br />
mère. Le sein est nourriture mais aussi<br />
joie et confort. Le sevrage est tardif,<br />
généralement au moment <strong>de</strong> la naissance<br />
d’un autre enfant. Comment ne<br />
pas penser à l’une <strong>de</strong>s scènes du makimono<br />
intitulé « dix scènes d’amour » (2)<br />
représentant un enfant au sein tandis<br />
que sa mère est en plein acte sexuel !<br />
L’obscénité <strong>de</strong> cette gravure suscite<br />
comme un malaise. Ce mélange<br />
improbable, la confusion <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />
sexualités qui ne sauraient se<br />
confondre puisque la génitalité chasserait<br />
l’infantile.<br />
La confusion générationnelle, l’enfant<br />
participant <strong>de</strong> la sexualité <strong>de</strong>s adultes :<br />
transgressions majeures pour nos<br />
esprits occi<strong>de</strong>ntaux. On peut d’ailleurs<br />
se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r si la représentation <strong>de</strong>s<br />
sexes dans les estampes, hypertrophiés,<br />
et pas seulement les pénis, ce qui tendrait<br />
à mettre en évi<strong>de</strong>nce qu’il n’y a<br />
pas là qu’un culte phallique, ne serait<br />
pas le résultat d’une vision infantile du<br />
sexe <strong>de</strong>s adultes. Nous sommes l’enfant<br />
voyeur face à la scène primitive.<br />
Attraction, répulsion, les rires fusent<br />
traduisant la gêne et le grotesque d’une<br />
perception improbable. Comment ne<br />
pas penser, encore, aux manga racontant<br />
les mésaventures <strong>de</strong> lolitas en jupe<br />
bleu marine et socquettes blanches<br />
subissant tous les outrages, que <strong>de</strong>s<br />
voyageurs laissent dans les trains sur<br />
leur fauteuil sans sourciller. L’intérêt<br />
pour les très jeunes filles a un nom : le<br />
lolicom contraction <strong>de</strong> lolita complex.<br />
L’enfant, les adultes, quelles limites ?<br />
Jusqu’à 5-6 ans la mère est source <strong>de</strong><br />
plaisirs extrêmes et ininterrompus, l’enfant<br />
peut même passer sur elle ses plus<br />
furieuses colères. C’est sa fonction <strong>de</strong><br />
subir les humeurs <strong>de</strong> l’enfant. De là,<br />
pour l’enfant, à se penser comme seul<br />
et unique objet du désir <strong>de</strong> la mère,<br />
mère toute puissante d’une part, parce<br />
que seule capable <strong>de</strong> satisfaire les<br />
besoins <strong>de</strong> l’enfant, et d’autre part,<br />
parce qu’elle assure à l’enfant une<br />
jouissance au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la satisfaction <strong>de</strong><br />
ces besoins. Adulte, celui-ci en gar<strong>de</strong>ra<br />
un souvenir d’harmonie, noyau qui<br />
encouragera les tentatives régressives.<br />
C’est ainsi que l’ivresse, et ses effets,<br />
rencontrent une indulgence totale dans<br />
la société japonaise.<br />
L’enfant se trouve pris dans une relation<br />
qui l’aliène, sans limite, l’amour<br />
<strong>de</strong> sa mère <strong>de</strong>vient une prison. Il ne<br />
rencontre ni objection ni jugement<br />
face à sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> plaisir. Comment<br />
opérer une séparation d’avec<br />
celle qui lui cè<strong>de</strong> tout ? L’objet est<br />
menaçant et il doit s’en séparer pour<br />
survivre à l’engloutissement.<br />
Il est à noter qu’à l’heure actuelle, au<br />
Japon, la fonction paternelle est si altérée<br />
que la mère a pris les armes du<br />
père pour <strong>de</strong>venir ce que Dominique<br />
Innara nomme « éducastratrice ».<br />
C’est elle qui fait régner la loi au foyer<br />
déserté par son mari, se rapprochant<br />
ainsi <strong>de</strong> la figure <strong>de</strong> la mère phallique.<br />
C’est encore elle qui gère le budget<br />
familial octroyant à son mari <strong>de</strong> l’argent<br />
<strong>de</strong> poche.<br />
Mari qui vit dans la nostalgie du temps<br />
où il était tout pour sa mère, qui bien<br />
<br />
AUTRES CULTURES 11<br />
LIVRES<br />
La question religieuse au<br />
XXI e siècle<br />
Géopolitique et crise <strong>de</strong> la<br />
postmo<strong>de</strong>rnité<br />
Georges Corm<br />
La Découverte, 17 €<br />
La thèse défendue par Georges Corm<br />
est que l’irruption du religieux dans<br />
le champ politique ne s’explique pas<br />
par une résurrection <strong>de</strong>s i<strong>de</strong>ntités religieuses<br />
que les Lumières aurait gommées.<br />
Prolongeant les analyses <strong>de</strong><br />
Hannah Arendt, il décrit la crise <strong>de</strong><br />
légitimité <strong>de</strong>s vieilles démocraties,<br />
minées par les effets <strong>de</strong> la globalisation<br />
économique et financière.<br />
Une crise qui affecte les trois monothéismes,<br />
juif, chrétien et musulman,<br />
contribue à produire les extrémismes<br />
religieux. Pour l’auteur l’archéologie<br />
<strong>de</strong>s violences mo<strong>de</strong>rnes n’est pas à<br />
rechercher dans la Révolution française<br />
et la « Terreur », mais bien plutôt<br />
dans l’Inquisition et le long siècle<br />
<strong>de</strong>s guerres <strong>de</strong> religion en Europe.<br />
C’est donc moins à un « retour du religieux<br />
» que l’on assiste qu’à un<br />
recours au religieux au service d’intérêts<br />
économiques et politiques profanes.<br />
Seules la réhabilitation du patrimoine<br />
<strong>de</strong>s Lumières et la mise en<br />
œuvre <strong>de</strong>s principes républicains à<br />
l’échelle internationale permettront<br />
<strong>de</strong> contrer cette spirale dangereuse<br />
où nous entraînent les élites néoconservatrices<br />
occi<strong>de</strong>ntales et les fondamentalismes<br />
religieux.<br />
La volonté <strong>de</strong> faire science<br />
A propos <strong>de</strong> la psychanalyse<br />
Isabelle Stengers<br />
Les Empêcheurs <strong>de</strong> penser en rond,<br />
9 €<br />
Cette réédition montre que, pour Isabelle<br />
Stengers, le génie <strong>de</strong> Freud est<br />
d’avoir transformé ce qui faisait obstacle<br />
dans l’hypnose, en moteur même<br />
<strong>de</strong> l’intervention clinique : ce qu’il a<br />
appelé le « transfert ». La scène analytique<br />
<strong>de</strong>vient alors le laboratoire<br />
où la névrose <strong>de</strong> transfert, analysable,<br />
se substitue à la névrose ordinaire<br />
qui était incontrôlable. La suggestion,<br />
qui était utilisée par les guérisseurs<br />
avant Freud, <strong>de</strong>vient un instrument<br />
contrôlable. Voilà le coup <strong>de</strong> génie<br />
freudien.<br />
Deux ans avant sa mort, dans Analyse<br />
avec fin, analyse sans fin, Freud<br />
a reconnu les limites <strong>de</strong> l’instrument<br />
qu’il avait ainsi forgé. D’où l’idée que<br />
l’invention freudienne est en rupture<br />
avec toutes les autres techniques doit<br />
être réinterrogée.<br />
Enrique Pichon-Rivière<br />
Une figure marquante <strong>de</strong> la<br />
psychanalyse argentine<br />
Sous la direction d’Eduardo<br />
Mahieu et Martin Reca<br />
L’Harmattan, 12 €<br />
Figure <strong>de</strong> la nuit porteña, danseur <strong>de</strong><br />
tango, footballeur, homme <strong>de</strong> culture,<br />
Enrique Pichon-Rivière (1907-<br />
1977), né à Genève d’une famille française,<br />
émigré dans le Chaco à l’âge<br />
<strong>de</strong> 3 ans, est <strong>de</strong>venu psychiatre à<br />
Buenos Aires, où il a revitalisé la tradition<br />
clinique française.<br />
Psychanalyste, il a été un <strong>de</strong>s fondateurs<br />
<strong>de</strong> la Asociaciòn psicoanalitica<br />
argentina. Enseignant, il a intégré<br />
certains concepts kleiniens avant<br />
<strong>de</strong> s’orienter vers l’élaboration d’une<br />
théorie sur la psychologie sociale.<br />
Il était naturel que l’Association francoargentine<br />
<strong>de</strong> psychiatrie et <strong>de</strong> santé<br />
mentale lui consacre ce recueil qui<br />
s’ouvre et se ferme sur <strong>de</strong>ux textes<br />
importants <strong>de</strong> cet homme faisant lien<br />
entre son pays et celui <strong>de</strong> ses ancêtres.<br />
Ont contribué à cet ouvrage : Salomon Resnik,<br />
Rosa Lopez et Alberto Eiguer avec le concours<br />
<strong>de</strong> Gilberte Gensel, Eduardo Mahieu et Martin<br />
Reca.
12<br />
AUTRES CULTURES<br />
LIVRES ET REVUES<br />
Désir noma<strong>de</strong><br />
Littérature <strong>de</strong> voyage : regard<br />
psychanalytique<br />
Véronique Elfakir<br />
L’Harmattan, 24,50 €<br />
Ce livre abor<strong>de</strong> la littérature <strong>de</strong> voyage<br />
à travers une approche psychanalytique.<br />
L’attrait pour un continent ou<br />
un pays qui s’exprime à travers le<br />
récit <strong>de</strong> voyage, notamment à partir<br />
du 19 e et du 20 e siècle, <strong>de</strong>ssine les<br />
contours d’une géographie mentale<br />
propre à chaque écrivain qui interroge<br />
en fait ainsi sa propre « étrangeté<br />
intérieure » ou son défaut d’être.<br />
Ainsi, le voyage et son écriture auraient<br />
pour fonction soit <strong>de</strong> relancer<br />
le fantasme et donc le désir par le<br />
biais <strong>de</strong> l’idéalisation <strong>de</strong> l’objet « exotique<br />
», soit <strong>de</strong> prendre valeur <strong>de</strong> passage<br />
à l’acte et <strong>de</strong> symptôme dès lors<br />
qu’il se situe plutôt du côté <strong>de</strong> l’errance.<br />
Cette réflexion s’articule autour <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ux axes : dans un premier temps<br />
le voyage est examiné sous l’angle<br />
<strong>de</strong> l’errance et d’une sorte <strong>de</strong> dérive<br />
ou <strong>de</strong> faillite i<strong>de</strong>ntitaire. Dans un second<br />
temps, l’écriture du voyage est<br />
analysée en tant que vecteur <strong>de</strong> sublimation<br />
à travers le « nomadisme »<br />
du désir qui va chercher au loin <strong>de</strong><br />
quoi alimenter son imaginaire et relancer<br />
sa créativité, chez G. <strong>de</strong> Nerval,<br />
A. Rimbaud, I. Eberhardt, V. Segalen,<br />
H. Michaux ou P. Bowles.<br />
Penser imaginer délirer<br />
Psychanalyse et psychose 2006, n°6<br />
Centre <strong>de</strong> Psychanalyse et <strong>de</strong><br />
Psychothérapie Evelyne et Jean<br />
Kestmberg*, 23 €<br />
Penser, délirer, imaginer, trois activités<br />
qui concourent, chacune à sa manière,<br />
et parfois articulées l’une à<br />
l’autre, à l’instauration <strong>de</strong> la continuité-discontinuité<br />
<strong>de</strong> la vie psychique.<br />
Ce numéro <strong>de</strong> Psychanalyse et Psychose<br />
propose différentes approches<br />
<strong>de</strong> la notion <strong>de</strong> mentalisation, ou plus<br />
largement, <strong>de</strong> la vie psychique, <strong>de</strong><br />
son évolution dans la psychose, <strong>de</strong><br />
ses moments d’égarements ou <strong>de</strong><br />
création.<br />
* Centre E. & J. Kestemberg, 11 rue Albert Bayet,<br />
Paris 13ème - Tél. : 01 40 77 44 68<br />
L’organisation du lexique<br />
mental<br />
Pierre Marquer<br />
L’Harmattan, 25,50 €<br />
Le « lexique mental » qui est l’ensemble<br />
<strong>de</strong>s représentations que nous avons<br />
<strong>de</strong>s mots <strong>de</strong> notre langue, constitue<br />
un objet d’étu<strong>de</strong> essentiel <strong>de</strong> la psychologie<br />
cognitive contemporaine,<br />
non seulement par son intérêt propre<br />
mais aussi parce qu’il permet <strong>de</strong> mettre<br />
à l’épreuve un certain nombre d’hypothèses<br />
sur l’architecture du système<br />
cognitif.<br />
Après une synthèse <strong>de</strong>s cadres théoriques<br />
utilisés et <strong>de</strong>s connaissances<br />
acquises dans le domaine <strong>de</strong> l’organisation<br />
lexicale et <strong>de</strong> l’accès au<br />
lexique, l’auteur propose une approche<br />
du lexique mental à travers<br />
l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> trois questions la représentation<br />
<strong>de</strong>s contraires, la résolution<br />
<strong>de</strong> l’ambiguïté lexicale et la<br />
compréhension <strong>de</strong>s expressions idiomatiques,<br />
qui fait actuellement l’objet<br />
<strong>de</strong> nombreux travaux.<br />
Sur chacune <strong>de</strong> ces questions, l’ouvrage<br />
comporte une revue critique<br />
<strong>de</strong> la littérature et une présentation<br />
<strong>de</strong> recherches expérimentales. Les<br />
résultats expérimentaux sont mis en<br />
relation avec les choix méthodologiques<br />
et évalués par rapport aux hypothèses<br />
théoriques, pour mettre en<br />
évi<strong>de</strong>nce les invariants <strong>de</strong> l’organisation<br />
lexicale et sa flexibilité en fonction<br />
du contexte.<br />
<br />
souvent méprise cette femme imparfaite,<br />
insatisfaisante quand il ne la hait<br />
pas. Mais cet amour sans bornes n’est<br />
pas sans conditions. Depuis plusieurs<br />
décennies la société japonaise a vu la<br />
famille se réduire au couple conjugal et<br />
les relations entre parents et enfants<br />
leur ambivalence s’amplifier. L’enfant,<br />
souvent unique, <strong>de</strong>vient surinvesti. Ses<br />
échecs sont vécus comme la ruine <strong>de</strong>s<br />
espoirs familiaux.<br />
L’enfant n’obtient pas ce que ses<br />
parents désirent pour lui, il gaspille les<br />
sacrifices consentis pour lui. Ces sacrifices<br />
que la mère a le « courage » <strong>de</strong><br />
faire, elle ne les dissimulera pas à l’enfant.<br />
La stratégie éducative serait une stratégie<br />
<strong>de</strong> non-résistance, <strong>de</strong> sacrifice qui<br />
conduit l’enfant, à un moment ou un<br />
autre, à s’angoisser d’attaquer son objet<br />
d’amour et <strong>de</strong> risquer <strong>de</strong> perdre <strong>de</strong>s<br />
liens qui lui sont indispensables. Le<br />
masochisme maternel induit, chez l’enfant,<br />
la prise <strong>de</strong> conscience du lien qui<br />
donne naissance au surmoi. Surmoi<br />
plus kleinien que freudien car il prend<br />
appui non sur les fantasmes <strong>de</strong> rivalité<br />
et par introjection <strong>de</strong> la fonction<br />
paternelle, mais plutôt dans l’expérience<br />
originaire <strong>de</strong> la pulsion <strong>de</strong> mort,<br />
dans les fantasmes <strong>de</strong> mort <strong>de</strong> la mère.<br />
L’agressivité dissuadée très tôt par la<br />
patience extrême <strong>de</strong> la mère ne peut<br />
pas s’exprimer, elle se contient et se<br />
retourne contre le sujet.<br />
Le sujet japonais est étroitement lié à<br />
son environnement qui est tout son<br />
bien. Il doit exercer sa vigilance contre<br />
lui-même au nom du bien <strong>de</strong> ce<br />
mon<strong>de</strong>. S’il le sert bien, il sera indulgent,<br />
protecteur, nourricier. Alors que<br />
dans la plupart <strong>de</strong>s sociétés la famille<br />
fait corps pour protéger l’un <strong>de</strong> ses<br />
membres <strong>de</strong>s critiques ou <strong>de</strong>s attaques<br />
d’un autre groupe, lui donnant ainsi<br />
le sentiment d’être toujours soutenu,<br />
au Japon on n’est assuré du soutien<br />
<strong>de</strong>s siens que dans la mesure où les<br />
autres groupes vous approuvent. Si<br />
l’enfant se met dans une situation<br />
embarrassante, il est rejeté par les siens.<br />
On considère comme une métho<strong>de</strong><br />
éducative d’énoncer à l’enfant <strong>de</strong>s propositions<br />
telles que : « Je vais adopter<br />
ce bébé là qui ne pleure pas. Je veux un<br />
enfant comme lui, il est sage lui. Toi, tu ne<br />
te conduis pas comme tu <strong>de</strong>vrais à ton<br />
âge » ou « Voulez-vous emmener cet<br />
enfant avec vous ? Nous n’en voulons<br />
plus ! » Le visiteur joue le jeu, ou encore<br />
« J’aime mieux ton père que toi. Lui il<br />
est gentil ! » etc... Le sentiment d’avoir<br />
été moqué et la terreur <strong>de</strong> perdre tout<br />
ce qui est sûr et familier fon<strong>de</strong> le rapport<br />
<strong>de</strong> l’enfant à ses proches et au<br />
reste <strong>de</strong> la société. Le sentiment <strong>de</strong><br />
honte ou haji se construit peu à peu.<br />
La honte est liée à la culpabilité lorsque<br />
la mère exprime à l’enfant que son<br />
comportement indispose le mon<strong>de</strong><br />
extérieur mais qu’elle va assumer la<br />
honte <strong>de</strong>s excuses qu’il faudra faire à<br />
sa place. La jalousie oedipienne largement<br />
évitée, le sevrage tardif, l’évitement<br />
<strong>de</strong>s épreuves <strong>de</strong> solitu<strong>de</strong> et <strong>de</strong><br />
Sclérose latérale amyotrophique :<br />
la conférence <strong>de</strong> consensus recomman<strong>de</strong><br />
la mise en place d’une consultation<br />
d’annonce du diagnostic<br />
Le caractère évolutif vers la dépendance et incurable <strong>de</strong> la sclérose latérale amyotrophique<br />
(SLA) nécessite la mise en place d’une consultation spéciale d’annonce<br />
du diagnostic selon le jury <strong>de</strong> la conférence <strong>de</strong> consensus dans ses recommandations.<br />
La SLA est une maladie évolutive dont la survie médiane est <strong>de</strong> 40 mois après<br />
l’annonce du diagnostic. Ce diagnostic peut être ressenti par le patient et son entourage<br />
comme une agression psychologique en raison du caractère inexorable<br />
<strong>de</strong> la maladie.<br />
Les phénomènes psychologiques observés habituellement lors <strong>de</strong> l’annonce d’une<br />
maladie grave se trouvent amplifiés par l’absence <strong>de</strong> traitement curatif. Il est difficile<br />
pour le patient et pour l’entourage <strong>de</strong> renoncer à leurs projets futurs. Or,<br />
l’annonce du diagnostic est une étape « cruciale » dans la prise en charge, point<br />
<strong>de</strong> départ du projet <strong>de</strong> soin établi en partenariat entre l’équipe soignante et le<br />
patient. « Il y a un risque <strong>de</strong> déni et, en conséquence, <strong>de</strong> mauvaise observance du<br />
traitement ».<br />
C’est pourquoi le jury recomman<strong>de</strong> que l’annonce du diagnostic <strong>de</strong> SLA soit<br />
faite dans le cadre d’une consultation dédiée, par le neurologue, tout en rappelant<br />
que le patient peut refuser, temporairement ou définitivement, d’être informé.<br />
Dans ses modalités, cette consultation doit notamment être personnalisée et le<br />
praticien prévoir un temps suffisant. Il est important <strong>de</strong> faire cette annonce préférentiellement<br />
en début <strong>de</strong> semaine afin que les soignants soient disponibles<br />
dans les jours qui suivent pour répondre aux questions et angoisses que suscite<br />
un tel diagnostic.<br />
Rappelant que la pério<strong>de</strong> entre les premières manifestations cliniques et la confirmation<br />
du diagnostic peut être longue, le jury estime qu’il est souhaitable <strong>de</strong> parler<br />
<strong>de</strong> SLA dès que la présomption est suffisante. Il est également important d’expliquer<br />
au patient l’importance du suivi évolutif dans la confirmation du diagnostic.<br />
Penser à la SLA face à une plainte musculaire<br />
Dans ce document, le jury fait également le point sur les critères diagnostiques<br />
<strong>de</strong> SLA, sur les signes d’appel initiaux, les formes <strong>de</strong> diagnostic facile et celles <strong>de</strong><br />
diagnostic plus difficiles, les examens initiaux et complémentaires ainsi que les<br />
diagnostics différentiels.<br />
C’est une maladie <strong>de</strong> diagnostic difficile en raison notamment <strong>de</strong> la multiplicité<br />
<strong>de</strong>s formes cliniques, <strong>de</strong> l’absence <strong>de</strong> marqueurs spécifiques et d’une mauvaise<br />
connaissance du corps médical.<br />
Les symptômes musculaires, qui sont les plus fréquents, conduisent à une plainte<br />
que le mé<strong>de</strong>cin généraliste est le plus susceptible d’entendre. En cas <strong>de</strong> suspicion,<br />
le patient doit être adressé à un neurologue libéral ou hospitalier pour confirmer<br />
le diagnostic notamment par un électroneuromyogramme (ENMG).<br />
La probabilité qu’un mé<strong>de</strong>cin généraliste voit un patient atteint <strong>de</strong> SLA dans sa<br />
carrière reste faible, comme pour toute maladie rare, mais il doit envisager ce diagnostic<br />
face à une plainte musculaire, penser que cela peut ne pas être anodin.<br />
Le diagnostic doit être posé le plus tôt possible pour initier rapi<strong>de</strong>ment la prise<br />
en charge, idéalement en lien avec un <strong>de</strong>s 17 centres <strong>de</strong> référence sur la SLA<br />
séparation laissent s’établir une intimité<br />
étroite et culpabilisent l’indépendance<br />
qui fait figure d’ingratitu<strong>de</strong> et<br />
<strong>de</strong> déloyauté, le fautif est l’enfant. Sa<br />
faute n’est pas la transgression mais la<br />
défection. Le lien à la mère prend une<br />
valeur morale. Il se confond aux conditions<br />
<strong>de</strong> survie du groupe. Le sujet est<br />
pris dans un sentiment d’obligation à<br />
l’égard <strong>de</strong>s siens qui ensuite animera<br />
toute sa vie relationnelle. Le « rôle » (3)<br />
bien rempli apaise et conforte. L’individu<br />
s’i<strong>de</strong>ntifie à la fonction qu’il<br />
assume au point <strong>de</strong> s’effacer. Ainsi,<br />
c’est la série parfaitement accomplie<br />
<strong>de</strong>s gestes qui fait l’être, comme le<br />
geste parfait <strong>de</strong> la cérémonie du thé,<br />
pas moins <strong>de</strong> 10 ans pour y parvenir,<br />
ou celui du calligraphe, ou... la liste est<br />
sans fin. Quelle alternative alors entre<br />
une mère menaçante et interdictrice,<br />
porte-parole <strong>de</strong> la fonction symbolique<br />
du père, et une mère séductrice encourageant<br />
la jouissance <strong>de</strong> l’enfant et<br />
bafouant la loi du père et barrant ses<br />
effets structurants ?<br />
Le jeune enfant japonais est très tôt<br />
pris dans les rets d’un système très<br />
complexe régissant le don et le contredon<br />
dans les rapports sociaux et familiaux.<br />
Le moteur interne du désir est :<br />
« le désir <strong>de</strong> rester dans les bonnes grâces<br />
<strong>de</strong> tout le mon<strong>de</strong>, donc amae (<strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
d’amour inconditionnelle) ». A l’égard <strong>de</strong><br />
celui qui répond à cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, on<br />
est en <strong>de</strong>tte : On. Cette <strong>de</strong>tte ne peut<br />
s’acquitter. Il faudra répondre aux sacrifices<br />
<strong>de</strong> cette trop bonne mère, payer<br />
N°3 - TOME XIX - AVRIL 2006<br />
en retour, en étant parfait, dans son<br />
désir.<br />
La société est donc toute entière prise<br />
dans la dialectique <strong>de</strong> la <strong>de</strong>tte et du<br />
don, du <strong>de</strong>voir et <strong>de</strong> l’amour. Le produit<br />
<strong>de</strong> cette dialectique sera l’harmonie<br />
ou la honte.<br />
L’ambivalence et la confusion qui fon<strong>de</strong>nt<br />
l’éducation font qu’au plus profond<br />
<strong>de</strong> chaque individu rési<strong>de</strong> un<br />
petit dieu qui a pu satisfaire, en toute<br />
impunité, ses pulsions. Cette dualité<br />
permet à chacun d’osciller entre excès<br />
et soumission à l’âge adulte. Le parcours<br />
d’une vie se fera entre timidité et<br />
témérité, soumission et résistance, politesse<br />
et arrogance, discipline et insubordination.<br />
Du point <strong>de</strong> vue occi<strong>de</strong>ntal<br />
: une vie clivée.<br />
Le clivage <strong>de</strong>vient la règle et ne peut<br />
plus être considéré comme une<br />
déviance. Les mécanismes qui fon<strong>de</strong>nt<br />
la perversion : clivage, déni, fétichisme,<br />
sont à l’œuvre dans le rapport<br />
qu’entretient le sujet japonais à luimême<br />
et à son environnement.<br />
Est-ce ce qui nous séduit, nous fascine<br />
? <br />
Charline Ferrand-Bennini*<br />
*Psychologue clinicienne, ethnologue<br />
(1) Yoshi OIDA Acteur.<br />
(2) Shun’ei KATSUKAWA (1762-1819),<br />
Dix scènes d’amour, British Museum.<br />
(3) Georges DE VOS, Le narcissisme <strong>de</strong> rôle.<br />
existant en France qui ont permis un réel progrès médico-social.<br />
Sur le plan <strong>de</strong> la thérapeutique pharmacologique, le seul médicament actif disposant<br />
d’une autorisation <strong>de</strong> mise sur le marché dans la SLA est le riluzole (Rilutek<br />
©, Sanofi-Aventis). Il doit être prescrit « dès le diagnostic suspecté <strong>de</strong> SLA »,<br />
le traitement sera adapté ensuite.<br />
Le jury préconise également <strong>de</strong> prescrire <strong>de</strong> l’alpha-tocophérol ou vitamine E en<br />
association avec le riluzole. Mais cette recommandation a été émise davantage<br />
sur le constat d’une habitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> prescription. Cette utilisation est hors AMM -<br />
mais « c’est un produit relativement innocent »- et la commission <strong>de</strong> la transparence<br />
avait conclu en janvier 2000 à l’absence <strong>de</strong> bénéfice supplémentaire à l’ajout d’alpha-tocophérol<br />
au riluzole.<br />
Une prise en charge essentiellement humaine et matérielle<br />
En conséquence, la prise en charge repose essentiellement sur les thérapeutiques<br />
non pharmacologiques, humaines et techniques. Faisant participer le patient et<br />
son entourage, elle vise à maintenir un confort et une qualité <strong>de</strong> vie acceptables<br />
et à prévenir l’isolement social.<br />
Globalement, si la prise en charge pluridisciplinaire a permis d’allonger la durée<br />
<strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s patients et d’en améliorer la qualité, l’histoire naturelle <strong>de</strong> la maladie<br />
n’a pas été modifiée.<br />
La prise en charge <strong>de</strong> la SLA se caractérise par sa pluridisciplinarité qui est d’autant<br />
plus importante que la SLA est une maladie non curative.<br />
Dans ses recommandations, le jury fait le point sur les thérapeutiques physiques,<br />
l’aménagement <strong>de</strong> l’environnement, les soins d’hygiène et <strong>de</strong> confort, l’ai<strong>de</strong> à l’alimentation<br />
et à la communication, la prise en charge psychologique.<br />
Le jury énumère les thérapeutiques médicamenteuses symptomatiques : douleurs,<br />
spasticité, labilité émotionnelle, troubles salivaires, fatigue, dépression et<br />
anxiété, troubles du sommeil, constipation, phlébites et embolies pulmonaires.<br />
Les décisions thérapeutiques sont prises en fonction d’un bilan initial <strong>de</strong> la maladie<br />
puis trimestriel, réalisé idéalement dans un centre <strong>de</strong> référence. Le patient<br />
doit être évalué régulièrement, même lorsqu’il n’y a pas <strong>de</strong> nouvelle plainte, afin<br />
d’anticiper l’évolution du handicap et la décompensation <strong>de</strong>s fonctions vitales.<br />
Est soulignée l’importance <strong>de</strong> discuter <strong>de</strong>s différentes étapes <strong>de</strong> la maladie et <strong>de</strong><br />
ses complications avec le patient et son entourage afin <strong>de</strong> les préparer à accepter<br />
les thérapeutiques <strong>de</strong> suppléance. A un sta<strong>de</strong> plus évolué, la question d’une<br />
gran<strong>de</strong> dépendance et du pronostic vital doit également être abordée, éventuellement<br />
en présence d’une équipe <strong>de</strong> soins palliatifs.<br />
Ces entretiens permettent <strong>de</strong> déci<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s différentes modalités d’intervention. La<br />
volonté du patient doit être retranscrite dans le dossier <strong>de</strong> suivi qui doit pouvoir<br />
être accessible à tous, notamment aux mé<strong>de</strong>cins réanimateurs et urgentistes, afin<br />
<strong>de</strong> faciliter les soins d’urgence.<br />
Sur la place <strong>de</strong>s traitements <strong>de</strong> suppléance dans la SLA, le jury insiste sur la démarche<br />
collégiale et sur la participation du patient dans la prise <strong>de</strong> décision. Il<br />
précise dans le texte <strong>de</strong> ses recommandations les différentes thérapeutiques d’assistance<br />
nutritionnelle et/ou respiratoire qui peuvent être proposées au patient.<br />
Sur le plan médical, ces recommandations tiennent largement compte <strong>de</strong>s réflexions<br />
menées par les centres <strong>de</strong> référence sur les procédures.<br />
Elles vont permettre <strong>de</strong> renforcer la coordination entre les centres <strong>de</strong> référence<br />
situés à l’hôpital et les soignants <strong>de</strong> ville assurant la prise en charge <strong>de</strong> proximité. <br />
G.M.<br />
* Prise en charge <strong>de</strong> la personne atteinte <strong>de</strong> sclérose latérale amyotrophique, texte court <strong>de</strong> 9 pages<br />
et texte long <strong>de</strong> 49 pages, disponibles sur www.has-sante.fr
N°3 - TOME XIX - AVRIL 2006<br />
Le système <strong>de</strong> réadaptation au<br />
Québec : naviguer dans<br />
l’ambiguïté ? (1) 1ère partie<br />
Initialement, on m’a <strong>de</strong>mandé <strong>de</strong><br />
décrire le système canadien <strong>de</strong> réhabilitation.<br />
Après analyse, j’ai décidé <strong>de</strong><br />
changer l’orientation <strong>de</strong> la présentation<br />
parce que d’après moi, un tel système<br />
n’existe pas encore au Canada. La<br />
situation au Québec n’est pas différente.<br />
On n’y trouve pas plus <strong>de</strong> système<br />
<strong>de</strong> réadaptation, mais un système<br />
<strong>de</strong> santé mentale à forte prédominance<br />
institutionnelle et reposant, en priorité,<br />
sur <strong>de</strong>s valeurs et modèles médicaux.<br />
Et dans ce système, il y a un<br />
sous-système <strong>de</strong> services <strong>de</strong>vant permettre<br />
aux personnes souffrant <strong>de</strong><br />
troubles mentaux graves <strong>de</strong> vivre dans<br />
la communauté. Ces services sont<br />
offerts par <strong>de</strong>s ressources institutionnelles<br />
et communautaires traversées<br />
par <strong>de</strong>s tendances très diverses et par<br />
<strong>de</strong>s expériences aussi très diversifiées.<br />
Une <strong>de</strong> ces tendances est la réadaptation<br />
qui se démarque, actuellement,<br />
<strong>de</strong>s autres car elle est maintenant reconnue<br />
politiquement. Le <strong>de</strong>rnier Plan<br />
d’action en santé mentale (http://www.<br />
msss.gouv. qc.ca/documentation/publications.html)adopté<br />
en juin 2005, stipule,<br />
en effet, que « l’ensemble <strong>de</strong>s services<br />
<strong>de</strong>stinés aux personnes ayant <strong>de</strong>s<br />
troubles mentaux graves (TMG)<br />
<strong>de</strong>vraient être offerts dans une perspective<br />
<strong>de</strong> réadaptation » (p. 51).<br />
Mais elle n’est pas la seule source d’inspiration<br />
<strong>de</strong>s ressources offrant ces services<br />
<strong>de</strong> sorte que diverses tendances<br />
co-existent dans ce sous-système : alternatives,<br />
défense <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong>s usagers,<br />
psychanalytique, psychodynamique,<br />
médical, etc... Une autre particularité<br />
<strong>de</strong> ce sous-système est que les valeurs<br />
qui y sont prônées semblent faire<br />
consensus auprès <strong>de</strong> tous les intervenants<br />
malgré leurs différences idéologiques<br />
et <strong>de</strong> lieux <strong>de</strong> pratique. Ce<br />
constat n’est pas sans effet car il s’en suit<br />
une confusion d’interprétation <strong>de</strong> cellesci.<br />
Tout le mon<strong>de</strong> semble parler <strong>de</strong> la<br />
même chose tout en ne parlant pas <strong>de</strong><br />
la même chose.<br />
Pour mieux comprendre ces particularités,<br />
j’ai choisi <strong>de</strong> ne pas décrire simplement<br />
les services offerts aux personnes<br />
souffrant <strong>de</strong> troubles mentaux<br />
graves, mais plutôt d’analyser la dynamique<br />
sous-jacente à la dispensation<br />
<strong>de</strong> ces services (2), ce qui nous permettra,<br />
tout <strong>de</strong> même, <strong>de</strong> décrire ces services<br />
comme on me l’avait initialement<br />
<strong>de</strong>mandé. Pour ce faire, nous proposons<br />
une démarche en quatre étapes :<br />
1) l’analyse <strong>de</strong> l’émergence du système<br />
<strong>de</strong> services et <strong>de</strong> ses valeurs ; 2) la<br />
<strong>de</strong>scription <strong>de</strong> ses caractéristiques ; 3)<br />
et <strong>de</strong>s expériences novatrices, ancrées<br />
dans la culture québécoise, qui démontrent<br />
comment certains organismes<br />
actualisent les concepts clés actuellement<br />
prônés par le milieu <strong>de</strong> la réadaptation,<br />
faisant contre-poids à la tendance<br />
générale dans ce milieu <strong>de</strong><br />
s’inspirer prioritairement <strong>de</strong>s expériences<br />
américaines comme modèles ;<br />
4) enfin une brève analyse <strong>de</strong>s enjeux<br />
<strong>de</strong> la réadaptation. Cette démarche<br />
nous permettra <strong>de</strong> comprendre comment<br />
la réadaptation a acquis sa reconnaissance<br />
actuelle, et comment elle se<br />
différencie <strong>de</strong>s autres modèles <strong>de</strong> services<br />
dans le champ <strong>de</strong> la santé mentale<br />
au Québec.<br />
L’émergence du système<br />
<strong>de</strong> services et <strong>de</strong> ses<br />
valeurs<br />
L’acquisition <strong>de</strong> la reconnaissance politique<br />
par la réadaptation est, <strong>de</strong>puis<br />
1962, le fruit d’un long cheminement<br />
jalonné par une Politique <strong>de</strong> santé<br />
mentale et trois rapports ou Plans d’action.<br />
Mais elle est aussi jalonnée par<br />
l’émergence parallèle et la consolidation<br />
d’autres courants <strong>de</strong> pensée et<br />
d’intervention qui ont aussi, en leur<br />
temps, obtenu une reconnaissance politique.<br />
Pour comprendre cette évolution<br />
différentielle, nous examinerons<br />
ces documents à la lumière <strong>de</strong>s valeurs<br />
et <strong>de</strong>s services qu’ils proposent.<br />
Les valeurs<br />
Dans le Tableau 1 sont décrites les<br />
valeurs sur lesquelles se basent ces<br />
documents. En 1962, on parle d’avoir<br />
droit à la même qualité <strong>de</strong> soins que le<br />
mala<strong>de</strong> physique, alors que 25 ans plus<br />
tard, on met l’accent sur la primauté<br />
<strong>de</strong> la personne. En 1998, on parle d’appropriation<br />
du pouvoir, alors que, maintenant,<br />
les mots pouvoir d’agir et <strong>de</strong><br />
rétablissement sont utilisés. Examinons<br />
un peu plus ces notions (cf. le Tableau<br />
2).<br />
Le postulat du rapport <strong>de</strong> la Commission<br />
d’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s hôpitaux psychia-<br />
Appel à candidature 2006<br />
Bourses Lilly <strong>Psychiatrie</strong> et Bourses Lilly Neurologie<br />
L’Institut Lilly lance son appel à candidature pour ses 2 bourses en neurologie<br />
et psychiatrie. Axées sur la recherche clinique, ces bourses sont <strong>de</strong>stinées aux<br />
jeunes chercheurs mé<strong>de</strong>cins cliniciens.<br />
L’Institut souhaite ainsi soutenir 6 jeunes chercheurs mé<strong>de</strong>cins cliniciens afin <strong>de</strong><br />
financer en partie une année <strong>de</strong> recherche dans le cadre d’une thèse <strong>de</strong> science<br />
ou d’une année <strong>de</strong> postdoctorat.<br />
Le montant <strong>de</strong> la bourse s’élève à 15 000 € par lauréat (3 boursiers en psychiatrie,<br />
3 en neurologie).<br />
La date limite du dépôt <strong>de</strong> dossier est le 29 mai 2006.<br />
Pour être candidat, il faut :<br />
- être au moins titulaire d’un DEA/Master et être inscrits en thèse <strong>de</strong> science,<br />
- justifier <strong>de</strong> son année postdoctorale par une lettre d’acceptation du directeur<br />
du laboratoire,<br />
- que le projet concerne la recherche clinique.<br />
Les dossiers sont examinés par <strong>de</strong>ux jurys indépendants, composés <strong>de</strong> cinq<br />
membres reconnus dans le domaine <strong>de</strong> la psychiatrie et <strong>de</strong> la neurologie.<br />
Inscriptions exclusivement sur internet : www.institutlilly.com<br />
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette bourse, s’adresser à :<br />
Institut Lilly, 13 rue Pagès, 92158 Suresnes. Tél.: 01 55 49 34 16. Fax :<br />
01 55 49 33 08. www.institutlilly.com<br />
triques (1962), « Comme mala<strong>de</strong> mental,<br />
j’ai droit à la même qualité <strong>de</strong> soins<br />
que le mala<strong>de</strong> physique », vise à mettre<br />
fin à la stigmatisation dont le patient<br />
est lui-même victime <strong>de</strong> la part du système<br />
<strong>de</strong> soins. Le livre qui a déclenché<br />
la création <strong>de</strong> cette Commission<br />
d’étu<strong>de</strong>, Les fous crient au secours, écrit<br />
par un ex-patient asilaire, Jean-Charles<br />
Pagé, décrivait très bien le système asilaire<br />
<strong>de</strong> l’époque qui excluait le patient<br />
psychiatrique du système <strong>de</strong> soins, et<br />
les traitements inhumains dont il était<br />
victime.<br />
Tableau 1<br />
Evolution <strong>de</strong>s valeurs sousjacentes<br />
aux politique et aux<br />
plans d’action<br />
(1962) Rapport <strong>de</strong> la Commission<br />
d’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s hôpitaux psychiatriques<br />
Comme mala<strong>de</strong> mental,<br />
j’ai droit à la même qualité <strong>de</strong> soins<br />
que le mala<strong>de</strong> physique<br />
(1989) Politique <strong>de</strong> santé mentale<br />
Je suis une personne : pas une maladie<br />
(la primauté <strong>de</strong> la personne)<br />
(1998) Plan d’action pour la transformation<br />
<strong>de</strong>s services <strong>de</strong> santé mentale<br />
Je m’approprie le pouvoir<br />
(2005) Plan d’action en santé<br />
mentale : la force <strong>de</strong>s liens<br />
J’ai le pouvoir d’agir et je me rétablis<br />
Pour déstigmatiser la maladie mentale<br />
et les personnes qui en souffrent, la<br />
Commission propose, entre autres, la<br />
création <strong>de</strong> départements <strong>de</strong> psychiatrie<br />
dans les hôpitaux généraux (au nombre<br />
<strong>de</strong> 70 actuellement), insérant la psychiatrie<br />
dans le système <strong>de</strong> soins général.<br />
Elle suscita aussi <strong>de</strong>s expériences<br />
<strong>de</strong> désinstitutionnalisation inspirées par<br />
la psychiatrie communautaire, permettant<br />
d’expérimenter <strong>de</strong> nouveaux<br />
services comme les rési<strong>de</strong>nces d’accueil,<br />
l’entrai<strong>de</strong>, la réintégration au travail,<br />
etc.Vingt-cinq ans plus tard, soit<br />
en 1989, la Politique <strong>de</strong> santé mentale<br />
qui faisait suite à un comité <strong>de</strong> travail<br />
qui avait conclu que les interventions<br />
étaient mal adaptées aux besoins <strong>de</strong>s<br />
personnes, et que leur milieu <strong>de</strong> vie<br />
n’était pas pris en compte (le rappport<br />
Harnois), insiste sur la nécessité <strong>de</strong> ne<br />
plus considérer la personne comme un<br />
agglomérat <strong>de</strong> symptômes mais<br />
comme une personne à part entière.<br />
L’accent est mis sur la conception <strong>de</strong> la<br />
personne souffrant <strong>de</strong> troubles mentaux<br />
graves <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s soignants.<br />
La Politique énonce qu’il y a primauté<br />
<strong>de</strong> la personne, ce qui « implique le respect<br />
<strong>de</strong> sa personnalité, <strong>de</strong> sa façon <strong>de</strong><br />
vivre, <strong>de</strong> ses différences et <strong>de</strong>s liens qu’elle<br />
entretient avec son environnement.<br />
C’est également miser sur ses capacités,<br />
tenir compte <strong>de</strong> son point <strong>de</strong> vue, favoriser<br />
sa participation et celle <strong>de</strong> ses<br />
proches. Cette orientation suppose sa<br />
participation dans les décisions qui la<br />
concernent, la prise en considération <strong>de</strong><br />
l’ensemble <strong>de</strong> ses besoins et <strong>de</strong> sa condition<br />
bio-psycho-sociale ainsi que le respect<br />
<strong>de</strong> ses droits ». (p. 23). La politique propose<br />
<strong>de</strong> rechercher <strong>de</strong>s solutions <strong>de</strong><br />
vie dans le milieu <strong>de</strong>s personnes afin<br />
d’y favoriser leur maintien et leur réintégration<br />
sociale, par la création <strong>de</strong><br />
groupes <strong>de</strong> défense et <strong>de</strong> promotion<br />
<strong>de</strong>s droits (ils sont 15 actuellement),<br />
le financement <strong>de</strong>s mesures <strong>de</strong> répit<br />
aux familles et le soutien <strong>de</strong>s familles<br />
(45 groupes familiaux à l’heure actuelle),<br />
et une stratégie d’information pour<br />
« diminuer le caractère stigmatisant associé<br />
aux troubles mentaux ».<br />
Enfin, la Politique reconnaît légalement<br />
les organismes communautaires (plus<br />
d’une centaine actuellement) et la<br />
nécessité <strong>de</strong> les financer. La Politique<br />
crée ainsi le système qui expérimentera<br />
durant les années subséquentes<br />
diverses approches pour maintenir les<br />
personnes dans leur milieu <strong>de</strong> vie. En<br />
résumé, elle vise ainsi à déstigmatiser la<br />
perception <strong>de</strong> la personne et à la sortir<br />
du giron institutionnel.<br />
La réadaptation y est spécifiquement<br />
mentionnée comme complémentaire à<br />
la réintégration sociale. Elle vise « à<br />
développer ou à restaurer les compétences<br />
personnelles et sociales <strong>de</strong> façon à<br />
accroître le niveaux d’autonomie d’une<br />
personne » alors que « la réintégration<br />
sociale en constitue le prolongement »<br />
(Politique <strong>de</strong> santé mentale, p. 44) mais<br />
sans plus <strong>de</strong> précision pour ce <strong>de</strong>rnier<br />
volet. Inspirés par la réadaptation, ces<br />
objectifs se réaliseront par la dispensation<br />
d’un ensemble <strong>de</strong> services allant<br />
<strong>de</strong>s activités à la vie quotidienne jusqu’aux<br />
services abordant le travail et<br />
les étu<strong>de</strong>s. Et une partie <strong>de</strong> ces activités<br />
se fait en vue <strong>de</strong> la réintégration sociale.<br />
Par cette phrase, la Politique campe<br />
les <strong>de</strong>ux tendances fondamentales du<br />
sous-système <strong>de</strong> services au Québec<br />
<strong>de</strong>stiné aux personnes souffrant <strong>de</strong><br />
troubles mentaux graves: un ensemble<br />
<strong>de</strong> services centrés sur la personne<br />
(volet individuel) ou centrés sur la personne<br />
en relation avec son milieu (volet<br />
social).<br />
Mais en 1996 cette Politique est vivement<br />
critiquée par le Vérificateur général<br />
du Québec (l’institution chargée <strong>de</strong><br />
vérifier « l’atteinte, au meilleur <strong>de</strong>gré,<br />
<strong>de</strong>s objectifs ou autres effets recherchés<br />
d’un programme, d’une organisation ou<br />
d’une activité » (http://www.vgq.gouv.<br />
qc.ca/) qui émet un rapport concluant<br />
que « six ans après l’élaboration <strong>de</strong> la<br />
Politique <strong>de</strong> santé mentale, on ne peut<br />
que constater un échec quant au réaménagement<br />
souhaité <strong>de</strong>s ressources en<br />
santé mentale. Un certain recul est même<br />
Tableau 2<br />
Rapport <strong>de</strong> la commission d’étu<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>s hôpitaux psychiatriques (1962)<br />
Comme mala<strong>de</strong> mental, j’ai droit à la<br />
même qualité <strong>de</strong> soins que le mala<strong>de</strong><br />
physique<br />
- Transformation du système asilaire<br />
en un système psychiatrique centré<br />
sur les institutions<br />
- Déstigmatiser la maladie mentale et<br />
les soins du patient psychiatrique<br />
Expériences <strong>de</strong> désinstitutionnalisation<br />
inspirées par la psychiatrie communautaire<br />
Politique <strong>de</strong> santé mentale (1989)<br />
Je suis une personne : pas une maladie<br />
(la primauté <strong>de</strong> la personne)<br />
- Rechercher <strong>de</strong>s solutions dans le<br />
milieu <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s personnes<br />
- Déstigmatiser la conception <strong>de</strong> la<br />
personne<br />
- Réadaptation : « développer ou restaurer<br />
les compétences personnelles<br />
et sociales »<br />
- Réintégration sociale : prolongement<br />
<strong>de</strong> la réadaptation<br />
Plan d’action pour la transformation<br />
<strong>de</strong>s services en santé mentale (1998)<br />
Je m’approprie le pouvoir<br />
- Exercice d’un choix libre et éclairé<br />
au moment <strong>de</strong> prendre <strong>de</strong>s décisions<br />
même sur les traitements offerts<br />
- Démarche collective traduite par la<br />
participation à la vie associative<br />
- Être consulté sur les modalités<br />
d’organisation <strong>de</strong>s services<br />
Plan d’action en santé mentale<br />
(2005)<br />
J’ai le pouvoir d’agir et je me rétablis<br />
- Pouvoir d’agir et rétablissement<br />
- Offrir les services <strong>de</strong> suivi, <strong>de</strong> soutien<br />
et d’intégration sociale dans une<br />
perspective <strong>de</strong> réadaptation<br />
<br />
ORGANISATION DES SOINS 13<br />
LIVRES<br />
Traité pratique <strong>de</strong>s réseaux<br />
<strong>de</strong> santé<br />
Stéphanie Barré, Clau<strong>de</strong> Évin,<br />
Pierre-Yves Fouré, Laurent<br />
Houdart, Dominique Larose,<br />
Gilles Poutout, Elsa Ptakhine<br />
Berger-Levrault, 48 €<br />
Ce traité définit le réseau <strong>de</strong> santé,<br />
tel qu’il a été introduit dans le Co<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> la santé publique par la loi du 4<br />
mars 2004, relative aux droits <strong>de</strong>s<br />
mala<strong>de</strong>s et à la qualité du système<br />
<strong>de</strong> santé. Il s’interroge sur la place<br />
<strong>de</strong>s réseaux <strong>de</strong> santé au sein du système<br />
<strong>de</strong> santé et sur les diverses modalités<br />
d’intégration <strong>de</strong> ce nouveau<br />
type d’organisation dans les cadres<br />
traditionnels <strong>de</strong> la santé en France.<br />
Les modalités pratiques nécessaires<br />
pour la constitution d’un réseau <strong>de</strong><br />
santé sont complétées par la présentation<br />
commentée d’un « dossierpromoteur<br />
» en annexe.<br />
Puis sont abordés les aspects juridiques,<br />
le financement, les sources<br />
possibles, le type <strong>de</strong> dépenses couvertes<br />
par les différentes sources, les<br />
principales règles budgétaires et comptables,<br />
la nature du contrôle financier,<br />
les relations contractuelles, l’évaluation.<br />
La conclusion cherche à ouvrir un<br />
certain nombre <strong>de</strong> perspectives, non<br />
pas sous la forme d’un développement<br />
théorique mais plutôt sous forme<br />
<strong>de</strong> recommandations.<br />
Gouverner la Sécurité Sociale<br />
Bruno Palier<br />
Presses universitaires <strong>de</strong> France<br />
19,50 €<br />
Chercheur au CNRS et au Centre <strong>de</strong><br />
recherches politiques <strong>de</strong> l’Institut<br />
d’étu<strong>de</strong>s politiques <strong>de</strong> Paris, Bruno<br />
Palier analyse les réformes du système<br />
français <strong>de</strong> protection sociale<br />
<strong>de</strong>puis 1945, à l’occasion <strong>de</strong>s 60 ans<br />
<strong>de</strong> la sécurité sociale. Détaillant le<br />
contenu <strong>de</strong> tous les plans <strong>de</strong> redressement,<br />
il cherche à savoir si ces réformes<br />
ont induit une transformation<br />
profon<strong>de</strong> <strong>de</strong>s principes et <strong>de</strong>s mécanismes<br />
sur lesquels reposait le système<br />
français d’assurances sociales.<br />
STOPP<br />
Suivi Thérapeutique Orienté sur<br />
la Psychose Persistante<br />
Une approche psychologique<br />
pour faciliter le rétablissment<br />
<strong>de</strong>s jeunes adultes présentant un<br />
premier épiso<strong>de</strong> psychotique<br />
Tanya Hermann-Doig, Diana<br />
Mau<strong>de</strong>, Jane Edwards<br />
Retz<br />
Ce livre s’appuie sur les travaux du<br />
centre EPPIC (Centre <strong>de</strong> prévention<br />
et d’intervention pour la psychose<br />
débutante) <strong>de</strong> Melbourne, qui a réalisé<br />
la conceptualisation et le développement<br />
d’un modèle d’intervention<br />
psychologique d’inspiration<br />
cognitive et comportementale visant<br />
au traitement <strong>de</strong> jeunes patients en<br />
phase précoce d’un trouble psychotique.<br />
Exposant les outils développés dans<br />
ce cadre, ce manuel pratique décrit<br />
<strong>de</strong> manière claire et didactique les<br />
programmes <strong>de</strong> traitement psychologique<br />
<strong>de</strong>s symptômes psychotiques.<br />
Ils prennent particulièrement en<br />
compte les spécificités inhérentes<br />
aux premiers sta<strong>de</strong>s d’évolution du<br />
trouble.<br />
Ce livre intéressera les équipes françaises<br />
et francophones qui s’engagent,<br />
<strong>de</strong> plus en plus, dans la prise<br />
en charge cognitive <strong>de</strong> jeunes patients<br />
psychotiques stabilisés, à commencer<br />
par celles qui font appel à<br />
d’autres programmes (comme, par<br />
exemple, IPT).
14<br />
LIVRES<br />
ORGANISATION DES SOINS<br />
Histoire <strong>de</strong>s centres sociaux<br />
Du voisinage à la citoyenneté<br />
Robert Durand<br />
Postface d’Henri Colombani<br />
Préface <strong>de</strong> jacques Eloy<br />
Nouvelle édition<br />
La Découverte, 22 €<br />
Il existe, actuellement, en France plus<br />
<strong>de</strong> 2 000 centres sociaux, implantés<br />
en majorité dans les communes <strong>de</strong><br />
banlieue, les grands ensembles et les<br />
quartiers périphériques <strong>de</strong>s villes.<br />
Cet ouvrage propose <strong>de</strong> rappeler la<br />
longue tradition historique dans laquelle<br />
ils s’inscrivent sur le plan national.<br />
Il a fallu près d’un siècle pour<br />
façonner le centre social tel qu’il existe<br />
aujourd’hui et pour qu’il <strong>de</strong>vienne un<br />
véritable dispositif d’action, d’animation<br />
et d’intervention dans la vie<br />
locale. Plus qu’un simple établissement,<br />
c’est un équipement polyvalent<br />
pour les habitants, leur offrant<br />
la possibilité <strong>de</strong> pratiquer un sport,<br />
<strong>de</strong> s’initier à l’informatique, <strong>de</strong> cuisiner,<br />
<strong>de</strong> consulter les services sociaux,<br />
etc. Cet ouvrage permet <strong>de</strong> découvrir<br />
comment les centres sociaux ont pu<br />
répondre aux problèmes <strong>de</strong> chaque<br />
époque, grâce à l’investissement <strong>de</strong>s<br />
acteurs impliqués : engagement <strong>de</strong>s<br />
intervenants, bien sûr, mais aussi <strong>de</strong>s<br />
habitants <strong>de</strong>s quartiers. Contrairement<br />
aux politiques sociales qui proposent,<br />
généraIement, un traitement<br />
individuel et sectoriel <strong>de</strong>s problèmes,<br />
le centre social développe une approche<br />
collective et globale. C’est pour<br />
cette raison qu’il constitue une forme<br />
originale <strong>de</strong> lutte contre l’exclusion.<br />
La famille : entre<br />
production <strong>de</strong> santé et<br />
consommation <strong>de</strong> soins<br />
Recherches familiales 2006 n°3<br />
Unaf*, 21 €<br />
Que l’on définisse le soin comme une<br />
action médicale stricto sensu ou comme<br />
une action, plus large, qui englobe<br />
l’ensemble <strong>de</strong>s actes relationnels, psychologiques,<br />
<strong>de</strong> confort, etc. (que les<br />
anglo saxons définissent par le terme<br />
« care »), la famille est un acteur du<br />
système <strong>de</strong> soins. Si nous étudions<br />
son attitu<strong>de</strong> face à la consommation,<br />
sa participation à la régulation économique<br />
du système <strong>de</strong> soins - ou,<br />
inversement, à l’augmentation <strong>de</strong>s<br />
dépenses <strong>de</strong> santé -, les coûts directs<br />
et indirects dont elle assume la charge,<br />
voire son rôle dans les associations,<br />
la famille est, tout d’abord, consommatrice<br />
<strong>de</strong> soins.<br />
Mais elle est également productrice<br />
<strong>de</strong> soins. Qu’il s’agisse d’actions <strong>de</strong><br />
prévention ou d’implication lors d’une<br />
maladie grave ou pas, que les troubles<br />
soient passagers ou chroniques, que<br />
la pathologie soit mentale, physiologique,<br />
ou physique, qu’elle atteigne<br />
<strong>de</strong>s enfants, <strong>de</strong>s adultes ou <strong>de</strong>s personnes<br />
du grand âge, que les soins<br />
aient lieu en établissement ou à domicile,<br />
la famille est présente par les<br />
ressources et les compétences qu’elle<br />
mobilise ou qui sont attendues <strong>de</strong> sa<br />
part.<br />
En définitive, la famille peut être envisagée<br />
comme un <strong>de</strong>s acteurs clés<br />
du système <strong>de</strong> soins elle n’est plus<br />
seulement consommatrice ou productrice,<br />
mais consommatrice et productrice<br />
dans un système sanitaire<br />
où chaque acteur a une place et un<br />
rôle largement redéfinis par les règles<br />
et les politiques publiques dans un<br />
contexte <strong>de</strong> décentralisation <strong>de</strong> la régulation<br />
<strong>de</strong> l’offre <strong>de</strong> soins et <strong>de</strong> remaniements<br />
<strong>de</strong> la protection sociale.<br />
* Union Nationale <strong>de</strong>s Associations Familiales,<br />
28 place Saint-Georges, 75009 Paris. Tél. :<br />
01 49 95 36 00 - Fax : 01 40 16 12 76. Site<br />
Internet: www.unaf.fr<br />
<br />
observé du fait que les ressources sont<br />
encore plus concentrées dans les traitements<br />
spécialisés » (cité dans Lecomte,<br />
1997, p.18).<br />
En 1998 paraît le Plan d’action pour la<br />
transformation <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> santé mentale<br />
(http://www.msss.gouv.qc.ca/ documentation/publications.html)<br />
qui priorise<br />
comme clientèle les personnes<br />
souffrant <strong>de</strong> troubles mentaux graves.<br />
Il énonce, comme principe général,<br />
l’appropriation du pouvoir par la personne<br />
sur son <strong>de</strong>stin c’est-à-dire « l’exercice<br />
d’un choix libre et éclairé au moment<br />
<strong>de</strong> prendre <strong>de</strong>s décisions à <strong>de</strong>s étapes<br />
cruciales <strong>de</strong> sa vie », même sur les traitements<br />
qui lui sont offerts. « L’appropriation<br />
du pouvoir comme démarche<br />
collective se traduit par la participation à<br />
la vie associative, telle qu’elle s’est développée<br />
dans les organismes communautaires<br />
en santé mentale. L’usager ou<br />
l’usagère sont consultés sur les modalités<br />
d’organisation <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> santé mentale,<br />
que ce soit en établissement ou en<br />
milieu communautaire. La défense <strong>de</strong>s<br />
droits <strong>de</strong>s usagères et <strong>de</strong>s usagers constitue<br />
d’ailleurs un <strong>de</strong>s fon<strong>de</strong>ments <strong>de</strong> cette<br />
démarche collective d’appropriation du<br />
pouvoir » dit le Plan d’action (p.17). Le<br />
Plan d’action énumère ensuite les divers<br />
services pour soutenir la personne dans<br />
la communauté (cf. le Tableau 4). Les<br />
mots réadaptation et réintégration sociale<br />
n’y sont toutefois pas mentionnés.<br />
Le principe <strong>de</strong> ce Plan d’action sera<br />
considéré par certains groupes comme<br />
au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la réadaptation et <strong>de</strong> la réintégration<br />
sociale. C’est la reconnaissance<br />
<strong>de</strong> la citoyenneté à part entière.<br />
Finalement, pour répondre aux critiques<br />
du Vérificateur général, le Plan<br />
d’action propose le fameux 60-40 soit<br />
que 60% <strong>de</strong>s dépenses publiques en<br />
santé mentale soient consacrés à <strong>de</strong>s<br />
services offerts dans la communauté.<br />
Ce Plan d’action vise à déstigmatiser<br />
la perception <strong>de</strong> la personne comme<br />
ayant perdu sa citoyenneté à cause <strong>de</strong><br />
sa maladie.<br />
En décembre 2003, à nouveau le Vérificateur<br />
général du Québec émet un<br />
rapport, encore très critique vis-à-vis<br />
ce Plan d’action et la Politique <strong>de</strong> santé<br />
mentale (http://www.vgq.gouv.qc.ca/<br />
HTML/Rapports.html). Il mentionne<br />
que seulement 24% <strong>de</strong>s recommandations<br />
<strong>de</strong> 1996 ont été mises en application.<br />
Tout en reconnaissant que certains<br />
progrès ont été faits, il dénonce le<br />
manque <strong>de</strong> ressources financières<br />
allouées pour la transformation <strong>de</strong>s services,<br />
et le fait « que les ressources (rési<strong>de</strong>ntielles)<br />
disponibles sont peu variées<br />
et mal adaptées aux nouvelles pratiques<br />
en santé mentale » (p.16). Malgré certains<br />
progrès comme la diminution <strong>de</strong><br />
lits psychiatriques, le rapport confirme<br />
que 76% <strong>de</strong>s ressources financières<br />
sont encore concentrées dans les hôpitaux<br />
psychiatriques et les départements<br />
<strong>de</strong> psychiatrie <strong>de</strong>s hôpitaux généraux.<br />
Les organismes communautaires reçoivent,<br />
pour leur part, seulement 6% du<br />
budget. Les organismes institutionnels<br />
monopolisent ainsi la majorité <strong>de</strong>s ressources<br />
financières et humaines, et sont<br />
en mesure d’imposer leurs valeurs et<br />
modèles d’intervention. Toutefois, il ne<br />
semble pas que ces valeurs et modèles<br />
correspon<strong>de</strong>nt aux modèles nouveaux<br />
prônés par la réadaptation selon le Vérificateur<br />
général.<br />
Le Plan d’action en santé mentale <strong>de</strong><br />
2005 est la réponse du gouvernement<br />
à ce rapport. Vu son adoption très<br />
récente, nous nous y attar<strong>de</strong>rons un<br />
peu plus. Pour les services <strong>de</strong>stinés aux<br />
personnes souffrant <strong>de</strong> troubles mentaux<br />
graves, le Plan cible en priorité les<br />
services <strong>de</strong> suivi, <strong>de</strong> soutien et d’intégration<br />
sociale qui « <strong>de</strong>vraient être offerts<br />
dans une perspective <strong>de</strong> réadaptation »<br />
(p.51) (cf. Tableau 4). Le Plan indique,<br />
clairement, son orientation mais sans<br />
la rendre obligatoire : se référer aux<br />
valeurs, aux principes et aux modèles<br />
<strong>de</strong> la réadaptation mais non exclusivement.<br />
Le Plan reconnaît, également,<br />
que « plusieurs organismes communautaires<br />
offrent <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> réadapta-<br />
tion » (p.51) mais sans préciser leurs<br />
orientations. Le Plan d’action ne choisit<br />
donc pas d’élaborer un système <strong>de</strong><br />
services fondés exclusivement sur la<br />
réadaptation. En filigrane, il reconnaît<br />
implicitement l’existence d’autres perspectives<br />
que celles <strong>de</strong> la réadaptation,<br />
et l’impossibilité d’offrir adéquatement<br />
dans la communauté <strong>de</strong>s services aux<br />
personnes souffrant <strong>de</strong> troubles mentaux<br />
graves, sans l’apport <strong>de</strong>s organismes<br />
communautaires.<br />
Comment est définie la réadaptation (3)<br />
dans ce Plan d’action ? « La réadaptation<br />
est le processus qui facilite le retour d’un<br />
individu à un niveau optimal <strong>de</strong> fonctionnement<br />
autonome dans la communauté.<br />
Alors que la nature du processus<br />
et les métho<strong>de</strong>s utilisées peuvent varier,<br />
la réadaptation encourage invariablement<br />
les personnes à participer activement<br />
avec d’autres à l’atteinte <strong>de</strong>s buts<br />
concernant la santé mentale ou la compétence<br />
sociale » (p. 51, tiré <strong>de</strong> Kovess<br />
et al. (2001) (4). Cette définition insiste<br />
donc sur les compétences individuelles<br />
et les soutiens pour y parvenir. Par la<br />
suite, le Plan d’action élargit, pourrait-on<br />
dire, cette définition en parlant <strong>de</strong>s ser-<br />
vices d’intégration sociale, spécifiquement<br />
<strong>de</strong>s services rési<strong>de</strong>ntiels et <strong>de</strong> l’intégration<br />
au travail. Il insiste sur la collaboration<br />
intersectorielle entre les<br />
ministères nécessaire pour favoriser<br />
cette intégration sociale et permettre<br />
à ces personnes d’exercer leur citoyenneté.<br />
Aux compétences individuelles, le Plan<br />
d’action ajoute un volet social (5).<br />
Cette définition <strong>de</strong> la réadaptation du<br />
Plan d’action est en continuité avec<br />
celle <strong>de</strong> 1989. Elle met en scène <strong>de</strong>ux<br />
tendances, individuelle et sociale, dont<br />
l’importance fera l’objet d’une interprétation<br />
différentielle <strong>de</strong>s intervenants<br />
selon leur lieu d’appartenance.<br />
Globalement, le Plan d’action <strong>de</strong> 2005<br />
semble marquer un changement<br />
d’orientation par rapport au Plan d’action<br />
<strong>de</strong> 1998 qui prônait la réappropriation<br />
du pouvoir. Il prône comme<br />
principes <strong>de</strong> base le pouvoir d’agir <strong>de</strong> la<br />
personne et son rétablissement qui est<br />
la « croyance dans les capacités <strong>de</strong>s personnes<br />
<strong>de</strong> prendre le contrôle <strong>de</strong> leur vie<br />
et <strong>de</strong> leur maladie » (p.15). En conséquence,<br />
le système <strong>de</strong> soins est invité à<br />
« soutenir les personnes atteintes d’un<br />
ACTION SOCIALE ET SANTE MENTALE :<br />
mariage d’amour ou mariage arrangé ?<br />
N°3 - TOME XIX - AVRIL 2006<br />
trouble mental en les aidant à réintégrer<br />
leur rôle en société, malgré l’existence<br />
chez elles <strong>de</strong> symptômes ou <strong>de</strong> handicaps<br />
». La visée est, maintenant, d’améliorer<br />
leurs compétences et <strong>de</strong> les soutenir<br />
pour qu’elles puissent exercer<br />
leurs rôles et retrouver une place dans<br />
la société. Malgré une reconnaissance<br />
<strong>de</strong> la nécessité <strong>de</strong> l’appropriation du<br />
pouvoir, <strong>de</strong>s organismes communautaires<br />
et <strong>de</strong> la défense <strong>de</strong>s droits, et <strong>de</strong><br />
la lutte contre la stigmatisation, le Plan<br />
d’action propose semble-t-il un changement<br />
<strong>de</strong> perspective : se centrer sur<br />
l’individu et <strong>de</strong> le préparer à jouer un<br />
rôle <strong>de</strong> citoyen. Le Plan d’action parle<br />
certes d’intégration sociale, <strong>de</strong> soutenir<br />
l’appropriation du pouvoir (p.13),<br />
mais ne parle plus <strong>de</strong> « démarche collective<br />
d’appropriation du pouvoir »<br />
comme le précé<strong>de</strong>nt Plan d’action. En<br />
ce sens, il omet <strong>de</strong> mentionner Le<br />
Gui<strong>de</strong> pour le développement <strong>de</strong>s<br />
compétences en santé mentale, produit<br />
par le ministère <strong>de</strong> la Santé et <strong>de</strong>s<br />
services sociaux en février 2004, afin <strong>de</strong><br />
mettre en pratique cette démarche collective<br />
d’appropriation du pouvoir par<br />
les intervenants et les gestionnaires. Le<br />
Depuis longtemps déjà, les relations entre « le sanitaire » (dont le champ <strong>de</strong> la santé mentale) et « le social » (en incluant<br />
le secteur médico-social), font l’objet <strong>de</strong> discours convenus. Qu’en est-il au aujourd’hui <strong>de</strong>s réalisations concrètes<br />
d’articulations entre ces <strong>de</strong>ux mon<strong>de</strong>s ? De nombreux rapports accompagnent <strong>de</strong>s textes législatifs et réglementaires<br />
qui viennent illustrer une nette évolution <strong>de</strong>s politiques publiques sur ce point. Mais dans la réalité ? Que sont <strong>de</strong>venues<br />
les expérimentations dont il a été question dans les dix <strong>de</strong>rnières années ? Comment se nouent dans la durée,<br />
tant bien que mal, <strong>de</strong>s coopérations qui paraissent indispensables pour les personnes en souffrance psychique ? Comment<br />
favoriser les expériences nouvelles ? Au moment où sont publiés le Plan Santé mentale et le rapport du Conseil<br />
supérieur du travail social sur « le décloisonnement du sanitaire et du social », comment faire avancer les projets sous<br />
l’angle <strong>de</strong> la formation <strong>de</strong>s professionnels ?<br />
L’organisation <strong>de</strong> ce Forum s’inscrit dans la poursuite <strong>de</strong>s collaborations entre les différents organisateurs et vise à témoigner,<br />
par ses modalités et par les intervenants sollicités, d’une volonté forte <strong>de</strong> mettre en synergie <strong>de</strong>s moyens et<br />
<strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s projets durables.<br />
Mardi 30 mai 2006 à l’IRTS site <strong>de</strong> Montrouge<br />
9 h : Présentation du Forum par Marcel Jaeger, IRTS et Gérard Massé, MNASM<br />
9 h 30 : Table ron<strong>de</strong> « Les réseaux : mise en place et financement »<br />
Animation : Dr Clau<strong>de</strong> Laguillaume, Coordination nationale <strong>de</strong>s réseaux <strong>de</strong> santé<br />
- Laurent El Ghozi, Maire-adjoint à Nanterre, chargé <strong>de</strong> la santé, <strong>de</strong> la prévention et <strong>de</strong>s personnes<br />
handicapées, Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’association « Elus, Santé Publique et Territoire »<br />
- Jérôme Guedj, Vice-Prési<strong>de</strong>nt du Conseil général <strong>de</strong> l’Essonne, chargé <strong>de</strong>s solidarités et <strong>de</strong> la lutte<br />
contre les discriminations et un réprésentant <strong>de</strong> l’Association <strong>de</strong>s Lieux <strong>de</strong> Vie Essoniens<br />
- Annick Deveau, Directrice-adjointe <strong>de</strong> la DRASS d’Ile-<strong>de</strong>-France<br />
- Evelyne Sylvain, responsable du pôle département « établissements et services médico-sociaux » à la<br />
CNSA<br />
- Pierre Larcher, DGAS<br />
- Maryvonne Lyasid, adjointe au Directeur général <strong>de</strong> la Fondation caisses d’épargne pour la solidarité<br />
12 h 30 : Repas libre<br />
14 h 30 : Présentation d’expériences<br />
Animation : Brigitte Cheval, ETSUP<br />
- Jean-Clau<strong>de</strong> Bonnin, Association <strong>de</strong> Réadaptation et d’Insertion Sociale, Yvelines<br />
- Mériam Smires, Marie-France Epagneul, Clau<strong>de</strong> Fernan<strong>de</strong>z, Jacques Piant, Réseau REPIES<br />
15 h 30 : Conférence <strong>de</strong> Marcel Gauchet, philosophe, EHESS<br />
Mercredi 31 mai 2006 au Centre hospitalier Sainte Anne (amphi CMME), Paris 14e<br />
9 h : Présentation d’expériences<br />
Animation : Serge Kannas, MNASM<br />
- Jean-Yves Châtaignier, ESAT Mondoloni, Gonesse (APAJH 95)<br />
- Jean-Paul Arveiller, Réseau « Santé-précarité » à Sainte-Anne, Paris<br />
- Sylvie Loichet, Dr Charpentier, Dr Bernard Voizot, ROSMES 94<br />
- Denis Roume, Réseau Sud Yvelines<br />
- Saïd Acef, Réseau <strong>de</strong> santé AURA 77<br />
- Monique Lips, cadre socio-éducatif, EPSM <strong>de</strong> Lille : « formation, action et précarité en santé mentale »<br />
12 h : Repas libre<br />
14 h : Présentation d’expériences<br />
Animation : John Ward, IRTS<br />
- Dr Marie-Christine Cabié, MNASM et Mme Rimbert, ASSAD-RM : « Les appartements avec<br />
gouvernantes », Melun<br />
- Jacques Houver, cadre socio-éducatif au centre hospitalier Le Vinatier, et Pierre Mercier, Directeur <strong>de</strong><br />
l’association Habitat et humanisme Rhône : « Santé mentale et logement dans le Rhône : comment<br />
mieux habiter la ville ensemble »<br />
- Sarah Saragoussi, « Santé mentale et logement », Paris 9e,12e et 18e<br />
15 h 30 : Table ron<strong>de</strong> « Préalables et enjeux <strong>de</strong>s formations »<br />
Animation : Geneviève Crespo, ETSUP<br />
- Jacques Riffault, IRTS<br />
- Martine Dutoit, « La formation <strong>de</strong>s personnes ressources pour les usagers <strong>de</strong>s GEM »<br />
- Olivier Huet, IRTS<br />
- Danièle Roche, Conseil Régional d’Ile-<strong>de</strong>-France<br />
16 h 30 : Conclusions<br />
Inscription au 01 40 92 35 01 ou fc.irts-idf.m@gni.asso.fr - 60 euros - Nombre <strong>de</strong> places limité
N°3 - TOME XIX - AVRIL 2006<br />
Plan d’action a choisi <strong>de</strong> ne pas être<br />
proactif à cet égard, contrairement au<br />
précé<strong>de</strong>nt Plan d’action.<br />
Si on envisage, maintenant, ces documents<br />
selon une perspective longitudinale,<br />
on peut constater un mouvement<br />
en alternance (cf. Tableau 3). Le<br />
premier rapport <strong>de</strong> 1962 insiste sur<br />
l’insertion <strong>de</strong> la personne dans le milieu<br />
<strong>de</strong>s soins (volet social) alors que la Politique<br />
<strong>de</strong> 1989 insiste sur la conception<br />
<strong>de</strong> la personne (volet individuel).<br />
Le Plan d’action <strong>de</strong> 1998 insiste, à nouveau,<br />
sur l’aspect social, se réapproprier<br />
le pouvoir comme citoyen, alors<br />
que le <strong>de</strong>rnier Plan d’action <strong>de</strong> 2005<br />
revient à la conception <strong>de</strong> la personne<br />
: une personne qui peut se rétablir.<br />
Donc une alternance entre le social et<br />
l’individu, mais en ayant toujours en<br />
filigrane l’autre perspective.<br />
Un <strong>de</strong>uxième point que l’on peut<br />
observer est la reconnaissance différentielle<br />
<strong>de</strong> diverses orientations idéologiques<br />
selon les rapports. Ainsi, en<br />
1962, le modèle psychiatrique hospitalier<br />
gagne sa reconnaissance. La psychiatrie<br />
gravite autour <strong>de</strong>s institutions,<br />
centre <strong>de</strong> gravité dont le système <strong>de</strong><br />
santé mentale n’est pas encore sorti.<br />
En 1989, la reconnaissance politique<br />
favorise les organismes communautaires<br />
: défense <strong>de</strong>s droits, familles et<br />
alternatives. Mais ces <strong>de</strong>rnières n’ont<br />
pas réussi à faire reconnaître leur dénomination<br />
à cause <strong>de</strong> sa portée contestatrice.<br />
En 1998, le Plan d’action<br />
cherche à diminuer le pouvoir du<br />
milieu hospitalier alors que le milieu<br />
communautaire (alternatif et défense<br />
<strong>de</strong>s droits) voit confirmer ses valeurs<br />
sociales. Mais l’année 2005 marque<br />
un retour vers <strong>de</strong>s valeurs individuelles<br />
avec la reconnaissance politique <strong>de</strong> la<br />
réadaptation.<br />
Tableau 3<br />
Reconaissance sociale<br />
Rapport <strong>de</strong> la Commission d’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
hôpitaux psychiatriques (1962)<br />
Volet social<br />
Reconnaissance milieux hospitaliers<br />
Politique <strong>de</strong> santé mentale (1989)<br />
Volet individuel<br />
Reconnaissance <strong>de</strong>s organismes communautaires<br />
(alternatives, familles,<br />
défense <strong>de</strong>s droits)<br />
Plan d’action pour la transformation<br />
<strong>de</strong>s services <strong>de</strong> santé mentale (1998)<br />
Volet social<br />
Reconnaissance <strong>de</strong>s organismes communautaires<br />
Plan d’action en santé mentale : la<br />
force <strong>de</strong>s liens (2005)<br />
Volet individuel<br />
Reconnaissance <strong>de</strong> la réadaptation<br />
Les services<br />
Comment soutenir les adultes ayant<br />
un trouble mental grave pour qu’il y<br />
ait « restauration <strong>de</strong>s rôles » comme le<br />
propose le Plan d’action ? Le rapport<br />
Bédard avait recommandé, en 1962,<br />
une série <strong>de</strong> services qui se sont révélées<br />
après coup d’avant-gar<strong>de</strong>. Par la<br />
suite, durant les années 80, s’est élaboré<br />
aux Etats-Unis un système <strong>de</strong> soutien<br />
communautaire pour les personnes<br />
aux prises avec <strong>de</strong>s troubles mentaux<br />
sévères (Turner et Ten Hoor, 1978).<br />
Ce système prévoit une série <strong>de</strong> 13<br />
services afin <strong>de</strong> permettre à ces personnes<br />
<strong>de</strong> vivre dans la communauté.<br />
Par la suite, les penseurs <strong>de</strong> la réadaptation<br />
font leurs ces services au point<br />
où ces services sont conçus comme<br />
<strong>de</strong>s services <strong>de</strong> réadaptation. Certes<br />
oui mais <strong>de</strong>s services aussi utilisés par<br />
d’autres courants.<br />
Même si on n’en parle plus au Québec,<br />
le système <strong>de</strong> soutien communautaire<br />
est <strong>de</strong>meuré la référence <strong>de</strong> base pour<br />
catégoriser ces services qui se divisent<br />
en <strong>de</strong>ux parties : services généraux et<br />
services <strong>de</strong> base (cf. Tableau 4).<br />
La poursuite <strong>de</strong> l’analyse <strong>de</strong>s autres<br />
Politique et Plan d’action permet <strong>de</strong><br />
constater que ces <strong>de</strong>rniers recomman<strong>de</strong>nt<br />
un ensemble <strong>de</strong> services afin <strong>de</strong><br />
mieux <strong>de</strong>sservir cette population dans<br />
la lignée du rapport Bédard et du système<br />
<strong>de</strong> soutien communautaire.<br />
Le tableau 4 permet <strong>de</strong> visualiser les<br />
services recommandés par les Politiques<br />
et Plans d’action. Comme il le<br />
démontre, d’un rapport à l’autre, ce<br />
sont les mêmes services qui sont<br />
recommandés. Ce qui les différencie<br />
est le vocabulaire et la finalité spécifique<br />
<strong>de</strong>s ressources. Il y a donc consensus<br />
sur les services pour <strong>de</strong>sservir les<br />
personnes souffrant <strong>de</strong> troubles mentaux<br />
graves. En résumé, s’est constitué<br />
au Québec au gré <strong>de</strong>s rapports, Politiques<br />
et Plans d’action en santé mentale,<br />
un système <strong>de</strong> services <strong>de</strong>stinés<br />
aux personnes souffrant <strong>de</strong> troubles<br />
mentaux graves qui reposent sur <strong>de</strong>s<br />
valeurs individuelles et sociales dont<br />
l’importance varie selon les pério<strong>de</strong>s.<br />
Ce système <strong>de</strong> services est congruent<br />
avec celui qui est prôné par les tenants<br />
<strong>de</strong> la réadaptation. Nous examinerons<br />
maintenant plus en détails les caractéristiques<br />
<strong>de</strong> ce système qui vont nous<br />
permettre <strong>de</strong> mieux comprendre les<br />
tendances <strong>de</strong> ce milieu et prélu<strong>de</strong>rons<br />
à <strong>de</strong>s expériences novatrices. Cette<br />
analyse nous permettra <strong>de</strong> constater<br />
que ces valeurs ne sont pas exclusives<br />
aux ressources <strong>de</strong> réadaptation, étant<br />
partagées par un ensemble <strong>de</strong> ressources<br />
provenant d’horizons fort différents.<br />
Il en est <strong>de</strong> même pour les services<br />
qui sont dispensés par <strong>de</strong>s<br />
ressources à la philosophie d’intervention<br />
aussi fort différentes.<br />
Caractéristiques du<br />
sous-système <strong>de</strong><br />
services<br />
Nous abordons trois caractéristiques<br />
qui sous-ten<strong>de</strong>nt la dynamique <strong>de</strong> ce<br />
système <strong>de</strong> services TMG : la sédimentation,<br />
la diversification <strong>de</strong>s philosophies<br />
et le modèle théorique.<br />
Sédimentation<br />
Comme dit précé<strong>de</strong>mment, <strong>de</strong>s ressources<br />
institutionnelles et/ou communautaires<br />
ont été progressivement<br />
reconnues par les documents ministériels<br />
au cours <strong>de</strong>s 50 <strong>de</strong>rnières années.<br />
Il s’en suit que le système <strong>de</strong> services<br />
TMG s’est constitué par sédimentation,<br />
c’est-à-dire qu’au cours <strong>de</strong>s ans, <strong>de</strong>s<br />
services se sont créés et sont <strong>de</strong>meurés<br />
en place (6) <strong>de</strong>puis leur création. Cela a<br />
pour effet <strong>de</strong> faire coexister diverses<br />
conceptions <strong>de</strong>s personnes et diverses<br />
théories, approches et métho<strong>de</strong>s plus<br />
Tableau 4 : Système <strong>de</strong> services<br />
ou moins congruentes avec la réadaptation.<br />
Diversification <strong>de</strong>s philosophies<br />
Dispensateurs <strong>de</strong>s services TMG<br />
Comme on a pu voir, les services TMG<br />
sont offerts par divers réseaux. Il y a<br />
certes les ressources hospitalières et<br />
institutionnelles qui y jouent un rôle<br />
très important par le biais <strong>de</strong>s centres<br />
<strong>de</strong> jour, <strong>de</strong>s cliniques spécialisées, <strong>de</strong>s<br />
cliniques externes <strong>de</strong> psychiatrie, <strong>de</strong>s<br />
programmes intensifs <strong>de</strong> réadaptation<br />
dans les unités <strong>de</strong> soins pour personnes<br />
aux psychoses réfractaires, etc. et <strong>de</strong>s<br />
professionnels comme les ergothérapeutes<br />
qui se sont faits une spécialité<br />
<strong>de</strong>s approches réadaptatives. Il y a aussi<br />
<strong>de</strong>s organismes communautaires (plus<br />
d’une centaine) qui dispensent ces services<br />
comme le mentionne le Plan d’action<br />
2005. La question qui se pose<br />
alors : est-ce que ces organismes partagent<br />
les mêmes valeurs? Mais auparavant,<br />
regardons seulement pour<br />
démonstration les organismes communautaires<br />
qui offrent <strong>de</strong>s services<br />
TMG, ressources sur lesquelles nous<br />
nous concentrerons pour la démons-<br />
Rapport Un système Politique <strong>de</strong> Plan Plan<br />
Bédard <strong>de</strong> soutien santé mentale d’action d’action<br />
(1962) communautaire (1989) (1998) (2005)<br />
1. Services généraux<br />
X 1.1 Services X X X<br />
d’intervention <strong>de</strong> crise (7)<br />
X 1.2 Traitement X X X<br />
X 1.3 Protection et<br />
défense <strong>de</strong>s droits (8) X X X<br />
X 1.4 Hospitalisation X X X<br />
2. Composante <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> réadaptation<br />
X 2.1 Sociale X X X<br />
X 2.2 Travail et étu<strong>de</strong>s (9) X X PRIORITAIRE<br />
X 2.3 Rési<strong>de</strong>ntielle (10) X X PRIORITAIRE<br />
2.4 Information à propos X X X<br />
<strong>de</strong> la maladie mentale (11)<br />
2.5 Information à propos<br />
<strong>de</strong> la médication (12)<br />
X 2.6 Soins médicaux et X X X<br />
<strong>de</strong>ntaires<br />
2.7 Soutien familial (13) X X X<br />
X 2.8 Soutien par les pairs X X X<br />
2.9 Soutien X X PRIORITAIRE<br />
communautaire (14)<br />
tration. Nous postulons que le réseau<br />
institutionnel offre aussi ces services<br />
mais <strong>de</strong> façon variable selon les institutions<br />
et les régions. Les divers documents<br />
ministériels dénoncent, en effet,<br />
la distribution inéquitable <strong>de</strong>s ressources<br />
entre les régions du Québec.<br />
Nous avons constitué un tableau<br />
(Tableau 5) qui décrit, par regroupement<br />
ou association, le pourcentage<br />
<strong>de</strong>s ressources communautaires<br />
membres qui offrent ces services. Nous<br />
en avons retenu <strong>de</strong>ux pour la démonstration<br />
(15). Son analyse montre que les<br />
membres du RRASMQ offrent presque<br />
toute la gamme <strong>de</strong> services du système<br />
<strong>de</strong> services, exception faite <strong>de</strong> l’hospitalisation<br />
et <strong>de</strong>s soins médicaux et <strong>de</strong>ntaires.<br />
Cette différence s’explique par le<br />
fait que <strong>de</strong>s ressources institutionnelles<br />
sont membres <strong>de</strong> l’AQRP. Donc, les<br />
services prévus dans le système <strong>de</strong> services<br />
sont offerts par <strong>de</strong>s ressources<br />
appartenant à divers réseaux d’intervention<br />
aux philosophies différentes.<br />
Consensus formel au sujet <strong>de</strong>s valeurs<br />
Est-ce que ces organismes communautaires<br />
partagent les mêmes valeurs ?<br />
Le tableau 6 permet d’y répondre.<br />
Comme la réadaptation est proposée<br />
comme modèle dans le Plan d’action<br />
pour les services TMG, nous avons<br />
retenu les valeurs prônées par l’AQRP<br />
sur son site comme point <strong>de</strong> référence,<br />
et les avons comparées aux documents<br />
officiels produits par le RRAMQ et<br />
l’AGGID. Le tableau 6 nous permet<br />
<strong>de</strong> constater que les dix valeurs prônées<br />
par l’AQRP font l’objet d’un<br />
consensus <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s trois groupes,<br />
même si elles se réclament d’orientations<br />
différentes.<br />
En résumé, les services du système<br />
TMG sont offerts par <strong>de</strong>s ressources<br />
appartenant à <strong>de</strong>s réseaux différents<br />
qui se réclament <strong>de</strong>s mêmes valeurs.<br />
Mais au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> ce consensus sur les<br />
valeurs, est-ce que ces ressources offrent<br />
<strong>de</strong>s services dans une perspective <strong>de</strong><br />
réadaptation comme le stipule le Plan<br />
d’action (2005, p. 51) ? Ancrés dans<br />
<strong>de</strong>s cultures très différentes, comment<br />
les intervenants <strong>de</strong>s réseaux communautaire<br />
et institutionnel peuvent-ils<br />
appréhen<strong>de</strong>r, par exemple, le concept<br />
d’appropriation du pouvoir, du rétablissement?<br />
Comment conçoivent-ils<br />
le suivi communautaire, l’hébergement<br />
? Comment envisagent-ils la<br />
médication ?<br />
Différences idéologiques<br />
À première vue, l’on pourrait croire<br />
que les conceptions seraient les mêmes<br />
puisque tous semblent adhérer aux<br />
même concepts et aux mêmes valeurs.<br />
La réalité est, toutefois, différente car<br />
au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> ce consensus, les divergences<br />
sont profon<strong>de</strong>s. Faut-il rappeler qu’un<br />
nombre élevé <strong>de</strong> ressources communautaires<br />
n’a pas attendu le Plan d’action<br />
pour développer <strong>de</strong>s services TMG<br />
et les offrir selon <strong>de</strong>s modèles d’intervention<br />
originaux. Ces ressources ont,<br />
en conséquence, développé une expertise<br />
et <strong>de</strong>s manières <strong>de</strong> faire qui peuvent<br />
être plus ou moins congruentes<br />
Tableau 5 : Pourcentage <strong>de</strong>s organisemes communautaires par associations<br />
offrant ce service<br />
Système <strong>de</strong> services AQRP RRASMQ Réseau<br />
1. Services généraux<br />
(145 ressources) (107 ressources) institutionnel<br />
1.1 Services d’intervention<br />
<strong>de</strong> crise 5% 23% X<br />
1.2 Traitement 25% 20% X<br />
1.3 Protection et<br />
défense <strong>de</strong>s droits ----- 6% X<br />
1.4 Hospitalisation 25% ---- X<br />
2. Services <strong>de</strong> base<br />
2.1 Sociale 10% 37% X<br />
2.2 Travail et étu<strong>de</strong>s 20% 21% X<br />
2.3 Rési<strong>de</strong>ntielles 35% 17% X<br />
2.4 Information à propos<br />
<strong>de</strong> la maladie mentale ------ 9% X<br />
2.5 Information à propos<br />
<strong>de</strong> la médication ----- 9% X<br />
2.6 Soins médicaux et<br />
<strong>de</strong>ntaires ----- ----- X<br />
2.7 Soutien familial 15% 4% X<br />
2.8 Soutien par les pairs 25% 33% X<br />
2.9 Soutien<br />
communautaire 35% 1% X<br />
ORGANISATION DES SOINS 15<br />
<br />
LIVRES<br />
Liberté, sexualités,<br />
féminisme<br />
50 ans <strong>de</strong> combat du Planning<br />
pour les droits <strong>de</strong>s femmes<br />
Mouvement français pour le<br />
planning familial<br />
Ouvrage conçu et rédigé par<br />
Isabelle Friedmann<br />
Préface <strong>de</strong> Janine Mossuz-Lavau<br />
La Découverte, 20 €<br />
Le Mouvement français pour le planning<br />
familial est une organisation<br />
non gouvernementale (association<br />
loi <strong>de</strong> 1901) qui agit auprès <strong>de</strong>s pouvoirs<br />
publics pour faire reconnaître<br />
les droits <strong>de</strong>s femmes à la maîtrise<br />
<strong>de</strong> leur fécondité (contraception, avortement)<br />
et qui lutte pour l’élimination<br />
<strong>de</strong> la violence sexiste. Les associations<br />
départementales sont organisées<br />
en vingt fédérations régionales<br />
et en une confédération nationale.<br />
L’intérêt <strong>de</strong> ce livre est <strong>de</strong> mettre en<br />
scène, <strong>de</strong> manière très vivante, un<br />
long combat, opiniâtre - car il en a<br />
fallu <strong>de</strong> l’obstination pour vaincre les<br />
préjugés, les peurs et l’hypocrisie <strong>de</strong><br />
certains -, et qui est loin d’être achevé.<br />
Mais, au-<strong>de</strong>là, c’est l’évolution <strong>de</strong>s<br />
moeurs dans notre pays qui est retracée<br />
et les pistes <strong>de</strong>s prochaines<br />
luttes à conduire qui sont indiquées.<br />
L’accompagnement<br />
spirituel en milieu<br />
hospitalier<br />
Habib S. Kaaniche<br />
L’Harmattan, 18 €<br />
La présence <strong>de</strong>s représentants <strong>de</strong>s<br />
religions auprès <strong>de</strong>s personnes hospitalisées<br />
se fait plus forte et se modifie.<br />
L’accompagnement spirituel revêt<br />
<strong>de</strong>s formes nouvelles. De nouveaux<br />
types d’accompagnants apparaissent,<br />
également, aux côtés <strong>de</strong>s aumôniers.<br />
L’accompagnant spirituel est une personne<br />
qui s’associe au mala<strong>de</strong> afin<br />
<strong>de</strong> pouvoir le soutenir dans ses moments<br />
d’angoisse et <strong>de</strong> souffrance.<br />
Son objectif est d’être avec l’accompagné<br />
dans toutes les étapes <strong>de</strong> sa<br />
maladie (parfois jusqu’à la mort). Il<br />
s’intéresse à son être entier, ce qui<br />
englobe la santé physique, morale et<br />
spirituelle. Cette notion d’accompagnement<br />
spirituel est précisée dans<br />
ce livre qui abor<strong>de</strong> aussi les les aumôneries.<br />
Celles-ci ont, <strong>de</strong>rrière elles,<br />
une longue tradition d’accompagnement<br />
spirituel dans les hôpitaux et<br />
ont également connu au fil <strong>de</strong>s années<br />
<strong>de</strong> profon<strong>de</strong>s mutations.
16<br />
ORGANISATION DES SOINS<br />
Des psychologues auprès <strong>de</strong>s tout-petits, pour quoi faire ?<br />
Sous la direction <strong>de</strong> Danièle Delouvin<br />
Collection Mille et un bébés<br />
Erès, 10 €<br />
L’A.NA.Psy.p.e. (Association nationale <strong>de</strong>s psychologues pour la petite enfance)<br />
a vingt ans. Ses membres, psychologues cliniciens, qui se réfèrent, dans<br />
leurs pratiques, à la psychanalyse, exercent dans <strong>de</strong>s lieux d’accueil et <strong>de</strong><br />
soins <strong>de</strong> la petite enfance (crèches, maternités, pouponnières, services <strong>de</strong> Protection<br />
maternelle et infantile...) auprès <strong>de</strong>s enfants, mais aussi <strong>de</strong> leurs familles<br />
et <strong>de</strong>s professionnels.<br />
Pour célébrer cet anniversaire, ce livre, recueil <strong>de</strong> textes, certains anciens et<br />
d’autres plus récents, apporte un témoignage <strong>de</strong> ce que [es psychologues <strong>de</strong><br />
l’A.NA.Psy.p.e. ont « fait » dans les lieux <strong>de</strong> la petite enfance <strong>de</strong>puis vingt ans.<br />
avec la réadaptation, mais qui sont<br />
reconnues dans les documents officiels.<br />
Qu’est-ce qui peut nous permet d’affirmer<br />
que la conceptualisation <strong>de</strong> ces<br />
services est envisagée différemment?<br />
L’analyse du discours officiel <strong>de</strong>s<br />
groupes sur leur mission et leurs<br />
valeurs. Examinons le discours <strong>de</strong> trois<br />
groupes officiellement reconnus.<br />
Tableau 6<br />
ADHÉSION AUX VALEURS<br />
DE l’AQRP<br />
Valeurs <strong>de</strong> :<br />
l’AQRP AGIDD RRASMQ<br />
Conviction<br />
(liberté <strong>de</strong> faire<br />
<strong>de</strong>s choix)<br />
X X<br />
Besoins (aspects<br />
biologiques,<br />
psychologiques,<br />
spirituels, sociaux,<br />
culturels et environnementaux)<br />
X X<br />
Potentiel X X<br />
Espoir X X<br />
Réseau <strong>de</strong><br />
soutien<br />
X X<br />
Entrai<strong>de</strong><br />
Action<br />
X X<br />
communautaire X X<br />
Relation d’ai<strong>de</strong> X X<br />
Qualité <strong>de</strong>s<br />
intervenants<br />
X X<br />
L’AQRP affirme, sur son site officiel,<br />
que « la réadaptation psychosociale s’est<br />
développée pour répondre aux besoins<br />
particuliers <strong>de</strong>s gens souffrant <strong>de</strong> troubles<br />
mentaux graves. Elle a pour mission <strong>de</strong><br />
soutenir ces personnes et <strong>de</strong> favoriser<br />
l’amélioration <strong>de</strong> leur qualité <strong>de</strong> vie, <strong>de</strong><br />
leurs relations interpersonnelles et <strong>de</strong> leur<br />
insertion dans un milieu <strong>de</strong> leur choix,<br />
afin qu’elles puissent éprouver du succès,<br />
du plaisir à vivre et satisfaire leurs<br />
aspirations ».<br />
Pour sa part, l’AGIDD affirme vouloir<br />
« défendre les droits <strong>de</strong>s personnes ayant<br />
ou qui ont vécu <strong>de</strong>s problèmes <strong>de</strong> santé<br />
mentale tout en dénonçant les abus <strong>de</strong> la<br />
psychiatrie ; démystifier la folie dans son<br />
langage et dans son essence, et établir<br />
un rapport <strong>de</strong> force entre les personnes<br />
qui ont ou qui ont déjà eu un problème<br />
<strong>de</strong> santé mentale et les professionnels(les)<br />
<strong>de</strong> la santé et autres ».<br />
Enfin, le RRASMQ souligne sur son<br />
site que « La personne a une histoire,<br />
elle vit dans un milieu donné et dans <strong>de</strong>s<br />
conditions économiques, sociales, culturelles<br />
et politiques qui impriment à sa<br />
souffrance <strong>de</strong>s caractéristiques propres<br />
et qui marquent ses relations avec les<br />
autres ; …. elle n’est pas un diagnostic<br />
ambulant… L’alternative respecte et<br />
encourage le pouvoir <strong>de</strong> la personne qui<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> a sur elle-même. Ceci,<br />
en opposition à ce qu’on retrouve dans le<br />
réseau étatique où la personne n’a pas<br />
vraiment le choix <strong>de</strong> ce qui lui est offert<br />
et <strong>de</strong> ce qui lui arrive. L’alternative vise<br />
à créer les conditions nécessaires permettant<br />
à la personne <strong>de</strong> se réapproprier<br />
le pouvoir sur elle-même, sur sa situation,<br />
sur son environnement (revendiqué<br />
comme un trait distinctif par rapport au<br />
réseau public). L’alternative favorise l’accès<br />
à tous les lieux <strong>de</strong> pouvoir décisionnels<br />
au sein <strong>de</strong>s ressources et travaille à<br />
améliorer, développer, inventer <strong>de</strong>s<br />
formes nouvelles d’exercice du pouvoir.<br />
Ce faisant, l’alternative travaille à redonner<br />
aux usagers et aux usagères leur<br />
statut <strong>de</strong> citoyens et <strong>de</strong> citoyennes à part<br />
entière. L’alternative permet aussi la<br />
contestation par les personnes, individuellement<br />
et collectivement, du pouvoir<br />
psychiatrique …. L’alternative tente d’éviter<br />
le plus possible la hiérarchie, la<br />
bureaucratie, les rapports <strong>de</strong> domination<br />
entre les usager-ère-s et entre les usager-ère-s<br />
et les intervenant-e-s… elle doit<br />
s’impliquer dans les luttes sociales plus<br />
globales… elle doit constamment<br />
remettre en question le pouvoir psychiatrique<br />
et toutes les formes <strong>de</strong> domination<br />
et d’aliénation ».<br />
Comme on peut le constater, les discours<br />
<strong>de</strong>s regroupements sont très<br />
contrastés. Corin et al. (1996) ont fait<br />
une analyse politique <strong>de</strong> l’AQRP et du<br />
RRASMQ qui permet <strong>de</strong> mieux comprendre<br />
leurs différences et enjeux<br />
sous-jacents. Selon ces auteurs, l’AQRP<br />
se situe dans le système et fait une critique<br />
<strong>de</strong>s services psychosociaux institutionnels<br />
pour les modifier. Selon les<br />
mêmes auteurs, l’AQRP s’inscrit dans<br />
un courant psychosocial <strong>de</strong> critique<br />
radicale <strong>de</strong>s modèles d’intervention,<br />
critique qui a « amené à définir <strong>de</strong> nouveaux<br />
modèles d’intervention qui visent<br />
BEBE - CULTURES<br />
Culture <strong>de</strong>s bébés<br />
Bébé <strong>de</strong>s cultures<br />
parmi les intervenants invités<br />
Catherine Dolto, René Frydman,<br />
Marie-Rose Moro,<br />
Geneviève Delaisi <strong>de</strong> Parseval,<br />
Patrick Bensoussan, Drina Candilis,<br />
Denis Mellier<br />
•••<br />
Association Recherche<br />
Information Périnatalité<br />
pour recevoir le PROGRAMME<br />
et le BULLETIN D’INSCRIPTION :<br />
ARIP - BP 36<br />
84142 MONTFAVET CEDEX<br />
Tél : 33 (0)4 90 23 99 35<br />
Fax : 33 (0)4 90 23 51 17<br />
Email : arip@wanadoo.fr<br />
site : perinatalité.org<br />
à renforcer la manière dont les personnes<br />
elles-mêmes se confrontent et s’adaptent<br />
à <strong>de</strong>s situations difficiles et à les encourager<br />
à utiliser les ressources du milieu »<br />
(p.49). Comme ces modèles insistent<br />
davantage sur les forces personnelles, il<br />
s’en suit une individualisation <strong>de</strong>s perspectives<br />
d’intervention plus conforme<br />
à une approche bureaucratique <strong>de</strong>s<br />
soins. Quant au RRASMQ, les auteurs<br />
mentionnent que les alternatives se<br />
situent en marge du système voire en<br />
opposition, et qu’elles fon<strong>de</strong>nt leur discours<br />
sur une contestation du modèle<br />
médical, et <strong>de</strong>s modèles <strong>de</strong> réadaptation<br />
à visée normalisante.<br />
Comment ces positions s’incarnentelles<br />
par exemple dans l’appropriation<br />
du pouvoir ? Selon Corin et al. (1996),<br />
l’AQRP voudrait promouvoir « l’approche<br />
<strong>de</strong> l’appropriation du pouvoir dans<br />
l’ensemble <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> santé mentale<br />
existants, en la mettant au centre <strong>de</strong>s<br />
modèles d’intervention à promouvoir »<br />
(p.46). Toutefois, le développement <strong>de</strong><br />
l’entrai<strong>de</strong> promu par l’AQRP, selon les<br />
auteurs, est « pensée en termes <strong>de</strong> pratiques<br />
<strong>de</strong> socialisation et <strong>de</strong> création <strong>de</strong><br />
milieux d’appartenance. Le souci <strong>de</strong><br />
modifier les milieux et les conditions <strong>de</strong><br />
vie se traduit en termes d’un élargissement<br />
<strong>de</strong> la capacité d’accueil <strong>de</strong>s communautés.<br />
Les intervenants sont par<br />
ailleurs invités <strong>de</strong> manière générale à<br />
contribuer au processus <strong>de</strong> changements<br />
nécessaires aux plans social et politique »<br />
(p.49). Cela réduirait la portée <strong>de</strong> la<br />
réappropriation du pouvoir car, selon<br />
ces chercheurs, « les pratiques collectives<br />
d’appropriation du pouvoir (entrai<strong>de</strong><br />
et action communautaire) <strong>de</strong> l’AQRP<br />
valorisent <strong>de</strong> manière implicite le rôle<br />
<strong>de</strong>s professionnels et les connotations<br />
sociopolitiques <strong>de</strong> ces notions dans le discours<br />
du RRASMQ se trouvent largement<br />
minimisées » (p.49). De plus, les<br />
auteurs estiment que promouvoir « une<br />
alliance générale et consensuelle entre<br />
tous les partenaires du champ <strong>de</strong> la santé<br />
mentale tend à effacer les particularités<br />
du contexte québécois dont la contribution<br />
du mouvement alternatif soit le<br />
RRASMQ. C’est un partenariat consensuel<br />
au lieu <strong>de</strong> conflictuel, lequel favorise<br />
<strong>de</strong>s modèles d’intervention qui sont<br />
parfois opposées à celles du réseau psychiatrique<br />
» (p.49). Quelles sont ces<br />
conotations sociopolitiques ?<br />
Les auteurs « situent les alternatives dans<br />
le courant <strong>de</strong>s mouvements sociaux<br />
contestataires du système et <strong>de</strong> son pouvoir<br />
». Elles montrent que la notion <strong>de</strong><br />
pouvoir est pensée à partir « <strong>de</strong>s conditions<br />
sociopolitiques dans lesquelles se<br />
trouvent inscrites les personnes, incluant<br />
la marginalisation associée à la maladie<br />
mentale et à l’hospitalisation psychiatrique;<br />
et celle d’une histoire <strong>de</strong> vie personnelle<br />
et les conditions socioculturelles<br />
dans lesquelles elle s’inscrit afin que les<br />
personnes, prenant conscience <strong>de</strong> leurs<br />
forces et retrouvant leur capacité d’agir,<br />
acquièrent un pouvoir sur leur propre<br />
vie et accè<strong>de</strong>nt à une place significative<br />
dans la société à titre <strong>de</strong> citoyens » (p.48).<br />
Le RRASMQ privilégie, ainsi, la participation<br />
à la vie associative dont les<br />
instances décisionnelles <strong>de</strong>s ressources<br />
comme mécanisme <strong>de</strong> réappropriation<br />
du pouvoir.<br />
Comme on peut le voir, sous-jacent<br />
aux services qu’offrent les organismes<br />
communautaires et aux valeurs auxquelles<br />
ils adhèrent, les organismes ont<br />
<strong>de</strong>s positions idéologiques fort différentes.<br />
Ces positions différentielles leur<br />
font envisager les concepts porteurs<br />
dont ils se réclament tous <strong>de</strong> manière<br />
différente, et mettent en place <strong>de</strong>s<br />
modèles d’intervention les appliquant<br />
sur <strong>de</strong>s bases autres.<br />
Modèle théorique<br />
Selon la Politique <strong>de</strong> santé mentale<br />
(1989), il y a trois dimensions à la<br />
santé mentale :<br />
- « un axe biologique qui a trait aux<br />
composantes génétiques et physiologiques<br />
»,<br />
- « un axe psychodéveloppemental qui<br />
met l’accent sur les aspects affectif, cognitif<br />
et relationnel »,<br />
- « un axe contextuel qui fait référence à<br />
l’insertion <strong>de</strong> l’individu dans un environnement<br />
et à ses relations avec son<br />
milieu » (p.21).<br />
De ces trois aspects, « C’est l’aspect du<br />
psychodéveloppement qui caractérise le<br />
mieux l’état <strong>de</strong> santé mentale. Ainsi, la<br />
santé mentale d’une personne s’apprécie<br />
à sa capacité d’utiliser ses émotions <strong>de</strong><br />
façon appropriée dans les actions qu’elle<br />
pose (affectif), d’établir <strong>de</strong>s raisonnements<br />
qui lui permettent d’adapter ses gestes<br />
aux circonstances (cognitif) et <strong>de</strong> composer<br />
<strong>de</strong> façon significative avec son environnement<br />
(relationnel). Tout en reconnaissant<br />
cette spécificité, il <strong>de</strong>meure<br />
fondamental d’agir à la fois sur les<br />
dimensions biologique, psychologique,<br />
sociale et ainsi élargir l’action en santé<br />
mentale » (p.21). Ce cadre théorique<br />
du système est ce que l’on appelle le<br />
bio-psycho-social. Même si cette<br />
conception <strong>de</strong> la santé mentale n’est<br />
pas mentionnée dans les <strong>de</strong>ux Plans<br />
d’action subséquents, elle <strong>de</strong>meure la<br />
Le laboratoire Bioco<strong>de</strong>x a organisé,<br />
le 28 mars <strong>de</strong>rnier, une conférence-déjeuner<br />
sur ce thème, dont<br />
le modérateur était Jean-Pierre Clément.<br />
Cette conférence s’est déroulée<br />
au cours du 3ème Congrès <strong>de</strong>s<br />
Mé<strong>de</strong>cins Coordonnateurs d’EHPAD<br />
(du 26 au 28 mars 2006 au Palais<br />
<strong>de</strong>s Congrès à Paris).<br />
Où en sommes-nous face à la<br />
problématique dépressive chez le<br />
sujet âgé ?<br />
Jean-Pierre Clément (1) a rappelé que<br />
ces <strong>de</strong>rnières années ont été marquées<br />
par un développement <strong>de</strong>s<br />
connaissances sur la dépression du<br />
sujet âgé. Etant la pathologie mentale<br />
la plus fréquente dans le grand âge,<br />
l’intérêt pour cette affection est <strong>de</strong>venu<br />
prépondérant au même titre que<br />
la démence avec laquelle elle tisse,<br />
<strong>de</strong>puis longtemps, <strong>de</strong>s liens.<br />
Pour ce qui concerne la clinique, et<br />
pour améliorer son repérage, les spécificités<br />
sémiologiques ont été rappelées<br />
en introduisant <strong>de</strong>s nouveaux<br />
concepts tels que ceux <strong>de</strong> « dépression<br />
vasculaire », <strong>de</strong> « dépression conative<br />
», <strong>de</strong> « dépression hostile », <strong>de</strong><br />
« syndrome dépressif dysexécutif »...<br />
On distingue aussi, <strong>de</strong> plus en plus, la<br />
dépression d’émergence tardive sans<br />
antécé<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la dépression récurrente<br />
à un âge tardif. De même qu’il<br />
est nécessaire <strong>de</strong> tenir compte <strong>de</strong><br />
l’environnement et <strong>de</strong> la personnalité<br />
antérieure par rapport à l’expressivité<br />
<strong>de</strong> la dépression. Dans ce sens<br />
ont été élaborées la mini-GDS qui<br />
peut ai<strong>de</strong>r au dépistage <strong>de</strong> la dépression<br />
en mé<strong>de</strong>cine générale et l’EDDI<br />
au dépistage en institution. Des éléments<br />
sur les personnalités à risque<br />
<strong>de</strong> développer une dépression tardive<br />
existent et il est intéressant <strong>de</strong><br />
les comparer avec ceux issus <strong>de</strong>s facteurs<br />
<strong>de</strong> risque psychosociaux <strong>de</strong>s<br />
démences.<br />
Une meilleure appréciation <strong>de</strong> l’état<br />
cognitif <strong>de</strong>vant une symptomatologie<br />
dépressive <strong>de</strong>vrait être vulgarisée.<br />
Sur un plan plus psychopathologique,<br />
mais toujours en lien avec les<br />
données <strong>de</strong> la biologie (perturbations<br />
<strong>de</strong> l’axe corticotrope, anomalies<br />
d’imagerie cérébrale), il serait aussi<br />
intéressant <strong>de</strong> distinguer « dépression<br />
<strong>de</strong> perte » et « dépression <strong>de</strong> contrainte<br />
». Il existe aussi <strong>de</strong>s données sur le<br />
pronostic, non négligeables pour ajuster<br />
les prises en charge. Le traitement<br />
<strong>de</strong> la dépression fait, maintenant,<br />
l’objet <strong>de</strong> recommandations<br />
découlant <strong>de</strong> l’épidémiologie, <strong>de</strong> la<br />
N°3 - TOME XIX - AVRIL 2006<br />
référence <strong>de</strong> base dans le milieu <strong>de</strong> la<br />
santé (16).<br />
Au lieu <strong>de</strong> permettre une intégration<br />
<strong>de</strong>s services offerts aux personnes en<br />
difficulté, il semble que cette approche<br />
a connu une dérive en faveur d’une<br />
prédominance du biologique dont le<br />
miroir s’est révélé le social. La maladie<br />
mentale n’est-elle pas considérée<br />
comme « l’interaction <strong>de</strong>s facteurs biologique,<br />
social et environnemental »<br />
(Weinstein et Hughes, 2000) dans les<br />
milieux <strong>de</strong> la réadaptation. Également,<br />
cette conception s’harmonisant bien<br />
avec une approche par programme,<br />
elle permet d’offrir une rationalisation<br />
pour une conception <strong>de</strong> la personne<br />
avec <strong>de</strong>s besoins que <strong>de</strong>s services viendraient<br />
satisfaire, d’où le système <strong>de</strong><br />
services en vigueur visant à répondre<br />
aux besoins multiples d’une personne.<br />
Pour caricaturer, c’est une approche<br />
saucisson. <br />
Yves Leconte<br />
Suite <strong>de</strong> cet article dans le prochain numéro.<br />
Regards sur la<br />
dépression du sujet âgé<br />
psychopharmacologie et <strong>de</strong> la pratique<br />
clinique, en particulier dans le<br />
choix <strong>de</strong> la molécule en fonction du<br />
contexte.<br />
Le ralentissement psychomoteur,<br />
un signe important <strong>de</strong> la<br />
dépression du sujet âgé<br />
Sylvie Bonin-Guillaume (2) et Olivier<br />
Blin (3) ont précisé qu’i<strong>de</strong>ntifier le<br />
ralentissement psychomoteur (RPM)<br />
chez le sujet âgé permettrait un<br />
meilleur dépistage <strong>de</strong> la dépression,<br />
notamment dans les formes atypiques,<br />
dont le pronostic et l’évolution<br />
sont défavorables.<br />
L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s temps <strong>de</strong> réaction du<br />
RPM par la Métho<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Facteurs<br />
Additifs a permis <strong>de</strong> distinguer le<br />
RPM associé à la dépression chez le<br />
sujet âgé <strong>de</strong> celui lié à l’âge. Dans le<br />
premier, seules certaines étapes du<br />
traitement <strong>de</strong> l’information sont affectées<br />
par la dépression alors que<br />
toutes les étapes sont ralenties <strong>de</strong><br />
façons i<strong>de</strong>ntiques dans le <strong>de</strong>uxième.<br />
L’Echelle du Ralentissement Dépressif<br />
(ERD) <strong>de</strong> Widlöcher, qui mesure,<br />
objectivement et spécifiquement, le<br />
RPM dépressif, a été validée dans<br />
une population <strong>de</strong> sujets âgés hospitalisés.<br />
L’ERD gar<strong>de</strong> une bonne<br />
validité <strong>de</strong> structure et interne : unidimensionnalité,<br />
évaluation globale<br />
du RPM (trois facteurs : moteur,<br />
mental et cognitif). Comparée à <strong>de</strong>s<br />
échelles <strong>de</strong> dépression <strong>de</strong> référence<br />
chez le sujet âgé (Echelle <strong>de</strong> dépression<br />
d’Hamilton, Echelle <strong>de</strong> Dépression<br />
<strong>de</strong> Montgomery et Asberg,<br />
Echelle <strong>de</strong> Dépression Gériatrique),<br />
l’ERD est vali<strong>de</strong> ; un score seuil <strong>de</strong><br />
10 permet <strong>de</strong> dépister 15% d’états<br />
dépressifs <strong>de</strong> plus. Une forme à 4<br />
items a été également validée montrant<br />
les mêmes qualités psychométriques.<br />
Un score seuil <strong>de</strong> 3 permet<br />
<strong>de</strong> dépister 23% <strong>de</strong> patients dépressifs<br />
<strong>de</strong> plus que les échelles <strong>de</strong> référence.<br />
La Mini-ERD <strong>de</strong>vrait être<br />
incluse dans les étu<strong>de</strong>s thérapeutiques<br />
et être utilisée systématiquement<br />
dans le dépistage <strong>de</strong> la dépression<br />
du sujet âgé. <br />
F.C.<br />
(1) Centre Hospitalier Esquirol, Limoges.<br />
(2) Service <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine interne gériatrie,<br />
CHU Nord, Assistance Publique <strong>de</strong>s Hôpitaux<br />
<strong>de</strong> Marseille.<br />
(3) Centre <strong>de</strong> Pharmacologie Clinique et<br />
d’Evaluation Thérapeutique, Hôpital <strong>de</strong> la<br />
Timone, Assistance Publique <strong>de</strong>s Hôpitaux<br />
<strong>de</strong> Marseille, Institut <strong>de</strong>s Neurosciences Cognitives<br />
<strong>de</strong> la Méditerranée, Faculté <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine<br />
<strong>de</strong> Marseille.
N°3 - TOME XIX - AVRIL 2006<br />
L’E.M.PRO.<br />
LA PLAINE<br />
DU<br />
MOULIN<br />
accueillant 45<br />
adolescents déficients<br />
intellectuels légers et<br />
moyens avec ou sans<br />
troubles associés<br />
Recherche<br />
Psychiatre<br />
à 0,28 ETP<br />
(soit 10h30/semaine,<br />
présence<br />
jeudi 13h30-18h00<br />
indispensable)<br />
CC 1966 - Orientation<br />
psychanalytique<br />
<strong>de</strong>mandée<br />
*****<br />
Adresser CV et<br />
lettre <strong>de</strong> motivation à<br />
Mme la Directrice <strong>de</strong><br />
l’EMPRO,<br />
Allée <strong>de</strong> Montfort<br />
78190 TRAPPES<br />
Tél. : 01 30 51 13 08<br />
LE CENTRE<br />
HOSPITALIER DE<br />
NEMOURS<br />
77796 NEMOURS CEDEX<br />
(Seine-et-Marne)<br />
(70 km <strong>de</strong> Paris par<br />
l’Autoroute A6)<br />
Recrute<br />
Pédo Psychiatre<br />
temps plein et<br />
temps partiel<br />
sur postes vacants<br />
(intersecteur 77 I 03)<br />
Exercice principal en CMP,<br />
Possibilité activité<br />
complémentaire mi-temps en<br />
IME à Fontainebleau<br />
(convention 66).<br />
Renseignements :<br />
Bureau <strong>de</strong>s Affaires Médicales<br />
Tél. 01.64.45.19.08<br />
Docteur Yannick FRANÇOIS<br />
(Chef <strong>de</strong> service)<br />
Tél. 01 64 45 24 75<br />
LE CHS DE<br />
LA SAVOIE<br />
Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE à CHAMBERY (BASSENS),<br />
assure les soins en santé mentale pour l’ensemble du département (cinq secteurs<br />
adultes, trois secteurs enfants et un département <strong>de</strong> psychopathologie <strong>de</strong><br />
l'adolescent).<br />
Etablissement dynamique : 60 mé<strong>de</strong>cins, 800 agents, hospitalisation complète<br />
rénovée, nombreuses structures extra-hospitalières, projet d’Etablissement<br />
2006-2010 validé, accréditation V2 en cours.<br />
Le CHS <strong>de</strong> la SAVOIE est à environ 1 heure <strong>de</strong> GRENOBLE, LYON, GENEVE…<br />
et <strong>de</strong>s stations <strong>de</strong> ski.<br />
R E C R U T E<br />
• Pour le Secteur AIX LES BAINS<br />
Secteur regroupant <strong>de</strong>ux unités d’hospitalisation <strong>de</strong> 25 lits, <strong>de</strong>ux hôpitaux <strong>de</strong> jour et les<br />
consultations externes<br />
2 PSYCHIATRES<br />
Praticiens Hospitaliers à temps plein - exercice <strong>de</strong> secteur et en hospitalisation<br />
• Pour le Secteur TARENTAISE<br />
Secteur regroupant <strong>de</strong>ux unités d’hospitalisations <strong>de</strong> 25 lits, un hôpital <strong>de</strong> jour et les<br />
consultations externes<br />
1 PSYCHIATRE, avec fonction <strong>de</strong> Chef <strong>de</strong> Service<br />
Dans le cadre <strong>de</strong> la mise en œuvre du SROS 3, le Chef <strong>de</strong> Service assurera l’organisation<br />
du service nouvellement créé et le transfert <strong>de</strong>s activités psychiatriques au sein du nouveau<br />
Centre Hospitalier Albertville-Moutiers (CHAM)<br />
et 1 PSYCHIATRE<br />
Praticien Hospitalier temps plein – exercice <strong>de</strong> secteur et en hospitalisation<br />
• Pour le Secteur CHAMBERY NORD<br />
Secteur regroupant <strong>de</strong>ux unités d’hospitalisation <strong>de</strong> 25 lits, un hôpital <strong>de</strong> jour et les<br />
consultations externes<br />
1 PSYCHIATRE<br />
Praticien Hospitalier temps plein – exercice <strong>de</strong> secteur et en hospitalisation<br />
Pour tout renseignement, contacter :<br />
les Affaires Médicales et Générales du CHS <strong>de</strong> la Savoie au n° <strong>de</strong> tél. 04 79 60 30 04<br />
Adresser les candidatures à l'attention <strong>de</strong> :<br />
Mme DESSEIGNE, Directeur <strong>de</strong>s Affaires Médicales et Générales<br />
CHS DE LA SAVOIE - BP 1126 - 73011 CHAMBERY CEDEX<br />
Fax : 04 79 60 31 89 - E-mail : dam@chs-savoie.fr<br />
ASM 13<br />
11 rue A. Bayet, 75013 PARIS<br />
Recrute<br />
1 assistant spécialiste <strong>de</strong> psychiatrie<br />
Joindre Dr. BONNET – 01 40 77 44 48<br />
LE CENTRE HOSPITALIER<br />
UNIVERSITAIRE DE REIMS<br />
Recherche<br />
Psychiatre temps plein<br />
Ou mé<strong>de</strong>cin généraliste (expérience en psychiatrie)<br />
A compter du 1 er avril 2006<br />
Pour son Unité d’accueil <strong>de</strong>s urgences psychiatriques (8 lits)<br />
Au sein du service d’Accueil <strong>de</strong>s Urgences<br />
Renseignements : Dr BAZIN, Chef <strong>de</strong> Service<br />
Tél : 03 26 78 76 03<br />
Candidatures et CV à adresser à :<br />
• Mme le Directeur Général du CHU <strong>de</strong> Reims,<br />
23 rue <strong>de</strong>s Moulins, 51092 Reims Ce<strong>de</strong>x<br />
Et à :<br />
• la Direction <strong>de</strong>s Affaires Médicales, Mme Nathalie BECRET,<br />
Directeur<br />
Tél : 03 26 78 74 44<br />
E-mail : nbecret@chu-reims.fr<br />
ANNONCES PROFESSIONNELLES 17<br />
Pour vos annonces professionnelles<br />
contactez Madame Susie Caron au<br />
01 45 50 23 08<br />
ou par e-mail<br />
info@nervure-psy.com<br />
L’établissement public <strong>de</strong> santé <strong>de</strong> Maison Blanche recrute<br />
PSYCHIATRE<br />
Praticien hospitalier à temps partiel<br />
Pour l’Equipe <strong>de</strong> Liaison Psychiatrique (ELP)<br />
Rattachée et articulée à l’intersecteur « addictions et psychiatrie »<br />
Service intersectoriel d’accueil et <strong>de</strong> soins LA TERRASSE<br />
220, rue Marca<strong>de</strong>t 75018 PARIS<br />
MISSION DU POSTE :<br />
Evaluation clinique, échanges avec les partenaires<br />
du XVIIIème arrondissement, orientation, travail d’équipe,<br />
formation et information<br />
L’équipe sera constituée <strong>de</strong> 2 psychiatres temps partiel,<br />
2 infirmiers temps plein, 1 assistante sociale temps plein,<br />
1 secrétaire temps partiel<br />
Contacter :<br />
Mr le docteur Jacques JUNGMAN<br />
Chef <strong>de</strong> service<br />
Tél : 01.42.26.36.51<br />
Nous recherchons <strong>de</strong>s<br />
MEDECINS SPECIALISES EN PSYCHIATRIE<br />
pour poursuivre la montée en charge <strong>de</strong> la <strong>de</strong>uxième procédure<br />
d'accréditation/certification <strong>de</strong>s établissements <strong>de</strong> santé orientée vers<br />
le service médical rendu dans les établissements<br />
* * * * *<br />
Votre profil :<br />
- Vous êtes psychiatre.<br />
- Vous exercez en établissement <strong>de</strong> santé privé ou public.<br />
Votre parcours professionnel :<br />
- Vous avez une expérience professionnelle d'environ 10 ans, dont les 3<br />
<strong>de</strong>rnières années en établissement <strong>de</strong> santé privé ou public.<br />
- Vous êtes fortement impliqué dans <strong>de</strong>s responsabilités à caractère<br />
transversal au sein <strong>de</strong> votre établissement <strong>de</strong> santé.<br />
- Vous avez conduit <strong>de</strong>s projets d'amélioration continue <strong>de</strong> la qualité.<br />
* * * * *<br />
Vous serez l'ambassa<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> la Haute Autorité <strong>de</strong> santé chargé d'assurer,<br />
après formation, les visites <strong>de</strong>s établissements <strong>de</strong> santé prévues par les<br />
dispositions législatives et réglementaires créant l'accréditation.<br />
* * * * *<br />
Modalités <strong>de</strong> dépôt <strong>de</strong>s candidatures<br />
Un dossier <strong>de</strong> candidature est à <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r par téléphone au 01 55 93 72 53,<br />
par téléchargement sur le site <strong>de</strong> l’agence www.has-sante.fr<br />
ou par courrier :<br />
Haute Autorité <strong>de</strong> Santé, Direction <strong>de</strong> l’Accréditation<br />
Sélection <strong>de</strong>s Experts-Visiteurs, 2 avenue du Sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> France<br />
93218 Saint-Denis la Plaine Ce<strong>de</strong>x<br />
Femme Mé<strong>de</strong>cin Généraliste bulgare<br />
en cours DIU <strong>Psychiatrie</strong> générale<br />
cherche poste pour vali<strong>de</strong>r sa formation<br />
Toutes régions<br />
Tél. 06 67 25 85 58
18<br />
LIVRES<br />
Management <strong>de</strong> la santé et <strong>de</strong><br />
la sécurité au travail<br />
Un champ <strong>de</strong> recherche à défricher<br />
Publié sous la direction <strong>de</strong><br />
Emmanuel Abord <strong>de</strong> Chatillon et<br />
Olivier Bachelard<br />
Préface <strong>de</strong> Jean-Marie Peretti<br />
L’Harmattan, 39 €<br />
Cet ouvrage, issu <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong>s premières<br />
journées <strong>de</strong> recherche sur le management<br />
<strong>de</strong> la santé et <strong>de</strong> la sécurité<br />
au travail d’Annecy, tente <strong>de</strong> répondre<br />
aux questions que se posent tous les<br />
acteurs <strong>de</strong> la prévention qu’ils soient<br />
responsables <strong>de</strong>s Ressources Humaines,<br />
responsables ou agent <strong>de</strong> prévention,<br />
membres <strong>de</strong> CHSCT, mais aussi représentants<br />
syndicaux, mé<strong>de</strong>cins ou inspecteurs<br />
du travail.<br />
Face à l’intensification du travail, le salarié<br />
<strong>de</strong>vient, à son corps défendant,<br />
la <strong>de</strong>rnière possibilité <strong>de</strong> flexibilité.<br />
L’homme au travail va ainsi subir la<br />
pression d’une hiérarchie soumise au<br />
résultat immédiat, cette <strong>de</strong>rnière étant<br />
elle-même dépendante d’une organisation<br />
<strong>de</strong> la production <strong>de</strong> plus en plus<br />
intense quels que soient les secteurs<br />
concernés. De nombreuses questions<br />
se posent sur la meilleure manière <strong>de</strong><br />
gérer les organisations et leurs conditions<br />
<strong>de</strong> travail pour éviter que ne se<br />
produisent <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts et que ne se<br />
développent <strong>de</strong>s troubles médicaux<br />
et/ou psychologiques.<br />
L’intérêt porté aux questions <strong>de</strong> santé<br />
et <strong>de</strong> sécurité au travail amène à examiner<br />
<strong>de</strong> plus près non seulement les<br />
origines <strong>de</strong> ces pathologies, mais également<br />
l’ensemble <strong>de</strong>s dispositifs <strong>de</strong><br />
management, <strong>de</strong> prévention et <strong>de</strong> traitement<br />
qui vient s’y greffer. En effet,<br />
s’intéresser à la santé et la sécurité au<br />
travail, c’est interroger non seulement<br />
sur ce qu’est l’organisation aussi bien<br />
dans ses frontières que dans ses dispositifs<br />
<strong>de</strong> régulation, mais également<br />
sur le fonctionnement <strong>de</strong>s collectifs <strong>de</strong><br />
travail et leurs conséquences sur la Santé<br />
Sécurité au Travail.<br />
Séparons-nous... mais<br />
protégeons nos enfants<br />
Stéphane Clerget<br />
Editions Albin Michel, 13,90 €<br />
Familles recomposées, beau-père, bellemère,<br />
gar<strong>de</strong> partagée : ces termes font<br />
partie intégrante <strong>de</strong> nos structures familiales<br />
et <strong>de</strong> la vie quotidienne <strong>de</strong> nombreux<br />
parents et enfants. La fréquence<br />
<strong>de</strong>s séparations parentales nous amène,<br />
parfois, à considérer la rupture comme<br />
un événement familier, presque anodin<br />
<strong>de</strong> l’existence.<br />
C’est à cette banalisation <strong>de</strong> la séparation<br />
que Stéphane Clerget, pédopsychiatre,<br />
s’attaque en adressant son livre,<br />
en premier lieu, à tout parent amené à<br />
se séparer ou à divorcer, mais également<br />
aux beaux-parents, grands-parents<br />
et enseignants, c’est-à-dire aux<br />
personnes qui « font partie <strong>de</strong> la pièce<br />
qui se joue autour <strong>de</strong> l’enfant ». Stéphane<br />
Clerget souhaite ai<strong>de</strong>r à ce que la séparation<br />
parentale ne s’apparente ni à<br />
un vau<strong>de</strong>ville ni à une tragédie pour<br />
suivre la métaphore théâtrale.<br />
L’auteur envisage la rupture parentale,<br />
d’une manière générale, comme un<br />
temps décisif dans le <strong>de</strong>venir psychologique<br />
<strong>de</strong> l’enfant concerné. Cela se<br />
comprend si l’on perçoit la famille comme<br />
un système au sein duquel l’enfant se<br />
construit tant d’un point <strong>de</strong> vue psychologique,<br />
affectif que social. Stéphane<br />
Clerget reprend les expressions <strong>de</strong> Françoise<br />
Dolto parlant <strong>de</strong> « moi-maman »<br />
et <strong>de</strong> « moi-papa » pour exprimer la façon<br />
dont le nourrisson peut se vivre en<br />
présence <strong>de</strong> ses parents avant <strong>de</strong> se<br />
rendre compte <strong>de</strong> son autonomie psychique.<br />
Par la suite, l’enfant construit<br />
progressivement son i<strong>de</strong>ntité en s’at-<br />
tribuant <strong>de</strong>s traits et caractéristiques,<br />
propres à ses <strong>de</strong>ux parents, auxquels<br />
il s’est i<strong>de</strong>ntifié.<br />
De ce fait, une rupture parentale difficile<br />
peut constituer, aux yeux <strong>de</strong><br />
l’enfant, une menace liée au développement<br />
<strong>de</strong> sa personnalité : menace<br />
d’être séparé <strong>de</strong> lui-même et <strong>de</strong><br />
ce qui le constitue dans son intégrité<br />
laissant apparaître, notamment, une<br />
anxiété massive et généralisée. Un<br />
divorce ou une séparation parentale<br />
peuvent également, selon l’auteur,<br />
entraîner chez l’enfant concerné reviviscence<br />
d’angoisses archaïques,<br />
conduites régressives, états dépressifs,<br />
perte d’appétit ou encore agressivité.<br />
Si Stéphane Clerget insiste sur le fait<br />
qu’une séparation parentale est toujours<br />
source <strong>de</strong> remaniements dans<br />
la vie <strong>de</strong> l’enfant, il précise également<br />
que ces ruptures n’entraînent pas que<br />
<strong>de</strong>s réactions négatives. C’est ainsi<br />
qu’à l’appui d’une rupture parentale<br />
et, selon l’auteur, dans le cadre <strong>de</strong> la<br />
résilience, l’enfant peut profiter d’une<br />
certaine désidéalisation <strong>de</strong> ses parents<br />
pour se rendre moins dépendant<br />
d’eux, accélérer sa maturité et<br />
s’ouvrir à d’autres liens.<br />
Au sein <strong>de</strong> cette vaste question <strong>de</strong> la<br />
séparation parentale, une place à part<br />
est réservée, par l’auteur, à l’adolescence<br />
et aux réactions qui lui sont<br />
propres. La particularité accordée à<br />
l’adolescence s’explique par le fait<br />
que cette pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> vie bouleverse<br />
la chronologie et les générations<br />
puisque l’adolescent, désormais pubère,<br />
quitte l’enfance pour <strong>de</strong>venir<br />
un parent potentiel alors que les parents<br />
voient leur jeunesse s’éloigner<br />
pour laisser place à <strong>de</strong>s premiers bilans<br />
<strong>de</strong> vie. De ce fait, l’adolescence<br />
<strong>de</strong>s enfants est, selon Stéphane Clerget,<br />
un facteur <strong>de</strong> risque majeur pour<br />
la solidité d’une union et peut, lorsqu’elle<br />
est contemporaine d’une rupture<br />
parentale, être particulièrement<br />
difficile du fait <strong>de</strong>s remaniements liés<br />
aux imagos parentales propres à cette<br />
pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> vie. Dans ce moment <strong>de</strong><br />
vie appelant une (re)définition <strong>de</strong>s<br />
places, droits et <strong>de</strong>voirs <strong>de</strong> chacun,<br />
Stéphane Clerget suit ainsi, pas à pas,<br />
les différentes étapes d’une séparation,<br />
<strong>de</strong> l’annonce à l’arrivée éventuelle<br />
d’un nouveau conjoint.<br />
Son livre développe <strong>de</strong>s pistes <strong>de</strong> réflexions,<br />
notamment concernant la<br />
distinction à établir entre maintien<br />
<strong>de</strong> la coparentalité et rupture du lien<br />
<strong>de</strong> conjugalité, et donne aux parents<br />
<strong>de</strong> nombreux conseils dont le premier<br />
serait peut-être <strong>de</strong> rassurer leur<br />
enfant quant au lien parental et à sa<br />
permanence.<br />
E. Bertrand<br />
45 €*<br />
pour un an<br />
75 €*<br />
pour 2 ans<br />
Tarif<br />
étudiant et internes<br />
30 €*<br />
*supplément étranger<br />
et DOM/TOM =30 €/an<br />
ANNONCES EN BREF<br />
25 au 28 mai 2006. Lisbonne. 66 e<br />
Congrès <strong>de</strong>s psychanalystes <strong>de</strong> langue<br />
française organisé par la Société psychanalytique<br />
<strong>de</strong> Paris et la Société psychanalytique<br />
du Portugal, sous le haut<br />
patronage du ministère <strong>de</strong> la Coopération<br />
et <strong>de</strong> la Francophonie, à l’hôtel Altis<br />
<strong>de</strong> Lisbonne sur le thème : Relations<br />
d’objet et modèle <strong>de</strong> la pulsion. Renseignements<br />
et inscriptions : Congrès <strong>de</strong>s<br />
psychanalystes <strong>de</strong> langue française, 187<br />
rue Saint-Jacques, 75005 Paris. Tél. :<br />
01 43 29 66 70. E-mail : infoCongres@<br />
spp.asso.fr. Site : www.spp.asso.fr<br />
1er et 2 juin 2006. Limoges. 9 ème Réunion<br />
annuelle <strong>de</strong> la Société Marcé<br />
Francophone sur le thème : Quels lieux<br />
pour quels soins en périnatalité ? La place<br />
du soin psychologique. Renseignements :<br />
Dr Rainelli, Dr Souchaud, CH Esquirol,<br />
15 rue du Dr Marcland, 87025 Limoges<br />
Ce<strong>de</strong>x. Tél. : 05 55 43 11 00. Fax :<br />
05 55 43 11 11. E-mail : christiane.rainelli@ch-esquirol-limoges.fr<br />
2 juin 2006. Paris. Journée organisée<br />
par l’Association Francophone d’Etu<strong>de</strong>s<br />
et <strong>de</strong> Recherche sur les troubles <strong>de</strong> la<br />
personnalité sur le thème : Le narcissisme<br />
et les troubles <strong>de</strong> la personnalité. Renseignements<br />
: Centre Hospitalier Sainte<br />
Anne. E-mail : verrier.annie@chu-amiens.fr<br />
Inscriptions : lcaihol@infonie.fr<br />
6 au 8 juin 2006. 104 ème Congrès <strong>de</strong><br />
psychiatrie et <strong>de</strong> neurologie <strong>de</strong> langue<br />
française. Renseignements : ABREP Cogrès<br />
2006, CHU Brest Hôpital <strong>de</strong> Bohars,<br />
29820 Bohars. Tél. : 02 98 01 51 57<br />
ou 02 98 01 50 46. Fax : 02 98 01 52 18.<br />
8 au 10 juin 2006. Brest. Journées <strong>de</strong><br />
la Société Française <strong>de</strong> <strong>Psychiatrie</strong> <strong>de</strong><br />
l’Enfant et <strong>de</strong> l’Adolescent et disciplines<br />
associées sur le thème : Nouvelles familles,<br />
nouveaux enfants, nouvelles pathologies.<br />
Renseignements : ABREP Cogrès<br />
2006, CHU Brest Hôpital <strong>de</strong> Bohars,<br />
29820 Bohars. Tél. : 02 98 01 51 57<br />
ou 02 98 01 50 46. Fax : 02 98 01 52 18.<br />
9 au 11 juin 2006. Paris. Colloque du<br />
Cercle freudien sur le thème : La langue,<br />
comment ça va ? Renseignements et inscriptions<br />
: Patrick Belamich, 30 rue Letellier,<br />
75015 Paris. Tél. : 06 11 78 46 65.<br />
Site : http://cercle.freudien.free.fr/<br />
8 au 10 juin 2006. Bor<strong>de</strong>aux. Conférenc<strong>de</strong><br />
organisée par le Groupe Aquitain<br />
<strong>de</strong> la Société Psychanalytique <strong>de</strong><br />
Paris sur le thème : Paranoïa et masochisme.<br />
Renseignements : Groupe Aquitain<br />
<strong>de</strong> la Société Psychanalytique <strong>de</strong><br />
Paris, 18 rue Verte, 33200 Bor<strong>de</strong>aux.<br />
Tél./Fax : 05 56 93 00 42. E-mail : gaspp.b<br />
@wanadoo.fr<br />
10 juin 2006. Paris. XXXIII e Journée<br />
scientifique <strong>de</strong> Michel Soulé, Marcel<br />
Rufo, Bernard Golse sur le thème : La<br />
dynamique du virtuel chez l’enfant. Bons<br />
plans pour les nuls. Inscriptions. Tél. :<br />
01 53 68 93 43. Fax : 01 53 68 93 45.<br />
E-mail : jscientifique@wanadoo.fr<br />
13 au 15 juin 2006. Lorquin. 30 e Festival<br />
International Ciné-Vidéo-Psy <strong>de</strong> Lor-<br />
Nom :<br />
Prénom :<br />
Adresse :<br />
quin. 30 ans d’images en psy ! Inscriptions<br />
: www.cnasm.prd.fr/festival/in<strong>de</strong>x.asp<br />
24 juin 2006. Paris. Réunion <strong>de</strong> travail<br />
<strong>de</strong>l’Association « Coordination Internationale<br />
entre Psychothérapeutes Psychanalystes<br />
s’occupant <strong>de</strong> personnes avec autisme<br />
» (CIPPA) sur le thème : Outils<br />
d’évaluation du diagnostic et <strong>de</strong> l’évolution<br />
<strong>de</strong>s états autistiques. Rénseignements<br />
: tél. : 01 47 83 29 84.<br />
26 juin 2006. Paris. Conférence-Hommage<br />
à Oscar Masotta organisée par<br />
l’Association franco-argentine <strong>de</strong> psychiatrie<br />
et <strong>de</strong> santé mentale. Informations<br />
: psy.francoarg.ass@free.fr. Site :<br />
http://psy.francoarg.asso.fr. Dr Perla<br />
Drechsler : perlad@wanadoo.fr, 20 rue<br />
Littré, 75006 Paris. Tél. : 01 45 55 34 65.<br />
17 au 21 juillet 2006. Marly-le-Roi. Séminaire<br />
<strong>de</strong> psychodrame psychanalytique<br />
organisé par le CEFFRAP. Renseignements<br />
: Tél./Fax : 01 40 09 84 74. Email<br />
: ceffrap@libertysurf.fr<br />
20 et 23 juillet 2006. Aix-en-Provence.<br />
XI e Rencontres Internationales <strong>de</strong> l’AIHP<br />
sur le thème : Ecrire l’histoire d’une science<br />
particulière : la psychanalyse. Inscriptions :<br />
Service gestion Congrès. Tél. :<br />
04 42 161 009/183. E-mail : gestioncongres@aixenprovencetourism.com<br />
2 au 6 août 2006. Ba<strong>de</strong>n Ba<strong>de</strong>n. Congrès<br />
Clinical Sandor Ferenczi Psychanalyse et<br />
Psychosomatique. Renseignements : The<br />
Clinical Sandor Ferenczi Conference c/o<br />
Ann-Louise S. Silver, M.D., Clinical Sandor<br />
Ferenczi Conference, 4966 Reedy<br />
Brook Lane, Columbia, MD 21044-1514,<br />
Etats-Unis.<br />
3 au 6 août 2006. Montréal. 2 e Congrès<br />
International <strong>de</strong> Thérapie Familiale Psychanalytique<br />
sur le thème : La part <strong>de</strong>s<br />
ancêtres. Le transgénérationnel dans<br />
les thérapies psychanalytiques <strong>de</strong> couple<br />
et <strong>de</strong> la famille. Inscriptions : CITFP,<br />
Bureau <strong>de</strong>s Congrès Universitaires,<br />
660 ch. Cote-<strong>de</strong>s-Neiges, Suite 510,<br />
Montréal (Québec), Canada H3s 2A9.<br />
Tél. : +1(514) 340 3215. E-mail : info@<br />
citfp2006.com. Site : www.citfp2006.com.<br />
10 au 14 septembre 2006. Melbourne.<br />
17 ème Congrès <strong>de</strong> l’Association for Child<br />
and Adolescent Psychiatry and Allied Professions.<br />
Renseignements : SFPEADA,<br />
6 rue Albert <strong>de</strong> Lapparent, 75007<br />
Paris. E-mail : raynaud.jph@chu-toulouse.fr<br />
5 au 7 octobre 2006. Chailles. XXXV e<br />
Journées Nationales <strong>de</strong> la <strong>Psychiatrie</strong><br />
Privée sur le thème : Hospitalier ? Inscriptions<br />
: AFPEP, 141 rue <strong>de</strong> Charenton,<br />
75012 Paris. Tél. : 01 43 46 25 55.<br />
Fax : 01 43 46 25 56. E-mail : info@<br />
afpep-snpp.org<br />
26 au 28 octobre 2006. Avignon. VII e<br />
Colloque International <strong>de</strong> Périnatalité<br />
organisé par l’Association Recherche<br />
Information Périnatalité sur le thème :<br />
Bébé - Cultures. Culture <strong>de</strong>s bébés. Bébés<br />
<strong>de</strong>s cultures. Inscriptions : ARIP, BP 36,<br />
84142 Montfavet Ce<strong>de</strong>x. Tél. :<br />
04 90 23 99 35. Fax : 04 90 23 51 17.<br />
E-mail : arip@wanadoo.fr<br />
Je m’abonne pour : 1 an 2 ans<br />
CHÈQUE À L’ORDRE DE MAXMED à envoyer avec ce bulletin,<br />
54, boulevard <strong>de</strong> la Tour Maubourg, 75007 Paris<br />
Téléphone : 01 45 50 23 08<br />
Je souhaite recevoir une facture acquittée justifiant <strong>de</strong> mon abonnement.<br />
N°3 - TOME XIX - AVRIL 2006<br />
13 au 15 novembre 2006. New Delhi.<br />
Congrès organisé par Psychiatres du<br />
Mon<strong>de</strong> en collaboration avec la Delhi<br />
Psychiatric Society et sous le parrainage<br />
<strong>de</strong> l’Ambassa<strong>de</strong> <strong>de</strong> France sur le thème :<br />
The psychic life at the interface of beliefs<br />
and knowledge. Renseignements : Dr<br />
Patrick Bantman. E-mail : pbantman<br />
@wanadoo.fr<br />
16 novembre 2006. Limoges. Journée<br />
dans le cadre <strong>de</strong> « Handicap psychique :<br />
<strong>de</strong> l’intsitution à la cité » organisée par la<br />
Fédération d’ai<strong>de</strong> à la Santé Mentale<br />
Croix-Marine sur le thème : Réinsertion<br />
au travail et aménagements raisonnables.<br />
Inscriptions : tél.: 01 45 96 06 36. Email<br />
: croixmarine@wanadoo.fr<br />
18 novembre 2006. Paris. XXVI ème Colloque<br />
du CECCOF sur le thème : Pertes<br />
et manques dans les familles. Quelles reconstructions<br />
possibles ? Renseignements :<br />
Centre d’étu<strong>de</strong>s Cliniques <strong>de</strong>s Communications<br />
Familiales. Secrétariat : 96 ave.<br />
<strong>de</strong> la République, 75011 Paris. Tél. :<br />
0148 05 84 33. Fax : 01 48 05 84 30.<br />
Site : www.ceccof.com. E-mail : ceccof@wanadoo.Fr<br />
24 au 25 novembre 2006. Avignon.<br />
XXI è Forum professionnel <strong>de</strong>s Psychologues<br />
sur le thème : Etre psychologue.<br />
De la diversité <strong>de</strong>s pratiques à l’unité <strong>de</strong><br />
la psychologie ? Renseignements : Le<br />
<strong>Journal</strong> <strong>de</strong>s Psychologues. Tél. :<br />
01 53 38 46 46. Fax : 0153 38 46 40.<br />
E-mail : forum@jifpsychologues.fr<br />
24 novembre au 7 décembre 2006.<br />
Cuba. 6 èmes Rencontres <strong>de</strong> l’Association<br />
franco-cubaine sur le thème : Famille,<br />
communauté, secteur, réseau en santé mentale<br />
: modèles cubains et français. Renseignements<br />
: AFCPP, Annette Thévenot,<br />
248 bd Saint-Denis, 92400 Courbevoie.<br />
E-mail : annette.thevenot@laposte.net<br />
24 novembre 2006. Paris. Colloque organisé<br />
par la Société Française <strong>de</strong> psychiatrie<br />
<strong>de</strong> l’enfant et <strong>de</strong> l’adolescent et<br />
disciplines associées sur le thème : Symptômes<br />
actuels <strong>de</strong> l’adolescence : répondre<br />
ou soigner. Renseignements et inscriptions<br />
: Secrétariat <strong>de</strong> la trèsorière <strong>de</strong> la<br />
SFPEADA, Centre mère-enfant, 11 rue<br />
du Général-Cérez, 87000 Limoges.<br />
Tél/Fax : 05 55 32 89 94.<br />
8 et 9 juin 2007. Montpellier. Troisième<br />
Congrès Franco-Algérien <strong>de</strong> <strong>Psychiatrie</strong><br />
sur le thème : Le suici<strong>de</strong> : <strong>de</strong> la culture aux<br />
neurosciences. Les personnes qui désirent<br />
organiser un symposium, un atelier,<br />
soumettre un appel <strong>de</strong> communication<br />
libre ou une présentation, doivent<br />
décrire le thème et les objectifs et faire<br />
parvenir leur projet par courrier électronique<br />
avec un document attaché,<br />
dans un format Word. Le document doit<br />
reprendre les éléments indiqués dans<br />
le formulaire postal. E-mail : p-courtet@chu-montpellier.fr<br />
ou par courrier<br />
au Pr Philippe Courtet, Service <strong>de</strong><br />
Psychologie Médicale et <strong>Psychiatrie</strong>,<br />
Hôpital Lapeyronie, CHU Montpellier,<br />
34295 Ce<strong>de</strong>x 5. Tél. : 04 67 33 85 81.<br />
Date limite <strong>de</strong> soumission : 31 décembre<br />
2006.<br />
Bulletin d’abonnement<br />
Le <strong>Journal</strong> <strong>de</strong> <strong>Nervure</strong> + La Revue
N°3 - TOME XIX - AVRIL 2006<br />
Serge Tribolet : Plusieurs étu<strong>de</strong>s montrent<br />
que l’observance <strong>de</strong>s thymorégulateurs<br />
(tous thymorégulateurs confondus)<br />
est inférieure à 60% en pério<strong>de</strong><br />
normothymique. Quelles sont selon vous<br />
les principales causes <strong>de</strong> cette mauvaise<br />
observance ?<br />
Roland Dar<strong>de</strong>nnes : L’expérience clinique<br />
et les recherches menées en la<br />
matière nous indiquent clairement que<br />
les patients se représentent les médicaments<br />
comme <strong>de</strong>s substances ayant<br />
<strong>de</strong>s effets dangereux, prescrites <strong>de</strong><br />
manière excessive par les mé<strong>de</strong>cins (1) !<br />
Les psychotropes sont souvent perçus<br />
d’une manière globale comme <strong>de</strong>s<br />
« drogues » (2) car ils modifient votre<br />
comportement « à l’insu <strong>de</strong> votre plein<br />
gré », sans passer par votre contrôle<br />
volontaire, et que vous ne pouvez plus<br />
ensuite vous en passer pour maintenir<br />
votre santé, ce qui est assimilé à la<br />
dépendance <strong>de</strong>s toxicomanes. La perception<br />
d’effets secondaires renforce<br />
cette conviction <strong>de</strong> la nocivité <strong>de</strong>s traitements<br />
; par exemple, dans le contexte<br />
actuel, une prise <strong>de</strong> poids rapi<strong>de</strong> est<br />
mal supportée, elle est synonyme d’une<br />
mauvaise santé et <strong>de</strong> risques importants,<br />
sans compter la mauvaise image<br />
donnée à soi et aux autres. Les discussions<br />
entre patients et les histoires véhiculées<br />
par <strong>de</strong>s proches bien intentionnés<br />
sur les connaissances qui prennent<br />
<strong>de</strong>s traitements <strong>de</strong>puis 20 ans contribuent<br />
également à maintenir la conviction<br />
qu’il s’agit d’une dépendance. A<br />
l’inverse, la perception <strong>de</strong> la nécessité<br />
du traitement repose d’abord sur la<br />
perception <strong>de</strong> l’efficacité du traitement.<br />
Celle-ci est véhiculée initialement par la<br />
relation <strong>de</strong> confiance avec son mé<strong>de</strong>cin<br />
et la qualité <strong>de</strong> sa relation et <strong>de</strong> sa communication,<br />
elle se développe ensuite<br />
en fonction <strong>de</strong> l’amélioration obtenue<br />
et <strong>de</strong> l’attribution <strong>de</strong> cette amélioration<br />
au traitement. En effet, le patient<br />
peut tout à fait attribuer son amélioration<br />
à <strong>de</strong>s facteurs environnementaux<br />
– un meilleur climat familial, une<br />
vie plus saine et moins stressante, <strong>de</strong>s<br />
aubaines sur le plan professionnel – et<br />
juger que le traitement préventif y joue<br />
un rôle mineur. Le <strong>de</strong>uxième défi <strong>de</strong><br />
l’observance est <strong>de</strong> la maintenir sur le<br />
long terme. Quelle que soit la pathologie,<br />
cette observance est faible (3).<br />
Dans le trouble bipolaire, cette mauvaise<br />
observance concerne tous les thymorégulateurs<br />
(4, 5). En <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s<br />
aspects pratiques <strong>de</strong> la mise en place <strong>de</strong><br />
cette observance – simplifier la prise<br />
médicamenteuse quotidienne, mettre<br />
en place <strong>de</strong>s routines pour la prise du<br />
traitement, prévoir l’accès au traitement<br />
lors <strong>de</strong>s déplacements, etc., <strong>de</strong>ux obstacles<br />
majeurs à cette observance sont<br />
le refus <strong>de</strong> la maladie ou, sous une<br />
autre forme, la conviction d’être guéri<br />
<strong>de</strong> son trouble bipolaire. La prise quotidienne<br />
d’un traitement rappelle<br />
chaque jour à cette personne que,<br />
même bien portante, elle est « mala<strong>de</strong><br />
», différente. La perception <strong>de</strong> la<br />
maladie et <strong>de</strong> son traitement par le<br />
patient, ainsi que la qualité <strong>de</strong> la relation<br />
mé<strong>de</strong>cin-mala<strong>de</strong> sont <strong>de</strong>s facteurs<br />
fondamentaux <strong>de</strong> l’observance (6).<br />
S.T. : La nécessité d’un traitement préventif<br />
au long cours est à l’origine <strong>de</strong><br />
représentations particulières <strong>de</strong> la maladie,<br />
pour les patients comme pour l’entourage.<br />
Ces représentations <strong>de</strong> la mala-<br />
Psychopathologie <strong>de</strong> la<br />
personnalité dépendante<br />
Gwenolé Loas, Maurice Corcos<br />
Préface <strong>de</strong> Philippe Jeammet<br />
Postface <strong>de</strong> Robert H. Bornstein<br />
Dunod, 23 €<br />
La dépendance affective constitue<br />
une caractéristique normale chez l’être<br />
humain mais lorsqu’elle <strong>de</strong>vient importante<br />
et rigi<strong>de</strong>, elle relève <strong>de</strong> la<br />
pathologie. Les auteurs définissent<br />
ce concept selon diverses approches<br />
(catégorielle, dimensionnelle, psychanalytique,cognitivo-comporte-<br />
Troubles bipolaires :<br />
comment améliorer le<br />
fonctionnement au<br />
quotidien ?<br />
Six questions à Roland Dar<strong>de</strong>nnes*<br />
die sont un déterminant essentiel <strong>de</strong> la<br />
qualité <strong>de</strong> vie du sujet. Comment agir<br />
efficacement pour améliorer ces représentations<br />
?<br />
R.D. : A ma connaissance, il n’existe<br />
heureusement pas <strong>de</strong> métho<strong>de</strong> simple<br />
et rapi<strong>de</strong> pour transformer radicalement<br />
les opinions <strong>de</strong>s individus ! Vous<br />
avez raison <strong>de</strong> souligner que la qualité<br />
<strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s patients est plus fortement<br />
liée à leur représentation <strong>de</strong> leur maladie<br />
qu’à la sévérité ou au handicap<br />
objectif <strong>de</strong> cette maladie (7). Les<br />
métho<strong>de</strong>s visant à modifier les représentations<br />
<strong>de</strong> la maladie ne sont pas<br />
encore formalisées. Il existe <strong>de</strong>s programmes<br />
psycho-éducatifs dont les<br />
résultats sont estimés sur la prévention<br />
<strong>de</strong>s récidives ultérieures mais pas sur les<br />
modifications <strong>de</strong>s représentations <strong>de</strong><br />
la maladie qu’ils ont pu opérer. Par<br />
contre, se contenter <strong>de</strong> fournir une<br />
information ne suffit pas à modifier<br />
les représentations : le style relationnel<br />
du mé<strong>de</strong>cin avec son patient a un<br />
impact sur la perception du traitement<br />
et sur son observance (8, 9). Les représentations<br />
<strong>de</strong>s proches influents du<br />
patient jouent vraisemblablement un<br />
rôle non négligeable dans le façonnement<br />
et le maintien <strong>de</strong> la perception<br />
par le patient <strong>de</strong> sa maladie. Recevoir<br />
ces proches et explorer d’une manière<br />
ouverte et sans affrontement direct<br />
leurs représentations cimente la collaboration<br />
et permet d’amener ces familiers<br />
à nuancer leur point <strong>de</strong> vue. Les<br />
points importants dans la relation <strong>de</strong><br />
suivi d’un traitement au long cours<br />
semblent être la capacité du mé<strong>de</strong>cin à<br />
encourager le patient à exprimer ses<br />
problèmes et ses préoccupations, et à<br />
démontrer son écoute en examinant<br />
avec le patient les différentes manières<br />
d’y apporter une solution ou un changement<br />
<strong>de</strong> perspective (9).<br />
S.T. : Parmi les causes d’interruption du<br />
traitement par le patient lui-même, la<br />
nostalgie <strong>de</strong>s épiso<strong>de</strong>s d’excitation et d’euphorie<br />
a souvent été mentionnée. Cette<br />
explication est-elle vali<strong>de</strong> ?<br />
R.D. : Pas du tout lorsque l’on considère<br />
les enquêtes réalisées auprès <strong>de</strong><br />
patients bipolaires pour connaître leurs<br />
raisons d’interrompre le traitement préventif.<br />
Ce motif est donné par moins<br />
<strong>de</strong> 10% <strong>de</strong>s bipolaires alors que c’est la<br />
première raison invoquée par les psychiatres<br />
pour expliquer l’abandon du<br />
traitement par leurs patients (4, 10).<br />
S.T. : L’importance du retentissement<br />
social du trouble bipolaire et en particulier<br />
<strong>de</strong> l’accès maniaque, son impact sur<br />
la vie <strong>de</strong>s patients et l’handicap (6ème<br />
cause selon l’OMS) qu’il constitue sont<br />
<strong>de</strong>s éléments essentiels à prendre en<br />
compte dans la stratégie thérapeutique.<br />
L’utilisation <strong>de</strong> l’échelle GAS (global<br />
mentale, biologique, phénoménologique).<br />
Ils en présentent les fon<strong>de</strong>ments<br />
théoriques, les concepts voisins<br />
(immaturité psycho-affective,<br />
attachement, sociotropie, addiction<br />
alexithymie) et les outils <strong>de</strong> mesure.<br />
Ils traitent <strong>de</strong> la clinique sou l’angle<br />
catégoriel (épidémiologie, comorbidités,<br />
évolution et pronostic, diagnostic,<br />
facteurs favorisants, étiologie), et<br />
dimensionnel (pathologies psychiatrique<br />
et somatique) et exposent, enfin,<br />
la thérapeutique. Dans le <strong>de</strong>rnier<br />
chapitre, un regard critique discute la<br />
question <strong>de</strong> la dépathologisation <strong>de</strong><br />
la dépendance affective.<br />
assessment scale) dans l’étu<strong>de</strong> Khanna<br />
(11) a pour but d’étudier l’effet <strong>de</strong> la rispéridone<br />
sur le fonctionnement social <strong>de</strong>s<br />
patients. Cet effet est-il avéré ?<br />
R.D. : Il s’agit d’une étu<strong>de</strong> à court<br />
terme portant sur le traitement aigu <strong>de</strong><br />
290 patients hospitalisés pour un épiso<strong>de</strong><br />
maniaque ou mixte. Dans ce<br />
contexte, il paraît clair que l’importante<br />
amélioration symptomatique obtenue<br />
avec ce traitement au bout <strong>de</strong>s<br />
trois semaines <strong>de</strong> l’essai s’accompagne<br />
d’une amélioration parallèle du fonctionnement<br />
social qui était gravement<br />
perturbé, initialement, par l’épiso<strong>de</strong><br />
maniaque.<br />
S.T. : Dans la thérapeutique préventive<br />
du trouble bipolaire quels sont les éléments<br />
permettant d’assurer <strong>de</strong> façon optimale<br />
le fonctionnement cognitif ?<br />
R.D. : La mise en évi<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s<br />
troubles cognitifs chez les patients<br />
atteints <strong>de</strong> troubles bipolaires alors qu’ils<br />
sont en rémission est une avancée relativement<br />
récente, et il était classique<br />
d’affirmer qu’entre les épiso<strong>de</strong>s la rémission<br />
était complète. Maintenant, on<br />
prête une attention plus soutenue aux<br />
plaintes <strong>de</strong> patients apparemment stabilisés<br />
sur le plan <strong>de</strong> l’humeur concernant<br />
leur mémoire ou leurs difficultés<br />
dans la vie quotidienne, et plus particulièrement<br />
leur difficulté à trouver<br />
leurs mots. Les ressources thérapeutiques<br />
sont actuellement limitées ; je<br />
ne crois pas que <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s neuropsychologiques<br />
ont été validées dans<br />
cette indication, certaines innovations<br />
thérapeutiques ont été testées avec succès<br />
sur <strong>de</strong>s petits groupes <strong>de</strong> patients<br />
mais il s’agit <strong>de</strong> résultats préliminaires<br />
qu’il faut encore confirmer. Je pense<br />
qu’il est superflu <strong>de</strong> recomman<strong>de</strong>r la<br />
parcimonie et la réévaluation régulière<br />
<strong>de</strong>s traitements afin <strong>de</strong> minimiser leur<br />
impact sur les fonctions cognitives.<br />
Cependant, il serait injuste <strong>de</strong> penser<br />
que tous les traitements utilisés dans<br />
le trouble bipolaire ont <strong>de</strong>s effets délétères<br />
sur les performances cognitives.<br />
D’une part, la prévention <strong>de</strong>s épiso<strong>de</strong>s<br />
doit préserver les fonctions cognitives,<br />
puisque la dégradation cognitive est<br />
associée à un plus grand nombre d’épiso<strong>de</strong>s<br />
et d’hospitalisations antérieurs.<br />
L’obtention d’une stabilisation thymique<br />
prolongée est donc certainement un<br />
<strong>de</strong>s éléments importants pour lutter<br />
contre cette altération. D’autre part,<br />
une amélioration <strong>de</strong>s performances<br />
cognitives a été observée dans la schizophrénie<br />
avec l’utilisation <strong>de</strong>s traitements<br />
antipsychotiques (12) et il serait<br />
intéressant <strong>de</strong> savoir ce qu’il en est<br />
pour le trouble bipolaire (13).<br />
S.T. : L’efficacité antimaniaque d’un antipsychotique<br />
atypique comme la rispéridone<br />
est validée par <strong>de</strong> nombreuses<br />
étu<strong>de</strong>s réalisées ces <strong>de</strong>rnières années.<br />
Avec le recul actuel quelle influence a-ton<br />
observé sur la qualité <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s<br />
patients ?<br />
L’apport <strong>de</strong>s antipsychotiques atypiques<br />
sur la qualité <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s patients a surtout<br />
été étudiée dans la schizophrénie<br />
et il paraît très probable que les patients<br />
atteints <strong>de</strong> schizophrénie ont une<br />
meilleure qualité <strong>de</strong> vie avec ces traitements<br />
dont fait partie la rispéridone<br />
(14). Dans le trouble bipolaire, les<br />
étu<strong>de</strong>s contrôlées publiées portent sur<br />
le traitement <strong>de</strong> l’épiso<strong>de</strong> aigu et l’appréciation<br />
<strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> vie ne repose<br />
pas, à mon avis, sur les mêmes paramètres.<br />
En aigu, on peut déduire un<br />
SIX QUESTIONS À ROLAND DARDENNES 19<br />
impact significatif sur la qualité <strong>de</strong> vie<br />
<strong>de</strong>s patients <strong>de</strong> la rapidité <strong>de</strong> la résolution<br />
<strong>de</strong> l’épiso<strong>de</strong> maniaque et, par<br />
conséquent, <strong>de</strong> la brièveté <strong>de</strong> la désinsertion<br />
sociale. Les étu<strong>de</strong>s publiées<br />
montrent un taux important <strong>de</strong> rémission<br />
après 3 semaines <strong>de</strong> traitement (15)<br />
et la prolongation sur 12 semaines au<br />
total <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> dont les premiers résultats<br />
ont été publiés par Khanna (11)<br />
montre que les patients traités ont au<br />
final un score <strong>de</strong> fonctionnement social<br />
à la GAS qui correspond à une personne<br />
ayant quelques difficultés ou<br />
symptômes et qui ne serait pas considérée<br />
comme mala<strong>de</strong> par <strong>de</strong>s personnes<br />
non averties (16). Ces résultats<br />
sont encourageants et les étu<strong>de</strong>s<br />
menées sur <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s prolongées<br />
<strong>de</strong>vraient nous apporter <strong>de</strong>s réponses<br />
à ce sujet. <br />
Serge Tribolet **<br />
* Faculté <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine, Université Paris 5 et<br />
Centre Hospitalier Sainte-Anne – Clinique <strong>de</strong>s<br />
Maladies Mentales et <strong>de</strong> l’Encéphale, 75674<br />
Paris ce<strong>de</strong>x 14<br />
** Praticien Hospitalier, Psychiatre, EPS Maison<br />
Blanche<br />
Références bibliographiques<br />
(1) HORNE R, WEINMAN J, HANKINS<br />
M, The Beliefs about Medicines Questionnaire<br />
(BMQ): a new method for assessing<br />
cognitive representations of medications, Psychol<br />
Health 1999, 10, 1-29.<br />
(2) PRIEST RG, VIZE C, ROBERTS A,<br />
ROBERTS M, TYLEE A, Lay people’s attitu<strong>de</strong>s<br />
to treatment of <strong>de</strong>pression: results of<br />
opinion poll for Defeat Depression Campaign<br />
just before its launch, BMJ 1996, 313,<br />
858-859.<br />
(3) OSTERBERG L, BLASCHKE T, Adherence<br />
to medication, NEJM 2005, 353, 487-<br />
497.<br />
(4) KECK PE, MCELROY SL, STRA-<br />
KOWSKI SM, BOURNE ML, WEST SA,<br />
Compliance with maintenance treatment in<br />
bipolar disor<strong>de</strong>r, Psychopharmacol Bull,<br />
1997, 33, 87-91.<br />
(5) COLOM F, VIETA E, MARTINEZ-<br />
ARAN A, REINARES M, BENABARRE A,<br />
GASTO C, Clinical factors associated with<br />
treatment noncompliance in euthymis bipolar<br />
patients, J Clin Psychiatry 2000, 61, 549-<br />
555.<br />
(6) KLEINDIEST N, GREIL W, Are illness<br />
concepts a powerful predictor of adherence to<br />
prophylactiv treatment in bipolar disor<strong>de</strong>r ? J<br />
Clin Psychiatry 2004, 65, 966-974.<br />
(7) MOSS-MORRIS R, WEINMAN J,<br />
PETRIE KJ, HORNE R, CAMERON LD,<br />
BUICK D (2002), The Revised Illness Perception<br />
Qustionnaire (IPQ-R), Psychology<br />
and Health 2002, 17, 1–16.<br />
(8) CRUZ M, PINCUS HA, Research on<br />
the influence that communication in psychiatric<br />
encounters has on treatment, Psychiatric<br />
Services 2002, 53, 1253-1265.<br />
(9) Effects of physician communication style<br />
on client medication beliefs and adherence<br />
with anti<strong>de</strong>pressant treatment, Patient Education<br />
and Counseling 2000, 40, 173-185.<br />
(10) POPE M, SCOTT J, Do clinicians<br />
un<strong>de</strong>rstand why individuals stop taking<br />
lithium ? J Affect Disord 2003, 74, 287-<br />
291.<br />
(11) KHANNA S, VIETA E, LYONS B,<br />
GROSSMAN F, EERDEKENS M, KRA-<br />
MER M, Risperidone in the treatment of<br />
acute mania: double-blind, placebo-controlled<br />
study, Br J Psychiatry 2005, Sep, 187, 229-<br />
34.<br />
(12) Evaluating the effects of antipsychotics<br />
on cognition in schizophrenia. Collaborative<br />
Working Group on Clinical Trial Evaluations.<br />
J Clin Psychiatry. 1998;59 Suppl<br />
12:35-40.<br />
(13) MACQUEEN G, YOUNG T, Cognitive<br />
effects of atypical antipsychotics: focus on<br />
bipolar spectrum disor<strong>de</strong>rs, Bipolar Disord.<br />
2003, 5 Suppl 2, 53-61.<br />
(14) AWAD AG, VORUGANTI LN,<br />
Impact of atypical antipsychotics on quality of<br />
life in patients with schizophrenia, CNS<br />
Drugs 2004,18, 877-93.<br />
(15) GOPAL S, STEFFENS DC, KRAMER<br />
ML, OLSEN MK, Symptomatic remission<br />
in patients with bipolar mania: results from a<br />
double-blind, placebo-controlled trial of risperidone<br />
monotherapy, J Clin Psychiatry<br />
2005, Aug, 66, 8, 1016-20.<br />
(16) SMULEVICH AB, KHANNA S, EER-<br />
DEKENS M, KARCHER K, KRAMER M,<br />
GROSSMAN F, Acute and continuation risperidone<br />
monotherapy in bipolar mania: a<br />
3-week placebo-controlled trial followed by a<br />
9-week double-blind trial of risperidone and<br />
haloperidol, Eur Neuropsychopharm 2005,<br />
15, 75-84.<br />
LIVRES<br />
Le suici<strong>de</strong> carcéral : <strong>de</strong>s<br />
représentations à l’énigme<br />
du sens<br />
Nathalie Papet, Sylvie Lepinçon<br />
L’Harmattan, 17 €<br />
Les conduites suicidaires en milieu<br />
carcéral font l’objet d’une médiatisation<br />
qui témoigne <strong>de</strong> la réactivité<br />
du corps social à l’égard <strong>de</strong> la prison<br />
et <strong>de</strong> ces conduites. De nombreux<br />
écrits s’attachent, principalement, aux<br />
causes <strong>de</strong>s suici<strong>de</strong>s.<br />
Cependant, une lecture essentiellement<br />
causale semble réductrice, et et<br />
l’on peut s’interroger sur l’existence<br />
et l’impact <strong>de</strong> représentations individuelles<br />
et collectives particulièrement<br />
attachées au suici<strong>de</strong> en prison. La<br />
mise au jour <strong>de</strong> ces représentations<br />
pourrait permettre la mise en place<br />
d’actions <strong>de</strong> prévention plus efficientes<br />
et favoriserait l’élaboration d’une clinique<br />
au plus près du sujet détenu.<br />
Vieillir en institution<br />
Témoignages <strong>de</strong> professionnels,<br />
regards <strong>de</strong> philosophes<br />
Catherine Déliot<br />
Alice Casagran<strong>de</strong><br />
John Libbey Eurotext<br />
Des images hantent les esprits lorsque<br />
sont évoquées les maisons <strong>de</strong> retraite<br />
: visages éteints, solitu<strong>de</strong>s rassemblées<br />
loin <strong>de</strong> leur foyer, journées<br />
rythmées par les impératifs collectifs<br />
<strong>de</strong> soin plutôt que les choix personnels<br />
<strong>de</strong> vie. Philosophes éthiciennes,<br />
Catherine Déliot et Alice Casagran<strong>de</strong><br />
accompagnent, <strong>de</strong>puis cinq ans, les<br />
équipes <strong>de</strong>s rési<strong>de</strong>nces du groupe<br />
Médi<strong>de</strong>p dans leur réflexion sur la<br />
prise en charge et sur les chemins <strong>de</strong><br />
la bien-traitance. Elles donnent dans<br />
ce livre la parole à ceux, directeurs,<br />
soignants, auxiliaires <strong>de</strong> vie, psychologues<br />
ou mé<strong>de</strong>cins, qui ont en<br />
charge les <strong>de</strong>rnières années <strong>de</strong> vie<br />
<strong>de</strong>s personnes qui leur sont confiées.<br />
Cette parole ne souhaite ni promouvoir<br />
ni décrier. Il ne s’agit pas ici <strong>de</strong><br />
révélations scandaleuses, mais <strong>de</strong> témoignages<br />
sur un quotidien vécu,<br />
parfois dans la douceur, parfois dans<br />
la violence.<br />
A ces témoignages est associée une<br />
réflexion éthique nourrie par les questionnements<br />
<strong>de</strong>s sciences humaines,<br />
dont l’ambition consiste à approfondir<br />
les interrogations <strong>de</strong>s équipes.<br />
La vie inconsciente<br />
Théodule Ribot<br />
Introduction <strong>de</strong> Serge Nicolas<br />
L’Harmattan, 19,50 €<br />
Ce livre est la réédition fac simile <strong>de</strong> la<br />
version originale (1914) du <strong>de</strong>rnier<br />
ouvrage <strong>de</strong> Ribot où il abor<strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> l’inconscient à une époque où<br />
Freud avait développé sa psychanalyse.<br />
Pour Ribot, une <strong>de</strong>s tendances<br />
principales <strong>de</strong> sa psychologie, a été<br />
<strong>de</strong> mettre en lumière le rôle essentiel<br />
que jouent les éléments moteurs dans<br />
les diverses fonctions psychiques.<br />
L’ouvrage est constitué par la réunion<br />
<strong>de</strong> quatre articles sur le rôle latent<br />
<strong>de</strong>s images motrices ; les mouvements<br />
et l’activité inconsciente ; le<br />
problème <strong>de</strong> la pensée sans images<br />
et sans mots ; le moindre effort en<br />
psychologie. L’idée générale défendue<br />
par Ribot est <strong>de</strong> montrer que tout<br />
état <strong>de</strong> conscience est un complexus<br />
dont les éléments kinesthésiques forment<br />
la portion stable, résistante et<br />
constituent, en quelque sorte, le squelette.<br />
Or ce squelette, ce résidu moteur<br />
<strong>de</strong>s états affectifs et intellectuels,<br />
formerait, pour Ribot, le substratum<br />
<strong>de</strong> la vie inconsciente, l’infrastructure<br />
<strong>de</strong> l’inconscient.<br />
Le fond, la nature intime <strong>de</strong> l’inconscient,<br />
ne doivent donc pas être<br />
déduits <strong>de</strong> la conscience : ils doivent<br />
être cherchés dans l’activité motrice,<br />
actuelle ou conservée à l’état latent.
20<br />
REVUES<br />
Médiations familiales : quels<br />
enjeux ?<br />
Dossier composé par Régine<br />
Scelles<br />
Dialogue 2005 n°170<br />
Erès, 16 €<br />
Ce numéro rassemble <strong>de</strong>s praticiens<br />
<strong>de</strong> la médiation et/ou <strong>de</strong> la thérapie<br />
<strong>de</strong> la famille et du couple (M. Berger,<br />
A. Ducousso-Lacaze, J. Grechez, M.-Th.<br />
Martinière, J.-L. Viaux) qui interrogent<br />
les indications, les limites <strong>de</strong> la médiation,<br />
ses effets et ses liens avec les<br />
autres dispositifs. Le sociologue B. Bastard<br />
met en perspective ce dispositif,<br />
la profession <strong>de</strong> médiateur, avec une<br />
certaine conception <strong>de</strong> la famille et<br />
avec la manière dont l’Etat, au fil du<br />
temps, a souhaité intervenir dans ce<br />
domaine <strong>de</strong> la vie privée.<br />
Plusieurs articles hors thème sont proposés.<br />
J. Cassanas invite les thérapeutes familiaux<br />
à s’intéresser aux effets <strong>de</strong> la<br />
communication analogique dans le<br />
cadre <strong>de</strong> la thérapie familiale, et à la<br />
manière <strong>de</strong> travailler avec la complexité<br />
<strong>de</strong> cette dimension <strong>de</strong> la communication<br />
interindividuelle et groupale. A.<br />
Thévenot et coll. poursuivent la réflexion<br />
initiée, précé<strong>de</strong>mment, dans le<br />
numéro sur les familles d’accueil. L. Ga<strong>de</strong>au<br />
invite à réfléchir au sens <strong>de</strong> l’acte<br />
éducatif pour l’adolescent et pour celui<br />
qui le pose, chacun ayant sa subjectivité<br />
et sa temporalité propres. Enfin,<br />
à partir d’une pratique d’analyste<br />
dans un lieu <strong>de</strong> rencontre parent-enfant,<br />
F. Pérez invoque les notions <strong>de</strong><br />
complexité et <strong>de</strong> chaos déterministe<br />
pour penser la complexité <strong>de</strong>s conflits<br />
familiaux traversés par chaque sujet<br />
dans un système intersubjectif, tel qu’il<br />
existe dans ce lieu <strong>de</strong> rencontre.<br />
Grandir<br />
Topique 2005 n°93<br />
L’Esprit du Temps, 21 €<br />
Le terme <strong>de</strong> « grandir » interroge la<br />
dimension <strong>de</strong> l’Idéal comme celle du<br />
Temps dans la problématique plus<br />
arge du « projet », d’où <strong>de</strong>s questionnements<br />
importants et trop peu étudiés<br />
sur la pensée du « progrès » chez<br />
Freud et en psychanalyse, et sur les<br />
liens que l’on peut établir avec les notions<br />
d’évolution ou, au contraire, <strong>de</strong><br />
développement.<br />
M. Moreau-Ricaud présente un <strong>de</strong>s premiers<br />
travaux sur la psychanalyse du<br />
vieillissement : une conférence donnée<br />
par Michael Balint l’année <strong>de</strong> la<br />
mort <strong>de</strong> Ferenczi, mort qui l’a totalement<br />
bouleversé.<br />
Balint reprend cette question à partir<br />
<strong>de</strong> la philosophie (Cicéron, dans De Senectute,<br />
etc) renouvelée par le Romantisme,<br />
et s’interroge sur le <strong>de</strong>venir<br />
<strong>de</strong> la libido sexualis et <strong>de</strong> la libido<br />
sciendi dans le vieillissement <strong>de</strong> l’individu.<br />
Il questionne les processus pulsionnels<br />
<strong>de</strong> l’adolescence et <strong>de</strong> la sénescence,<br />
leur similitu<strong>de</strong> et leur différence, en<br />
s’appuyant sur <strong>de</strong>s faits sociaux et <strong>de</strong>s<br />
biographies <strong>de</strong> personnalités célèbres<br />
(Bismarck, Gladstone, la Reine Victoria<br />
et son fils Edouard VII, Goethe, Le<br />
Titien, ToIstoï, Voltaire) donc dans le<br />
registre <strong>de</strong> la psychanalyse appliquée.<br />
Il ouvre ici une perspective nouvelle :<br />
le processus <strong>de</strong> <strong>de</strong>venir vieux n’est pas<br />
toujours synonyme <strong>de</strong> « naufrage »<br />
(Charles <strong>de</strong> Gaulle) mais au contraire<br />
<strong>de</strong> réappropriation <strong>de</strong> soi, <strong>de</strong> croissance,<br />
voire même <strong>de</strong> création d’une<br />
œuvre.<br />
En se référant au mythe <strong>de</strong> Narcisse,<br />
G. Roger examine les facteurs à l’œuvre<br />
dans l’acte <strong>de</strong> grandir, notamment les<br />
mouvements psychiques favorisant la<br />
co-existence <strong>de</strong> son achèvement et son<br />
inachèvement.<br />
La Casa <strong>de</strong> la Familia, créée sur le modèle<br />
français <strong>de</strong> l’I.R.A.E.C. - Institut <strong>de</strong><br />
Recherche Appliquée pour l’Enfant et le<br />
Couple -, fonctionne au Pérou <strong>de</strong>puis<br />
16 ans dans un quartier défavorisé <strong>de</strong><br />
Lima. Dans ce pays déshérité, ce ne<br />
sont pas les améliorations immédiates<br />
du niveau <strong>de</strong> vie qui fon<strong>de</strong>nt la <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
pressante <strong>de</strong>s parents, <strong>de</strong>s enfants<br />
ou <strong>de</strong>s adolescents, mais d’abord<br />
l’urgence d’être écouté et entendu.<br />
En référence à ses travaux <strong>de</strong> psychosociologue,<br />
J. Bor<strong>de</strong>t propose <strong>de</strong> renforcer<br />
les solidarités entre les adultes<br />
et les responsables <strong>de</strong>s institutions pour<br />
tenir, ensemble, cet enjeu par rapport<br />
aux enfants et adolescents aux prises<br />
avec les risques d’exclusion sociale.<br />
Elle analyse, particulièrement, les solidarités<br />
créées entre les parents et les<br />
professionnels au sein <strong>de</strong> l’école, leurs<br />
potentialités et leurs limites.<br />
M.-Cl. Stuart propose une réflexion sur<br />
le maintien <strong>de</strong> la dépendance à la mère<br />
chez l’adolescente. L’évitement du mouvement<br />
dépressif lié à la menace <strong>de</strong><br />
perte <strong>de</strong> l’objet semble pouvoir être facilité<br />
par l’apparition d’une maladie somatique<br />
remettant en cause l’« économie<br />
psycho-somatique » et favorisant<br />
la position <strong>de</strong> dépendance à la mère.<br />
Cette dépendance serait une sorte d’effort<br />
pour ne pas grandir et pour retar<strong>de</strong>r<br />
l’accession à la sexualité adulte.<br />
Ce que Ch. Brunot nomme esthétique<br />
du non grandir s’avère être un fantasme<br />
narcissique qui vise à <strong>de</strong>meurer<br />
l’éternel enfant, à opposer au temps<br />
pulsionnel une résistance morale et<br />
éthique qui trouve une incarnation<br />
dans un double <strong>de</strong> soi, objet intemporel,<br />
fétiche d’un temps révolu sur lequel<br />
la tension d’altérité se reporte.<br />
Cette perversion du temps pulsionnel<br />
à l’œuvre dans certaines pathologies<br />
telles la névrose <strong>de</strong> contrainte trouve<br />
ici une illustration dans l’analyse d’un<br />
patient autobiographe chez qui le désir<br />
du nostos est <strong>de</strong>venu le seul désir<br />
qui soit comme quête d’un retour dans<br />
l’avant-naître.<br />
La pratique systématique et multiforme<br />
<strong>de</strong> l’humour à l’adolescence invite<br />
J.-P. Kamienak à s’interroger sur sa nature<br />
et sa fonction dans le processus<br />
<strong>de</strong> subjectivation adolescente. Les humours<br />
apparaissent ainsi, par la mise<br />
en représentations et en mots qu’elles<br />
effectuent, comme un moyen <strong>de</strong> traitement<br />
<strong>de</strong> l’excitation permettant les<br />
remaniements instanciels requis à ce<br />
moment du développement, offrant<br />
du même coup la possibilité d’élaborer<br />
les problématiques amoureuses qui<br />
lui sont spécifiques.<br />
Dossier I : Malaise dans la<br />
culture libérale<br />
Dossier II : Psychanalyse,<br />
société, anthropologie<br />
Le Coq-Héron Décembre 2005 n°183<br />
Erès, 16 €<br />
Dans un premier dossier consacré au<br />
« Malaise dans la culture libérale », sont<br />
présentés <strong>de</strong>s textes d’auteurs intervenus<br />
dans un colloque sur ce thème<br />
en décembre 2005. Ce dossier s’ouvre<br />
par un court monologue <strong>de</strong> Charles<br />
Melman qui évoque l’état d’esprit <strong>de</strong><br />
ce sujet post-mo<strong>de</strong>rne. Puis, Jean-<br />
Clau<strong>de</strong> Liau<strong>de</strong>t abor<strong>de</strong> la question <strong>de</strong><br />
la fantasmatique sous-jacente à l’exercice<br />
du pouvoir en régime libéral et insiste<br />
sur le fonctionnement collectif qui<br />
précè<strong>de</strong> le fonctionnement individuel,<br />
ce <strong>de</strong>rnier étant une variation du modèle<br />
collectif.<br />
Michel Benasayag, sous forme <strong>de</strong> dialogue<br />
avec Jean-Clau<strong>de</strong> Liau<strong>de</strong>t, interroge<br />
la psychanalyse dans son illusion<br />
<strong>de</strong> faire accé<strong>de</strong>r le moi à l’autonomie.<br />
Quant à Eugène Enriquez, il oppose à<br />
l’individualisme narcissique <strong>de</strong>structeur<br />
<strong>de</strong> la culture libérale, source d’une<br />
montée <strong>de</strong>s pathologies dont l’analyste<br />
est témoin, le rôle central <strong>de</strong><br />
l’amour non seulement comme signe<br />
<strong>de</strong> bonne santé psychique mais aussicomme<br />
capacité à reconnaître la différence<br />
<strong>de</strong> l’autre. Jean-Pierre Lebrun,<br />
auteur d’Un mon<strong>de</strong> sans limites, pense<br />
qu’il ne s’agirait pas tant d’une perversion<br />
construite contre le régime paternel<br />
(en particulier chez le sujet<br />
« consommateur » et « salarié » du système<br />
libéral) mais plutôt d’une pseudoperversion,<br />
résultant <strong>de</strong> l’absence <strong>de</strong><br />
confrontation au système paternel. Un<br />
article d’Alain Deneault sur « L’argent<br />
comme préconscient culturel » a pour<br />
sous-titre « L’économie psychique selon<br />
Avenarius, Simmel et Freud ».<br />
Un second dossier : « Psychanalyse, société,<br />
anthropologie » présente <strong>de</strong>s écrits,<br />
dont certains sont inédits en français.<br />
Vient tout d’abord un texte d’Erich<br />
Fromm (en traduction), texte qui date<br />
<strong>de</strong> 1974 et est intitulé « L’homme estil<br />
paresseux par nature ? ».<br />
Carlos Alberto Castillo Mendoza abor<strong>de</strong><br />
ensuite les « Rapports entre le psychique<br />
et le social chez Sandor Ferenzi ». Jean-<br />
Luc Vannier, qui a exercé la psychanalyse<br />
au Liban, se pose la question<br />
<strong>de</strong> la signification anthropologique et<br />
clinique <strong>de</strong> l’attirance qu’exercent sur<br />
les jeunes Libanais les pratiques occultistes,<br />
en se <strong>de</strong>mandant s’il en va<br />
<strong>de</strong> même en Europe.<br />
Angélique Christaki, dans un article intitulé<br />
« Inci<strong>de</strong>nces éthiques <strong>de</strong> paradigmes<br />
politiques relatifs à l’autisme et au handicap<br />
», met en ulmière les effets réducteurs<br />
<strong>de</strong> la législation et <strong>de</strong> l’abord<br />
neuro-cognitifs <strong>de</strong> l’autisme et du handicap<br />
mental.<br />
Ces <strong>de</strong>ux dossiers sont suivis d’un article,<br />
placé dans la rubrique « Varia »<br />
d’Odile Cazas qui s’intitule « La régression<br />
dans les Unités mère-bébés ».<br />
La douleur chez l’enfant<br />
Numéro thématique coordonné<br />
par Marc Zabalia<br />
Enfance 2006 n°1, PUF, 22 €<br />
La douleur est moins aisément reconnue<br />
et peut être largement sous-estimée<br />
chez les petits avant le langage<br />
et chez les plus grands lorsqu’ils sont<br />
non verbaux comme beaucoup d’enfants<br />
avec autisme, ou comme les jeunes<br />
avec une déficience mentale profon<strong>de</strong>.<br />
Dans ces cas, seuls les comportements<br />
manifestés peuvent constituer <strong>de</strong>s indices,<br />
or ceux-ci ne sont pas toujours<br />
fiables. C’est pourquoi sont si importants<br />
les travaux <strong>de</strong> recherche qui mettent<br />
en relation les indices neurophysiologiques<br />
et biochimiques concomitants<br />
à la survenue <strong>de</strong> comportements<br />
qui expriment la douleur. La France<br />
tar<strong>de</strong> à s’y impliquer. Il s’agit, pourtant,<br />
non seulement d’aiguiller le diagnostic<br />
mais aussi <strong>de</strong> mettre en place <strong>de</strong>s<br />
traitements antalgiques pertinents. De<br />
ce fait, l’étu<strong>de</strong> psychologique et neuropsychologique<br />
constitue un véritable<br />
enjeu <strong>de</strong> santé publique.<br />
Marc Zabalia, enseignant à l’Université<br />
<strong>de</strong> Caen, coordonne ce numéro thématique.<br />
Il propose, en introduction,<br />
un plaidoyer en faveur d’une psychologie<br />
<strong>de</strong> l’enfant face à la douleur. Il<br />
donne ensuite la parole à un ensemble<br />
<strong>de</strong> contributeurs qui abor<strong>de</strong>nt différents<br />
aspects du problème, <strong>de</strong>puis le<br />
développement d’une compétence à<br />
communiquer sa douleur, l’examen <strong>de</strong><br />
la place et du rôle <strong>de</strong> l’hypno-analgésie<br />
dans le contrôle <strong>de</strong> sa douleur par<br />
l’enfant lui-même, jusqu’à l’évaluation<br />
<strong>de</strong> la douleur chez les enfants atteints<br />
<strong>de</strong> déficience mentale. Au problème<br />
<strong>de</strong> la mémoire <strong>de</strong> la douleur, s’ajoute<br />
l’examen <strong>de</strong> l’influence <strong>de</strong>s souffrances<br />
chroniques <strong>de</strong>s parents sur la susceptibilité<br />
à la douleur chez leurs enfants.<br />
Matthieu <strong>de</strong> Brunhoff apporte le point<br />
<strong>de</strong> vue du pédiatre à cette question encore<br />
peu abordée dans l’étu<strong>de</strong> scientifique<br />
du développement <strong>de</strong> l’enfant.<br />
N°3 - TOME XIX - AVRIL 2006
22<br />
LIVRES<br />
VAE, quand l’expérience se<br />
fait savoir<br />
L’accompagnement en validation<br />
<strong>de</strong>s acquis<br />
Alex Lainé<br />
Erès, 15 €<br />
On peut obtenir <strong>de</strong>s diplômes professionnels<br />
grâce à la validation <strong>de</strong>s acquis<br />
<strong>de</strong> l’expérience (VAE). Cet ouvrage<br />
présente la métho<strong>de</strong> d’accompagnement<br />
<strong>de</strong>s candidats mise en œuvre pour<br />
les diplômes relevant du ministère <strong>de</strong><br />
la Jeunesse et <strong>de</strong>s Sports.<br />
Cette métho<strong>de</strong>, que l’auteur a contribué<br />
à définir, convient également pour<br />
l’obtention d’un diplôme délivré par les<br />
ministères <strong>de</strong> l’Éducation nationale, <strong>de</strong><br />
la Santé, <strong>de</strong> I’Agriculture.<br />
L’ouvrage suit le chemin parcouru par<br />
le candidat à la validation <strong>de</strong> ses acquis,<br />
<strong>de</strong>puis l’information sur le cadre<br />
réglementaire jusqu’à la décision du<br />
jury dont la métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> travail est, également,<br />
définie. Il montre comment cette<br />
démarche constitue un processus d’autoformation<br />
par lequel le candidat change<br />
le regard qu’il porte sur son expérience.<br />
Le bien : qu’en disent les<br />
jeunes ?<br />
Sophie Levasseur<br />
L’Harmattan, 11 €<br />
Ce livre est un enquête s’appuyant sur<br />
les témoignages d’une centaine <strong>de</strong><br />
jeunes, filles et garçons, d’un lycée <strong>de</strong><br />
la région parisienne, qui parlent <strong>de</strong> leur<br />
vision du bien, <strong>de</strong> leurs interrogations<br />
sur la valeur morale <strong>de</strong> leurs actes, et<br />
analysent, avec sincérité, leurs motivations<br />
et leurs freins à agir en bien et<br />
pour le bien.<br />
A travers la diversité <strong>de</strong>s expressions,<br />
ces paroles <strong>de</strong> jeunes révèlent quelque<br />
chose <strong>de</strong> la permanence et <strong>de</strong> l’invariance<br />
<strong>de</strong>s aspirations éthiques qui <strong>de</strong>meurent<br />
en chacun.<br />
La santé au miroir <strong>de</strong><br />
l’économie<br />
Une histoire <strong>de</strong> l’économie <strong>de</strong> la<br />
santé en France<br />
Daniel Benamouzig<br />
PUF, 34 €<br />
Ce livre qui analyse l’essor et le développement<br />
<strong>de</strong> l’économie <strong>de</strong> la santé<br />
en France, étudie les usages du raisonnement<br />
économique dans le domaine<br />
<strong>de</strong> la santé <strong>de</strong>puis les années 1950 en<br />
portant intérêt aux aspects cognitifs du<br />
travail <strong>de</strong>s économistes, et à leur activité<br />
sociale, institutionnelle ou Politique.<br />
De 1950 aux années 1970, l’Etat s’est<br />
progressivement doté <strong>de</strong> compétences<br />
et d’instruments économiques pour<br />
mettre en œuvre une politique <strong>de</strong> planification<br />
dans le domaine <strong>de</strong> la santé.<br />
Pendant plus <strong>de</strong> quinze ans, un vif débat<br />
oppose partisans et adversaires du<br />
calcul économique quant à la possibilité<br />
ou non d’établir un « prix <strong>de</strong> la vie<br />
humaine ». Rétrospectivement, cette<br />
controverse permet d’analyser les liens<br />
étroits entre les propriétés intrinsèques<br />
du raisonnement économique, qui évoluent<br />
au cours <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong>, et les<br />
usages auxquels il est <strong>de</strong>stiné et donne<br />
parfois lieu. Dans les années 1970 et<br />
1980, les réformes universitaires favorisent<br />
la création <strong>de</strong> nouveaux espaces<br />
académiques dédiés à l’économie <strong>de</strong> la<br />
santé. Des cycles d’enseignement et <strong>de</strong>s<br />
recherches spécialisées se développent<br />
au bénéfice d’une politique <strong>de</strong> recherche<br />
contractuelle en sciences sociales. Si les<br />
facultés <strong>de</strong> sciences économiques tirent<br />
bénéfice <strong>de</strong> ces évolutions, les facultés<br />
<strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine restent, pour l’essentiel,<br />
en marge du développement <strong>de</strong> l’économie<br />
<strong>de</strong> la santé, malgré quelques tentatives<br />
isolées. Dans les années 1980,<br />
<strong>de</strong>s alliances avec <strong>de</strong>s acteurs externes<br />
à l’administration <strong>de</strong>viennent possibles<br />
et se nouent parfois aux dépens <strong>de</strong> l’Etat.<br />
Une première alliance associe <strong>de</strong>s économistes<br />
et <strong>de</strong>s professionnels <strong>de</strong> santé<br />
autour du projet <strong>de</strong> développement <strong>de</strong><br />
l’évaluation économique <strong>de</strong>s pratiques<br />
médicales. Malgré quelques traductions<br />
institutionnelles, l’initiative vi<strong>de</strong> en pratique<br />
le raisonnement économique <strong>de</strong><br />
toute portée et le prive <strong>de</strong> toute conséquence.<br />
Une secon<strong>de</strong> alliance rapproche<br />
<strong>de</strong>s économistes à <strong>de</strong>s entrepreneurs<br />
politiques <strong>de</strong> sensibilité libérale, qui défen<strong>de</strong>nt<br />
un projet <strong>de</strong> mise en concurrence<br />
et <strong>de</strong> privatisation partielle du<br />
système <strong>de</strong> santé. Le projet <strong>de</strong>s Réseaux<br />
<strong>de</strong> soins coordonnés proposé au milieu<br />
<strong>de</strong>s années 1980, sans conséquences<br />
institutionnelles immédiates, donne lieu<br />
à <strong>de</strong> substantielles transformations du<br />
raisonnement économique, qui rend<br />
possible <strong>de</strong> nouvelles manières <strong>de</strong><br />
représenter le système <strong>de</strong> santé, permettant<br />
plus facilement d’envisager certaines<br />
transformations.<br />
Etre victime... et après ?<br />
Imaginaire et inconscient 2005,<br />
L’Esprit du Temps, 21 €<br />
Une nouvelle discipline, la victimologie,<br />
est en formation, exposant les diverses<br />
théories psychopathologiques du traumatisme,<br />
recensant les situations et événements<br />
victimisants, décrivant la clinique<br />
chez l’adulte comme chez l’enfant,<br />
étudiant les diverses conduites à tenir<br />
dans l’urgence, les prises en charge précoces<br />
et à long terme, détaillant enfin<br />
les diverses réponses juridiques et administratives<br />
aux <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong> réparation.<br />
Dans ce numéro, les psychanalystes<br />
s’effacent <strong>de</strong>vant les politiques et hommes<br />
d’action, les écrivains et les universitaires.<br />
Nicole Guedj, secrétaire d’Etat aux droits<br />
<strong>de</strong>s victimes - première titulaire du portefeuille<br />
créé en avril 2004 - expose la<br />
pensée qui sous-tend son action au sein<br />
du gouvernement et le programme en<br />
dix droits fondamentaux qu’elle projette<br />
<strong>de</strong> réaliser. Serge Klarsfeld, montre<br />
que ce qu’il appelle « <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> mémoire »<br />
est sans rapport avec les déferlements<br />
émotionnels sans len<strong>de</strong>main déclenchés<br />
par les médias qui, eux, n’aboutissent<br />
guère, en fait, qu’à rendre futile<br />
la gravité du mon<strong>de</strong>.<br />
Bernard Kouchner livre ses réflexions<br />
sur plus <strong>de</strong> trente-cinq années d’action<br />
humanitaire à travers le mon<strong>de</strong>.<br />
Sylvie Germain médite sur le mal et la<br />
seule alternative valable à celui-ci: « tenter<br />
<strong>de</strong> le mettre à distance <strong>de</strong> soi (<strong>de</strong> son<br />
être souffrant), <strong>de</strong> le contempler sur fond<br />
<strong>de</strong> vi<strong>de</strong> béant en nous et au « Ciel », et <strong>de</strong><br />
le laisser se consumer dans ce vi<strong>de</strong>. C’est<br />
lui opposer une fin <strong>de</strong> non recevoir définitive<br />
en refusant <strong>de</strong> le répercuter par<br />
voie <strong>de</strong> <strong>de</strong> violence et <strong>de</strong> vengeance, aussi<br />
légitime soit celle-ci ». Diane <strong>de</strong> Margerie<br />
apporte une nouvelle inédite inspirée<br />
par un fait divers réel récent repris<br />
sur le mo<strong>de</strong> romancé qui montre certains<br />
aspects du vécu victimaire et que,<br />
dans certains contextes, les suites d’un<br />
traumatisme peuvent être pires que le<br />
trauma lui-même. Marie-Christine<br />
Navarro, dont on gar<strong>de</strong> le souvenir <strong>de</strong>s<br />
interviews qu’elle a réalisées pour<br />
France-Culture, présente un texte où se<br />
mêlent confi<strong>de</strong>nce - ou fiction ? et méditation<br />
philosophique.<br />
René <strong>de</strong> Obaldia a autorisé à reproduire<br />
Rappening, monologue tiré du tome VIII<br />
<strong>de</strong> son Théâtre comple et par lequel<br />
débutent les Obaldiableries, créées à<br />
Paris en 1999. On y trouve un personnage<br />
dont la langue poétique mêle le<br />
cocasse et le pathétique <strong>de</strong> la déréliction.<br />
Janine Altounian, à partir <strong>de</strong> trois souvenirs,<br />
et à l’intersection <strong>de</strong> l’histoire<br />
collective et <strong>de</strong> l’histoire psychique individuelle<br />
(le génoci<strong>de</strong> arménien étant<br />
pris comme paradigme d’autres drames<br />
analogues), porte moins sa méditation<br />
sur la mémoire du meurtre collectif, que<br />
sur le besoin impérieux pour les <strong>de</strong>scendants<br />
<strong>de</strong>s survivants « <strong>de</strong> se démettre<br />
<strong>de</strong> l’emprise du crime qui en perpétue les<br />
effets au sein même <strong>de</strong> la vie qui leur fut<br />
malgré tout transmise ».<br />
Avec Florence Fabre, une victime s’exprime.<br />
Elle témoigne du fait qu’une réparation<br />
psychologique nécessite une<br />
justice, qu’une victime mérite un procès.<br />
Judith Kauffman, au travers d’exemples<br />
littéraires - tirés <strong>de</strong> romans d’Albert Cohen<br />
et <strong>de</strong> ceux <strong>de</strong> Romain Gary - fait la<br />
démonstration que quand une situation<br />
est sans issue, il reste l’humour.<br />
Jean Bénichou, prenant appui sur une<br />
vignette clinique, réfléchit sur le spectacle<br />
désolant qu’offrent certains patients<br />
que rien ni personne ne peut arracher<br />
aux déterminismes <strong>de</strong> cette<br />
marche au malheur que semble être<br />
pour eux l’auto-victimisation, par lesquels<br />
toute offre d’ai<strong>de</strong>, tout dispositif<br />
thérapeutique est annulé par cette fascination<br />
ayant l’apparence d’une addiction,<br />
et qui parfois s’accompagne<br />
d’une délectation - voire d’une érotisation<br />
- <strong>de</strong> la souffrance... Norbert Chatillon,<br />
dans un contrepoint, expose la<br />
vision <strong>de</strong> C. G. Jung sur l’état victimaire<br />
et la nécessité impérieuse <strong>de</strong> « savoir<br />
quoi faire <strong>de</strong>s conséquences » pour « ne<br />
pas épouser - au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la cruauté <strong>de</strong>s<br />
faits - la position <strong>de</strong> victime ».<br />
Martine Fleury expose la thérapie EMDR<br />
qui apporte <strong>de</strong>s solutions lorsque le patient<br />
reste bloqué sur <strong>de</strong>s évènements<br />
<strong>de</strong> vie <strong>de</strong>structeurs et, tout particulièrement,<br />
dans les stress post-traumatiques.<br />
Les résultats invitent à une réflexion.<br />
N°3 - TOME XIX - AVRIL 2006<br />
Paul Fuks, partant <strong>de</strong> trois récits <strong>de</strong> rêves,<br />
montre que les cauchemars peuvent<br />
être les messagers du positif, que l’« air<br />
du temps » peut parfois faire voir <strong>de</strong>s<br />
victimes là où il n’y en a pas, et que certaines<br />
victimes préfèrent s’aveugler plutôt<br />
que <strong>de</strong> s’assumer comme telles.<br />
Maurice Hurni désigne la psychanalyse<br />
comme « ayant joué un rôle non négligeable<br />
dans le concert <strong>de</strong>s doctrines qui<br />
ont contribué à occulter toutes sortes<br />
d’actes cruels perpétrés au cours du XX e<br />
siècle, du moins au sein <strong>de</strong>s familles ». Il<br />
pense, bien sûr, au discrédit jeté par<br />
Freud sur les récits que ses patientes<br />
faisaient <strong>de</strong> leurs traumatismes. « On ne<br />
saurait en tout cas imaginer pire dénigrement<br />
d’une victime <strong>de</strong> maltraitances.<br />
Peut-on mettre en regard <strong>de</strong> cette mystification<br />
le bénéfice d’avoir mis l’accent<br />
sur le mon<strong>de</strong> intérieur <strong>de</strong>s patients, tout<br />
aussi violent, et donc inventé la psychanalyse<br />
? ».<br />
François Krauss, à partir d’exemples cliniques,<br />
explore la notion <strong>de</strong> victimisation<br />
- empruntée à la justice pénale - et<br />
ses mécanismes aboutissant aux violences<br />
sexuelles tant chez l’adulte que<br />
chez l’enfant. Il montre que la reconnaissance<br />
par le juriste et le thérapeute<br />
du fait que la victime n’est pas la cause<br />
<strong>de</strong> ce qui lui arrive, est indispensable<br />
pour atténuer la culpabilité <strong>de</strong> la victime,<br />
important obstacle dans le travail<br />
thérapeutique.<br />
Gérard Lopez parcourt les techniques<br />
thérapeutiques utilisées - et consensuellement<br />
admises - dans la prise en<br />
charge <strong>de</strong>s états limites post-traumatiques,<br />
leurs principes cliniques, les aménagements<br />
qu’elles exigent, visant à<br />
donner la parole à une victime, dans<br />
un climat d’empathie active, afin <strong>de</strong> lui<br />
permettre d’ordonner ses souvenirs, <strong>de</strong><br />
donner un sens au traumatisme et<br />
d’échapper à son emprise.<br />
Ma<strong>de</strong>leine Natanson se penche sur le<br />
cas <strong>de</strong>s enfants <strong>de</strong> bourreaux.<br />
Yves Prigent décrit cette « cruauté ordinaire<br />
» qui se déploie au quotidien, dans<br />
la vie du couple, au travail, en tous lieux<br />
- y compris au sein d’associations psychanalytiques.<br />
Le « pervers envieux » est<br />
partout à l’œuvre... L’auteur préconise<br />
une contre-logique <strong>de</strong> l’honneur et <strong>de</strong><br />
la dignité, une éthique du respect <strong>de</strong><br />
l’homme.