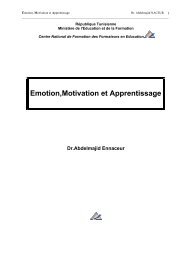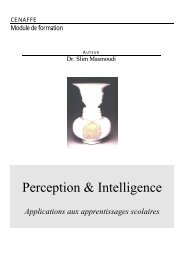541 Ko - Cenaffe
541 Ko - Cenaffe
541 Ko - Cenaffe
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
REPUBLIQUE TUNISIENNE<br />
MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION<br />
Centre National de Formation des Formateurs en Education<br />
Département des Etudes<br />
La lecture des textes courts<br />
Jalila BEN ZINEB ZITOUNI Chédly TROUDI<br />
Inspectrice Inspecteur<br />
Lilia KHEMIRI ABDELMLEK<br />
Mohamed Lassaad KHLASS<br />
Tarek MOKRANI<br />
Professeurs formateurs<br />
Version expérimentale<br />
CENAFFE / PREFSET 1
PREFACE<br />
Ce module intitulé la lecture des textes courts et lancé sous l’égide du<br />
PREF/SET a pour but d’améliorer et d’affiner l’approche du professeur en<br />
matière de lecture.<br />
Cette tâche a été rendue possible grâce au concours des différents<br />
membres du réseau et au précieux apport des professeurs formateurs qui<br />
nous ont encadrés lors du stage de formation à l’IUFM de Versailles, du 19<br />
au 31 mars 2007.<br />
Nous remercions tous ceux qui nous ont accompagnés lors de ce<br />
stage, aussi bien du côté français que du côté tunisien, nous exprimons le<br />
vœu que ce document soit un vif témoignage de leur collaboration.<br />
Nous espérons que ce module de formation sera à la hauteur de nos<br />
aspirations et qu’il apportera de nouvelles façons d’aborder les textes courts.<br />
Nous souhaitons surtout que ses répercussions se fassent sentir sur le travail<br />
et le rendement de l’élève tunisien qui gagneront en qualité et en efficacité.<br />
Nous voudrions désormais que cette activité pivot qu’est la lecture,<br />
devienne, en plus de l’apport linguistique et culturel qu’elle constitue, un<br />
véritable moment de plaisir et pour l’enseignant et pour l’élève.<br />
CENAFFE / PREFSET 2<br />
Les auteurs
TABLE TABLE DES DES MATIERES<br />
MATIERES<br />
Introduction ……………………………………………….Page 4<br />
Présentation du document ……………………………...Page 6<br />
Les objectifs du module …………………………………Page 8<br />
Tableau récapitulatif …………………………………….Page 9<br />
du programme des journées de formation.<br />
Journée 1 …………………………………………………Page 10<br />
Annexe journée 1 ………………………………………..Page 16<br />
Journée 2 …………………………………………………Page 22<br />
Annexe journée 2 ………………………………………..Page 29<br />
Journée 3 …………………………………………………Page 62<br />
Annexe journée 3 ………………………………………..Page 66<br />
Journée 4 …………………………………………………Page 73<br />
Annexe journée 4 ………………………………………..Page 79<br />
Journée 5 …………………………………………………Page 84<br />
Bibliographie ……………………………………………..Page 88<br />
CENAFFE / PREFSET 3
INTRODUCTI<br />
INTRODUCTION<br />
INTRODUCTI ON<br />
L’intitulé « lecture des textes courts » cible l’activité de lecture telle<br />
qu’elle se présente dans les programmes officiels tunisiens ainsi que dans les<br />
différents manuels. La lecture des textes courts représente la clé de voûte de<br />
l’enseignement apprentissage d’une langue. Traiter ce sujet lors d’un projet<br />
de formation se révèle incontournable tant les enjeux sont vitaux et divers.<br />
Il ne faut pas se leurrer. Les constats et les rapports des évaluateurs et<br />
des observateurs sont alarmants. Les dysfonctionnements en séance de<br />
lecture sont légion tant au niveau des enseignants qu’à celui des apprenants.<br />
Et les répercussions sont telles que les objectifs ciblés par les programmes<br />
officiels sont loin d’être atteints. Les dits dysfonctionnements doivent être<br />
identifiés et traités avec le concours actif des participants.<br />
Réfléchir sur ses pratiques, innover, viser l’efficience, aider l’élève et le<br />
doter des outils nécessaires pour aborder un texte et découvrir sa voie, sa<br />
vocation de lecteur tel devrait être le pari du professeur.<br />
Ce module a pour ambition d’amener les participants à réfléchir sur la<br />
pratique de la lecture en classe de français, à diagnostiquer les difficultés<br />
rencontrées. En outre, des méthodes préconisées par des spécialistes en la<br />
matière viendront enrichir un savoir-faire existant. Ainsi, ce travail s’inscrit<br />
dans la continuité et ne prétend nullement remettre en question les<br />
approches dites traditionnelles mais plutôt leur utilisation servile, sclérosée,<br />
mécanique qui fait perdre de vue l’objectif premier en lecture : le texte,<br />
transformant ce dernier en prétexte pour mettre en œuvre des pratiques<br />
manquant de pertinence.<br />
CENAFFE / PREFSET 4
La multitude des mécanismes entrant en jeu lors de l’acquisition du<br />
réflexe de lecture, les obstacles rencontrés pendant cette activité de classe et<br />
la diversité des méthodes didactiques représentent une richesse qui pose un<br />
problème d’approche et de gestion du temps, problème que nous aborderons<br />
lors de cette session de formation.<br />
La démarche proposée dans ce module répondra à un souci<br />
d’exhaustivité. Toutefois, la priorité sera accordée au volet pratique et aux<br />
échanges entre professeurs plutôt qu’aux propositions théoriques. Il sera<br />
question de passer en revue les pratiques et les démarches classiques pour<br />
aboutir aux innovations dans le domaine de la pédagogie de la lecture des<br />
textes courts. Pour ce faire, Le module s’articulera autour de cinq journées<br />
modulables en plus d’éventuelles activités en « non présentiel ».<br />
Le formateur chargé d’appliquer ce module disposera, outre d’une<br />
proposition de démarche pour les journées de formation, d’un apport<br />
théorique qui lui permettra de maîtriser les sujets abordés. Il bénéficiera aussi<br />
d’un corpus de textes se prêtant aux différentes activités proposées. Des<br />
documents à l’intention des participants lui seront fournis.<br />
CENAFFE / PREFSET 5
PRESENTATION PRESENTATION PRESENTATION DU DU DOCUMENT<br />
DOCUMENT<br />
Nature du document :<br />
Fascicule à l’attention des formateurs comportant :<br />
• Le détail du déroulement des journées de formation<br />
• Des supports textuels divers (pris dans les manuels scolaires et dans<br />
des œuvres littéraires)<br />
• Des documents théoriques destinés au formateur<br />
• Des documents théoriques destinés aux formés<br />
Public cible :<br />
Ce module profitera aussi bien aux enseignants des collèges qu’à ceux<br />
des lycées quelle que soit leur expérience dans le domaine.<br />
Problématique :<br />
Vu les enjeux de la lecture dans l’apprentissage d’une langue et afin<br />
d’essayer d’aplanir certaines difficultés que rencontrent la plupart des<br />
enseignants en séance de lecture, nous nous proposons de réfléchir à la<br />
problématique suivante :<br />
Quelles sont les difficultés auxquelles se heurtent enseignants et<br />
élèves lors de la lecture des textes courts et comment les surmonter ?<br />
Comment faire de la lecture du texte court une motivation à la lecture<br />
tout court ?<br />
Quels sont les dispositifs, les démarches, qui permettent de mieux<br />
conjuguer lecture personnelle et lecture professionnelle ?<br />
Comment concevoir l’enseignement de la lecture des textes courts en<br />
termes de projet ?<br />
CENAFFE / PREFSET 6
Durée de la formation :<br />
Dans un souci d’exhaustivité, nous proposons des activités à exploiter<br />
sur cinq journées de formation. Ces journées sont conçues dans un souci de<br />
progression et de complémentarité. Cependant, chacune de ces journées<br />
présente des objectifs spécifiques et peut à elle seule faire l’objet d’une<br />
action de formation.<br />
Au formateur d’adapter ce contenu aux objectifs de la session qu’il aura<br />
à assurer et au temps dont il disposera.<br />
Modalités :<br />
Méthode active centrée sur le formé et qui privilégie les exercices<br />
impliquant les enseignants (découverte, analyse, recherche, présentation des<br />
travaux réalisés en groupes sur transparent, production d’outils<br />
didactiques…).<br />
Nous proposons :<br />
• des activités en présentiel et en non présentiel<br />
• des stratégies interactives<br />
• des travaux individuels, par petits groupes et/ou en plénière<br />
• des moments de mise en commun<br />
• des mises au point ponctuelles avec ou sans documents théoriques.<br />
Compétences à développer chez les enseignants :<br />
Au terme de cette session de formation, nous espérons que l’enseignant<br />
sera capable de :<br />
• Choisir des textes adaptés au niveau et aux besoins de la classe.<br />
• Choisir une approche pertinente, en rapport avec le texte programmé et<br />
la progression dans le programme.<br />
• Varier les activités relatives à la lecture.<br />
• Concevoir les activités de lecture en termes de projet d’enseignementapprentissage,<br />
conforme aux programmes officiels.<br />
Evaluation<br />
• Evaluation des acquis<br />
• Evaluation de la session<br />
Matériel<br />
• Rétroprojecteur, transparents, feutres<br />
• Tableau, stylo<br />
• Vidéo projecteur<br />
• Lecteur DVD, lecteur CD audio<br />
CENAFFE / PREFSET 7
Les Les objectifs objectifs du du module module<br />
module<br />
Ce module de formation se propose comme objectif général, de doter<br />
les enseignants d’un savoir, d’un savoir faire et d’un savoir être leur<br />
permettant de développer chez l’élève le plaisir de lire et la capacité de<br />
« lire » un texte de façon autonome.<br />
Les sous objectifs retenus :<br />
cerner les difficultés rencontrées par les enseignants comme par les<br />
élèves et les catégoriser<br />
redéfinir les compétences en lecture à développer chez les élèves<br />
insister sur l’importance d’une lecture personnelle comme préalable<br />
à une lecture professionnelle<br />
identifier les obstacles relatifs à la compréhension et définir des<br />
stratégies pour y remédier<br />
souligner la nécessité de fixer des objectifs d’enseignement –<br />
apprentissage de la lecture<br />
sensibiliser à l’importance de la notion d’inférence<br />
distinguer et définir les spécificités de deux catégories de textes : les<br />
proliférants et les réticents<br />
proposer des approches variées, diversifiées et complémentaires<br />
des textes courts dont le débat interprétatif<br />
évaluer grâce à des indicateurs :<br />
l’enseignement de la lecture<br />
l’apprentissage de la lecture<br />
CENAFFE / PREFSET 8
Objectifs<br />
Supports<br />
Modalités<br />
Programme Programme des des journées<br />
journées<br />
Journée 1 Journée2 Journée3 Journée 4 Journée 5<br />
- Cerner les<br />
difficultés en<br />
lecture et les<br />
classer<br />
- Définir les<br />
compétences à<br />
développer en<br />
lecture<br />
- Sensibiliser à<br />
la lecture<br />
personnelle/<br />
professionnelle<br />
- Leçon témoin<br />
enregistrée<br />
- Extraits de<br />
rapports de<br />
synthèse établis<br />
par l’inspection<br />
générale<br />
- Programme<br />
officiel<br />
- Finalités/<br />
Objectifs de la<br />
lecture<br />
- Brainstorming<br />
- Lecture /<br />
commentaire du<br />
PO<br />
- Echange<br />
- Dégager les<br />
obstacles<br />
relatifs à la<br />
compréhension<br />
- Proposer des<br />
pistes<br />
d’approche<br />
pour aplanir<br />
ces difficultés<br />
- Documents<br />
théoriques à<br />
distribuer<br />
- Textes<br />
choisis dans et<br />
hors des<br />
manuels<br />
scolaires<br />
- Travail sur<br />
différents<br />
textes<br />
- Lecture du<br />
document<br />
théorique<br />
CENAFFE / PREFSET 9<br />
- Distinguer<br />
deux<br />
catégories de<br />
textes :<br />
réticents /<br />
proliférants.<br />
- Définir les<br />
spécificités de<br />
chacune de ces<br />
deux<br />
catégories<br />
- Insister sur le<br />
caractère<br />
immanent de<br />
toute<br />
interprétation<br />
- Groupement<br />
de textes :<br />
textes<br />
représentatifs<br />
de ces deux<br />
catégories.<br />
- Documents<br />
théoriques.<br />
- Réflexion sur<br />
l’aspect<br />
réticent et/ou<br />
proliférant<br />
d’un texte<br />
- Exercices<br />
pour baliser<br />
son<br />
interprétation.<br />
- (Re) découvrir<br />
les différentes<br />
approches<br />
- Souligner la<br />
nécessité de fixer<br />
des objectifs<br />
d’enseignement<br />
– apprentissage<br />
de la lecture<br />
- Choisir<br />
l’approche en<br />
fonction des<br />
objectifs fixés<br />
- Des documents<br />
théoriques<br />
- Les Instructions<br />
Méthodologiques<br />
Et les P.O<br />
- Des textes<br />
divers<br />
- Des<br />
enregistrements<br />
de textes lus par<br />
des<br />
professionnels de<br />
la lecture.<br />
- Exercices de<br />
lecture<br />
expressive<br />
- Travail sur les<br />
outils d’analyse<br />
et les approches<br />
- Application :<br />
réflexion sur<br />
différentes<br />
approches pour<br />
un même texte<br />
- Faire<br />
apprécier un<br />
texte en dehors<br />
de toute<br />
subjectivité<br />
- Faire<br />
construire une<br />
séance de<br />
lecture<br />
-Evaluer :<br />
*l’enseignement<br />
de la lecture<br />
*l’apprentissage<br />
de la lecture<br />
- Textes choisis<br />
dans les<br />
manuels et<br />
réputés<br />
rebutants<br />
- Travail sur des<br />
textes<br />
considérés<br />
‘’rebutants’’<br />
- Présentation<br />
des travaux et<br />
discussion.<br />
- Elaboration de<br />
grilles<br />
d’évaluation
Journée Journée Journée 1<br />
1<br />
Objectifs Contenus<br />
Supports<br />
1- Cerner les<br />
difficultés en<br />
lecture et les<br />
classer<br />
2- Définir les<br />
compétences à<br />
développer en<br />
lecture<br />
3- Sensibiliser à la<br />
lecture<br />
personnelle/<br />
professionnelle<br />
- Leçon témoin enregistrée<br />
- Extraits de rapports de synthèse<br />
établis par l’inspection générale<br />
(mis à la disposition du formateur)<br />
- Programme officiel<br />
- Finalités/ Objectifs de la lecture<br />
- La fable de La Fontaine « La Cigale<br />
et la Fourmi »<br />
CENAFFE / PREFSET 10<br />
Modalités<br />
- Brainstorming<br />
- Lecture /<br />
commentaire du PO<br />
- Echange :<br />
-Formateur/professeur<br />
-Professeur/professeur
1/ Réflexion sur :<br />
Ordre Ordre du du du jour<br />
jour<br />
• les difficultés rencontrées en séance de lecture<br />
• les pratiques de classe pour aborder les textes courts<br />
2/ Echange autour du Programme Officiel pour dégager les compétences à<br />
développer chez l’élève<br />
3/ Sensibilisation au passage de la lecture personnelle et plurielle à une lecture<br />
professionnelle<br />
CENAFFE / PREFSET 11
Etape Etape 1<br />
1<br />
Déroulement<br />
Déroulement<br />
Déroulement<br />
I/ Brainstorming visant à recueillir les représentations que les enseignants ont de la séance<br />
de lecture.<br />
Les questions suivantes peuvent être utilisées comme déclencheur :<br />
Qu’est-ce qu’une séance de lecture ?<br />
Quels problèmes se posent lors d’une séance de lecture ?<br />
Quelles sont vos pratiques habituelles en séance de lecture ?<br />
Le formateur peut charger les enseignants de prendre des notes pour une éventuelle<br />
classification des difficultés que le brainstorming fera ressortir.<br />
II/ Observation et analyse de certaines pratiques en séance de lecture à partir de la<br />
projection de séquences d’une leçon témoin en vue de dégager les dysfonctionnements qui<br />
nuisent à l’efficience de cette activité.<br />
Le formateur pourra exploiter les extraits des rapports de l’inspection générale pour<br />
compléter cet inventaire.<br />
Parmi ces dysfonctionnements, on peut relever :<br />
- L’utilisation de démarches stéréotypées : le même rituel est reconduit dans toutes les<br />
séances : les entrées, le parcours, l’après texte se répètent.<br />
- Le recours à un questionnement basé sur des clichés : « Quel est le type du texte ? De<br />
quoi s’agit-il dans le texte ? Quelle est l’idée générale du texte ?.....<br />
- L’absence de stratégie qui se fixe des objectifs précis en lecture et qui arrête des choix en<br />
fonction de ces objectifs et des besoins des élèves : les supports, les démarches, les<br />
activités…<br />
- La confusion entre la lecture personnelle du professeur et la lecture professionnelle<br />
réalisée en classe avec les élèves. Certains professeurs choisissent les textes en fonctions<br />
de leurs goûts et de leur idéologie personnels. Par là même, ils imposent à leurs élèves leur<br />
lecture du texte et n’admettent pas des interprétations qui différent des leurs. Il va de soi<br />
que l’élève ne participe pas à la construction d’une signification du texte.<br />
- L’enferment dans deux perspectives non-pertinentes : la première est techniciste et se<br />
contente de relever des indices formels sans les rattacher au sens, la deuxième est<br />
thématique et utilise le texte comme prétexte au « délire interprétatif ».<br />
CENAFFE / PREFSET 12
- Le centrage de l’apprentissage autour des textes narratifs, jugés plus accessibles que<br />
d’autres genres comme les poèmes ou les scènes de théâtre.<br />
- La non prise en considération de la dimension émotionnelle en lecture sans laquelle les<br />
élèves ne peuvent pas réagir, interagir face au texte. Or sans émotion, le plaisir de lire n’a<br />
pas de sens.<br />
Etape Etape 2<br />
2<br />
Définir les compétences à développer<br />
-Support : programmes officiels<br />
Consultation des programmes de lecture pour les classes des collèges et des lycées,<br />
suivie d’un échange visant l’identification des compétences à installer chez l’élève.<br />
Cet échange devrait permettre de dégager les compétences suivantes chez l’élève :<br />
Lire / comprendre/ analyser/ interpréter/ apprécier un texte.<br />
Comprendre ce qui est écrit, c'est-à-dire tirer du message textuel une signification et<br />
la construire progressivement en recourant au relevé d’indices et à leur mise en<br />
relation.<br />
S’initier à la lecture savante en apprenant des démarches intellectuelles d’analyse et<br />
de jugement.<br />
Se doter progressivement d’un métalangage simple portant sur les fondamentaux<br />
d’un texte littéraire : Enonciation, structures, genres, types…<br />
S’enrichir grâce à la lecture des textes sur les plans linguistique, psychologique,<br />
intellectuel afin de se forger son identité personnelle.<br />
Développer son autonomie de lecteur en se dotant de plusieurs stratégies, de<br />
plusieurs démarches ce qui permettrait de ne pas s’enfermer dans un moule figé.<br />
Développer le plaisir de lire en tant que moyen de :<br />
• détente et distraction<br />
• satisfaction intellectuelle due à la construction de la signification d’un texte<br />
• émotion face à un texte bien écrit<br />
• transport dans l’imaginaire et le rêve<br />
Se situer par rapport à autrui par identification et/ou distanciation<br />
S’ouvrir sur d’autres cultures et d’autres horizons<br />
Eveiller la sensibilité esthétique<br />
CENAFFE / PREFSET 13
Etape Etape Etape 3<br />
3<br />
Sensibiliser à la lecture personnelle / professionnelle<br />
Support : Une fable de la Fontaine, La Cigale et la Fourmi<br />
A/ Tâche donnée aux professeurs : faire une lecture personnelle de la fable (relever les<br />
jeux de dénotation et de connotation, les référents culturels et historiques, …)<br />
B/ Présentation et comparaison des lectures :<br />
La fable pourrait être lue comme :<br />
- une valorisation du travail<br />
- une mise en relief de l’art…<br />
Le choix de cette fable a pour but de montrer que le texte littéraire, qui est<br />
polysémique, s’apprête à plusieurs lectures. Toute interprétation de cette fable, ou de<br />
n’importe quel texte, devrait se baser sur le texte lui-même, y trouver des indices et des<br />
éléments pertinents et les mettre en relation pour construire une signification. Il va de soi<br />
que le professeur doit s’imprégner du texte avant de pouvoir l’aborder en classe, avec les<br />
élèves.<br />
Lecture personnelle/ professionnelle<br />
En fin de séance, l’animateur est invité à faire réfléchir les enseignants sur la<br />
question : Quel(s) axe(s) de lecture de cette fable pourrait-on retenir pour une classe d’un<br />
niveau donné ? Ceci lui permettra de poser la problématique de l’importance de la lecture<br />
personnelle dans la préparation d’une séance de lecture (lecture professionnelle).<br />
En effet, une lecture professionnelle ne peut être efficace, et ne peut atteindre les<br />
objectifs fixés que si elle est précédée, préparée par une bonne lecture personnelle et<br />
plurielle. Avant d’aborder le texte en classe avec les élèves, le professeur doit l’étudier<br />
sous plusieurs angles, s’exercer à la lecture expressive et réfléchir éventuellement à la<br />
théâtralisation, … afin d’explorer les différentes possibilités auxquelles il s’apprête. Cette<br />
lecture aide le professeur à fixer une stratégie de lecture qui tient compte des difficultés du<br />
texte retenu, de son intérêt et qui s’adapte à la situation pédagogique effective.<br />
CENAFFE / PREFSET 14
Activité Activité en en en non non présentiel présentiel :<br />
:<br />
Donner les documents :<br />
Qu’est-ce que comprendre ?<br />
Apprendre à comprendre.<br />
Demander aux enseignants de faire un compte rendu de leurs lectures.<br />
CENAFFE / PREFSET 15
ANNEXE JOURNEE 1<br />
Extraits de rapports de synthèse établis par l’inspection générale.<br />
La fable : La cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine.<br />
Documents pour la journée 2:<br />
- Qu’est-ce que comprendre ?<br />
- Apprendre à comprendre.<br />
CENAFFE / PREFSET 16
Document pour le formateur<br />
Extraits de rapports établis par l’inspection générale<br />
1993 :<br />
- Exploitation assez fréquente des questions proposées à la suite des textes, comme s’il<br />
s’agissait de fiches de cours.<br />
-Difficultés pour certains enseignants, particulièrement les non-spécialistes, à analyser les textes<br />
poétiques.<br />
1994 :<br />
- Accorder l’importance requise à la pédagogie du texte littéraire.<br />
-Pour le second cycle, les connaissances relatives à l’histoire littéraire, aux caractéristiques des<br />
genres, aux courants littéraires sont, assez souvent très limitées.<br />
- les manuels sont jugés « lourds » et peu attrayants.<br />
- Beaucoup de professeurs trouvent des difficultés à utiliser le manuel de 6 ème année. Ce livre est<br />
jugé non adapté au niveau réel des élèves.<br />
1995 :<br />
Le manuel de 7 ème année.<br />
Au bout d’une année d’expérimentation, il se confirme d’une part, que ce manuel est touffu, difficile<br />
et inadapté au niveau des élèves. D’autre part, parmi les enseignants chargés de l’utiliser, nombreux sont<br />
ceux qui éprouvent des difficultés réelles au moment d’aborder certains textes ou d’exploiter les éléments<br />
du para texte.<br />
Propositions :<br />
- procéder à un allègement des contenus du manuel.<br />
- éliminer les textes les plus difficiles et ceux qui, de par leur thème, leur écriture ou leur auteur sont<br />
considérés comme trop originaux pour être pédagogiquement rentables.<br />
- simplifier l’appareil pédagogique accompagnant les textes en éliminant ou en reformulant les<br />
questions difficiles et les exercices trop fouillés qui font appel à des capacités que les élèves du<br />
secondaire ne sont pas censés posséder.<br />
1996 :<br />
Pour ce qui est des différentes activités et même si quelques inspecteurs signalent une relative évolution<br />
touchant l’enseignement de la grammaire, un grand nombre d’entre eux signalent des difficultés qui<br />
entravent la réalisation des objectifs de lecture et d’expression écrite :<br />
- démarche de lecture globale non maîtrisée ;<br />
- textes déstructurés et/ou réduits à une liste de procédés ;<br />
- pratique courante de la paraphrase ;<br />
- difficulté à saisir la dimension implicite des textes littéraires et à en percevoir le référent culturel.<br />
Ces lacunes sont imputées, tantôt à une insuffisance de pratique textuelle, tantôt à l’attitude servile<br />
des enseignants par rapport aux manuels et autres instruments didactiques en vigueur.<br />
1998/1999 :<br />
Les manuels scolaires sont déjà caducs. Les versions remaniées seront évaluées ultérieurement. Les<br />
manuels du cycle secondaire posent des problèmes notamment en lecture (7 ème année) et celui de<br />
grammaire (5 ème année).<br />
CENAFFE / PREFSET 17
* Acquis des enseignants : les thèmes dont ils ont tiré profit<br />
Tous les thèmes traités dans le programme de formation 98/99 sont cités : explication de texte,<br />
communication, grammaire, culture et civilisation.<br />
* Impact sur le cours :<br />
Inexistant ou difficile à évaluer certains, perceptible à travers l’amélioration de certaines pratiques<br />
pédagogiques( activités de lecture plus cohérentes, épreuves d’évaluation mieux conçues, communication<br />
mieux établie en classe) pour d’autres.<br />
1999/2000 :<br />
L’exploitation des manuels et des documents méthodologiques :<br />
« servile », « mécanique », « passive », « superficielle », « formelle », « sans esprit d’initiative », telles<br />
sont les qualifications de l’exploitation des manuels et autres documents et ce, en dépit d’une nette<br />
amélioration de ces outils.<br />
Laboratoires langues : inexistants.<br />
2000/2001 :<br />
Les enseignants non spécialistes présentent, au niveau pédagogique, globalement les mêmes<br />
caractéristiques que les autres enseignants titulaires. Par contre, au niveau scientifique, ils ont parfois des<br />
lacunes assez importantes. La sensibilité littéraire leur fait souvent défaut.<br />
2001/2002 :<br />
Texte court<br />
-En séance de lecture, on se contente en général, de paraphraser le texte.<br />
- Les enseignants axent, le plus souvent, l’analyse textuelle sur le contenu thématique aux dépens de<br />
l’écriture.<br />
-On observe le recours quasi-systématique à une démarche répétitive, sans prise en compte de la<br />
spécificité des textes.<br />
- La démarche adoptée par certains professeurs se limite à la reprise pure et simple des questions<br />
proposées dans l’appareil pédagogique du manuel.<br />
* Propositions :<br />
- Former aux différentes approches textuelles ;<br />
- programmer des journées pédagogiques (ou des séances de formation continue) consacrées à<br />
l’élaboration de fiches de lecture, avec prise en compte de la variété des approches et de la diversité des<br />
textes ;<br />
- réaliser des observations de classes où seront mises en pratique les fiches élaborées dans les journées<br />
pédagogiques.<br />
CENAFFE / PREFSET 18
LA CIGALE ET LA FOURMI<br />
La Cigale, ayant chanté<br />
Tout L'Été,<br />
Se trouva fort dépourvue<br />
Quand la Bise fut venue.<br />
Pas un seul petit morceau<br />
De mouche ou de vermisseau.<br />
Elle alla crier famine<br />
Chez la Fourmi sa voisine,<br />
La priant de lui prêter<br />
Quelque grain pour subsister<br />
Jusqu'à la saison nouvelle.<br />
« Je vous paierai, lui dit-elle,<br />
Avant l'Août, foi d'animal,<br />
Intérêt et principal. »<br />
La Fourmi n'est pas prêteuse :<br />
C'est là son moindre défaut.<br />
« Que faisiez-vous au temps chaud ?<br />
Dit-elle à cette emprunteuse.<br />
- Nuit et jour à tout venant<br />
Je chantais, ne vous déplaise.<br />
- Vous chantiez ? J’en suis fort aise :<br />
Eh bien! Dansez maintenant. »<br />
Jean de La Fontaine, Fables<br />
CENAFFE / PREFSET 19
Qu'est-ce que comprendre ?<br />
Le processus de compréhension commence bien avant la lecture d'un texte proprement dite. La<br />
reconnaissance de la situation évoquée par le texte ainsi que la construction de l'univers de référence<br />
appartenant à l'histoire s'effectuent par le biais du repérage et la reconnaissance d'éléments textuels<br />
(présentation, titres, illustrations, silhouette…), une mobilisation des connaissances du lecteur et<br />
l'émission d'hypothèses sur l'activité même, de manière à créer un horizon d'attente. C'est pourquoi il est<br />
conseillé, avant de lire le texte, de faire mobiliser et évoquer les vécus ainsi que les lectures antérieures<br />
des élèves en rapport avec ce qui est dit par le texte, de montrer des images, de présenter les personnages,<br />
de raconter l'histoire ou de résumer le texte avant de le lire.<br />
Pendant la lecture, l'élève devra effectuer simultanément plusieurs tâches : en plus d'intégrer de nouvelles<br />
informations qu'il doit traiter localement au fur et à mesure qu'elles sont perçues et de se les représenter<br />
mentalement, il doit les mettre en cohérence sa représentation des informations antérieures qu'il aura<br />
mémorisées, traiter les inférences et l'implicite éventuel du texte, effectuer des résumés partiels et des<br />
retours en arrière, ralentir sa vitesse de lecture et faire des pauses en fonction des difficultés du texte ou<br />
de la nature des informations prélevées: lourd programme !<br />
Le lecteur effectue donc de constants allers et retours entre ce qui est en mémoire et ce qui est en cours de<br />
traitement. La complexité du processus explique les nombreuses difficultés rencontrées par les élèves. Il<br />
est certain qu'un élève qui dépense déjà beaucoup d' «énergie» pour déchiffrer et pour lequel ce processus<br />
de déchiffrage n'est donc pas encore automatisé, sera plus en difficulté qu'u meilleur déchiffreur pour<br />
effectuer les tâches simultanées que nécessite la compréhension d'un texte. Cela n'implique pas pour<br />
autant deux phases successives dans l'apprentissage : la première consacrée à l'apprentissage du décodage<br />
au cycle 2 voire au cycle 3 et la seconde dévolue à l'apprentissage de la compréhension et dévolue à la<br />
fin du cycle 3 et au collège. Au contraire, tout le monde s'accorde pour reconnaître la nécessité<br />
d'apprendre à comprendre dès le cycle2.<br />
Construire son projet de lecteur (comprendre à quoi ça sert de lire et comment on s'y prend pour lire),<br />
comprendre le fonctionnement de la langue, mémoriser le lexique, savoir combiner les unités lexicales ne<br />
suffisent donc pas. Les connaissances linguistiques (concernant le lexique, la syntaxe, l'organisation d'un<br />
écrit), encyclopédiques (sur le monde liées aux thèmes abordés par le texte) et stratégiques (planification,<br />
contrôle et régulation du processus) sont essentielles ; mais pour comprendre le lecteur doit aussi<br />
comprendre ce qu'est comprendre. C'est-à-dire prendre conscience et être convaincu de l'utilité de tâches à<br />
effectuer et de stratégies à mettre en place, concevoir que les réussites sont dues à des efforts.<br />
Ces tâches sont de deux ordres différents : d'un côté, elles concernent l'autorégulation de la lecture<br />
(adaptation de sa lecture à la nature du texte, adaptation du rythme de lecture en fonction des difficultés<br />
du texte ou de ce qui est raconté, va et vient entre les morceaux lus et l'ensemble du texte, entre ce qui est<br />
lu et le vécu et les connaissances encyclopédiques du lecteur, revenir en arrière, anticiper, inférer) ; de<br />
l'autre, elles sont liées à des obstacles présents dans les textes qu'il s'agit d'identifier afin de mettre en<br />
place les stratégies de régulation qui viennent d'être évoquées.<br />
CENAFFE / PREFSET 20<br />
P. JOOLE, 2007
APPRENDRE À COMPRENDRE<br />
Les questions de compréhension<br />
Le travail sur la compréhension en lecture dans la classe prend très souvent la forme d'un questionnaire<br />
oral ou écrit, ou les deux successivement. Les questions posées par les auteurs d'un manuel ou par<br />
l'enseignant à l'élève permet, selon la brochure de La maîtrise de la langue de développer les<br />
compétences en matière de compréhension fine, cette «capacité d'utiliser le texte pour le dépasser». Il est<br />
cependant bien précisé qu'il ne s'agit pas de questions portant sur la surface du texte et dont la réponse ne<br />
consisterait qu'en un recopiage de phrases du texte, mais de questions «dont la réponse n'est pas<br />
littéralement formulée dans le texte et doit donc être inférée à partir de celui-ci». Pourtant les programmes<br />
de 2002 expliquent que «laisser les élèves fréquenter des fichiers de lecture qui ne prévoient, comme<br />
seule intervention didactique, que le contrôle des réponses faites à un questionnaire ne sauraient en ce cas<br />
suffire». Cette contradiction légitime l'interrogation de Goannach et Fayol dans leur ouvrage Apprendre à<br />
comprendre : faut-il poser des questions dans les textes pour en améliorer la compréhension ?<br />
Goannach et Fayol concluent, à partir d'expériences réalisées par Van den Broek et ses collaborateurs,<br />
«que l'impact des questions varie très sensiblement en fonction du niveau scolaire et de l'âge des enfants».<br />
Pour les élèves de CM1, la conclusion est que «la présence de questions diminue très fortement les<br />
performances». De plus les questions attirent l'attention des élèves sur des éléments présents dans les<br />
questions et uniquement ceux-là. Chaque enseignant sait bien que ce sont les élèves qui ont déjà compris<br />
le texte qui répondent correctement aux questions. De plus, il est possible de n'avoir pas compris le texte<br />
dans son ensemble et de répondre tout de même aux questions en allant chercher dans le texte le mot ou<br />
les phrases contenus dans la question et de recopier la ou les phrases du texte correspondantes en guise de<br />
réponse.<br />
Dispositif très aléatoire d'évaluation et non d'apprentissage de la compréhension, les questions sur un<br />
texte ont une incidence sur la conception même que les élèves se font de la lecture et de la compréhension<br />
d'un texte.<br />
R.Goigoux note au cours d'un entretien publié dans La lettre de l'éduction (13 novembre 2000) que les<br />
élèves de Segpa considèrent que comprendre c'est répondre à des questions et qu'ils n'imaginent donc pas<br />
reformuler le texte avec leurs mots à eux. Un constat comparable est fait par M.C.Guernier et A.Rouxel<br />
qui ont toutes deux mené une enquête auprès des élèves. La première fait le constat que répondre à des<br />
questions est pour les élèves plus important que lire le texte. Ils pensent même que l'écrivain a fait son<br />
texte de manière à ce que l'on puisse poser des questions dessus. Pour eux, «les questions ça sert à savoir<br />
le texte». Les lycéens interrogés par la seconde confondent eux aussi lecture et réponse à de questions. Ils<br />
sont persuadés que le sens du texte est volontairement dissimilé par l'auteur. Il ne faut donc pas s'étonner<br />
que, habitués à répondre à des questions sur un texte du CP à la terminale, les élèves soient «confortés<br />
dans l'idée que la compréhension n'est pas le fruit d'un processus autonome (auto-contrôlé) mais qu'elle<br />
est sous la dépendance d'une tutelle externe». On peut donc se dema nder avec l'auteur d'un dossier<br />
paru dans Les actes de lecture en décembre 2001(n°76, «Des questionnaires …») «Où est donc passé le<br />
texte ? ».<br />
Pourtant R. Goigoux semble penser en 2006 que « les questionnaires sont des tâches qui peuvent aider les<br />
élèves à mieux comprendre les textes » à la condition qu’ils ne soient pas passifs face aux questions et<br />
que celles-ci ne consistent pas en un repérage superficiel (identification du mot-clé de la question suivie<br />
du repérage dans le texte d’un indice en rapport avec ce mot-clé puis du recopiage de l’information<br />
trouvée). D’où une proposition commune avec d’autres auteurs pour apprendre aux élèves à poser des<br />
questions sur les textes, à prendre conscience que la question n’est pas toujours dans le texte et qu’elle<br />
exige un raisonnement. Pour ces auteurs, l’apprentissage de la compréhension passe par le développement<br />
de cette capacité à questionner les textes. Ce projet très séduisant et parfaitement cohérent est cependant<br />
spécifique. Il ne fait aucun doute que les élèves, grâce au processus décrit avec précision, apprendront à<br />
répondre à des questions et à en fabriquer à leur tour.<br />
P. JOOLE<br />
CENAFFE / PREFSET 21
OBJECTIFS<br />
Identifier les obstacles<br />
relatifs à la compréhension<br />
pour les surmonter<br />
Proposer des pistes<br />
d’approche pour aplanir ces<br />
difficultés<br />
Journée Journée Journée 2<br />
2<br />
SUPPORTS ET<br />
CONTENUS<br />
Les types d'obstacles<br />
rencontrés dans le<br />
traitement d’un texte<br />
Documents théoriques à<br />
distribuer<br />
Textes choisis dans et hors<br />
des manuels scolaires<br />
CENAFFE / PREFSET 22<br />
MODALITES<br />
Travail collectivement sur<br />
plusieurs textes à raison d'un<br />
texte par obstacle<br />
Exercices à partir de textes:<br />
lecture individuelle,<br />
commentaire collectif.<br />
Lecture du document<br />
théorique distribué, réflexions
1/- Tour de table :<br />
Réflexion: Qu'est-ce que comprendre ?<br />
Ordre Ordre du du jour<br />
jour<br />
Commentaire du tableau résumant le processus de compréhension.<br />
2/- Travail sur des textes :<br />
Relever dans les textes proposés ce qui fait obstacle à la compréhension.<br />
Travail en deux temps :<br />
- Travail collectif, le grand groupe, sur quelques textes.<br />
- Travail par petits groupes sur d'autres textes.<br />
3/- Echange et mise au point :<br />
- Comment repérer les obstacles liés à la compréhension ? Comment les traiter<br />
avec l'élève ?<br />
- Comment aplanir ces difficultés ? Comment faire acquérir à l’élève des<br />
stratégies de lecture ?<br />
CENAFFE / PREFSET 23
I I / / Tour Tour de de de table<br />
table<br />
Déroulement<br />
Déroulement<br />
Déroulement<br />
Donner la parole aux enseignants pour qu’ils rendent compte de leurs lectures (faites en non<br />
présntiel).<br />
Puis proposer le document 1 à lire et à commenter dans un souci de récapitulation.<br />
Poser la question :<br />
Qu'est-ce qui fait obstacle à la compréhension ?<br />
Noter au tableau les problèmes et les obstacles que les enseignants citeront.<br />
II II / / Travail Travail sur sur des des texte textes texte<br />
Proposer des textes aux enseignants et essayer de dégager les obstacles liés à la compréhension<br />
qu'ils présentent.<br />
Procéder en deux temps :<br />
Premier temps :<br />
Une réflexion collective et rapide avec le grand groupe.<br />
→ travail sur des extraits choisis essentiellement pour illustrer des difficultés précises dans le but<br />
d'entraîner les enseignants à repérer les obstacles à la compréhension.<br />
Pour chaque extrait proposé, dégager l'obstacle majeur et vérifier s'il est déjà noté au tableau,<br />
sinon l'ajouter à la liste.<br />
[ 12 textes à proposer aux enseignants ]<br />
Deuxième temps :<br />
Des textes à observer par petits groupes ou individuellement.<br />
→ textes pris dans les nouveaux manuels (7 ème année de base, 1 ère , 2 ème et 3 ème année secondaire)<br />
7 ème de base : A table, de Francesca Simon, p.40<br />
Métro, de Bernard Friot, p. 72<br />
Gare à l’homme, de Daniel Pennac, p. 140<br />
L’enfant et l’arbre, d’Yves Labat, p. 157<br />
1 ère année secondaire : Un enfant venu d’ailleurs, d’Antoine de Saint-Exupéry, p. 15<br />
Quelle carrière ? de Jean L’Hote, p. 81<br />
2 ème année secondaire : Il pleut, Francis Carco,p.46<br />
Une existence exemplaire, Roger Martin du Gard, p. 195<br />
Sur les routes du monde, de Gilbert Cesbron, p. 244<br />
3 ème année (scientifiques) : Si j’étais Jupiter, de Ronsard, p. 109<br />
L’éternel masculin et l’éternel féminin, de Jean Rostand,<br />
p. 142<br />
Littérature et cinéma, de Simone de Beauvoir, p.273<br />
3 ème année (littéraires) : Appartenance, de Jules Vallès, p. 250<br />
Texte sans titre, de Simone de Beauvoir, p. 257<br />
CENAFFE / PREFSET 24
III III III / / Echange Echange et et mise mise au au au poin point poin t<br />
Etape Etape 1<br />
1<br />
Les groupes présentent le résultat de leur réflexion sur les textes proposés.<br />
⇒ Echange autour de ces textes.<br />
Partir de ce qui est noté au tableau et réfléchir sur la nature des obstacles en vue de les<br />
classer.<br />
⇒ difficultés à se repérer :<br />
dans le système des personnages<br />
→ textes 4 & 12<br />
dans leur parcours, leur déplacement<br />
→ textes 2 & 3 & 6<br />
dans leur désignation<br />
→ textes 7<br />
dans le temps du texte (temps du récit, temps symbolique, temps de l’action)<br />
→ textes 5 & 8<br />
dans l’espace du texte (réel ou symbolique)<br />
→ textes 11<br />
dans le système d’énonciation<br />
→ textes 1 & 9 & 10<br />
L’élève peut également rencontrer des difficultés :<br />
pour traiter les obstacles d’un texte<br />
de conceptualisation face à l’abstrait d’un texte<br />
pour hiérarchiser<br />
….<br />
Projeter le transparent (document 2) et récapituler avec les collègues les obstacles liés à la<br />
compréhension.<br />
Distribuer le tableau récapitulatif de P. Joole (document 3)<br />
Etape Etape 22<br />
2 2<br />
Prendre appui sur les textes travaillés dans le deuxième moment de la séance pour essayer<br />
de voir comment faire pour aplanir ces difficultés.<br />
Réfléchir sur les possibilités dont dispose l'enseignant pour essayer de trouver des activités<br />
de remédiation puis proposer quelques stratégies (document 4)<br />
Proposer deux illustrations de l’une des stratégies présentées, appliquée à deux textes:<br />
La métamorphose d’actéon<br />
Comme une bête<br />
Le deuxième texte est pris dans le manuel de 7 ème année de base. Une fiche<br />
l’accompagne. Elle a été expérimentée en situation de classe.<br />
CENAFFE / PREFSET 25
Etape Etape 3<br />
3<br />
Attirer l’attention sur l’importance de la mise en réseau des textes comme moyen de<br />
faciliter la compréhension.<br />
Exemple : Les textes Les Grillons de Lobel et le texte p.103, rubrique Lire/Rire peuvent<br />
être mis en réseau dans la mesure où le deuxième prépare la compréhension du premier,<br />
les deux textes présentant la même difficulté.<br />
(Les deux textes se suivent ci-dessous dans la partie Supports textuels).<br />
Etape Etape 4<br />
4<br />
Proposer les textes 7 & 8, et introduire le principe de coopération du lecteur<br />
TEXTE<br />
CENAFFE / PREFSET 26<br />
CASE VIDE<br />
BLANC<br />
Comment un lecteur fait-il pour remplacer les blancs dans un texte ?<br />
Il fait acte d'inférence.<br />
TEXTE<br />
→ Amener l'élève à faire le lien, l'inférence, c'est à dire une mise en relation pour<br />
expliciter l'implicite.<br />
Lire, c'est lier = amener l'élève à lier, relier le fait et la conséquence, le sentiment et<br />
l'endroit, relier des morceaux du texte.<br />
Une règle pédagogique : Donner les moyens de mémoriser ce qui a été lu, de tenir en<br />
mémoire ⇒ résumer, reformuler pour s’approprier le texte.<br />
Le lecteur prélève des indices et les met en relation les uns avec les autres (ce que les<br />
élèves ne savent pas faire automatiquement).<br />
Il est indispensable de recourir à des stratégies de lecture et lire c'est prendre plaisir :<br />
⇒ Plaisir de construire le sens<br />
⇒ Plaisir de pénétrer dans le texte<br />
⇒ Plaisir de comprendre de façon autonome<br />
⇒ Plaisir d'établir des liens, de faire des inférences<br />
Il y a essentiellement deux sources de plaisir en lecture :<br />
1- Le plaisir d’identification (plus immédiat), le plaisir de l’illusion référentielle, de la<br />
mise à distance du texte. Et ce plaisir est souvent oublié.<br />
2- Le plaisir de maîtriser du texte. C’est la source que les enseignants privilégient.
Récapitulation<br />
Récapitulation<br />
Récapitulation<br />
Les compétences relatives à la lecture de textes littéraires courts :<br />
• Comprendre la situation d’énonciation, ses enjeux, sa dynamique<br />
• Traiter l’implicite et ses ambiguïtés<br />
Faire des déductions et des inférences.<br />
Et une question se pose d’elle-même : qu’est-ce que l’inférence ?<br />
« L'inférence est le processus par lequel on arrive à une conclusion en partant de<br />
prémisses. C'est un phénomène essentiel dans la compréhension des textes. L'inférence<br />
joue son rôle par exemple dans les associations inter phrastiques. Le lien entre deux<br />
phrases contiguës peut être implicite et laissé à l'interprétation du lecteur. Au contraire,<br />
l'inférence peut être guidée par la présence de connecteur logico-temporel (ainsi, aussi,<br />
donc, alors…) qui viennent faciliter l'établissement du lien désiré par l'auteur. L'inférence<br />
opère alors entre la mémoire discursive du lecteur nourrie par l'amont du texte et ses<br />
connaissances encyclopédiques d'une part et les éléments linguistiques nouveaux apportés<br />
par la nouvelle phrase d'autre part ».<br />
Dictionnaire de didactique du français langue seconde et langue étrangère, CLE international.<br />
INFERER : Tirer une conséquence d'une proposition, d'un fait.<br />
Du latin inferre "être la cause de"<br />
INFERENCE : raisonnement consistant à admettre une proposition du fait de sa liaison<br />
avec d'autres propositions antérieurement admises.<br />
LES INFERENCES<br />
CENAFFE / PREFSET 27<br />
Dictionnaire Hachette encyclopédique<br />
La plupart des ouvrages théoriques traitant de la question de la compréhension en<br />
lecture se sont attachés aux inférences. Cette opération qui consiste à faire des liens a fait<br />
l'objet de classifications permettant d'élaborer des stratégies d'entraînement. Retenons<br />
simplement qu'il existe fondamentalement deux types d'inférences : celles qui consistent à<br />
mettre en relation plusieurs parties et différentes informations d'un texte (inférences<br />
logiques ou de liaison) et celles consistant à relier les informations du texte aux<br />
connaissances du lecteur (inférences pragmatiques ou interprétatives). Il est effectivement<br />
possible d'entraîner les élèves à effectuer des inférences mais le problème est qu'en lecture<br />
tout est inférence, que lire consiste à inférer sans cesse. Apprendre à lire c'est<br />
effectivement apprendre à inférer mais le programme est tellement vaste qu'il est<br />
impossible de palier aux difficultés précises des élèves par un programme qui consisterait<br />
à s'entraîner à repérer la totalité des inférences. Cependant la nature des différentes<br />
inférences, les résultats des évaluations nationales et les recherches en didactique<br />
permettent d'identifier des critères de complexité des textes qui sont autant d'obstacles<br />
pour un lecteur débutant.<br />
P. JOOLE, 2007
Activité Activité en en en non non présentiel présentiel :<br />
Distribuer six textes que les enseignants auront à lire, à classer selon leur degré<br />
d’accessibilité et proposer éventuellement le niveau auquel ils peuvent s’adapter.<br />
Textes à proposer :<br />
1- Victor Hugo, Melancholia (Manuel 3 ème année Lettres, p.64)<br />
2- Gérard de Nerval, El Desdichado (Manuel 3 ème année Lettres, p.115)<br />
3- Gogol (voir ci-après)<br />
4- Pierre Coran, Magma (voir ci-après). Texte à proposer d’abord sans titre<br />
5- Cortazar (voir les textes de la journée 2)<br />
6- Maupassant (voir les textes de la journée 2)<br />
( voir annexe )<br />
CENAFFE / PREFSET 28
ANNEXE JOURNEE 2<br />
Des documents pour le formateur.<br />
Des documents pour le formé<br />
Les textes supports de la journée<br />
La fiche de lecture à proposer<br />
Les textes supports de la journée 3<br />
CENAFFE / PREFSET 29
Résumé du processus de compréhension<br />
1- Mobiliser des connaissances :<br />
- sur l'acte de lire<br />
- linguistiques pour traiter les marques linguistiques (ponctuation,<br />
connecteurs, marques référentielles)<br />
- encyclopédiques<br />
- stratégiques<br />
2- Réguler sa lecture<br />
- concernant le traitement du texte : traiter localement au fur et à mesure,<br />
mémoriser ce qui a été lu, faire des va et vient entre le traitement local du<br />
texte et l'ensemble du texte<br />
- concernant le rythme de lecture : ralentir, faire des pauses, revenir en arrière,<br />
anticiper<br />
- inférer : relier les informations du texte entre elles ; relier les informations<br />
du texte avec les connaissances du lecteur<br />
3- Identifier des obstacles spécifiques et les surmonter<br />
4- Comprendre l'utilité de recourir à ces stratégies et comprendre<br />
que le lecteur est l'agent de sa propre réussite<br />
CENAFFE / PREFSET 30
QUELQUES POSSIBILITES D’EXPLOITATION<br />
POUR UNE ENTREE DANS LE TEXTE<br />
1/- Relever des indices, c'est revenir en arrière, relire, faire des liens.<br />
→ Comment guider l'élève pour qu'il effectue un relevé, pour qu'il relie les mots entre eux<br />
et donc revenir au texte.<br />
L'enseignant doit faire preuve d'imagination : comparaison, référence avec le réel.<br />
Dans un premier temps, faire le relevé à la place de l'élève, relier les indices une couleur<br />
par compétence.<br />
Changer la forme de l'activité : remettre de l'ordre dans des illustrations et rédiger un petit<br />
résumé de la séquence narrative. Présenter une fiche auto corrective, l'objectif étant de<br />
mettre en mémoire.<br />
2/- Emettre des hypothèses (ou éventuellement résumer le texte oralement ou par<br />
écrit), faire des dessins… et valider en donnant la suite ou par la parole du professeur.<br />
Mais ne jamais mélanger les obstacles. Il faut décomposer les compétences de<br />
compréhension et revenir à une vraie lecture à la fin.<br />
3/- Suivre le déplacement du (ou des) personnage(s): lire une phrase et tracer<br />
le parcours → avancer pas à pas avec le texte : le parcours de lieu en lieu à la manière des<br />
Song line (le chant des pistes).<br />
Lire en suivant une trajectoire → par référence aux textes antiques : les textes dans les<br />
grottes.<br />
Le parcours du personnage : structure typographique avec un schéma de trajet, ce qui<br />
compte, c'est où va le personnage.<br />
4/- Prélever le champ lexical<br />
Visualiser, prélever des mots + faire appel à son vécu personnel, à ses connaissances<br />
antérieures, à sa culture et à ses représentations.<br />
Privilégier l'interaction entre ses connaissances préalables et les nouvelles connaissances<br />
acquises.<br />
Faire des recoupements pour définir de quoi parle le texte.<br />
5/- Identifier les actants<br />
Reconstituer une chaîne de substituts permettant de repérer les dénominations d'un actant<br />
Dresser la liste des personnages et expliciter les relations qui les lient.<br />
CENAFFE / PREFSET 31
Une première interrogation a trait au caractère global ou local de l'effet. Soit la facilitation est globale : en augmentant<br />
l'attention que les lecteurs consacrent à l'ensemble des liaisons causales, la compréhension du texte entier se trouve améliorée.<br />
Soit l'amélioration porte sur les seules liaisons qui font l'objet de questionnement, cela en raison de l'encodage différentiel des<br />
différentes informations. La performance en compréhension dépendrait alors de l'attention spécifiquement affectée a<br />
telle ou tette information.<br />
Une deuxième interrogation concerne la position des questions. Au cours de la lecture, l'attention change continuellement<br />
de focus, passant d'un segment au suivant. La présence de questions influerait sur la distribution de l'activation au cours de la<br />
lecture. Par contraste, les questions posées après lecture auraient un moindre intérêt car les lecteurs ont déjà construit leur<br />
représentation et sont moins en mesure de la modifier.<br />
Une troisième interrogation vise à déterminer si les effets sont les mêmes selon le niveau des élèves. Premièrement, chez<br />
les plus jeunes, la moindre automatisation du traitement du code (décodage, accès lexical, etc.) laisse moins d'attention<br />
disponible pour la compréhension et entre de ce fait en compétition avec les processus impliques dans l'élaboration de la réponse<br />
aux questions, par exemple la génération d'inférences. Deuxièmement, les plus jeunes encore sont moins sensibles aux relations<br />
entre buts super ordonné et subordonnés, aussi bien qu'ils ont des difficultés à identifier les thèmes. Ils sont donc moins habiles<br />
à détecter les relations globales dans les narrations, alors que celles-ci semblent repérées de manière routinière par les adultes. Les<br />
deux facteurs précédemment évoqués limitent d'autant les interrelations et la cohérence des représentations construites. II s'ensuit<br />
que l'effet des questions pourrait varier de manière sensible en fonction du niveau scolaire des enfants. Van den Broek et ses<br />
collaborateurs soumettent des récits à des enfants de 10, 13, 16 ans et à des étudiants. Ces récits comportent un personnage<br />
central cherchant à atteindre un but super ordonnè en satisfaisant des buts successifs subordonnés. Ces récits sont présentés à l'écrit<br />
(lecture) sous trois conditions : sans (condition dite contrôle) ou avec questions (14), ces dernières apparaissant soit en<br />
fin soit dans le cours même du texte. Les participants lisent le texte et répondent aux questions puis doivent fournir<br />
ultérieurement un rappel du texte. En d'autres termes, les auteurs évaluent l'impact des questions sur la compréhension en<br />
faisant appel à une épreuve de remémoration du texte. Le raisonnement est que le rappel sera d'autant meilleur que la<br />
compréhension en sera élevée.<br />
Les participants rappellent d'autant plus d'informations issues du texte qu'ils sont âgés (25 %, 42 %, 50 % et 57 %<br />
respectivement pour les CM1, Cinquième, Seconde et étudiants). Les rappels ne diffèrent pas entre la condition contrôle<br />
(pas de questions) et la condition questions insérées dans le texte, ces deux conditions donnant de meilleurs résultats que la<br />
condition questions en fin.<br />
L'effet de la position des questions interagit avec le niveau scolaire. Nous ne rapportons ici que les données des plus<br />
âgés et des plus jeunes. Les étudiants bénéficient des questions en cours de lecture par rapport aux questions en position finale<br />
et à la condition contrôle. Par contraste, en CM1, la présence de questions diminue tres fortement les performances. En d'autres<br />
termes, la seule amélioration des performances apparaît chez les étudiants avec les questions dans le cours même du texte.<br />
Quant aux effets négatifs, ils sont marqués avec les plus jeunes. Par ailleurs, pour les seuls lecteurs compétents, l'effet positif des<br />
questions se manifeste exclusivement sur les informations qui leur sont associées. En d'autres termes, les questions orientent<br />
l’attention vers les informations cibles des questions et seulement celles-là<br />
En résumé, le niveau détermine à la fois l'effet positif ou négatif de la présence de questions et l'intensité de cet effet. Ces<br />
résultats suggèrent que la mémoire de travail et/ou la gestion des ressources attentionnelles ont un rôle majeur. Ils montrent que les<br />
questions peuvent être utilisées pour orienter l'encodage de certains types d'informations. Toutefois, leur impact est très<br />
dépendant du niveau ou de l’âge.<br />
Fayol M., Le récit et sa construction : une approche de psychologie cognitive, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1985.<br />
Fayol M., « Comprendre et produire des textes Ecrits : l ' exemple du récit », in Kail M. et Fayol M. (Eds.), L'acquisition du<br />
langage. Le Langage en développement : au-delà de trois ans, PUF, 2000.<br />
Van den Broek P.Risden K.,TzengY.,Trabasso T. et Basche P. (à paraître), « Inferential questioning : effects on<br />
comprehension of narrative textes as a function of grade and timing », Journal of Educational Psychology.<br />
CENAFFE / PREFSET 32<br />
F A U T - I L P O S E R D E S Q U E S T I O N S<br />
DANS LES TEXTES POUR EN AMELIORER<br />
LA COMPREHENSION ?
Document 1<br />
Processus de compréhension<br />
Avant la lecture<br />
• Reconnaître et comprendre la situation.<br />
• Construire un univers de référence (créer le monde de l’histoire).<br />
• Reconnaître et comprendre certains éléments textuels.<br />
• Emettre des hypothèses sur l’activité.<br />
• Créer un horizon d’attente.<br />
• Mobiliser des connaissances.<br />
Pendant la lecture<br />
• Traiter la chaîne sonore lue et entendue.<br />
• Traiter les inférences.<br />
• Mémoriser des informations, résumer des parties, faire des retours en<br />
arrière, ralentir la vitesse de lecture sur certains passages...<br />
• Intégrer de nouvelles informations : les interpréter localement puis les<br />
mettre en cohérence avec ce qui a été mémorisé (va et vient entre ce qui<br />
est en mémoire et ce qui est en cours de traitement).<br />
Après la lecture<br />
⇒ Evaluer sa compréhension<br />
( dessiner, jouer, choisir le meilleur résumé, trouver un titre, retrouver une<br />
histoire parmi plusieurs, reformuler, rappeler, jouer sur les changements de<br />
points de vue ( l’enseignant lit à deux groupes différents la même histoire vue<br />
de deux points de vue puis chacun des groupes se raconte l’histoire)...)<br />
CENAFFE / PREFSET 33
Document 2<br />
OBSTACLES A LA COMPREHENSION<br />
• Composantes de l'énonciation : 1) Qui parle ?<br />
Qui raconte ?<br />
2) D'où ?<br />
3) Quand ?<br />
• Actants : 1) Dénomination<br />
2) Caractérisation<br />
3) Relations<br />
• Cohérences : 1) Chronologie<br />
2) Parcours<br />
3) Autres (entrelacement,…)<br />
• Rapport logiques : 1) Causalité<br />
2) Opposition, concession<br />
3) Hypothèse, condition<br />
• Hiérarchisation : 1) Idées<br />
2) Evénements<br />
3) Personnages<br />
CENAFFE / PREFSET 34
Document 3<br />
Des activités au service des compétences textuelles<br />
Nous proposons dans le tableau ci-dessous de mettre en regard les compétences appartenant aux cinq<br />
domaines textuels que nous jugeons essentiels après notre regard sur les performances des élèves lors des<br />
évaluations. Chaque case du tableau peut ainsi être complétée en fonction des idées d'activités des<br />
collègues enseignants.<br />
Chacune des cinq domaines de compétences textuelles dégagées constituent autant de directions à suivre<br />
pour le choix des textes qui serviront de supports au travail des élèves. L'enseignant peut ainsi choisir son<br />
corpus de textes en fonction de la compétence qu'il souhaite faire acquérir par les élèves.<br />
Il convient de noter la place particulière accordée à l'identification du cadre spatio-temporel qui est<br />
incontournable quel que soit le texte ou la compétence qu'il a été décidé par ailleurs de travailler.<br />
Chacune des compétences textuelles présentes dans le tableau récapitulatif peut être traduite en termes<br />
d'obstacle à surmonter («je n'ai pas compris le texte car je n'ai pas identifié les actants et n'ai donc pas pu<br />
visualiser mentalement ceux-ci») : simple question de point de vue ! L'enseignant peut ainsi déterminer<br />
en connaissance de cause l'objectif d'une activité précise. Le texte n'a donc pas été choisi de manière<br />
aléatoire mais en fonction d'une intention précise. C'est la définition préalable du domaine de compétence<br />
textuelle qui détermine donc le choix de tel ou tel texte. Chaque activité devra ensuite être traduite en<br />
termes de consignes.<br />
Enfin, les stratégies que les élèves n'ont pas su mettre en place ou auxquelles ils ont eu recours de manière<br />
inconsciente au cours des activités pourront être élucidées et explicitées lors de la correction avec<br />
l'ensemble de la classe de l'exercice.<br />
Il est à noter que l'entrée par les compétences textuelles exclut la priorité à donner au travail sur les<br />
déficits spécifiques au traitement du texte écrit et liés à une mauvaise régulation de l'activité de lecture.<br />
Ces obstacles à la compréhension peuvent paraître hybrides car mêlant repérage et éléments d'un texte<br />
(actants par exemple) et stratégies pour mieux comprendre (hiérarchiser par exemple). Ils relèvent à la<br />
fois de la grammaire textuelle, de la grammaire de l'énonciation, de l'analyse narratologique ou d'une<br />
grammaire plus sémantique et prennent en compte des difficultés ayant des origines diverses car liées à<br />
d'insuffisantes compétences linguistiques ou textuelles ou liées tantôt aux micro-traitements tantôt aux<br />
macro-traitements.<br />
Ce caractère hybride s'explique par le fait qu'ils ont été dégagés à partir de constats faits dans les classes<br />
et après un dialogue permanent avec les enseignants et un suivi attentif des performances des élèves.<br />
L'analyse et la réflexion théorique ne sont intervenus dans un second temps que pour étayer les constats<br />
pragmatiques.<br />
L'examen attentif de ces obstacles et surtout le fait de les avoir pris en compte pour élaborer des stratégies<br />
de remédiation et d'apprentissage a révélé des constantes. Pour surmonter ces obstacles, les élèves sont en<br />
effet obligés de mettre en place des traitements et des stratégies presque identiques. Pour reconstituer une<br />
chaîne de substituts permettant de repérer les dénominations d'un actant, pour identifier l'énonciateur,<br />
caractériser le cadre spatio-temporel, identifier une cohérence ou hiérarchiser, le lecteur doit, après avoir<br />
relevé divers indices dans le texte, les relier entre eux : il s'agit bien là d'un jeu d'inférences qui nécessite<br />
une capacité à localiser les informations pertinentes, à les relier entre elles. Identifier des actants ou<br />
repérer les indices d'une cohérence topographique suppose en outre que les lecteurs soient capables de<br />
réaliser simultanément des traitements locaux (décoder les groupes de mots ou les phrases se rapportant à<br />
l'actant en question ou ceux révélateurs de la cohérence dont il est question)) et des traitements globaux<br />
permettant de repérer les éléments essentiels d'un texte ou de comprendre son organisation globale.<br />
CENAFFE / PREFSET 35<br />
P. JOOLE, 2007
Tâches<br />
Compétences textuelles<br />
Identifier la situation<br />
d'énonciation :<br />
- Qui parie ? Qui raconte ?<br />
- A qui ?<br />
- D' où ?<br />
- A quel moment ?<br />
Identifier les actants :<br />
- Quelles dénominations ?<br />
- Quelles caractérisations ?<br />
- Quelles relations entre eux ?<br />
Relever<br />
Repérer<br />
Les indices<br />
permettant<br />
d'identifier :<br />
Relier<br />
Etablir un<br />
lien<br />
Relier entre<br />
eux les<br />
indices<br />
relatifs à la<br />
CENAFFE / PREFSET 36<br />
Remettre<br />
dans l'ordre<br />
Remettre dans .<br />
l'ordre un<br />
dialogue<br />
Répondre<br />
en justifiant<br />
A l’oral<br />
Ecrire<br />
Rédiger<br />
Transpose<br />
r<br />
au<br />
discours<br />
indirect<br />
L'énonciateur situation Introduire<br />
et le d'énonciation<br />
dans un<br />
destinataire<br />
dialogue le<br />
nom du<br />
Le lieu<br />
locuteur suivi<br />
d’énonciation<br />
-<br />
d'un verbe de<br />
parole<br />
Le moment<br />
d' énonciation<br />
Les thèmes<br />
et les reprises<br />
Les éléments<br />
de portrait<br />
Des extraits<br />
significatifs<br />
La chaîne des<br />
substituts<br />
Schéma<br />
actanciel<br />
Toute<br />
question sur<br />
les actants<br />
Rédiger<br />
quelques<br />
éléments de<br />
portrait<br />
Réécrire un<br />
texte<br />
descriptif en<br />
changeant le<br />
point de vue<br />
Dessiner le<br />
personnage<br />
Identifier la cohérence : Les Reconstituer Remettre un Rappeler . Rappeler un<br />
connecteurs la trame texte dans L’histoire ou épisode<br />
et chronologique l'ordre faire anticiper supplémentaire<br />
- De type chronologique indicateurs Sur un axe,, chronologique la suite<br />
de lieu, de un<br />
Changer<br />
- De type topographique<br />
- Autre<br />
temps. un plan. L’ordre d'un<br />
parcours<br />
Identifier la logique Les Entre deux Des Compléter<br />
'<br />
d’enchaînement des<br />
connecteurs,<br />
la silhouette<br />
phrases syntagmes<br />
pour<br />
une phrase,<br />
faits ou des évènements : du texte. construire une Reformuler<br />
- de cause à conséquence<br />
- d’opposition /de concession<br />
E x t r a i r e<br />
des phrases<br />
significatives<br />
et les classer.<br />
phrase, des<br />
phrases pour<br />
construire un<br />
court texte<br />
Pourquoi ? une phrase, un<br />
Avec quelles court texte.<br />
Conséquences ?<br />
- d’hypothèse / de condition<br />
Hiérarchiser :<br />
- des idées<br />
- des évènements<br />
- des actants<br />
Les relever<br />
ne compétence textuelle liée à chacune des compétences :<br />
Identifier le cadre spatio-temporel<br />
Un court texte<br />
Et si... ?<br />
Questionner a<br />
l’oral.<br />
Résumer<br />
Rédiger un<br />
titre<br />
Dire<br />
Théâtrali-<br />
ser<br />
Un<br />
dialogue ou<br />
un<br />
monologue<br />
Mimer un<br />
personnage<br />
Interpréter un<br />
extrait après<br />
écriture<br />
transcodée<br />
U
5 stratégies : inférer, revenir en arrière/anticiper, mémoriser, résumer/reformuler, clarifier<br />
Document 4<br />
STRATEGIES ET ACTIVITES DE CLASSE POUR RESOUDRE LES<br />
PROBLEMES LIES À LA COMPREHENSION<br />
Les travaux de Goannach, Fayol, Sèbe et Goigoux ont permis de dégager 7 stratégies qui peuvent donner<br />
lieu à la définition de directions pouvant être suivies pour l'élaboration de dispositifs ou d’activités de<br />
remédiation.<br />
1- Résumer / Synthétiser: cela consiste à extraire les éléments les plus importants d'un ensemble<br />
textuel (idées principales d'un texte informatif ou explicatif, événements principaux d'un récit,…).<br />
Cette stratégie peut faire l'objet de comparaisons de résumés pour choisir le plus adéquat, de<br />
recherche d'un titre, d'activité de production (résumés intermédiaires ou finaux sous la forme d'une<br />
ou de plusieurs phrases)<br />
2- Reformuler : avec ses propres mots, l'élève redit ou réécrit le texte et manifeste ainsi ce qu'il a<br />
perçu.<br />
3- Anticiper : il s'agit de prédire ou prévoir ce que le texte va proposer au lecteur. Pour ce faire le<br />
lecteur doit relever des indices et les mettre en relation.<br />
4- Inférer : cela consiste à mettre en relation plusieurs éléments du texte ou relier les éléments du<br />
texte avec ses connaissances et son expérience du monde. Cette stratégie permet de traiter autant<br />
l'implicite que l'explicite du texte.<br />
5- Interpréter : les inférences facilitent l'expression d'un avis personnel sur la signification du texte.<br />
L'interprétation est le résultat d'un processus d'appropriation voire d'identification. L'enseignant<br />
peut alors demander aux élèves ce qu'ils pensent de l'action de tel personnage. L'interprétation<br />
concerne avant tout les textes littéraires.<br />
6- Questionner : élaborer des questions sur un texte en évitant qu'elles ne concernent que la surface<br />
du texte ou des détails sans importance pour sa compréhension globale.<br />
7- Clarifier : il s'agit pour l'élève de s'interroger sur sa compréhension et sur les obstacles qu'il<br />
rencontre.<br />
Ces stratégies fondamentales peuvent être immédiatement traduites en termes d'activité de classe de sorte<br />
qu'il est difficile de distinguer ce qui relève de l'une ou de l'autre. Ainsi un enseignant convaincu que<br />
résumer est indispensable pour comprendre, peut demander à ses élèves de résumer au moyen d'un mot,<br />
d'une ou de plusieurs phrases du texte. La consigne elle-même peut reprendre exactement les termes<br />
utilisés pour définir l'activité : «Résumez ce texte en une phrase».<br />
De plus, il est difficile face à la réalité d'une situation de classe ou d'une autre action de formation<br />
d'enseignants de traduire une réflexion sur les stratégies en termes d'activités, de tâches ou de consignes<br />
pour les élèves. C'est pourquoi nous avons décidé de prendre comme point de départ de notre réflexion<br />
didactique et des propositions pédagogiques qui en découlent les déficits spécifiques du traitement du<br />
texte liés à d'insuffisantes compétences textuelles. Nous excluons de notre dispositif les pistes pour<br />
remédier aux déficits généraux liés à la compréhension du langage, qu'il s'agisse des dysfonctionnements<br />
cognitifs relatifs à des problèmes de mémorisation, concentration, attention ou raisonnement, ou liés au<br />
manque de connaissances du lecteur pour comprendre tel ou tel texte. Notre objectif est de sensibiliser les<br />
élèves au fait que pour comprendre il faut porter une attention particulière aux cinq aspects du texte<br />
dégagés et de leur proposer des activités liées à des stratégies plus générales. Relever des indices textuels<br />
concernant l'un des cinq domaines puis les mettre en relation pour produire un écrit permet aux élèves<br />
d'apprendre à inférer puis, dans le cas d'un texte littéraire à interpréter.<br />
CENAFFE / PREFSET 37<br />
P. JOOLE, 2007
CENAFFE / PREFSET 38
Texte 1 : MAUPASSANT<br />
On remonta sur le pont après dîner. Devant nous, la Méditerranée n'avait pas un frisson sur<br />
toute sa surface qu'une grande lune calme moirait. Le vaste bateau glissait, jetant sur le ciel, qui<br />
semblait ensemencé d'étoiles, un gros serpent de fumée noire; et, derrière nous, Pearl<br />
toute blanche agitée par le passage rapide du lourd bâtiment, battue par l'hélice, moussait,<br />
semblait se tordre, remuait tant de clarté qu'on eût dit de la lumière de lune bouillonnant.<br />
Nous étions 1à, six ou huit, silencieux, admirant, l'œil tourné vers l'Afrique lointaine où nous<br />
allions. Le commandant, qui fumait un cigare au milieu de nous, reprit soudain la conversation du<br />
dîner.<br />
«Oui, j'ai eu peur ce jour-là. Mon navire est resté six heures avec ce rocher<br />
dans le ventre, battu par la mer. Heureusement que nous avons été recueillis, vers le soir,<br />
par un charbonnier anglais qui nous aperçut.»<br />
CENAFFE / PREFSET 39
Texte 2 : Michel TOURNIER, Barbedor<br />
C'était un signe, une invite. Nabounassar tenant toujours la plume en équilibre<br />
sur sa paume, s'élança dans l'escalier du palais, sans répondre aux marques<br />
de respect dont le saluaient les courtisans et les domestiques qu'il croisait.<br />
Lorsqu'il se trouva dans la rue, au contraire, personne ne parut le<br />
reconnaître. Les passants ne pouvaient imaginer que cet homme sans barbe<br />
qui courait vêtu d'un simple pantalon bouffant et d'une courte veste, en<br />
tenant une petite plume blanche en équilibre sur sa main, c'était leur<br />
souverain majestueux, Nabounassar III. Etait-ce que ce comportement<br />
insolite leur paraissait incompatible avec la dignité du roi ? Ou bien autre<br />
chose, par exemple un air de jeunesse nouveau qui le rendait méconnaissable ?<br />
Nabounassar ne se posa pas la question — une question primordiale pourtant —<br />
trop occupé à garder la plume sur sa paume et à suivre ses indications.<br />
Il courut longtemps ainsi, le roi Nabounassar III — ou faut-il déjà dire<br />
l'ancien roi Nabounassar III ? Il sortit de Chamour, traversa des champs<br />
cultivés, se retrouva dans une forêt, franchit une montagne, passa un<br />
fleuve grâce à un pont, puis une rivière à gué, puis un désert et une autre<br />
montagne. Il courait, courait, courait sans grande fatigue, ce qui était<br />
bien surprenant de la part d'un homme âgé, corpulent et gâté par une vie<br />
indolente.<br />
Enfin il s'arrêta dans un petit bois, sous un grand chêne vers le sommet<br />
duquel la plume blanche se dressa verticalement. Tout la-haut, sur la dernière<br />
fourche, on voyait un amas de brindilles, et sur ce nid — car c'était un nid,<br />
évidemment — le bel oiseau Blanc qui s'agitait avec inquiétude.<br />
Nabounassar s'élança, saisit la branche la plus basse et d'un coup de<br />
reins se retrouva assis, puis tout de suite debout, et il recommença avec<br />
la deuxième branche, et il grimpait ainsi, agile et léger comme un écureuil.<br />
CENAFFE / PREFSET 40
Texte 3 : DELERM, Première gorgée de bière<br />
CENAFFE / PREFSET 41<br />
Le croissant du trottoir<br />
On s'est réveillé le premier. Avec une prudence de guetteur indien on s'est habillé,<br />
faufilé de pièce en pièce. On a ouvert et refermé la porte de l'entrée avec une<br />
méticulosité d'horloger. Voilà. On est dehors, dans le bleu du matin ourlé de rose : un<br />
mariage de mauvais goût s'il n'y avait le froid pour tout purifier. On souffle un nuage<br />
de fumée à chaque expiration : on existe, libre et léger sur le trottoir du petit matin.<br />
Tant mieux si la boulangerie est un peu loin. Kerouac mains dans les poches, on a tout<br />
devancé : chaque pas est une<br />
fête. On se surprend à marcher sur le bord du trottoir comme on faisait enfant, comme<br />
si c'était la marge qui comptait, le bord des choses. C'est du temps pur, cette<br />
maraude que l'on chipe au jour quand tous les autres dorment.<br />
Presque tous. Là-bas, il faut bien sûr la<br />
lumière chaude de la boulangerie — c'est du -néon, en fait, mais l'idée de chaleur lui<br />
donne un reflet d'ambre. Ii faut ce qu'il faut de buée sur la vitre quand on s'approche, et<br />
l'enjouement de ce bonjour que la boulangère réserve aux seuls premiers clients —<br />
complicité de l'aube.<br />
— Cinq croissants, une baguette moulée pas trop cuite !<br />
Le boulanger en maillot de corps fariné se montre au fond de la boutique, et vous<br />
salue comme on salue les braves à l'heure du combat.<br />
On se retrouve dans la rue. On le sent bien : la marche du retour ne sera pas la même. Le<br />
trottoir est moins libre, un peu embourgeoisé par cette baguette coincée sous un coude,<br />
par ce paquet de croissants tenu de l'autre main. Mais on prend un croissant dans le<br />
sac. La pâte est tiède, presque molle. Cette petite gourmandise dans le froid, tout en<br />
marchant : c'est comme si le matin d'hiver se faisait croissant de l'intérieur, comme si<br />
l'on devenait soi même four, maison, refuge. On avance plus doucement, tout imprégné<br />
de blond pour traverser le bleu, le gris, le rose qui s'éteint. Le jour commence, et le<br />
meilleur est déjà pris.
Texte 4 : George ORWELL, La ferme des animaux.<br />
Dans la journée, la rumeur s'était répandue que Sage l'Ancien avait été visité, au<br />
cours .de la nuit précédente, par un rêve étrange dont il désirait entretenir les autres<br />
animaux. Sage l'Ancien était un cochon qui avait été proclamé lauréat de sa catégorie. Il<br />
avait concouru sous le nom de Beauté de Willingdon, mais pour tout le monde il était Sage<br />
l'Ancien. II avait été convenu que tous les animaux se retrouveraient dans la grange dès que<br />
Mr. Jones se serait éclipse. Et Sage l'Ancien était si profondément vénère que chacun<br />
était prêt à prendre sur son sommeil pour savoir ce qu'il avait à dire.<br />
Lui-même avait déjà pris place à l’une des extrémités de la grange. II avait douze ans,<br />
et avec rage avait pris de l'embonpoint mais il en imposait encore, et on lui trouvait un air<br />
raisonnable, bienveillant même, malgré des canines intactes. Bientôt les autres animaux se<br />
présentèrent, et ils se mirent à l'aise, chacun suivant les lois de son espèce. Ce fut d'abord<br />
le chien Filou et les deux chiennes qui se nommaient Fleur et Constance, et ensuite les<br />
cochons qui se vautrèrent sur la paille. Les poules allèrent se percher sur des appuis de<br />
fenêtres et les pigeons sur les chevrons du toit. Vaches et moutons se placèrent derrière<br />
les cochons, et se prirent à ruminer. Puis deux chevaux de trait, Malabar et Douce, firent<br />
leur entrée. Ils avancèrent à petits pas précautionneux, posant avec délicatesse leurs<br />
nobles sabots sur la paille, de peur qu'une petite bête ou l'autre s'y est tapie. Douce était<br />
une superbe matrone entre deux ages qui, depuis la naissance de son quatrième poulain,<br />
n'avait plus retrouvé la silhouette de son jeune temps. Quant à Malabar- une énorme bête,<br />
forte comme n'importe quels deux chevaux. Une longue raie blanche lui tombait jusqu'aux<br />
naseaux, ce qui lui donnait un air un peu bêta; et, de fait, Malabar n'était pas génial.<br />
Néanmoins, chacun le respectait parce qu'on pouvait compter sur lui et Gull abattait une<br />
besogne fantastique. Vinrent encore Edmée, la chèvre blanche, et Benjamin, l’âne. Benjamin<br />
était le plus vieil animal de la ferme et le plus acariâtre. Peu expansif, quand il s'exprimait<br />
c'était en général par boutades cyniques. II déclarait, par exemple, que Dieu lui avait bien<br />
donné une queue pour chasser les mouches, mais qu'il aurait beaucoup préfère n'avoir ni queue<br />
ni mouches. De tous les animaux de la ferme, il était le seul à ne jamais rire. Quand on lui<br />
demandait pourquoi, il disait qu'il n'y a pas de quoi rire. Pourtant sans vouloir en convenir, il<br />
était l'ami dévoue de Malabar. Ces deux-la passaient d'habitude le dimanche ensemble,<br />
dans le petit enclos derrière le verger, et sans un mot broutaient de compagnie.<br />
CENAFFE / PREFSET 42
Texte 5 : Malika FERDJOUKH, Minuit Cinq, Ecole des loisirs<br />
De son côté, Minuit-Cinq ressassait son plan sur la manière de soutirer quelques florins à la princesse Danilova. Il finit<br />
par dormir, malgré les rires et les écl ats de voix qui montaient de l a taverne.<br />
Un léger bruit le réveilla. Tous les tonneaux étaient tranquilles, alignés dans la cour comme des barques sur un<br />
étang gelé. Par l'ouverture on voyait un pied qui sortait, ou un bras, une tignasse ou un museau... Minuit-Cinq entendit Emil<br />
qui marmonnait dans son tonneau et qui exerçait ses bestioles. III se leva pour le rejoindre.<br />
— Qu'est-ce que tu fais ?<br />
— Je parle avec Froufrou.<br />
Minuit-Cinq haussa les épaules et voulut retourner se coucher, Emil le retint.<br />
— R e g a r d e<br />
Il aligna par terre quatre rondelles en carton que Minuit-Cinq reconnut être des dessous de bocks à bière. Une<br />
seule portait un mot écrit. Minuit-Cinq rassembla le peu qu'il avait appris à l'hospice d'où il s'était échappé avec sa sœur<br />
au printemps dernier. II déchiffra: Ruby.<br />
— Et alors dit-il intrigué.<br />
Emil exécuta une série d'arabesques avec ses mains:<br />
— Froufrouuuu, belle Froufrouuuu, psalmodia-t-il, dis-môa qui est la plus beeeelle femme en ces lieux?<br />
Il lâcha la souris qui alla droit vers la rondelle marquée Ruby.<br />
— Oooh! Souffla Minuit-Cinq. Elle te répond<br />
Impérial, Emil retira la rondelle Ruby qu'il remplaça par une autre où était dessiné un soleil.<br />
— Froufrouuu! gémit-il. Belle Froufrouuu! (Fermant les yeux avec ferveur.) Qui nous éclaire de sa lumièèère,<br />
nous chauffe de sa châââleur?<br />
Il libéra à nouveau Froufrou qui trottina sans hésiter vers le carton au soleil. Minuit-Cinq se pinça.<br />
— Comment tu fais ?<br />
— Je lui ai simplement dit que si elle voulait manger, elle devait se montrer coopérative. (Il ajouta tout bas:)<br />
Et je frotte le bon carton avec un peu de fromage.<br />
— Avec ce tour tu vas gagner cinquante sous par jour!<br />
— Possible. On partage si tu veux.<br />
Minuit-Cinq lui secoua le bras:<br />
— Moi aussi j'ai pense à un tour.<br />
— Avec les poux qui habitent dans ta chemise ?<br />
Minuit-Cinq ne releva pas.<br />
— Tu sais, dit-il, le collier de la princesse... ?<br />
— Tu l'as retrouvé ? demanda Emil soudain attentif.<br />
— Non. Mais tu as remarqué que Ruby avait un collier en verre rouge ?<br />
— Qui vaut à peine six sous.<br />
— On ne va pas le voler. Seulement l'emprunter. Ensuite on ira tous les trois l'apporter à la princesse Danilova...<br />
— Elle verra tout de suite que c'est pas le sien.<br />
— C'est là que je pince Bretelle.<br />
— ?<br />
— Je la pince au sang. Elle pleure. Je pince plus fort Elle pleure plus fort.<br />
— .?<br />
— Alors moi aussi je pleure... Et toi aussi, ce n'est pas interdit. Et la princesse pleure à son tour, très émue, et<br />
nous donne pour la peine et la consolation un demi-florin à chacun.<br />
CENAFFE / PREFSET 43
Texte 6 : Caroll LEWIS, Alice au pays des merveilles<br />
Alice a suivi un étrange Lapin Blanc dans son terrier...<br />
Alice ne s'était pas fait le moindre mal, et fut sur pied en un moment ;<br />
elle leva les yeux, mais tout était noir au-dessus de sa tête. Devant elle<br />
s'étendait un autre couloir où elle vit le Lapin Blanc en train de courir à<br />
toute vitesse. Il n'y avait pas un instant à perdre : voilà notre Alice partie,<br />
rapide comme le vent. Elle eut juste le temps d'entendre le Lapin dire, en<br />
tournant un coin : « Par mes oreilles et mes moustaches, comme il se fait<br />
tard ! « Elle tourna le coin à son tour ; très peu de temps après lui, mais,<br />
quand elle l'eut tourné, le Lapin avait disparu. Elle se trouvait à présent<br />
dans une longue salle basse éclairée par une rangée de lampes accrochées au<br />
plafond. Il y avait plusieurs portes autour de la salle, mais elles étaient toutes<br />
fermées à clé quand Alice eut marché d'abord dans un sens, puis dans<br />
l'autre, en essayant de les ouvrir une par une, elle s'en alla tristement au<br />
milieu de la pièce, en se demandant comment elle pourrait bien faire pour en<br />
sortir. Brusquement, elle se trouva devant une petite table à trois pieds,<br />
entièrement faite de verre massif', sur laquelle il y avait une minuscule clé d'or,<br />
et Alice pensa aussitôt que cette clé pouvait fort bien ouvrir une des portes<br />
de la salle. Hélas ! soit que les serrures fussent trop larges, soit que la clé fût<br />
trop petite, aucune porte ne voulut s'ouvrir. Néanmoins, la deuxième fois<br />
qu'Alice fit le tour de la pièce, elle découvrit un rideau bas qu'elle n'avait pas<br />
encore remarqué ; derrière ce rideau se trouvait une petite porte haute de<br />
quarante centimètres environ elle essaya d'introduire la petite de d'or dans<br />
la serrure, et elle fut ravie de constater qu'elle s'y adaptait parfaitement !<br />
Alice ouvrit la porte, et vit qu'elle donnait sur un petit couloir guère plus<br />
grand qu'un trou à rat ; s'étant agenouillée, elle aperçut au bout du couloir le<br />
jardin le plus adorable qu'on puisse imaginer.<br />
Comme elle désirait sortir de cette pièce sombre, pour aller se promener au milieu des<br />
parterres de fleurs aux couleurs éclatantes et des fraîches fontaines ! Mais elle ne<br />
pourrait même pas faire passer sa tête par l'entrée ; « et même si ma tête pouvait passer, se<br />
disait la pauvre Alice, ça ne me servirait pas à grand-chose à cause de mes épaules. Oh ! que je<br />
voudrais pouvoir rentrer en moi-même comme une longue-vue ! Je crois que j'y arriverais si je<br />
savais seulement comment m'y prendre pour commencer ». Car, voyez-vous, il venait de se<br />
passer tant de choses bizarres qu'elle en arrivait à penser que fort peu de choses étaient<br />
vraiment impossibles.<br />
CENAFFE / PREFSET 44
Texte 7: Michel TOURNIER, Vendredi ou la vie sauvage<br />
C’étaient trois pirogues à balancier cette fois qui étaient posées sur le sable, comme<br />
des jouets d'enfant. Le cercle des hommes autour du feu était plus vaste que lors de la<br />
première incursion, et Robinson en les examinant à la longue vue crut remarquer qu'il ne<br />
s'agissait pas du même groupe. Le sacrifice rituel paraissait consommé à en juger par<br />
l'amoncellement de chairs pantelantes vers lequel deux guerriers se dirigeaient. Mais<br />
alors eut lieu un incident qui jeta un moment de trouble dans l'ordonnance rituelle. La<br />
sorcière sortit tout à coup de la prostration qui la tenait recroquevillée et, bondissant<br />
vers l'un des hommes, elle le désigna de son bras décharné, la bouche béante pour<br />
vociférer un flot de malédictions que Robinson ne pouvait entendre. Etait-il possible que<br />
les cérémonies expiatoires araucaniennes fassent plus d’une victime? Il y eut<br />
flottement parmi les hommes. Enfin l'un d'eux se dirigea, une machette à la main, vers<br />
le coupable désigné que ses deux voisins avaient soulevé et projeté sur le sol. La<br />
machette s'abattit une première fois et le pagne de cuir vola dans les airs. Elle allait<br />
retomber sur le corps nu, quand le malheureux bondit sur ses pieds et s'éloigna en<br />
avant vers la foret. Dans la longue-vue de Robinson, il paraissait sauter sur place,<br />
poursuivi par deux Indiens. En réalité il courait droit vers Robinson avec une rapidité<br />
extraordinaire. Pas plus grand que les autres, il était beaucoup plus svelte et comme<br />
taillé pour la course. Il paraissait de peau plus sombre de type un peu négroïde,<br />
sensiblement différent de ses congénères et peut-être cela avait-il contribué à le faire<br />
désigner comme victime.<br />
Cependant il approchait de seconde en seconde, et la distance qui le séparait de ses deux<br />
poursuivants ne cessait de croître. Si Robinson n'avait pas eu la certitude qu'il<br />
était absolument invisible de la plage il aurait pu croire que le fuyard l'avait vu et venait<br />
se réfugier auprès de lui. Il fallait prendre une décision. Dans quelques instants les<br />
trois indiens allaient se trouver nez à nez avec lui, et cette découverte d’une victime<br />
inespérée allait peut-être les réconcilier. C’est le moment que choisit Tenn pour aboyer<br />
furieusement dans la direction de la plage. Maudite bête ! Robinson se rua sur le chien et,<br />
lui passant le bras autour du cou, il lui serra le museau dans sa main gauche, tandis qu'il<br />
épaulait tant bien que mal son mousquet d’une seule main. En abattant I'un des<br />
poursuivants, il risquait d'ameuter toute la tribu contre lui. Au contraire en tuant le<br />
fuyard, il rétablissait l'ordre du sacrifice rituel, et peut-être son intervention seraitelle<br />
interprétée comme l'acte surnaturel d’une divinité outragée. Ayant à se ranger<br />
dans le camp de la victime ou dans celui des bourreaux - l'un et l'autre lui étant<br />
indifférents - la sagesse lui commandait de se faire l'allié des plus forts. Il visa au<br />
milieu de la poitrine le fugitif qui n'était plus qu'à trente pas de lui et pressa la<br />
détente. Au moment où le coup partait, Tenn, incommodé par la contrainte que lui<br />
imposait son maître, fit un brusque effort pour se libérer. Le mousquet dévia, et le<br />
premier des poursuivants opéra un plongeon parabolique qui s'acheva dans une gerbe de<br />
sable. L'indien qui le suivait s'arrêta, se pencha sur le corps de son congénère, se releva,<br />
inspecta le rideau d'arbres où s'achevait la plage et, finalement, s'enfuit à toutes<br />
jambes vers le cercle de ses semblables.<br />
CENAFFE / PREFSET 45
Texte 8 : J. CORTAZAR, Continuité des parcs, in Les Armes Secrètes<br />
Il avait commencé à lire le roman quelques jours auparavant. Il abandonna à cause d'affaires<br />
urgentes et l'ouvrit de nouveau dans le train, en retournant à sa propriété. Il se laissait<br />
lentement intéresser par l’intrigue et le caractère des personnages. Ce soir là, après avoir<br />
écrit une lettre à son fondé de pouvoirs, et discuté avec l'intendant d’une question de métayage,<br />
il reprit sa lecture dans la tranquillité du studio, d'où la vue s'étendait sur le parc planté de chênes.<br />
Installé dans son fauteuil favori, le dos à la porte pour ne pas être gêné par une irritante<br />
possibilité de dérangements divers, il laissait sa main gauche caresser de temps en temps le velours<br />
vert. Il se mit à lire les derniers chapitres. Sa mémoire retenait sans effort les noms et l'apparence des<br />
héros. L'illusion romanesque le prit presque aussitôt. Il jouissait du plaisir presque pervers de<br />
s'éloigner petit à petit, ligne après ligne, de ce qui l’entourait, tout en demeurant conscient que<br />
sa tête reposait commodément sur le velours du dossier élevé, que les cigarettes restaient à<br />
portée de sa main et qu'au-delà des grandes fenêtres le souffle du crépuscule semblait danser sous<br />
les chênes.<br />
Phrase après phrase, absorbé par la solitude alternative où se débattaient les<br />
protagonistes, il se laissait prendre aux images qui s'organisaient et acquéraient<br />
progressivement couleur et vie. Il fut ainsi témoin de la dernière rencontre dans la cabane parmi<br />
la broussaille. La femme entra la première, méfiante. Puis vint l'homme, le visage griffé par les<br />
épines d'une branche. Admirablement, elle étanchait de ses baisers le sang des égratignures. Lui, se<br />
dérobait aux caresses. Il n'était pas venu pour répéter le cérémonial d'une passion clandestine<br />
protégée par un monde de feuilles sèches et de sentiers furtifs. Le poignard devenait tiède au<br />
contact de sa poitrine. Dessous, au rythme du cœur, battait la liberté convoitée. Un dialogue<br />
haletant se déroulait au long des pages comme un fleuve de reptiles, et on sentait que tout était<br />
décidé depuis toujours. Jusqu'à ces caresses qui enveloppaient le corps de l'amant comme pour le<br />
retenir et le dissuader, dessinaient abominablement les contours de l'autre corps, qu'il était<br />
nécessaire d'abattre. Rien n'avait été oublié alibis, hasards, erreurs possibles. A partir de cette<br />
heure, chaque instant avait son usage minutieusement calculé. La double et implacable répétition<br />
était à peine interrompue le temps qu'une main frôle une joue. Il commençait à faire nuit.<br />
Sans se regarder, étroitement liés à la tâche qui les attendait, ils se séparèrent à la porte de la<br />
cabane. Elle devait suivre le sentier qui allait vers le nord. Sur le sentier opposé, il se retourna un<br />
instant pour la voir courir, les cheveux dénoués. A son tour, il se mit à courir, se courbant<br />
sous les arbres et les haies. A la fin, il distingua dans la brume mauve du crépuscule l’allée qui<br />
conduisait à la maison. Les chiens ne devaient pas aboyer et il n'aboyèrent pas.<br />
A cette heure, l'intendant ne devait pas être là et il n'était pas là. Il monta les trois marches du<br />
perron et entra. A travers le sang qui bourdonnait dans ses oreilles, lui parvenaient encore les<br />
paroles de la femme. D'abord une salle bleue, puis un corridor, puis un escalier avec un tapis. En<br />
haut, deux portes. Personne dans la première pièce, personne dans la seconde. La porte du salon , et<br />
alors, le poignard en main, les lumières des grandes baies, le dossier élevé du fauteuil de velours vert<br />
et, dépassant le fauteuil, la tête de l'homme en train de lire un roman.<br />
CENAFFE / PREFSET 46
Texte 9 : Evelyne Brisou-Pellen, La plus grosse bête.<br />
Je ne me rappelle pas quand exactement je suis né (je ne suis pas très porté<br />
sur les chiffres) mais lorsque je suis arrivé dans cette famille, ils étaient déjà quatre.<br />
Il y avait un grand costaud, avec une voix tonnante qui m’impressionnait. On l’appelait<br />
papa. Ensuite, une dame blonde dont les chaussures faisaient tac, tac quand elle<br />
marchait, c’était maman. Les deux autres étaient plus petits, plus braillards. Leurs<br />
noms, j’ai eu un peu de mal à les apprendre : Julian et Coline.<br />
Si j’ai eu du mal, c’est qu’ils s’appelaient entre eux « pauv’crêpe », ou<br />
« pignouf », ou « tartouille », ou « faux derche », alors que ce n’est pas leur vrai nom.<br />
Et même, ils n’ont pas le droit de dire ces mots : quand papa et maman les entendent,<br />
ils se mettent en colère et, parfois, des claques volent.<br />
Moi, dans ce cas, je me tiens à carreau dans mon coin. Pas un poil qui dépasse.<br />
Ca prouve que, s’il y a quelqu’un de raisonnable dans cette maison, c’est bien moi.<br />
Papa me faisait très peur au début. Il faut dire que c’est lui qui m’a kidnappé. Il est<br />
arrivé dans la cour où je jouais avec mes frères et sœurs. Traîtreusement, il a d’abord<br />
caressé tout le monde. Nous, on n’était pas méfiants en ce temps-là. Il suffisait que<br />
quelqu’un nous fasse des papouilles et on devenait son copain.<br />
Bref, papa nous a soulevé de terre un par un entre ses grandes mains, comme<br />
pour jouer, et puis moi (pourquoi moi ?), il m’a gardé dans ses bras. Et il est parti.<br />
Quand je me suis rendu compte de ce qui se passait, et que tous mes frères et sœurs<br />
continuaient à s’amuser là-bas, je me suis mis à hurler. Rien n’y a fait. Papa m’a collé<br />
dans la voiture et il a claqué la portière.<br />
C’est comme ça que j’ai débarqué chez eux.<br />
CENAFFE / PREFSET 47
Texte 10 : Eric SIMARD, Je te sauverai<br />
Quand le garçon arrive avec sa mère à la clinique des oiseaux, Hélène est dans la<br />
cellule de Jonathan en train de nettoyer le sol. Elle est drôlement surprise.<br />
« Vous êtes revenus ! s'exclame-t-elle. Ca tombe bien! Le démazoutage commence<br />
aujourd'hui.<br />
L'enfant compte ses oiseaux. Ils sont tous là ! Il cherche Jonathan des<br />
yeux. Le voilà qui s'approche en poussant de petits Cris...<br />
Il est là ! Il est revenu! C'est lui! Je savais qu’il ne m'abandonnerait pas!<br />
La Terre peut trembler... le ciel peut gronder... Rien ne pourra m’empêcher<br />
de survivre... parce que mon ami est là !..<br />
L'enfant se baisse et ouvre les battants. Jonathan passe la tête et en profite pour<br />
jeter un coup d'œil autour de lui. Le regard de l'oiseau est redevenu vif et plein de<br />
malice. L'enfant le caresse, le cœur serré. Jonathan sent l'air du large. Il sort en se<br />
débattant légèrement, fait quelques pas et se jette à la mer. Avant<br />
de rejoindre les autres guillemots, l'oiseau patauge un peu dans l'eau.. La tête tournée<br />
vers Alan, il semble avoir du mal à partir...<br />
Adieu, mon ami. Je m'en vais saluer le Soleil. Jamais je n'oublierai ta<br />
chaleur, tes larmes aussi. Tout ce que tu as fait pour moi. . .<br />
Alan part s'asseoir sur un rocher à l'écart de la foule. Jonathan, lui, rejoint les<br />
autres guillemots qui flottent au large. Bientôt, tous les oiseaux s'envolent et<br />
s'éloignent à l'horizon. La foule applaudit. Alan frémit. Son ami vient de le quitter.<br />
Une immense . tristesse l'envahit. Le voilà à nouveau seul, perdu dans son silence.<br />
CENAFFE / PREFSET 48
Texte 11 : Extrait de Rue du Havre, de P. Guimard<br />
Une fois de plus Julien Legris remua des idées d'évasion. Le petit jour favorise<br />
les songes creux car l'espérance est matinale. Souvent, à cette heure incertaine,<br />
l’envie l'effleurait d'oser le geste qui lui permettrait d'échapper à sa condition de<br />
matricule. Il se laissait bercer quelques moments par l'audace anodine de ses velléités<br />
puis il capitulait devant l'évidence qu'aucune fuite n'était possible.<br />
Comme chaque matin, il regarda ses compagnons d'infortune, cherchant autour<br />
de lui une étincelle humaine. II eut suffi de peu pour lui réchauffer le cœur : à cet<br />
égard il avait un appétit d'oiseau ; mais ce peu était trop. Du morne et las troupeau<br />
qui avançait autour de lui, à petits pas, Julien savait qu'il ne fallait attendre nul encouragement<br />
à la révolte, pas même un clin d'œil amical ou complice.<br />
L'énorme bâtiment pesait sur lui de toute la force de ses murs épais et le troupeau<br />
savait qu'en un pareil endroit la notion d'escapade était saugrenue.<br />
"Pourtant, soufflèrent les démons du matin, il suffirait peut-être d'un geste<br />
pour..."<br />
Une bourrade remit Julien dans le droit chemin. Il suivit l'ordonnance de cet<br />
univers concentrationnaire dont il connaissait la mécanique, les mouvements secrets<br />
et l'odeur puissante, inimitable. Noyé dans la masse, il parcourut un couloir forme de<br />
deux grilles aux barreaux massifs. Un haut-parleur aboya des ordres<br />
incompréhensibles entremêlés d'informes chiffres. Le troupeau défila entre deux<br />
cages d'acier et de verre dans lesquelles deux hommes en uniforme posaient un<br />
regard attentif sur les dos voûtés qui glissaient devant eux. Puis ce furent un escalier,<br />
un autre couloir sombre, sans issue, dans lequel résonnait le lourd tumulte de milliers<br />
de pas. Partout des écriteaux : Défense de... II est interdit de... sous peine de...<br />
Dans la grande tour, la lumière était cruelle. Là encore, il y avait des grilles,<br />
des murs noirs ; mais au-dessus de leurs perspectives obliques un grand pan de ciel<br />
bleu laissait déchiffrer la promesse vaine d'une belle journée.<br />
Julien Legris alluma la première cigarette de la journée. Près de lui on cria<br />
des numéros et, en bon ordre, une partie du troupeau s'engouffra dans de longs<br />
fourgons verts dont les portes furent verrouillées automatiquement.<br />
Des policiers montaient une garde débonnaire.<br />
"Dans une vraie prison, se dit Julien, je n'aurais pas le droit de fumer."<br />
CENAFFE / PREFSET 49
Texte 12 : Jean de la Fontaine, Les deux amis<br />
Deux vrais amis vivaient au Monomotapa<br />
L’un ne possédait rien qui n’appartint à l’autre<br />
Les amis de ce pays<br />
Valaient bien, dit-on, ceux du notre<br />
Une nuit que chacun s’occupait au sommeil<br />
Et mettait à profit l’absence du soleil<br />
Un de nos deux amis sort du lit en alarme<br />
Il court chez son intime, éveille les valets<br />
Morphée avait touché le seuil de ce palais<br />
L’ami couché s’étonne : il prend sa bourse, il s’arme<br />
Vient trouver l’autre et dit : « Il vous arrive peu<br />
De courir quand on dort, vous me paraissez homme<br />
A mieux user du temps destiné pour le somme :<br />
N’auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu ?<br />
En voici. S’il vous est venu quelque querelle,<br />
J’ai mon épée, allons. Vous ennuyez-vous point<br />
De coucher toujours seul ? Une esclave assez belle<br />
Etait à mes côtés : voulez-vous qu’on l’appelle ?<br />
- Non dit l’ami, ce n’est ni l’un ni l’autre point<br />
Je vous rends grâce de ce zèle.<br />
Vous m’êtes, en dormant, un peu triste apparu ;<br />
J’ai craint qu’il ne fût vrai ; je suis vite accouru.<br />
Ce maudit songe en est la cause. »<br />
Qui d’eux aimait le mieux ? Que t’en semble lecteur ?<br />
Cette difficulté vaut bien qu’on la propose.<br />
Qu’un ami véritable est une douce chose !<br />
Il cherche vos besoins au fond de votre cœur ;<br />
Il vous épargne la pudeur<br />
De les lui découvrir vous-même ;<br />
Un songe, un rien, tout lui fait peur<br />
Quand il s’agit de ce qu’il aime.<br />
CENAFFE / PREFSET 50
Les grillons<br />
Une nuit, une souris fut réveillée par un crissement sonore de l’autre côté de sa<br />
fenêtre.<br />
- Qu’est-ce que ce bruit ? demande-t-elle.<br />
- Que dites-vous ? demanda à son tour un grillon. Je ne peux pas en même temps<br />
vous entendre et faire ma musique.<br />
- Je veux dormir, dit la souris, et je ne veux pas d’autre musique.<br />
- Que dites-vous, reprit le grillon, vous voulez plus de musique ? Je vais chercher<br />
un ami.<br />
Bientôt, il y eut deux grillons à crisser.<br />
- Comment ? dit la souris, je vous demande d’arrêter votre musique, et vous m’en<br />
faites davantage !<br />
- Que dites-vous, demanda le grillon, vous voulez plus de musique ? Nous allons<br />
chercher un autre ami.<br />
Et aussitôt, il y eut trois grillons à crisser.<br />
- Arrêtez cette musique, dit la souris. Je suis fatiguée et je ne peux pas<br />
l’entendre plus longtemps.<br />
- Qu’avez-vous dit ? interrogea le grillon, vous voulez que l’on joue plus<br />
longtemps ? Eh bien, nous allons chercher beaucoup d’autres amis.<br />
Aussitôt, il y eut là dix grillons à crisser.<br />
- Assez ! cria la souris, votre musique est trop bruyante.<br />
- Bruyante ? demanda le grillon. Bien sûr, nous pouvons faire davantage de bruit.<br />
Et les dix grillons se mirent à crisser très fort.<br />
- Je vous en prie, s’écria la souris. Je veux dormir. Je désire que vous partiez<br />
tous d’ici.<br />
- Partir d’ici ? demanda le grillon. Pourquoi ne l’avez-vous pas dit dès le début ?<br />
nous nous en allons et nous crisserons ailleurs, dirent les dix grillons.<br />
C’est ce qu’ils firent et la souris retourna dormir.<br />
CENAFFE / PREFSET 51
Un paysan revenu du marché rencontre un de ses amis et lui raconte qu’il<br />
vient d’être attaqué par des brigands.<br />
- Combien étaient-ils ?<br />
- Sept.<br />
- Tu dis ?<br />
- Je dis sept.<br />
- Dix-sept ?<br />
- Non, sans dix.<br />
- Cent dix ?<br />
- Mais non, sans dix, sept !<br />
- Comment ! Cent dix sept !<br />
- Mais non, toujours sept, sans dix.<br />
- Comment ! Sept cent dix ?<br />
- Sapristi ! Sept, sans dix, sept.<br />
- C’est trop ! Sept cent dix sept brigands pour toi seul !<br />
- Mais non, comprends donc ! Je dis : sept, sans dix, sept.<br />
- Dix-sept cent dix ?<br />
- Mais non, que diable ! Je dis : sept, sans dix, sept.<br />
- Arrête ! J’ai compris : dix-sept cent dix sept.<br />
CENAFFE / PREFSET 52
CENAFFE / PREFSET 53<br />
La métamorphose d'Actéon<br />
Diane 1 traverse monts et vallées. Ses compagnes rivalisent avec elle et d'adresse et<br />
d'ardeur. Toutefois, vers le milieu de la journée, quand la chaleur invite à<br />
rechercher l'ombre et la fraîcheur, la Chasse est momentanément interrompue.<br />
A l'orée 2 d'un bois, la nature a formé dans le creux d'un rocher une grotte<br />
couverte de feuillages et de fleurs ; une source murmure dans le voisinage ;<br />
l'onde 3 serpente limpide et transparente près d'un lit d'herbe et de mousse.<br />
L'endroit est propice 4 . Les nymphes et leur bien-aimée déesse entrent s'y délasser,<br />
quittent leurs armes et leurs minces habits, abandonnent leurs flexibles 5 sandales et<br />
procurent à leur corps souples et nerveux la douceur d'une eau rafraîchissante et<br />
pure.<br />
Egaré dans ces parages qu'il fréquentait pour la première fois, un chasseur<br />
conduit par le hasard, ou, plus exactement, par son triste destin, arrive tout à coup<br />
dans ce lieu retiré, caché à tous les yeux. Les chastes 6 et pudiques 7 baigneuses<br />
l'aperçoivent et se sauvent confuses et rougissantes. Diane, scandalisée, n'écoute que<br />
son indignation. Elle se dispose à sévir 8 contre l'insolent, mais plus d'arc, plus de<br />
javelots ; l'onde seule dans laquelle plonge son corps est à sa portée ; elle en asperge la<br />
figure d'Actéon, d'Aristée, petit-fils de Cadmus, et l'élève du centaure 9 Chiron. Elle y<br />
ajoute reproches et malédictions. L'imprévoyant chasseur ne demande qu'à<br />
s'excuser, tout confus de sa méprise 10 involontaire. Il n'en a pas le temps, et quelle est sa<br />
stupeur quand sur sa tête poussent d'élégantes cornes ! Son cou s'allonge ; ses oreilles se<br />
dressent fines et pointues ; plus de mains ; plus de bras ; des jambes grêles 11 et délicates<br />
les remplacent ; son corps est transformé en celui d'un cerf à la flûte rapide. Actéon<br />
s'échappe en effet, poursuivi par sa propre meute 12 qui ne le connaît plus. Bientôt<br />
rattrapé, mordu, il voudrait appeler, crier : « Mais c'est moi ! Actéon, votre maître ! ».<br />
Il ne peut. La fatigue, la douleur l'accablent ; il tombe, et ses membres déchirés sont<br />
dévorés par ses propres chiens que sa main avait nourris !<br />
1 Déesse de la chasse, elle vit avec des jeunes flues et chasse les hommes<br />
2 lisière d’un bois<br />
3 eau<br />
4 favorable<br />
5 souple<br />
6 vertueux<br />
7 discret, réservé<br />
8 punir<br />
9 être fabuleux, moitié homme, moitié cheval<br />
10 erreur<br />
11 long et mince<br />
12 groupe de chiens utilisés pour la chasse<br />
Emile Genest, Contes et légendes mythologiques.
Consigne 1 : Complète les cadres blancs. Indique pour chaque événement donné, la<br />
conséquence de cet événement.<br />
Diane chasse avec ses<br />
compagnes, elles ont<br />
chaud.<br />
Actéon aperçoit<br />
Diane et ses<br />
compagnes en train<br />
de se baigner.<br />
Consigne 2 : Précise à quel personnage renvoient les expressions soulignées<br />
dans le texte.<br />
(1) → leur bien aimée déesse : …………………………………..<br />
(2) → ces parages qu’il fréquentait… : ……………………………..<br />
(3) → Les chastes et pudiques baigneuses :…………………………………<br />
(4) → l’aperçoivent : ……………………………………….<br />
(5) → Elle se dispose à sévir : ……………………………….<br />
(6) → l’insolent :………………………….<br />
(7) → L’imprévoyant chasseur : ……………………………..<br />
(8) → Il n’en a pas le temps :………………………………..<br />
CENAFFE / PREFSET 54<br />
Diane…<br />
Actéon<br />
meurt<br />
dévoré<br />
par sa<br />
meute.
Correction<br />
Diane chasse avec ses<br />
compagnes, elles ont<br />
chaud.<br />
Actéon aperçoit<br />
Diane et ses<br />
compagnes en train<br />
de se baigner.<br />
CENAFFE / PREFSET 55<br />
Diane est furieuse.<br />
Elle asperge Actéon<br />
d’eau et le<br />
transforme en cerf.<br />
Les chiens d’Actéon<br />
ne le reconnaissent<br />
pas, ils le chassent.<br />
Elles s’arrêtent à l’orée<br />
d’un bois et se<br />
déshabillent pour se<br />
baigner.<br />
Actéon<br />
meurt<br />
dévoré<br />
par sa<br />
meute.
Un chasseur<br />
ou Actéon<br />
Diane traverse monts et vallées. Ses compagnes rivalisent avec<br />
elle et d'adresse et d'ardeur. Toutefois, vers le milieu de la<br />
journée, quand la c h a l e ur i n v i t e à r ec h er c h er l'o m br e<br />
e t l a fr a îc h eur , l a C h a s s e e s t momentanément interrompue.<br />
A l'orée d'un bois, la nature a formé dans le creux d'un<br />
rocher une grotte couverte de feuillages et de fleurs ; une<br />
source murmure dans le voisinage ; l'onde serpente limpide et<br />
transparente près d'un lit d'herbe et de mousse. L'endroit<br />
est propice Les nymphes et leur bien-aimée déesse entrent<br />
s'y délasser, quittent leurs armes et leurs minces habits,<br />
abandonnent leurs flexibles sandales et procurent à leur<br />
corps souples et nerveux la douceur d'une eau rafraîchissante<br />
et pure.<br />
Egaré dans ces parages qu'il fréquentait pour la première<br />
fois, un chasseur conduit par le hasard, ou, plus exactement,<br />
par son triste destin, arrive tout à coup dans ce lieu retiré,<br />
caché à tous les yeux. Les chastes et pudiques baigneuses<br />
l'aperçoivent et se sauvent confuses et rougissantes. Diane,<br />
scandalisée, n'écoute que son indignation. Elle se dispose à<br />
sévir contre l'insolent, mais plus d'arc, plus de javelots ; l'onde<br />
seule dans laquelle plonge son corps est à sa portée ; elle en<br />
asperge la figure d'Actéon, d'Aristée, petit-fils de Cadmus, et<br />
l'élève du centaure Chiron. Elle y ajoute reproches et<br />
malédictions. L'imprévoyant chasseur ne demande qu'à<br />
s'excuser, tout confus de sa méprise involontaire. Il n'en a pas le<br />
temps, et quelle est sa stupeur quand sur sa tête poussent<br />
d'élégantes cornes ! Son cou s'allonge ; ses oreilles se dressent<br />
fines et pointues ; plus de mains ; plus de bras ; des jambes<br />
grêles et délicates les remplacent ; son corps est transformé en<br />
celui d'un cerf à la flûte rapide. Actéon s'échappe en effet,<br />
poursuivi par sa propre meute qui ne le connaît plus. Bientôt<br />
rattrapé, mordu, il voudrait appeler, crier : « Mais c'est moi !<br />
Actéon, votre maître ! ». Il ne peut. La fatigue, la douleur<br />
l'accablent ; il tombe, et ses membres déchirés sont dévorés<br />
par ses propres chiens que sa main avait nourris !<br />
CENAFFE / PREFSET 56<br />
Diane<br />
Les compagnes de Diane<br />
Diane<br />
Actéon
Texte : Marie-Héléne DELVAL Victor, l’enfant sauvage.<br />
Comme une bête<br />
Cette histoire est vraie. Elle commence il y a presque deux cents ans dans une<br />
région de France qui s’appelle l’Aveyron. Une femme qui ramassait des champignons<br />
dans la forêt revient en courant dans son village. Elle est épouvantée. Elle raconte : «<br />
J’ai vu une espèce de bête qui courait à moitié debout, à moitié sur quatre pattes,<br />
avec une crinière noire sur la tête. »<br />
Le lendemain, les chasseurs fouillèrent la forêt. Les chiens ont vite fait de<br />
flairer la piste de cette bête bizarre qui grimpe aux arbres et galope entre les<br />
buissons. La bête se réfugie dans un trou. Mais quand les chiens l’encerclent, elle<br />
attaque. Elle plante férocement ses dents dans la gorge d’un chien. Les chasseurs se<br />
précipitent. La bête est prise. Alors l’un des chasseurs lui jette sur le dos un chemise.<br />
Car ce qu’ils viennent de capturer, ce n’est pas une bête, c’est un enfant, un garçon nu,<br />
au corps noir de terre, aux ongles longs et durs, c’est un enfant sauvage.<br />
On enferme le sauvage à la gendarmerie, comme une bête dans une cage. Il est sale<br />
et il sent mauvais. Il grogne et il mord. Quand on lui apporte à manger. Il renverse les<br />
aliments, il les pétrit avec les doigts avant de les enfourner dans sa bouche. Le<br />
commissaire soupire :<br />
- C’est dégoûtant ! Vivement qu’on nous débarrasse de cet animal-là !<br />
On envoie l’enfant sauvage à Paris dans une sorte d’école où l’on soigne les enfants<br />
sourds-muets.<br />
Tous les journaux parlent de lui. Les gens s’imaginent que le garçon va raconter des<br />
choses extraordinaires sur sa vie dans la forêt.<br />
Des curieux viennent pour le regarder de près, et ils n’arrêtent pas de poser des<br />
questions aux infirmiers :<br />
- Qu’est-ce qu’il mange ?<br />
- Pourquoi il ne dit rien ?<br />
- Il est méchant ?<br />
- Vous dites qu’il a onze ou douze ans ? c’est impossible !<br />
- S’il avait douze ans, il parlerait !<br />
Le garçon ne les regarde même pas. On dirait qu’il n’entend rien.<br />
CENAFFE / PREFSET 57
Texte : Comme une bête<br />
Citations du texte Personnage de<br />
référence<br />
l.8 Quand les chiens l’encerclent<br />
l.8 elle attaque<br />
l.9 Elle plante ses dents dans la gorge d’un chien<br />
l.10 L’un des chasseurs lui jette sur le dos…<br />
l.14 Il est sale et il sent mauvais<br />
l.14 Il grogne et il mord<br />
l.14 Quand on lui apporte à manger…<br />
l.15 il les pétrit avec les doigts<br />
l.20 Tous les journaux parlent de lui<br />
l.22 Des curieux viennent pour le regarder<br />
Consigne : Relève dans le texte les différentes expressions qui désignent le<br />
personnage principal.<br />
l.4 → ……………………………………………………………..<br />
l.7 → ……………………………………………………………..<br />
l.11 → ……………………………………………………………..<br />
l.13 → ……………………………………………………………..<br />
l.17→ ……………………………………………………………..<br />
l.18→ ……………………………………………………………..<br />
CENAFFE / PREFSET 58
FICHE FICHE DE DE DE LECTURE<br />
LECTURE<br />
Objectifs :<br />
Découvrir le plaisir de comprendre un texte.<br />
Découvrir le plaisir de construire le sens d’un texte.<br />
Exprimer son avis sur une situation.<br />
Se référer à ses propres lectures.<br />
Etape 1 :<br />
Lecture magistrale du texte. Les élèves n’ont pas le texte sous les yeux.<br />
Echange avec la classe : recueillir les impressions des élèves, les laisser parler, ne<br />
rien refuser de leurs propositions …<br />
Etape 2 :<br />
Les élèves ont le texte sous les yeux. Ils remplissent le tableau et retrouvent les<br />
expressions de reprise pour le personnage principal.<br />
Correction collective et résumé du texte. Demander aux élèves d’expliquer et de<br />
commenter les expressions relevées dans la deuxième partie de l’exercice.<br />
Etape 3 :<br />
Les élèves lisent le texte à haute voix, paragraphe par paragraphe. On reconstitue le<br />
texte et par la même occasion l’histoire de l’enfant. Les élèves émettent des<br />
hypothèses, c’est à dire qu’ils essaient d’expliquer ce qui est arrivé à cet enfant.<br />
Etape 4 :<br />
Les élèves jouent le dernier paragraphe. Ils décrivent l’attitude de l’enfant sauvage et<br />
comment doit jouer celui qui prendra le rôle.<br />
On cherche la façon la plus expressive pour prononcer les paroles des curieux.<br />
Etape 5 :<br />
⇒ ouverture : amener les élèves à aller vers d’autres lectures comme Tarzan, Mowgli…<br />
CENAFFE / PREFSET 59
Texte : GOGOL, Le Nez<br />
(…) Soudain, il s’arrêta cloué sur place, à quelques pas de la porte d’une maison. Il<br />
venait d’être le témoin d’un phénomène inexplicable : devant l’entrée, un coupé s’était<br />
rangé ; les portières s’ouvrirent ; un homme en grand uniforme bondit tête baissée sur<br />
le trottoir et s’élança en courant dans l’escalier. Or quelles ne furent pas l’horreur de<br />
<strong>Ko</strong>valiov et sa stupéfaction lorsqu’il reconnut en cet individu…son propre nez ! A ce<br />
spectacle inouï tout se mit à tourner devant ses yeux, il sentit ses jambes se<br />
dérober ; mais il décida d’attendre le retour de l’homme coûte que coûte, quoiqu’il<br />
trembla de tous ses membres comme s’il avait la fièvre. Effectivement, au bout de<br />
deux minutes, le nez réapparut. Son uniforme était chamarré d’or et muni d’un grand<br />
col droit ; il portait des culottes de daim ; à son côté pendait une épée. Le plumet de<br />
son couvre-chef permettait de conclure qu’il avait rang de conseiller d’Etat. Tout<br />
indiquait qu’il se rendait en visite. Il regarda à droite et à gauche, cria au cocher<br />
d’arrêter la voiture, monta dedans et disparut.<br />
Le pauvre <strong>Ko</strong>valiov crut perdre la raison. Il ne savait que penser d’une aventure aussi<br />
étrange. En effet, comment se pouvait-il que son propre nez fût en uniforme, alors<br />
qu’il était hier encore sur son visage, incapable aussi bien de marcher sur ses pieds<br />
que de rouler en voiture ! Il se mit à courir derrière le coupé, lequel par bonheur<br />
n’allait pas loin et s’arrêta devant la cathédrale de Kazan.<br />
CENAFFE / PREFSET 60
Il se réveilla,<br />
toussa,<br />
éructa,<br />
La quinte le reprit,<br />
l’opressa,<br />
l’étouffa.<br />
D’un coup, il fit sauter le chapeau<br />
qu’il n’avait plus ôté<br />
depuis des décennies.<br />
Il en sortit des pluies<br />
de feu<br />
de suies<br />
de cendres.<br />
Longtemps, il hoqueta,<br />
bava,<br />
tira la langue<br />
tel un loup, flancs ouverts,<br />
à bout de vies exsangue.<br />
Pas de foule accourue,<br />
peu de flashes,<br />
de rares paysans de la montagne à vaches.<br />
Alors, déçu, vexé, il referma la bouche,<br />
fit taire son étuve<br />
puis il se rendormit<br />
avec ses rêves de Vésuve.<br />
Pierre Coran, Les éléments des poètes, réunis par<br />
Jacques Charpentreau, le livre de poche Jeunesse<br />
CENAFFE / PREFSET 61
Journée Journée 3<br />
3<br />
Objectifs Contenus et<br />
supports<br />
Distinguer deux catégories<br />
de textes : textes réticents et<br />
textes proliférants.<br />
Définir les spécificités de<br />
chacune de ces deux<br />
catégories de textes.<br />
Insister sur le caractère<br />
immanent de toute<br />
interprétation à propos des<br />
textes proliférants dits<br />
textes polysémiques.<br />
Groupement de<br />
textes : textes<br />
représentatifs de ces<br />
deux catégories.<br />
Documents<br />
théoriques.<br />
Textes à interpréter<br />
CENAFFE / PREFSET 62<br />
Modalités<br />
Travail sur un corpus de textes<br />
se prêtant à une réflexion sur<br />
l’aspect réticent et/ou<br />
proliférant d’un texte en vue de<br />
les classer en deux catégories<br />
Exercices pour baliser son<br />
interprétation
Ordre Ordre du du jour<br />
jour<br />
1/ Un travail en petits groupes puis en plénière sur :<br />
• la distinction entre un texte réticent et un texte proliférant<br />
• les répercussions de chacune de ces deux catégories sur les séances<br />
de lecture.<br />
2/ Une réflexion autour de l’interprétation et de son caractère immanent,<br />
accompagnée d’exercices.<br />
3/ Une mise au point qui viendra clôturer le travail de la journée.
Etape Etape 1<br />
1<br />
Déroulement<br />
Déroulement<br />
Déroulement<br />
Texte réticent / texte proliférant<br />
- Procéder à un échange avec les enseignants pour établir les critères selon<br />
lesquels ils ont classé les textes.<br />
Textes à proposer :<br />
1- Victor Hugo, Melancholia (Manuel 3 ème année Lettres, p.64)<br />
2- Gérard de Nerval, El Desdichado (Manuel 3 ème année Lettres, p.115)<br />
3- Gogol (voir annexe journée 2)<br />
4- Magma (voir annexe journée 2)<br />
5- Cortazar (voir annexe journée 2)<br />
6- Maupassant (voir annexe journée 2)<br />
- Faire classer les textes en deux catégories, ceux recelant des difficultés de<br />
compréhension et ceux au contraire susceptibles de faire naître une multiplicité<br />
d’interprétations pour introduire les notions de texte réticent et texte proliférant.<br />
- Faire lire le document proposant des définitions concernant le texte réticent et le<br />
texte proliférant. (Préciser que la prolifération de sens implique une pluralité de<br />
lectures et que cette pluralité de lectures est le fruit de plusieurs interprétations).<br />
-Rappeler la notion d’inférence.<br />
Etape Etape 2<br />
2<br />
L’interprétation<br />
1- Donner le poème de Prévert pour un travail en trois temps :<br />
• Réflexion individuelle sur une interprétation possible<br />
• Travail en petits groupes en vue d’une confrontation restreinte<br />
• Mise en commun avec le grand groupe pour valider toute interprétation qui<br />
prend appui sur des indices ponctuels dans le texte.<br />
La mise en commun doit permettre<br />
• d’appuyer l’interprétation à partir de signes qu’on perçoit dans le poème.<br />
• de spéculer sur le pluriel du texte.<br />
• de choisir parmi tous les possibles signifiants.<br />
2- Proposer le texte Le Jobard de M. Piquemal en vue d’installer un débat interprétatif.<br />
CENAFFE / PREFSET 64
Etape Etape Etape 33<br />
3<br />
Mise au point<br />
Lire et distinguer les définitions de « comprendre » et « interpréter »<br />
(projetés sur transparent) afin de pouvoir adopter la démarche adéquate face à un<br />
texte.<br />
Faire remarquer que le travail d’interprétation ne consiste pas à utiliser le<br />
texte pour servir des hypothèses interprétatives qui ne demeurent pas fidèles à son<br />
contenu, mais plutôt pour faire jaillir des significations directement du texte d’où la<br />
nécessité de baliser son interprétation et de prévenir les dérives interprétatives :<br />
Le lecteur a des droits<br />
Le texte a ses droits<br />
Dans un tel cadre didactique, l’animateur n’impose pas une lecture unique, il<br />
permet aux enseignants présents de construire leurs compétences interprétatives.<br />
Ainsi, au cours de sa lecture individuelle, le participant se construira une<br />
compréhension qui repose en partie sur une interprétation qu’il consolidera au fur et<br />
à mesure qu’il progressera dans le texte.<br />
Une fois la lecture personnelle terminée, l’apprentissage se continue en travail<br />
coopératif dans la confrontation des diverses interprétations ; chacun aura à défendre<br />
la sienne.<br />
Le caractère consensuel de l’interprétation naîtra de la mise en œuvre des<br />
propositions successives qui tendent, à mesure qu’elles sont confirmées par un<br />
retour constant au texte, à se cimenter autour de certaines significations et à se muer<br />
en explication de texte.<br />
Activité Activité en en en non non présentiel présentiel :<br />
:<br />
Proposer des documents théoriques, qui portent sur certaines approches et certaines<br />
démarches, à lire et à redécouvrir. Les enseignants auront à réfléchir sur la manière de les<br />
exploiter en situation de classe.<br />
Les documents à fournir :<br />
• Document : La place de la lecture dans quelques approches, le point sur la lecture,<br />
Claudette Cornaire<br />
• Document : Définitions de quelques méthodes de critique littéraire, Dictionnaire de<br />
critique littéraire.<br />
CENAFFE / PREFSET 65
ANNEXE JOURNEE 3<br />
Les documents pour la journée<br />
Les textes supports<br />
Les documents pour la journée 4<br />
CENAFFE / PREFSET 66
TEXTE RETICENT ET TEXTE PROLIFERANT<br />
Le texte réticent pose des problèmes de compréhension au lecteur. Parmi les<br />
effets de réticence, on peut citer : les blancs de toute nature, singulièrement ceux<br />
relatifs aux intentions des personnages et certains de leurs actes cruciaux, les<br />
analepses, l’intrication de récits, l’adoption de points de vue insolites, non<br />
identifiables, pluriels et contradictoires, la rupture volontaire de la lisibilité des<br />
chaînes anaphoriques, la perturbation des valeurs, la création d’un monde fictif à là<br />
logique inédite, ou aux logiques contradictoires, l’éloignement des canons du genre,<br />
la pratique de l’intertextualité, la mise en scène d’auteurs fictifs et la substitution de<br />
la métanarration à la narration attendue…<br />
Le texte proliférant, quant à lui, à l’inverse du précédent, dit en quelque sorte<br />
plus qu’il ne devrait dire et pose des problèmes d’interprétation. C’est un texte<br />
polysémique, susceptible d’une lecture plurielle aboutissant à des compréhensions<br />
différentes ou, parce que fortement symboliques, présentant plusieurs niveaux<br />
d’interprétation possibles.<br />
Falardeau, Compréhension et interprétation : deux composantes complémentaires de la lecture littéraire.<br />
CENAFFE / PREFSET 67<br />
l
CENAFFE / PREFSET 68<br />
COMPRENDRE<br />
C’est s’écarter de la microstructure<br />
lexicale et syntaxique pour réorganiser les<br />
informations dans une structure globalisante,<br />
qui rende intelligible les informations<br />
essentielles du contenu du texte ; cette<br />
généralisation cherche à dégager un sens,<br />
une représentation d’ensemble qu’actualise<br />
le lecteur à l’aide de ses connaissances dans<br />
un discours essentiellement paraphrastique.<br />
Le sens perçu participe à un certain<br />
consensus et il ne requiert pas de<br />
confrontation sociale pour être reconnu.<br />
Falardeau, Compréhension et interprétation : deux composantes complémentaires de la lecture littéraire.
CENAFFE / PREFSET 69<br />
INTERPRETER<br />
Pour interpréter, le lecteur ausculte le<br />
texte de manière attentive pour explorer<br />
les récurrences et déployer un des<br />
possibles signifiants. Ce n’est plus le sens<br />
qu’il poursuivra mais une signification.<br />
La lecture devient ainsi une actualisation<br />
sociale d’un signe créé ; elle n’est plus<br />
une représentation personnelle puisqu’elle<br />
doit nécessairement passer par la<br />
confrontation sociale pour acquérir une<br />
certaine légitimité. Le texte polysémique<br />
se transforme de la sorte en un matériau<br />
d’un nouveau texte, fruit de la création du<br />
lecteur qui déborde du texte original.<br />
Falardeau, Compréhension et interprétation : deux composantes complémentaires de la lecture littéraire.
PREMIER JOUR / J.PREVERT<br />
Des draps blancs dans une armoire<br />
Des draps rouges dans un lit<br />
Un enfant dans sa mère<br />
Sa mère dans les douleurs<br />
Le père dans le couloir<br />
Le couloir dans la maison<br />
La maison dans la ville<br />
La ville dans la nuit<br />
La mort dans un cri<br />
Et l’enfant dans la vie.<br />
J'avais débarque du bateau et je me baladais seul dans les rues de New-York. Je<br />
me tenais sur mes gardes car je pouvais à tout moment être attaqué par une bande de<br />
«« Black- malabars » super baraqués. [...]<br />
Ma balade me menait toujours jusqu'au terrain vague. Là, il n'y avait plus une seule<br />
lumière. Quelqu'un avait déquillé les ampoules des lampadaires publics. Sans doute le<br />
Jobard qui n'avait pas de volets aux fenêtres, et que tout cet éclairage devait gêner<br />
pour dormir.<br />
Silencieusement, je m'approchais de la maison du vieux. C'est dingue comme ce<br />
bonhomme pouvait m'intriguer. A cette heure de la soirée, il ne regardait pas la télé. Il<br />
était le plus souvent à sa table de travail en train de griffonner des plans avec un crayon<br />
et une règle. Parfois aussi, il lisait de vieux bouquins tout jaunis.<br />
Ce type-là n'était pas fou. C'était sans doute un sorcier mais il n'était pas fou.<br />
J'aurais donné beaucoup pour savoir ce qu'il manigançait avec toutes ces<br />
paperasses ; mais les carreaux étaient si sales qu'on voyait tout flou.<br />
Alors, je restais une dizaine de minutes à l'observer, assis devant la fenêtre<br />
éclairée comme devant un écran de télé. Puis, quand je parvenais enfin à détacher mes<br />
yeux de cette silhouette, je rentrais chez moi en courant.<br />
M. Piquemal, Le Jobard<br />
CENAFFE / PREFSET 70
Joëlle Gardes-Tamine, Marie-Claude Hubert<br />
Dictionnaire de critique littéraire,<br />
Structuralisme. Mouvement né dans les années soixante dans le champ de la linguistique et<br />
qui s'étendit très vite à d' autres sciences humaines, en particulier à1'anthropologie. Le<br />
structuralisme, qui se réclame du Cours de Linguistique générale de Ferdinand de Saussure publié<br />
en 1916, cherche à mettre en évidence dans la langue sa structure. Par structure, on entend la loi de<br />
composition d'un système, un système étant un ensemble clos d'éléments liés entre eux tel que<br />
si un élément disparaît, c'est le système entier qui change. Cela implique que la linguistique doit<br />
s'occuper d'états de langue stables. Elle ne sauna plus être historique (diachronique, dit Saussure),<br />
mais synchronique. Si le système est susceptible d'une étude en lui-même, c'est que la langue est<br />
autonome par rapport à la réalité, et arbitraire. Du coup l'étude des éléments du système doit se<br />
faire à l'intérieur du système. La sémantique, par exemple, conçue comme l'étude du signifié, ne<br />
peut porter que sur la place respective des signes les uns par rapport aux autres : « dans la langue, il<br />
n'y a que des différences », dit Saussure. Le modèle de l'étude linguistique structuraliste, c'est la<br />
phonologie, ou ces différences sont décrites en termes de traits pertinents, l' analogue du trait<br />
pertinent étant en sémantique le sème. Mais les sèmes sont beaucoup plus difficiles à mettre en<br />
évidence que les traits pertinents, la complexité apparaissant avec le sens. Les limites de l'analyse<br />
structurale se voient avec encore plus de netteté dans le domaine de la poétique structurale,<br />
illustrée en particulier par Jakobson. Il s'agit d'une étude des textes immanentistes, c'est-à-dire<br />
qui ne fasse pas intervenir de données externes, même s'il faut au bout du compte ramener le texte<br />
à une structure générale, appelée littérarité. Le texte, dans lequel s'incarne cette structure, est<br />
considéré comme un tout clos sur lui-même.<br />
Le structuralisme, dans son souci de pureté et dans ses exigences méthodologiques, a constitué<br />
pour les sciences humaines le type de I' analyse scientifique. Levi-Strauss en particulier l' a mis en<br />
pratique en anthropologie, pour l'étude des liens de parents, et pour l'étude des mythes.<br />
Les apports du structuralisme, en ce qu'il a permis de décrire systématiquement des domaines<br />
qui l'étaient souvent jusqu'alors de manière impressionniste, ont été très grands. Il a néanmoins<br />
été remis en cause lorsqu' il a fallu interpréter les structures car elles ne peuvent l'être que par le<br />
recours à des données et des questions extérieures l'objet que l'on décrit.<br />
* Diachronie, signe<br />
Ducrot 0., et alii, Qu'est-ce que le structuralisme ?, Paris, Seuil, 1968 ; Jakobson R., Questions de<br />
poétique, Paris, Seuil, 1973 ; Jakobson R., et Levi-Strauss Cl., «Les Chats de Charles Baudelaire»,<br />
L'Homme, II, 1, 1962 ; Levi-Strauss Cl., Tristes tropiques, Paris, Plon, 1973 (1 ère édition 1955) ;<br />
Levi-Strauss Cl., Anthropologie structurale<br />
Sociocritique (ou sociologie de la littérature). Méthode de critique<br />
littéraire née au cours des années soixante, issue de la sociologie. Elle apparaît comme une<br />
tentative pour expliquer la production, la structure et le fonctionnement du texte littéraire par le<br />
contexte historico-social. Elle a en Taine (Philosophie de l'art, 1865) et en Lanson (critique du<br />
début du XX siècle) deux lointains précurseurs. Le premier, centrant ses travaux sur l’émetteur,<br />
montre comment le milieu social de l'auteur conditionne l’œuvre, le deuxième, les centrant sur le<br />
récepteur, insiste sur le rôle du lecteur dans l' évolution de la littérature.<br />
Le concept de sociocritique, difficile à définir, recourt des approches théoriques disparates, selon<br />
que les critiques se situent dans la mouvance des philosophes marxistes, comme Marx, Engels ou<br />
Durkheim, de Hegel ou de sociologues comme Max Weber. Dans la lignée des marxistes, se situent<br />
des théoriciens comme Th. W. Adorno et comme P. Macherey. Leur originalité est de souligner la<br />
dimension critique de la littérature qui n'est pas nécessairement en adéquation avec les discours<br />
CENAFFE / PREFSET 71
idéologiques. Escarpit s'apparente à Max Weber, pour qui les structures culturelles ne sont pas<br />
seulement autonomes mais peuvent agir sur les structures sociales et économiques. Weber affirme<br />
également qu'il faut séparer les jugements de valeur des jugements de fait. Lukacs et Goldmann se<br />
réclament de Hegel à qui ils empruntent la catégorie de totalité. Dans un phénomène particulier se<br />
concrétise la problématique d’une époque. Goldmann cherche à dégager une structure qui rende<br />
compte de la totalité de l'œuvre, et qui soit elle-même explicable par un rapport à une structure<br />
englobante : la vision du monde d'un groupe. Ainsi explique-t-il la vision des Pensées de Pascal<br />
et des tragédies de Racine par leur référence commune à la pence janséniste et à la position précaire<br />
de la noblesse de robe à l'époque de l'absolutisme.<br />
La sociologie du texte est une sociosémiotique car elle utilise des concepts issus à la fois de la<br />
sociologie et de la sémiotique. Cette méthode, utilisée notamment par J. Kristeva, cherche à<br />
transposer les problèmes sociaux au niveau linguistique, s'attachant à la situation sociolinguistique<br />
dans laquelle un texte est produit, car cette situation porte l'empreinte des contradictions<br />
historiques et des conflits sociaux.<br />
Goldmann L., Le Dieu caché, Paris, Gallimard, 1956 ; Pour une sociologie du roman, Gallimard, 1964 ;<br />
Lukacs G., Théorie du roman, Genève, Gonthier, 1963.<br />
Psychocritique. Méthode de critique littéraire forgée par Charles Mauron qui utilise, pour<br />
expliciter l'œuvre littéraire, les leçons de la psychanalyse. Elle se fonde sur quatre opérations<br />
successives. Les œuvres d'un même auteur sont superposées comme des photographies, de façon à<br />
mettre en évidence les traits structurels récurrents. Ces motifs obsédants sont alors analysés<br />
comme le serait une symphonie ; c'est l'étude des thèmes, de leurs groupements, de leurs<br />
métamorphoses. Le matériel ainsi ordonne en réseaux est interprété avec les outils<br />
psychanalytiques, ce qui permet de mettre au jour l'image de la personnalité inconsciente de<br />
l'écrivain, son mythe personnel. La dernière étape consiste, à titre de contre-épreuve, à vérifier,<br />
dans la biographie de l'écrivain, l'exactitude de l'image découverte.<br />
Etudiant les métaphores dans l’œuvre de Baudelaire, Mauron, lorsqu'il superpose poèmes en<br />
prose, lettres, etc., est frappé par le retour de deux figures. Un groupe de personnages, à la<br />
marche entravée, «porteur de chimères », recherche vainement le contact avec autrui et ne le<br />
trouve que sous forme sado-masochiste. Un autre groupe de personnages est fait de figures qui<br />
sont toutes des avatars du prince (chat, sphinx, dandy, etc.). Ce couple antagoniste, où<br />
l’un des deux personnages est commandé par une identification maternelle, I'autre par une<br />
identification paternelle, représente le dynamisme de la personnalité de l'écrivain, son mythe<br />
personnel.<br />
Mauron C., Des métaphores obsédantes au mythe personnel, Paris, Corti, 1962.<br />
CENAFFE / PREFSET 72
Journée Journée Journée 4<br />
4<br />
Objectifs Contenus et supports Modalités<br />
(Re)découvrir les<br />
différentes approches<br />
des textes courts<br />
Souligner la nécessité<br />
de fixer des objectifs<br />
d’enseignement –<br />
apprentissage de la<br />
lecture<br />
Choisir l’approche en<br />
fonction des objectifs<br />
fixés pour la séance de<br />
lecture<br />
-Des documents théoriques<br />
- Les Instructions<br />
Méthodologiques<br />
- Les Programmes Officiels<br />
- Des textes divers pour les<br />
classes de 2 ème cycle de base et<br />
pour les classes de lycées<br />
- Des enregistrements de textes<br />
lus par des professionnels de la<br />
lecture A l’école du Caméléon,<br />
de Amadou Ambateba, lu par<br />
Pascal Zanzi<br />
Les deux amis, de La Fontaine,<br />
lu par Luchini<br />
CENAFFE / PREFSET 73<br />
-Travaux de groupes suivis de<br />
mise en commun et de<br />
discussion en plénière, lecture<br />
expressive de textes,<br />
-Réflexion, prise de<br />
connaissance des outils<br />
d’analyse et des approches<br />
pertinentes, commentaires<br />
suivis de conceptualisation.<br />
-Application : réflexion sur les<br />
différentes approches pour un<br />
même texte.
Ordre Ordre du du du jour<br />
jour<br />
1. Réflexion sur l’apport de la lecture expressive en classe, accompagnée<br />
d’exercices.<br />
2. (Re) découverte des outils d’analyse textuelle utilisables en classe et de<br />
leur relation avec les approches textuelles.<br />
3. Débat autour de l’exploitation de l’appareil pédagogique.<br />
4. Définition d’exemples d’objectifs d’enseignement-apprentissage de la<br />
lecture.<br />
5. Application à travers une fiche de lecture à produire.<br />
CENAFFE / PREFSET 74
Etape Etape 1<br />
1<br />
Déroulement<br />
Déroulement<br />
Déroulement<br />
1- Proposer aux enseignants le texte A l’école du Caméléon, de Amadou Ambateba.<br />
Consigne : Lisez le texte silencieusement et réfléchissez à la manière de le lire à haute voix, à<br />
ce que vous avez envie de faire ressentir à ceux qui vous écoutent.<br />
Faire visionner un enregistrement du même texte lu par Pascal Zanzi puis demander aux<br />
enseignants de commenter l’expressivité de cette lecture.<br />
3- Faire écouter la fable de La Fontaine Les deux amis lue par Luchini. Les enseignants ont<br />
le texte sous les yeux.<br />
4- Proposer d’autres textes avec la même consigne.<br />
Après un temps de préparation, demander à des volontaires de proposer leurs lectures. Chaque<br />
lecture sera suivie des commentaires des collègues afin de dire dans quelle mesure la lecture<br />
oriente la compréhension du texte.<br />
Poser la question : A quel moment de la séance de lecture faire une lecture expressive du<br />
texte ?<br />
Mise au point par le formateur :<br />
• La lecture expressive, une entrée au texte.<br />
• Distinction entre :<br />
lecture à haute voix et lecture expressive,<br />
lire et dire,<br />
subjectivité et plaisir de lire.<br />
• Les compétences mises en œuvre pour la lecture expressive.<br />
Distribuer le document 1<br />
Etape 2<br />
1- Proposer des exercices à faire par petits groupes sur des textes de la journée 2 pour :<br />
• déterminer les types de discours,<br />
• prendre conscience des différents niveaux d’analyse et des indices en rapport<br />
(niveau énonciatif, niveau morphosyntaxique, niveau lexical et leur apport dans<br />
l’explication des textes).<br />
Consigne : Relevez dans ces textes les indices qui vous paraissent pertinents pour un parcours<br />
de lecture.<br />
2- Faire réfléchir les enseignants, par petits groupes, sur les possibilités qu’offrent ces indices<br />
pour choisir les entrées possibles aux textes (un texte différent par groupe).<br />
Ce travail permettra de passer en revue différentes approches de lecture (qu’on appelle<br />
aussi modèle de lecture) : linéaire, analytique, méthodique, …, à partir d’une entrée<br />
énonciative, lexicale, morphosyntaxique, typologique, …<br />
Les réponses des collègues seront transcrites sur transparents<br />
Consigne : Quelle est l’entrée que vous proposez à la lecture de ce texte et qui vous paraît<br />
la plus pertinente ?<br />
3- Charger un représentant de groupe d’exposer le travail à l’aide du transparent préparé et<br />
de justifier son choix.<br />
CENAFFE / PREFSET 75
Les documents à fournir :<br />
• Document : copie de « le point sur la lecture » et les approches didactiques qui les sous<br />
tendent.<br />
• Document : copie de définitions de quelques méthodes de critique littéraire.<br />
4- Accorder éventuellement un temps à la lecture collective de quelques passages des<br />
documents que le formateur jugera pertinents.<br />
5- Revoir les instructions officielles pour attirer l’attention sur la méthodologie conseillée.<br />
(distribuer les photocopies).<br />
6- Faire réfléchir à l’intérêt de proposer aux élèves, lors des séances de lecture ou de<br />
prolongement à la lecture, en activités annexes, des exercices ponctuels de lecture et de<br />
compréhension sur des fragments de textes (tels que : exercices d’identification du genre et<br />
du type du texte, exercices de repérage d’indices de personnes, de substituts anaphoriques,<br />
de champs lexicaux, de mots clés…).<br />
Etape Etape Etape 3<br />
3<br />
Mise au point par le formateur<br />
- Repasser en revue, brièvement, les outils permettant d’aborder un texte.<br />
- Les mettre en rapport avec les “ modèles de lecture”.<br />
- Préciser le lien entre les approches en didactique des langues, les méthodes de<br />
critique littéraire et les “ modèles de lecture ”.<br />
Faire réfléchir sur l’exploitation de l’appareil pédagogique qui accompagne le texte dans les<br />
manuels scolaires. Discuter les pratiques habituelles des enseignants et parler des difficultés<br />
qu’ils rencontrent ; proposer des réponses, des possibilités d’exploitation(s).<br />
Mise au point par le formateur<br />
Exemples d’exploitation :<br />
• S’inspirer de l’appareil pédagogique pour choisir les axes de lecture sur lesquels se<br />
basera l’explication du texte en classe<br />
• En choisir la (ou les) question(s) qui permet(tent) à l’élève d’aborder le texte et lui<br />
demander de réfléchir hors classe, avant la séance de lecture, à une réponse.<br />
• S’y référer suite à l’explication du texte, avec les élèves, pour comparer la lecture<br />
qu’il propose à celle qui a été faite par la classe.<br />
• En sélectionner les questions qui conviennent à une vérification de la<br />
compréhension en fin de séance de lecture.<br />
Etape Etape 44<br />
4<br />
Vu la diversité des approches textuelles et la multiplicité des outils qu’on peut utiliser à<br />
cette fin, il nous parait nécessaire de concevoir le travail de la lecture comme un<br />
enseignement-apprentissage progressif permettant de former l’élève à la lecture de façon<br />
autonome.<br />
Notre programme de lecture sera donc appliqué en tant que projet qui se fixe des objectifs<br />
et qui définit les compétences à développer chez l’élève.<br />
CENAFFE / PREFSET 76
1- Amener les enseignants à rappeler les programmes officiels et les compétences à<br />
développer chez l’élève en lecture, selon le niveau ; puis faire formuler des objectifs de<br />
lecture.<br />
2- Les charger de fixer et de formuler, par petits groupes, des objectifs en rapport avec<br />
chaque texte proposé et le niveau de la classe.<br />
Consigne : Formulez l’objectif (ou les objectifs) d’une séance de lecture autour de ce<br />
texte. Justifiez votre choix dans une progression annuelle visant à doter l’élève d’une<br />
autonomie en lecture.<br />
3- Accorder un temps à la présentation des réponses de chaque groupe et à la discussion.<br />
Mise au point par le formateur<br />
Rappeler les objectifs qu’on peut assigner à une séance de lecture.<br />
Etape Etape 5<br />
5<br />
1- Proposer un même texte pour tous les groupes : la fable de Jean de La Fontaine Le lion<br />
devenu vieux.<br />
Les enseignants auront pour tâches de :<br />
• Préciser le niveau et le module<br />
• Fixer des objectifs d’enseignement - apprentissage de la lecture<br />
• Choisir l’entrée et l’approche qui leur paraissent convenables.<br />
2- Discuter, en plénière, la proposition de chaque groupe afin de décider de l’approche la<br />
plus appropriée et des critères de choix.<br />
Une proposition possible :<br />
Entrée au texte<br />
Une entrée par le lexique pour tous les niveaux.<br />
Pour les classes des écoles préparatoires, se contenter de relever les adjectifs qui<br />
rendent compte de l’état du lion devenu vieux. Dans un second temps, relever le champ<br />
lexical de la vieillesse et de la faiblesse.<br />
Pour les classes de lycées, demander aux élèves de relever le champ lexical relatif au<br />
personnage principal. Les élèves établiront un parallèle entre le lion jeune et le lion<br />
vieux. Ils parleront du lion par rapport aux autres animaux.<br />
Objectif(s) de la séance :<br />
Ecoles préparatoires<br />
Apprendre à l’élève à :<br />
Relever les informations essentielles à partir d’indices précis<br />
Exprimer un point de vue sur la fable<br />
Lycées<br />
Amener l’élève à :<br />
Repérer les champs lexicaux et percevoir leur importance<br />
Décrire le mode de fonctionnement de la fable<br />
Interroger le texte pour proposer des interprétations<br />
CENAFFE / PREFSET 77
Mise au point par le formateur :<br />
Insister sur la diversité des approches possibles pour un même texte<br />
Souligner la nécessité de se fixer des critères de choix du texte à programmer pour<br />
une séance de lecture, tenant compte de<br />
• du niveau des élèves,<br />
• l’objectif de la séance,<br />
• des compétences à développer chez les élèves,<br />
• de la progression annuelle.<br />
Activité Activité Activité een<br />
ee<br />
n n non présentiel présentiel :<br />
:<br />
Charger les enseignants de ramener des textes des manuels qu’ils évitent de travailler avec<br />
leurs élèves.<br />
CENAFFE / PREFSET 78
Les textes supports<br />
Les documents à distribuer<br />
ANNEXE JOURNEE 4<br />
CENAFFE / PREFSET 79
A l’école du Caméléon<br />
Texte de Amadou Ambateba<br />
Lu par Pascal Zanzi<br />
Et si j’ai un conseil à vous donner, je vous dirai : « Ouvrez votre cœur et surtout allez à<br />
l’école du caméléon. C’est un très grand professeur. Si vous l’observez, vous verrez.<br />
Qu’est- ce que le caméléon ? D’abord quand il prend une direction, il ne détourne<br />
jamais sa tête donc ayez tous un objectif précis dans votre vie et que rien ne vous détourne<br />
de cet objectif.<br />
Et que fait-il le caméléon ? Il ne tourne pas sa tête, c’est son œil qu’il tourne. Il regarde<br />
en haut, il regarde en bas, cela veut dire : informez-vous ! Ne croyez pas que vous êtes le<br />
seul existant de la terre ! Il y a toute l’ambiance autour de vous.<br />
Et que fait le caméléon quand il arrive dans un endroit ? Il prend la couleur du lieu. Ce<br />
n’est pas de l’hypocrisie, c’est d’abord la tolérance et le savoir vivre. Se heurter les uns les<br />
autres n’apporte rien. Jamais on n’a rien construit dans la bagarre. La bagarre détruit donc<br />
la mutuelle compréhension est une voie. Il faut toujours chercher à comprendre notre<br />
prochain. Si nous existons il faut admettre que, lui aussi, il existe.<br />
Et que fait-il le caméléon quand il lève le pied ? Il se balance pour savoir si les deux<br />
pieds déjà posés ne s’enfoncent pas. C’est après seulement qu’il va poser les deux autres.<br />
Il balance encore, il lève, cela s’appelle prudence dans la marche. Sa queue est préhensile,<br />
il l’accroche. Il ne se déplace pas comme ça, il l’accroche afin que si le devant s’enfonce,<br />
il reste suspendu. Cela s’appelle assurer ses arrières. Ne soyez pas imprudent !<br />
Et que fait le caméléon quand il voit une proie ? Il ne se précipite pas dessus, il envoie sa<br />
langue. C’est sa langue qui va la chercher car la petite proie ne vous dit pas qu’elle ne peut<br />
pas vous faire mourir alors il envoie sa langue. Si sa langue peut lui ramener sa proie, il la<br />
ramène tranquillement sinon, il a toujours la ressource de reprendre sa langue et d’éviter le<br />
mal.<br />
Ne soyez pas imprudents! Allez doucement dans tout ce que vous faites! Si vous voulez<br />
faire une œuvre durable, soyez patients! Soyez bons! Soyez vivables! Soyez humains!<br />
Amadou Ambateba, A l’école du Caméléon,<br />
Extrait de : La parole de la parole enseignée sous le baobab.<br />
CENAFFE / PREFSET 80
Le lion devenu vieux<br />
De Jean de La Fontaine<br />
Le lion, terreur des forêts,<br />
Chargé d’ans, et pleurant son antique prouesse,<br />
Fut enfin attaqué par ses propres sujets,<br />
Devenus forts par sa faiblesse.<br />
Le cheval s’approchant lui donne un coup de pied ;<br />
Le loup, un coup de dent ; le bœuf, un coup de corne.<br />
Le malheureux lion, languissant, triste, et morne,<br />
Peut à peine rugir, par l’âge estropié.<br />
Quand, voyant l’âne même à son antre accourir :<br />
« Ah ! c’est trop, lui dit-il ; je voulais bien mourir ;<br />
mais c’est mourir deux fois que souffrir tes atteintes. »<br />
CENAFFE / PREFSET 81
Quelques extraits de :<br />
La lecture à haute voix<br />
In Pratique Pédagogique, Bordas pédagogie<br />
La lecture à haute voix, la lecture expressive de l’enseignant<br />
En toute situation, la lecture à haute voix de l’enseignant offre aux élèves le plaisir de<br />
l’écoute, l’acquisition facile d’une culture et peut éveiller le goût de lire.<br />
Il est intéressant de penser la lecture à haute voix de l’enseignant comme un outil<br />
d’enseignement de la lecture capable de servir deux compétences fondamentales pour<br />
accéder à la maîtrise de l’écrit en réception :<br />
apprendre à écouter<br />
apprendre à comprendre<br />
La lecture magistrale se charge de trois grandes valeurs dans le domaine de la<br />
langue :<br />
Imprégnation<br />
Désir de lire<br />
Représentation de la tâche<br />
Celle de l’élève est un moyen d’évaluer les compétences d’orientation d’abord et ensuite<br />
d’expression<br />
Il est important de préciser que comprendre un texte ne se résume pas seulement à<br />
comprendre ce qu’un auteur a écrit mais à émettre une interprétation personnelle du texte<br />
lu..<br />
La lecture de l’enseignant conserve sa capacité à faire connaître et partager les<br />
différents plaisir de la lecture : plaisir de l’histoire, plaisir d’écouter un texte lu, de<br />
ressentir diverses émotions suggérées par le texte, de confronter des sentiments<br />
personnels, de développer son imaginaire…<br />
Lire, oui. L’élève est dans une situation d’écoute.<br />
Mais l’écoute doit être suivie d’échanges :<br />
Reformuler<br />
Raconter<br />
Commenter<br />
Développer<br />
Résumer<br />
Formuler une interprétation<br />
La confronter à celle d’autrui<br />
Débattre des idées du texte<br />
⇒ L’objectif sera : ♦établir le sens<br />
♦ affiner le sens<br />
CENAFFE / PREFSET 82
La lecture méthodique<br />
La démarche de la lecture méthodique est très facile à comprendre si on la<br />
met en relation avec le triangle pédagogique.<br />
LE TRIANGLE PEDAGOGIQUE<br />
SAVOIR<br />
Processus Processus<br />
« ENSEIGNER » « APPRENDRE »<br />
PROFESSEUR ELEVES<br />
Processus<br />
« FORMER »<br />
Triangle pédagogique, M. Develay, de l'apprentissage à l’enseignement, p. 64, repris de<br />
J. Houssaye, le triangle pédagogique, Berne, Peter Lang 1988, p. 40.<br />
Ce schéma, en instaurant trois pôles – élèves, savoir, professeur – ouvre<br />
la possibilité pour l’élève d'entrer directement en rapport avec le savoir sans<br />
passer obligatoirement par le professeur : c'est exactement le pari de la lecture<br />
méthodique. II ne s'agit plus d'une explication de texte dans laquelle le<br />
professeur sert d'intermédiaire entre le savoir et l'élève, mais d'une<br />
« lecture » effectuée directement par l'élève lui-même. Elle est « méthodique »<br />
parce que des outils méthodologiques issus de la grammaire, de la rhétorique<br />
et de la linguistique sont procurés aux élèves par les manuels ou par le<br />
professeur pour les aider dans leur démarche d'investigation sur le texte.<br />
Geneviève Mathi, Professeur de français : les clés d’un savoir faire<br />
Nathan Pédagogique, Collection Perspectives didactiques<br />
CENAFFE / PREFSET 83
Journée 5<br />
objectifs Contenus et supports Modalités<br />
Faire apprécier un texte en<br />
dehors de toute subjectivité<br />
(approche professionnelle).<br />
Faire construire une séance<br />
de lecture de texte court.<br />
Evaluer :<br />
• l’enseignement de la<br />
lecture (évaluer ou faire<br />
auto évaluer le travail de<br />
l’enseignant, son approche,<br />
la stratégie choisie…).<br />
• l’apprentissage de la<br />
lecture : l’autonomie de<br />
l’élève et sa capacité à<br />
s’auto évaluer<br />
Textes choisis dans les<br />
manuels et réputés<br />
rebutants<br />
CENAFFE / PREFSET 84<br />
Demander aux enseignants de<br />
présenter les textes qu’ils ont<br />
apportés et de justifier leurs<br />
choix.<br />
Faire construire, par petits<br />
groupes une séance de lecture<br />
dans son intégralité, autour<br />
d’un des textes retenus.<br />
Présenter les travaux et<br />
discuter les différentes<br />
propositions.<br />
Concevoir des grilles pour<br />
évaluer :<br />
1- ses propres pratiques de<br />
classe en séance de lecture<br />
2- le comportement de<br />
l’élève face à un texte<br />
Note au formateur : prévoir des textes pour cette journée pour le cas où ceux que les<br />
enseignants proposeront se révèlent insuffisants.
Ordre Ordre du du jour<br />
jour<br />
Lors de cette séance nous allons réfléchir aux questions suivantes afin<br />
d’apporter quelques réponses et quelques propositions :<br />
1/ Comment dépasser sa subjectivité et faire apprécier un texte ?<br />
2/ Comment construire une séance de lecture de textes courts ?<br />
3/ Comment évaluer<br />
l’enseignement de la lecture (en nous situant du côté de<br />
l’enseignant) ?<br />
↑ ↓<br />
l’apprentissage de la lecture (en nous situant du côté de l’élève) ?<br />
CENAFFE / PREFSET 85
Etape Etape 1<br />
1<br />
Déroulement<br />
Déroulement<br />
Déroulement<br />
Demander aux enseignants de présenter les textes qu’ils ont apportés et de justifier<br />
leurs choix, d’exposer à l’assistance les raisons pour lesquelles ils les ont « évités »<br />
jusqu’à aujourd’hui.<br />
1- Les enseignants se répartissent en groupes de quatre, choisissent l’un des textes<br />
retenus et élaborent une séance de lecture qui sera une mise en application des acquis de la<br />
session de formation.<br />
2- Chaque rapporteur présente le travail de son groupe. Le grand groupe discutera la<br />
pertinence de la fiche proposée.<br />
Mise au point par le formateur<br />
Il s’agit d’attirer l’attention des professeurs sur l’aspect professionnel de la lecture :<br />
apprendre à se détacher de sa personne et oublier ses propres réflexes de lecteur. L’élève a<br />
le droit de découvrir tous les types et tous les genres de textes.<br />
Le rôle du professeur est :<br />
de le guider dans cette quête,<br />
de réveiller en lui son identité de lecteur<br />
de développer chez lui le plaisir de lire.<br />
Etape Etape 2<br />
2<br />
Engager un débat sur les moyens qu’on peut utiliser afin d’évaluer les acquis des<br />
élèves en matière de lecture et de vérifier dans quelle mesure l’élève a pu acquérir une<br />
autonomie suffisante pour lire, comprendre, apprécier et interpréter un texte court ; à<br />
quel point il a pu intérioriser les mécanismes, les réflexes qui entrent en jeux lors de cet<br />
exercice. Le but étant de prévoir une remédiation qui sera programmée ultérieurement<br />
par l’enseignant.<br />
Les participants réfléchiront également sur les différentes manières d’évaluer leurs<br />
propres pratiques en vue d’une éventuelle régulation.<br />
Proposer un travail en atelier pour concevoir des grilles d’évaluation à la lumière de<br />
ce que la discussion a fait ressortir :<br />
une grille pour l’élève<br />
une grille pour l’enseignant<br />
CENAFFE / PREFSET 86
Quelques Quelques suggestions suggestions<br />
suggestions<br />
Le formateur peut utiliser les questions suivantes pour aider les enseignants à élaborer les<br />
grilles.<br />
Pour la grille destinée à l’autoévaluation de l’enseignant<br />
Est-ce que je propose suffisamment d’exercices ?<br />
Le lexique, le vocabulaire, la terminologie… que j’emploie sont-ils<br />
adaptés au niveau de ma classe ?<br />
Est-ce que j’ai toujours un objectif explicite et clairement formulé pour ma<br />
séance de lecture ?<br />
Est-ce que je fais revenir mes élèves au texte ?<br />
Mon rythme convient-il aux capacités réelles de mes élèves ?<br />
Les entrées que je choisis au texte sont-elles motivantes pour mes élèves ?<br />
Le temps de réflexion que je donne à mes élèves est-il suffisant ?<br />
Est-ce que je pense à aplanir les difficultés ?<br />
Est-ce que je donne à mes élèves l’occasion de participer à la construction<br />
du sens ?<br />
Est-ce que je traite les obstacles avant de proposer des exercices ?<br />
Est-ce que je demande systématiquement à mes élèves de justifier<br />
l’interprétation qu’ils proposent ?<br />
Est-ce que je motive mes élèves suffisamment pour qu’ils pensent à lire en<br />
dehors de la classe de français ?<br />
Est-ce que je fais participer mes élèves à la construction du sens du texte ?<br />
Pour la grille destinée à l’évaluation de l’élève<br />
Mes élèves ont-ils appris les mécanismes de compréhension ?<br />
Prennent-ils du plaisir en séance de lecture ?<br />
Mettent-ils en œuvre des stratégies pour aborder un texte ?<br />
Ont-ils l’opportunité de se découvrir une voie de lecteur ?<br />
Eprouvent-ils plus d’aisance à lire et à comprendre un texte ?<br />
Utilisent-ils efficacement des outils d’analyse leur permettant d’accéder au<br />
sens d’un texte ?<br />
CENAFFE / PREFSET 87
Bibliographie<br />
Geneviève Mathis, Professeur de français les clés d’un savoir-faire,<br />
collection Perspectives didactiques, Nathan pédagogie<br />
Roland Barthes, Le degré zéro de l’écriture, Paris : Seuil, 1972<br />
S/Z, Seuil, 1976<br />
Le plaisir du texte, Seuil, 1982<br />
Claudette Cornaire, Le point sur la lecture, collection Didactique des langues<br />
étrangères, Clé international, 2000<br />
Joëlle Gardes-Tamine, Marie-Claude Hubert, dictionnaire de critique littéraire<br />
Cérès édition, 1998<br />
CENAFFE / PREFSET 88