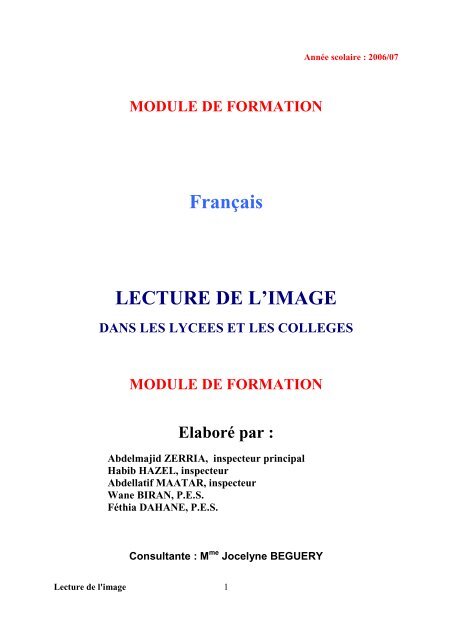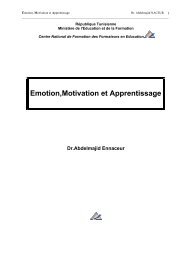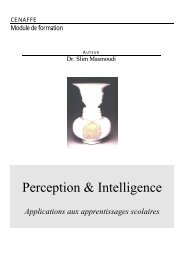You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Lecture de l'image<br />
MODULE <strong>DE</strong> FORMATION<br />
<strong>Français</strong><br />
<strong>LECTURE</strong> <strong>DE</strong> L’IMAGE<br />
1<br />
Année scolaire : 2006/07<br />
DANS LES LYCEES ET LES COLLEGES<br />
MODULE <strong>DE</strong> FORMATION<br />
Elaboré par :<br />
Abdelmajid ZERRIA, inspecteur principal<br />
Habib HAZEL, inspecteur<br />
Abdellatif MAATAR, inspecteur<br />
Wane BIRAN, P.E.S.<br />
Féthia DAHANE, P.E.S.<br />
Consultante : M me Jocelyne BEGUERY
Introduction<br />
Préambule<br />
Thème 1 : Lire un texte, lire une image<br />
(Fiche formateur + fiche enseignant)<br />
Lecture de l'image<br />
Contenu du module<br />
Thème 2 : Les niveaux de lecture<br />
(Fiche formateur + fiche enseignant)<br />
Exercices :<br />
1) Le Serment des Horaces (1784) de<br />
Jacques-Louis David<br />
(Fiche formateur + fiche enseignant)<br />
2) Café de nuit-intérieur de Vincent Van<br />
Gogh<br />
(Fiche formateur)<br />
3) Nicolas poussin ; Paysage avec Orphée et<br />
Eurydice<br />
(Fiche formateur)<br />
4) Jean- Baptiste Corot : Orphée ramenant<br />
Eurydice (1861).<br />
(Fiche formateur)<br />
5) Jean Delacroix ; Orphée apporte la<br />
civilisation en Grèce<br />
(Fiche formateur)<br />
6) Caspar David Friedrich (1774-1840)1 ;<br />
Voyageur contemplant une mer de<br />
nuages<br />
(Fiche formateur)<br />
Thème 3 : Image de création et image de<br />
communication<br />
(Fiche formateur + fiche enseignant)<br />
Annexes<br />
1 Voir manuel 3 ème lettres, p.8 module 1<br />
2
Lecture de l'image<br />
Introduction<br />
Les programmes de français réservent une part importante à l'image soit en tant que support à des<br />
activités de classe soit en tant qu'objet d'étude. Cela s'explique par le fait que l'image s'avère être<br />
aussi bien un outil pédagogique intéressant qu'un outil de communication. En effet, dans le monde<br />
moderne, l'image est omniprésente ; elle est partout. Elle est utilisée par tous les média : la presse, la<br />
télévision, le cinéma, la publicité etc. Elle constitue aussi une composante essentielle de la B.D., des<br />
albums et des illustrés.<br />
L'homme moderne est donc entouré d'images ; il se nourrit d'images (nous parlons de nourriture<br />
intellectuelle). D'où la nécessité pour l'école de s'intéresser à cette prépondérance de l'image dans<br />
notre vie quotidienne. En effet, il est dorénavant, indispensable d'apprendre à lire les images, de les<br />
comprendre, de les décoder afin de mieux cerner leur impact et de mieux s'en servir.<br />
C'est dans ce but que les programmes et les manuels scolaires s'intéressent à l'image et que dès<br />
la 7 ème année de l'Enseignement de base, on lui réserve une part assez importante.<br />
Effectivement, il s'agit en 7 ème , 8 ème et 9 ème années d'"initier" les élèves à la lecture de l'image c'està-dire<br />
de leur apprendre à en étudier le chromatisme (les couleurs) et la composition de façon<br />
générale. Aussi devrait-on les habituer à mettre en parallèle image et texte et à cerner les rapports<br />
qu'ils entretiennent.<br />
Cette première approche de l'image est importante dans la mesure où les élèves découvriront que<br />
le cours d'initiation aux arts plastiques ou ce qu'on appelle à juste titre d'ailleurs cours d'éducation<br />
artistique les aide à comprendre les images figurant dans le manuel de français ainsi que dans tout<br />
autre manuel scolaire. C'est un moment très important d'intégration des apprentissages.<br />
Ainsi, ils seront amenés à lire des cartes, des dessins, des photographies, des caricatures, des<br />
aquarelles, des tableaux de peinture etc.<br />
Ce travail d'initiation se fait au cours des différentes activités de français : à l'oral, en explication de<br />
texte, en grammaire, en expression écrite, en lecture suivie etc. Effectivement, dans les nouveaux<br />
manuels de français on trouve un grand nombre d'images que nous devons nous aussi apprendre à<br />
lire afin d'aider les élèves à les décoder, à en dégager le message et à en apprécier la valeur et la<br />
beauté.<br />
En effet, en 1 ère et 2 ème années de l'enseignement secondaire, l'image est toujours là surtout en<br />
tant que support. Ce n'est qu'en 3 ème et 4 ème années qu'elle devient objet d'étude.<br />
C'est pour cette raison que les enseignants de français devraient avoir la formation nécessaire<br />
pour lire l'image. Il faudrait les outiller afin qu'ils puissent amener les élèves à :<br />
- "identifier, de façon globale, les principales techniques de l'image (cadre, plan, point de<br />
vue, formes et couleurs, jeux de lignes et de lumière…) ;<br />
- en analyser les fonctions (raconter, informer, expliquer, illustrer, séduire, émouvoir…) ;<br />
- prendre conscience de son impact ;<br />
- mettre en relation texte et image".<br />
(cf. Programmes officiels et Instructions méthodologiques pour la 3 ème année secondaire).<br />
Ainsi, des actions de formation seront programmées afin de développer la compétence de lecture<br />
des images chez les enseignants.<br />
Pour ce faire, il faudrait, avant tout, développer des capacités qui les aideraient à "lire<br />
progressivement l'image de façon autonome".<br />
Cette tâche n'est pas simple. Bien au contraire ! Car en matière d'images, et contrairement au<br />
texte, il n'y a pas de méthode de lecture valable pour toute sorte d'image. En effet, chaque image se<br />
distingue par ses formes, ses lignes, ses couleurs, ses plans, etc.<br />
Par conséquent, nous allons découvrir les spécificités de chaque type d'image en analysant ses<br />
composantes, son impact et sa symbolique.<br />
3
Lecture de l'image<br />
Préambule<br />
Ce module de formation se propose d'apporter quelques pistes de réflexion quant aux façons<br />
d'appréhender et d'analyser l'image et ce, à partir d'activités alternant travaux d'ateliers et éclairages<br />
théoriques ponctuels.<br />
Les images retenues sont analysées sous un double aspect, celui de la sémiotique et celui de<br />
la rhétorique afin de mettre en relief les significations et les effets rhétoriques et stylistiques induits par<br />
l’utilisation des images en général et, plus particulièrement, les images d'art, de communication ainsi<br />
que les nouvelles formes d'images (image virtuelle, de synthèse etc.).<br />
Nous partons de l’hypothèse que nonobstant son omniprésence (et peut-être aussi en raison<br />
même de cette omniprésence), l'image nous est paradoxalement à la fois familière et étrangère, voire<br />
empreinte d'une certaine étrangeté. Mais qu'elle nous dérange, ou qu'elle passe presque inaperçue,<br />
ses effets sur nous n'en sont pas moins réels. L'image nous émeut au point de nous soustraire au<br />
réel: la contemplation d'une œuvre d'art nous procure une jouissance esthétique, un plaisir artistique "<br />
qui est celui de percevoir ces formes pures en dehors du temps, de l'espace et de l'individu"2<br />
Mais que se passe-t-il donc au juste en nous quand nous sommes en présence d'une image?<br />
Peut-on apprendre à lire une image comme on lit un texte?<br />
Si non pour quelles raisons?<br />
Autrement dit, quel rapport existe-t-il entre l'image et le langage verbal ?<br />
I/<br />
La production des images est un fait de culture. Elle apparaît dès les commencements, aux<br />
débuts de l'écriture d'après Leroi-Gourhan, sous forme de signes mis en rythme ou dessins<br />
schématisés à portée symbolique. Elle n'a cessé au cours des âges et des civilisations de se multiplier<br />
et se diversifier.<br />
C'est bien à titre d'objet culturel à part entière qu'aujourd'hui l'image en tant qu'objet<br />
d'étude apparaît dans les curricula scolaires dans les programmes tunisiens de l'enseignement du<br />
français au collège et au lycée.<br />
Objet d'apprentissage donc parce qu' objet culturel, l'image donne lieu à des regards, des<br />
traitements croisés de la part de disciplines d'enseignement comme les arts plastiques, l'histoire et la<br />
géographie et le français. Une approche instruite, distanciée, objective et critique de l'image fait<br />
désormais partie de la formation intellectuelle générale de la jeunesse.<br />
Il faut noter toutefois la spécificité d'un tel enseignement. Toute démarche de connaissance<br />
emprunte un cheminement paradoxal dans la mesure où elle doit s'arracher à la doxa, à l'opinion et à<br />
la représentation spontanée. La formation à la réception de l' image redouble ce mouvement<br />
paradoxal en ceci que la perception d' une image peut d'abord apparaître comme l'acte le plus<br />
spontané et universel qui soit. La perception est au départ un phénomène physiologique, il se<br />
trouve donc que nous sommes d'emblée instantanément touchés par les images en lesquelles nous<br />
recueillons l'écho analogique de la visibilité du monde et de ses objets. L'image a de ce fait un impact<br />
émotionnel fort. Nous nous y reconnaissons, il ne peut en être autrement.<br />
Or cette familiarité première dissimule une totale étrangeté, elle incite à méconnaître la part<br />
de fabrication de l'image, sa dimension d'arte fact. Produit des cultures humaines, l'image est<br />
incontestablement aussi un objet technique dont les attributs et caractéristiques (supports,<br />
techniques de fabrication, outils, matériaux) sont et ont constamment été des plus diversifiés. Mais de<br />
même que nous sommes mystérieusement accordés aux formes du monde,-ainsi sommes-nous<br />
spontanément réceptifs aux formes d' un paysage, à son atmosphère et à sa signification ou<br />
reconnaissons-nous, dit Mikel Dufrenne3, le désespoir sur telle toile de Van Gogh sans l'avoir<br />
précisément vécu nous-mêmes-, de même nous trouvons-nous de plein pied avec les évocations<br />
ressemblantes que les images offrent du monde. Et ce, quelques soient les modalités de<br />
représentation qui montrent ce rapport d'analogie avec les formes du visible, de la gravure ou peinture<br />
préhistorique au tag, en passant par le dessin d'enfant, l'affiche publicitaire ou la bande dessinée, etc.<br />
La liste des types d'images serait longue à recenser.<br />
Il faudrait d'ailleurs ajouter que les images de l'art4 abstrait, ou de simples compositions, jeux<br />
de formes et de couleurs sont, elles aussi, susceptibles de trouver sens auprès d'un regard humain<br />
par la médiation de ce type d'imagination spécifique qu'Emmanuel Kant a nommé "imagination<br />
2 Michel HAAR, L'œuvre d'art. Essai sur l'ontologie des œuvres, coll. Optiques philosophiques, Hatier, 1994; p32<br />
3 Cf. Mikel Dufrenne. L'inventaire des apriori Recherche de l'originaire. Paris, Christian Bourgois, 1981<br />
4 Des enfants de l'école primaire sont ainsi capables de donner sens à une toile informelle de Pierre Soulages et<br />
d'en restituer la richesse, d'évocation dans des textes de prose poétique.<br />
4
symbolique" 5 .Dans ce cas, l'image ne se contente pas de reproduire le visible mais comme le dit<br />
Paul Klee, désignant ainsi le programme de l'art moderne, de "rendre visible ". Du reste, si le temps<br />
désormais consacré à l'image dans l'enseignement secondaire vise aujourd'hui à armer enfants et<br />
adolescents des compétences nouvelles à des fins d'usages sociaux et culturels, historiquement la<br />
valeur pédagogique reconnue à l'image à titre de support d' enseignement et d'éducation le fut du fait<br />
de cet impact sensoriel, émotionnel et, finalement existentiel, fort. En effet, l'injonction de Comenius<br />
dans son Orbis pictus (1658) de privilégier dès la première éducation l'utilisation des images;<br />
donnant ainsi le pas à une espèce de " langue natale des formes", pour éveiller à la connaissance et<br />
accompagner l'entrée dans le langage et l'apprentissage de la langue et de l'écriture, repose à la fois<br />
sur ce constat du pouvoir de l'image et sur le début de reconnaissance d'une spécificité des besoins<br />
de la petite enfance.<br />
Finalement, l'impact affectif de l'image vient bien de la capacité de celle-ci à<br />
présenter/représenter le monde dans son état visible. Il surgit du plaisir de la reconnaissance de<br />
formes déjà rencontrées dans le réel, plaisir propre à notre mimétique. Et lorsque l'image créative ou<br />
d'art, apporte du nouveau, donne à voir, ouvre de nouvelles perspectives sur la visibilité du monde,<br />
l'émotion de la découverte n'advient jamais que sur font de re-connaissance. Ces gratifications<br />
spécifiques à la réception de l'image, dans lesquelles doivent entrer aussi quelque chose des<br />
satisfactions propres à la pulsion scopique, éloignent le regard des aspects techniques et culturels de<br />
l'image, de sa dimension d'arte fact. Autant d'aspects qui échappent à une réception spontanée, non<br />
réfléchie de l'image. Reste ainsi la plupart du temps à l'arrière plan nombre d'inconnues, beaucoup de<br />
non su, la part d'ombre qui s'adresse à l'inconscient, les procédés de manipulation parfois. On<br />
comprend dés lors à la fois l'attrait et la gêne que les images peuvent susciter. L'évidence du code<br />
analogique amène souvent à confondre le modèle et sa représentation , l'image et son référent .La<br />
fausse clarté des métaphores empruntées à la sémiologie porte aussi à illusion , de fait il n'est pas si<br />
simple de "lire des images" . La profusion contemporaine de celles – ci n'a rien changé, au<br />
contraire, à la fois familières et omniprésentes, elles gardent toute "l'inquiétante étrangeté" des<br />
anciennes icônes, quoiqu'à d'autres titres.<br />
II/<br />
Il faut dire que la représentation analogique est dans l'image le fait plus particulier de la<br />
civilisation occidentale. Platon l'a, au plan de l'ontologie, théorisé fondant ainsi une longue tradition.<br />
Nous avons du mal à sortir de ce cadre de la représentation par analogie, forcément seconde, dans<br />
laquelle l'image n'est jamais que le reflet appauvri, dévalué, du monde réel, lui-même reflet<br />
dérisoire pour le philosophe antique du monde des idées ,monde de l'intelligible. De ce fait,<br />
l'Occident surtout a symbolisé le monde en termes de mimesis, d'imitation. Et nous poursuivons dans<br />
l'image le rêve d'approcher toujours plus la ressemblance au réel. Comme si le progrès technique<br />
devait nous livrer le secret de fabrication de cette ressemblance. Or c'est le contraire qui se produit,<br />
l'avènement de nouveaux types d'images, virtuelles, de synthèse, renverse le modèle<br />
métaphysique d'origine platonicienne et oblige à penser l'image en elle-même, comme un objet<br />
à part entière. Ce que la sortie de la mimesis dans l'histoire de l'art occidental et l'épuisement<br />
momentané de l'art figuratif, avait déjà obligé à faire. Ainsi était, comme dit Gilles Deleuze,"monté le<br />
simulacre".6<br />
En effet, par rapport à l'effet de réalité produit notamment par la photographie, par rapport à<br />
son ancrage dans une réalité qui a forcément été là un jour, devant l'objectif ou le chevalet du peintre<br />
sur le motif, les images de synthèse s'avèrent indépendantes d'une réalité préexistante et par là<br />
s'affichent comme vrais simulacres. Par là encore elles exigent, parce que devenues des objets-<br />
images et non plus des images –objets, de nouvelles postures critiques7.Nous ne les avons<br />
délibérément pas prises en compte dans ce module, par souci de sérier les urgences en termes de<br />
formation et d'enseignement au niveau du secondaire.<br />
Revenons donc aux images traditionnelles qui s'accumulent encore au fil des pages des<br />
manuels scolaires. Quoiqu' incontournable écho de notre enracinement dans le monde, l'image<br />
témoigne aussi, parce que production de la culture humaine, d'un désir d'émergence par rapport au<br />
réel. Objet culturel à part entière l'image n'est jamais le réel malgré ce qui la relie à lui, au point que<br />
Walter Benjamin ait pu avoir cette formule:"l'image brûle le réel". Loin d'être une simple<br />
émanation/reproduction de la réalité visible, elle se fabrique comme un conglomérat de différentes<br />
constructions culturelles qui obéissent à des déterminismes particuliers, historiques, géographiques,<br />
sociaux, psychologiques et idéologiques. C'est pourquoi la percevoir et la comprendre demande une<br />
opération mentale très complexe, liée à la totalité de notre activité psychique et renvoyant à toutes les<br />
5 Cf. Emmanuel Kant. Critique de la Faculté de juger. Vrin, 1989.<br />
6 Cf. Gilles Deleuze. Logique du sens. Editions de Minuit, 1969.<br />
7 Cf. Serge Tisseron Comment l'esprit vient aux objets. Aubier, 1999<br />
Lecture de l'image<br />
5
dimensions de la personne. C'est aussi en cela que son étude convoque nombre de disciplines de<br />
référence. Les sciences humaines doivent incontestablement instruire le regard. Mais nous avons<br />
souhaité une méthodologie ouverte hors toute hégémonie de l'un ou de l'autre de ces supports et<br />
garants théoriques. Le choix de citer tel ou tel corpus scientifique- l' anthropologie, l'ethnologie,<br />
l'histoire, la sociologie, la sémiologie, la psychanalyse et diverses symboliques…- est déterminé par le<br />
cadre de telle image, de sa nature et de ses fonctions. Les images résultent de tout le contexte de<br />
culture et à chaque fois l'engagent. C'est pourquoi leur interprétation critique ne peut encore<br />
éviter au final un positionnement éthique et philosophique.<br />
III/<br />
L'étude de l'image dans les collèges et lycées revendique ces finalités culturelles. Il faut<br />
toutefois noter les difficultés et la complexité de l'entreprise. Les compétences culturelles requises<br />
sont nombreuses mais tout en même temps développées, précisées, fixées par leur mise en acte,<br />
par les performances répétées semaine après semaine. Antinomie ou paradoxe? Sans doute, mais<br />
inhérent à l'acquisition de toute compétence, car " ce qu'il faut apprendre pour savoir le faire,<br />
c'est en le faisant qu'on l'apprend" disait Aristote.<br />
Devant l'ampleur et la complexité de la tâche, il faut se jeter à l'eau, s'affronter à de vrais<br />
situations fonctionnelles et en même temps fournir aux formateurs quelques repères méthodologiques<br />
clairs et relativement simples, qui prennent en compte les difficultés les plus souvent rencontrées par<br />
les élèves et les enseignants eux-mêmes. Difficultés majoritairement dues d'une part, à une prise en<br />
compte littérale de l'injonction "lire l'image", à une méconnaissance de la nature métaphorique de<br />
l'expression, aboutissant forcément à une application des plus approximatives et parcellaires des<br />
schémas de la sémiologie puisque l'expression ne peut être prise à la lettre. On ne lit une image<br />
comme on lit un texte. Les écueils de la "lecture" de l'image vient d'autre part de la non prise en<br />
compte de la facticité de l'image, de l'image en tant que telle. Lui est très vite et subrepticement<br />
substitué un discours interprétatif sauvage parce que fruit de savoirs culturels hasardeux projetés sur<br />
elle mais n'émanant pas de sa stricte observation.<br />
Devant quoi, le premier impératif est de " revenir aux choses mêmes", d'adopter une attitude<br />
phénoménologique particulièrement adaptée, dans un premier temps, aux actes de perception. Il<br />
s'agit de s'astreindre à regarder et mettre à plat ce qui est là, dans l'image, et qui se voit. Revenir<br />
à l'objet et non au sujet, afin justement de mettre à distance autant que faire se peut et dans un<br />
premier temps les projections personnelles, culturelles et idéologiques propres à l'approche<br />
spontanée d'une image. Il s'agit de préparer un regard objectif pour asseoir une compétence<br />
critique, ce qui demande de faire taire bien des réactions affectives.<br />
Rester au plus près des actes de perception est une manière de "démystériser" l'image, de la<br />
démystifier aussi, en la dépouillant de tout commentaire, toute glose convenue et extérieure. On peut<br />
en effet toujours parler sur une image en la prenant pour prétexte. Ce n'est apprendre à la connaître,<br />
pour ce faire au contraire, il faut prendre en compte le tissu de signes qu'elle constitue en sériant les<br />
niveaux d'observation et de repérage de ces signes.<br />
Au niveau du signe visuel ou de la lecture iconique, l'image est prise comme objet visuel qui<br />
renvoie à un autre objet, en le représentant sur un mode analogique. Très vite, ce niveau se fait<br />
iconographique, c'est-à-dire s'intéresse à l'enracinement circonstanciel, historique des objets ou<br />
schémas représentés. La lecture d'image fait place au récit mais un récit contrôlé, limité et<br />
historiquement pertinent. Au niveau plastique, il s'agit de désigner, repérer et caractériser les<br />
éléments de formulation plastique présents dans l'image. Ces phases préparent la dernière étape, la<br />
lecture symbolique de l'image, interprétation d'ensemble qui ne peut être menée sans donner<br />
signification aux contenus apportés par les analyses précédentes et faire intervenir à tous les niveaux<br />
l'usage de la symbolique. L'iconographie ne se contente plus de raconter mais explicite les finalités de<br />
tel ou tel récit. La lecture plastique ne se contente plus de décrire les éléments de formulation<br />
plastique employés mais s'intéressent à leurs effets de sens, sens d'une composition, direction ou<br />
ligne, sens d'un rapprochement de couleurs, etc.<br />
Dans l'enseignement du français, l'interprétation des images rencontre enfin forcément<br />
l'imbroglio du texte et de l'image, les différentes figures de ce rapport texte-image. Le texte écrit, voire<br />
imprimé, peut lui-même faire image Mais par ailleurs, l'image est rarement autonome, prise qu'elle très<br />
souvent dans textes préexistants ou concomitants. 8<br />
Le processus d'ensemble d'une lecture d'image passe par un démontage/remontage de sa<br />
forme globale. Ce qui se fait au prix d'une méthodologie un temps réductrice mais qui a le mérite<br />
d'obliger à voir et d'apprendre à voir, ainsi que d'amener souvent à voir ce qui avait été vu sans le<br />
8 Voir par exemple l'œuvre de Gary Hill (artiste américain) qui exploite les derniers progrès technologiques pour présenter<br />
des réalisations dans lesquelles le texte (mots, références littéraires, citations philosophiques) fait image, est au cœur de<br />
l'image. Son œuvre intitulée Je crois que c'est une image à la lumière de l'autre illustre clairement cette technique<br />
novatrice.<br />
Lecture de l'image<br />
6
savoir, qui donc n'avait été perçu. Le moment de la synthèse a tout à gagner à passer par le travail de<br />
l'écriture. Il est alors sensible que "' lire une image" consiste à chaque fois à chercher à restituer le<br />
sens d'une langue " introuvable", langue à construire pour chaque image à la croisée de ses<br />
différents codes. C'est une tâche si ce n'est improbable, interminable. Et pour ce qui est des images<br />
de création voire d'art, une tâche poïétique autant que poétique.<br />
Lecture de l'image<br />
7<br />
Les auteurs
Thème 1 : Lire un texte, lire une image<br />
Lecture de l'image<br />
Fiche formateur<br />
Objectifs: - Prendre conscience de l'impact de l'image<br />
- Distinguer, d'un point de vue sémiologique, lecture de texte et<br />
lecture d'image.<br />
Supports: - Images, tableaux, affiche publicitaire (cf. images thème1)<br />
- Texte de J. Hébrard (cf. annexe 1)<br />
- Définitions du verbe lire et celle de la sémiologie tirées du Petit Robert et<br />
du Dictionnaire des sciences du langage<br />
Démarche<br />
Première étape:<br />
- Présenter (sur vidéo projecteur) une à une les images du thème 1<br />
- Observer les images proposées et y réagir spontanément en répondant à la question<br />
" Qu'est ce que vous voyez? Qu'est ce que vous voyez d'abord?<br />
- Susciter un échange entre les participants sur la façon dont ils auront réagi par<br />
rapport aux images proposées.<br />
- Faire le bilan. Celui-ci reprendra les points essentiels soulevés au cours de l'échange.<br />
Généralement, nous reconnaissons ou croyons reconnaître ce qui est (re)présenté à<br />
notre œil. Notre perception de l'image se fait d'une manière à la fois spontanée et<br />
instantanée.<br />
Très rapidement, l'image est intégrée à notre champ de connaissances. Nous<br />
réagissons alors affectivement en faisant référence à tout un système de valeurs sociales<br />
et culturelles; nous pouvons approuver l'image parce qu'elle nous plaît " j'aime", mais<br />
nous pouvons aussi la rejeter parce qu'elle nous déplaît " je n'aime pas", mais nous<br />
aurons de toute façon porté un jugement.<br />
La " lecture" de l'image nous offre de manière simultanée et un message perceptif et<br />
un message culturel. " La perception d'une œuvre est à la fois globale et successive,<br />
instantanée et très lente. "9<br />
Dans la nature, il n'y a pas d'image. L'image n'est pas la réalité. Elle n'est pas réelle.<br />
L'image est quelque chose de "construit", même si l'effet qu'elle produit sur nous est réel.<br />
9 Michel HAAR, L'œuvre d'art. Essai sur l'ontologie des œuvres, Optiques philosophie; p.71<br />
8
Deuxième étape:<br />
- Lire, individuellement, le texte de J. Hébrard et s’attarder tout particulièrement sur le<br />
paragraphe suivant:<br />
"Qu’est-ce que lire ?"10<br />
"L’acte de lecture implique la conjonction étroite de trois activités :<br />
- la perception d’indices graphiques de statuts très divers (support du texte,<br />
mise en page, typographie, texte lui-même, etc.),<br />
- l’élaboration progressive d’un sens pour cet objet textuel porteur<br />
d’indices : sens qui n’est pas à recevoir de l’objet, mais à construire en<br />
référence aux contraintes spécifiques de cet objet."<br />
Lecture de l'image<br />
- Chercher dans le Petit Robert la définition du verbe lire<br />
- Lire la définition de la sémiologie tirée du Dictionnaire des sciences du<br />
langage.<br />
- Puis, en groupe de trois, répondre aux questions suivantes:<br />
Quelles sont les différentes acceptions des mots lire et sémiologie?<br />
Peut-on lire une image comme on lit un texte?<br />
Mise en commun et bilan, devant aboutir à la formulation des points suivants:<br />
Au sens strict, lire est un acte qui nécessite la mise en œuvre d'une combinatoire<br />
d'éléments non signifiants (graphème/phonème dont le décodage permet la restitution du<br />
sens).<br />
Dans son acception sémiologique, lire désigne métaphoriquement l'activité de<br />
décodage global du code culturel.<br />
Lire un texte consiste à mobiliser des opérations cognitives spécifiques en vue de<br />
traiter de l'information (reconnaissance, discrimination, classement, hiérarchisation, etc.)<br />
Lire une image est donc une métaphore qui suppose qu'il soit possible d'appliquer à<br />
l'image le système verbal.<br />
Or, il n'existe pas dans l'image de plan autonome et unique d'éléments non<br />
signifiants, comme c'est le cas pour le signe linguistique. Les signes iconiques sont<br />
tellement imbriqués les uns dans les autres et dépendants du contexte qu'il serait vain de<br />
décomposer l'image en unités du type morphème. La réception (la lecture) d'une image<br />
combine à la fois différents plans et niveaux de formulation.<br />
Ces derniers sont à redéfinir pour chaque tableau et leur fonctionnement<br />
(agencement) interne est à expliquer.<br />
Avec l'image, on accède d'emblée à l'interprétation, au sens. Il est pratiquement<br />
impossible d'isoler dans un tableau d'art un ou des éléments non signifiants.<br />
Le signe iconique est polysémique, à la différence du signe linguistique qui a plutôt<br />
tendance à se "monosémitiser" dés qu'il est contextualité.<br />
Le "langage" de l'image est un langage continu à la différence du langage verbal qui,<br />
lui, est discontinu.<br />
Le signe verbal aussitôt énoncé, se met à l'arrière plan de son sens, ce qui en reste<br />
est une information, alors que l'image se met toujours à l'avant plan de son sens, elle le<br />
dissimule. Quand on se rappelle une image c'est rarement à son sens que l'on pense mais<br />
plutôt à l'image elle-même. D'où la nécessité de mettre en perspective les différents<br />
niveaux du" signe plastique". D'où aussi la nécessité de la connaissance des différents<br />
codes de l'image, car sans la maîtrise de ces derniers, on en reste au stade des<br />
impressions intuitives. Or l'objectif d'une éducation à l'image est précisément de passer<br />
(dépasser) l'effet premier et instantané de l'émotion que suscite en nous l'image pour<br />
apprendre à l'observer, à en décrire les différents codes et niveaux pour arriver enfin à<br />
construire une signification cohérente et raisonnée.<br />
10 Voir annexe 1 " Qu'est ce que lire?"<br />
9
Thème 2 : Niveaux de lecture<br />
Lecture de l'image<br />
Fiche formateur<br />
Objectifs :<br />
- Mettre en évidence les niveaux de lecture de l’image ;<br />
- S’initier ou s’exercer à la reconnaissance des différents niveaux de<br />
lecture et notamment le niveau plastique.<br />
Supports : - Document 1« Les niveaux de lecture » (cf. annexe 2)<br />
- Document 2« Quelques repères pour lire une image ».<br />
- Reproduction du tableau « Paysage avec Icare » (cf. images thème 2)<br />
Démarche :<br />
Présentation du document sur les niveaux de lecture<br />
Lecture par les participants des documents1 (cf. annexe 2) et 2 (cf. II/ le niveau plastique) et<br />
intervention du formateur pour expliciter quelques détails et répondre aux interrogations des<br />
participants. Il serait préférable de distribuer les documents à la fin des travaux sur le premier thème<br />
et leur demander de les lire chez eux avant d’aborder ce deuxième thème.<br />
I/ le niveau iconique:<br />
Cela consiste en gros à identifier dans une image (qu'il s'agisse d'icône, de tableau figuratif<br />
ou même dans l'art abstrait) les éléments que l'on reconnaît (personnages, objets, postures, gestes,<br />
vêtements, formes géométriques).<br />
Décrire, dire ce que l’on voit.<br />
Est-ce que nous voyons tous la même chose dans une image ? Il faudrait s’en assurer en<br />
classe. Nous allons nous en assurer aujourd’hui.<br />
1/ Images ambiguës ( cf ; images Thème1 et commentaires annexe 3)<br />
Ce sont des images qui dans lesquelles on voit un objet ou un personnage mais à force de les<br />
regarder, on pourrait découvrir autre chose. On se demandera alors comment on n’a pas pu ne pas<br />
s’en apercevoir avant. Cette réaction est normale parce que ces images sont ambiguës.<br />
Exemples d’images :<br />
a/ Des yeux dans la forêt (1)<br />
Le tableau de Bev Doolittle nous montre un cavalier qui se promène dans la forêt. Mais il<br />
n’est pas seul. Il est épié par un grand nombre de visages cachés dans le paysage. En effet,<br />
dans les arbres (verts), nous voyons des visages (5 ou 6 et même plus) ; dans les branches,<br />
les pierres des visages se forment aussi. « Tant que vous n’êtes pas à vingt, vous pouvez<br />
continuer à chercher ».<br />
b/ La belle et la sorcière (d’après Boring)<br />
Nous pouvons voir le visage d’une jeune femme « tournée de trois quart ». Mais ; on peut<br />
aussi distinguer un autre visage : celui d’une sorcière vue de profil.<br />
Toutefois il est impossible de voir les deux visages à la fois. Notre œil regarde mais notre<br />
cerveau interprète et décide : une jeune fille ou une sorcière. Nous allons de l’un à l’autre.<br />
c/ Vase ou visages (Le vase de Rubin)<br />
Le vase de Rubin montre aussi que la vision est une question d’interprétation. On voit soit<br />
un vase noir, soit deux visages blancs vus de profil. « C’est notre cerveau qui décide. Mais les<br />
deux interprétations sont exclusives. » On ne peut pas les voir ensemble.<br />
2/ Plus clair, plus foncé<br />
Il s’agit de comparer des couleurs. A priori c’est très simple mais notre perception visuelle<br />
peut être bluffée sans qu’il y ait trucage. Il s’agit simplement d’illusions.<br />
Exemples d’images :<br />
a/ SVJ tricolore<br />
Trois couleurs : vert, blanc et rose. Le rose du S et du J est le même que celui du V.<br />
C’est incroyable mais vrai car le rose du V paraît plus clair. Pourquoi ?<br />
C’est que « notre perception du rose est influencé par celle de son entourage. Les petits carrés<br />
roses du S et du J nous paraissent plus foncés (et plus rouges) que ceux du V qui sont eux<br />
entourés de blanc ».<br />
_____________________________________________________________________<br />
(1) D’après Sciences et Vie Junior ; Dossier HORS SERIE N° 51 ; Janvier 2003<br />
10
Disque unique<br />
Cette illusion créée par Jacques Ninio à trait à la couleur grise des deux disques. S’agit-il du<br />
même gris ? Oui. Pourtant nous les voyons différents : le disque sur fond clair paraît plus foncé<br />
que celui sur fond sombre.<br />
3/ Plus grand, plus petit<br />
Il n’est pas facile d’évaluer une taille car notre cerveau n’analyse pas les objets eux-mêmes<br />
mais en fonction des choses qui les entourent.<br />
Exemples d’images :<br />
a/ Le tunnel des monstres<br />
Un grand monstre poursuit un petit qui paraît terrifié. C’est aussi une illusion créée par la<br />
perspective car les deux monstres ont exactement la même taille. « Le petit » n’est pas terrifié puisque<br />
les deux monstres sont identiques. On peut vérifier à la règle.<br />
Cette tromperie sur la taille résulte du tunnel : « tout est dans la perspective donnée au sol, au mur,<br />
au plafond. Notre cerveau se charge du reste.<br />
b/ Au cœur des fleur<br />
Le cœur des deux fleurettes est-il le même ? On répond non sans hésiter. Lequel est le plus gros ?<br />
Celui de la fleur B paraît plus gros. C’est une illusion. Les deux cœurs sont exactement les mêmes.<br />
On peut mesurer.<br />
C’est l’environnement des cœurs qui change et induit notre vision en erreur.<br />
N.B. : D’autres images peuvent être exploitées ; cf. images thème2 et annexe 3.<br />
II/ Le niveau plastique:<br />
Les éléments de formulation plastique sont liés à la composition : les plans, la représentation<br />
de l'espace (plan étagé, espace perspectif etc.), le support (toile, papier etc.), la forme (elle est<br />
donnée par le graphisme, les à-plats de couleur, les modelés de peinture etc.), la couleur<br />
(chaud/froid – contrastes – etc.)<br />
1. Le support:<br />
le matériau: pierre, bois, tissu, papier, plastique;<br />
le format (les dimensions : largeur x longueur) . Ne jamais oublier d’attirer l’attention sur<br />
l’importance du format dans les choix esthétiques de l’artiste et de l’effet recherché.<br />
(gigantisme, petite dimension, effet de réel…)<br />
Les caractéristiques du support entraînent des contraintes dans la construction de l'image.<br />
2. La technique: dessin au fusain, peinture à, l'eau, à l'huile, acrylique, au pinceau ou au<br />
couteau…Les techniques sont aussi nombreuses que les procédés de reproduction, qui influent<br />
aussi sur l'image (gravure sur bois ou sur métal, lithographie, offset, sérigraphie). Le choix de la<br />
technique n’est jamais gratuit.<br />
3. La composition:<br />
a) le cadre: souvent rectangulaire, peut être aussi rond, carré, ovale. Généralement, un cadre<br />
horizontal est associé à l’idée de calme,;tandis que le cadre vertical suggère la proximité,<br />
l’action.<br />
b) la géométrie: (la construction de l’image)<br />
• Les lignes de force<br />
Ce sont les lignes que l’on peut voir sans analyser l’image :<br />
- Les lignes horizontales : la séparation entre le ciel et la terre par exemple peut traduire la<br />
séparation entre zone de matérialité et zone de spiritualité. Elles peuvent être suggérées par<br />
un mur, un chemin, un ruisseau etc. Elles signifient l’immobilité, le calme, la tranquillité, la<br />
solidité… ou la passivité, la lourdeur.<br />
- Les lignes verticales : elles sont suggérées par un arbre, un poteau, un personnage debout,<br />
une porte etc. Elles signifient la hauteur.<br />
- Les courbes : on peut les retrouver dans un objet rond, une position assise, un visage<br />
arrondi etc. Elles suggèrent la douceur, le calme, l’harmonie, l’élégance, la joie, la féminité ou<br />
l’instabilité, la passivité.<br />
- Les obliques et les diagonales créent une impression de dynamisme.<br />
- Les lignes sinueuses : un chemin, un ruisseau de branches d’arbre peuvent traduire des<br />
sentiments d’angoisse et de trouble.<br />
Lecture de l'image<br />
11
• Le point de fuite<br />
C’est le point de convergence de lignes imaginaires que l’on peut tracer par les personnages ou<br />
les objets d’une image. En général, le point de fuite, formé par la rencontre des lignes de fuite, se<br />
trouve à l’horizon et assure ainsi la perspective de l’image.<br />
• Les figures géométriques<br />
Les éléments représentés par un peintre peuvent revêtir différentes figures géométriques (carré,<br />
cercle, triangle).<br />
Un carré ayant des côtés égaux implique par sa régularité l’idée de stabilité et de<br />
masse.<br />
Un cercle traduit l’idée de perfection, l’idée de rondeur, de féminité.<br />
Un triangle évoque l’harmonie et la stabilité lorsque sa pointe est en l’air. Mais si sa<br />
pointe est en bas, il signifie un équilibre précaire.<br />
Les formes anguleuses traduisent la virilité, la fermeté ou la dureté, l’agressivité.<br />
lignes de force, point de fuite, figures géométriques,<br />
c) La profondeur de l’image<br />
Les effets de profondeur peuvent être créés par la perspective (le point de fuite, les lignes de fuite).<br />
Ils peuvent aussi résulter des plans successifs formés par les éléments peints (ou représentés) qui<br />
peuvent paraître de plus en plus éloignés parce que le peintre a respecté l’échelle. Plus les éléments<br />
sont petits, plus ils donnent l’impression d’être loin les uns des autres. L’illusion de profondeur peut<br />
être donnée par des personnages situés sur des plans différents.<br />
Les couleurs produisent aussi un effet de profondeur (couleurs de plus en plus pâles).<br />
Les plans :<br />
a) Le premier plan : il est constitué par les personnages ou les objets situés tout prés du<br />
« lecteur » de celui qui regarde l’œuvre.<br />
b) Ceux qui sont placés derrière forment le second plan, le troisième plan etc. Des objets ou des<br />
personnages cachés par d’autres donnent l’illusion d’être plus en arrière parce qu’ils se<br />
trouvent sur un autre plan.<br />
4. Les couleurs<br />
A) le système des couleurs<br />
1) Le bleu, le jaune et le rouge sont les couleurs primaires : elles sont fondamentales car on<br />
ne peut les obtenir par aucun mélange de couleurs. Par contre toutes les autres couleurs<br />
s'obtiennent par mélange des couleurs primaires.<br />
2) Le vert, le violet et l'orangé sont des couleurs secondaires.<br />
3) Les couleurs complémentaires : ce sont celles qui s'opposent dans le cercle chromatique:<br />
* L'orangé est la couleur complémentaire du bleu.<br />
* Le violet est la couleur complémentaire du jaune.<br />
* Le vert est la complémentaire du rouge.<br />
Lecture de l'image<br />
Bleu<br />
Vert violet<br />
Jaune Orangé Rouge<br />
4) On distingue des couleurs chaudes et des couleurs froides :<br />
* Les couleurs chaudes sont associées à la lumière, au feu (rouge, orange, jaune etc.)<br />
* Les couleurs froides sont associées à l'eau, à la glace… (Bleu, violet, vert etc.)<br />
Le fait qu'un ensemble de ces couleurs domine dans un tableau lui donne un sens précis :<br />
- les couleurs chaudes peuvent traduire la joie, la gaieté, le plaisir etc.<br />
- les couleurs froides peuvent signifier la tristesse, le malheur etc.<br />
B) Les contrastes<br />
Le contraste des couleurs aide le lecteur à percevoir l’organisation de l’image et en facilite la<br />
compréhension car il permet aux formes et aux volumes de se détacher.<br />
Les effets de contraste résultent :<br />
- de la couleur elle-même : une forme ou un objet rouge par exemple rayonne sur un fond<br />
noir mais il est peu lumineux sur un fond blanc.<br />
- du clair-obscur.<br />
- du jeu entre les couleurs chaudes et les couleurs froides.<br />
- du jeu entre les couleurs primaires et les couleurs complémentaires.<br />
12
Remarques :<br />
Une couleur "appelle" sa complémentaire.<br />
Deux couleurs complémentaires juxtaposées s'exaltent.<br />
Le voisinage du blanc augmente l'intensité d'une couleur, le noir la diminue.<br />
Le jaune semble "avancer" sur un fond noir et "reculer" sur un fond blanc.<br />
L'harmonie des couleurs peut jouer sur les contrastes ou au contraire sur la proximité.<br />
III/ Le niveau symbolique (l'interprétation)<br />
Interpréter un tableau consiste à:<br />
- l'observer de manière raisonnée pour tenter de comprendre comment, par la conjugaison<br />
des différents éléments iconiques, plastiques, historiques et culturels, un artiste parvient à nous faire<br />
vivre, partager une expérience esthétique.<br />
- Montrer comment cette œuvre d'art, qui est par essence l'expression singulière et unique d'une<br />
volonté à un moment précis, arrive à parler à tous et à chacun, par quelle "magie", elle nous ouvre au<br />
bonheur sublime d'accéder à un niveau et à un type de connaissance et de rapport à nous-mêmes et<br />
au monde différents.<br />
Interpréter un tableau, c'est donc :<br />
a) "mettre en perspective" toutes les conclusions obtenues à la suite des différents<br />
niveaux de lecture<br />
- la carte d'identité de l'œuvre: titre, auteur, date de création ou d'exposition, support (huile sur<br />
toile, dessin au fusain…)<br />
- ses dimensions : en cm, (hauteur et largeur), proportions standard, en miniature ou caractère<br />
monumental,<br />
- le sujet du tableau: (le message explicite) mythologie, portrait de personnages historiques<br />
célèbres, événement historique, etc.<br />
- la composition, le jeu de couleurs et de lumière, lignes de force, point de vue, etc.<br />
b) ne retenir des remarques (d'ordre formel) que celles qui permettent de souligner<br />
les aspects essentiels du tableau et qui illustrent son originalité, etc.<br />
c) rappeler les réactions qu'une œuvre a pu susciter au moment de sa parution<br />
(admiration ou scandale) et ce, afin de monter les aspects (thématiques ou<br />
formels) du tableau qui en font une œuvre originale, singulière, innovante ou en<br />
parfaite conformité avec le goût de l'époque et la tradition du genre;<br />
d) comparer l'accueil de l'œuvre par les contemporains de son auteur et l'accueil qui<br />
lui a été réservé au travers des époques et des siècles pour mettre en relief son<br />
actualité.<br />
Lecture de l'image<br />
13
Atelier 1 : le niveau iconique :<br />
Lecture de l'image<br />
Fiche formateur<br />
Présenter sur vidéo projecteur ou sur transparent une reproduction du tableau Paysage avec<br />
Icare (cf. images thème2) accompagné de quelques informations sur son auteur, la date de sa<br />
production, ses dimensions réelles, le lieu de son exposition.<br />
Demander aux participants de décrire les éléments iconiques du tableau.<br />
Modalité de travail : Travail intragroupe puis intergroupe et mise en commun<br />
Aboutir aux remarques suivantes:<br />
Le niveau iconique11<br />
Le titre : un paysage+ Icare<br />
Que voit-on?<br />
-Un paysage décrivant des hommes vacant à leurs occupations:<br />
- un fermier laboure sa terre;<br />
- un berger gardant son troupeau ;<br />
- des bateaux de pêcheurs.<br />
- En bas à droite du tableau, un détail presque invisible attire tout de même<br />
l'attention: deux jambes qui sortent de l'eau. Probablement celles d'un personnage<br />
qui se noie dans l'indifférence générale.<br />
Atelier 2: le niveau plastique<br />
b) Le sens de la lecture:<br />
Observer le tableau et répondre aux questions<br />
Par quoi le regard du spectateur est-il d'abord attiré?<br />
Comment le regard est-il orienté (dirigé) pour embrasser l'ensemble du tableau?<br />
Aboutir aux remarques suivantes:<br />
- Ce qui attire d'abord le regard c'est la couleur rouge des vêtements que porte le<br />
laboureur.<br />
- Mouvement circulaire du regard : 1le laboureur, 2l'attelage, 3 l'arbre, 4l'horizon, 5<br />
les pêcheurs; les bateaux.<br />
- La direction du vent soufflant dans les mâts ainsi que celle de la charrue<br />
En dehors de ce cercle englobant des activités humaines, on "devine" à peine la<br />
chute d' Icare.<br />
- Tout dans le tableau attire le regard du spectateur et l'oriente vers la gauche.<br />
Tout concourt à (re)présenter la chute d'Icare comme n'étant pas le sujet principal<br />
du tableau. C'est tout au plus un détail que l'on découvre presque par hasard.<br />
Rappeler que l'œil humain est d'abord interpellé par l'humain, le mouvement<br />
(l'animé) et enfin l'inanimé)<br />
c) La composition du tableau :<br />
Dégager les différents plans du tableau en identifiant<br />
- les lignes (horizontales, verticales, diagonales);<br />
- les couleurs dominantes et leur répartition sur la toile;<br />
Quel effet est ainsi obtenu?<br />
Aboutir aux éléments de réponse suivants:<br />
- des plans en diagonales;<br />
- le dégradé des couleurs (du sombre au clair);<br />
- la stabilité et la sérénité conférées au paysage par le jeu des lignes verticales et<br />
horizontales.<br />
11 Voir le site http://G:/icare.htm<br />
14
Atelier 3: Le niveau symbolique<br />
- Donner une interprétation cohérente du tableau en veillant à mettre en perspective les conclusions<br />
et commentaires faits à propos des différents niveaux de lecture;<br />
- Expliquer la signification du titre;<br />
- Rattacher le tableau à la tradition humaniste et à la vision particulière que le peintre porte sur le<br />
mythe d'Icare.<br />
Lecture du commentaire d'Anne Philippe, extrait de Le temps d'un soupir<br />
Le vol d'Icare de Breughel, plein de soleil, est l'expression même de la solitude, non pas<br />
de l'égoïsme, mais de l'indifférence qui isole les hommes les uns des autres. Il a sans<br />
doute raison, ce laboureur, de tracer son sillon pendant qu'Icare se tue. Il faut que la vie<br />
continue, que le grain soit semé ou récolté pendant que d'autres meurent. Mais on<br />
souhaiterait qu'il lâche sa charrue et aille au secours de son prochain. Je me trompe peutêtre<br />
et sans doute ignore-t-il qu'un homme se tue. Il est aussi inconscient que la mer et le<br />
ciel, que les collines et les rochers. Icare meurt, non pas abandonné mais ignoré. Chacun<br />
de nous est comme ce laboureur. Chaque fois que l'on sort, on passa à côté d'un<br />
désespoir, d'une souffrance ignorée. On ne voit pas les regards implorants, ni les misères<br />
de l'âme ou du corps. Je suis loin de mon prochain. Si j'en étais vraiment proche,<br />
j'abandonnerais toujours sans même y réfléchir ce que je suis occupée à faire, pour aller<br />
vers lui.<br />
Lecture de l'image<br />
15
Lecture de l'image<br />
Fiche formateur<br />
EXERCICES (individuels ou en groupes) : Lecture de tableaux<br />
1) Le Serment des Horaces (1784) de Jacques-Louis David<br />
Jacques-Louis David, Le Serment des Horaces, 1784.<br />
Huile sur toile, 330cm x 425cm. Musée du Louvre, Paris<br />
Jacques-Louis David ; Le Serment des Horaces (1784) ; huile sur toile (330x425cm).<br />
Musée du Loure.Paris<br />
Observons le tableau :<br />
I/ Le niveau iconique :<br />
Que voyez-vous ?<br />
Des personnages :<br />
- Trois soldats qui tendent le bras droit vers trois épées tenues par un vieux (un vieillard),<br />
un homme qui paraît plus vieux que les autres.<br />
- Trois femmes (qui pleurent).<br />
- Deux enfants.<br />
Comment sont-ils vêtus ?<br />
- Les trois soldats portent : un casque, une tunique, une culotte et un cap.<br />
- Le vieil homme ne porte pas de casque. Il porte un cap rouge.<br />
Quelle époque cela vous rappelle-t-il?<br />
- L'époque romaine: des citoyens / des hommes libres<br />
A quoi renvoie donc ce tableau ? ⇒ à la mythologie romaine (cf. le titre du tableau).<br />
Quand a-t-il été peint ? – en 1784<br />
D'après le titre du tableau qui sont les 3 personnages placés à gauche ?<br />
- Les Horaces<br />
Le vieil homme qui peut-il être ?<br />
- Le père<br />
Les femmes et les enfants ?<br />
16
Conclusion : c'est une scène "familiale".<br />
Où se passe la scène ?<br />
- Dans une cour<br />
- Trois arcades<br />
- Sol dallé – fond sombre.<br />
- Décor simple / sobre / absence de faste.<br />
Où se trouvent les personnages par rapport aux arcades ?<br />
- Chaque groupe de personnages occupe une arcade (se situe dans le prolongement d'une<br />
arcade).<br />
Pourquoi pouvons-nous bien distinguer les personnages ?<br />
- Parce que le fond est sombre.<br />
Quel effet cela donne-t-il aux personnages ?<br />
- On peut mieux les voir, les distinguer (idée de netteté).<br />
- Ils sont mis en valeur par rapport au décor.<br />
II/ Le niveau plastique :<br />
A/ Les plans<br />
Quelle est la partie éclairée du tableau ?<br />
Tous les personnages.<br />
D'où vient l'éclairage ?<br />
Quelle est la partie sombre?<br />
Les arcades et une partie de la cour.<br />
Combien de plans peut-on distinguer?<br />
(Deux plans)<br />
- 1 er plan → les personnages. Ils sont mis en valeur.<br />
Ils sont importants.<br />
- 2 ème plan (second plan ou arrière-plan) → le décor est simple / austère.<br />
B/ L'attitude des personnages :<br />
1/ Quelle est la position des trois soldats ?<br />
- jambes écartées – bras tendus – tête levée.<br />
Comment sont posés leurs pieds sur le sol ?<br />
- bien posés → solidité – force assurance.<br />
Comment sont leurs jambes et leurs bras? → musclés. Cela traduit la force – la détermination.<br />
Que regardent-ils ? les épées.<br />
Vers quoi tendent-ils les bras ? vers les épées.<br />
Ils se soutiennent → ils sont solidaires. C'est comme s'il s'agissait d'un seul homme.<br />
2/ Le vieil homme (le père)<br />
Quelle place occupe-t-il dans le tableau ?<br />
Il est au centre du tableau. C'est le personnage le plus important.<br />
Comment se tient-il ?<br />
Droit – la tête haute – jambe droite en avant.<br />
Que tient-il à la main gauche ?<br />
Trois épées.<br />
Que regarde-t-il ?<br />
Il regarde les épées.<br />
Les épées, il les garde entre les mains ou il les tend vers les trois soldats ?<br />
Il les tend vers les trois soldats.<br />
Qu'est ce qui le montre ?<br />
Il les tient par la main gauche et il libère sa main droite.<br />
De nombreux éléments convergent vers les trois épées. Lesquels?<br />
Le regard – les mains – la position des jambes.<br />
Si on essaye de tracer des lignes en direction du point vers lequel convergent ces éléments quelles<br />
lignes peut-on avoir?<br />
Lecture de l'image<br />
17
Où se trouvent-elles ces lignes ?<br />
Elles se trouvent au milieu du tableau, au milieu de la 3 ème arcade.<br />
Comment appelle-t-on ces lignes ? Les lignes de fuite.<br />
Comment appelle-t-on le point de rencontre de ces lignes? C'est le point de fuite.<br />
En quoi est-ce important ?<br />
Les lignes de fuite créent la perspective. Dans ce tableau, elles donnent un effet de<br />
profondeur. Grâce au point de fuite (et aux lignes de fuite), on découvre que dans ce tableau il y a<br />
trois dimensions : les arcades – les hommes – les femmes.<br />
3/ Les femmes<br />
Quelle est la position des femmes ?<br />
Elles ont le dos courbé, la tête baissée. L'une d'elle donne l'impression d'être évanouie.<br />
Si on essaie de lier par un trait la femme habillée en blanc avec celle qui tient les deux enfants, que<br />
va-t-on obtenir ?<br />
Une courbe.<br />
Cela contraste avec quoi ? Cela s'oppose à la position debout, la tête levée du père et des enfants.<br />
Comment vous semble-t-elles ces femmes ? Elles ont peur. Elles sont abattues. De quoi (Pourquoi)<br />
ont-elles peur ?<br />
- Elles ont peur pour les trois bommes, les trois soldats. Cela confirme l'idée qu'il s'agit<br />
d'une scène familiale.<br />
C/ Les couleurs :<br />
Quelles sont les couleurs dominantes dans ce tableau ?<br />
Couleurs froides mis à part la couleur rouge.<br />
Quelle atmosphère traduisent les couleurs froides ?<br />
Atmosphère morne, pesante, dramatique, pathétique, solennelle.<br />
Qu'est-ce qui accentue / confirme cette atmosphère solennelle? Le lieu<br />
Quelle est la couleur chaude?<br />
- Le rouge.<br />
Où la voit-on ?<br />
- Le père est presque entièrement habillé en rouge. Les Horaces portent du rouge<br />
(partiellement).<br />
- Le gris est rompu par la couleur rouge.<br />
Il y a donc un contraste de chaud et froid.<br />
- Le chaud est central. Le froid est environnant.<br />
Il y a donc un jeu sur les couleurs qui donne un sens au tableau.<br />
Lecture de l'image<br />
18
Le père tend les épées aux Horaces ; mais qu'est-ce qu'il leur communique en même temps?<br />
- La couleur rouge.<br />
Le rouge c'est la couleur du sang / de la révolte / de la révolution / du sacrifice etc. / C'est<br />
le prix à payer pour vivre en paix, pour vivre heureux etc.<br />
D/ Les formes<br />
Elles sont claires et nettes. Effet de réel. On perçoit une certaine sévérité dans les formes<br />
(raideur des muscles) et une certaine dureté (geste – regard).<br />
Ces formes laissent penser que ce tableau est comme une photographie du réel mais on se<br />
détonne rapidement de cette idée puisqu'il est question de personnages mythologiques.<br />
Pourquoi donc David a-t-il peint ce tableau à ce moment précis de l'Histoire.<br />
Interprétation (le niveau symbolique)<br />
Cette toile a été peinte en 1784, cinq ans avant la Révolution française. Dans ce tableau<br />
géant, monumental (330 x 425cm), David décrit une scène au cours de laquelle un vieil homme (un<br />
père) tend des épées à ses enfants, les Horaces. Pourquoi a-t-il donné une telle importance à cette<br />
scène par le choix d'un tableau phénoménal ? Il veut certainement impressionner les observateurs,<br />
les visiteurs du Louvre à l'époque et montrer qu'il s'agit d'une œuvre grandiose.<br />
Pourquoi ce retour à la mythologie gréco-romaine ?<br />
"Le tableau représente un épisode de l'histoire romaine : des citoyens, des hommes libres,<br />
recourent aux armes pour défendre la République."<br />
Le père "incite" ses enfants à prendre les armes pour défendre la nation. Les enfants<br />
acceptent de se sacrifier pour la patrie, de la défendre à tout prix (la couleur rouge c'est la couleur du<br />
sang, de la révolution). Ce qui explique leurs attitudes (le père ainsi que les enfants) et leur<br />
détermination à prendre la relève. Ainsi on comprend mieux la désolation des femmes traduite par leur<br />
attitude (tête baissée – dos courbé etc.)<br />
Pourquoi David a-t-il choisi des couleurs froides ?<br />
D'abord, il ne voulait pas donner l'impression de pittoresque à son tableau mais d'austérité et de<br />
pathétique. A travers les formes peintes, il se dégage aussi l'idée de sévérité et de dureté qui exprime<br />
du pathétisme épique, révolutionnaire.<br />
Le tableau est intitulé Le Serment des Horaces. Ces derniers ont donc juré d'être fidèles à la patrie.<br />
Cet engagement se manifeste dans leur attitude et leur geste (bras tendus).<br />
Ce "serment" est glorifié par DAVID. Mais pourquoi à ce moment précis de l'Histoire de France<br />
(1784).<br />
Le XVIII ème siècle c'est le siècle des Lumières. DAVID a donc perçu un certain changement qui<br />
s'est manifesté au niveau des idées. En fait, ce ne sont plus les rois, les princes ou les nobles qui<br />
décident du sort de la nation mais plutôt les citoyens, les gens du peuple. Ce sont ces gens là qui sont<br />
responsables du destin du pays, du destin de la nation.<br />
En peignant ce tableau à la veille de la révolution française DAVID a voulu montrer qu'un<br />
changement est en train de se faire (on doit se faire) au niveau des idées. Ce n'est pas par hasard si<br />
les contemporains de DAVID ont considéré ce tableau comme "le plus beau tableau du siècle".<br />
D'ailleurs, sur le plan pictural, le peintre a rompu avec le baroque qui accordait de l'importance au<br />
faste de la cour et de la noblesse.<br />
David qui est revenu à la peinture classique en cherchant ses modèles dans la mythologie grécoromaine<br />
a réussi à se créer son propre style : se servir de la mythologie pour démontrer une idée.<br />
C'est le néo-classicisme: "l'œuvre d'art est conçue comme la forme artistique d'une pensée, politique<br />
par exemple comme chez David. Les tableaux néo-classiques sont en ce sens des "tableaux d'idées".<br />
Peut-on dire alors que dans ce tableau David annonce déjà la Révolution française ou du moins en<br />
a-t-il saisi des signes précurseurs. Cette œuvre est-elle donc prémonitoire ?<br />
Lecture de l'image<br />
19
Lecture de l'image<br />
Fiche enseignant<br />
Observons le tableau :<br />
I/ Le niveau iconique :<br />
Que voyez-vous ?<br />
Comment les personnages sont-ils vêtus ?<br />
Quelle époque cela vous rappelle-t-il<br />
- A quoi renvoie donc ce tableau ? Quand a-t-il été peint ?<br />
- D'après le titre du tableau qui sont les 3 personnages placés à gauche ?<br />
- Qui sont les autres personnages : le vieil homme, les femmes et les enfants ?<br />
Où se passe cette scène ?<br />
Où se trouvent les personnages par rapport aux arcades ?<br />
Pourquoi pouvons-nous bien distinguer les personnages ?<br />
Quel effet cela donne-t-il aux personnages ?<br />
II/ Le niveau plastique :<br />
A/ Les plans<br />
- Quelle est la partie la plus éclairée du tableau ?<br />
- D'où vient l'éclairage ?<br />
- Quelle est la partie sombre? Combien de plans peut-on distinguer?<br />
B/ L'attitude des personnages :<br />
1/ Quelle est la position des trois soldats ?<br />
- Que traduit la position des pieds et des bras des trois personnages?<br />
- Dans quelle direction regardent-ils? Que regardent-ils ?<br />
- Vers quoi tendent-ils les bras ?<br />
2/ Le vieil homme (le père)<br />
- Quelle place occupe-t-il dans le tableau ?<br />
- Comment se tient-il ?<br />
- Que tient-il à la main gauche ?<br />
- Que regarde-t-il ?<br />
- Qu'est ce qui le montre ?<br />
- De nombreux éléments convergent vers les trois épées. Lesquels?<br />
- Si on trace des lignes en direction du point vers lequel convergent ces éléments, quelles<br />
lignes peut-on avoir?<br />
- Où ces lignes se trouvent-elles?<br />
- Comment appelle-t-on ces lignes ?<br />
- Comment appelle-t-on le point de rencontre de ces lignes? En quoi est-ce important<br />
3/ Les femmes<br />
Quelle est la position des femmes ?<br />
Si on essaie de lier par un trait la femme habillée en blanc avec celle qui tient les deux enfants, quelle<br />
figure géométrique obtient-on?<br />
Avec quelle autre attitude cela constitue-t-il un contraste?<br />
Quel sentiment l'attitude du groupe des personnages femmes + enfant semble –t-elle traduire?<br />
Pourquoi?<br />
C/ Les couleurs :<br />
Quelles sont les couleurs dominantes dans ce tableau ?<br />
Quelle atmosphère traduisent les couleurs froides ?<br />
Qu'est-ce qui accentue / confirme cette atmosphère?<br />
Reconnaissez-vous une couleur chaude? Laquelle ? Où la voit-on ?<br />
Que symbolise cette couleur?<br />
D/ Les formes<br />
Quelles sont les formes que vous distinguez dans ce tableau?<br />
A quelle valeur symbolique ces formes sont –elles généralement associées?<br />
Interprétation (le niveau symbolique)<br />
En autonomie.<br />
Rédigez un texte dans lequel vous essayez de construire une interprétation globale du tableau<br />
et ce, en tirant profit des conclusions et commentaires obtenus à travers les différents niveaux de<br />
lecture.<br />
20
Lecture de l'image<br />
Fiche animateur<br />
1) Café de nuit-intérieur de Vincent Van Gogh<br />
Présentation de l'artiste et de son œuvre<br />
Vincent Van Gogh 12 (1856-1890) est un peintre hollandais qui a mené une vie mouvementée<br />
entre la Hollande, la Belgique et la France. Il a connu de nombreux artistes tels que Toulouse –<br />
Lautrec, Bernard, Pissarro, Seurat, Signac etc.<br />
C'est à Arles que son génie s'est manifesté le plus : les années 1888-1890 sont les plus fécondes<br />
et les plus originales dans sa carrière.<br />
En effet, ses toiles les plus célèbres – dont "Le Café de nuit" – ont été peintes à Arles.<br />
Vincent VAN GOGH, Le Café de nuit-intérieur, 1888<br />
12 Voir annexe 5 La lettre à Théo<br />
21
I/ Le niveau iconique :<br />
Nous commençons d'abord par décrire ce que nous voyons dans ce tableau.<br />
Il y a d'abord un billard qui est placé au milieu du tableau. L'ombre du billard que l'on peut bien<br />
distinguer sur le sol montre que la lumière qui vient d'en haut (du plafond que l'on voit à peine) est très<br />
forte. En effet, quatre lampes accrochées au plafond – peint en vert – éclairent la salle qui semble<br />
baigner dans la lumière : cette lumière est très vive. En témoigne la couleur du sol.<br />
A droite et à gauche du billard, on peut distinguer des consommateurs, des clients qui sont en<br />
nombre réduit (5 au total) mais qui semblent dormir, somnoler, des tables et des chaises "libres" et un<br />
personnage debout, seul, habillé en blanc mais, sous l'effet de la lumière, son costume est devenu<br />
jaunâtre. Il semble regarder et poser pour "un photographe".<br />
Sur les tables, on peut voir des bouteilles de vin ou de bière et des verres. Au fond de la salle, il y a<br />
une sorte de comptoir sur lequel sont entassées des bouteilles. C'est donc un café où l'on peut boire<br />
de l'alcool.<br />
Sur ce même comptoir de couleur verdâtre, il y a un vase de fleurs assez importantes de par leur<br />
forme.<br />
Derrière ce comptoir mais légèrement à gauche il y a comme une entrée d'où sort une lumière<br />
jaune assez vive.<br />
Sur le mur du fond au dessus du comptoir, est accrochée une grande montre de forme circulaire<br />
qui indique l'heure : minuit quinze minute environ.<br />
Le contour de cette montre est de couleur marron. Une partie du mur – sur lequel on a placé la<br />
montre – est noire.<br />
Une sorte de tableau "illisible" est accroché au mur.<br />
II/ Le niveau plastique<br />
1/ Un lieu en perspective<br />
Personnages et objets sont vus d'en haut par Van Gogh. Si l'on trace des lignes perspectives, on<br />
voit bien qu'il est placé en hauteur pour regarder l'intérieur du café. Il surplombe le lieu. C'est comme<br />
s'il se trouvait au niveau des lampes accrochées au plafond.<br />
Les lignes perspectives montrent que l'intérieur de ce café, très large au départ, se rétrécit au fond.<br />
Cela se voit au niveau du sol, des murs et du plafond ainsi qu'au niveau du billard et de son ombre.<br />
De plus, vus d'en haut, les consommateurs ainsi que le garçon sont assez petits de taille et sont<br />
comme écrasés. En tout cas, ils donnent l'impression d'être "abattus".<br />
Par ailleurs, les ampoules qui éclairent ce lieu sont assez grandes (démesurées). Le peintre peut<br />
bien les voir de par sa position ("élevée").<br />
Lecture de l'image<br />
22
2/ Un éclairage étonnant<br />
Ce café baigne dans la lumière : une lumière vive éclatante, difficile à supporter. Elle sort de quatre<br />
lampes "géantes" de forme assez bizarre : circulaire et oblongue. Cette lumière est aussi circulaire: en<br />
témoigne la touche du peintre. C'est de petits traits jaunâtres qui entourent les lampes et non pas des<br />
faisceaux lumineux. On dirait que la lumière est en train de tournoyer dans la salle. Quel en est l'effet<br />
sur les clients ? Ils semblent être foudroyés par la lumière car ils ont tous la tête baissée et ils<br />
semblent dormir. (Ils auraient la tête qui tourne !) C'est comme s'ils voulaient se protéger contre cette<br />
lumière.<br />
3/ La palette du peintre<br />
Les couleurs utilisées par Van Gogh sont le jaune, le rouge, le vert, le bleu et l'orange.<br />
Le bleu, le rouge et le jaune sont des couleurs complémentaires.<br />
On constate qu'il y a un rapprochement, une juxtaposition des couleurs.<br />
Ainsi, le rouge est placé entre le jaune et le vert pour lui donner plus d'éclat, pour le mettre en<br />
relief.<br />
Le jaune et le rouge sont deux couleurs primaires : elles sont juxtaposées afin qu'elles gardent leur<br />
netteté, leur pureté et que le contraste soit évident.<br />
Le dessus des tables est peint en bleu : couleur primaire qui contraste avec le rouge et le jaune.<br />
Le vert, couleur complémentaire du rouge est placé à côté du rouge mais il contraste avec le jaune.<br />
On constate que Van Gogh par le jeu des couleurs a choisi de choquer le lecteur pour lui montrer<br />
que le lieu qu'il décrit n'a rien d'harmonieux, de calme. C'est un lieu dont les couleurs chaudes<br />
dominent. Ces couleurs traduisent l'idée de violence, d'atmosphère difficile à supporter où il est<br />
difficile de vivre.<br />
Lecture de l'image<br />
23
4/ Les personnages :<br />
Ils sont seuls puisqu'ils sont éloignés les uns des autres. Ils sont "à côté du mur". Leurs traits ne<br />
sont pas nets. Ils sont méconnaissables, indéfinis, anonymes.<br />
Leur position est significative : accoudés aux tables, ils semblent dormir. En tout cas, ils donnent<br />
l'air d'être épuisés, crevés.<br />
Seul le personnage debout, nous pouvons distinguer son visage. Mais il est seul, il ne sait quoi<br />
faire. En fait qui est-il? Que regarde-t-il? Ou bien est-t-il en train de rêver ?<br />
III/ Le niveau symbolique (cf. annexe 5)<br />
"Le café de nuit" est un lieu étonnant. Sa forme géométrique n'est pas respectée. En effet, la<br />
perspective choisie par le peintre (des plans du sol, des murs et des meubles) ne correspond pas à la<br />
géométrie de l'espace. Car il paraît évasé, agrandi, ouvert, "écartelé". L'artiste y voit donc un endroit<br />
peu commun, bizarre anormal qui n'est pas conforme à la géométrie de l'espace. L'impression d'ordre<br />
donnée par la perspective est rompue par le non respect des règles géométriques. Il s'agit donc d'un<br />
lieu peu habituel, à valeur symbolique.<br />
L'éclairage assez particulier de ce café est très significatif. D'abord la lumière jaune, verte et<br />
orange dégagée par les quatre lampes accrochées au plafond est très vive: son éclat sur le sol le<br />
montre. Ensuite, la couleur de l'habit blanc du personnage qui se tient debout, les mains dans les<br />
poches, à côté du billard (qui est le patron d'après Van Gogh) est devenue jaunâtre.<br />
Les lampes sont plutôt basses et font jaillir une lumière "circulaire", giratoire qui va dans tous les<br />
sens. C'est comme si elle foudroyait celui qui se trouvait dans son sillage. Or, puisqu'elle éclaire le<br />
café cela signifie que les personnages ainsi que les objets sont modifiés par elle. En effet, le vert du<br />
billard et celui du comptoir sont des verts adoucit par la lumière, rompus par elle. Le rouge est<br />
accentué par la lumière : le contraste est évident.<br />
La dominance des couleurs chaudes est significative car les lampes diffusent de la lumière mais<br />
aussi de la chaleur. Donc, l'intérieur du café est chaud (puisque le jaune est partout) et en même<br />
temps, il s'en dégage l'idée de violence qui résulte du choix des couleurs, des contrastes entre les<br />
couleurs.<br />
D'ailleurs, cela se voit au niveau de l'attitude, de la position des consommateurs : ils sont assis, ils<br />
se cachent le visage, ils baissent la tête ou carrément ils somnolent et subissent la lumière. C'est<br />
comme s'ils se résignaient à encaisser "les coups de lumière". Ils sont assommés par les couleurs, la<br />
lumière et la chaleur qui règne dans ce lieu extra-ordinaire, transformé par la sensibilité du peintre en<br />
une véritable "fournaise infernale".<br />
En effet, les personnages se sentent et se trouvent réellement seuls dans ce lieu plutôt lugubre où<br />
ils sont entourés d'objets hostiles puisqu'ils se caractérisent par des couleurs froides (bleu – vert –<br />
marron…).<br />
En réalité, dans ce tableau tout se joue au niveau des contrastes des couleurs. Car c'est par ce jeu<br />
des couleurs que Van Gogh voulait exprimer ses émotions, ses sensations. D'ailleurs, l'intensité des<br />
Lecture de l'image<br />
24
couleurs est toujours la même, quelle que soit la profondeur et l'éloignement dans l'espace. Sur ce<br />
plan-là, le peintre fait preuve d'originalité et rompt avec "la perspective chromatique connue depuis la<br />
renaissance". A travers l'intensité des couleurs, il voulait exprimer "une réalité ressentie, chargée de<br />
tensions".<br />
Par les contrastes de couleurs, il voulait traduire ses émotions mais aussi suggérer une lecture du<br />
tableau.<br />
Ses couleurs sont pures et ont une valeur symbolique. De ce point de vue Van Gogh s'inscrit dans<br />
la lignée des impressionnistes qu'il a bien connus : Camille Pissaro, Georges Seurat, Claude Monet<br />
etc. Mais en même temps, il les dépasse dans la mesure où il n'utilise pas la couleur "à seule fin de<br />
représenter des effets physiques" mais aussi pour "ses pouvoirs d'émotion, d'expression et de<br />
décoration". Ainsi dans l'une des lettres envoyées à son frère Théo, il avait écrit : "Je voudrais peindre<br />
des hommes ou des femmes avec ce je ne sais quoi d'éternel, dont autrefois le nimbe était le<br />
symbole, et que nous cherchons par le rayonnement même, par la vibration de nos colorations."<br />
Pourquoi Van Gogh a-t-il peint l'intérieur de ce café ?<br />
C'est l'intérieur du café de l'Alcazar (qui existe toujours) situé sur la Place Lamartine où Van Gogh<br />
a logé au début de son séjour à Arles.<br />
"Dans mon tableau du Café de nuit, j'ai cherché à exprimer que le café est un endroit où l'on peut<br />
se miner, devenir fou, commettre des crimes." Van Gogh, 1888)<br />
En choisissant de peindre ce lieu, Van Gogh rejoint les impressionnistes qui "ont fermement rejeté<br />
l'idée qu'un sujet artistique devait avoir une valeur littéraire intrinsèque ou qu'il devait, pour être digne<br />
d'être représenté, être précieux ou instructif". C'est pourquoi, ils se sont attachés à peindre ce qu'ils<br />
voyaient et non pas ce qu'ils savaient. Dans ce sens, ils ont rompu avec une certaine tradition<br />
artistique pour fonder une nouvelle école. Ils ont ainsi cherché à développer de nouvelles techniques<br />
pour déployer leurs talents.<br />
A propos des impressionnistes il a écrit à son frère : "[…] Je dis cela pour te faire comprendre<br />
quelle sorte de lieu m'attache aux peintres français qu'on nomme les impressionnistes, pour te dire<br />
que je connais personnellement beaucoup d'entre eux, et que je les aime.<br />
Et aussi que, dans ma propre technique, j'ai les mêmes idées concernant les couleurs, que je<br />
pensais déjà comme eux, autrefois en Hollande."<br />
Ainsi par le sujet et la technique Van Gogh s'inscrit dans le courant impressionniste mais il s'en<br />
distingue par le sens qu'il donne aux couleurs pour exprimer des émotions et des sensations. Ainsi, il<br />
fait œuvre originale-post impressionniste : ce qui compte le plus ce sont les "effets produits par la<br />
couleur et la vision".<br />
Lecture de l'image<br />
25
Lecture de l'image<br />
Fiche formateur<br />
3) Nicolas poussin ; Paysage avec Orphée et Eurydice, (1594-1665), huile sur toile, 124 X 200 cm,<br />
Paris, musée du Louvre. (cf. images thème 2 et annexe 6)<br />
1/ Le niveau iconographique:<br />
(Qu'est-ce que je vois? Qui? Quoi? Où?)<br />
La scène:<br />
Légèrement décalée vers la droite, la scène se déroule au premier plan, sur les bords d'un<br />
lac, dans une atmosphère imprégnée de calme et de bonheur. Il semblerait que la célébration des<br />
noces d'Orphée13 vient de s'achever comme le suggèrent les objets réunis près de l'arbre à droite: un<br />
vêtement rouge accroché à une branche (vases précieux, paniers, fleurs, deux couronnes, deux<br />
carquois);<br />
Les protagonistes:<br />
Consigne:<br />
- Identifiez les différents personnages.<br />
- Caractérisez l'attitude adoptée par chacun d'entre eux.<br />
- Que font-ils?<br />
- Quelle conclusion en tirez-vous ?<br />
Orphée: assis sur un rocher, il chante, jouant de sa lyre.<br />
Les nymphes nonchalamment allongées à ses pieds, sont sous le charme de la musique.<br />
Personnage couronné, debout, drapé d'un manteau blanc recouvrant une robe rouge<br />
(symbolise peut-être "Hyménée", dieu du mariage).<br />
Au centre, Eurydice, agenouillée,<br />
Un pêcheur se retourne.<br />
Une foule de personnages au fond (haleurs, baigneurs, silhouettes de personnages aux<br />
environs des maisons au loin).<br />
Conclusion<br />
Chaque personnage a une attitude particulière:<br />
Orphée: Tout à son bonheur, le regard tourné vers le ciel. Inconscient du drame qui se joue<br />
pourtant devant lui.<br />
Hyménée: Debout au centre du tableau, tournant le dos à Eurydice, le regard presque<br />
indifférent à ce qui se passe autour de lui.<br />
Eurydice: agenouillée, visage marquant l'effroi et tourné vers l'arrière: elle est effrayée par un<br />
serpent à peine visible, dissimulé dans l'herbe. Elle a été ou va être mordue.<br />
Le pêcheur: se retourne, dirige son regard vers Eurydice; probablement surpris par le cri de<br />
cette dernière.<br />
Scène dramatique:<br />
Contraste violent entre :<br />
le chant d'Orphée et le cri d'Eurydice:<br />
l'apparence d'harmonie et le drame imminent.<br />
Poussin choisit ce moment intensément dramatique avant la mort: il rassemble ainsi dans une<br />
seule image - l'unité du lieu prenant le pas sur celle de temps- deux épisodes du récit: le chant<br />
13 Voir annexe 6 " le mythe d'Orphée".<br />
26
d'Orphée, ses effets sur son auditoire ainsi que le cri d'Eurydice avant la mort. L'horreur frappe au<br />
milieu du bonheur.<br />
2/ Les éléments de formulation plastiques<br />
a) La composition:<br />
Consigne:<br />
- Sur toute la surface du tableau, se déploie un admirable paysage savamment composé.<br />
On y distingue nettement une succession de plans horizontaux et verticaux.<br />
- Dégagez les plans horizontaux et verticaux qui structurent le tableau.<br />
- Quel commentaire peut-on faire sur l'attitude particulière d'Eurydice par rapport au groupe<br />
d'Orphée d'un côté et par rapport au pêcheur de l'autre?<br />
Plans horizontaux:<br />
la rive du lac,<br />
le lac miroir et ses multiples reflets,<br />
la barre des "fabriques" devant la silhouette des montagnes qui se dessinent sur un ciel<br />
imposant.<br />
Plans verticaux:<br />
les lignes verticales de l'architecture et des arbres viennent couper les zones horizontales.<br />
L'attitude d'Hyménée, debout<br />
Effet obtenu: lignes horizontales + lignes verticales = impression d'harmonie, de stabilité et<br />
d'équilibre.<br />
Position particulière d'Eurydice:<br />
Liée au groupe d'Orphée par la direction du bras et la position de la jambe (vers la droite) ≠<br />
elle s'en détourne par un brusque mouvement de la tête et l'ouverture du corps (vers la gauche).<br />
b) La lumière:<br />
Consigne:<br />
- De quel côté la lumière semble-t-elle arriver?<br />
- S'agit-il d'une lumière naturelle ou plutôt d'une lumière artificielle?<br />
- Quel effet l'alternance de zones d'ombre et de lumière permet-elle de créer?<br />
La lumière – artificielle- arrive de arrive de la gauche;<br />
l'alternance de zones d'ombre et de lumière permet de créer un rythme et de cerner avec<br />
précision les plans, les contours et les formes;<br />
Les couleurs:<br />
Consigne :<br />
- Quelles sont les couleurs qui prédominent ? Comment se répartissent-elles dans le<br />
tableau?<br />
- Quel rôle jouent-elle dans la composition générale da la scène?<br />
- Quel effet est obtenu par l'alternance des couleurs? Cela confirme-t-il les conclusions sur<br />
les autres éléments de formulation plastique décrits précédemment?<br />
contraste couleurs claires (scène au bord du lac) et masses de couleurs sombres qui<br />
cadrent le tableau (à gauche et à droite: les arbres et l'ombre, de la forteresse s'élèvent<br />
d'épaisses fumées noires, des nuages noirs s'amoncellent dans le ciel.<br />
Contraste entre:<br />
- couleurs chaudes ≠ couleurs froides<br />
- noir ≠ rouge<br />
- et rouge ≠ jaune<br />
Effet d'harmonie et de rythme<br />
3/ Interprétation : niveau symbolique:<br />
Consigne:<br />
En vous appuyant sur les conclusions obtenues à la suite des différents niveaux de lecture,<br />
construisez une analyse/interprétation du tableau:<br />
Sujet: un paysage "classique" ou "idéal": s'inspirant de la nature, chaque élément y est<br />
nettement identifiable- lac, colline, arbres, montagnes, personnages- mais l'ensemble est une<br />
"recréation" idéale d'un épisode du mythe d'Orphée.<br />
Aucune difficulté, en effet, à reconnaître le sujet du tableau: il s'agit évidemment du mythe<br />
d'Orphée.<br />
Mais un jeu de contrastes entre:<br />
Lecture de l'image<br />
27
- l'harmonie générale du paysage et l'imminence du drame qui se prépare;<br />
- la sensualité des nymphes (envoûtées par le chant d'Orphée) et l'horreur qui se lit sur le<br />
visage d'Eurydice;<br />
- description (l'aspect statique de la partie droite du tableau) et narration (mouvements<br />
décrits par l'attitude d'Eurydice et du pêcheur dans la partie droite);<br />
Conclusions:<br />
Sérénité et grandeur de la nature: impassible, indifférente aux destinées mortelles<br />
des humains. Walter Friedlaender lit dans ce tableau: " le sentiment de la fragilité de<br />
l'existence, sans cesse menacée par des catastrophes dont les hommes sont inconscients."<br />
La barque pourrait évoquer celle de Charon aux Enfers.<br />
Le serpent signifie l'apparition de la mort brutale dans ce paysage idyllique, une<br />
représentation de la mort et de l'inéluctable finitude humaine.<br />
Valeur symbolique :<br />
- désir de mettre le monde en harmonie: son chant rassemble les éléments<br />
épars de la nature (minéraux, végétaux, animaux) pour créer l'harmonie<br />
universelle;<br />
- le pouvoir d'Orphée sur les êtres et les choses: fascination, pouvoir,<br />
tyrannie, soumission?<br />
- Risque de perdre la conscience de ses actes?<br />
- l'enchantement de la musique: a-t-elle toujours des effets positifs?<br />
- Orphée artiste: la fonction, le rôle de l'artiste et le mystère de la création ?<br />
Lecture de l'image<br />
28
Lecture de l'image<br />
Fiche formateur<br />
D'autres tableaux figurant dans les manuels de 3 ème année peuvent être proposés au<br />
titre de travail en autonomie.<br />
1. Jean- Baptiste Corot 14 : Orphée ramenant Eurydice (1861). Huile sur toile, 111,8x137, 7 cm.<br />
(cf. images thème 2)<br />
Orphée, la lyre à la main, guide sa bien-aimée hors du royaume d'Hadès. Insertion du mythe<br />
dans un paysage familier:<br />
- un paysage familier de sous-bois,<br />
- un paysage vaporeux, aux riches nuances de gris;<br />
- un jeu de lumière marquant le passage progressif du monde des morts à<br />
celui des vivants;<br />
- contraste entre les deux univers (jeunesse, dynamisme, mouvement,<br />
amour, vie) ≠ (grisaille, statisme des figures tristes de la mort en arrière<br />
plan).<br />
.<br />
2. Jean Delacroix 15; Orphée apporte la civilisation en Grèce ( 1838), 735x1098 cm, fresque.<br />
(cf. images thème 2)<br />
Au centre, jouant de sa lyre, il apporte aux Grecs dispersés et livrés à la vie sauvage les<br />
bienfaits des arts et de la civilisation, tandis que les deux divinités des arts et de la paix quittent le ciel<br />
pour descendre sur la terre en entendant la voix de l'enchanteur.<br />
Les Thraces (couleur brune) prolongent la nature. ≠ Orphée, prêtre et poète, teint plus clair,<br />
robe blanc-bleu, rouleau manuscrit à la main (rouleau qui lui a été transmis par Déméter et Athéna).<br />
Il apporte la lumière: symbole du passage de la terre et au divin.<br />
Rapprochement possible avec un poème Paul Valéry :<br />
Orphée, in Album de vers anciens, (1990), recueil de Poésies, Ed. Gallimard, 1957<br />
...Je compose en esprit, sous les mythes, Orphée<br />
L'admirable!...Le feu des cirques purs descend;<br />
Il change le mont chauve en auguste trophée<br />
D'où s'exhale d'un dieu l'acte retentissant.<br />
Si le dieu chante, il rompt le site tout-puissant;<br />
Le soleil voit l'horreur du mouvement des pierres;<br />
Une plainte inouïe appelle éblouissants<br />
Les hauts murs d'or harmonieux d'un sanctuaire.<br />
Il chante, assis au bord du ciel splendide, Orphée!<br />
Le roc marche, et trébuche; et chaque pierre fée<br />
Se sent un poids nouveau qui vers l'azur délire!<br />
D'un temple à demi nu le soir baigne l'essor,<br />
Et soi-même il s'assemble et s'ordonne dans l'or<br />
À l'âme immense du grand hymne sur la lyre!<br />
3. Caspar David Friedrich (1774-1840)16 ; Voyageur contemplant une mer de nuages, vers 1818.<br />
Peinture, 74,8x 94,8 cm. (cf. images thème 2)<br />
1- Ce que le tableau dit/ présente/ représente<br />
Quel est le sujet du tableau? Dans quelle mesure le titre " Voyageur contemplant une mer de nuages"<br />
vous semble t-il s'appliquer au tableau?<br />
Quels éléments plastiques correspondent à la métaphore contenue dans le titre " une mer de<br />
nuages"?<br />
Quels détails permettent de reconnaître le "voyageur"?<br />
14 Voir manuel 3 ème Sciences, Economie p. 100, module 2<br />
15 idem<br />
16 Voir manuel 3 ème lettres, p.8 module 1<br />
29
Aboutir aux conclusions suivantes:<br />
a. le paysage est composé de plusieurs vallées noyées dans la brume et les nuages derrière<br />
lesquelles des montagnes s'étendent à l'horizon, ce dernier ouvre sur un grand espace de ciel<br />
très lumineux.<br />
b. au premier plan, tournant le dos au spectateur, tout de noir vêtu et s'appuyant sur sa canne,<br />
le marcheur, - arrivé au sommet d'une montagne rocheuse- contemple l'immensité du<br />
paysage qui s'offre à son regard.<br />
2- Les éléments de formulation plastique<br />
- Combien de plans peut-on distinguer dans le tableau? Quels éléments plastiques permettent de les<br />
reconnaître (lumière, couleur…)?<br />
- Où se situe le centre géométrique du tableau et le point de fuite du paysage?<br />
- Quel organe du corps du voyageur est ainsi mis en relief? Pourquoi?<br />
Aboutir à<br />
-Trois plans peuvent être aisément distingués<br />
a. le premier plan très sombre (la roche + le marcheur);<br />
b. le deuxième plan beaucoup plus clair (nuages blancs+ ciel bleu entrecoupé de roches<br />
marrons et de flancs de collines grises);<br />
c. le troisième très embrumé (montagne à peine perceptible).<br />
- Le centre géométrique du tableau et le point de fuite du paysage convergent vers le même point: la<br />
poitrine du voyageur.<br />
- Le regard est centré sur le cœur du voyageur. Peut-être est-ce une manière de mettre en valeur<br />
l'importance des sentiments et des émotions que la contemplation solitaire de la nature suscite chez<br />
le voyageur et, que le peintre voudrait communiquer au spectateur. Il s'agirait alors d'une émotion au<br />
second et même au troisième degré: émotion du peintre communiquée au spectateur par le biais du<br />
personnage plongé dans une attitude de contemplation.<br />
3- Vers une interprétation du tableau:<br />
En vous aidant des réponses aux questions des niveaux 1+2, expliquez :<br />
- pourquoi le marcheur tourne le dos au spectateur;<br />
- que le jeu de contraste et la composition confèrent à l'attitude et la position du personnage<br />
une valeur symbolique (à la fois esthétique, éthique et philosophique).<br />
Aboutir à :<br />
1. Le personnage du voyageur est présenté de dos comme si son visage importait peu (ou pas du<br />
tout). C'est que l'essentiel, ce sur quoi le peintre veut insister, c'est moins l'aspect extérieur du<br />
personnage lui-même, ni ce qu'il est ou ce à quoi il peut ressembler. A cet égard, tout ce qu'il donne à<br />
voir, c'est un habit qui ne fournit aucune information sur son statut social et une canne qui, elle, nous<br />
renseigne sur ce qu'il a fait, (l'effort physique et peut –être aussi psychologique pour arriver, au terme<br />
d'une longue ascension en solitaire au sommet de cette montagne rocheuse.) Il pourrait donc s'agir<br />
non pas d'un "marcheur" bien déterminé mais d'un personnage dans lequel le spectateur pourrait se<br />
reconnaître.<br />
2. Tout concourt à mettre en relief l'état d'âme du personnage:<br />
- La composition du tableau d'abord dont le point névralgique se situe au niveau du cœur,<br />
siège des sentiments du voyageur dont la position élevée est une sorte de métaphore qui<br />
traduit l'effort physique et psychologique pour atteindre le plus haut point d'élévation<br />
morale et intellectuelle.<br />
- Le contraste entre les plans (solitude du personnage face à l'immensité de la nature)<br />
marque l'opposition entre l'infiniment humain et l'infiniment grand: l'homme seul face à la<br />
nature.<br />
- La conjugaison de tous ses composants plastiques confère au tableau une valeur<br />
esthétique (le plaisir peine, comme dirait Kant, plaisir de l'effort consentie, de la douleur<br />
contenue, qui aboutit à un moment de symbiose avec la nature), autant qu'éthique (la<br />
connaissance de soi à travers l'exercice solitaire de la marche et la contemplation de<br />
l'immensité de la nature).<br />
Lecture de l'image<br />
30
Thème 3 : Image de création et image de communication<br />
Séquence 1 :<br />
Lecture de l'image<br />
Fiche animateur<br />
Objectif: Distinguer image de création et image de communication<br />
Supports : 1. corpus général d’images variées. (Support 1 cf. images thème 3)<br />
2. tableau de comparaison : image de création/image de communication. (Support 2<br />
cf. images thème 3)<br />
Démarche :<br />
Première étape:<br />
Faire défiler les images dans le corpus général (support 1) et demander aux participants d’établir<br />
une catégorisation des images selon un critère choisi librement (nature du support utilisé, finalité,<br />
nature de l’image, usage…)<br />
Exemples de catégorisations :<br />
1) Selon le support : Affiches (mur) : Image 1, Image 5, Image 8<br />
Pancartes : Image 13<br />
Livres (première de couverture, illustrations) : Image 7<br />
Ecran (T.V, ordinateur, jeu vidéo) : toutes sortes d’image.<br />
Toile : Image 10<br />
2) Selon l’usage (critères fonctionnels) :<br />
Usages institutionnels (qui ont donné naissance à la photo d’identité ou anthropométrique<br />
(justice), aux timbres postaux, aux cartes téléphoniques et bancaires, aux panneaux de<br />
signalisation routière): Image 6, Image 13.<br />
Usages commerciaux (qui ont fait apparaître les affiches, les prospectus, les logos…) :<br />
Image5<br />
Usage technique ou scientifique : Image 3, Image 4<br />
Usage ludique (dans les jeux vidéo, reconstituée par l’ordinateur) : Images 11<br />
Usages culturels : Image 7, Image 10, Image 12<br />
3) Selon la finalité :<br />
Finalité communicative (exemples : Informer : Image 1, Image 8 ; prescrire, interdire :<br />
Image13 ; convaincre, persuader : Image 5, Image 12; diagnostiquer, analyser :<br />
Image 4 ; expliquer : Image 3)<br />
Finalité artistique (toucher, susciter des sensations ou des émotions): Image 10<br />
4) Selon une typologie empruntée aux textes (selon la fonction de l’image):<br />
Image descriptive : Image 9, Image 10<br />
Image narrative : Image 2<br />
Image explicative : Image 3<br />
Image argumentative : Image 5, Image 12<br />
Image informative : Image 8<br />
Faire remarquer que :<br />
Les images sont sujettes à plusieurs types de classification d’importances inégales.<br />
Une même image peut appartenir à une ou plusieurs catégories (On parle de la<br />
polysémie de l’image)<br />
La classification selon la finalité est la plus opérationnelle du point de vue pédagogique:<br />
1. Les images ayant une finalité communicative plus ou moins explicite (réalisation d’un acte<br />
« langagier » bien déterminé : informer, prescrire, persuader, séduire, interdire, mettre en garde…).<br />
Ce sont des images de communication.<br />
2. Les images ayant une finalité artistique, qui relèvent du domaine de l’esthétique. Elles n’ont pas<br />
de finalité en terme de communication utilitaire. Ce sont des Images de création (ou d’art).<br />
31
Deuxième étape:<br />
Comparer Image de création et image de communication dans un tableau à double entrée.<br />
Demander aux participants de compléter (en plénière ou en atelier) le tableau de comparaison<br />
. Faire défiler et commenter un à un les éléments de chaque colonne. (Support 2)<br />
Faire remarquer que :<br />
parmi les images de communication, l’image publicitaire occupe une place prépondérante dans<br />
la vie courante et qu’elle mérite, de ce fait, un traitement particulier dans nos pratiques de<br />
lecture de l’image en classe.<br />
parmi les images de création, le tableau de peinture nécessite lui aussi un traitement particulier<br />
qui exige des connaissances appropriées et des pratiques de lecture à trois niveaux. (voir<br />
partie 2 du module)<br />
Lecture de l'image<br />
32
Lecture de l'image<br />
Fiche formateur<br />
Séquence 2 :<br />
Objectif: Enrichir son répertoire culturel en matière de peinture pour mieux « lire » des images de<br />
création (les tableaux de peinture)<br />
Supports :<br />
- Corpus de tableau appartenant à différents genres de peinture. (Support 3 cf. images thème 3)<br />
- Corpus de tableaux appartenant au même genre et utilisant différentes techniques. (Support 4<br />
cf. images thème 3)<br />
- Produits, matériaux et outils utilisés en peinture. (Support 5 cf. images thème 3)<br />
Démarche :<br />
Première étape:<br />
- Faire observer un corpus de tableaux appartenant à différents genres de peinture. (Support 3)<br />
- Demander aux participants d’opérer un classement en genres de peinture à partir des sujets traités<br />
Faire remarquer que ce classement a longtemps constitué une hiérarchie qui tenait à la difficulté<br />
supposée des premiers genres, et à la noblesse de leurs sujets.<br />
Genre noble<br />
Genre de manière<br />
Genre Sujets Exemples<br />
Peinture d'histoire<br />
(appelée aussi genre<br />
noble)<br />
Mythologie, religion, batailles,<br />
évènements historiques<br />
Portrait Monarques, personnes célèbres,<br />
commanditaires, entourage du<br />
peintre.<br />
33<br />
J-L David, Le serment<br />
des Horaces<br />
Jacob Peter Gowi, la<br />
Chute d'Icare<br />
Rembrandt, Sacrifice<br />
d'Isaac<br />
Van Gogh, l’autoportrait<br />
J.A.D.Ingres, Bonaparte<br />
Paysage Montagnes ou rivages, jardins, villes Paul Cézanne,<br />
Montagne Sainte-victoire<br />
Pissarro, Coucher de<br />
soleil et brouillard<br />
Nature morte Tables servies, bouquets, livres,<br />
instruments de musique, sabliers<br />
Scène de genre Intérieurs; scènes de rue: musiciens,<br />
diseuses de bonne aventure…<br />
Menéndez Nature morte<br />
aux figues<br />
Pissarro, Bouquet de<br />
fleurs<br />
Renoir, Jeunes filles au<br />
piano<br />
Renoir, La marchande<br />
de pommes<br />
Deuxième étape: Présenter un ensemble de tableaux (numérotés en lettres alphabétiques, support<br />
4) et un ensemble de techniques (produits et d’outils) utilisées en peinture (numérotées en chiffres,<br />
support 5 cf. images thème 3) et demander d’associer chaque tableau à la technique avec laquelle il a<br />
été réalisé.<br />
Corrigé de l’exercice<br />
Tableaux Techniques<br />
A 5<br />
B Intrus : crayon noir, mine<br />
C 7<br />
D 4<br />
E 1<br />
F 6<br />
G 3<br />
H 2
Thème 3 :<br />
Lecture de l'image<br />
Fiche enseignant<br />
Image de création et image de communication<br />
I/ Objectif : Distinguer image de création et image de communication<br />
1/ Classer les images selon un critère choisi librement (nature du support utilisé, finalité, nature de<br />
l’image, usage…)<br />
2/ Comparer image de création et image de communication<br />
Image de création image de communication<br />
34
II/ Objectif: Enrichir son répertoire culturel en matière de peinture pour mieux « lire » des<br />
images de création (les tableaux de peinture)<br />
Exercices :<br />
1) Classer ces tableaux de peinture selon les sujets traités.<br />
Genre noble<br />
Genre de manière<br />
Genre Sujets Tableau<br />
Lecture de l'image<br />
Peinture d'histoire<br />
(appelée aussi genre<br />
noble)<br />
Mythologie, religion, batailles,<br />
évènements historiques<br />
Portrait Monarques, personnes célèbres,<br />
commanditaires, entourage du<br />
peintre.<br />
Paysage Montagnes ou rivages, jardins, villes<br />
Nature morte Tables servies, bouquets, livres,<br />
instruments de musique, sabliers<br />
Scène de genre Intérieurs; scènes de rue: musiciens,<br />
diseuses de bonne aventure…<br />
2) Associez chaque tableau à la technique avec laquelle il a été réalisé.<br />
Tableaux Techniques<br />
A<br />
B<br />
C<br />
D<br />
E<br />
F<br />
G<br />
H<br />
35
Lecture de l'image<br />
Fiche formateur<br />
Séance3:<br />
Objectif: Lire une image particulière de communication : l’affiche publicitaire<br />
Supports :<br />
- Corpus d’affiches publicitaires variées (support 6)<br />
- Une affiche publicitaire classique (support 7)<br />
- Schéma récapitulatif des composantes d’une affiche publicitaire. (support<br />
8)<br />
- Une affiche publicitaire sans le texte (support 9), avec une partie du texte<br />
(support 10) et entière (support 11)<br />
Démarche :<br />
Première étape:<br />
Saisir les spécificités d’une catégorie d’image de communication : L’affiche publicitaire. (Son<br />
évolution historique, sa fonction particulière, les étapes de sa fabrication, ses règles de<br />
fonctionnement)<br />
Faire visualiser dans l’ordre les affiches publicitaires dans le corpus (support 6)<br />
Faire remarquer que :<br />
les premières images qui préfiguraient nos images publicitaires actuelles remontent à la fin<br />
du 19 ème siècle, qu’elles étaient faites par des artistes comme Lautrec (pour Le Moulin<br />
Rouge), Mucha (pour Job), Chéret (pour les magasins du Louvre), que la dimension<br />
esthétique y était très présente, laissant trop peu de place aux valeurs du marketing ;<br />
l’image publicitaire a pris ensuite une fonction quasi didactique en ce sens qu’elle se donne<br />
à lire comme mode de communication publique qui accorde une place plus grande au<br />
texte, particulièrement informatif et explicatif et qui vise la formation (des consommateurs)<br />
par l’information ;<br />
en adoptant les principes du marketing (connaissance du marché, positionnement de la<br />
marque par rapport aux concurrents, valeur ajoutée au produit, prédominance du message<br />
visuel), l’image publicitaire a désormais une fonction plus nettement persuasive et exploite<br />
toutes les formes de support (magazine, journal, mur, moyens de transport, télé, Internet…)<br />
et toutes les prouesses et les techniques possibles offertes par la peinture, la photo,<br />
l’informatique, la langue utilisée et ses figures de style…<br />
Expliquer les étapes de la fabrication de l’image publicitaire :<br />
Au départ : un annonceur (maison de voiture par exemple) consacre un budget pour la publicité de<br />
son produit et met en compétition des agences de publicité qui font leurs propositions. L’annonceur<br />
choisit ensuite un axe de publicité (Ex : Jeunesse éternelle pour la marque EVIAN (eau minérale),<br />
minceur pour la marque CONTREX) proposé par l’une des agences qui passe à la production de la<br />
publicité en question. Un directeur artistique se charge de la partie image et un concepteur rédacteur<br />
s’occupe de la partie texte avec ses différents constituants. En fait, rien n’est laissé au hasard, compte<br />
tenu du public ciblé.<br />
Présenter l’échelle AIDA qui explique les règles de fonctionnement de la production de l’image<br />
publicitaire.<br />
A Achat (Passer à l’action d’acheter)<br />
D Désir (Eveiller, augmenter le Désir de consommer le produit)<br />
I Intention (Déclencher l’intention d’acheter)<br />
A Attention (Capter l’Attention du consommateur potentiel)<br />
36
Deuxième étape:<br />
Faire observer une affiche publicitaire classique (support 7) et en dégager les différentes composantes.<br />
- LE VISUEL :<br />
1. L’illustration principale<br />
2. Le bloc marque ou le logo (très souvent en bas et à droite)<br />
3. Le graphisme général.<br />
4. Le code couleur (organisation des couleurs selon leurs évocations : noir=luxe,<br />
bleu=fraîcheur, blanc=pureté, propreté, vert=nature)<br />
II- LE TEXTE :<br />
2. Une accroche, souvent en haut.<br />
3. La body ou le corps du texte.<br />
4. Le slogan de la marque (il se répète dans différentes publicités d’une même<br />
marque).<br />
5. Le texte légal (quand les publicitaires sont obligés de le mettre. Ex : Le tabac nuit à la<br />
santé)<br />
6. La citation du site Web et/ou le numéro de téléphone.<br />
III- LA MISE EN PAGE :<br />
1. La typographie.<br />
2. La distribution des couleurs sur la page.<br />
Présenter le récapitulatif (support 8)<br />
Troisième étape:<br />
Faire lire une image publicitaire en procédant en trois étapes :<br />
• L’image sans le texte (support 9.) :<br />
Lecture iconique rapide (ce qu’on voit : une jeune femme confortablement assise et rêveuse, des<br />
ballons suspendues,…) puis lecture plastique (composition de l’image, forme géométrique dominante,<br />
couleur dominante, tonalité…) et demander enfin ce que l’image pourrait évoquer sur le plan<br />
symbolique et le produit auquel elle serait destinée (hypothèses de lecture).<br />
• L’image avec une partie du texte : L’accroche (support 10).<br />
Première vérification des hypothèses de lecture, analyse syntaxique et sémantique de l’accroche, sa<br />
disposition dans la page, typographie.<br />
• L’affiche toute entière (support 11)<br />
Vérification des hypothèses de lecture. Commentaire critique. (rattacher l’affiche à son contexte<br />
historique socioculturel, s’interroger sur la distribution des rôles masculin/féminin, les connotations<br />
suggérées par les techniques utilisées…)<br />
Quatrième étape:<br />
Faire réfléchir sur des activités possibles avec les élèves à partir d’affiches publicitaires.<br />
Exemples d’activités :<br />
Inventer ou changer l’accroche ou le slogan d’une affiche<br />
Rédiger un texte (ou paragraphe) argumentatif qui vante les mérites du produit en<br />
promotion.<br />
Comparer des affiches (axes de positionnement, public ciblé, code couleurs, volume du<br />
texte dans l’ensemble de l’affiche)<br />
Etudier le rapport entre les différents constituants de l’affiche (le visuel, le texte et la mise<br />
en page).<br />
Lecture de l'image<br />
37
Annexe 1 (Thème 1)<br />
Qu’est-ce que lire ?<br />
On a longtemps pensé que l’activité de lecture relevait d’une opération de transcodage. En fait, il<br />
s’agit pour l’essentiel d’une activité perceptive déployée sur une longue durée. Comme activité<br />
perceptive, la lecture ne diffère pas profondément des autres modes de prise d’information. Percevoir,<br />
c’est reconnaître, c’est-à-dire comparer les informations qui parviennent au cerveau par l’intermédiaire<br />
de récepteurs sensoriels aux catégories perceptives stockées en mémoire et qui constituent un capital<br />
acquis tout au long de la vie. S’il n’existe pas de catégorie perceptive pour « ranger » une information,<br />
elle n’est pas perçue. Par contre, il est toujours possible de ramener à une catégorie perceptive<br />
connue des sensations qui en sont proches même si elles ne la recouvrent pas exactement. Une<br />
reconnaissance n’est pas une procédure automatique, c’est une décision. On ne s’en rend jamais<br />
aussi bien compte que lorsque les récepteurs sensoriels travaillent dans des conditions difficiles (bruit,<br />
obscurité, etc.). La décision n’est alors plus instantanée. « Cette tache sombre là-bas pourrait être un<br />
rocher ; mais elle vient de bouger, un rocher ne bouge pas, etc. » Chacune des catégories<br />
perceptives est dotée d’une série de traits pertinents qui la caractérisent. Mais aucune prise<br />
d’information ne donne, pour un objet défini, la totalité de ces traits (je ne vois jamais un objet sous<br />
tous les angles à la fois, de l’extérieur et de l’intérieur, etc.). Si bien que la reconnaissance perceptive<br />
reste toujours une approximation, une décision prise à partir d’un certain seuil, variable selon les<br />
exigences du sujet ou de la situation (cet objet présente suffisamment de caractéristiques de la<br />
catégorie « automobile » pour que je décide que c’est une automobile).<br />
En fait, dans les situations normales de perception, les décisions sont très rapidement prises, car<br />
nous ne nous soucions même pas d’effectuer des vérifications. Nous anticipons sur la prise<br />
d’information elle-même. Nous savons ce que nous allons voir avant de l’avoir vu (je m’attends en<br />
sortant dans la rue à voir des automobiles et non des paquebots). La perception est pour l’essentiel<br />
une prévision. D’où ces quiproquos perceptifs : je m’attends tellement à voir entrer Pierre que je ne<br />
reconnais pas Jacques qui s’est présenté à sa place.<br />
En situation de lecture, l’attente perceptive (il s’agit d’une affiche, d’un roman que je prends dans<br />
ma bibliothèque, d’un graffiti dans le couloir du métro…) sélectionne, dans le champ indéfini des<br />
possibles, un domaine précis autour duquel se focalise l’attention. C’est dans ce domaine que le<br />
lecteur cherche à produire des reconnaissances.<br />
Reconnaître peut parfois suffire à épuiser l’acte de lecture. En particulier lorsqu’il s’agit de textes<br />
courts, très « fonctionnels » (une étiquette sur une boîte, un panneau dans la rue, etc.). Mais l’acte de<br />
lecture porte aussi sur des textes longs qui nécessitent une exploration plus complexe, qu’il s’agisse<br />
de récits, d’argumentations, de dialogues, de modes d’emploi, etc. Dans ce cas, la reconnaissance<br />
n’épuise plus l’activité intellectuelle du lecteur, elle n’en devient plus qu’un aspect tout à fait partiel.<br />
En effet, la compréhension d’un texte long (c’est-à-dire comportant au moins une phrase !)<br />
implique une stratégie de mise en correspondance des éléments constitutifs de ce texte (les mots)<br />
avec l’emboîtement des structures dans lesquelles ces mots sont pris. Par exemple, au niveau de la<br />
phrase, un mot n’a de sens que par rapport à la structure syntaxique et sémantique de celle-ci. Or<br />
cette structure ne se dévoile pas immédiatement, elle apparaît progressivement au cours du<br />
cheminement de l’œil sur la ligne. Tant que le point final n’est pas rencontré, le sens de chaque mot<br />
peut être modifié par les autres mots qui surgissent après lui dans la phrase. Une phrase est un<br />
système d’interdépendances elle ne peut être traitée que par rapport à cette interdépendance.<br />
Il en est de même au niveau supérieur. Le texte est aussi un système de phrases interdépendantes<br />
où chaque phrase ne prend un sens que par rapport à son contexte, à la structure du texte dans<br />
lequel elle est prise. « La pluie ne cesse de tomber » ne peut avoir la même signification dans un récit<br />
et dans un texte de linguistique, dans un bulletin météorologique, dans un roman policier, ou dans une<br />
chanson.<br />
Un lecteur qui se contenterait d’avancer mot après mot dans le texte mettrait à rude épreuve sa<br />
mémoire (tout garder jusqu’à la fin du texte) ou, plus sûrement, ne comprendrait pas ce qu’il lit.<br />
L’articulation entre prises de données ponctuelles et repérage des structures d’ensemble porteuses<br />
de sens est en fait largement assurée par des stratégies de prédiction du sens. Le lecteur avance<br />
dans un texte en faisant une hypothèse sur ce qu’il risque d’y trouver. Au fur et à mesure de sa<br />
progression, il vérifie cette hypothèse et la modifie si besoin est. Bien sûr, si la première piste se<br />
révèle non congruente avec les données progressivement rencontrées dans le balayage des lignes, le<br />
réaménagement de l’hypothèse risque de devenir irréalisable. Une relecture est alors nécessaire.<br />
Comment se formule la première hypothèse ? Très fréquemment, à partir de reconnaissances<br />
culturelles larges et qui précèdent l’entrée même dans le texte. S’il s’agit d’un livre, le repérage de ses<br />
caractéristiques matérielles (format, couverture, typographie, mise en page, etc.) suffit souvent. Le<br />
feuilletage préalable à la lecture est certainement, de ce fait, une voie d’accès essentielle au sens. Sur<br />
d’autres supports, l’image peut être aussi le point de départ de l’activité de lecture. A cet égard,<br />
l’image titre d’un album est, pour un enfant, l’occasion d’une anticipation sémantique efficace. Au-delà<br />
Lecture de l'image<br />
38
de cette entrée dans le texte, la conduite de la lecture peut elle aussi s’appuyer sur la succession des<br />
caractéristiques non verbales du texte (transformation de la mise en page, illustration, etc.). On peut<br />
ainsi repérer, à l’avance, que l’on va passer d’un récit à un dialogue par la seule modification de<br />
l’apparence typographique de la page. L’essentiel reste que cette gestion continue du contexte ne<br />
s’efface pas au profit du seul repérage des mots du texte ; la construction du sens deviendrait alors<br />
impossible. On voit la difficulté que peuvent rencontrer de jeunes enfants dès qu’ils sont confrontés à<br />
des textes longs, de surcroît impossibles à lire d’une seule traite. Ils se contentent souvent d’une<br />
compréhension très « locale » limitée à la dernière page lue, glissant ainsi d’une page à page à<br />
l’autre, d’un épisode à l’autre, sans parvenir à les relier entre eux dans un projet cohérent de lecture.<br />
On comprend aussi qu’une littérature visant un public peu alphabétisé se soit souciée de s’adapter à<br />
ce mode de lecture en multipliant des épisodes courts, qui n’ont souvent entre eux d’autre cohérence<br />
que la permanence du personnage principal et la répétition de la même trame dramatique. On voit<br />
aussi, par là, que la vitesse de lecture d’un texte tien pour l’essentiel à la plus ou moins grande<br />
difficulté de gestion du contexte. Lorsque les hypothèses de départ sont claires, lorsqu’elles se<br />
confirment régulièrement en avançant dans le texte, la lecture peut devenir extrêmement rapide. Par<br />
contre, lorsque le lecteur anticipe mal le contenu de son texte, lorsqu’il est contraint à de fréquents<br />
réaménagements de ses prévisions, la lecture est nécessairement très lente. Le mauvais lecteur est<br />
celui qui maîtrise difficilement cette flexibilité des vitesses de lecture et ne parvient pas, de ce fait, à<br />
consacrer l’attention nécessaire à la gestion de son contexte et au maintien de la cohérence<br />
d’ensemble de sa lecture.<br />
En définitive, l’acte de lecture implique la conjonction étroite de deux activités :<br />
- la perception d’indices graphiques de statuts très divers (support du texte, mise en page,<br />
typographie, texte lui-même, etc.),<br />
- l’élaboration progressive d’un sens pour cet objet textuel porteur d’indices : sens qui n’est<br />
pas à recevoir de l’objet, mais à construire en référence aux contraintes spécifiques de cet objet.<br />
C’est dire que, pour un texte donné, l’activité du lecteur se développe dans un champ bipolaire :<br />
- d’un côté, une nécessaire attention au texte,<br />
- de l’autre, une non moins nécessaire attention à soi.<br />
Si l’attention au texte vient à trop diminuer, l’esprit vagabonde pour son propre compte, s’éloigne<br />
du texte et peut se perdure dans des rêveries indéfinies. Si, au contraire, l’attention à soi vient à faire<br />
défaut, le message se transforme en un assemblage de mots qui n’existent plus que comme réalités<br />
sonores, et résistent à toute saisie.<br />
Chaque lecture apparaît bien ainsi comme un cheminement entre deux risques. Nous ne nous en<br />
rendons jamais aussi bien compte que lorsque le texte auquel nous sommes confrontés se révèle<br />
être, pour nous, un texte « difficile ». Il nous semble tel, dans la mesure même où l’attention au texte<br />
devient tout à coup trop importante. Nous ne devinons plus, nous n’anticipons plus le sens par ce<br />
simple effort d’attention, cette simple recherche de cohérence en nous-mêmes qui caractérise la<br />
lecture « facile ». Que ce texte puisse dire autre chose que ce que nous imagions qu’il doit dire cesse<br />
de relever de cette tranquille assurance du lecteur serein et sûr de lui. L’acte de lecture se grippe.<br />
Deux voies s’ouvrent alors :<br />
- ou bien l’attention au texte l’emporte et la matérialité graphique des mots s’impose bientôt à<br />
la place du sens. La relecture des phrases amplifie le malaise. Bientôt le texte échappe totalement : le<br />
livre tombe des mains.<br />
- ou bien, par un effort souvent difficile à faire, le lecteur parvient à ne pas céder à la tentation<br />
du retour au texte et amplifie, au contraire, l’attention à soi. Repli intellectuel ou affectif, réexamen de<br />
ses attentes, de ses voies d’accès à la problématique intellectuelle ou fantasmatique qui demeure<br />
pour l’instant étrangère. Il faut modifier l’intention qui préside à l’acte de lecture, chercher d’autres<br />
messages possibles que ceux qui viennent spontanément à l’esprit. Bref, il faut, à proprement parler,<br />
« inventer » une lecture qui n’a encore jamais été faite. Moment difficile mais fécond. Moment rare<br />
aussi.<br />
La lecture n’est souvent qu’un processus de réassurance culturelle : je retrouve dans le texte d’un<br />
autre mes pensées, mes images, mes sentiments, mes sensations. La lecture est alors cette voie<br />
d’accès au partage social de l’expérience et du savoir. Le lecteur éprouve dans cette rencontre avec<br />
un texte la communauté culturelle qui est la sienne. Il renouvelle périodiquement son inscription dans<br />
cette communauté par ses actes de lecture. Mais – plus rarement – la lecture est aussi l’occasion<br />
d’une expérience de l’altérité. Face à ce qui n’est pas moi, face à ce que j’imagine être des<br />
significations pour d’autres, mais pas encore pour moi, il ne me reste plus qu’à tenter d’opérer sur<br />
moi-même cette conversion, cette transformation qui me fera accéder à un nouveau partage culturel,<br />
à un savoir, à des affects autres.<br />
Lecture de l'image<br />
Jean Hébrard , L’apprentissage de la lecture à l’école.<br />
39
Annexe 2<br />
Lecture de l'image<br />
Les niveaux de lecture<br />
(Eléments de méthode)<br />
1/ Le niveau iconique<br />
Pour lire une image, il est plus facile de commencer par décrire ce que l'on voit (c'est le niveau<br />
iconique). On doit être capable de décrire l'image comme si l'on s'adressait à un aveugle. C'est-à-dire<br />
qu'une personne qui ne peut pas voir le tableau, peut toutefois se le représenter (en avoir une idée<br />
assez précise).<br />
2/ Le niveau plastique<br />
Les éléments de formulation plastique sont liés à la composition : les plans, la représentation de<br />
l'espace (plan étagé, espace perspectif etc.), le support (toile, papier etc.), la forme (elle est donnée<br />
par le graphisme, les à-plats de couleur, les modelés de peinture etc.), la couleur (chaud/froid –<br />
contrastes – etc.)<br />
3/ Le niveau symbolique<br />
a/ L'aura de l'image : son effet sur le lecteur. Toute image quelle quelle soit produit un effet sur<br />
celui qui la regarde. Cet effet varie d'une personne à l'autre : il peut aller de l'admiration jusqu'au rejet.<br />
Mais généralement l'image produit une impression difficile à expliquer et parfois inexplicable. Ce<br />
premier contact avec l'œuvre est révélateur : il démontre qu'une image peut avoir un pouvoir de<br />
séduction sur celui qui la regarde ou au contraire provoquer sa répulsion.<br />
b/ La symbolique de l'image (ce qu'elle symbolise) : c'est l'interprétation. Il s'agit de donner un sens<br />
(ou une signification aux deux premiers niveaux déjà étudiés : les niveaux iconique et plastique. En<br />
effet, pour découvrir le symbolisme d'une œuvre, il faudrait mettre en relation l'iconique et le plastique.<br />
Le sens d'une œuvre ne saurait être donné et explicité qu'à travers des éléments liés à la composition<br />
: les couleurs, la lumière, les plans, les lignes de force etc.<br />
L'exploitation de toutes ces données pourrait donner lieu à une interprétation bien fondée et<br />
cohérente ; car tout est dit par et dans l'œuvre : tout a un sens qu'il faudrait découvrir. Chaque<br />
élément de la composition a un sens en lui-même mais aussi quand il est mis en rapport avec d'autres<br />
éléments. Ainsi la lecture de l'œuvre d'art ne sera ni arbitraire ni aléatoire.<br />
Il est donc évident que chaque niveau ou plan d'analyse fonctionne de façon autonome et qu'il<br />
constitue une sorte de système.<br />
Ces différents plans ou systèmes ne se retrouvent pas obligatoirement dans chaque image. Ils sont<br />
à repérer et à analyser pour en saisir le fonctionnement interne car ils ne sont pas reproduits de la<br />
même manière dans les images. Chaque peintre en fait une utilisation personnelle et les utilise de<br />
façon originale qui – par là même – le distingue des autres.<br />
Cela complique la tâche du lecteur d'images parce que d'une part, les niveaux d'analyse de l'image<br />
ne sont pas immuables et d'autre part, il faudrait les connaître, les relever, les mettre en relation,<br />
montrer leur interdépendance etc. De plus, en matière d'image, il n'y a pas un seul code de lecture<br />
mais plusieurs dont l'utilisation dépend de l'image.<br />
Par conséquent, il n'existe pas de méthode de lecture de l'image : on pourrait parler de différentes<br />
approches qui dépendent de l'image elle-même. Cela rend complexe l'analyse de l'image justement<br />
faute de méthode applicable à toute sorte d'image (contrairement à la lecture des textes).<br />
S'ajoute à cette difficulté, la nécessité d'avoir une bonne compétence culturelle. En effet, les<br />
tableaux de peinture -pour être compris et expliqués- exigent une bonne connaissance et de<br />
l'environnement culturel où ils sont nés et des principaux mouvements artistiques (histoire de la<br />
peinture).<br />
Pour toutes ces raisons, on doit développer une compétence de lecture d'images aussi bien chez<br />
les enseignants que chez les élèves. Cet objectif ne pourrait être atteint qu'à travers l'étude de<br />
différents types d'images.<br />
40
Annexe 3 : Le niveau iconique<br />
(Les images se trouvent dans le fichier « images thème 1»)<br />
1/ Images ambiguës<br />
Ce sont des images dans lesquelles on voit un objet ou un personnage mais à force de les<br />
regarder, on pourrait découvrir autre chose. On se demandera alors comment on n’a pas pu ne pas<br />
s’en apercevoir avant. Cette réaction est normale parce que ces images sont ambiguës.<br />
Le tas de cubes<br />
On peut voir, selon le cas, sept ou huit cubes. Huit cubes dont on peut bien distinguer trois faces :<br />
une face supérieure bleue, une face gauche verte et une face droite bleu foncé. Les trois points<br />
rouges font partie d’un même cube.<br />
Sept cubes qui ont aussi trois faces visibles : jaune dessous, verte à droite et bleue à gauche.<br />
Dans ce cas, deux points rouges sont sur deux cubes.<br />
(Vous pouvez avoir des difficultés pour les voir.)<br />
2/ Plus clair, plus foncé<br />
Gris changeant<br />
Cette figure créée par le psychologue Gaetano Kanizsa est étonnante. Nous pouvons la voir de<br />
deux façons :<br />
• un fond noir sur lequel est posé un rectangle blanc perforé et au dessus un voile<br />
rectangulaire transparent.<br />
• un fond noir sur lequel est posé un rectangle gris et par-dessus tout un rectangle blanc<br />
troué.<br />
Dans les deux montages le gris n’est pas le même. Il varie beaucoup : voile transparent dans le 1 er<br />
cas, gris opaque dans le 2 ème cas.<br />
3/ Il est là, pas là…<br />
a/ Le faux dégradé<br />
Pour chaque rectangle nous voyons le côté droit plus foncé que le côté gauche. C’est encore une<br />
erreur car chaque rectangle a rigoureusement partout la même couleur. Pour s’en convaincre essayez<br />
de cacher – avec un stylo – la frontière entre deux bandes successives : elles ont la même couleur.<br />
b/ Le triangle illusoire<br />
Cette figure est de Gaetano Kanizsa. Comment la décrire ? Un triangle blanc, posé à la fois sur un<br />
autre triangle aux contours noirs et sur trois disques noirs.<br />
Qu’est-ce qui nous permet de dire qu’il y a un triangle blanc ?<br />
Nous voyons ses contours mais il est illusoire à cent pour cent. « Chose plus étrange encore, il<br />
nous paraît d’un blanc plus lumineux que celui de la page, au point qu’il semble même se détacher du<br />
fond. »<br />
4/ Plus grand, plus petit<br />
Mur à damier<br />
Les deux traits noirs, tracés à la verticale ont-ils la même taille. Apparemment non. En réalité, il<br />
sont de même taille : ils ont la même longueur même si celui de droite nous paraît plus grand.<br />
C’est certainement dû à l’effet de perspective renforcé par le damier. En effet, logiquement, le trait<br />
de droite fait trois carreaux alors que celui de gauche ne fait qu’un seul carreau. Donc celui de droite<br />
est vu plus grand.<br />
5/ Mouvement et relief<br />
a/ La roue folle<br />
C’est l’éblouissante roue de Mackay. Lorsqu’on fixe du regard cette roue, on a l’impression que ça<br />
tonne, que ça se mélange et peut être que ça se colore.<br />
Fixez l’image et décrivez ce que vous voyez.<br />
C’est fabuleux, incroyable.<br />
Plusieurs phénomènes apparaissent : « des ombres en forme de 8 qui composent une rosace en<br />
rotation qui grandit et rétrécit », etc.<br />
On a l’impression que ça bouge.<br />
Lecture de l'image<br />
41
Enigma<br />
Fixez l’image. Les anneaux colorés semblent bouger, la matière semble en rotation dans un sens<br />
puis dans l’autre mais jamais dans le même sens en même temps dans les trois anneaux.<br />
C’est une énigme parce que les chercheurs n’arrivent toujours pas à expliquer cette illusion.<br />
6/ Distorsion<br />
a/ Courbe ou pas ?<br />
Cette figure a été publiée en 1861 par Ewald Hering. Les deux lignes semblent se courber et<br />
s’écarter au centre. En réalité, ce sont deux droites parallèles. On peut mesurer pour s’en assurer.<br />
b/ Parallèles malgré tout<br />
Des droites parallèles hachurées… qui ne paraissent pas parallèles. Cette illusion géométrique est<br />
de Zöllner. Pourquoi ne semblent-elles pas parallèles ? Les coupables sont les segments qui<br />
hachurent les lignes.<br />
c/ La courte paille<br />
Quel est le segment de droite qui continue le segment rouge à gauche ? Le 1 ou le 3 ? Raté. Le<br />
4 ? Encore raté.<br />
Vérifiez avec une règle : c’est le segment 2 qui prolonge le segment rouge de gauche.<br />
Lecture de l'image<br />
D’après Sciences et Vie Junior ; Dossier HORS SERIE N° 51 ; Janvier 2003<br />
42
Annexe 4 : Le niveau symbolique : la symbolique des couleurs<br />
Jaune:<br />
- Intense, violent, aigu ou bien ample et aveuglant comme une coulée de métal en fusion, le jaune est<br />
la plus chaude des couleurs, la plus expansive, la plus ardente. Ce sont les rayons du soleil traversant<br />
l'azur des cieux.<br />
- Le jaune, couleur mâle de lumière et de vie ne peut tendre à l'obscurcissement.<br />
- " Le jaune a une telle tendance au clair qu'il ne peut y avoir de jaune très foncé. On peut dire qu'il<br />
existe une affinité profonde physique entre le jaune et le blanc." Kandinsky<br />
Le jaune est le véhicule de la jeunesse, de la force, de l'éternité divine. Etant d'essence divine, le<br />
jaune d'or devient sur terre, l'attribut de la puissance des princes, des rois, des empereurs. En Chine,<br />
pour assurer la fertilité du couple, les vêtements, les oreillers de la couche nuptiale sont tous de gaze<br />
ou de soie jaune.<br />
Le jaune est aussi associé à la connaissance, à la lumière de l'esprit.<br />
il symbolise également l'or et la richesse.<br />
Blanc<br />
- Comme sa non-couleur, le noir, le blanc peut se situer aux deux extrémités de la gamme<br />
chromatique;<br />
- la somme/ le mélange des couleurs lumières;<br />
- " Le blanc que l'on considère comme une non-couleur est comme le symbole d'un monde où toutes<br />
les couleurs, en tant que substances matérielles se sont évanouies." Kandinsky<br />
- couleur d'un changement d'état, de passage: naissance – mort ;<br />
- mariage, le blanc virginal de la robe de la jeune femme vierge (couleur de pureté, de blancheur<br />
virginale);<br />
- blanc associé aussi au silence absolu (ex. paysage de neige) 17<br />
Orange<br />
- couleur de la sexualité et du désir. A mi-chemin entre le rouge (énergie pure) et le jaune (couleur de<br />
la connaissance).<br />
- symbolise le point d'équilibre entre la libido et l'esprit; mais cet équilibre est tellement fragile que<br />
l'orangé devient aussi la couleur de l'infidélité et de la luxure.<br />
- c’est aussi la couleur soleil, de la lumière et de la chaleur.<br />
- Orange fruit: comme tous les fruits à nombreux pépins, est symbole de fécondité.<br />
Vert<br />
- Entre le bleu et le jaune, le vert résulte de leurs interférences chromatiques.<br />
Sa valeur moyenne et médiatrice entre le chaud et le froid, fait du vert une couleur rassurante,<br />
apaisante, humaine (voir blouses vertes dans les salles d'opération).<br />
- Couleur du règne végétal se réaffirmant chaque saison (espérance, renouvellement du cycle de<br />
vie).18<br />
Le rouge symbolise la fraîcheur, l’espace, l’harmonie.<br />
Le bleu symbolise le calme, la fraîcheur.<br />
Le gris symbolise les valeurs de la société industrielle et la réussite.<br />
Cette symbolique des couleurs est largement utilisée par la publicité.<br />
17 Source: Dictionnaire des symboles, pp.83<br />
18 Idem pp.710 à 712<br />
Lecture de l'image<br />
43
Annexe 5 :<br />
Tableau de Van Gogh : lettre de Van Gogh à son frère.<br />
Lettre à Théo (son frère). – Arles, septembre 1888.<br />
"Enfin à la grande joie du logeur, du facteur de poste que j'ai déjà peint, des visiteurs rôdeurs de<br />
nuit et de moi-même, trois nuits durant j'ai veillé à peindre, en me couchant pendant la journée.<br />
Souvent il me semble que la nuit est bien plus vivante et richement colorée que le jour.<br />
Maintenant pour ce qui est de rattraper l'argent payé au logeur par ma peinture, je n'insiste pas, car<br />
le tableau est un des plus laids que j'aie faits.(…)<br />
J'ai cherché à exprimer avec le rouge et le vert les terribles passions humaines.<br />
La salle est rouge sang et jaune sourd, un billard vert au milieu, 4 lampes jaune citron à<br />
rayonnement orangé et vert. C'est partout un combat et une antithèse des verts et des rouges les plus<br />
différents, dans les personnages de voyous dormeurs petits, dans la salle vide et triste, du violet et du<br />
bleu. Le rouge sang et le vert jaune du billard exemple contrastent avec le petit vert tendre Louis XV<br />
du comptoir, où il y a un bouquet rose.<br />
Les vêtements blancs du patron, veillant dans un coin dans cette fournaise, deviennent jaune<br />
citron, vert pâle et lumineux.<br />
J'en fais un dessin avec tons à l'aquarelle, pour te l'envoyer demain, pour t'en donner une idée.<br />
(…)<br />
C'est une couleur alors pas localement vraie au point de vue réaliste du trompe-l'œil, mais une<br />
couleur suggestive d'une émotion quelconque d'ardeur de tempérament".<br />
Annexe 6<br />
Le mythe d'Orphée<br />
Orphée aurait vécu son enfance et une partie de son existence près des l'Olympe en Thrace<br />
(région située sur les bords de la mer Noire et de la mer Marmara, partagée entre la Turquie, la<br />
Bulgarie et la Grèce).<br />
Il est considéré comme le plus grand chanteur-musicien-poète de tous les temps (ces termes sont<br />
indissociables: chez les Grecs, tout homme récitant un poème s'accompagnait d'une lyre ou d'un<br />
cithare). Sa poésie chantée subjugue la nature entière Elle rassemble les hommes. Les tempêtes<br />
s'apaisent. la mer se calme. Les rochers, les arbres eux-mêmes tombent sous son charme et le<br />
suivent. Les plus anciens témoignages évoquent les oiseaux planant au dessus de la tête d'Orphée et<br />
les poissons bondissant des flots sous l'effet de sa merveilleuse voix.<br />
Selon le mythe, Orphée a une passion pour Eurydice, qui le jour même de leurs noces, est<br />
mordue par un serpent et meurt. D'abord inconsolable, Orphée décide d'aller la chercher aux Enfers,<br />
monde inaccessible aux vivants. Là encore, la puissance irrésistible de son chant opère d'abord sur<br />
les gardiens, dont Cerbère " le chien à triple tête", ensuite sur toute la population infernale et enfin sur<br />
les maîtres des lieux: le dieu Hadès (Pluton) et Perséphone (Proserpine pour les Romains) qui<br />
se laissent persuader de rendre Eurydice à la vie. A condition qu'il ne tourne pas son regard en<br />
arrière, avant d'avoir rejoint le monde des vivants. Mais Orphée se retourne: Eurydice meurt pour la<br />
seconde fois. Il la perd à jamais.<br />
Lecture de l'image<br />
44
Annexe 7<br />
Lecture de l'image<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
1. Ouvrages cités:<br />
- Anne Philippe, Le temps d'un soupir<br />
- Bachelard, Gaston. La terre et les Rêveries de la volonté<br />
La terre et les Rêveries du repos, José Corti, 1977.<br />
- Durand, Gilbert. Les structures Anthropologiques de l'imaginaire, Bordas, 1969<br />
- Gilles Deleuze. Logique du sens. Editions de Minuit, 1969<br />
- Kant, Emmanuel. Critique de la faculté de Juger. Trad. A.Philonenko, librairie<br />
philosophique,<br />
- Millet, Catherine. L'art contemporain, Dominos, Flammarion, 1997.<br />
- Michel HAAR, L'œuvre d'art. Essai sur l'ontologie des œuvres, coll. Optiques<br />
philosophiques, Hatier, 1994. Se situant à l’intersection de la philosophie et de<br />
l'esthétique, ce livre apporte des éclairages théoriques permettant de cerner avec clarté et<br />
précision la spécificité du signe plastique.<br />
- Mikel Dufrenne. L'inventaire des apriori Recherche de l'originaire. Paris, Christian<br />
Bourgois, 1981<br />
- Mikel Dufrenne. L'inventaire des apriori Recherche de l'originaire. Paris, Christian<br />
Bourgois, 1981<br />
- Tisseron Serge, Comment le sens vient aux objets (surtout le chapitre IV). Aubier 1999<br />
2. Ouvrages théoriques, manuels et revues didactiques consultés:<br />
- Barthes, Roland. La chambre claire, Note sur la photographie, Cahiers de cinéma<br />
Gallimard, Seuil, 1980 Garat, Anne_Marie.<br />
Photos de famille, fiction et Cie, le Seuil,<br />
- Groupes, Mouvements, Tendances de l'art contemporain depuis 1945.Collectif, école<br />
internationale supérieure des Beaux_Arts Paris, 2eme édition ,1990.<br />
- Histoire de la peinture, de la Renaissance à nos jours. Anna-Carola KRAUSSE, éd.<br />
Gründ-<br />
- Images à la page. Une histoire de l'image dans les livres pour enfants. Collectif Gallimard,<br />
1984<br />
- In Revue Communications, Roland Barthes, jacques Leenhardt"la photographie, miroir<br />
des sciences humaines", n 36,1982<br />
- In revue Communications, recherches sémiologiques. Roland Barthes "Rhétorique de<br />
l'image" n 4,1982.J.Vrin. (Plus spécialement analytique du Beau, analytique du Sublime).<br />
- Fozza Jean-Claude, Garat Anne-Marie, Parfait Françoise. Petite Fabrique de l'image,<br />
éditions Magnard, 2003. Outil de travail indispensable, cet ouvrage propose un tour<br />
d’horizon des notions essentielles permettant de s'initier à la lecture de l'image. Pratique<br />
et accessible, il permet aisément de se renseigner sur des aspects formels et techniques<br />
des différents types d'images.<br />
- Léon Renée. La littérature de jeunesse à l'école. Pourquoi? Comment? (Approche<br />
pédagogique pour l'école primaire) Ouvrage didactique qui s’adresse aux enseignants du<br />
primaire. Des constats de la difficulté à enseigner "la lecture de l'image " à la proposition<br />
concrète d’un projet d’enseignement nouveau qui associe littérature et images en insistant<br />
tout particulièrement sur le profit à tirer, d'un point de vue pédagogique, de l'album.<br />
- L'image au collège. CNDP Poitiers (Approche historique et culturelle de toutes espèces<br />
d'images pour le collège).<br />
- LWatteau Fabrice L 'image au collège. Belin, 2002. Proposition d’une didactique de<br />
l'image qui associe : une description précise des différents types d'images, une préface<br />
présentant une réflexion didactique sur l'intérêt et la nécessité d'un enseignement à la<br />
lecture de l'image, un ensemble d’activités pédagogiques.<br />
- S. Schvalberg Analyse de l'image, <strong>Français</strong> Seconde, 1 ère , Nathan. Ce dossier très<br />
consistant a pour but de mettre à la disposition des enseignants (de lycées français) un<br />
ensemble cohérent, riche et varié de fiches élèves et de fiches professeur. Il comprend<br />
aussi une présentation sommaire de la méthodologie du commentaire de tableaux et de<br />
sculpture.<br />
- Science et vie Junior. Dossier Hors série,n° 51 ;ja nvier 2003<br />
45
- TDC, N° 891 . Le mythe d'Orphée. 1 er mars 2005. Cet ensemble d’articles analyse<br />
différentes versions et évolutions historiques, littéraires, artistiques, musicales,<br />
cinématographiques, etc. du mythe d'Orphée.<br />
3. Sites Internet:<br />
- http:// carta.org/art/bruegel<br />
- http://G:/icare.htm<br />
- www.ac-versailles.fr/pedagogi/lettres/latin/Ovide/orphee.htm<br />
- www.musee-moreau.fr<br />
Lecture de l'image<br />
46