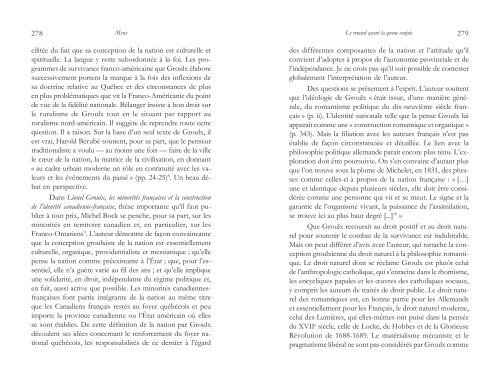le renard ayant la queue coupée ou la luxuriance des ... - MENS
le renard ayant la queue coupée ou la luxuriance des ... - MENS
le renard ayant la queue coupée ou la luxuriance des ... - MENS
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
278<br />
Mens<br />
cilitée du fait que sa conception de <strong>la</strong> nation est culturel<strong>le</strong> et<br />
spirituel<strong>le</strong>. La <strong>la</strong>ngue y reste subordonnée à <strong>la</strong> foi. Les programmes<br />
de survivance franco-américaine que Gr<strong>ou</strong>lx é<strong>la</strong>bore<br />
successivement portent <strong>la</strong> marque à <strong>la</strong> fois <strong>des</strong> inf<strong>le</strong>xions de<br />
sa doctrine re<strong>la</strong>tive au Québec et <strong>des</strong> circonstances de plus<br />
en plus problématiques que vit <strong>la</strong> Franco-Américanie du point<br />
de vue de <strong>la</strong> fidélité nationa<strong>le</strong>. Bé<strong>la</strong>nger insiste à bon droit sur<br />
<strong>le</strong> ruralisme de Gr<strong>ou</strong>lx t<strong>ou</strong>t en <strong>le</strong> situant par rapport au<br />
ruralisme nord-américain. Il suggère de reprendre t<strong>ou</strong>te cette<br />
question. Il a raison. Sur <strong>la</strong> base d’un seul texte de Gr<strong>ou</strong>lx, il<br />
est vrai, Harold Bérubé s<strong>ou</strong>tient, p<strong>ou</strong>r sa part, que <strong>le</strong> penseur<br />
traditionaliste a v<strong>ou</strong>lu — au moins une fois — faire de <strong>la</strong> vil<strong>le</strong><br />
<strong>le</strong> cœur de <strong>la</strong> nation, <strong>la</strong> matrice de <strong>la</strong> civilisation, en donnant<br />
« au cadre urbain moderne un rô<strong>le</strong> en continuité avec <strong>le</strong>s va<strong>le</strong>urs<br />
et <strong>le</strong>s événements du passé » (pp. 24-25) 8 . Un beau débat<br />
en perspective.<br />
Dans Lionel Gr<strong>ou</strong>lx, <strong>le</strong>s minorités françaises et <strong>la</strong> construction<br />
de l’identité canadienne-française, thèse importante qu’il faut publier<br />
à t<strong>ou</strong>t prix, Michel Bock se penche, p<strong>ou</strong>r sa part, sur <strong>le</strong>s<br />
minorités en territoire canadien et, en particulier, sur <strong>le</strong>s<br />
Franco-Ontariens 9 . L’auteur démontre de façon convaincante<br />
que <strong>la</strong> conception gr<strong>ou</strong>lxiste de <strong>la</strong> nation est essentiel<strong>le</strong>ment<br />
culturel<strong>le</strong>, organique, providentialiste et messianique ; qu’el<strong>le</strong><br />
pense <strong>la</strong> nation comme préexistante à l’État ; que, p<strong>ou</strong>r l’essentiel,<br />
el<strong>le</strong> n’a guère varié au fil <strong>des</strong> ans ; et qu’el<strong>le</strong> implique<br />
une solidarité, en droit, indépendante du régime politique et,<br />
en fait, aussi active que possib<strong>le</strong>. Les minorités canadiennesfrançaises<br />
font partie intégrante de <strong>la</strong> nation au même titre<br />
que <strong>le</strong>s Canadiens français restés au foyer québécois et peu<br />
importe <strong>la</strong> province canadienne <strong>ou</strong> l’État américain où el<strong>le</strong>s<br />
se sont établies. De cette définition de <strong>la</strong> nation par Gr<strong>ou</strong>lx<br />
déc<strong>ou</strong><strong>le</strong>nt ses idées concernant <strong>le</strong> renforcement du foyer national<br />
québécois, <strong>le</strong>s responsabilités de ce dernier à l’égard<br />
Le <strong>renard</strong> <strong>ayant</strong> <strong>la</strong> <strong>queue</strong> <strong>c<strong>ou</strong>pée</strong><br />
279<br />
<strong>des</strong> différentes composantes de <strong>la</strong> nation et l’attitude qu’il<br />
convient d’adopter à propos de l’autonomie provincia<strong>le</strong> et de<br />
l’indépendance. Je ne crois pas qu’il soit possib<strong>le</strong> de contester<br />
globa<strong>le</strong>ment l’interprétation de l’auteur.<br />
Des questions se présentent à l’esprit. L’auteur s<strong>ou</strong>tient<br />
que l’idéologie de Gr<strong>ou</strong>lx « était issue, d’une manière généra<strong>le</strong>,<br />
du romantisme politique du dix-neuvième sièc<strong>le</strong> français<br />
» (p. ii). L’identité nationa<strong>le</strong> tel<strong>le</strong> que <strong>la</strong> pense Gr<strong>ou</strong>lx lui<br />
apparaît comme une « construction romantique et organique »<br />
(p. 343). Mais <strong>la</strong> filiation avec <strong>le</strong>s auteurs français n’est pas<br />
établie de façon circonstanciée et détaillée. Le lien avec <strong>la</strong><br />
philosophie politique al<strong>le</strong>mande paraît encore plus ténu. L’exploration<br />
doit être p<strong>ou</strong>rsuivie. On s’en convainc d’autant plus<br />
que l’on tr<strong>ou</strong>ve s<strong>ou</strong>s <strong>la</strong> plume de Miche<strong>le</strong>t, en 1831, <strong>des</strong> phrases<br />
comme cel<strong>le</strong>s-ci à propos de <strong>la</strong> nation française : « […]<br />
une et identique depuis plusieurs sièc<strong>le</strong>s, el<strong>le</strong> doit être considérée<br />
comme une personne qui vit et se meut. Le signe et <strong>la</strong><br />
garantie de l’organisme vivant, <strong>la</strong> puissance de l’assimi<strong>la</strong>tion,<br />
se tr<strong>ou</strong>ve ici au plus haut degré [...] 10 »<br />
Que Gr<strong>ou</strong>lx rec<strong>ou</strong>rait au droit positif et au droit naturel<br />
p<strong>ou</strong>r s<strong>ou</strong>tenir <strong>le</strong> combat de <strong>la</strong> survivance est indubitab<strong>le</strong>.<br />
Mais on peut différer d’avis avec l’auteur, qui rattache <strong>la</strong> conception<br />
gr<strong>ou</strong>lxienne du droit naturel à <strong>la</strong> philosophie romantique.<br />
Le droit naturel dont se réc<strong>la</strong>me Gr<strong>ou</strong>lx est plutôt celui<br />
de l’anthropologie catholique, qui s’enracine dans <strong>le</strong> thomisme,<br />
<strong>le</strong>s encycliques papa<strong>le</strong>s et <strong>le</strong>s œuvres <strong>des</strong> catholiques sociaux,<br />
y compris <strong>le</strong>s auteurs de traités de droit public. Le droit naturel<br />
<strong>des</strong> romantiques est, en bonne partie p<strong>ou</strong>r <strong>le</strong>s Al<strong>le</strong>mands<br />
et essentiel<strong>le</strong>ment p<strong>ou</strong>r <strong>le</strong>s Français, <strong>le</strong> droit naturel moderne,<br />
celui <strong>des</strong> Lumières, qui el<strong>le</strong>s-mêmes ont puisé dans <strong>la</strong> pensée<br />
du XVII e sièc<strong>le</strong>, cel<strong>le</strong> de Locke, de Hobbes et de <strong>la</strong> Glorieuse<br />
Révolution de 1688-1689. Le matérialisme mécaniste et <strong>le</strong><br />
pragmatisme libéral ne sont pas considérés par Gr<strong>ou</strong>lx comme