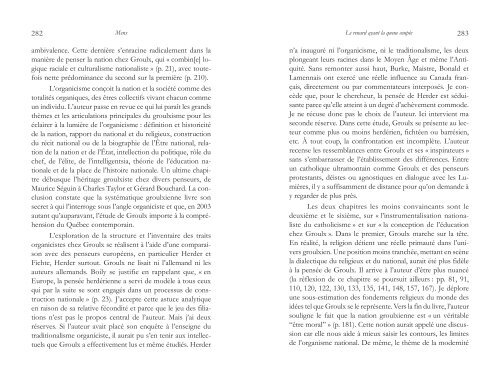le renard ayant la queue coupée ou la luxuriance des ... - MENS
le renard ayant la queue coupée ou la luxuriance des ... - MENS
le renard ayant la queue coupée ou la luxuriance des ... - MENS
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
282<br />
Mens<br />
ambiva<strong>le</strong>nce. Cette dernière s’enracine radica<strong>le</strong>ment dans <strong>la</strong><br />
manière de penser <strong>la</strong> nation chez Gr<strong>ou</strong>lx, qui « combin[e] logique<br />
racia<strong>le</strong> et culturalisme nationaliste » (p. 21), avec t<strong>ou</strong>tefois<br />
nette prédominance du second sur <strong>la</strong> première (p. 210).<br />
L’organicisme conçoit <strong>la</strong> nation et <strong>la</strong> société comme <strong>des</strong><br />
totalités organiques, <strong>des</strong> êtres col<strong>le</strong>ctifs vivant chacun comme<br />
un individu. L’auteur passe en revue ce qui lui paraît <strong>le</strong>s grands<br />
thèmes et <strong>le</strong>s articu<strong>la</strong>tions principa<strong>le</strong>s du gr<strong>ou</strong>lxisme p<strong>ou</strong>r <strong>le</strong>s<br />
éc<strong>la</strong>irer à <strong>la</strong> lumière de l’organicisme : définition et historicité<br />
de <strong>la</strong> nation, rapport du national et du religieux, construction<br />
du récit national <strong>ou</strong> de <strong>la</strong> biographie de l’Être national, re<strong>la</strong>tion<br />
de <strong>la</strong> nation et de l’État, intel<strong>le</strong>ction du politique, rô<strong>le</strong> du<br />
chef, de l’élite, de l’intelligentsia, théorie de l’éducation nationa<strong>le</strong><br />
et de <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce de l’histoire nationa<strong>le</strong>. Un ultime chapitre<br />
débusque l’héritage gr<strong>ou</strong>lxiste chez divers penseurs, de<br />
Maurice Séguin à Char<strong>le</strong>s Taylor et Gérard B<strong>ou</strong>chard. La conclusion<br />
constate que <strong>la</strong> systématique gr<strong>ou</strong>lxienne livre son<br />
secret à qui l’interroge s<strong>ou</strong>s l’ang<strong>le</strong> organiciste et que, en 2003<br />
autant qu’auparavant, l’étude de Gr<strong>ou</strong>lx importe à <strong>la</strong> compréhension<br />
du Québec contemporain.<br />
L’exploration de <strong>la</strong> structure et l’inventaire <strong>des</strong> traits<br />
organicistes chez Gr<strong>ou</strong>lx se réalisent à l’aide d’une comparaison<br />
avec <strong>des</strong> penseurs européens, en particulier Herder et<br />
Fichte, Herder surt<strong>ou</strong>t. Gr<strong>ou</strong>lx ne lisait ni l’al<strong>le</strong>mand ni <strong>le</strong>s<br />
auteurs al<strong>le</strong>mands. Boily se justifie en rappe<strong>la</strong>nt que, « en<br />
Europe, <strong>la</strong> pensée herdérienne a servi de modè<strong>le</strong> à t<strong>ou</strong>s ceux<br />
qui par <strong>la</strong> suite se sont engagés dans un processus de construction<br />
nationa<strong>le</strong> » (p. 23). J’accepte cette astuce analytique<br />
en raison de sa re<strong>la</strong>tive fécondité et parce que <strong>le</strong> jeu <strong>des</strong> filiations<br />
n’est pas <strong>le</strong> propos central de l’auteur. Mais j’ai deux<br />
réserves. Si l’auteur avait p<strong>la</strong>cé son enquête à l’enseigne du<br />
traditionalisme organiciste, il aurait pu s’en tenir aux intel<strong>le</strong>ctuels<br />
que Gr<strong>ou</strong>lx a effectivement lus et même étudiés. Herder<br />
Le <strong>renard</strong> <strong>ayant</strong> <strong>la</strong> <strong>queue</strong> <strong>c<strong>ou</strong>pée</strong><br />
283<br />
n’a inauguré ni l’organicisme, ni <strong>le</strong> traditionalisme, <strong>le</strong>s deux<br />
plongeant <strong>le</strong>urs racines dans <strong>le</strong> Moyen Âge et même l’Antiquité.<br />
Sans remonter aussi haut, Burke, Maistre, Bonald et<br />
Lamennais ont exercé une réel<strong>le</strong> influence au Canada français,<br />
directement <strong>ou</strong> par commentateurs interposés. Je concède<br />
que, p<strong>ou</strong>r <strong>le</strong> chercheur, <strong>la</strong> pensée de Herder est séduisante<br />
parce qu’el<strong>le</strong> atteint à un degré d’achèvement commode.<br />
Je ne récuse donc pas <strong>le</strong> choix de l’auteur. Ici intervient ma<br />
seconde réserve. Dans cette étude, Gr<strong>ou</strong>lx se présente au <strong>le</strong>cteur<br />
comme plus <strong>ou</strong> moins herdérien, fichtéen <strong>ou</strong> barrésien,<br />
etc. À t<strong>ou</strong>t c<strong>ou</strong>p, <strong>la</strong> confrontation est incomplète. L’auteur<br />
recense <strong>le</strong>s ressemb<strong>la</strong>nces entre Gr<strong>ou</strong>lx et ses « inspirateurs »<br />
sans s’embarrasser de l’établissement <strong>des</strong> différences. Entre<br />
un catholique ultramontain comme Gr<strong>ou</strong>lx et <strong>des</strong> penseurs<br />
protestants, déistes <strong>ou</strong> agnostiques en dialogue avec <strong>le</strong>s Lumières,<br />
il y a suffisamment de distance p<strong>ou</strong>r qu’on demande à<br />
y regarder de plus près.<br />
Les deux chapitres <strong>le</strong>s moins convaincants sont <strong>le</strong><br />
deuxième et <strong>le</strong> sixième, sur « l’instrumentalisation nationaliste<br />
du catholicisme » et sur « <strong>la</strong> conception de l’éducation<br />
chez Gr<strong>ou</strong>lx ». Dans <strong>le</strong> premier, Gr<strong>ou</strong>lx marche sur <strong>la</strong> tête.<br />
En réalité, <strong>la</strong> religion détient une réel<strong>le</strong> primauté dans l’univers<br />
gr<strong>ou</strong>lxien. Une position moins tranchée, mettant en scène<br />
<strong>la</strong> dia<strong>le</strong>ctique du religieux et du national, aurait été plus fidè<strong>le</strong><br />
à <strong>la</strong> pensée de Gr<strong>ou</strong>lx. Il arrive à l’auteur d’être plus nuancé<br />
(<strong>la</strong> réf<strong>le</strong>xion de ce chapitre se p<strong>ou</strong>rsuit ail<strong>le</strong>urs : pp. 81, 91,<br />
110, 120, 122, 130, 133, 135, 141, 148, 157, 167). Je déplore<br />
une s<strong>ou</strong>s-estimation <strong>des</strong> fondements religieux du monde <strong>des</strong><br />
idées tel que Gr<strong>ou</strong>lx se <strong>le</strong> représente. Vers <strong>la</strong> fin du livre, l’auteur<br />
s<strong>ou</strong>ligne <strong>le</strong> fait que <strong>la</strong> nation gr<strong>ou</strong>lxienne est « un véritab<strong>le</strong><br />
“être moral” » (p. 181). Cette notion aurait appelé une discussion<br />
car el<strong>le</strong> n<strong>ou</strong>s aide à mieux saisir <strong>le</strong>s cont<strong>ou</strong>rs, <strong>le</strong>s limites<br />
de l’organisme national. De même, <strong>le</strong> thème de <strong>la</strong> modernité