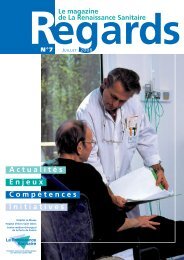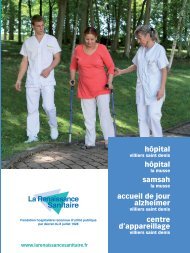N°13 - Juin 12 (.pdf) - La Renaissance Sanitaire
N°13 - Juin 12 (.pdf) - La Renaissance Sanitaire
N°13 - Juin 12 (.pdf) - La Renaissance Sanitaire
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
étiquettes autocollantes ont été créées<br />
en attendant la finalisation du dossier<br />
informatisé.<br />
Planning de l’évaluation<br />
des pratiques professionnelles<br />
et résultats attendus<br />
Ces mesures correctives ont été mises en<br />
place en janvier 20<strong>12</strong> avec une nouvelle<br />
Qualité et gestion des risques e n j e u x<br />
évaluation des comportements prévue<br />
pour le mois de juin 20<strong>12</strong>. Si nécessaire,<br />
un rappel sur l’attitude thérapeutique sera<br />
pratiqué en vue d’une troisième et dernière<br />
évaluation en octobre 20<strong>12</strong>. Il est clair que<br />
le but n’est pas de se conformer à 100 %<br />
aux recommandations officielles du<br />
GEHT. En effet, il s’agit bien de recommandations<br />
et non d’impératifs, et chaque<br />
Le temps de Quick et la mesure de l’INR<br />
• Le TP (taux de prothrombine) a ses limites: les résultats varient d’un laboratoire à l’autre<br />
en fonction de la sensibilité du réactif utilisé (thromboplastine). C’est pourquoi, on utilise<br />
aujourd’hui préférentiellement l’INR pour surveiller un traitement AVK.<br />
• Ce paramètre est calculé comme le rapport du temps de coagulation du malade sur le temps<br />
de coagulation du témoin (en secondes) porté à la puissance ISI, qui est l’indice de sensibilité<br />
de la thromboplastine utilisée et précisée par le fabricant.<br />
• On entend par « INR cible » la valeur thérapeutique recherchée en fonction de la pathologie<br />
considérée. Cet INR cible varie le plus souvent entre 2 et 3 mais, de façon plus précise, il faut<br />
distinguer les valeurs entre 2 et 2,5 suffisantes pour la prévention des thromboses veineuses<br />
et des embolies sur fibrillation auriculaire, en opposition avec les INR cibles élevés,<br />
supérieurs à 3 et pouvant aller jusqu’à 4,5, chez les patients porteurs de prothèses<br />
valvulaires cardiaques mécaniques, en particulier mitrales, ou d’un état de thrombophilie<br />
responsable d’accidents artériels ischémiques.<br />
patient représente un cas particulier amenant<br />
le médecin à moduler en fonction du<br />
contexte à risque hémorragique ou thrombogène.<br />
Le point le plus important reste la<br />
réalisation d’un contrôle biologique à<br />
« J+1 » qui est dans notre analyse l’anomalie<br />
la plus souvent rencontrée. ■<br />
Dr Sylvain Duthois<br />
Hôpital <strong>La</strong> Musse<br />
Bibliographie<br />
• A. Bezeaud, Exploration de la coagulation<br />
in EMC, Elsevier éd. SAS, 2001.<br />
• V. Simonet, Antivitamines K: utilisation pratique,<br />
EMC, Elsevier éd., 2003.<br />
• C. Gozalo, « GEHT. Surdosages asymptomatiques<br />
en antivitamines K »,<br />
STV 2008, 20, 56-68.<br />
Les Drs Corinne<br />
Rousselin et<br />
Sylvain Duthois<br />
au laboratoire<br />
de biologie<br />
médicale<br />
de l’hôpital<br />
<strong>La</strong> Musse<br />
L A R E n A i S S A n C E S A n i T A i R E • n ° 1 3 - j u i n 2 0 1 2 13