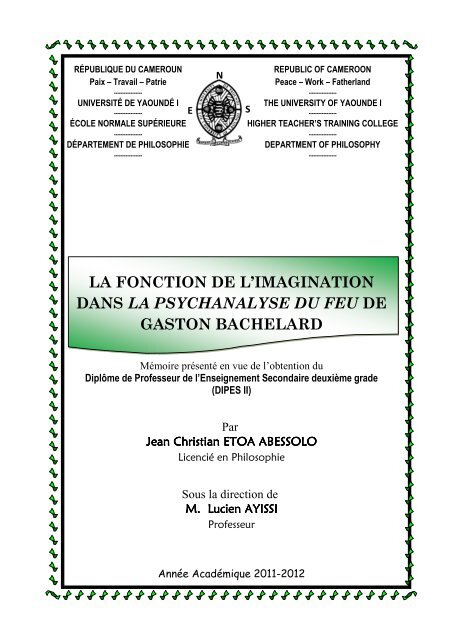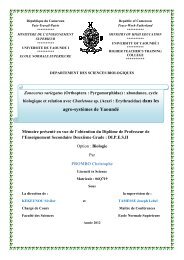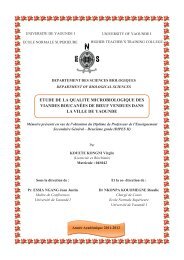MEMOIRE ETOA ABESSOLO - L'ENS
MEMOIRE ETOA ABESSOLO - L'ENS
MEMOIRE ETOA ABESSOLO - L'ENS
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON<br />
N<br />
Paix – Travail – Patrie Peace – Work – Fatherland<br />
----------------- -----------------<br />
UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I<br />
E<br />
----------------- -----------------<br />
ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE HIGHER TEACHER’S TRAINING COLLEGE<br />
----------------- -----------------<br />
DÉPARTEMENT DE PHILOSOPHIE DEPARTMENT OF PHILOSOPHY<br />
----------------- -----------------<br />
LA FONCTION DE L’IMAGINATION<br />
DANS LA PSYCHANALYSE DU FEU DE<br />
GASTON BACHELARD<br />
Mémoire présenté en vue de l’obtention du<br />
Diplôme de Professeur de l’Enseignement Secondaire deuxième grade<br />
(DIPES II)<br />
Par<br />
Jean Jean Christian Christian <strong>ETOA</strong> <strong>ETOA</strong> <strong>ABESSOLO</strong><br />
<strong>ABESSOLO</strong><br />
Licencié en Philosophie<br />
S<br />
Sous la direction de<br />
M. Lucien AYISSI<br />
Professeur<br />
Année Académique 2011-2012
DEDICACE<br />
A tous ceux qui comme moi,<br />
aspirent à la perfection et reconnaissent qu’ils ne savent rien.<br />
i
REMERCIEMENTS<br />
Nous remercions tous ceux qui, d’une façon quelconque ont contribué à la<br />
réalisation de ce travail. Il s’agit, en priorité de notre directeur de travaux, le Professeur<br />
Lucien Ayissi, qui a bien accepté nous encadrer pour ce travail, et pour sa totale<br />
disponibilité.<br />
Il s’agit également de tous les enseignants et encadreurs du Département de<br />
philosophie de l’École Normale Supérieure de Yaoundé, pour la qualité de la formation<br />
qu’ils nous ont dispensée. A travers eux, que tous ceux qui militent en faveur de<br />
l’excellence trouvent ici ma profonde gratitude.<br />
Nous sommes enfin reconnaissant aux familles, Abessolo, Enama Ambela,<br />
Nkama, Akoa, Ondoua, Tang, Ngbwa, Mbarga, Atangana André et Avouzoa, Foumane<br />
Enga’a : pour leur soutien ineffable durant toutes ces longues années d’études.<br />
ii
RESUME<br />
La réflexion sur le symbolisme du feu a été décisive pour les travaux de la poétique,<br />
de la sémiologie et même de l’épistémologie contemporaine. Par son ouvrage, La<br />
Psychanalyse du feu paru en 1938, Gaston Bachelard esquisse pour la première fois, une<br />
étude qui se réfère aux structures permanentes de la rêverie du feu. En dénonçant les<br />
valorisations scientifiques du feu, Bachelard fait d’une pierre deux coups : d’une part, il<br />
ruine toute théorie pseudo-scientifique des « quatre éléments » ; d’autre part, il montre que,<br />
derrière un élément en apparence homogène à la conceptualisation et même à la sensation,<br />
notamment le feu, se cachent des intentions structurales divergentes. L’effort de Bachelard<br />
est de séparer le « concept scientifique » des « arrière-images » de la subjectivité. Ainsi, la<br />
psychanalyse objective qui purifie l’objet de son terroir psychanalytique a tôt fait de<br />
dénoncer la mensongère unité de l’élémentarisme du feu. C’est dire que la poésie est, à<br />
l’instar de la science instauratrice d’un sens. La seule différence est que l’acte poétique est<br />
une fonction primitive qui ne renvoie à rien d’autre qu’à elle-même, alors que le langage<br />
scientifique, renvoie à un concept, c'est-à-dire à une opération mentale, à un problème à<br />
résoudre : il est la traduction d’un travail à effectuer.<br />
iii
ABSTRACT<br />
The reflection on fire symbolism has been crucial in contemporary epistemology,<br />
semiologiy and poetics works. A Gaston Bachelard sketches for the very first time a study<br />
that refers to as permanent structures of fire dreaming in his book intitled Psycho-analysis<br />
of fire published in 1938. In denouncing scientific values of fire, Bachelard equally tackles<br />
two other aspects: on the one hand, he scatters any false scientific theory based on the<br />
fourth elements; on the other hand, he shows that behind an apparent homogeneous<br />
element to the conceptualization and even for the sensitization notably fire, hide various<br />
structural intentions. Bachelard’s effort to separate the scientific concept of “backward<br />
pictures” from the subjectivity. Thus, the objective psychoanalysis that purifies the object<br />
from its psychoanalytical position has early succeeded in denouncing the lie behind fire<br />
element just to affirm that poetry is as well as science, meaningful. The only difference<br />
being that poetic activity has a primitive function that does not lead to another one except<br />
in itself whereas scientific language refers to a concept that is to a mental operation, in<br />
short to a problem to solve. In other words, it is the rendition of a work to be done.<br />
iv
INTRODUCTION GENERALE<br />
« L’imagination invente de l’esprit nouveau. » 1<br />
1 Gaston Bachelard, L’Eau et les rêves, Paris, José Corti, 1943, p. 24.
Accéder à la science c’est spirituellement rajeunir 2 a déclaré Bachelard pour<br />
souligner l’importance de l’adoption d’une certaine attitude si l’on aspire vraiment à<br />
l’objectivité et à la connaissance scientifiques : l’humilité. Le fait est que pendant<br />
longtemps et presque partout où l’on se trouve, on est frappé par certaines attitudes de<br />
croyance et prises de positions radicales ou inflexibles au point de nourrir un doute sur<br />
la « raison universelle ». Sans prétendre que l’universalité signifie l’uniformité de la<br />
pensée, il est quand même problématique de constater un certain penchant à<br />
l’irrationnel, au radicalisme de la pensée même dans les milieux éducatifs,<br />
universitaires supposés être ouverts en principe. C’est évident que l’on s’échange des<br />
informations pour s’instruire davantage, la connaissance étant diversifiée et plurielle,<br />
d’où la spécialisation ou la diversification en plus du fait que personne ne peut à lui<br />
seul tout connaître. L’ouverture semble donc de rigueur ici, comme partout où l’on est<br />
supposé apprendre ou s’instruire. Mais le plus souvent, il est fort regrettable de<br />
constater que chacun reste cantonné dans sa « position » que l’on défend plus qu’on<br />
partage : c’est donc clair qu’avant, pendant et après un apprentissage ou une formation<br />
quelconque, on a une intime conviction, une connaissance personnelle, voire subjective<br />
dans la plupart des faits quels qu’ils soient.<br />
L’apprenant, en milieu scolaire par exemple, entre en classe ou à la faculté avec<br />
des convictions déjà toutes constituées en savoirs, ce qui ne facilite pas une<br />
connaissance neutre ou objective, ce d’autant plus qu’il s’agit semble t’il pour ce<br />
dernier de défendre ses certitudes autant que possible. N’est-ce pas là une façon de<br />
« poser les conclusions avant les prémisses ? » Pourrait demander un syllogiste.<br />
Pourquoi cette attitude dans les milieux mêmes supposés être tolérants, ouverts ? Même<br />
l’enseignant dont le charisme intellectuel est plus que reconnu tombe fatalement dans<br />
cette erreur. Parce que théoriquement plus instruit, il est, semble-t-il plus apte à<br />
imposer sa façon de voir et par conséquent, il n’a presque plus rien à apprendre surtout<br />
qu’il est face à ses apprenants. Oubliant le caractère universel, interactif, mouvant et<br />
riche du gnoséologique, il se croit investi de tout pouvoir et savoir nécessaires pour<br />
pleinement remplir sa tâche à lui tout seul, sans aucune participation autre que la<br />
sienne. Ce qui est, nous semble-t-il une erreur comme on l’a déjà souligné plus haut. Il<br />
y’a donc une nécessité à comprendre le « pourquoi » et le « comment » de ce genre<br />
2 Gaston Bachelard, La Formation de l’esprit scientifique, Paris, VRIN, 2004,5 e éd., p.16.<br />
2
d’attitude pour ne pas dire leur origine, afin de revoir et d’améliorer nos<br />
comportements, nos connaissances, nos relations et …notre métier. D’où l’intérêt<br />
qu’on porte dans l’ensemble aux travaux de Gaston Bachelard, et précisément, à la<br />
Psychanalyse du feu où la subjectivité encore une fois, rejaillit pour constituer sous une<br />
forme de processus inconscient et latent, mais puissant un « obstacle épistémologique »<br />
à travers la rêverie et l’imagination.<br />
L’objectivité apparaît si vite et de prime abord dans les théories scientifiques au<br />
point que l’on a tendance à croire qu’elle nous est inhérente et toute donnée ; en vérité,<br />
il n’en est rien, l’objectivité contrairement à ce que l’on peut croire est un long<br />
processus si pénible et contraignant que seules les personnes ayant le goût de la vérité<br />
et de l’effort acceptent s’y soumettre. A cet égard, l’avant-propos de La psychanalyse<br />
du feu est d’une importance capitale. Dans la réflexion initiale sur le concept<br />
d’ « objet », Bachelard rappelle que le choix d’un objet ne nous rend nullement<br />
objectif. Nous croyons choisir alors que souvent, nous sommes choisis à notre insu.<br />
Il suffit que nous parlions d’un objet pour nous croire objectifs.<br />
Mais par notre premier choix, l’objet nous désigne plus que<br />
nous ne le désignons et ce que nous croyons nos pensées<br />
fondamentales sur le monde sont souvent des confidences sur la<br />
jeunesse de notre esprit 3<br />
Déclare Bachelard à cet effet. L’orientation, même scientifique dans le choix<br />
des objets d’étude, semble obéir à une certaine préférence, à une sentimentalité<br />
préférentielle qui semble ne rien avoir dès le départ avec l’objectivité. Dans tous les cas<br />
de figures, l’objectivité n’est nullement première, ce qui est premier c’est l’opinion, la<br />
rumeur publique, le préjugé, l’imagination. On saisit bien par-là que l’image,<br />
représentation individuelle de ma perception des faits n’est pas d’abord un vecteur de la<br />
connaissance, elle en est même tout le contraire. L’image dans son sens le plus large,<br />
est un voile interposé entre l’objet et nous. Elle est un obstacle, elle nourrit les<br />
obstacles épistémologiques analysés dans la Formation de l’Esprit Scientifique ; raison<br />
pour laquelle Bachelard, tant qu’il se situe sur le plan de la connaissance, insiste sur la<br />
nécessité d’une rupture, d’un rejet, d’une critique.<br />
3 Idem, La psychanalyse du feu, Paris, Gallimard, 1949.<br />
3
En fait l’objectivité scientifique n’est possible que si l’on a<br />
d’abord rompu avec l’objet immédiat, si l’on a refusé la<br />
séduction du premier choix, si l’on a arrêté et contredit les<br />
pensées qui naissent de la première observation 4 .<br />
Pour connaître le fait, il faut s’en détacher, éviter toute affection possible,<br />
s’oublier à la limite… évidemment, cela constitue une tâche longue, parfois ardue, à<br />
laquelle le sujet humain, rappelons-le, n’est pas disposé à se soumettre à moins de tenir<br />
à la vérité. La connaissance véritable est pourtant à ce prix, et elle est en théorie<br />
indépendante de l’émerveillement ou du rejet de notre personne.<br />
Notons avant d’aller plus loin dans nos investigations que, la pensée de Gaston<br />
Bachelard, penseur très original, s’enracine en général dans une triple tradition :<br />
premièrement, celle de la science contemporaine concernant la première moitié du XXe<br />
siècle qui a éveillé l’intérêt passionné et provoqué la réflexion du professeur de<br />
physique que fut Bachelard. Ensuite, l’intérêt qu’ont suscité pour lui, les travaux de<br />
Carl Gustav Jung, qui avait proposé une notion très importante, celle d’inconscient<br />
collectif, qui a certainement enrichi la « psychanalyse de la connaissance » pratiquée<br />
par Bachelard ; enfin, l’influence qu’ont eu les poètes et écrivains pour lui, d’Hésiode à<br />
Henri Michaux, en passant par Lautréamont, à qui il a consacré une étude. C’est dire<br />
qu’un esprit aussi universel que le sien ne pouvait se satisfaire de la seule approche<br />
philosophique. Philosophe, critique et épistémologue, Bachelard est aussi homme de<br />
science, grand penseur et poète. La particularité de notre ouvrage parlant de<br />
l’imagination réside dans le fait que l’auteur, sans le souligner lui-même, nous fait<br />
entrer au même moment dans un univers certes cognitif, mais presque synthétique de<br />
toute son œuvre qui met ensemble la triple tradition dont on vient de voir les différentes<br />
articulations : la science (classique et contemporaine), la psychologie et la poésie.<br />
Il s’agira donc dans le présent travail où il se pose concrètement le problème de<br />
la véritable fonction de l’imagination dans la connaissance, de voir, non seulement son<br />
déploiement, mais aussi ses différentes caractéristiques dans les productions humaines,<br />
scientifiques ou non pour mieux la situer dans le processus d’acquisition du savoir<br />
scientifique. Permettre par là, à partir d’une méthodologie analytique, une meilleure<br />
saisie de l’imaginaire qui a toujours été considérée comme essentiellement<br />
4 Ibidem.<br />
4
eproductrice du phénomène, à moins d’être purement sa copie. Il est important de<br />
rappeler en effet, depuis la période dite classique, que l’imagination, de façon critique,<br />
est considérée comme une faculté essentiellement reproductrice des images, de ce fait,<br />
elle renvoie presque exclusivement à la mémoire. Platon par exemple, placera<br />
essentiellement l’imagination dans le sens de la ressemblance et de la similitude, donc,<br />
elle ne sera que reproduction, même si elle peut, dans sa double polarité, soit nous<br />
rapprocher du réel ou de la vérité, soit nous en éloigner. Même si Descartes, Jean-Paul<br />
Sartre et Bergson pour ne citer que ceux-là, lui confèrent un statut nettement meilleur<br />
dans les théories de la connaissance moderne, elle reste quelque peu secondaire, voire<br />
assez négligeable pour ne pas dire réductive à l’irréel, car sa dimension créatrice n’est<br />
pas assez mise en valeur, la raison la précédant à tous les niveaux. On se contente de la<br />
cantonner à l’adaptation au monde sensible ou à l’assujettir à la raison. Comme quoi,<br />
l’imagination est sans doute, toujours secondaire à la réflexion, car vient après coup,<br />
suivant la réflexion. Pour Bachelard, l’ordre est inverse, « on ne peut étudier que ce<br />
qu’on a d’abord rêvé. La science se forme plutôt sur une rêverie que sur une expérience<br />
et il faut bien des expériences pour effacer les brumes du songe 5 ». Comme on peut le<br />
constater, même si l’ordre confère une grande importance au statut à lui accorder par<br />
les uns et les autres, toute la portée du statut de l’imagination pour Bachelard repose<br />
aussi et surtout, sur la définition à lui donner, la précision de son action quelconque sur<br />
les productions humaines, l’orientation spécifique à lui conférer, ainsi que la différence<br />
à établir entre elle et la réflexion purement formelle ou objective. Cette dernière peut<br />
lui être différente sans forcément lui être opposée. Et c’est là que réside le génie de<br />
l’imaginaire bachelardien, dont l’originalité est de lui trouver une très grande<br />
importance dans le processus d’acquisition de la connaissance scientifique, à condition<br />
bien sur de pouvoir la psychanalyser, la distinguer en ce qu’elle peut être consciente ou<br />
non, et pouvoir conséquemment la réorienter, suivant le sujet d’étude. Il s’agit donc en<br />
fait ici, de saisir la distanciation aussi nécessaire qu’importante à faire pour éviter toute<br />
confusion entre la connaissance dite scientifique et la rêverie, ainsi que nos vouloirs<br />
intimes.<br />
Pour ce faire, à partir d’une méthode analytique, il nous semble nécessaire de<br />
revisiter l’origine de la culture humaine tout entière, voir ensuite en quoi constitue<br />
5 Ibidem, p. 48.<br />
5
l’imagination dans les sciences dites expérimentales, pour finalement statuer sur la<br />
fonction véritable de la rêverie. Catharsis intellectuelle nécessaire pour mieux<br />
comprendre ce en quoi consiste précisément l’objectivité scientifique bachelardienne,<br />
concernant spécialement l’imagination. Ne pouvons-nous pas dès lors nous poser les<br />
questions de savoir : à quoi a bien pu constituer l’imagination dans la vie de l’homme<br />
primitif ? Comment comprenait et expliquait-il les phénomènes sans notre science<br />
actuelle ? Comment est-il parvenu au phénomène de production du feu ? La rêverie<br />
exerce-t-elle une grande influence dans nos réflexions objectives ? Si oui, qu’est ce qui<br />
explique cette tendance de l’esprit à l’imaginaire ?... Répondre à ces interrogations<br />
nous permettra sans doute de mieux comprendre l’originalité à laquelle assigne<br />
Bachelard à l’imagination.<br />
6
PREMIERE PARTIE :<br />
LES FORMES DE CULTURE HUMAINE :<br />
L’ORIGINE DES VALORISATIONS
La psychanalyse de la connaissance objective observée dans La Psychanalyse<br />
du feu concerne la science en général. Elle vise à la fois, aussi bien la médecine, la<br />
physique, la chimie, que la littérature… bref, toute la science classique jusqu’à celle<br />
dite contemporaine. Et c’est précisément au niveau de cette dernière que notre étude<br />
s’attelle avec plus de vigueur, car constat a été fait que la science est profondément<br />
adultérée par les valorisations, comme celles qu’expliquent les intuitions du feu<br />
accumulées dans la science. Rappelons-le, « les intuitions du feu sont des obstacles<br />
épistémologiques d’autant plus difficiles à renverser qu’elles sont plus claires<br />
psychologiquement 6 » d’où la nécessité de la psychanalyse comme méthode<br />
d’exploration de l’inconscient cognitif, surtout que, le feu qui permet de cuire les<br />
aliments, de se chauffer, de s’éclairer la nuit, d’effrayer les fauves rôdeurs semble être<br />
une des acquisitions les plus précieuses de la culture humaine. L’obsession du feu<br />
hanta longtemps les imaginations. Au XVIIe siècle encore, on comptait en Europe, le<br />
nombre, non des habitants du village, ni des familles, mais des « feux », symbole d’un<br />
groupe d’individus réunis. Notons cependant que si notre psychanalyse s’est attachée<br />
aux chimistes, biologistes, physiciens…des siècles passés pour mieux étudier le<br />
phénomène des valorisations du feu, elle surprend une homogénéité ou convergence de<br />
la subjectivité et de l’objectivité dans l’étude des phénomènes, même à notre époque<br />
pourtant dite moderne et où la distanciation entre les deux devrait être effective.<br />
Si on a donc pu observer et relever en plus de cela que, la conquête du feu est<br />
un fait marquant pour l’humanité en ce qu’il nous sépare d’une façon définitive de<br />
l’animal, on a cependant dû oublier comme le remarque si bien Bachelard qu’on n’a<br />
peut-être pas vu que l’esprit, dans son destin primitif, avec sa poésie et sa science,<br />
s’était formé dans la méditation du feu. Cette méditation passe d’une façon quasi<br />
absolue par l’imaginaire, la profondeur, le devenir quasi hypothétiques du rêveur. Le<br />
problème qui nous interpelle ici est celui de la grande importance qu’ont les<br />
valorisations humaines dans les sciences de la nature. La valorisation, notons-le, est<br />
cette tendance exagérée de l’esprit humain à mettre trop en valeur ses productions au<br />
détriment de tout. Surtout qu’il existe une continuité permanente de la pensée et de la<br />
rêverie et, comme le soulève si bien Bachelard lui-même, le danger provient du fait que<br />
« dans cette union de la pensée et des rêves, c’est toujours la pensée qui est déformée et<br />
6 Ibidem, p.107.<br />
8
vaincue 7 ». N’apparaît-il donc pas légitime de se demander pourquoi la rêverie est-elle<br />
si puissante ? Sans méconnaître son importance, ne faut-il pas cependant l’exclure à<br />
certains moments donnés d’une connaissance qui se veut objective ? Quel est en fait le<br />
statut fondamental de l’imagination dans la science ? Répondre à ces interrogations<br />
nous permettra sans doute de résoudre la difficulté que pose la confusion de la double<br />
activité que mènent la raison et la rêverie dans la science ; d’où la nécessité d’une<br />
catharsis intellectuelle ou psychanalyse de l’esprit scientifique ayant pour but l’arrêt,<br />
l’interdiction ou la réorientation de la rêverie dans le domaine de la science.<br />
7 Ibidem, p. 108.<br />
9
SECTION A:<br />
LA MAGIE OU LE PROBLEME DES<br />
ASPIRATIONS DE LA PENSEE HUMAINE
Dans les définitions scolastiques, l’homme passe communément pour un animal<br />
raisonnable. Cependant, les manifestations les plus lointaines de son activité paraissent<br />
folles : dans toutes les sociétés primitives fleurissent des pratiques de sorcellerie, de<br />
magie. Ces pratiques sont, sous une forme délirante, la première manifestation de la<br />
raison humaine dont toutes les autres activités de culture, religion, technique, art et<br />
science sont pour une large part issues. L’imagination « nous transcende et nous met<br />
face au monde 8 » souligne Armand Petit jean pour montrer l’importance paradoxale que<br />
peut avoir notre imagination sur nos représentations du monde qui, loin d’être<br />
unanimes, sont pour la plupart, divergentes. Ainsi, les conflits entre les interprétations<br />
ou les théories dans les sciences humaines sont courants ; mais il y’a lieu de se<br />
demander si les sciences de la nature sont exemptes des problèmes que connaissent les<br />
sciences dites « humaines » ? On peut, à raison se poser la question de savoir si, les<br />
sciences de la nature sont moins « humaines » ou moins chargées de subjectivité ? Il ne<br />
fait pas de doute que l’on explique ici, « scientifiquement » des mécanismes, des<br />
phénomènes, en mettant hors-jeu des curiosités jugées « non scientifiques » mais<br />
échappe-t-on pour autant à toute subjectivité, sentimentalité ou préférence ? Peut-on<br />
véritablement être neutre lors de l’étude d’un phénomène qui nous est extérieur ? Voilà<br />
les questions à se poser pour engager, dès le départ, le problème que posent les<br />
valorisations humaines dans la vie en général, et dans la science précisément. Il est<br />
donc question pour nous de, remonter aux source et genèse mêmes de la connaissance,<br />
pour saisir la difficulté que pose particulièrement l’imagination dans la connaissance,<br />
depuis que l’homme aspire à la rationalité. Cette analyse nous amène donc à revoir les<br />
implications de la magie dans la vie humaine.<br />
En effet, l’activité magique dans la vie humaine semble si importante que l’on<br />
n’arrive presque pas à se convaincre de la totale objectivité des faits, même en science.<br />
Les phénomènes aussi anodins que la mort par exemple, sont toujours entourés<br />
d’explications relevant parfois du délire. Il semble toujours « normal » et prioritaire<br />
d’attribuer une explication magique pour ne pas dire irrationnelle, à ces phénomènes de<br />
forme ou de constitution élémentaires. La mort semble pourtant banale et inhérente à<br />
notre constitution biologique que la couvrir d’autant de mystères, pose un problème<br />
permanent à notre entendement. La magie, notons-le, est un savoir qui permettrait par<br />
8 Armand Petit Jean, Imagination et Réalisation, Paris, Passim, 1936.<br />
11
des procédés secrets et la maîtrise de forces occultes d’obtenir des effets ne relevant<br />
pas d’explications rationnelles. Les hommes entretiennent donc une liaison particulière<br />
avec l’irrationnel. Il faut donc commencer par comprendre, le pourquoi de cette place<br />
spéciale pour ne pas dire spécifique du fantastique dans la conscience humaine afin de<br />
mieux aborder la difficulté que pose la subjectivité dans la vie et partant, dans la<br />
science.<br />
Le sorcier qui perce des figurines dans le but de tuer à distance ses ennemis, celui<br />
qui asperge les champs de quelques gouttes d’eau rituelle pour faire pleuvoir ou celui<br />
qui compose des philtres d’amour, nous offrent des exemples typiques et bien connus<br />
de magie. Ils nous présentent clairement en quoi consiste le délire magique : l’homme<br />
agit sur la nature par des moyens psychologiques. Il essaye d’intimider les vents et les<br />
pluies par ses incantations. Ainsi, le monde serait constitué par des forces que l’on peut<br />
séduire, dompter et diriger par des paroles ou la volonté. Le monde est donc plein<br />
d’âmes et la magie n’est rien d’autre que la « stratégie de l’animisme ». Les<br />
ressemblances subjectives sont tenues pour des instruments d’action objective, celui<br />
qui s’empare du symbole s’empare en même temps de l’objet.<br />
Le feu étudié dans notre ouvrage aurait donc une explication pseudo-scientifique<br />
de nature purement idéologique, dans un processus inconscient de mystification.<br />
L’ordre des facteurs pour l’explication sous-tend ici que ce n’est pas le naturel ou le<br />
phénomène qui explique le culturel, ce n’est pas le biologique qui explique le social, au<br />
contraire c’est le social qui explique le biologique pour mieux dire que c’est l’idée qui<br />
constitue et organise un fait existant pourtant indépendant de notre réflexion. C’est<br />
pourquoi il apparaît clairement dans notre ouvrage que «le feu est donc initialement<br />
l’objet d’une interdiction générale ;d’où cette conclusion :l’interdiction sociale est<br />
notre première connaissance générale sur le feu » 9 pour dire que le feu est considéré<br />
comme un phénomène unifiant objectivité et subjectivité, aussi curieux ou paradoxal<br />
que cela puisse paraître .S’il nous est demandé de savoir si le magicien prétend-il<br />
comme le croyait Voltaire, détenir « le secret de faire ce que la nature ne peut faire » ?<br />
Il y’a lieu de savoir qu’en fait, les primitifs ne distinguent guère la nature et le<br />
surnaturel ; cette distinction ne sera claire que lorsque l’activité scientifique nous aura<br />
familiarisés avec l’idée de loi naturelle et de causalité mécanique. Ce qui nous parait<br />
9 Gaston Bachelard, op. cit., p. 29.<br />
12
plus intéressant ici, c’est le fait de savoir pourquoi la magie s’est perpétuée, malgré<br />
l’échec constant de ses pratiques. Ce qui nous amène à dire qu’en fait la magie a<br />
toujours été soutenue par l’intensité des désirs et passions qu’elle prétendait satisfaire.<br />
Le désir humain de dompter les forces qui règlent la vie et la mort, la santé et la<br />
maladie, la prospérité et le malheur, est assez puissant pour obscurcir et faire oublier<br />
les leçons amères de l’expérience. Considérée du haut de notre science moderne, la<br />
magie n’est qu’un rêve, une action imaginaire. Ses procédés psychologiques et<br />
symboliques ignorent tout des lois réelles de la matière. Et pourtant, la culture humaine<br />
tout entière s’enracine dans la magie primitive à partir de la technique, la religion, l’art<br />
et la science.<br />
La technique en effet est en germe dans les recettes délirantes du magicien. Car<br />
celui-ci est avant tout l’homme qui veut transformer les choses, l’homme pour lequel le<br />
monde cesse d’être un spectacle dont il serait le témoin passif. Le rêve magique fait de<br />
l’homme un démiurge qui prétend dicter sa loi à l’univers au lieu d’en être le jouet.<br />
L’idée de causalité qui, rappelons-le dans son essence est technique et prométhéenne,<br />
la cause étant « ce qui fait » disait Pradines est éminemment impliquée dans le rituel<br />
magique ;certes la causalité sur laquelle se fonde le magicien est imaginaire, du moins<br />
la causalité par laquelle nous pourrions agir sur la matière est indûment c'est-à-dire<br />
contrairement à la règle objective ou scientifique actuelle, conçue sur le modèle de la<br />
causalité psychologique, celle qui nous fait convaincre, effrayer, séduire. Mais<br />
l’exigence de causalité technique s’affirme, se perpétue malgré les échecs ; à travers les<br />
délires de la magie, l’homme ne cesse de proclamer sa foi en son propre pouvoir. Cette<br />
attitude se retrouve ensuite dans la religion malgré quelques légères différences.<br />
La religion semble dans ses plus lointaines origines étroitement liée à la magie.<br />
La magie est la première source du mysticisme sous toutes ses formes, c’est cette<br />
croyance absolue qui se forme autour de l’idée selon laquelle l’homme est tout puissant<br />
face à la nature. Non pas que la magie débouche sur le domaine du surnaturel, puisque<br />
les forces que le magicien croit dompter sont les forces mêmes de la nature. Mais la<br />
magie est déjà une mystique dans la mesure où elle met le sorcier et ses disciples en<br />
communion avec la force qui anime la nature entière ; et pour être naturelles les<br />
puissances avec lesquelles la magie prétend sympathiser n’en sont pas moins cachées et<br />
mystérieuses. Par l’affirmation de l’existence d’un monde invisible et la croyance que<br />
13
l’homme peut participer à ce monde, sympathiser avec lui, la magie prépare la religion.<br />
Les mêmes hypothèses s’observent dans l’art.<br />
L’art lui-même est sans doute d’origine magique : les premières sculptures sont<br />
peut-être des figurines destinées aux envoûtements. Les peintures rupestres de la<br />
préhistoire semblent liées à un rituel magique. Les œuvres les plus anciennes datent du<br />
paléolithique, entre 15000 et 20000 ans. On observe par exemple les peintures aux<br />
couleurs vives des cavernes d’Espagne et du sud de France qui représentent avec une<br />
exactitude étonnante des bisons, des chevaux ou des cerfs. Les scènes de chasse<br />
dessinées sur les murs des grottes représentent presque toujours des animaux blessés ou<br />
pris au piège ; il est probable que le sorcier ou l’artiste, en représentant de telles scènes<br />
croyait ainsi, assurer une chasse fructueuse. Par ailleurs, il est remarquable que les<br />
femelles soient généralement figurées pleines, ce qui est sans doute lié à des rites<br />
magiques de fécondité, devant assurer la multiplication du gibier, c’est-à-dire la<br />
certitude d’être ravitaillé en tout temps. Certitude qui s’exprime concrètement avec la<br />
science.<br />
La magie est également une des sources de la science. L’idée du déterminisme<br />
scientifique selon laquelle les phénomènes ne se produisent pas n’importe comment<br />
mais dépendent de conditions d’existence bien déterminées, est déjà présente dans la<br />
croyance du magicien. Frazer, l’un des historiens les plus perspicaces de la magie,<br />
remarque que le magicien est absolument convaincu que les mêmes causes produiront<br />
sans se démentir jamais les mêmes effets. Il pense que l’accomplissement de la<br />
cérémonie convenable, accompagnée du charme approprié, sera indubitablement suivi<br />
du résultat désiré à moins, bien entendu, que les envoûtements d’un collègue plus<br />
puissant ne viennent contrarier et déjouer ses propres incantations. La magie suppose<br />
donc l’affirmation d’un déterminisme imaginaire, qui dans une certaine mesure prépare<br />
la connaissance du déterminisme réel.<br />
Nous apercevons ainsi, la signification fondamentale de toutes les œuvres du<br />
génie humain, qu’il s’agisse de la technique, de la religion ou de l’art. L’homme ne<br />
s’est jamais contenté d’être le spectateur passif des apparences .Il ne s’est jamais<br />
contenté d’accueillir comme l’a si bien dit Alain, cette pluie de l’expérience qui jamais<br />
n’instruit. L’homme a toujours pris sur l’univers réel un certain recul afin d’expliquer<br />
14
cet univers et le transformer. Alors que l’animal ne cesse jamais d’être présent à<br />
l’univers, l’homme prend ses distances pour se re-présenter l’univers et le dompter. Il<br />
faut commencer par reconnaître cette attitude transformatrice et imaginaire de la pensée<br />
qui a presque toujours été inhérente à l’homme avant d’entamer toute étude sur quelque<br />
phénomène que ce soit. S’il est donc vrai que les premières représentations que<br />
l’homme se fait du monde sont mythologiques et ses premières recettes d’action<br />
délirantes, précisément, le caractère imaginaire des idées primitives souligne le<br />
dynamisme de l’esprit humain, qui projette au-devant du spectacle de l’univers et au-<br />
devant de ses propres actes des conceptions a priori. L’homme est le seul être qui non<br />
content de voir et de subir, imagine, invente, cherche au-delà de ce qui apparaît le<br />
secret des apparences. Ainsi, la magie comme source ou partie de la rêverie, de<br />
l’imaginaire même dans ses pires extravagances esquisse déjà l’autonomie de la raison.<br />
Sans toutefois renier cette spécificité humaine de la pensée qui fait de nous des êtres<br />
différents des animaux, il y’a lieu de ne pas confondre l’objet d’étude ou le phénomène<br />
qui désigne un ensemble de réalités qui existent indépendamment de notre pensée ou de<br />
notre imagination avec le sujet ou l’ensemble de réalités spirituelles produites par notre<br />
pensée comme on le verra à la suite de nos travaux. Le problème que met en évidence<br />
Bachelard dans notre Psychanalyse du feu consiste en effet, dans l’étude des sciences<br />
dites expérimentales, à personnifier les phénomènes, à les analyser en conformité avec<br />
nos affections : c’est donc le désir de construire une représentation du monde,<br />
d’expliquer les choses par des lois de sympathie, d’antipathie, d’affinités symboliques<br />
qui fait problème. Attitude qu’on rencontre jusqu’aujourd’hui dans la science et qu’il<br />
faut combattre pour parvenir objectivement à la conformité de ce que l’on dit, pense<br />
avec ce qui est ou devrait être, même si cela s’avère pénible et harassant à la limite.<br />
Ainsi, « s’il est vrai que le monde commence chaque matin, il n’en est pas moins<br />
que le passé a, lui aussi, connu tous nos commencements et qu’il les a souvent poussés<br />
plus loin que nous » 10 . Expression d’une mentalité primitive et arbitraire de l’Homme,<br />
la magie, les mythes traduisent sans doute des complexes ou des opérations de pensée<br />
complexes qui nous fournissent des modèles logiques à travers lesquels les sociétés<br />
dites « primitives » ou « traditionnelles » ou « archaïques » structurent leurs<br />
représentations du monde et d’elles mêmes. Les antiques magiciens ont souvent<br />
10 Kurt Seligmann, (préface de Jacques Bergier) Histoire des magies, Paris, Planète, (sans date) p. 11.<br />
15
parcouru avant nous, à leur manière, les chemins que notre science est en train de<br />
redécouvrir. Ils sont les ancêtres de nos savants. Ils témoignent mystérieusement de<br />
réussites oubliées et dont nous serions sages de rechercher les traces pour en tirer<br />
profit. On peut donc estimer dès lors que tout système mythologique est le reflet d’une<br />
structure sociale indissociable d’un système de valeurs déterminé à un moment donné.<br />
Etudier et comparer les mythes, c’est donc découvrir comment, dans une société<br />
donnée, les techniques, l’art, les croyances religieuses ou non, l’économie,<br />
l’organisation politique,…sont des aspects interdépendants de la vie sociale et<br />
constituent des domaines qui se répondent à des niveaux différents d’une même<br />
structure. N’est ce donc pas à partir de là que l’on peut expliquer la difficulté que pose<br />
la connaissance dite métaphysique dans l’étude des phénomènes physiques ou<br />
objectifs ?<br />
16
SECTION B:<br />
FEU, SUBSTANCE ET VALEUR : LA<br />
METAPHYSIQUE DU FEU
Le problème de confusion des objets de science que connaît la pensée et qui<br />
provient de l’imagination a donc des origines lointaines. La raison, capable de réflexion<br />
et d’interrogation à l’infini, associée à la liberté, se satisfait mal de ce qui est limité.<br />
Elle tient difficilement dans ses limites que lui impose sa propre analyse de la faculté<br />
de connaître. Cette analyse, qui circonscrit le phénoménal connaissable, ne cesse de se<br />
référer à un monde en soi et à un sujet absolus. C’est pourquoi « en tant que substance<br />
le feu est certainement parmi les plus valorisées, celle qui déforme le plus les<br />
jugements objectifs » 11 déclare Bachelard à propos. L’absolu, fondement de l’action,<br />
n’est pas affaire de connaissance, mais objet d’une foi. « Aussi longtemps que j’explore<br />
les motifs et les buts de mes actes, je m’en tiens au fini et au relatif. Ce n’est que si ma<br />
vie s’alimente à une source injustifiable objectivement qu’elle dérive de l’absolu. »<br />
L’absolu « n’est réel que dans la foi qui permet de le vivre et pour la foi qui permet de<br />
le voir » 12 dira Jaspers empruntant à Kierkegaard l’idée de la foi comme adhésion de la<br />
liberté à la transcendance.<br />
En effet, plus que d’autres peuples de l’antiquité les Grecs se servirent du<br />
raisonnement par induction qui donna un cadre poétique aux sombres images de la<br />
mythologie et s’infiltra dans leur philosophie. Les phénomènes naturels furent<br />
examinés comme les plus hautes spéculations de l’esprit, lequel était censé participer<br />
du divin. Cela explique pourquoi les Grecs furent de si médiocres expérimentateurs ; en<br />
dépit de leur logique magistrale, ils ne produisirent que de vagues et peu scientifiques<br />
explications des faits de la nature. L’esprit avait pris le pas sur la matière de façon<br />
disproportionnée, raison pour laquelle Bachelard dans son avant-propos déclare :<br />
On trouverait, sous les théories plus ou moins facilement<br />
acceptées par les savants ou les philosophes, des convictions<br />
souvent bien ingénues. Ces convictions non discutées sont autant<br />
de lumières parasites qui troublent les légitimes clartés que<br />
l’esprit doit amasser dans un esprit discursif 13 .<br />
Cette négligence de l’expérimentation résultait de leur complaisance à l’égard de ce<br />
qu’ils considéraient comme « supérieur », et de l’acceptation sans réserve de l’autorité<br />
de leur raison, qui pouvait se passer de preuves matérielles. Et l’Occident hérita cette<br />
11 Gaston Bachelard, op. cit., p.126.<br />
12 Mikel Dufrenne et Paul Ricœur, Karl Jaspers et la philosophie de l’existence, Paris, Seuil, 1947.<br />
13 . Ibid., p.18.<br />
18
méthode peu scientifique de la philosophie grecque. De l’essence transcendante de<br />
l’homme, on ne peut avoir qu’une expérience indirecte.<br />
L’être en soi, le fondement universel, l’absolu, doit prendre<br />
objectivement figure devant nos yeux, fût-ce sous une forme<br />
inadéquate en tant qu’objective et qui s’écroule sur elle-même,<br />
laissant en nous par sa destruction la pure clarté de<br />
l’englobant 14<br />
Dira Jaspers pour étayer sa spécificité des « chiffres » qui ne sont que les signes<br />
de la transcendance dans l’immanence. Jaspers appelle « chiffres » ce qui peut<br />
apparaître comme un signe de l’Englobant, une « médiation entre existence et<br />
transcendance » pour estimer que « Tout peut être chiffre », par exemple :<br />
1- La nature, domaine par excellence de la première conversion de l’objet au<br />
chiffre, puisque tout peut y servir de symbole laissant « transparaître » un<br />
mystère de l’Être.<br />
2- Tout ce qui renvoie à une dimension métaphysique de la réalité vécue – la<br />
communication, qui révèle la déchirure de l’existence, désignant, par son<br />
défaut même, l’Un transcendant, et l’échec, qui montre l’oscillation de<br />
l’existence entre une aspiration infinie et l’être-là où elle retombe ;<br />
3- Les mythes, les « ontologies et métaphysiques millénaires » du feu, de la<br />
matière, de l’esprit, du devenir universel,…sont « la langue immédiate de<br />
l’Être », telle que l’homme indirectement la parle, « désignant l’être au<br />
moyen d’une écriture chiffrée ; le philosophe, après l’avoir tracée en<br />
présence de l’Englobant pour éclairer son être propre et l’Être même s’est<br />
laissé aller à l’erreur de la considérer comme une réalité objective définie qui<br />
serait en même temps l’être en soi. »<br />
De telles évidences dont la profondeur ne fait pas unanimité nous ramènent aux<br />
origines mêmes de la pensée philosophique originale. C’est pour cela que Bachelard<br />
estime que « si le feu, phénomène au fond bien exceptionnel et rare, a été pris pour un<br />
élément constituant de l’univers, n’est-ce pas parce qu’il est élément de la pensée,<br />
14 Jaspers Karl, Introduction à la philosophie, Paris, Seuil, 1932.<br />
19
l’élément de choix pour la rêverie ? » 15 . A travers tout le moyen Age, pendant la<br />
Renaissance, et même à des époques plus récentes, le progrès des sciences de la nature<br />
a été retardé par la persistance de cette tradition de l’originalité.<br />
A vrai dire, ces substances immédiatement valorisées, qui<br />
engagent l’étude objective sur des thèmes sans généralité, sont<br />
moins nettement doubles (…) que le feu ; mais elles portent tout<br />
de même une fausse marque, le faux poids des valeurs non<br />
discutées 16 .<br />
Pour Platon par exemple, il y’a quatre espèces d’êtres : ceux de l’air, les<br />
oiseaux ; ceux de l’eau, les poissons ; ceux de la terre, les animaux terrestres, et ceux<br />
du ciel, les étoiles, dont l’élément est le feu. Pendant la renaissance, Agrippa de<br />
Nettesheim (Agrippa Von Nettesheim, Heinrich Cornelius (1486-1535), médecin,<br />
alchimiste et philosophe allemand), répugnant à admettre l’idée que les étoiles étaient<br />
reliées à la faune terrestre, modifia le postulat de Platon. Ainsi, fondant son opinion sur<br />
Aristote, Dioscoride ((v. 40-90 apr. J.-C.), médecin et botaniste grec) et Pline l’Ancien<br />
((v. 23-79 apr. J.-C.), écrivain latin et auteur d’une « encyclopédie », il dit que le feu<br />
est le domaine des salamandres et des grillons. Une simple expérience aurait prouvé<br />
que les salamandres et les grillons meurent dans le feu comme tout autre animal, mais<br />
Agrippa partageait l’aversion du passé pour l’expérimentation. Nous pouvons donc<br />
constater ici avec Bachelard que les intuitions du feu, plus peut-être que toute autre<br />
« restent chargées d’une lourde tare. Elles entraînent à des convictions immédiates dans<br />
un problème où il ne faudrait que des expériences et des mesures » 17 . Pline nous<br />
apprend que de telles croyances aux vertus merveilleuses des salamandres avaient<br />
cours en Égypte et à Babylone. Sans doute Aristote avait-il fondé sa sagesse sur celle<br />
de ses voisins orientaux et ne trouvait-il pas nécessaire de soumettre la salamandre à un<br />
test scientifique. Et c’est ainsi qu’une superstition survécut à peu près deux mille ans,<br />
et c’est « ainsi que les idées anciennes traversent les âges ; elles reviennent toujours<br />
dans les rêveries plus ou moins savantes avec leur charge de naïveté première » déclare<br />
Bachelard 18 . Que la nature ardente de la salamandre fut communément admise au<br />
temps d’Agrippa, on n’en peut douter puisque son royal contemporain, François Ier,<br />
15 Gaston Bachelard, op. cit., p.42.<br />
16 Ibidem, p.17.<br />
17 Ibidem, p.13.<br />
18 Ibidem, p.119.<br />
20
adopta comme emblème ce batracien entouré de flammes. Cette façon de raisonner des<br />
philosophes conduisait aux pires absurdités, encore qu’il y’en eut de poétiques. Pour<br />
Platon, la tête, habitacle des idées, était sphérique à l’image des étoiles ; à la différence<br />
du reste du corps, elle était reliée au ciel ; un petit isthme, le cou, séparait nettement<br />
l’intelligible et le corporel. Le monde de Platon est un monde magique ; car il est<br />
unifié : toutes choses sont connexes. Les mêmes remarques concernent les chimistes et<br />
biologiques du siècle des lumières où l’on constate avec Bachelard que « ce sont ces<br />
valeurs inconscientes qui font la permanence de certains principes d’explication » 19 .<br />
Avec eux, on constate comme le dit si bien Scheele en étudiant le phénomène du feu :<br />
Tantôt la chaleur est le Feu élémentaire, bientôt elle est un effet<br />
du Feu : là, la lumière est le feu le plus pur et un élément ; là,<br />
elle est déjà répandue dans toute l’étendue du globe, et<br />
l’impulsion du Feu élémentaire lui communique son mouvement<br />
direct ; ici, la lumière est un élément qu’on peut enchaîner au<br />
moyen de l’acidum pingue, et qui est délivré par la dilatation<br />
de cet acide supposé, etc. 20 .<br />
Ainsi, les conceptions substantialistes et animistes sont mêlées d’une façon<br />
inextricable même dans l’étude des phénomènes. C’est ainsi que le feu est devenu plus<br />
qu’un phénomène physique anodin, un symbole de pureté ; le nœud du problème se<br />
situant au contact de la métaphore et de la réalité. Bachelard à ce propos se demande si<br />
« le feu qui embrasera le monde au jugement dernier, le feu de l’enfer sont-ils ou ne<br />
sont ils pas semblables au feu terrestre ? » 21 . Cette variété dans les opinions peut<br />
d’ailleurs souligner l’énorme floraison des métaphores autour de l’image première du<br />
feu estime Bachelard à propos. Le principe suprême, à la fois matière et raison, est le<br />
Feu et tout n’est que transformation du feu : « Le feu se transforme d’abord en mer ; de<br />
la mer une moitié devient terre et l’autre souffle igné » 22 . Le feu étant l’unique principe<br />
d’un monde un et illimité, tout ce qui est engendré par le feu doit retourner au feu, l’un<br />
se faisant multiple et le même devenant autre dans un perpétuel mouvement. Le feu,<br />
principe de toute chose, est en même temps polémos (guerre), car à tous les niveaux,<br />
cosmique ou anthropologique, les contraires s’affrontent dans une lutte et un conflit<br />
19 Ibid., p.108.<br />
20 Charles Guillaume Scheele, Traité chimique de l’air et du feu, Paris, trad., 1781.<br />
21 Gaston Bachelard, op.cit, p. 174.<br />
22 Héraclite, fragment 31.<br />
21
permanents. Mais le feu est en même temps logos, raison, pensée, et l’opposition<br />
matérielle des contraires devient alors contradiction dialectique et la loi universelle<br />
d’ajustement des contraires qui s’affrontent est dite « harmonie » ce qui nous semble<br />
paradoxal, du fait de la confusion que ces métaphores peuvent semer dans le fait par<br />
exemple à un même moment donné.<br />
Ainsi, la difficulté que pose la confusion des objets à la science s’explique par<br />
la présence des valorisations métaphysiques dans les sciences expérimentales qui n’ont<br />
pourtant rien à voir avec elle. La raison ne cesse donc dans cette erreur, d’entretenir<br />
une référence à l’absolu en expliquant la nature. Il s’agit pourtant de distinguer, le<br />
phénomène du noumène comme l’aurait dit Kant, car :<br />
Les choses qui apparaissent à nos sens, en tant qu’on les pense<br />
à titre d’objets suivant l’unité des catégories, s’appellent<br />
phénomènes. Mais si j’admets des choses qui soient simplement<br />
des objets de l’entendement et qui pourtant peuvent être<br />
données, comme telles, à une intuition, sans pouvoir l’être<br />
toutefois à l’intuition sensible (…), il faudrait appeler ces choses<br />
des noumènes. 23<br />
Pour ne pas dire au-delà de la connaissance. On comprend donc pourquoi la<br />
métaphysique ne peut pas être une science : « des pensées sans contenu sont vides ». il<br />
ne peut y avoir de connaissance sans intuition sensible. Les objets de l’intuition pour<br />
les mathématiques sont l’espace et le temps ; pour la physique, ce sont les données<br />
expérimentales. En métaphysique, il n’y a aucun objet que nous puissions connaître par<br />
intuition sensible : Dieu, l’âme, le monde comme totalité ne peuvent pas être connus<br />
par expérience. Toutes les méditations métaphysiques ne sont que des concepts vides,<br />
et c’est là un usage illégitime de l’entendement, bien qu’il soit inévitable.<br />
L’ « Absolu » n’a-t-il pas toujours été le thème de la philosophie sous des appellations<br />
diverses, telles que : la Cause qui ne serait pas toujours déjà un effet, la Condition<br />
inconditionnée, la Substance, c’est-à-dire cela qui existe en soi et par soi, la Totalité qui<br />
ne serait pas toujours encore une partie, la Fin qui ne serait plus un moyen ou une étape<br />
vers un but ultérieur… ? Or, il ne fait nul doute que les scientifiques croient en<br />
l’existence réelle de tels absolus : l’existence du monde en soi, origine de la totalité des<br />
phénomènes ; l’existence du sujet en soi, c’est-à-dire de l’esprit substantiel support des<br />
23 Emmanuel Kant, Critique de la Raison pure, Paris, PUF, 1787(2 e édition modifiée) p.224<br />
22
structures transcendantales comme l’explique la physique ou la chimie du feu pour ne<br />
citer que ces deux exemples. Dieu tout comme le feu serait source et articulation du<br />
monde et du sujet en soi. Pourtant, ces absolus qui sont des « noumènes » comme<br />
l’aurait dit Kant ne peuvent devenir des objets de connaissance scientifique. La raison<br />
en est qu’il faut distinguer afin de les séparer, deux types de science : la science dite<br />
formelle qui est celle que le sujet ou la raison élabore en thématisant ses propres<br />
structures exemple des mathématiques. La science réelle qui est la science au sens<br />
ordinaire du terme, les sciences de la nature, c’est-à-dire celles qui s’appliquent à des<br />
objets, mais en tant que phénomènes co-constitués par l’expérience qui fournit la<br />
matière et par la raison cognitive qui structure, organise. La science des noumènes ou<br />
« choses en soi »ne pourrait donc être ni formelle parce que les noumènes ne sont pas<br />
des formes de la raison du fait qu’ils existent absolument, ni réelle en ce qu’elle n’est<br />
pas saisie du phénomène. Le problème s’explique par ailleurs du fait que les idées<br />
morales qu’on trouve assez dans la métaphysique ont tendance, si l’on n’y prête un soin<br />
extrême, à tomber dans l’obscurité et la confusion. Comme on peut donc le constater,<br />
ni la science dite formelle, ni celle de la nature ne peuvent se satisfaire du principe<br />
métaphysique. Il n’y a derrière les phénomènes, à titre de chose en soi ou d’essence,<br />
que la volonté, dont le monde est le phénomène. Le désir de comprendre, d’expliquer et<br />
de reconnaître ses productions est fort et inhérent à l’esprit humain qu’on feint de le<br />
mentionner, si ce n’est par omission involontaire de le reconnaître qu’on l’écarte de nos<br />
productions dites objectives. Bachelard attire à cet effet, notre attention sur une<br />
remarque que l’on pourrait prendre pour anodine, mais combien de fois, importante en<br />
affirmant :<br />
Savoir et fabriquer sont des besoins qu’on peut caractériser en<br />
eux-mêmes, sans les mettre nécessairement en rapport avec la<br />
volonté de puissance. Il y’a en l’homme une véritable volonté<br />
d’intellectualité. On sous-estime le besoin de comprendre quand<br />
on le met, comme l’ont fait le pragmatisme et le bergsonisme,<br />
sous la dépendance absolue du principe d’utilité 24 .<br />
Mais la métaphysique est à exclure du champ de la science qui plus se veut<br />
objective. Elle constitue un obstacle à la science lorsqu’elle participe à l’explication des<br />
phénomènes physiques. L’étymologie même du concept souligne déjà assez cette<br />
exclusion qui tarde à être effective dans la science. Elle est hors du champ des lois du<br />
24 Gaston Bachelard, op. cit., p. 30.<br />
23
connaissable. Notons que la métaphysique se développe dès que le scientifique se<br />
rapporte aux noumènes non plus comme à des idées régulatrices du savoir, mais<br />
comme à des réalités dont l’expérience et la connaissance seraient possibles et<br />
absolues. Mais une telle expérience et une telle connaissance, dites métaphysiques, sont<br />
illusion, apparence puisque quasi in expérimentables.<br />
Il s’agit donc ici, d’une psychanalyse de l’obstacle métaphysique qui, pendant<br />
longtemps a posé de réelles difficultés à la science, c’est en quelque sorte, l’histoire des<br />
embarras que les intuitions du feu ont accumulés dans la science, surtout qu’elles<br />
continuent jusqu’à cette époque pourtant moderne, à influer la science ce que<br />
Bachelard ne manque pas de souligner en reconnaissant par ailleurs que si cette<br />
psychanalyse s’attache aux chimistes et aux biologistes des siècles passés. Mais<br />
précisément elle surprend une continuité de la pensée et de la rêverie et elle s’aperçoit<br />
que dans cette union de la pensée et des rêves, c’est toujours la pensée qui est déformée<br />
et vaincue. Comme on peut le constater, la rêverie ne se contente pas d’être là, elle<br />
s’impose à la raison ce qui, dès le départ exclut toute certitude à toute recherche<br />
objective de la vérité précisément, en parlant des sciences de la nature où les lois<br />
entendues comme modes de fonctionnement du phénomène sont observées.<br />
A travers cette rêverie imaginante et transcendante, n’est-il pas question de la<br />
volonté comme expression de la capacité humaine à produire, à façonner son monde<br />
pour ne pas subir les lois de la nature ?<br />
24
SECTION C :<br />
FEU, DESIR ET VOLONTE : LE PROBLEME<br />
DE LA CULTURE HUMAINE
L’imagination, faculté transcendante est une caractéristique proprement humaine.<br />
Elle traduit la capacité propre de l’homme à prendre de la distance face à la nature qui<br />
impose ses lois au phénomène brut et à l’animal. L’imagination créatrice, subjective ou<br />
non traduit la culture, la soif de connaître des hommes, ainsi que la spécificité des<br />
sociétés humaines. Cependant, la société, qu’elle soit humaine ou animale, immanente<br />
à l’instinct comme à l’intelligence, est organisation, c'est-à-dire coordination et<br />
subordination des parties les unes aux autres. La volonté de vivre d’une société<br />
engendre d’abord une tendance à la clôture, le modèle parfait de la société close étant<br />
la société animale dont l’organisation invariable est figée par les automatismes de<br />
l’instinct qui imposent à l’animal un comportement conforme aux intérêts du groupe.<br />
Chez les êtres humains doués d’intelligence, donc d’une certaine liberté, la société est<br />
de forme variable et ouverte au progrès. Mais les résistances que les individus opposent<br />
à l’exigence de cohésion du groupe sont compensées, chez un être dépourvu d’instinct,<br />
par les automatismes acquis de l’habitude. La société close chez l’homme se traduit par<br />
un système d’habitudes plus ou moins enracinées qui correspondent aux besoins de la<br />
communauté et par un ensemble d’obligations et d’interdits orientés tout entiers vers la<br />
conservation du groupe. C’est ce qui semble valablement expliquer la dialectique<br />
statique originelle des sociétés closes qui n’aiment pas le changement.<br />
En effet, la culture ne désigne que des attitudes, des croyances, des mœurs, des<br />
« valeurs »acquises et transmises par l’éducation. La culture c’est ce qui s’ajoute à la<br />
nature. L’organisation raffinée de la ruche, par exemple, n’est aucunement une culture.<br />
Le comportement complexe des abeilles semble jaillir immédiatement, en effet de leur<br />
structure biologique. Sans doute tous les êtres vivants sont-ils soumis à l’Évolution qui<br />
transforme très lentement les espèces au cours des millions d’années, mais seul<br />
l’homme a une histoire car il est à la fois un inventeur et un héritier de la culture. Il<br />
crée des langues, des outils, des religions, des œuvres d’art, transmettant ce patrimoine<br />
par la parole et dans les derniers millénaires par l’écriture aux générations suivantes qui<br />
n’exercent à leur tour leur faculté d’invention que dans le cadre de ce qu’elles ont reçu.<br />
L’homme accorde donc prioritairement de l’importance à ses propres représentations.<br />
C’est la raison pour laquelle Bachelard déclare que « ce qu’on connaît d’abord du feu<br />
c’est qu’on ne doit pas le toucher » 25 pour montrer la place qu’occupe l’éducation dans<br />
25 Ibid., p. 29.<br />
26
notre comportement en général. Jean Rostand dans ses Pensées d’un biologiste exprime<br />
magnifiquement cette distinction fondamentale entre l’hérédité biologique et l’héritage<br />
culturel lorsqu’il déclare :<br />
Le biologique ignore le culturel. De tout ce que l’homme a<br />
appris, éprouvé, ressenti au long des siècles, rien ne s’est<br />
déposé dans son organisme …Chaque génération doit refaire<br />
tout l’apprentissage. …Là gît la grande différence des<br />
civilisations humaines avec les civilisations animales. De jeunes<br />
fourmis isolées de la fourmilière refont d’emblée une fourmilière<br />
parfaite. Mais de jeunes humains séparés de l’humanité ne<br />
pourraient reprendre qu’à la base l’édification de la cité<br />
humaine. La civilisation fourmi est inscrite dans les réflexes de<br />
l’insecte…La civilisation de l’homme est dans les bibliothèques,<br />
dans les musées et dans les codes ; elle exprime les<br />
chromosomes humains, elle ne s’y imprime pas.<br />
Notons en effet que les instincts biologiquement héréditaires et par là « naturels »<br />
n’ont jamais eu chez l’homme l’importance et la précision qu’ils ont chez la plupart des<br />
animaux. L’homme dépourvu de crocs puissants, de fourrure épaisse, nu et faible dans<br />
la nature a reçu en retour l’intelligence. L’intelligence est la faculté d’inventer,<br />
d’imaginer et, s’il faut ajouter à cela ces propos de Bergson pour qui l’intelligence est<br />
essentiellement la faculté d’inventer les outils, il faut noter que pour que cette aptitude<br />
puisse se manifester, il faut d’abord que l’intelligence soit « cultivée », soumise à<br />
toutes sortes d’apprentissages. L’homme naît donc en quelque sorte prématuré,<br />
incapable pendant de longues années d’assurer sa subsistance. L’enfant demeurera<br />
donc longtemps (beaucoup plus longtemps que n’importe quel petit animal) sous la<br />
dépendance des adultes et notamment de sa famille. C’est, remarque à juste titre<br />
l’anthropologue américain Abram Kardiner 26 , la durée exceptionnelle d’une telle<br />
dépendance, ainsi que le caractère incertain et extrêmement plastique des instincts<br />
reçus à la naissance (car aucun comportement strictement déterminé ne semble ici fixé<br />
par l’espèce) qui expliquent la prédominance de la culture sur la nature dans les<br />
conduites définitives de l’homme adulte. Bachelard déclare :<br />
En réalité, les interdictions sociales sont les premières.<br />
L’expérience naturelle ne vient qu’en second lieu pour apporter<br />
une preuve matérielle inopinée, donc trop obscure pour fonder<br />
26 Kardiner Abram, L’individu dans sa société, Paris, Gallimard, 1969. (Publié en 1939 l’ouvrage est traduit<br />
par Tanette Prigent).<br />
27
une connaissance objective (…) Il y’a donc, à la base de la<br />
connaissance enfantine du feu, une interférence du naturel et du<br />
social où le social est presque toujours dominant 27 .<br />
Dans ces conditions, le système des valeurs, des règles sociales, des conduites<br />
apprises dans chaque groupe social, relatif à une longue succession d’inventions et<br />
d’héritages a quelque chose d’accidentel, de contingent. S’il est vrai comme l’admet<br />
Bachelard que l’interdiction sociale puisse être notre première connaissance générale<br />
du feu, il est plus remarquable de noter :<br />
Au fur et à mesure que l’enfant grandit, les interdictions se<br />
spiritualisent : le coup de règle est remplacé par la voix<br />
courroucée ; la voix courroucée par le récit des dangers<br />
d’incendie, par les légendes sur le feu du ciel. Ainsi le<br />
phénomène naturel est rapidement impliqué dans des<br />
connaissances sociales, complexes et confuses, qui ne laissent<br />
guère de place pour la connaissance naïve 28 .<br />
On voit par là comment un seul phénomène peut avoir autant d’explications en<br />
fonction des besoins humains du moment. Les conditions sociales objectives<br />
d’existence sont intériorisées par les individus sous forme d’habitus (du latin « manière<br />
d’être »), dispositions acquises devenues « naturelles », qui composent les structures de<br />
la subjectivité, et sont l’instrument d’une sorte d’intériorisation de l’extériorité, la<br />
réalité sociale ne cessant de se reconstruire à travers l’action de facteurs subjectifs. La<br />
difficulté subjectiviste et relativiste que pose cette attitude de valeurs dans la culture<br />
naît du fait qu’il y’a autant de cultures, de civilisations, qu’il y’a de sociétés distinctes.<br />
Tandis que ce qui est universel, propre à tous les hommes révèle leur nature, porte la<br />
marque de constantes biologiques, tout ce qui appartient à la culture porte la marque du<br />
divers et du relatif. Il y’a plusieurs religions, plusieurs formes d’art, plusieurs formes<br />
politiques, etc. ; ce sont les cultures qu’il convient d’opposer à la nature. Les lois<br />
naturelles appartiennent à la modalité du nécessaire : on ne saurait s’y soustraire, elles<br />
sont universelles.<br />
Comme on peut le constater, les règles sociales, les rites dont chaque culture fait<br />
obligation à l’individu sont contingents, varient avec les civilisations. Ce sont des<br />
27 Gaston Bachelard, op. cit., p. 28.<br />
28 Ibid., p. 29.<br />
28
normes de conduite édictées par le groupe et auxquelles il arrive que l’individu<br />
désobéisse. . C’est ici que Bachelard souligne la spécificité de la pensée humaine qui a<br />
soif de l’universalité, cette tendance de l’esprit humain qui ne se contente pas du savoir<br />
limité à un groupe, à un système, mais qui recherche l’accord de tous les esprits et qu’il<br />
définit par le complexe de Prométhée c’est-à-dire « toutes les tendances qui nous<br />
poussent à savoir autant que nos pères, plus que nos pères, autant que nos maîtres, plus<br />
que nos maîtres » 29 . Cette volonté de puissance, d’intellectualité la plupart du temps,<br />
est oubliée, ou sous-estimée quand on la met, comme l’ont fait le pragmatisme et le<br />
bergsonisme, sous la dépendance absolue du principe d’utilité nous rappelle Bachelard.<br />
Lévi-Strauss nous propose précisément ce critère pour distinguer l’étage de la culture et<br />
celui de la nature :<br />
Partout où la règle se manifeste nous savons avec certitude être<br />
à l’étage de la culture. Symétriquement il est aisé de reconnaître<br />
dans l’universel le critérium de la nature. Car ce qui est<br />
constant chez les hommes échappe nécessairement au domaine<br />
des coutumes, des techniques et des institutions par lesquelles<br />
leurs groupes se différencient et s’opposent… Posons donc que<br />
tout ce qui est universel chez l’homme relève de la nature et se<br />
caractérise par la spontanéité, que tout ce qui est astreint à une<br />
norme appartient à la culture et présente les attributs du relatif<br />
et du particulier 30 .<br />
Il est donc clair que dans l’étude des phénomènes naturels, on ne saurait en plus<br />
des méthodes différentes, faire usage des valorisations substantialiste et animiste pour<br />
accéder à la connaissance scientifique. Certes la science fait partie de la culture<br />
humaine, mais elle est distincte d’elle en ce qu’elle échappe au relativisme culturel des<br />
valeurs humaines. Distinction importante à faire lorsqu’il est question de l’étude soit<br />
d’un objet scientifique, soit du sujet connaissant.<br />
Lorsque Bachelard déclare que « tout homme, dans son effort de culture<br />
scientifique, s’appuie non pas sur une, mais bien sur deux métaphysiques.» 31 Bien<br />
qu’elles puissent être distinctes, ces métaphysiques, que Bachelard trouve naturelles<br />
sont non seulement contradictoires, mais plus implicites et tenaces ce qui les rend<br />
29 Ibidem, p. 30.<br />
30 Lévi-Strauss, Les Structures élémentaires de la parenté, Paris, PUF, 1949, p. 34.<br />
31 Gaston Bachelard, Le Nouvel esprit scientifique, Paris, ALCAN, (IIe édition.PUF, 1971.) 1934, p.1.<br />
29
toutes problématiques dans le processus d’acquisition d’une connaissance rigoureuse.<br />
Ce que Bachelard veut démontrer c’est que la science depuis sa « modernité » reconnue<br />
ne s’est pas complètement débarrassée des valeurs métaphysiques, subjectives qui la<br />
rendent impure. Ainsi, il y’a lieu de constater que d’une part il existe un rationalisme,<br />
le plus déterminé qui accepte journalièrement l’instruction d’une réalité qu’il ne<br />
connaît pas à fond et que le réaliste le plus intransigeant procède à des simplifications<br />
immédiates, exactement comme s’il admettait les principes informateurs du<br />
rationalisme. Autant dire que pour la philosophie scientifique, il n’y a ni réalisme ni<br />
rationalisme absolus et qu’il ne faut pas partir d’une attitude philosophique générale<br />
pour juger la pensée scientifique. Un esprit universel, ne peut se satisfaire de la seule<br />
approche philosophique. Néanmoins, il faut :<br />
Guérir l’esprit de ses bonheurs, l’arracher au narcissisme que<br />
donne l’évidence première, lui donner d’autres assurances que<br />
la possession, d’autres forces de conviction que la chaleur et<br />
l’enthousiasme, bref, des preuves qui ne seraient point des<br />
flammes ! 32 .<br />
32 Idem, La Psychanalyse du feu, p. 16.<br />
30
DEUXIEME PARTIE :<br />
LES SCIENCES DE LA MATIERE : DE<br />
L’IMAGINAIRE A LA REALITE
Dans l’activité magique comme source des formes de culture humaine, nous<br />
avons trouvé deux aspirations, l’une pratique : volonté d’action directe sur la nature, de<br />
manipulation réelle des choses, l’autre idéologique et théorique : désir de construire<br />
une représentation du monde, une explication des choses par des lois de sympathie,<br />
d’antipathie, d’affinités symboliques. Mais au vrai, la magie ne tient pas ses promesses<br />
et ne satisfait pas les besoins qu’elle révèle ; ceux-ci tendent alors à se différencier et à<br />
se satisfaire par deux formes de culture distinctes : la religion et la métaphysique qui<br />
cherchent le secret du monde dans un au-delà et la technique qui se présente de plus en<br />
plus comme une pratique concrète réglée sur l’expérience immédiate. Il nous apparaît<br />
donc dans la science, un nouvel effort pour rapprocher et unifier les deux exigences,<br />
théorique et pratique, de l’esprit humain. Nous pouvons donc dire en ce sens, que la<br />
science serait une magie réussie, la magie étant en quelque sorte une science rêvée,<br />
imaginaire.<br />
La science apparaît en effet comme une volonté d’explication du monde, un<br />
système de concepts qui rend compte des apparences. Et dans cet effort d’explication,<br />
la hardiesse de la raison à priori, de l’esprit inventeur d’hypothèses se donne libre<br />
cours. Mais d’autre part l’explication scientifique est directement en prise sur le réel.<br />
Comme une recette technique, mais avec une plus haute intelligibilité et une efficacité<br />
plus précise, la loi scientifique est une formule d’action. L’intelligibilité théorique et<br />
l’efficacité pratique se trouvent ici réunies. Les premières sciences furent la géométrie<br />
et l’astronomie, sans doute parce que c’était entre les positions des astres ou entre les<br />
éléments des figures qu’il semblait le plus facile de découvrir des relations constantes,<br />
exprimables dans un langage logique. Des lois physiques, chimiques, biologiques ne se<br />
découvrirent que plus tard car, dans ces domaines complexes, il faut largement torturer<br />
les apparences et reconstruire les données immédiates pour dégager des rapports<br />
constants et intelligibles. Mais alors même que la science parait s’éloigner des données<br />
concrètes pour aboutir à un système complexe de rapports mathématiques, le contact<br />
avec le réel n’est pas perdu, au contraire. Plus l’explication scientifique au cours de<br />
l’histoire est devenue abstraite, complexe, et plus la prévision scientifique a été sure.<br />
L’intelligibilité la plus haute et le contact le plus étroit avec le réel (comme objet de<br />
prévision et d’action) vont de pair.<br />
32
La science se caractérise donc comme un système de jugements tout à la fois<br />
exprimable dans un langage rigoureux, mathématique, et toujours vérifiable<br />
pratiquement d’où la nécessité de l’objectivité certes, mais l’objectivité renvoie-t-elle<br />
toujours à l’exclusivité empirico-rationnelle comme l’ont toujours prétendue les<br />
explications scientifiques aujourd’hui ? Il semble que non, car pour Bachelard,<br />
Si nous savions, à propos de la psychologie de l’esprit<br />
scientifique, nous placer juste à la frontière de la connaissance<br />
scientifique, nous verrons que c’est à une véritable synthèse des<br />
contradictions métaphysiques qu’est occupée la science<br />
contemporaine 33 .<br />
Ainsi, la science, sans admettre elle-même qu’elle progresse avec et à partir de<br />
cette confusion, prétend, à l’objectivité par une simplification dualiste de sa<br />
connaissance en la réduisant aux seules sources empirique et rationnelle,<br />
méconnaissant ainsi le rôle de la rêverie dans ses productions intelligibles, alors qu’elle<br />
doit, bien que fictive, être considérée comme une étape très importante dans le<br />
processus d’acquisition de la connaissance scientifique. Le tout c’est de savoir où la<br />
placer dans ce processus. A partir de là, on se demande si effectivement, la raison et<br />
l’expérience objective constituent nos seules sources de connaissance ?<br />
33 Idem, Le Nouvel esprit scientifique, p. 8.<br />
33
SECTION A :<br />
L’INFERENCE : CRISE DE L’OBSERVATION<br />
IMMEDIATE ET DE LA RAISON
En expliquant et limitant la source de la connaissance aux seuls niveaux de<br />
l’expérience et de la raison, les empiristes et rationalistes dogmatiques n’ont pas assez<br />
étudié l’importance de l’imagination comme fonction psychique de la rêverie en ce<br />
qu’elle puisse avoir un impact lointain (ou profond), conséquent et donc hautement<br />
important dans le processus de la connaissance.<br />
Sans doute, on a souvent répété que la conquête du feu séparait<br />
définitivement l’homme de l’animal, mais on n’a peut être pas<br />
vu que l’esprit, dans son destin primitif, avec sa poésie et sa<br />
science, s’était formé dans la méditation du feu 34<br />
Souligne Bachelard à cet effet. Il s’agit ici d’une autre façon de poser le problème<br />
philosophique ou scientifique : qui n’est plus d’ordre ontologique. Il n’est plus question<br />
de savoir s’il existe ou non une substance matérielle, une âme ou Dieu, mais de<br />
procéder à la genèse de nos croyances et de nos facultés. En dénonçant les illusions<br />
substantialistes issues des questions métaphysiques, les explications d’un rationalisme<br />
ou empirisme purs, loin de ruiner la science, encore moins la morale, la philosophie<br />
bachelardienne essaie de fonder clairement l’objectivité scientifique en procédant en<br />
même temps à une normativité de l’imagination, néanmoins, en ce qui concerne<br />
pratiquement nos investigations sur les sources de la connaissance scientifique ou non<br />
concernant notre ouvrage. Raison pour laquelle en remarquant comme avec la plupart<br />
des phénomènes frappants que « si le feu est aussi captieux, aussi ambigu, on devrait<br />
commencer toute psychanalyse de la connaissance objective par une psychanalyse des<br />
intuitions du feu » 35 .<br />
En effet, si on a pu judicieusement constater avec le rationalisme kantien qui<br />
critiquait le scepticisme humien que la connaissance bien qu’elle débute avec<br />
l’expérience, ne provenait pas toute d’elle, la pensée bachelardienne, sans nier<br />
l’importance de la raison encore moins celle de l’expérience dans le processus<br />
d’acquisition de la connaissance, attire particulièrement notre attention en trouvant une<br />
autre source originale et hautement importante à la connaissance : la rêverie. Notons<br />
déjà avec Kant que, contrairement à ce que dit Hume, notre raison ne peut se borner à<br />
l’expérience, ce qui veut dire qu’elle a d’autres sources qui lui fournissent ses<br />
34 Idem, La Psychanalyse du feu, p. 100.<br />
35 Ibid., p. 99.<br />
35
connaissances. Il s’agit donc de prendre le problème à la racine, s’interroger sur les<br />
possibilités mêmes de la raison, chercher dans la raison elle-même les règles et les<br />
limites de son activité : faire la critique de la raison par la raison par la raison, comme<br />
l’aurait dit Kant 36 c'est-à-dire discerner ce que la raison peut faire et ce qu’elle est<br />
incapable de faire. Notons d’emblée que la rêverie dont il est question ici n’est pas<br />
prise en son sens premier et passif de l’état d’abandon où l’esprit se laisse absorber par<br />
toutes formes de fantasmagories pendant le sommeil. La rêverie est une pensée<br />
concentrée à laquelle se laisse aller l’imagination. C’est l’attitude de l’homme pensif<br />
qui se laisse absorber par la rêverie devant le feu, un moment spécial et spécifique de la<br />
pensée humaine qui émet des projections, des possibilités de son hypothétique vouloir<br />
et pouvoir, c’est le moment où les images en lui se libèrent, le moment où l’homme est<br />
dans le domaine de la qualité en imaginant et créant dans son esprit, ce qui lui<br />
conviendrait le mieux.<br />
L’homme rêvant devant son foyer est, (…) l’homme des<br />
profondeurs et l’homme d’un devenir. Ou encore, pour mieux<br />
dire, le feu donne à l’homme qui rêve la leçon d’une profondeur<br />
qui a un devenir : la flamme sort du cœur des branches 37 .<br />
C’est ici qu’on retrouve une importance capitale à la pensée humienne qui,<br />
en examinant la question de l’origine des idées, avait déjà assez entamée le problème<br />
de l’imagination dans la connaissance, notamment avec le principe de connexion<br />
nécessaire. Celui-ci organise l’expérience, mais n’en provient pas estime l’auteur.<br />
Hume, en accordant un intérêt particulier à la causalité après la ressemblance et la<br />
contiguïté, démontre par exemple que la liaison causale établie par l’esprit entre des<br />
faits, par exemple entre la fumée et la flamme, ne repose sur aucune raison<br />
démonstrative. Hume présente merveilleusement cette situation lorsqu’il affirme :<br />
Il n’est donc pas indigne d’un esprit curieux d’examiner de plus<br />
près la nature de cette évidence qui nous assure de la réalité des<br />
existences et des faits, quand ils échappent au témoignage actuel<br />
des sens ou ne sont point consignés par la mémoire. Or, il est<br />
notable que cette partie de la philosophie a été peu cultivée par<br />
les anciens ou par les modernes ; ce qui doit rendre d’autant<br />
plus excusables nos doutes et nos erreurs dans la conduite d’une<br />
36 Emmanuel Kant, Critique de la Raison pure, Paris, PUF, 1963(préface), p.7.<br />
37 Gaston Bachelard, op.cit., p.99.<br />
36
étude aussi importante,(…) Doutes et erreurs qui peuvent même<br />
s’avérer profitables, s’ils suscitent la curiosité et détruisent cette<br />
assurance et cette foi implicites qui font le malheur du<br />
raisonnement et de la libre recherche 38 .<br />
Bachelard, allant dans la même visée estime en effet dans l’étude de la<br />
reproduction du feu, qu’aucun raisonnement ou observations aussi objectives soient-ils<br />
n’auraient suggéré à l’homme primitif l’idée selon laquelle le frottement de deux<br />
branches de bois puisse produire du feu. Ce phénomène :<br />
L’observerait-on que ce n’est pas à proprement parler à un<br />
frottement qu’on penserait si l’on abordait le phénomène en<br />
toute ingénuité. On penserait à un choc ; on ne trouverait rien<br />
qui pût suggérer un phénomène long, préparé, progressif,<br />
comme est le frottement qui doit entraîner l’inflammation du<br />
bois 39 .<br />
Il est question de se mettre à la place de l’homme n’ayant au préalable<br />
aucune connaissance antérieure du feu pour mieux comprendre la source de<br />
l’inspiration reproductrice de ce phénomène. Voilà pourquoi Bachelard affirme :<br />
Nous ne sommes pas éloigné de croire que le feu est très<br />
précisément le premier objet, le premier phénomène sur lequel<br />
l’esprit humain est réfléchi ; entre tous les phénomènes, le feu<br />
seul mérite, pour l’homme préhistorique, le désir de connaître<br />
par cela même qu’il accompagne le désir d’aimer 40 .<br />
Et même, à supposer qu’il ait acquis davantage d’expérience et qu’il ait vécu<br />
longtemps pour observer que des objets ou phénomènes semblables sont constamment<br />
joints ensemble, la conséquence de cette expérience lui fait aboutir à l’inférence d’un<br />
objet à partir de l’apparition de l’autre.<br />
Et pourtant, avec toute son expérience, elle n’a acquis ni l’idée<br />
ni la connaissance de la force secrète par laquelle un objet<br />
produit l’autre ; et ce n’est par aucune conduite de<br />
raisonnement qu’elle est portée à tirer cette inférence 41<br />
38 David Hume, Enquête sur l’entendement humain, Paris, VRIN, 2008, Section IV, p. 97.<br />
39 Gaston Bachelard, op. cit., p. 49.<br />
40 Ibid., pp. 99-100.<br />
41 David Hume, op. cit., pp. 133-135<br />
37
Observe Hume. Pour Hume tout comme Bachelard, l’esprit est d’abord<br />
fortement marqué par l’impression, la sensation. Les impressions sensibles constituent<br />
ainsi le matériau primitif originaire de toutes nos connaissances. Une façon de dire que<br />
le penser repose sur le sentir. Dans une phrase de la Poétique de l’espace, Bachelard,<br />
qui se réfère explicitement à Schopenhauer, précise :<br />
Dans l’axe d’une philosophie qui accepte l’imagination comme<br />
faculté de base, on peut dire, sur le mode schopenhauerien : « le<br />
monde est mon imagination. » je possède d’autant mieux le<br />
monde que je suis plus habile à le miniaturiser. 42<br />
Mais ces lointaines études épistémologiques fournissent bien d’autres<br />
exemples d’imagination valorisante, qui ne détourne pas de la vérité puisque<br />
l’imagination « ne se trompe jamais », n’ayant pas à confronter une image avec une<br />
réalité objective. Elles dénoncent la prétendue objectivité d’explications qui n’en sont<br />
pas et opposent, sur le plan des vérités scientifiques, une imagination apte à saisir la<br />
complexité du réel et étroitement unie à l’expérience organisée, à l’observation<br />
immédiate ou à l’intuition matérialiste. C’est encore à Schopenhauer qu’il s’en prend<br />
dans son article « Lumière et substance » 43 . Fidèle à sa méthode d’épistémologie<br />
historique qui le conduit à replacer un philosophe ou un savant dans son temps, et à ce<br />
type de recherches qu’il appellera plus tard la psychanalyse de la connaissance<br />
objective, il dénonce dans la Philosophie et science de la nature du philosophe<br />
allemand, un substantialisme et un anthropomorphisme d’un autre âge (celui des<br />
physiciens du XVIIIe siècle), et aussi une volonté de puissance et un réalisme « où un<br />
psychanalyste noterait une avarice de célibataire » 44 . Car, expliquant la lumière par la<br />
matière en se servant du concept vague d’affinité matérielle, usant de métaphores telles<br />
que la digestion de la lumière par des corps chimiques, l’absorption de la lumière par<br />
l’eau qui en fera de la chaleur « en satisfaisant son avidité à s’évaporer », les<br />
substances se rassasiant de lumière, il exploite l’intuition d’absorption, dont la<br />
42 Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, Paris, PUF, 1957, p. 142.<br />
43 Cf., Revue de métaphysique et de morale, 1934, XLI, pp. 343-366 (in Etudes, p.45-75).<br />
44 Ibidem, p. 57.<br />
38
prétendue clarté objective n’est en somme que « le reflet d’une clarté subjective<br />
d’essence plus trouble 45 ».<br />
D’autre part, l’esprit a le pouvoir de rappeler les impressions, devenant alors<br />
mémoire, c'est-à-dire la faculté d’évoquer une impression passée, ou imagination, le<br />
pouvoir de former des images à partir d’une impression existante ou possible. Dans les<br />
deux cas, l’esprit n’a que l’image ou la copie d’une impression, ce que Hume désigne<br />
sous le nom d’ « idée ». Celle-ci n’est nullement un concept, mais une impression<br />
affaiblie comme on le verra à la suite de nos recherches. Penser c’est donc imaginer et<br />
les idées ne se distinguent des impressions que par leur moindre vivacité. Mais<br />
l’impression, originaire et fondatrice, est à découvrir, par un effort d’analyse de notre<br />
expérience et d’attention à un donné caché. Une expérience pure est à retrouver en deçà<br />
de l’expérience commune du complexe devenu confus. Il s’agit ici de déterminer le<br />
point de vue qui domine le mieux pourrait-on dire, dans nos connaissances : est ce la<br />
réflexion seule qui nous permet d’avoir accès à la connaissance ? Est-ce l’expérience ?<br />
Leurs mouvements réciproques, ou l’imagination entendue comme une rêverie<br />
originale ? Et pourquoi pas tout cela à des moments différents et distincts qu’il faut<br />
juste démarquer ou classer par ordre ?<br />
L’attention accordée à la relation causale est justifiée par ce dépassement<br />
qu’elle seule permet : à partir d’un fait présent, nous posons un effet ou une cause non<br />
actuellement donnés. Il s’agit donc, de se demander quel est le fondement des<br />
conclusions tirées de l’expérience. Le paradoxe initial du dépassement du donné à<br />
partir du donné, loin de se dissiper au cours de l’analyse, se précise et s’accentue avec<br />
insistance sur le fait de la croyance. Non seulement je conçois, lorsqu’un fait se<br />
produit, la cause ou l’effet qui lui est constamment conjoint, mais je pose et j’affirme<br />
son existence passée ou à venir, sa réalité. J’y crois.<br />
Nous sommes portés à excuser toutes ces croyances naïves<br />
parce que nous ne les prenons plus que dans leur traduction<br />
métaphorique. Nous oublions qu’elles ont correspondu à des<br />
réalités psychologiques. Or souvent les métaphores ne sont pas<br />
entièrement déréalisées, déconcrétisées 46 .<br />
45 Ibidem.<br />
46 Gaston Bachelard, La Psychanalyse du feu,p.123.<br />
39
Remarque judicieusement Bachelard. Ce n’est pas seulement en concevant le<br />
possible que je dépasse le donné, mais en constituant un monde réel qui déborde ce qui<br />
m’est actuellement donné. L’effort de description, substitué consciemment à la<br />
recherche d’une définition, permet de mieux cerner la différence dans la manière de<br />
percevoir. La croyance s’explique alors comme le transfert de la vivacité d’une<br />
impression à l’idée qui lui est liée. L’analyse de l’inférence causale a mis en évidence<br />
dans la pensée une détermination, due à l’accoutumance, à passer d’une impression<br />
présente à l’idée de ce qui lui a toujours été associé. Cette tendance ou transition<br />
coutumière dont nous faisons l’expérience, est l’original de l’idée de nécessité qui n’est<br />
pas la copie d’un pouvoir ou d’une efficace que nous observerions dans les<br />
phénomènes. La connexion n’est pas saisie sur les objets, elle s’établit entre les idées,<br />
et il y’a là une transition coutumière dans l’imagination, non un acte de l’entendement.<br />
C’est la raison pour laquelle Bachelard estime que le rêve précède l’expérience car il<br />
est plus fort qu’elle. En plus de cela, notons avec Kant dans que ce que nous appelons<br />
l’expérience n’est pas quelque chose que l’esprit tel une cire molle recevrait<br />
passivement. C’est l’esprit qui grâce à ses structures a priori, construit lui-même<br />
l’ordre de l’univers. Le rêve en ce qu’il est projet, nécessité et création. Il existe donc<br />
un lien profond pour ne pas dire inconscient entre le feu et la sexualité c’est pourquoi<br />
« il faut reconnaître que le frottement est une expérience fort sexualisée. (…) L’amour<br />
est la première hypothèse pour la reproduction objective du feu » 47 . Autrement dit, il<br />
existe avec Bachelard, partout, un lien primordial entre l’homme et le monde, même<br />
dans ses constructions rationnelles, raison pour laquelle il estime que l’ « on ne peut<br />
étudier que ce qu’on a d’abord rêvé » 48 . Il s’agit là, de constater une certaine antériorité<br />
psychique des images par rapport aux idées, de reconnaître que le feu de la passion<br />
nous a permis de penser à celui de bois. C’est donc l’imagination qui, bien avant,<br />
invente des formes de liens entre les idées et les phénomènes. Hume le montre si bien<br />
lorsqu’il affirme :<br />
47 Ibidem, pp. 50-51.<br />
48 Ibid., p. 48.<br />
Former des monstres et unir des formes et des apparences<br />
discordantes, cela ne coûte pas plus de trouble à l’imagination<br />
que de concevoir les objets les plus familiers (…) Ce qu’on n’a<br />
40
jamais vu, ce dont on n’a jamais entendu parler, on peut<br />
pourtant le concevoir… 49 .<br />
Lorsqu’en effet Hume relève que tous les raisonnements tirés de l’expérience<br />
ne relèvent pas des opérations de l’entendement du fait qu’il n’existe aucune nécessité<br />
dans la relation de cause à effet, mais que c’est par la disposition philosophique qu’est<br />
l’accoutumance que nous le pensons, il attire l’attention sans le préciser lui-même sur<br />
la dynamique interactive de l’imagination sur les phénomènes. La liaison causale<br />
établie par l’esprit entre des faits ou l’idée de connexion nécessaire, sur laquelle repose<br />
toute la validité des lois physiques, n’a de réalité ni objective ni intelligible : c’est un<br />
pur produit de l’imagination. Ce fait, le plus souvent est négligé dans les explications<br />
dites objectives ou scientifiques qui prétendent tout expliquer par la raison, ou<br />
l’expérience uniquement. Ne faut-il pas à certains moments dénoncer cette raison<br />
dogmatique ou cette expérience exclusive qui, le plus souvent prétendent tout<br />
expliquer ? Remarquons avec Hume que toutes les perceptions de l’esprit se divisent en<br />
deux classes selon leurs différents degrés de vivacité et de force : les idées qui sont les<br />
moins fortes et les moins vives et parallèlement, les impressions qui sont tout le<br />
contraire. Par impression, « j’entends donc toutes nos plus vives perceptions quand<br />
nous entendons, voyons, touchons, aimons, haïssons, désirons ou voulons » déclare t’il<br />
pour marquer la distinction fondamentale entre elles. Inutile de préciser en outre que<br />
les moins fortes sont le plus souvent sous le joug des plus fortes.<br />
Ainsi, après avoir remarqué que l’esprit humain associe ses idées selon son<br />
principe de nécessité, il notera judicieusement pour conséquence :<br />
La passion philosophique, comme la passion religieuse, est<br />
exposée, semble-t-il à cet inconvénient que, bien qu’elle vise à<br />
corriger nos mœurs et à déraciner nos vices, il se peut qu’elle ne<br />
serve, si on la gouverne imprudemment, qu’à encourager une<br />
inclination prédominante et à pousser l’esprit, avec une<br />
résolution plus déterminée, du coté qui l’attire trop déjà par<br />
l’effet des tendances et inclinations de son caractère naturel 50 .<br />
49 David Hume, op. cit., p. 60.<br />
50 Ibidem, p. 93.<br />
41
Une notion telle que « substance » par exemple se trouve ainsi disqualifiée dans<br />
la mesure où, comme l’avait déjà constaté Berkeley, on ne peut établir aucun lien avec<br />
une impression dont elle dériverait. Le rationalisme de par ses abus et penchants<br />
n’explique donc la plupart des phénomènes qu’en fonction de ses valeurs. Cela ne veut<br />
pas dire par conséquent quelle est l’instance suprême qui puisse objectivement rendre<br />
compte de la réalité pour ne pas dire la totalité des phénomènes par conséquent, la<br />
récurrence qu’applique donc systématiquement le rationalisme actuel pour expliquer<br />
les phénomènes est donc à revoir car en plus, il ne revit pas les conditions de<br />
l’observation naïve des faits pour prétendre à leur objectivité observable. Lorsque l’on<br />
se contente exclusivement de ce genre d’explication, on court le grand risque de limiter<br />
la connaissance des phénomènes qui, en plus d’être mouvants, peuvent et doivent avoir<br />
d’autres causes et explications pertinentes que celles proposées par des systèmes clos.<br />
La vie psychique tout entière se comprend donc par l’association des idées,<br />
propriété qu’ont les représentations de s’appeler, de s’évoquer, de s’entraîner les unes<br />
les autres, selon les principes de la nature humaine (ressemblance, contiguïté dans<br />
l’espace et le temps, causalité) qui structurent l’imagination et imposent ordre et<br />
régularité aux associations. Grâce à ces principes obscurs, enracinés au plus profond de<br />
la nature humaine, l’imagination étend très loin son pouvoir : elle rend compte du<br />
processus d’abstraction et de la reproduction des idées générales. Celles-ci ne sont en<br />
effet que les idées particulières, associées par ressemblance et jointes à un terme<br />
général, mais que l’imagination a tendance à hypostasier en essences indépendantes des<br />
impressions particulières. On peut donc aisément comprendre que l’imagination soit<br />
également à l’origine de l’illusion substantialiste par sa disposition à combler avec des<br />
images les intervalles entre chaque perception. Elle est donc responsable de notre<br />
croyance spontanée en l’existence permanente d’objets extérieurs à nous et<br />
indépendants de nos perceptions.<br />
42
SECTION B :<br />
EMPIRISME, RATIONALISME ET<br />
IMAGINATION : LE PROBLEME DE<br />
L’EXPLICATION PHENOMENALE
De l’homme primitif à l’homme moderne, il ne fait nul doute que le problème que<br />
pose la connaissance quant à sa nature, sa source …plus que jamais, préoccupe<br />
l’humanité. Du primitif jusqu’à nous, il a toujours été question de la connaissance<br />
comme fait particulièrement humain, c’est ainsi que les sciences de la matière par<br />
exemple se présentent comme un effort pour connaître le monde réel, comme une<br />
exploration de la nature afin de le connaître ce sont, dit-on souvent des « sciences<br />
d’observation », qui portent sur des « faits ». Mais, il n’est pas tout à fait exact de dire<br />
que la science part des faits ; car même aux époques les plus primitives on trouve déjà<br />
autour des faits des explications, des pseudo explications d’ordre mythologique et<br />
anthropomorphique comme on a pu l’observer au début de nos investigations.<br />
Il est particulièrement intéressant, pour une psychanalyse de la<br />
connaissance objective, de voir comment une intuition chargée<br />
d’affectivité comme l’intuition du feu va s’offrir pour l’explication de<br />
phénomènes nouveaux 51 .<br />
Déclare Bachelard à cet effet. De telles interprétations, alors même qu’elles n’ont<br />
rien de scientifique, révèlent cependant les ambitions de l’esprit humain, la vocation<br />
qu’il a de dépasser le donné empirique brut. Lorsque de nouveaux faits sont découverts,<br />
l’esprit tend naturellement à les intégrer au système de croyances et d’interprétations<br />
qu’il avait précédemment adopté. Mais il arrive que les faits nouvellement découverts<br />
soient en contradiction avec le système du monde précédemment admis. Ce sont ces<br />
faits que Gaston Bachelard nomme « polémiques » qui contraignent le savant à se<br />
poser un problème. Le point de départ de la recherche n’est donc pas le fait empirique<br />
considéré à part, mais le problème posé par le fait, la contradiction entre le fait<br />
découvert et les conceptions théoriques antérieures.<br />
Aujourd’hui plus qu’hier, il a toujours été question pour l’homme d’expliquer, de<br />
comprendre ce qui se passe autours de lui pour mieux contrôler la nature. Il est donc<br />
fort conséquent de concevoir le fait que les explications irrationnelles ou inconscientes<br />
de l’homme primitif, sans la science actuelle aient fortement influé sur nos<br />
connaissances actuelles, la culture n’étant d’abord qu’une transmission de données,<br />
avant toute transformation quelconque. Il importe donc de savoir à partir de quels<br />
procédés ces hommes ont pu parvenir à la connaissance en étudiant le phénomène de<br />
51 Gaston Bachelard, La psychanalyse du feu, p. 119.
eproduction du feu par exemple, pour mieux saisir le fonctionnement de l’esprit<br />
humain, riche et mouvant, qui s’adapte aux situations de son temps.<br />
Pour les empiristes l’hypothèse est directement suggérée par les faits ou plutôt il<br />
ne faut pas émettre d’hypothèse, il suffit de voir comment les faits s’enchaînent les uns<br />
aux autres. Il suffit, dit Brunschvicg, de laisser l’expérience se déposer elle-même dans<br />
notre esprit, la nature s’inscrire elle-même dans la science. L’idéal empiriste est<br />
simplement de décomposer fil à fil le réseau enchevêtré des phénomènes, de déchiffrer<br />
patiemment les relations simples inscrites dans la complexité du donné perçu sans<br />
passer par le détour des hypothèses. Des faits bien observés, disait Magendie, valent<br />
mieux que toutes les hypothèses du monde. Mais le point de vue empiriste repose sur<br />
l’illusion naïve que la nature offre spontanément à l’observateur tous ses phénomènes,<br />
qu’elle les présente « étiquetés d’eux-mêmes » pourrions nous dire, que la cause d’un<br />
phénomène est donnée dans l’expérience comme le phénomène lui-même qu’on<br />
cherche à expliquer. D’où cette préoccupation de Bachelard, qui se demande<br />
concernant les explications scientifiques modernes récurrentes et objectives qui<br />
expliquent si aisément le phénomène de reproduction du feu par le frottement :<br />
Que deux morceaux de bois sec soient tombés pour la première<br />
fois entre les mains d’un sauvage, par quelle indication de<br />
l’expérience devinera-t-il qu’ils peuvent s’enflammer par un<br />
frottement rapide et longtemps continué ? 52<br />
En réalité la cause est d’abord cachée et il faut commencer par la supposer, par<br />
l’imaginer. Tel est le rôle de l’hypothèse dans le processus de la connaissance.<br />
Considérons le phénomène de reproduction du feu par exemple : l’homme primitif de<br />
par son expérience intime de la chaleur produite par deux corps, rêve du feu dans du<br />
bois comme dans les corps (humains). Le feu n’est pas d’abord donné comme un fait ;<br />
avant d’être une expérience, elle est une exigence. Cette découverte bachelardienne<br />
nous fait comprendre que le feu a d’abord été une invention de l’esprit humain et non<br />
une découverte provenant des objets qui nous sont extérieurs. On a ici cette conviction<br />
selon laquelle, on ne peut rien trouver si on ne cherche pas quelque chose de déterminé.<br />
Certes on peut parler d’une expérience des corps, mais cette expérience n’est pas<br />
suffisante pour être seule, valablement assimilable par inférence au bois. L’hypothèse<br />
52 Ibidem, p.50.<br />
45
est imaginaire même dans le cas de l’esprit préscientifique, ou de l’homme primitif qui<br />
cherche à expliquer, comprendre un phénomène.<br />
Dans le même sillage, lorsque Urbain Le Verrier (1811-1877), astronome<br />
français, à l’origine de la découverte de la planète Neptune n’arrive pas à rendre<br />
compte des mouvements d’Uranus par l’attraction des planètes connues, il y’a ce que le<br />
philosophe et économiste britannique, John Stuart Mill (1806-1873), eut appelé un<br />
« résidu ». Mais la méthode de ce dernier ne peut servir à rien pour rendre compte de ce<br />
résidu puisque, précisément, la cause des perturbations d’Uranus n’est pas donnée dans<br />
l’expérience de cette époque. Ici encore, il faut dépasser le donné, émettre une<br />
hypothèse, situer le fait donné dans un contexte de relations intelligibles où le savant<br />
introduit, à titre d’hypothèse, des faits possibles. Le Verrier fait l’hypothèse d’une<br />
planète encore inconnue dont la force d’attraction expliquerait précisément le<br />
« résidu »énigmatique des perturbations d’Uranus. Il calcule ce que devraient être la<br />
masse, la distance de cette planète supposée qu’il appelle Neptune, pour que dans le<br />
cadre des lois de Newton, les mouvements d’Uranus deviennent intelligibles.<br />
Comme on peut le constater, même le savant dans son effort d’explication des<br />
faits, loin de « simplifier » le donné empirique, l’enrichit au contraire de faits supposés.<br />
Raison pour laquelle Bachelard estime que « pour un chimiste comme pour un<br />
philosophe, pour un homme instruit comme pour un rêveur, le feu se substantifie si<br />
facilement qu’on l’attache aussi bien au vide qu’au plein » 53 . Nous saisissons<br />
maintenant quelle est la nature et la fonction de l’hypothèse. L’hypothèse, c’est ce qui<br />
est « sous la thèse », ce n’est pas une simple conjecture mais une explication<br />
intelligible fonction aussi des êtres qui l’émettent, et de leur époque. Elle relève de<br />
l’imagination, rationnelle ou non. C’est la raison pour laquelle Bachelard, trouvant les<br />
explications objectives des rationalistes et empiristes purs du phénomène de<br />
reproduction du feu faibles, pour ne pas dire suffisamment inintelligibles estime à<br />
raison, qu’ « il y’aurait donc place, croyons-nous, pour une psychanalyse indirecte et<br />
seconde, qui chercherait toujours l’inconscient sous le conscient, la valeur subjective<br />
sous l’évidence objective, la rêverie sous l’expérience » 54 montrant par là la nécessité<br />
d’autres approches possibles lorsque les précédentes n’explicitent pas assez un<br />
53 Ibidem, p. 112.<br />
54 Ibidem, p. 48.<br />
46
phénomène. Constat a été fait par lui que « pour beaucoup d’esprits, le feu a une telle<br />
valeur que rien ne limite son empire. Boerhaave prétend ne faire aucune supposition<br />
sur le feu, mais il commence par dire, sans la moindre hésitation, que « les éléments du<br />
feu se rencontrent partout ; ils se trouvent dans l’or qui est le plus solide des corps<br />
connus, et dans le vide de Torricelli » 55 . On a donc ici avec le phénomène du feu, la<br />
preuve de la résistance subjective des impressions du feu qui sont expliqués en intensité<br />
et concentration en science :<br />
Nous devons souligner ici ce besoin d’expliquer les détails d’une<br />
expérience première. Ce besoin d’explication minutieuse est très<br />
symptomatique chez les esprits non scientifiques qui prétendent<br />
ne rien négliger et rendre compte de tous les aspects de<br />
l’expérience concrète. La vivacité d’un feu propose ainsi de faux<br />
problèmes : elle a tant frappé notre imagination dans notre<br />
enfance ! Le feu de paille reste, pour l’inconscient, un feu<br />
caractéristique 56<br />
remarque si bien Bachelard pour souligner la nécessité de la psychanalyse et de<br />
l’expérimentation continues en science car il apparaît clairement avec l’auteur que non<br />
seulement, le fonctionnement de la pensée humaine est fonction des circonstances<br />
d’une période donnée, mais aussi, le savant ne répond pas directement et<br />
définitivement à la question « pourquoi » par une proposition affirmative par exemple,<br />
il est aussi question du « comment » et du « pourquoi pas » ; plusieurs facteurs<br />
intervenant dans le processus de la connaissance. Les efforts que l’homme produit en<br />
vue de la connaissance ne sont donc pas toujours rationnels, ce d’autant plus que<br />
l’hypothèse entendue comme produit de l’imagination est susceptible d’être plurivoque<br />
selon la double orientation, rationnelle et inconsciente qu’on vient de lui reconnaître.<br />
Néanmoins, s’il faut reconnaître que l’hypothèse est plus un effort pour com-prendre,<br />
c’est-à-dire pour prendre ensemble tous les faits, pour les systématiser (sun-istemi en<br />
grec signifie je pose ensemble). Elle ne saurait donc se limiter aux seules explications<br />
objectives surtout lorsque constat est fait que ces dernières sont peu satisfaisantes à la<br />
compréhension de certains phénomènes qu’elles prétendent rendre compte. Notons tout<br />
de même qu’il y’a lieu de la soumettre à une expérimentation, à une vérification<br />
55 Ibidem, p. 112.<br />
56 Ibidem, p.113.<br />
47
igoureuses quelle que soit la méthode de recherche pour pouvoir statuer sur sa<br />
scientificité qui ne reste qu’hypothétique sans ces dernières.<br />
48
SECTION C :<br />
SCIENCE, MYTHE, COMPLEXE ET<br />
PHENOMENOLOGIE : LE PROBLEME DE LA<br />
PSYCHANALYSE
Le souci de la vérification de l’hypothèse repose sur le postulat qu’il n’existe pas<br />
de règles pour l’invention de l’hypothèse comme on vient de le constater<br />
précédemment car elle provient d’une intuition, d’une anticipation spontanée. Par<br />
contre, l’hypothèse, n’a de signification scientifique que si elle est vérifiable. Nous<br />
avons vu plus loin que c’était la contradiction avec l’expérience qui faisait rejeter les<br />
théories anciennes. L’hypothèse nouvellement née pour rendre compte d’un fait-<br />
problème, doit être à son tour soumise à l’épreuve de l’expérience pour être détachée<br />
de tout sentiment, pour garantir une certaine crédibilité ou certitude. En effet,<br />
Bachelard note :<br />
Les sentiments plus subtils de l’esprit, les opérations de<br />
l’entendement, les agitations variées des passions, bien que<br />
réellement distincts en eux-mêmes, nous échappent aisément<br />
quand nous les examinons par réflexion ; et il n’est pas en notre<br />
pouvoir de rappeler l’objet primitif aussi souvent que nous<br />
avons l’occasion de le rappeler 57<br />
Ceci pour souligner la nécessité d’une démarche méthodologique supplémentaire<br />
et spéciale autre que la seule réflexion dans l’étude des phénomènes. D’où la<br />
psychanalyse de la connaissance objective. Au seuil de l’entreprise structuraliste de<br />
Bachelard se situe donc la volonté de se démarquer par rapport aux discours antérieurs<br />
portant sur le même objet, précisément dans la mesure où les processus sociaux sont<br />
régis par des lois qui demeurent inconscientes. Une « coupure » est nécessaire pour<br />
marquer le passage des discours idéologiques qui ne font que refléter les structures<br />
sociales dans lesquelles ils sont insérés, à un discours scientifique ou théorique qui<br />
s’attache à les mettre au jour. Il s’agit donc dans sa double investigation, de l’union de<br />
la méthode phénoménologique et de la méthode psychanalytique spéciales en plus de<br />
celles déjà connues.<br />
L’étude du phénomène de feu comme la plupart des phénomènes est, empreinte<br />
de nos sentiments à tel point que l’on ne sépare pas le plus souvent l’objet du sujet. Il<br />
faut donc avec la psychanalyse, commencer par mettre en relief les motifs de la pensée<br />
préscientifique pour la séparer des faits pour pouvoir prétendre à une certaine<br />
objectivité par la suite. Il s’agit donc de la meilleure méthode pour étudier ces<br />
57 David Hume, op. cit., p.127.<br />
50
phénomènes qui font preuve d’une certaine convergence abusive ou inconsciente des<br />
expériences intimes et objectives. « Cette double phénoménologie prépare des<br />
complexes qu’une psychanalyse de la connaissance objective devra dissoudre pour<br />
retrouver la liberté de l’expérience 58 » déclare Bachelard. Il s’agit de poser les bases à<br />
partir desquelles la vérification scientifique se déploiera, de dénoncer ces doctrines qui<br />
prétendent à l’objectivité en faisant fi de leurs valeurs subjectives, ceci, en ne faisant<br />
appel qu’à leur seule valeur d’explication objective alors que, comme le dit si bien<br />
Bachelard, « ce sont ces valeurs inconscientes qui font la permanence de certains<br />
principes d’explication» 59 . La phénoménologie bachelardienne, précisons-le, n’est pas<br />
une description empirique des phénomènes au sens husserlien car pour<br />
Bachelard, « décrire empiriquement serait une servitude à l’objet, en se faisant une loi<br />
de maintenir le sujet dans la passivité. 60 » Le phénoménologue, dit-il encore, peut<br />
utiliser les documents mis à sa disposition par le psychologue, mais il les met « sur<br />
l’axe de l’intentionnalité ». Jusque-là, rien ne le différencie de Husserl, sinon qu’il a<br />
choisi comme acte de visée, comme acte conscientiel, l’image, l’image matérielle. Mais<br />
c’est précisément sur cette visée intentionnelle que va se nouer le problème des<br />
rapports de sa phénoménologie avec la phénoménologie classique. « La première<br />
instance spécifique de la notion de matière est la résistance. Or précisément, c’est là<br />
une instance qui est proprement étrangère à la contemplation philosophique… » 61<br />
S’inscrivant en faux contre toutes les philosophies contemplatives et contre ce que l’on<br />
pourrait appeler l’attitude objective classique, qui « attend les objets », qui « refuse le<br />
contact », qui « veut d’abord voir l’objet, le voir à distance, en faire le tour, en faire un<br />
petit centre autour duquel l’esprit dirigera le feu tournant de ses catégories 62 », il<br />
restitue au point de départ de l’acte de conscience la solidarité objet-matière. A une<br />
phénoménologie de la contemplation et à une phénoménologie de la visée, il opposera<br />
une philosophie de l’action et phénoménologie matérialiste ; au clair de regard de la<br />
conscience, il substituera une conscience opiniâtre, dont le caractère directionnel<br />
s’inscrit fortement dans la réalité. Avec la vérification scientifique, il est donc question<br />
de voir « jusqu’où vont les valorisations inconscientes de l’aliment du feu et combien il<br />
58<br />
Gaston Bachelard, op. cit., p.146.<br />
59<br />
Ibid.<br />
60<br />
Idem, La Poétique de la Rêverie, p.4.<br />
61<br />
Idem, Le Matérialisme rationnel, Paris, PUF, 1953, pp.10-11.<br />
62 Ibidem, p. 10.<br />
51
est désirable de psychanalyser ce qu’on pourrait appeler le complexe de Pantagruel<br />
chez un inconscient préscientifique » 63 . La phénoménologie de l’imaginaire consiste<br />
donc à débarrasser la philosophie du privilège des déterminations visuelles frappantes.<br />
En effet, tout au long de nos travaux, on a pu observer que les recherches, les<br />
résultats et autres phénomènes scientifiques ou non obéissaient à une logique<br />
passionnelle et imaginaire qui met le raisonnement à la disposition de nos préférences.<br />
Le problème ici provient du fait que « si, dans une connaissance, la somme des<br />
convictions personnelles dépasse la somme des connaissances qu’on peut expliciter,<br />
enseigner, prouver, une psychanalyse est indispensable » car « le savant doit se refuser<br />
à personnaliser sa connaissance ; corrélativement, il doit s’efforcer de socialiser ses<br />
convictions » 64 . Il s’agit donc du problème de la critique psychanalytique dans la<br />
science, de sa légitimité dans le cadre de certaines explications scientifiques. La<br />
critique qui implique non pas un refus systématique, mais un choix éclairé qui, sans<br />
exclure l’erreur la reconnaît comme participante à la recherche de la vérité. Tout<br />
d’abord, la critique externe qui se doit de rétablir les phénomènes dans leur authenticité<br />
primitive, en faisant la chasse aux « interpolations ». Une fois les interpolations<br />
reconnues et éliminées, procéder à une critique interne qui consiste non à recouvrir les<br />
faits de notre subjectivité, mais à les en détacher. Ainsi, lorsque Gaston Bachelard<br />
affirme que lorsque l’« on cherche les conditions psychologiques des progrès de la<br />
science, on arrive à cette conviction que c’est en termes d’obstacles épistémologiques<br />
qu’il faut poser le problème de la connaissance scientifique 65 », il ne fait nul doute que<br />
le problème que l’on puisse avoir avec la connaissance émane de nous-mêmes<br />
prioritairement, sujets connaissant. En précisant par la suite :<br />
Il ne s’agit pas de considérer des obstacles externes, comme la<br />
complexité et la fugacité des phénomènes, ni d’incriminer la<br />
faiblesse des sens et de l’esprit humain (…) c’est dans l’acte<br />
même de connaître, intimement, qu’apparaissent, par une sorte<br />
de nécessité fonctionnelle, des lenteurs et des troubles. 66<br />
63<br />
Idem, La psychanalyse du feu, p. 117.<br />
64<br />
Ibid., p. 134.<br />
65<br />
Idem, La Formation de l’esprit scientifique, Paris,VRIN, 2004, p.15.<br />
66 Ibid.<br />
52
Il n’est pas plus clair qu’il faille recourir à une exploration de l’inconscient pour<br />
découvrir la difficulté que posent nos sentiments dans les processus d’acquisition du<br />
savoir. Les résistances à la connaissance scientifique ne sont pas seulement extérieures,<br />
mais internes à l’acte de connaître ; quoi donc de plus appropriée que la psychanalyse<br />
pour rechercher et détecter afin de les objectiver, les valeurs et projections<br />
inconscientes entravant le savoir ? Il est question de pouvoir détecter les convictions et<br />
préférences d’un inconscient individuel ou collectif dans des faits ou difficultés qui ne<br />
nécessitent que mesures et expériences, afin de :<br />
Guérir l’esprit de ses bonheurs, l’arracher au narcissisme que<br />
donne l’expérience première, lui donner d’autres assurances<br />
que la possession, d’autres forces de conviction que la chaleur<br />
et l’enthousiasme, bref, des preuves qui ne seraient point des<br />
flammes ! 67<br />
Dans les domaines mêmes où la mathématique permet une expression des lois du<br />
réel assez précise pour que la prévision et l’action technique reçoivent une grande<br />
puissance, il ne faut pas oublier que l’aspect qualitatif des phénomènes – l’aspect<br />
purement subjectif, mais par là même celui qui est vécu – est systématiquement<br />
sacrifié. Le monde « vécu » des qualités sensibles, des états de conscience, des<br />
sentiments, a sa valeur propre que l’ascèse mathématique se donne légitimement le<br />
droit d’exclure, mais que le mathématicien en tant qu’homme ne saurait oublier. Ne<br />
nous apprend-t-il pas que le « savant, lorsqu’il quitte son métier, retourne aux<br />
revalorisations primitives 68 » ?<br />
Pendant longtemps, l’idéal a toujours consisté à mettre en suspension l’erreur, à<br />
l’isoler du processus de la connaissance, l’éviter pour ne retenir que le résultat, à croire<br />
que la science ne consiste qu’à accumuler les bons résultats pourrions-nous dire. Mais<br />
nous savons aujourd’hui à quel point il est préjudiciable de décrire, à la façon<br />
empiriste, le progrès des sciences de la matière comme une accumulation progressive<br />
de faits positifs découverts et qui seraient paisiblement ajoutés les uns aux autres. En<br />
réalité, il faut savoir que la science ne procède pas par accumulation mais par crises,<br />
d’où la grande importance qu’accordent nos travaux à l’erreur, à la subjectivité, aux<br />
obstacles épistémologiques.<br />
67<br />
Idem, La psychanalyse du feu, p.16.<br />
67<br />
Ibidem.<br />
68<br />
Idem, La Formation de l’esprit scientifique, p. 64.<br />
53
L’hypothèse de la connaissance phénoménale a donc deux significations ou<br />
orientations possibles à la vue de nos investigations : la première et la plus reconnue, la<br />
scientifique dont la vérification est concrète et effective par l’expérience et<br />
l’inconsciente dans la mesure où, ne répondant qu’aux seules aspirations, valorisations<br />
de la rêverie, ne peut s’appliquer à l’expérience. Demeurant au seul niveau de<br />
l’imagination créatrice, l’hypothèse inconsciente, sans la rejeter toute entière doit avoir<br />
toute sa place dans la poésie, l’art en ce qu’elle est transformation et projection de la<br />
beauté purement intellectuelle de la pensée humaine. Il apparaît donc clairement avec<br />
Bachelard dans le cadre de la connaissance de l’objet que la prudence et l’esprit<br />
critique sont résolument de mise. Ainsi, Bachelard pressent un autre plan dans le<br />
processus d’acquisition de la connaissance : s’il s’agit de rêver l’objet, de l’épouser par<br />
l’imagination et d’en jouir par une libre rêverie, alors une tout autre attitude est<br />
envisageable et possible. Celle-ci nous sera notamment offerte par l’univers des poètes<br />
raison pour laquelle il dira que « les axes de la poétique et la science étant d’abord<br />
inverses. Tout ce que peut espérer la philosophie, c’est de rendre la poésie et la science<br />
complémentaires, de les unir comme deux contraires bien faits » 69 . Il s’agit donc<br />
premièrement de pouvoir les reconnaître afin de les distinguer, pour les unifier si<br />
possible par la suite et non de les mélanger en étudiant leurs objets pourtant distincts<br />
d’où le souci de précision dans les domaines de la science tout comme celui de la<br />
poésie ou de l’art.<br />
69 Idem, La psychanalyse du feu, p.10.<br />
54
TROISIEME PARTIE :<br />
L IMAGINATION BACHELARDIENNE DANS<br />
L’ORDRE DES DISTINCTIONS
La poésie et les poètes ou incidemment, le couple dialectique poésie-philosophie,<br />
ont retenu, depuis la psychanalyse du feu l’attention passionnée de Bachelard. S’il ne fut<br />
pas lui-même un poète au sens des classifications traditionnelles et des définitions<br />
techniques, il devint, selon le mot de Louis Guillaume, « le meilleur sourcier poétique de<br />
son époque ». L’amour et la pratique de la poésie, source de la méditation bachelardienne<br />
du langage, sont aussi à l’origine d’une nouvelle philosophie de l’imagination. En notre<br />
temps où les mythes n’ont plus cours, écrit Bachelard,<br />
L’imagination ne peut s’éclairer que par les poèmes qu’elle<br />
inspire. Son rôle est de former des images qui dépassent la réalité,<br />
qui la chantent. Elle invente la vie nouvelle, elle invente l’esprit<br />
nouveau…Cette adhésion à l’invisible, voilà la poésie première,<br />
voila la poésie qui nous permet de prendre goût à notre destin<br />
intime. Elle nous donne une impression de jeunesse et de jouvence<br />
en nous rendant sans cesse la faculté de nous émerveiller. La vraie<br />
poésie est une fonction d’éveil…le monde n’existe poétiquement<br />
que s’il est réinventé. 70<br />
Bachelard ne manque aucune occasion de souligner la platitude de la description<br />
métaphorique. Partout, il recherche un lien primordial entre l’homme et le monde, même<br />
dans ses constructions rationnelles, car il écrit dans la psychanalyse du feu 71 ; « on ne peut<br />
étudier que ce qu’on a d’abord rêvé», évoquant par là une antériorité psychique et peut être<br />
aussi ontologique ou génétique des images par rapport aux idées. Parlant dans la<br />
philosophie du non, d’un objet parfaitement rationnel comme l’atome, il apprend aux<br />
philosophes et aux scientifiques à ne pas oublier les poètes : « il ne nous semble pas, en<br />
effet, qu’on puisse comprendre l’atome de la physique moderne sans évoquer l’histoire de<br />
son imagerie. 72 » Comprenant par là que si l’animisme anime les choses, il lui faut au<br />
contraire désanimer les êtres pour les ordonner dans un nouvel ensemble. Ainsi en est-il du<br />
serpent, « le plus terrestre des animaux », « racine valorisée », « trait d’union entre le règne<br />
végétal et le règne animal 73 ». Ou encore du feu, « fils des deux morceaux de bois 74 »,<br />
autant d’exemples dont l’évocation surréaliste traduit, au niveau de notre affectivité la plus<br />
profonde, ce qu’une longue analyse abstraite arriverait difficilement à faire assimiler à<br />
notre intelligence. Comme on peut le constater, la lecture bachelardienne des poètes n’est<br />
70 Idem, L’Eau et les rêves, Paris, José Corti, 1942, pp. 23-24, 27.<br />
71 Idem, La Psychanalyse du feu, p.12.<br />
72 Idem, La Philosophie du non, Paris, PUF, 1966, p. 139.<br />
73 Idem, La Valeur inductive de la relativité, Paris, VRIN, 1929, p. 262.<br />
74 F. Max Muller, cité par Bachelard, dans Origine et développement de la Religion, trad. J. Darmester,<br />
1879, p.190, La Psychanalyse du feu, PUF ; p. 51.<br />
56
pas un délassement, au sens banal du terme. Elle n’est pas non plus un oubli de la lecture<br />
des philosophes et des savants, puisqu’elle est une incitation permanente à les comprendre<br />
de plus loin et du dedans.<br />
Par l’application des méthodes psychanalytiques dans l’activité de<br />
la connaissance objective, nous sommes arrivés à cette conclusion<br />
que le refoulement était une activité normale, une activité utile,<br />
mieux une activité joyeuse. Pas de pensée scientifique sans<br />
refoulement. Le refoulement est à l’origine de la pensée attentive,<br />
réfléchie, abstraite. Toute pensée cohérente est construite sur un<br />
système d’inhibitions solides et claires. Il y’a une joie de la raideur<br />
au fond de la joie de la culture. C’est en tant qu’il est joyeux que le<br />
refoulement bien fait est dynamique et utile. Pour justifier le<br />
refoulement, nous proposons dans l’inversion de l’utile et de<br />
l’agréable, en insistant sur la suprématie de l’agréable sur le<br />
nécessaire. A notre avis, la cure vraiment anagogique ne revient<br />
pas à libérer les tendances refoulées, mais à substituer au<br />
refoulement inconscient un refoulement conscient, une volonté<br />
constante de redressement 75 .<br />
Il s’agit là de reconnaître l’erreur comme telle en tant qu’une réalité polémique<br />
inhérente et heureuse à l’humanité.<br />
atteindre.<br />
Avouer qu’on s’était trompé, c’est rendre le plus éclatant<br />
hommage à la perspicacité de son esprit. C’est revivre sa culture,<br />
la renforcer, l’éclairer de lumières convergentes. C’est aussi<br />
l’extérioriser, la proclamer, l’enseigner. Alors prend naissance la<br />
pure jouissance du spirituel. Mais combien cette jouissance est<br />
plus forte quand la connaissance objective est la connaissance<br />
objective du subjectif, quand nous découvrons dans notre propre<br />
cœur l’universel humain, quand l’étude de nous-mêmes étant<br />
loyalement psychanalysée, nous intégrons les règles morales dans<br />
les lois psychologique ! Alors le feu qui nous brûlait, soudain, nous<br />
éclaire. La passion rencontrée devient la passion voulue 76<br />
Dira merveilleusement Bachelard pour ne pas être plus explicite sur l’objectif à<br />
75 Gaston Bachelard, La Psychanalyse du feu, pp. 170-171.<br />
76 Ibidem, pp. 171-172.<br />
57
SECTION A:<br />
LA POETIQUE BACHELARDIENNE OU LA<br />
FONCTION DE L’IRREEL
L’intérêt porté par Bachelard à l’imagination ne saurait être le fruit d’un hasard, car<br />
une même activité imageante est à l’œuvre dans les deux directions opposées, activité<br />
scientifique et activité onirique, qui ne sont pas simplement juxtaposées mais articulées par<br />
une dialectique d’inspiration psychanalytique. Mais si la psychanalyse de la connaissance,<br />
ayant pour finalité la formation de l’esprit scientifique, de sa rigueur et de son objectivité,<br />
doit purifier l’esprit de toutes les valorisations et illusions qui constituent autant<br />
d’obstacles épistémologiques, la psychanalyse de l’expérience poétique à l’inverse doit<br />
être à l’écoute de la subjectivité profonde et rester fidèle à l’onirisme des archétypes<br />
inconscients.<br />
Il ne fait nul doute que l’imagination a presque toujours été considérée comme la<br />
faculté de reproduction de la réalité exclusivement. Ainsi, en tant que faculté des images<br />
elle a été, le plus souvent et presque toujours liée à la mémoire, au souvenir. Cette<br />
perspective, essentiellement celle de la philosophie classique antique, attribue de façon<br />
critique et exclusive à l’imagination, la fonction reproductrice. La philosophie réaliste tout<br />
comme le commun des psychologues, estime à cet effet que c’est la perception des images<br />
qui détermine les processus de l’imagination. L’imagination serait donc la fonction de la<br />
combinaison des images du réel. Pour dire qu’avec eux, on voit les choses d’abord, pour<br />
les imaginer ensuite ; « on combine, par l’imagination, des fragments du réel perçu, des<br />
souvenirs du réel vécu, mais on ne saurait atteindre le règne d’une imagination<br />
foncièrement créatrice. Pour richement combiner, il faut avoir beaucoup vu » 77 estiment-<br />
ils. Ils s’attacheront ainsi à l’objet essentiellement, sans tenir compte du sujet dans sa<br />
richesse créatrice. Or qu’est ce qu’imaginer ? Ce n’est pas la capacité de former des<br />
images à la ressemblance de la perception, mais au contraire la faculté de déformer les<br />
images premières pour constituer un domaine spécifique, l’imaginaire, qui dépasse toute<br />
réalité donnée. « Le conseil de bien voir, qui fait le fond de la culture réaliste, domine sans<br />
peine notre paradoxal conseil de bien rêver, de rêver en restant fidèle à l’onirisme des<br />
archétypes qui sont enracinés dans l’inconscient humain 78 » déclare Bachelard. En<br />
dénonçant « les illusions premières » et en opposant à l’idéalisme « immédiat » celui qu’il<br />
appelle discursif, Bachelard définit dans un autre article 79 , mais sans le nommer, la<br />
fonction majeure de l’imagination. En effet, quand il nous fait assister à la naissance de ce<br />
77<br />
Idem, La Terre et les rêveries de la volonté, Paris, José Corti, 1948, p.3.<br />
78<br />
Ibidem.<br />
79<br />
Intitulé précisément « Idéalisme discursif » (Recherches philosophiques, 1934-1935, pp. 21-29, Études, pp.<br />
87-97).<br />
59
psychisme nouveau qu’il appelle orthopsychisme, et où l’apodictique s’est substitué à<br />
l’assertorique, quand il oppose, à un intellect passif recevant intuitivement les idées les<br />
unes à coté des autres, un esprit dynamisé qui organise et hiérarchise la réalité tout en<br />
hiérarchisant et organisant ses propres attitudes, il désigne à n’en pas douter l’imagination<br />
structurante et valorisante. L’imagination matérielle, qui est centrée dans la profondeur ou<br />
l’intimité des choses elles-mêmes et qui établit un pont entre le sujet et l’objet, entre<br />
l’Esprit et la Nature. On comprend mieux cette paradoxale expression de subjectivisme<br />
objectif qu’il utilise dans son étude des Recherches philosophiques, mais qu’il commente<br />
en des termes que reprendront, à propos de l’imagination, les livres sur les quatre<br />
éléments :<br />
Le sujet, en méditant l’objet, élimine non seulement les traits<br />
irréguliers dans l’objet, mais des attitudes irrégulières dans son<br />
propre comportement intellectuel. Le sujet élimine ses singularités,<br />
il tend à devenir un objet pour lui-même. Finalement, la vie<br />
objective occupe l’âme entière 80 .<br />
On retiendra cette dernière phrase, car elle résume l’activité imageante du<br />
bachelardisme, dont la préface de l’Eau a donné la clef : « L’imagination invente plus que<br />
des choses et des drames, elle invente de la vie nouvelle ; elle invente de l’esprit nouveau ;<br />
elle ouvre des yeux qui ont des types nouveaux de vision. 81 » Cette vision est active, elle<br />
voit dans les choses, selon le mot de Rimbaud, plus que les choses, mais elle n’est pas<br />
désordonnée, ni ne se veut pure fantasmagorie ; elle est l’invention d’un sens nouveau à<br />
partir d’archétypes qu’elle découvre ou crée dans les choses elles-mêmes, qu’elle trouve et<br />
réactive dans certaines images littéraires, celles qui précisément donnent à voir ou à rêver.<br />
Notons déjà que Descartes dans ses Méditations et Passions, contre Pascal et Fontenelle<br />
revalorisait déjà l’imagination entendant par elle une mutation épistémique qui donne à<br />
l’imagination un statut important dans la théorie de la connaissance moderne, ce qui se<br />
ressent notamment chez Bergson lorsqu’il parle de l’imagination créatrice. C’est ainsi que<br />
Jean Paul Sartre et Bachelard développeront la puissance de l’imagination créatrice, encore<br />
appelée l’imaginaire. L’imagination authentique serait donc l’imagination créatrice.<br />
Autrement dit, c’est parce que l’imagination est créatrice qu’elle correspond à la fonction<br />
véritable de l’irréel. L’irréel rappelons-le, est ce qui transcende toute réalité donnée et qui<br />
concerne le pôle de la pensée se situant au-delà des faits. Il s’agit, pour agir, de façon<br />
80 Études, p. 83.<br />
81 Gaston Bachelard, L’Eau et les Rêves, p. 24.<br />
60
explicite, d’entreprendre les diverses modifications que l’on peut réaliser dans son cerveau,<br />
car l’esprit a la capacité de jauger les possibilités à réaliser ; pour dire que l’esprit humain<br />
fonctionne par anticipation. Optique dans laquelle se situe Fabien Eboussi Boulaga<br />
lorsqu’il affirme dans le cadre de l’imaginaire des philosophies de la libération :<br />
L’homme dans ses chaînes peut se découvrir libre, capable de<br />
liberté en rêvant de s’évader. Par l’imaginaire, il peut se trouver<br />
ailleurs. On l’a vu, on ne saurait mépriser la puissance de<br />
l’imaginaire et du rêve. Sans eux, rien ne se ferait. Pour faire, il<br />
faut anticiper, il faut un espace de jeux pour concevoir et essayer<br />
déjà les mondes à bâtir, dans leur agencement, la liberté ne<br />
commence que si elle peut « prévoir » les conditions de son<br />
effectuation, l’agencement ou la succession de ses moments 82 .<br />
Les images, produits de l’imagination, transcendent la subjectivité close de<br />
l’individu. Leur force et leur dynamisme expriment la puissance des éléments, eau, air,<br />
terre, feu. En tant qu’archétypes, elles constituent un véritable « transcendantal » de la<br />
perception et nous font participer à une symbolique universelle. Quand Bachelard écrit :<br />
« la fraîcheur d’un paysage est une manière de le regarder », et qu’il ajoute : « Il faut sans<br />
doute que le paysage y mette un peu du sien, il faut qu’il tienne un peu de verdure et un<br />
peu d’eau, mais c’est à l’imagination…que revient la plus longue tâche 83 » il indique dans<br />
ce transfert du sujet vers l’objet et dans cette correspondance entre un système d’images et<br />
une typologie de tempéraments, le sens et la portée de sa phénoménologie. Cette<br />
distinction et cette liaison du sujet et de l’objet, que nous retrouvons à l’œuvre aussi bien<br />
dans sa psychanalyse que dans sa phénoménologie, marque par la conjugaison de ces deux<br />
méthodes, l’originalité de l’épistémologie phénoménologique qui nous occupe. « La<br />
phénoménologie de la nouveauté pure dans l’objet, a-t-il écrit dans le Rationalisme<br />
appliqué, ne pourrait éliminer la phénoménologie de la surprise dans le sujet. 84 ». Si la<br />
fraîcheur d’un paysage est une manière de le regarder, et non un état d’âme, c’est bien<br />
parce que l’imagination est créatrice d’êtres et non reproductrice, comme la mémoire,<br />
d’états d’âmes ; c’est parce qu’elle se libère d’images parasitaires, véritable fonction<br />
déréalisante (selon l’expression même de Bachelard 85 ) à laquelle correspond, comme<br />
82<br />
Fabien Eboussi Boulaga in La Crise du Muntu, Authenticité africaine de philosophie, Paris, Présence<br />
africaine, 1977, pp. 175-176.<br />
83<br />
Gaston Bachelard, La poétique de la rêverie, p. 199.<br />
84<br />
Idem, Le Rationalisme appliqué, Paris, PUF, 1949, p .78.<br />
85<br />
Idem, L’Air et les Songes, Paris, José Corti, 1943, p.1.<br />
61
vocable fondamental, celui d’imaginaire. Elle est, au sens propre du terme, un regard neuf<br />
projeté sur le monde. Fonction éminemment propre à la découverte scientifique comme à<br />
la création artistique, s’il est vrai comme l’écrit Canguilhem, que l’esprit doit être vision<br />
« pour que la raison soit révision » et « que l’esprit soit poétique pour que la raison soit<br />
analytique dans sa technique et le rationalisme, psychanalytique dans son intention » 86 .<br />
Dans la Psychanalyse du feu, il revient, une fois de plus, sur l’idée que l’imagination est<br />
par excellence de la production psychique, « plus que la volonté, plus que l’élan vital 87 » ;<br />
et dans la Terre et les Rêveries de la volonté, sur celle-ci, à savoir que l’image matérielle,<br />
en approfondissant l’être superficiel, « ouvre une double perspective : vers l’intimité du<br />
sujet agissant et dans l’intérieur substantiel de l’objet inerte rencontré par la perception 88 ».<br />
L’image participe véritablement à une ontogenèse de la conscience. Cependant, s’il faut<br />
établir un rapport de différence entre l’imagination et l’image, force est de retenir que<br />
l’imagination est au-delà de l’image en ce qu’elle la transcende, raison pour laquelle<br />
Bachelard remarque judicieusement que « sans doute, en sa vie prodigieuse, l’imaginaire<br />
dépose des images, mais il se présente toujours comme un au-delà de ses images, il est<br />
toujours un peu plus que ses images » 89 . Cette différence est fondamentale parce que<br />
l’image est susceptible d’être immobile, quittant ainsi son principe imaginaire mouvant qui<br />
ne saurait épouser cette fixité corruptible ; raison pour laquelle l’auteur spécifiant le<br />
caractère sacrifié d’une psychologie de l’imagination qui ne s’occupe que de la constitution<br />
des images oubliant leur mobilité caractère pourtant essentiel estime à raison que<br />
« l’imagination, pour une psychologie complète, est, avant tout, un type de mobilité<br />
spirituelle la plus grande, la plus vivante. Il faut donc ajouter systématiquement à l’étude<br />
d’une image particulière l’étude de sa mobilité, de sa fécondité, de sa vie » 90 .<br />
On ne peut parler d’un monde du phénomène, d’un monde des<br />
apparences que devant un monde qui change d’apparences. Or,<br />
primitivement, seuls les changements par le feu sont des<br />
changements profonds, frappants, rapides, merveilleux, définitifs 91<br />
dira Bachelard. Mais l’image cesse d’être neuve, ouverte lorsqu’elle se fige en une<br />
forme définitive qui la rend proche de la perception. A ce moment, nous dit Bachelard<br />
« lorsqu’une image prend une forme définitive en s’éloignant d’une forme imaginaire, elle<br />
86<br />
Cf. « Sur une épistémologie concordataire », in Hommage à Gaston Bachelard, p.10<br />
87<br />
Gaston Bachelard, La Psychanalyse du feu, p. 181.<br />
88<br />
Idem, La Terre et les Rêveries de la volonté, p. 32.<br />
89<br />
Idem, L’Air et les songes, p.7.<br />
90<br />
Ibidem.<br />
91<br />
Idem, La Psychanalyse du feu, pp. 101-102.<br />
62
ne nous fait plus rêver, elle fait appel à l’action, au faire 92 » car ce qui caractérise<br />
l’imagination est de s’éloigner des images et donc de créer un monde nouveau. Il faut donc<br />
rompre avec l’ancienne manière de considérer l’image. L’imagination n’est pas la faculté<br />
de former des images mais celle de nous libérer des « images premières ». S’il n’y a pas<br />
changement d’images, il n’y a pas d’action imaginante. Il s’agit de faire venir à l’esprit ce<br />
qui est absent.<br />
L’imagination est très différente de l’habitude, de la mémoire, du<br />
souvenir, de la perception. Contre l’étymologie, le vocable<br />
fondamental qui convient à l’imagination ce n’est pas l’image,<br />
mais l’imaginaire. Un monde peuplé, différent de celui que nous<br />
percevons, que nous gardons sous la forme de souvenir par la voie<br />
de l’imaginaire 93 .<br />
L’imagination créatrice est donc seule digne de s’appeler imagination parce que sa<br />
faculté est précisément de changer les images perçues. L’imagination est donc une faculté<br />
de l’innovation qui a prêté jour à l’ouverture du monde ; c’est tout à fait un autre domaine<br />
auquel elle s’ouvre. L’imagination, comme le nouvel esprit scientifique, se définit donc en<br />
rupture avec la perception commune. Comme lui, elle est négativité, mobilité, expérience<br />
même de la nouveauté. Ainsi, dans le registre poétique comme dans celui de la science,<br />
Bachelard nous donne à voir des facultés ouvertes et novatrices, expression de la<br />
transcendance de l’homme et de son infinie liberté.<br />
92 Idem, L’Air et le songe, p.7.<br />
93 Ibidem.<br />
63
SECTION B :<br />
PHILOSOPHIE, SCIENCE ET IDEOLOGIE : LA<br />
RUPTURE EPISTEMOLOGIQUE
La rupture épistémologique c’est le moment où une discipline surmonte les<br />
obstacles épistémologiques, les erreurs et les illusions de sa préhistoire, pour se<br />
constituer comme science. Cette philosophie de Bachelard est essentielle en ce qu’elle<br />
combat une valorisation idéologique excessive des affects qui trouble assez la science,<br />
précisément dans la mesure où les processus sociaux sont régis par des lois qui<br />
demeurent inconscientes. Une « coupure » est nécessaire pour marquer le passage des<br />
discours idéologiques qui ne font que refléter les structures sociales dans lesquelles ils<br />
sont insérés, à un discours scientifique ou théorique qui s’attache à les mettre à jour. Il<br />
s’agit donc dans le cadre de nos travaux, d’un vaste projet devant : faire un bilan<br />
critique des pratiques philosophiques et scientifiques courantes, ainsi que des erreurs<br />
inhérentes à l’esprit humain, entraves aux progrès de la science. Un inventaire des<br />
processus cognitifs, et une répartition ou division des sciences devant orienter la<br />
recherche scientifique et dont le principe est la mise en correspondance des différentes<br />
branches du savoir avec les facultés de l’esprit.<br />
En effet, il est important de souligner que l’œuvre de Bachelard en général est<br />
construite dans une perspective bipolaire : la raison scientifique d’un coté et, à l’opposé<br />
l’activité onirique de l’imagination qui nous a principalement intéressé dans le cadre de<br />
la présente recherche. Dans le premier registre, il propose une conception nouvelle de<br />
l’histoire des sciences, progressant par crises et ruptures successives, et une<br />
épistémologie formée à la négativité et à la pensée polémique. Un nouveau<br />
rationalisme en découle refusant la structure immuable et éternelle de la raison. Pour<br />
lui, il y’a lieu de savoir qu’alors qu’aucune catégorie a priori ne préside à la<br />
constitution de la science, la raison remet en question ses principes et concepts en les<br />
ajustant aux révolutions scientifiques successives. La notion d’obstacle<br />
épistémologique commande ainsi la double orientation de sa philosophie à savoir ; la<br />
formation de l’esprit scientifique contre les valorisations inconscientes, la connaissance<br />
sensible et toute forme d’évidence immédiate ; la réhabilitation dans l’ordre de<br />
l’imaginaire des expériences condamnées sur le plan de la rationalité. Bachelard ainsi,<br />
milite pour une épistémologie nouvelle, discontinuiste pourrions nous dire car il est<br />
clair que la science ne progresse pas de façon continue, mais qu’elle se construit à<br />
partir de ruptures successives. Ces ruptures épistémologiques qui ne sont que des<br />
mutations brusques à effectuer par l’esprit pour ajuster ses cadres rationnels aux<br />
65
expériences nouvelles, constituent autant de changements de méthodes et de concepts à<br />
l’intérieur même du devenir scientifique. Bachelard utilise très librement la loi des trois<br />
états d’Auguste Comte pour désigner les trois grandes étapes du devenir scientifique :<br />
1- L’état préscientifique qui s’étendrait de l’Antiquité au XVIII e siècle, est<br />
caractérisé par l’absence de rupture entre l’expérience commune et<br />
l’expérience scientifique et par le caractère empirique de l’objet scientifique<br />
en continuité avec les apparences, de façon substantialiste, avec un regard<br />
fasciné par la chose et prisonnier de l’imagination, des idées générales et des<br />
concepts immuables comme on a pu le voir dans la première partie de nos<br />
travaux.<br />
2- L’état scientifique qui s’étendrait de la fin du XVII e siècle au début du XX e<br />
siècle, est marqué par la séparation de la science avec la connaissance<br />
commune. Ici, la raison édifie ses premières constructions et la pensée<br />
scientifique se différencie de son passé préscientifique par sa marche vers une<br />
abstraction croissante où le réalisme élémentaire devient obstacle à l’effort de<br />
rationalisation. On remarque toutefois que l’état scientifique bien qu’au<br />
moment des lumières, reste tributaire d’une philosophie de l’intuition, de<br />
l’immédiat, des natures simples et d’un esprit scientifique confiant dans les<br />
vérités premières et les notions de base d’où l’objet du présent travail.<br />
3- L’ère du nouvel esprit scientifique aurait débuté dès 1905 avec la théorie de la<br />
relativité einsteinienne et c’est elle qui constitue valablement notre actualité.<br />
Elle consacre la rupture avec les natures simples cartésiennes. On s’aperçoit<br />
que l’état d’analyse de nos intuitions communes est très trompeur et que les<br />
idées les plus simples comme celle de choc, de réaction, de réflexion<br />
matérielle ou lumineuse ont besoin d’être révisées. Autant dire que les idées<br />
simples ont besoin d’être compliquées pour pouvoir expliquer les<br />
microphénomènes déclare l’auteur à cet effet dans l’ouvrage concerné. Le<br />
simple est une illusion et les natures prétendues simples se révèlent un tissu de<br />
relations complexes, la nouvelle pensée scientifique ne cessant d’affiner et de<br />
différencier les structures. Ce qu’on note particulièrement ici, c’est que cette<br />
troisième période est l’ère d’une prise de conscience réflexive par la science.<br />
66
Raison pour laquelle alors que les deux premières sont des états, elle se définit<br />
plutôt comme un esprit c’est dire que l’épistémologie nouvelle qui anime la<br />
science ou philosophie du non, prend acte des ruptures épistémologiques<br />
(épistémologie non cartésienne, géométrie non euclidienne, relativité non<br />
newtonienne) et, découvrant que « tout ce qui est décisif ne naît que malgré et<br />
contre », elle voit dans l’état de crise le moteur et le dynamisme même de la<br />
science.<br />
S’il faut donc se demander quels sont alors les principes et les concepts<br />
fondamentaux de cette nouvelle épistémologie ?<br />
Rien n’est donné, tout est construit déclare Bachelard, posant comme tel<br />
l’axiome fondamental de son épistémologie. La science ne constitue pas une<br />
émergence à partir d’une absence totale de science, elle ne commence pas à proprement<br />
parler, mais s’édifie contre un savoir préalable : il n’y a pas de vérité première, il n’y a<br />
que des erreurs premières dit-il à cet effet. Dès lors, pour lui, le progrès scientifique ne<br />
suit pas la voie cumulative d’une addition de connaissances : il est plutôt une démarche<br />
réductrice qui procède par soustraction d’opinions erronées, d’images encombrantes et<br />
de préjugés, et la vérité, notion polémique par excellence, n’est pas un point de départ<br />
mais un résultat. La connaissance comme savoir acquis et objectif à partir d’un certain<br />
nombre de processus est ce qui nous préoccupe particulièrement ici. Bachelard dans<br />
son avant propos dira à cet effet :<br />
S’il s’agit d’examiner des hommes, des égaux, des frères, la<br />
sympathie est le fond de la méthode. Mais devant ce monde<br />
inerte qui ne vit pas de notre vie, qui ne souffre d’aucune de nos<br />
peines et que n’exalte aucune de nos joies, nous devons arrêter<br />
toutes les expansions, nous devons brimer notre personne 94 .<br />
Il est donc légitime d’étudier, comprendre et de critiquer afin d’améliorer les<br />
manières par lesquelles le sujet humain accède à la connaissance, le comment de<br />
l’organisation de ce savoir…pour prétendre à une quelconque objectivité.<br />
L’insistance sur l’effort de précision doit nous permettre d’atteindre le juste<br />
milieu entre les deux extrêmes de l’objectivité claire et précise et de la subjectivité<br />
94 Idem, La Psychanalyse du feu, p.12.<br />
67
profonde et confuse. On notera que la précision apparaît d’abord comme une qualité de<br />
la science contrairement à toute connaissance confuse, purement spéculative en faveur<br />
de laquelle on observe le plus souvent des défauts et des excès. La contradiction que<br />
Bachelard décèle entre la science, ou plutôt les problèmes de la science, et la réflexion<br />
philosophique, mériterait davantage d’être appelée incompatibilité d’orientation,<br />
confusion des domaines ou décalage historique. En effet, la science est par fonction et<br />
nécessité historique tournée vers l’avenir, ouverte vers un progrès incessant et un<br />
champ illimité d’applications techniques. En affirmant, d’un livre à un autre, que le<br />
jugement récurrent et normatif de l’historien-philosophe des sciences est à réviser sans<br />
cesse. L’épistémologie des « nouveaux philosophes » reste ouverte, il nous met en état<br />
de comprendre que les concepts produits par la connaissance scientifique doivent être<br />
retravaillés, et que l’histoire sanctionnée (selon son expression), ne liquide pas<br />
définitivement le passé : l’histoire périmée, celle des échecs, des impasses instruit<br />
autant l’historien des sciences que celle des réussites et des réorganisations positives.<br />
Et elle le laisse dans une disposition d’esprit propice à l’invention et à la découverte.<br />
C’est sans doute là que réside le secret de la vitalité, de la juvénilité intellectuelle de<br />
Bachelard, de son étonnante modernité.<br />
Quand tout change dans la culture, écrit-il avec conviction, et les<br />
méthodes et les objets, on peut s’étonner qu’on donne l’immobilité<br />
philosophique comme un mérite. (…) Tel philosophe qui écrit à<br />
soixante ans défend encore la thèse qu’il soutint à trente ans. La<br />
carrière entière, chez certains philosophes d’aujourd’hui est ainsi une<br />
« soutenance continuée » 95 .<br />
La culture scientifique, Bachelard ne le dira pas assez, nécessite de plus grands<br />
renoncements. C’est ainsi qu’en proposant dans sa philosophie du non un « essai de<br />
philosophie du nouvel esprit scientifique », il formule avec véhémence à l’égard des<br />
philosophes et des savants des exigences qui sont autant de provocations.<br />
Nous demanderons aux philosophes de rompre avec l’ambition<br />
de trouver un seul point de vue et un point de vue fixe pour juger<br />
l’ensemble d’une science aussi vaste et aussi changeante que la<br />
physique 96 .<br />
95 Idem, Le Rationalisme appliqué, p.43.<br />
96 Idem, La Philosophie du non, p.12.<br />
68
On pense, parmi d’autres, à Bergson, dont Bachelard fut sur presque tous les<br />
plans le tenace adversaire, et au célèbre texte de la Pensée et le Mouvant sur l’intuition<br />
« centrale » du philosophe qui aurait passé toute sa vie et écrit tous ses livres pour<br />
répéter sous des formes diverses une seule et même idée. Quand aux savants, les<br />
questions qu’il leur pose peuvent apparaître encore plus déconcertantes, car nous<br />
voyons un épistémologue, ennemi des descriptions comme des anecdotes, se faire<br />
psychologue et interroger ses interlocuteurs sur leur humeur, leur état d’esprit…bref<br />
sur leur humanité.<br />
Aux savants, nous réclamerons le droit de détourner un instant<br />
la science un instant de son travail positif, de sa volonté<br />
d’objectivité pour découvrir ce qui reste de subjectif dans les<br />
méthodes les plus sévères. Nous commencerons en posant aux<br />
savants des questions d’apparence psychologique et peu à peu<br />
nous leur prouverons que toute psychologie est solidaire des<br />
postulats métaphysiques… Nous demanderons donc aux<br />
savants : « comment pensez vous, quels sont vos tâtonnements,<br />
vos essais, vos erreurs ? Sous quelle impulsion changez-vous<br />
d’avis ?... Donnez nous surtout vos idées vagues, vos<br />
contradictions, vos idées fixes, vos convictions sans preuve…<br />
Dites-nous ce que vous pensez, non pas en sortant du<br />
laboratoire, mais aux heures où vous quittez la vie commune<br />
pour entrer dans la vie scientifique. Donnez nous, non pas votre<br />
empirisme du soir, mais votre vigoureux rationalisme du matin ;<br />
l’a priori de votre rêverie mathématique, la fougue de vos<br />
projets, vos intuitions inavouées 97 .<br />
Un pareil langage, reconnaissons le, ne devait guère être compris des philosophes<br />
et des savants, et les injonctions de Bachelard furent assez peu suivies d’effets. Et<br />
pourtant ! Si l’on veut comprendre l’histoire d’une pensée, d’une découverte, d’une<br />
science, peut-on négliger l’étude du terrain sociologique ou des données<br />
anthropologiques qui en ont conditionné l’émergence ? L’originalité et le « scandale »<br />
de Bachelard c’était de vouloir faire parler à l’épistémologie ou à l’histoire des sciences<br />
le langage de la psychologie, de la sociologie ou de l’anthropologie structurelle. Le<br />
scandale, aux yeux des philosophes traditionnels, c’était de faire des systèmes de<br />
pensée comme l’empirisme ou le rationalisme, traditionnellement liés à une œuvre ou à<br />
une époque et à une explication unifiée du monde, des humeurs changeantes, sans<br />
97 « Paroles de Gaston Bachelard » in Mercure de France, 1963, p.15.Cf. P. Quillet, p. 9.<br />
69
statut, sans lettres de créance, sans passé respectable ! Les dix années qui séparent la<br />
Philosophie du non du Rationalisme appliqué marquent de la même intensité, cette<br />
rupture radicale avec les philosophies traditionnelles. Surtout, la fixité de leurs<br />
appellations est liée à deux idées fondamentales : le « déplacement » systématique de<br />
toute théorie philosophique de la connaissance par rapport à la pratique effective des<br />
savants ; la dispersion sous la forme d’un « spectre » de tous les types de théorie de la<br />
connaissance autour de la réalité du travail de production des concepts scientifiques.<br />
Poètes, philosophes et savants : si les rencontres de Bachelard avec les premiers<br />
sont marquées d’un signe contraire à celui de ses rencontres avec les deux autres<br />
cohortes biblio-humaines qui peuplent son univers, elles excitent toutes son activité<br />
inventive ; elles lui donnent cette joie de vivre et de créer, d’enseigner et d’être instruit.<br />
L’objectif fondamental de Bachelard est de favoriser le progrès des sciences de la<br />
nature en analysant les causes d’inertie de l’esprit. Ainsi, avant toute autre démarche<br />
épistémologique, la première tache consiste à dénombrer les principales sources<br />
d’erreur qui résultent de la nature humaine par ses désirs. Il s’agit donc pour Bachelard<br />
de rendre la rêverie, la poésie, l’imagination accessibles aux amis de la philosophie<br />
facile et claire, en évitant de laisser l’abstrait se dégrader en abstrus, et la profondeur en<br />
obscurité.<br />
70
SECTION C :<br />
ACTUALITE ET RE-EVALUATION
Si pour rester fidèle à notre thèse de l’unité profonde de la philosophie<br />
scientifique et de la philosophie poétique de Bachelard, nous voulions rapprocher des<br />
textes appartenant à différentes époques de sa vie et témoignant de préoccupations<br />
diverses, nous reconnaîtrions vite qu’il faut en chercher le lien et le liant dans une<br />
théorie transcendantale de l’imagination créatrice. Lorsque dans un article publié dès<br />
1954 dans la Revue philosophique 98 , Jean Hyppolite un de ses meilleurs<br />
commentateurs, célèbre le « romantisme de l’intelligence » de Bachelard comme<br />
caractéristique de sa philosophie, entendant par là une puissance « déniant toute limite<br />
à une imagination créatrice », « ouvrant sans cesse des perspectives nouvelles et<br />
refusant toute fermeture », cette puissance de l’intelligence, pour citer les propos<br />
mêmes de Bachelard « construit sa propre surprise et se prend au jeu des questions ».<br />
Sans vouloir tabler sur des influences auxquelles le libre jeu et l’utilisation si<br />
personnelle des citations et des références rendent la détermination malaisée, il est<br />
difficile de ne pas évoquer Novalis et par conséquent la pensée de Fichte ou celle de<br />
Schelling, qui poursuivaient d’ailleurs un mouvement amorcé par Kant lui-même dans<br />
la voie de d’une généralisation de l’imagination, imagination transcendantale, projet de<br />
l’être. Cette imagination généralisée, dont Hegel disait qu’elle était la raison même, est<br />
productrice de concepts aussi bien que d’images ; mais ce serait une erreur que de<br />
vouloir en faire la seule puissance d’anima. Disons qu’elle peut tantôt dériver vers la<br />
rêverie, tantôt soutenir et accroître la portée de l’entendement. Il s’agit donc à présent,<br />
de pouvoir situer l’œuvre de ce génie dont la grande importance n’est plus à mettre en<br />
doute à moins d’être issu d’une autre civilisation que celle terrestre.<br />
Nous devons le souligner, la dualité des recherches de Bachelard, philosophe des<br />
sciences et phénoménologue de l’imaginaire ne brise pas la profonde unité qui sourd à<br />
travers toute son œuvre. Si la rémanence d’images dans la conscience de l’homme de<br />
science compromet le progrès scientifique quand il les ignore, la reconnaissance de ces<br />
obstacles permet plus aisément qu’une voie lisse et unie, le bond en avant de la raison.<br />
D’autre part, on a pu constater, dans la formation de ces objets de pensée que sont les<br />
concepts ou de ces objets de rêve que sont les images, le rôle proprement structural,<br />
architectonique ou créateur de la raison et de l’imagination. L’acte poétique, comme<br />
98 Cf. « Gaston Bachelard ou le romantisme de l’intelligence » in Hommage à G. Bachelard, PUF, 1957, pp.<br />
13-27.<br />
72
l’acte d’invention scientifique, n’a pas d’aïeux. « Il n’y a pas de poésie antécédente à<br />
l’acte du verbe poétique 99 », lisons-nous dans l’Air et les Songes. Et, quand il veut<br />
opposer à l’objet perçu de la connaissance commune l’objet pensé de la connaissance<br />
scientifique, il se sent obligé de créer un vocable neuf correspondant à cette création de<br />
l’esprit : « pour caractériser pleinement un objet qui réalise une conquête théorique de<br />
la science, lisons-nous dans le Rationalisme appliqué, il faudrait parler d’un noumène<br />
nougonal, d’une essence de pensée qui engendre des pensées. » 100<br />
Concordance ou convergence des deux fonctions et des deux domaines, ou encore<br />
isomorphisme, pour reprendre une expression de Dagognet ? Aucun doute n’est permis,<br />
écrit-il encore, science et poésie, toutes deux spécifiquement ontogéniques, dépassent<br />
et renouvèlent le monde, lui substituent une matière nouménale, relèvent d’une<br />
philosophie de l’énergie. Mais la science et la poésie, pour jaillissantes et<br />
imprévisibles qu’elles soient, ne sont pas le fruit d’une génération spontanée : elles ont<br />
un créateur, si elles sont également créatrices, et ce créateur, c’est l’homme, l’homme<br />
qui parle. Si, comme nous le lisons dans la Poétique de l’espace, « la nouveauté<br />
essentielle de l’image poétique pose le problème de la créativité de l’être parlant » 101 ,<br />
l’invention scientifique ne suscite pas moins un effort de création linguiste : l’exemple<br />
de Bachelard, créateur d’un « nouveau lexique », en est le plus éclatant témoignage. Le<br />
langage métaphorique est le pont qui relie donc la philosophie et la poésie. La poésie<br />
est instauratrice d’un sens. Mais le langage scientifique a la même fonction volontaire.<br />
La seule différence est que l’acte poétique est une fonction primitive, qui ne renvoie à<br />
rien d’autre qu’à elle-même, qui n’est ni traduction ni langage second, alors que le<br />
langage scientifique, qu’il soit purement technique ou un mixte de langage commun et<br />
de langage technique, renvoie à un concept, c'est-à-dire à une opération mentale, à un<br />
problème à résoudre : il est traduction d’un travail à effectuer…à moins d’être un néant<br />
verbal. C’est ainsi que lorsque Fourier « parle fluide, il faut lui laisser le bénéfice de<br />
son affirmation : il pense équation » 102 , mais lorsque l’on affirme que la lumière est un<br />
phénomène vibratoire 103 , en se servant à mauvais escient d’une locution réaliste et<br />
mécaniste, on utilise un mot vide de sens. Pour sa part, Bachelard préférerait une<br />
99 Gaston Bachelard, L’Air et les Songes, p.14.<br />
100 Idem, Le Rationalisme appliqué, p. 110.<br />
101 Idem, La Poétique de l’espace, p.8.<br />
102 Idem, Étude sur l’évolution d’un problème de physique, Paris, VRIN, 1928, p. 58.<br />
103 Idem, Le Rationalisme appliqué, p.183.<br />
73
formulation du type « la lumière est un cosinus » (puisqu’une décision d’ordre<br />
mathématique permet de représenter ce mouvement vibratoire par un cosinus) malgré<br />
son caractère outré et paradoxal, à la fausse clarté verbale que procure le terme de<br />
vibration. Bachelard aurait sûrement été le dernier à refuser que l’on fit la psychanalyse<br />
de son vocabulaire philosophique : il était conscient de ses diverses strates et des<br />
valorisations affectives qu’il y introduisait. Mais précisément cette lucidité dans la<br />
création de nouveaux vocables fortement personnalisés lui permettait d’échapper aux<br />
pièges dont la plupart des philosophes et des savants sont victimes, quand ils se servent<br />
inconsidérablement d’images ou de formules empruntées à l’expérience et au<br />
vocabulaire communs. Un chapitre de la Formation scientifique, dénonçant, parmi<br />
d’autres obstacles verbaux, le mot-image éponge, montre à la fois le danger de la<br />
métaphore, quand on en fait un usage intempestif et qu’elle conduit à un raisonnement<br />
par analogie empirico-verbale, et son importance dans l’économie ou la structuration<br />
d’une pensée :<br />
On ne peut confiner aussi facilement qu’on le prétend les métaphores<br />
dans le seul règne de l’expression. Qu’on le veuille ou non, les<br />
métaphores séduisent la raison. Ce sont des images particulières et<br />
lointaines qui deviennent insensiblement des schémas généraux. 104<br />
Si une métaphore réaliste ou obscurément substantialiste comme celle de<br />
l’éponge appliquée au fer, éponge de fluide magnétique, est scientifiquement (et même<br />
poétiquement) inefficace, une reconnaissance n’étant pas plus une connaissance qu’une<br />
expression n’est une explication 105 , les métaphores poético-mathématiques de notre<br />
auteur sont suffisamment provocantes pour leur nouveauté même. Et, leur halo<br />
d’imprécision pour que le lecteur attentif et averti ne les prenne pas au pied de la lettre<br />
mais les utilise comme un tremplin lui permettant d’accomplir un bond intellectuel en<br />
avant, vers la permanente objectivité scientifique.<br />
Terme d’un processus discursif d’erreurs corrigées, l’objectivité fait apparaître<br />
rétrospectivement tout commencement comme illusoire. La connaissance scientifique<br />
est essentiellement un travail permanent de rectification qui, par récurrence réflexive de<br />
la vérité sur son passé, redonne une configuration nouvelle à la totalité du savoir. Mais<br />
104 Idem, La Formation de l’esprit scientifique, p.76.<br />
105 Ibidem, p.73.<br />
74
ce qui doit être surtout rectifié et combattu, ce sont les « obstacles épistémologiques »<br />
insidieux et insoupçonnés que sont les intuitions spontanées, les habitudes de pensée,<br />
les valorisations inconscientes qui constituent des entraves et des résistances inhérentes<br />
à l’acte même de connaître. Ainsi, qu’il s’agisse de l’expérience immédiate, de la<br />
généralité, de l’animisme, du réalisme ou du substantialisme, on ne saurait les<br />
surmonter une fois pour toutes, car ils sont toujours récurrents et c’est à ce titre qu’ils<br />
requièrent la psychanalyse comme on l’a déjà mentionné dans notre travail.<br />
La philosophie du non induit ainsi l’idée d’une mobilité essentielle de la<br />
connaissance qui ne peut être dès lors qu’une connaissance approchée. Celle-ci ne doit<br />
pas être comprise au sens péjoratif d’un savoir approximatif ou vague qui se contente<br />
d’à-peu-près, au contraire. La connaissance approchée exclut l’exactitude propre à la<br />
connaissance absolue mais se veut néanmoins précise et cerne son objet par des<br />
mesures calculées au plus près. Ainsi, si la rectification discursive est le processus<br />
fondamental de la connaissance objective, l’approximation et l’inachèvement de la<br />
connaissance qui en découlent nécessairement tiennent autant à l’exigence pour l’esprit<br />
scientifique de surmonter les obstacles épistémologiques qu’à la complexité illimitée<br />
inhérente à la réalité même. Dès lors, l’objet, hors d’une atteinte définitive, n’est que le<br />
produit de cette rectification permanente du savoir : « qu’est ce que l’atome si ce n’est<br />
la somme des critiques auxquelles on soumet son image première ? » s’interrogera<br />
l’auteur à cet effet.<br />
En ce qui concerne la raison, elle ne saurait plus être considérée comme une<br />
structure immuable et définitive. Aucune catégorie a priori, rappelons le une fois de<br />
plus, ne préside à la constitution du savoir : la pensée produit ses propres catégories<br />
dans un dialogue permanent avec l’expérience, dialogue qui instruit et informe la<br />
raison. Il faut noter ici avec Bachelard, qu’il s’agit d’une manière courageuse de<br />
tourner l’obstacle par un élargissement de son horizon intellectuel, la plongée dans de<br />
nouvelles lectures, la révision de ses propres pensées, on ne saurait manquer la<br />
discrétion dont lui-même faisait preuve, même à l’égard de ses proches, et c’est dans<br />
ses livres qu’il faut retrouver, comme en filigrane, des confidences qui ne sont rien<br />
moins qu’anecdotiques, mais révélatrices de nouvelles dispositions mentales. Cette<br />
situation entraîne Bachelard à la distinction d’une raison constituée correspondant à<br />
l’acquis des connaissances scientifiques et d’une raison constituante désignant « le<br />
75
nouvel esprit scientifique ». Celui-ci requiert une pédagogie orientée vers le refus des<br />
intuitions premières, du réalisme chosiste, ou des certitudes définitives, pédagogie qui<br />
développe le sens du problème, de la complexité et de l’abstraction croissantes.<br />
Bachelard ne veut pas plus critiquer que justifier. Il veut élucider. Certes, ses<br />
explications révèlent sous l’objectivité la subjectivité, sous la stabilité, la fragilité. Mais<br />
Bachelard ne cherche pas à détruire ce dont il découvre la fragilité (subjectivité). Même<br />
si la connaissance dégénère en probabilité, la probabilité n’est pas l’ignorance ni le<br />
doute. La science est pour Bachelard un fait dont il tente de rendre compte, de même la<br />
poésie.<br />
76
CONCLUSION GENERALE
L’originalité d’un Bachelard, aussi difficile à tolérer par les rêveurs<br />
exclusivement épris de leur propre subjectivité que par les esprits scientifiques ou les<br />
philosophes tournés vers la seule objectivité du monde, c’est de soutenir la thèse que<br />
l’homme doit et peut accéder à l’humanité en se confrontant avec l’objectivité et en<br />
reconnaissant aux mondes imaginaires une réalité d’un autre type que celle du perçu,<br />
mais non moins consistante. Bachelard, notons-le, veut constituer une ontologie de<br />
l’image et, pour ce faire, il faut commencer par respecter son propre être, l’appréhender<br />
dans sa singularité, et le saluer comme le produit d’une création, au même titre que<br />
d’autres produits de l’activité humaine. Sartre avait tenté dans l’Imaginaire 106 de<br />
préciser les caractéristiques structurales de l’image ; mais sa phénoménologie de<br />
l’imagination se réfère constamment, et presque malgré elle, à une phénoménologie de<br />
la perception, et l’image demeure finalement le substitut d’une perception irréalisable.<br />
Au fond, pour Sartre, l’imaginaire n’a pas d’existence propre, elle représente un moyen<br />
spécifiquement humain d’évoquer ou de modifier par le projet notre rapport au monde<br />
de la perception et de l’action. Comme l’écrit Patiente : « pour Alain, l’image était<br />
erreur sur le perçu ; pour Sartre, elle devient neutralisation du perçu. 107 »<br />
En rappelant que l’image avec Bachelard, participe véritablement à une<br />
ontogénèse de la conscience, il faut dire que cette conception de l’imagination permet<br />
d’envisager la création artistique comme une métaphysique instantanée, au lieu d’être<br />
dispersée dans la durée : « …Elle doit donner une vision de l’univers et le secret d’une<br />
âme, un être et des objets tout à la fois 108 . »Dans ce cas, la dualité du sujet et de l’objet<br />
est « irisée, miroitée, sans cesse active dans ses inversions 109 ». Même dialectique du<br />
sujet et de l’objet, qui s’incarne dans la plénitude instantanée du projet, à propos du<br />
travail scientifique ; car l’instant (le temps qu’on utilise) est celui de l’invention ou de<br />
la découverte, celui de l’éclosion des idées. Mais à noter que ces instants qui ponctuent<br />
la vie de l’esprit ne sont que la rançon d’une polémique constante et toujours<br />
inachevée, d’une tension de l’esprit et du réel. Dès l’Essai sur la connaissance<br />
approchée, où la raison était opposée à l’image vivante et foisonnante, Bachelard ne<br />
pouvait se résoudre ni à accepter une conception dualiste de la connaissance, ni à<br />
106<br />
Jean Paul Sartre, L’Imaginaire, Paris, Gallimard, 1940.<br />
107<br />
Art. Cité, p.7.<br />
108<br />
« Instant poétique et instant métaphysique » in Messages, tome I, Cahier num.2, 1939, p.2 8.<br />
109<br />
Gaston Bachelard, La Poétique de l’Espace, p.4.<br />
78
ésorber entièrement cette opposition à l’intérieur du développement<br />
rationnel. « L’intérieur même du concept chez les esprits les plus géométriques,<br />
écrivait-il, est encore envahi par les images. La besogne n’est jamais finie de<br />
débarrasser ces formes de la matière originelle que le hasard y avait déposée » 110 .Mais<br />
à cette date, il considère cette aura irrationnelle du concept comme une nécessité dont<br />
le philosophe doit tenir compte, ou comme une difficulté supplémentaire ; plus tard, il<br />
l’accueillera comme un bienfait intellectuel, car cette tension du concept et de l’image<br />
réveille le dynamisme de l’esprit, de l’imagination, source de toutes les erreurs, certes,<br />
mais aussi point de départ de toutes les vérités.<br />
Si comme on l’a souligné précédemment que Bachelard, dans sa double<br />
investigation, réunissait la méthode psychanalytique et la méthode phénoménologique,<br />
il faut apporter une précision quant à ces expressions, ce d’autant plus que notre auteur<br />
tourne plutôt le dos à la psychanalyse freudienne comme à la phénoménologie<br />
husserlienne.<br />
En effet, sans songer à sous-estimer l’influence profonde que le freudisme et la<br />
psychanalyse exercèrent sur le développement de sa pensée et sa méthodologie, il faut<br />
bien admettre, que la souplesse d’esprit de Bachelard et la ductilité de sa fonction<br />
imageante s’opposent à la rigidité de la systématique freudienne, à sa rationalisation<br />
qui explique les rêves en faisant accéder l’inconscient au seuil de la conscience, qui<br />
conceptualise les symboles. Cette inversion de sens de la psychanalyse bachelardienne<br />
par rapport à celle du Maître de Vienne a été mise en valeur avec une particulière<br />
netteté lorsque l’on sait en les expliquant que, la psychologie analytique tue l’image<br />
qu’elle réfère, sinon à des conditionnements instinctuels, du moins à des situations<br />
infantiles. Mais il faut distinguer, voire opposer, la rationalisation et le rationalisme. La<br />
seconde démarche consiste à comprendre ce que, à l’inverse, la première se borne à<br />
nier…L’anthropologue, l’ami de l’homme, doit entrer dans les images, y séjourner, en<br />
ressusciter l’animation, mais la psychologie, dédaigneuse de l’onirisme, le tient bientôt<br />
pour un mensonge et lui substitue ses propres interprétations. Elle remplace le symbole<br />
par l’idée. C’est là le péché majeur pour Bachelard, sourcier de l’imagination ou<br />
historien des sciences. Car si, l’image poétique ou le symbole animiste sont presque<br />
toujours un obstacle à l’explication rationnelle d’un phénomène scientifique,<br />
110 Idem, Essai sur la connaissance approchée, Paris, VRIN, 1928, p. 23.<br />
79
l’épistémologue ne doit pas les éliminer en les remplaçant par un concept transparent à<br />
l’intelligence, mais les tenir en réserve dans un recoin de sa conscience, pour se livrer,<br />
le cas échéant, à la psychologie de la dépsychologisation des concepts. De même que<br />
les erreurs sont nécessaires à la recherche de la vérité et les échecs à la formation du<br />
caractère, les images littéraires ou les rêveries substantialistes, consciemment<br />
travaillées ou agies, révèlent leur positivité et leur efficacité, même dans les entreprises<br />
intellectuelles, à condition de n’être ni transformées en idées ni évidemment<br />
confondues avec elles. En commentant la trouvaille de Bachelard de placer sa poétique<br />
sous le signe des quatre éléments d’Empédocle, son éditeur et ami José Corti écrivait :<br />
« Freud a psychanalysé bien de patients. Il a étendu sa méthode à la psychologie<br />
collective. Il n’aurait pas songé à psychanalyser un objet. » 111 C’est là en effet un coup<br />
d’audace unique dans l’histoire de la pensée de notre siècle, que même les admirateurs<br />
et disciples de Bachelard n’entérinent pas sans peine. Bachelard, pour montrer une fois<br />
de plus la divergence de sa ligne de recherches par rapport à celle de Freud dira : « un<br />
symbole psychanalytique, pour protéiforme qu’il soit, est cependant un centre fixe, il<br />
incline vers le concept ; c’est en somme avec assez de précision un concept<br />
sexuel…L’image est autre chose. L’image a une fonction plus active. 112 » Il s’agit, bien<br />
sur, de l’image matérielle, car l’image formelle est inerte, souvent réductible à un<br />
cliché littéraire, elle ne « dit » rien à l’imagination rêvante. La recherche et la<br />
thérapeutique freudiennes sont orientées par la découverte de la réalité sous l’image,<br />
celle-ci n’étant qu’un moyen de décrypter celle-là. Mais alors :<br />
Elle oublie la recherche inverse : sur la réalité, chercher la<br />
positivité de l’image…Trop souvent, pour le psychanalyste, la<br />
fabulation est considérée comme cachant quelque chose. Elle est<br />
une couverture. C’est donc une fonction secondaire. 113<br />
A sa psychanalyse d’un nouveau genre, Bachelard a donné le nom de poético-<br />
analyse. Certes, il n’ignore pas le succès de certaines thérapeutiques à base de<br />
psychanalyse et l’intérêt de l’explication de certaines images pour dénouer de sourdes<br />
angoisses insurmontées, mais elles n’offrent aucun intérêt pour celui qui analyse la<br />
rêverie. Le dynamisme de l’image vécu dans la rêverie de l’eau, de la terre, de l’air ou<br />
111 José Corti, in Les Temps modernes, numéro39, p.115<br />
112 Gaston Bachelard, La Terre et les Rêveries de la volonté, p.20.<br />
113 Ibidem, p. 20.<br />
80
du feu, ne relève pas de l’homme historico-social ou de l’homme biologique, mais de<br />
l’homme qui dépasse toutes ses déterminations, toutes ses limitations. Comme<br />
quoi, « la psychanalyse étudie une vie d’évènements, une vie qui n’engrène plus sur la<br />
vie des autres. 114 »<br />
Ainsi, prendre le feu ou se donner au feu, anéantir ou s’anéantir, suivre le<br />
complexe de Prométhée ou le complexe d’Empédocle, tel est le virement<br />
psychologique qui convertit toutes les valeurs, qui montre aussi la discorde des valeurs.<br />
Comment mieux prouver que le feu est l’occasion, au sens très précis de Carl Gustav<br />
Jung, d’un complexe archaïque fécond et qu’une psychanalyse spéciale doit en détruire<br />
les douloureuses ambiguïtés pour mieux dégager les dialectiques alertes qui donnent à<br />
la rêverie sa vraie liberté et sa vraie fonction de psychisme créateur.<br />
L’imagination n’est donc pas, comme le suggère l’étymologie, la faculté de<br />
former des images de la réalité ; elle est la faculté de former des images qui dépassent<br />
la réalité, qui chantent la réalité. Elle est une faculté de surhumanité. Un homme est un<br />
homme dans la proportion où il est un surhomme. On doit définir un homme par<br />
l’ensemble des tendances qui le poussent à dépasser l’humaine condition. Une<br />
psychologie de l’esprit en action est automatiquement la psychologie d’un esprit<br />
exceptionnel, la psychologie d’un esprit qui tente l’exception : l’image nouvelle greffée<br />
sur une image ancienne. L’imagination invente plus que des choses et des drames, elle<br />
invente de la vie nouvelle, elle invente de l’esprit nouveau ; elle ouvre des yeux qui ont<br />
des types nouveaux de vision. Elle verra si elle a des « visions ». Elle aura des visions<br />
si elle s’éduque avec des rêveries avant de s’éduquer avec des expériences, si les<br />
expériences viennent ensuite comme des preuves de ses rêveries, comme le dit<br />
d’Annunzio, les évènements les plus riches arrivent en nous bien avant que l’âme s’en<br />
aperçoive. Et, quand nous commençons à ouvrir les yeux sur le visible, déjà nous étions<br />
depuis longtemps adhérents à l’invisible. Cette adhésion à l’invisible, voilà la poésie<br />
première, voilà la poésie qui nous permet de prendre goût à notre destin intime…la<br />
vraie poésie est une fonction d’éveil 115 .<br />
Il s’agit précisément, en ce qui concerne l’imagination pour l’Afrique en général et le<br />
Cameroun en particulier, de revoir sa mentalité extrêmement superstitieuse, de se<br />
114 Idem, La Poétique de la rêverie, p. 110.<br />
115 Idem, L’Eau et les Rêves, PP 23-24<br />
81
préoccuper plus de la recherche scientifique. Comme l’a si bien remarqué njoh mouelle<br />
dans la préface de De la Médiocrité à l’Excellence, il ne fait nul doute que « dans<br />
l’imagerie nécessairement vague du sous développé, le développement signifie<br />
automobiles pour tous, réfrigérateurs, machines à laver,… » 116 Notre penchant à<br />
l’imagination, en ce qu’elle est croyance aux pseudo-savoirs, est à revoir et à remettre aux<br />
mythes et légendes lorsqu’elle peut servir à l’éducation des enfants. Dans le cas contraire,<br />
l’extirper dans nos mentalités. C’est ce que préconise Njoh Mouelle lorsqu’il affirme :<br />
Le spectacle le plus affligeant en situation de sous-développement c’est<br />
celui de l’irrationalité dans le comportement de l’homme. A Douala, on<br />
meurt rarement de mort naturelle et la maladie elle-même ne nous vient<br />
point par le microbe, par exemple ; c’est nécessairement le résultat de la<br />
malveillance d’une tierce personne. La crise cardiaque est un<br />
phénomène inacceptable ; on lui préfère l’explication par la foudre<br />
nocturne et occulte déchainée par un oncle, un frère qu’on dit détenir le<br />
« pouvoir de la foudre » 117 .<br />
A tout prendre, il s’agit pour l’africain de retenir que la science est seule à<br />
promouvoir, il n’y a rien à gagner en voulant s’affirmer par une identité<br />
différentielle et subjective plus mystique que dogmatique, ce d’autant plus<br />
que par sa visée de l’objectivité et son souci de dégager des explications à portée<br />
universelle(…) la production des connaissances scientifiques se soucie de se<br />
démarquer, pour les corriger, des aventures hasardeuses de la pure subjectivité<br />
individuelle, ils s’inscrivent dans la lignée d’une communauté de pensées,<br />
d’option, d’orientation et de pratique partagées qu’on nomme « cité<br />
scientifique » 118 .<br />
116<br />
Ebenezzer Njoh Mouelle, De la médiocrité à l’excellence, Yaoundé, Éditions CLE, 1970.p.4.<br />
117<br />
ibidem, p.30.<br />
118<br />
Manga Bihina Antoine, « Invention scientifique et affirmation de l’individu », in L’individuel et le collectif,<br />
édité par Belle Wangue Thérèse, Paris, Danoia, 2004. P.202.<br />
82
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES DE BACHELARD :<br />
I- Ouvrage principal<br />
BACHELARD, GASTON, La Psychanalyse du feu, Paris, Gallimard, 1949.<br />
II-Autres ouvrages de l’auteur<br />
° Essai sur la connaissance approchée, Paris, VRIN, 1928.<br />
° Le Nouvel Esprit Scientifique, Paris, ALCAN, 1934.<br />
° La Formation de l’esprit scientifique, Paris, VRIN, 1938.<br />
° Lautréamont, Paris, José Corti, (Nouvelle édition<br />
augmentée, 1951. – Nouvelle édition, 1963), 1940.<br />
° La Philosophie du non, Paris, PUF, (4 e édition, 1966),<br />
1940.<br />
° L’Eau et les Rêves, Paris, José Corti, (6 e réimpression,<br />
1965), 1942.<br />
° L’Air et les songes, Paris, José Corti, (5 e réimpression,<br />
1965) 1943.<br />
° La Terre et les Rêveries de la volonté, Paris, José Corti,<br />
(4 e réimpression, 1965)1948.<br />
° Le Matérialisme rationnel, Paris, PUF, (2e édition,<br />
1963), 1953.<br />
° La poétique de l’espace, Paris, PUF, (4 e édition, 1964),<br />
1957.<br />
° La Poétique de la rêverie, Paris, PUF, (3 e édition, 1965),<br />
1960.<br />
84
OUVRAGES ET ARTICLES SUR BACHELARD :<br />
• SCHEELE, GUILLAUME CHARLES, Traité chimique de l’air et du feu, trad.,<br />
Paris, 1781.<br />
• MARGOLIN, JEAN CLAUDE, Bachelard, Paris, Seuil, 1974.<br />
• GINESTIER, PAUL., Pour connaître la pensée de Gaston Bachelard, Bordas,<br />
1968.<br />
• LECOURT, DOMINIQUE., l’épistémologie historique de Gaston Bachelard, Paris,<br />
VRIN, 11 è éd., 2002.<br />
• « Noumène et Microphysique » in Recherches philosophiques, Paris, 1931-1932, I,<br />
p. 55-65. (Réédité dans Études, 1970, pp.25-43), 1932.<br />
• « Le monde comme caprice et miniature » in Recherches philosophiques, III, 1933-<br />
1934, p.306-320. (Réédité dans Études, pp.25-43),1934.<br />
• « Lumière et Substance » in Revue de métaphysique et de morale, Paris, juillet<br />
1934(41), p343-366. (Réédité dans Études, pp.45-75).<br />
• « Logique et épistémologie » in Recherches philosophiques, Paris, 1936-1937(6),<br />
pp.410-413.1936.<br />
• « La psychanalyse de la connaissance objective » in Études philosophiques,<br />
Annales de l’École des hautes études de Gand, t. III, pp.3-13.<br />
OUVRAGES GENERAUX :<br />
• EBOUSSI BOULAGA, FABIEN, La Crise du Muntu, Paris, Présence africaine,<br />
1977<br />
• HUME, DAVID, Enquête sur l’entendement humain, Paris, VRIN, 2008.<br />
• Traité de la nature humaine, Paris, Aubier Montaigne, 1968.<br />
• JASPERS, KARL, Introduction à la philosophie, Paris, Seuil, 1932.<br />
• KURT SELIGMANN, Histoire des magies, Paris, Planète, (sans date).<br />
• KANT EMMANUEL, Critique de la raison pure, Paris, PUF, 1963.<br />
• KARDINER ABRAM, L’Individu dans sa société, Paris, Gallimard, 1969.<br />
• LEVI-STRAUSS, Les Structures élémentaires de la parenté, Paris, PUF, 1949.<br />
85
• LOCKE JOHN, Essai sur l’entendement humain, Paris, VRIN, 1972.<br />
• NJOH-MOUELLE, EBENEZZER, De la Médiocrité à l’Excellence, Yaoundé,<br />
CLE, 1970.<br />
• PONTY MAURICE MERLEAU, La Phénoménologie de la perception, Paris,<br />
N.R.F. 1945.<br />
• SARTRE JEAN PAUL, L’Existentialisme est un humanisme, Paris, Nagel 1946.<br />
• L’Imaginaire, Paris, Gallimard, 1940.<br />
<strong>MEMOIRE</strong>S ET THESES.<br />
• LEWONO NGAH, V., « De La Conversion philosophique chez Gaston<br />
Bachelard », mémoire de D.E.A., Cameroun, U.Y.I, 2002.<br />
• MANGA BIHINA A., « Les Transmutations des valeurs épistémologiques dans la<br />
philosophie de Gaston Bachelard », mémoire de Maîtrise, France,<br />
Université de Tours, 1971.<br />
• YAKOUBOU, B.-M., « Matérialisme constitué et rationalisme constituant : une<br />
approche épistémologique de l’esprit de la modernité à partir des<br />
œuvres de Gaston Bachelard », thèse Ph. D., Cameroun, U.Y.I,<br />
2007.<br />
86
TABLE DES MATIERES<br />
DEDICACE ...................................................................................................................... i<br />
REMERCIEMENTS ...................................................................................................... ii<br />
RESUME ....................................................................................................................... iii<br />
ABSTRACT ................................................................................................................... iv<br />
INTRODUCTION GENERALE ................................................................................... 1<br />
PREMIERE PARTIE : LES FORMES DE CULTURE HUMAINE : L’ORIGINE<br />
DES VALORISATIONS ................................................................................................ 7<br />
SECTION A: LA MAGIE OU LE PROBLEME DES ASPIRATIONS DE LA PENSEE<br />
HUMAINE ..................................................................................................................... 10<br />
SECTION B: FEU, SUBSTANCE ET VALEUR : LA METAPHYSIQUE DU FEU ................. 17<br />
SECTION C : FEU, DESIR ET VOLONTE : LE PROBLEME DE LA CULTURE HUMAINE . 25<br />
DEUXIEME PARTIE : LES SCIENCES DE LA MATIERE : DE<br />
L’IMAGINAIRE A LA REALITE ............................................................................. 31<br />
SECTION A : L’INFERENCE : CRISE DE L’OBSERVATION IMMEDIATE ET DE LA RAISON34<br />
SECTION B : EMPIRISME, RATIONALISME ET IMAGINATION : LE PROBLEME DE<br />
L’EXPLICATION PHENOMENALE .................................................................................. 43<br />
SECTION C : SCIENCE, MYTHE, COMPLEXE ET PHENOMENOLOGIE : LE PROBLEME DE<br />
LA PSYCHANALYSE ...................................................................................................... 49<br />
TROISIEME PARTIE : L IMAGINATION BACHELARDIENNE DANS<br />
L’ORDRE DES DISTINCTIONS ............................................................................... 55<br />
SECTION A: LA POETIQUE BACHELARDIENNE OU LA FONCTION DE L’IRREEL ........ 58<br />
SECTION B : PHILOSOPHIE, SCIENCE ET IDEOLOGIE : LA RUPTURE<br />
EPISTEMOLOGIQUE ...................................................................................................... 64<br />
SECTION C : ACTUALITE ET RE-EVALUATION ......................................................... 71<br />
CONCLUSION GENERALE ...................................................................................... 77<br />
BIBLIOGRAPHIE ....................................................................................................... 83<br />
TABLE DES MATIERES ........................................................................................... 87<br />
87