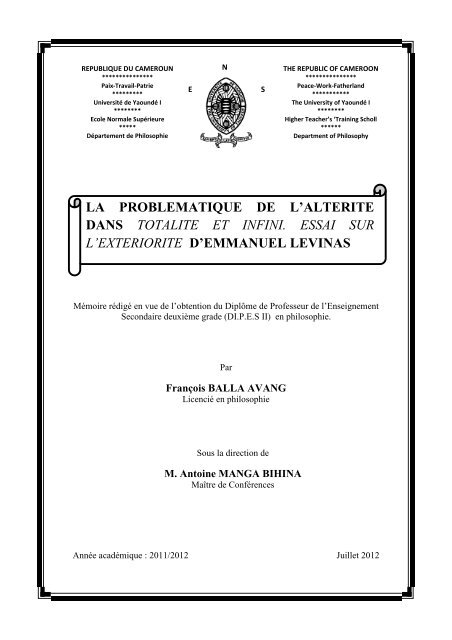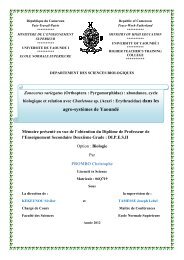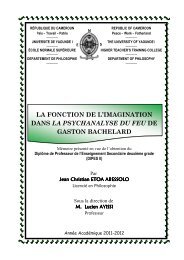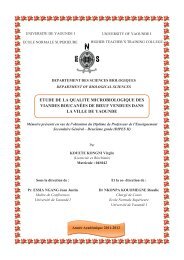MEMOIRE BALLA AVANG - L'ENS
MEMOIRE BALLA AVANG - L'ENS
MEMOIRE BALLA AVANG - L'ENS
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
REPUBLIQUE DU CAMEROUN<br />
***************<br />
Paix-Travail-Patrie<br />
*********<br />
Université de Yaoundé I<br />
********<br />
Ecole Normale Supérieure<br />
*****<br />
Département de Philosophie<br />
N<br />
E S<br />
LA PROBLEMATIQUE DE L’ALTERITE<br />
DANS TOTALITE ET INFINI. ESSAI SUR<br />
L’EXTERIORITE D’EMMANUEL LEVINAS<br />
Mémoire rédigé en vue de l’obtention du Diplôme de Professeur de l’Enseignement<br />
Secondaire deuxième grade (DI.P.E.S II) en philosophie.<br />
Par<br />
François <strong>BALLA</strong> <strong>AVANG</strong><br />
Licencié en philosophie<br />
Sous la direction de<br />
M. Antoine MANGA BIHINA<br />
Maître de Conférences<br />
THE REPUBLIC OF CAMEROON<br />
***************<br />
Peace-Work-Fatherland<br />
***********<br />
The University of Yaoundé I<br />
********<br />
Higher Teacher’s ‘Training Scholl<br />
******<br />
Department of Philosophy<br />
Année académique : 2011/2012 Juillet 2012
A mon feu père, Gilbert Dieudonné <strong>BALLA</strong> OMGBA.<br />
II
REMERCIEMENTS<br />
Qu’il me soit permis de présenter ici mes remerciements à tout un petit monde de<br />
personnes qui ont rendu possible la présente étude et qui ont contribué à son élaboration sous<br />
quelque forme que ce soit.<br />
Je tiens tout d’abord à remercier monsieur Antoine MANGA BIHINA qui, malgré les<br />
prérogatives qui sont siennes, a accepté sans réserve, de diriger ce mémoire. Merci pour la<br />
confiance et la liberté qu’il m’a donné dans le choix de mon thème de recherche. Je tiens à lui<br />
exprimer ici toute ma gratitude pour sa grande disponibilité et ses précieux conseils tout au<br />
long de ces années.<br />
Je tiens fermement à mentionner le plaisir que j'ai eu à étudier à l'Ecole Normale<br />
Supérieure de Yaoundé. J'en remercie ici le Directeur, monsieur Nicolas Gabriel ANDIGA,<br />
pour son hospitalité durant ces deux dernières années. Je pense également à tous les<br />
enseignants du département de philosophie dont les cours ont pleinement éclairé cette étude.<br />
Merci éternellement à mon adorable mère, Marguerite AGON-<strong>BALLA</strong>, à celle qui est<br />
toujours présente et continue de l’être pour faire mon bonheur. Merci pour t’être sacrifiée<br />
pour que tes enfants grandissent et prospèrent. Merci de trimer sans relâche, malgré les<br />
péripéties de la santé, de la vie, au bien-être de tes enfants. Merci aussi à ma sœur chérie, à<br />
l’unique sœur que j’ai au monde, Françoise <strong>BALLA</strong> MBARGA. Merci d’être toujours à mes<br />
côtés, par ta présence, par ton amour et par ton attention.<br />
Merci à ma femme, Marie Thérèse BEYALA qui a su être discrètement mais réellement<br />
présente à mes côtés tout au long de ce travail, qui a souvent supporté mon manque de<br />
disponibilité et a su ranimer ma motivation les quelques fois où elle faiblissait. Merci à ma<br />
fille, Germaine-Iranie <strong>BALLA</strong> MFOUMOU pour les nombreuses fois où elle m’a fait sentir<br />
son réel intérêt pour la réussite de mon travail malgré le temps qu’il nous prenait sur notre vie<br />
familiale.<br />
Je remercie mes frères, Alexis <strong>BALLA</strong> et Marc-Antoine <strong>BALLA</strong> ETENDE pour leur<br />
sincère encouragement et soutien indéfectible. Aucun mot sur cette page ne saurait exprimer<br />
ce que je vous dois, ni combien je vous aime.<br />
III
Je ne manquerais pas non plus de dire un grand merci à ma tante, Marie Dieudonné<br />
EDOA-<strong>BALLA</strong>, qui a cru en moi, m'a encouragé et m'a donné la force d'aller jusqu'au bout.<br />
Merci pour ta disponibilité, ton énergie et ta sympathie généreuse malgré les contrées qui<br />
nous séparent.<br />
Mes remerciements vont également à mes amis, Alain-Michel NTOUZO’O et Narcisse<br />
OUAFO FOSSO qui ont eu l’amabilité de discuter avec moi sur certains points clés de mon<br />
analyse, leurs remarques pertinentes m’ont amené à repenser ma position et à réviser bien des<br />
points.<br />
Je tiens chaleureusement à remercier mon très cher camarade de lycée Oumarou SALLY<br />
et mes collègues, Fils SANAMA SANAMA, Valery MBA, Jean-Pierre WESSAMBO et tous<br />
ces lecteurs et correcteurs de l’ombre, qu’ils trouvent ici l’expression de toute ma gratitude.<br />
Enfin, je tiens à exprimer mes vifs remerciements au DIEU TOUT-PUISSANT qui m'a<br />
toujours soutenu, protégé et orienté.<br />
IV
RESUME<br />
Le présent mémoire est une investigation – à travers les champs de la métaphysique et<br />
l’éthique d’Autrui – sur la problématique de l’altérité dans Totalité et Infini d’Emmanuel<br />
Levinas. L’enjeu est de proposer une méta-éthique, une philosophie première du sujet en tant<br />
qu’il est d’emblée sujet éthique. Cette dernière aboutit à la mise en relief d’une pensée de<br />
l’Autrement qu’être aiguillonnée par l’idée de l’Infini, de bonté et de responsabilité incessible<br />
pour Autrui qui conduit nécessairement à l’avènement d’un monde humainement viable dans<br />
lequel l’Autre préserve son altérité radicale. Il ne s’agit aucunement ici de revenir à<br />
l’humanisme des Lumières, de définir l’homme par rapport aux pouvoirs de sa raison, mais au<br />
contraire de dépasser cette alternative historique en donnant sens à l’humain à partir de sa<br />
faiblesse, de la nudité de son visage, nudité qui exprime son étrangeté au monde, son<br />
isolement, la mort, voilée dans son être. Cette révolution implique que ce n’est pas la relation<br />
du Moi avec l’Etre qui est première, parce qu’on peut mettre l’Etre entre parenthèse, c’est<br />
plutôt la relation du Moi avec l’Autre qui est première car on ne peut se passer de l’autre<br />
homme. La relation à Autrui est expérience éthique par excellence. Néanmoins c'est<br />
l’asymétrie entre Autrui et Moi, qui constitue la conscience morale. L’Autre en tant que<br />
faible, veuve, orphelin, étranger et pauvre est plus important que moi. Se priver d’Autrui n’est<br />
rien d’autre que mettre en œuvre une pensée de la violence, une civilisation du plus avoir, de<br />
l’en-sauvage-ment qui est source de chaos. Levinas supplante la « Totalité » par « l’Infini » et<br />
advient à l’éveil de l’Autre par le « bonjour ! » qui précède toute pensée, toute aliénation,<br />
toute prise sur soi et sur le monde. En conséquence, le soi n’est pas essence mais hospitalité,<br />
réponse et responsabilité. La justice est Désir de l'extériorité qui conduit à la vérité. Elle me<br />
contraint d'aller au-delà de la droiture de la loi, dans l’univers de la bonté, là où la<br />
responsabilité inonde, dans un effort sempiternel qui m’affranchira de tout penchant égoïste<br />
afin de m’ouvrir à l’humanité en me vouant à Autrui. Cette réflexion sur l’altérité se dévoile<br />
comme le négatif - ou plutôt le positif - de l’archétype occidental mondialisé. Elle laisse<br />
augurer que le développement du monde pourrait se réaliser sous une autre forme, plus saine,<br />
moins destructrice, plus prudente, plus humaine. L’éthique n’est donc pas un mode de l’être,<br />
il est autrement et mieux qu’être, l’éventualité même de l’au-delà, l’instant dans lequel l’être<br />
s’éprouve en son autre, en son altérité pour ne plus rester tel, mais au-delà, après l’Autre. La<br />
paix que l’humanité recherche tant passe nécessairement par l‘enseignement de l’éthique<br />
d’Autrui, car cette dernière par delà toute certitude manifeste la structure de l’extériorité<br />
même. Mais, cette paix n’est possible que si elle va d’un homme vers un autre, uniquement si<br />
elle se traduit dans une relation de face-à-face et asymétrique, dans une relation fraternelle,<br />
dans une relation pédagogique d’otage et d’hôte, dans l’assujettissement et le sacrifice infini<br />
de soi pour les autres. Tel est l’enseignement que nous croyons avoir reçu de notre périple<br />
herméneutique.<br />
Mots clés : Métaphysique, méta-éthique, l’Autrement qu’être, visage, l’en-sauvage-ment,<br />
Totalité, Infini, responsabilité, altérité, paix.<br />
V
ABSTRACT<br />
This dissertation is an investigation – through the areas of metaphysics and ethics for<br />
Others - on the problematics of otherness in Totality and Infinite by Emmanuel Levinas. The<br />
stake is to provide a meta-ethics, a first philosophy of the subject as an ethical subject. The<br />
philosophical analysis end up in an enhancement of the thought otherwise than being spurred<br />
on the idea of the Infinity, goodness and responsibility non-negotiable for Others which will<br />
necessarily lead to advent humanely better world where the Other one maintains his radical<br />
otherness. In this case it is not at all about going back to the humanism of Enlightenments nor<br />
to define the human being in proportion to the power of his mind but to go beyond that<br />
historical option by giving a meaning to the human being from their weakness his face,<br />
bareness that expresses his oddness, the bareness of in the world, his seclusion, death, veiled<br />
in his being. This revolution means that the relationship between the Ego and the Being is<br />
secondary - because the Being can be put between parentheses - but what is primary turns out<br />
to be the relationship between the Ego and others since one cannot do without others. The<br />
relationship with the other people is the real ethical experience. Nevertheless, the asymmetry<br />
between Others and the Ego is what nurtures moral conscience. Others, whoever they are:<br />
weak, widow, orphan, foreigner and poor, are more important than I am. Getting rid of the<br />
Other one is similar to building a thought of violence, a form of culture prioritizing the<br />
accumulation of more assets, the back to barbarism that is source of chaos. Levinas replaces<br />
the « Totality » with the « Infinite » and triggers the awakening of Others by means of<br />
the « good morning! » that comes before any thought, any self alienation, any control over the<br />
world consequently the oneself is not the essence but hospitality response and responsibility.<br />
The justice is Desire of exteriority that leads to the truth, its compels me to go beyond the<br />
exigency of the law, in the world of goodness flooded by responsibility in an everlasting<br />
effort will free me from every selfish propensity in order to open me up to the world by<br />
devoting myself to the Other one. This study of the otherness turns to be negative - or the<br />
positive - of the universalized western archetype. What makes us foretell that the world<br />
development may made in a different way, healthier, more balanced, less destructive, more<br />
advisable : more humane. The ethics is not therefore a method of the being, it is otherwise and<br />
better than being, the eventuality even of hereafter, the moment when the being improves<br />
himself, through his otherness for a change, but beyond and behind the Other one. The peace<br />
that the world is longing for will pass obviously through the teaching of the ethics, of the<br />
otherness, for this latest upwards all certainty displays clearly the structure of exteriority<br />
itself. But, this peace will be possible only if it goes from one man to another, solely if it is<br />
rendered in a face to face and asymmetric relationship, in a fraternal relationship in a<br />
pedagogic relationship between a hostage and a host, in a spirit of subjugation and oneself<br />
endless sacrifice for others. Such is the teaching that we believe we have acquired through our<br />
hermeneutic expedition.<br />
Key-words: Metaphysics, meta-ethics, the otherwise than being, savagery/primitivism,<br />
totality, infinite, responsibility, otherness, peace.<br />
VI
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
INTRODUCTION GENERALE<br />
« La vrai vie est absente ». Mais nous sommes au<br />
monde. La métaphysique surgit et se maintient dans<br />
cet alibi. Elle est tournée vers l’« ailleurs », et<br />
l’« autrement », et l’« autre ».<br />
Emmanuel Levinas, Totalité et Infini. Essai sur<br />
l’extériorité, Deuxième édition, Martinus Nijhoff, La<br />
Haye, 1965, p.3<br />
1
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Notre ère a vu le visage de l’autre homme se volatiliser derrière de multiples<br />
déterminations biologiques, sociales et linguistiques que les sciences ont mises en lumière :<br />
c’est la mort de l’homme proclamé par Michel Foucault 1 . L’ambition particulier de la<br />
rationalité occidentale de faire de l’homme comme de toutes choses un objet de science, de<br />
l’englober dans un système, dans la « totalité » de l’être et du savoir, a eu précisément pour<br />
effet de le détruire. La pensée en Occident s'est efforcée de comprendre l'Autre en général,<br />
pour le ramener à soi, pour l'assimiler au « Même ». L’oubli et la négation de l’Autre,<br />
l’exploitation du tiers, les violences effectuées par la puissance technoscientifique, le déni<br />
d’une existence humaine, traduisent le meurtre de l'autre homme. Nous pensons ainsi à<br />
l’esclavage dans l’antiquité, à la traite négrière, à Auschwitz, à l’impérialisme occidentale, au<br />
capitalisme et aujourd’hui au parasitisme postcolonialisme, qui ne cessent de causer de<br />
nombreux morts dans le monde. Cette volonté de domination, d’asservissement, de prendre<br />
l’Autre sur le plan de la pensée, dans l’optique de le ramener à soi est le déploiement de la<br />
violence occidentale qui trouve, d’après Levinas, son aboutissement extrême dans le génocide<br />
hitlérien. La recherche disproportionnée et outrageuse du pouvoir, l’autoritarisme et leur<br />
résultante, l’ensauvagement conduisant jusqu’au mépris de la vie d’Autrui sont les maîtres<br />
mots qui ont signifié les conduites humaines au cœur de l'histoire. Le drame de la shoah,<br />
l’incapacité de la philosophie occidentale à enrayer l'extermination permanente de milliers<br />
êtres humains, pose des interrogations capitales. Peut-on encore philosopher aujourd'hui ?<br />
Comment penser l’homme et dans quel sens ? Quelle signification donner à notre être au<br />
monde ? Peut-on enrayer l’ensauvagement qui perturbe l’existence humaine ? Comment<br />
penser l’altérité aujourd’hui ?<br />
Emmanuel Levinas 2 est une victime de la barbarie du XX e siècle. Né en Lituanie en 1906,<br />
puis nationalisé français en 1931, il est fait prisonnier de guerre par les allemands en 1940 et<br />
gardé en captivité pendant cinq ans dans un camp particulièrement destiné aux détenus de<br />
1<br />
Michel Foucault : « pour la pensée moderne, il n’y a pas de morale possible » ; cf. Les mots et les choses,<br />
Gallimard, Paris, 1966, p.338<br />
2<br />
« Emmanuel Levinas (12 janvier 1906 - 25 décembre 1995) est un philosophe français d'origine lituanienne, né<br />
à Kaunas et naturalisé français en 1930. Il a reçu dès son enfance une éducation juive traditionnelle,<br />
principalement axée sur la Torah. Il a été plus tard introduit au Talmud par l'énigmatique « Monsieur<br />
Chouchani ».<br />
Levinas a profondément été influencé par Edmund Husserl et Martin Heidegger, qu'il a rencontrés à l'Université<br />
de Fribourg et dont il a introduit l'œuvre en France, notamment les Méditations Cartésiennes de Husserl dont il a<br />
assuré la traduction. Son travail philosophique a également été marqué par la tradition juive, et par la condition<br />
juive elle-même, Levinas ayant été interné dans un camp de prisonniers juifs durant la Seconde Guerre mondiale.<br />
L'enseignement philosophique d'Emmanuel Levinas est aujourd'hui mené au sein de l'Institut d'Études<br />
Levinassiennes, fondé en l'an 2000 par les philosophes Benny Lévy, Alain Finkielkraut et Bernard-Henri Lévy ».<br />
Cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Levinas<br />
2
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
guerre juifs. Levinas rappelle rarement ses cinq années de séquestration dans un Stalag en<br />
Allemagne. Pourtant, ces écrits montrent qu’il a été profondément touché par la violence<br />
nazie qu’il traduit par ces termes : racisme dirigé contre les juifs. Sa pensée serait donc<br />
incompréhensible si on l’éloigne de son expérience personnelle qu’il définit lui-même dans<br />
son texte Difficile liberté comme « dominée par le pressentiment et le souvenir de l’horreur<br />
nazie » 3 . Son expérience repose sur une existence bourrée d'affects très variés, sur des faits<br />
traumatiques non désignés. C’est en pleine seconde guerre mondiale, dans ses « Carnets de<br />
captivité », que le philosophe juif, prisonnier du Stalag, au matricule II6078, s’est efforcé de<br />
penser au-delà de l’expérience inhumaine à laquelle il fut confronté. Dans ses deuxièmes<br />
« Ecrits sur la captivité », il affirme que c’est durant ces moments d’atrocité qu’il a appris « la<br />
différence entre avoir et être […]. Le peu d’espace et le peu de choses qu’il faut pour vivre.<br />
[…] la liberté ». C’est donc sur la base de son expérience de la guerre et des camps nazies,<br />
que Levinas décontenance la philosophie de la « totalité », de l’être pour la supplanter par la<br />
philosophie de l'Autre. Face à l’impérieuse responsabilité d’enseigner aux générations futures<br />
l’histoire, Levinas s'efforce de porter sur l'histoire du monde et sur ce qu’il a vécu un exposé<br />
sans inimitié ni rancœur. Certes, il n’a pas été à Auschwitz, à l’exception de sa femme et de<br />
ses filles, réfugiées chez les sœurs de Saint Vincent de Paul, toute sa famille restée en<br />
Lituanie fut tuée. Pour Levinas, survivre est une faveur élogieuse. Dans cet ajournement de la<br />
mort, le rescapé de la guerre réalise l'expérience d'une liberté qui s’aperçoit responsable de<br />
l'autre homme de manière infinie et non-réciproque : notre responsabilité envers l’Autre est<br />
inconditionnelle, et c’est précisément cette incommensurable inconditionnalité face à Autrui<br />
qui fonde l’humanité de l’Homme.<br />
L’œuvre d’Emmanuel Levinas représente une des tentatives les plus rigoureuses de notre<br />
siècle pour répondre au problème de l’ensauvagement du XX e siècle qui se perpétue<br />
aujourd’hui sous des formes diverses. La pensée levinassienne n’est pas qu’une simple<br />
théorisation de l’existence ou une simple phénoménologie 4 de l’avenir, mais une philosophie<br />
du vécu, du transcendant et du concret, dépassant le vice pour culminer dans un monde<br />
humainement viable. Levinas est auteur de plusieurs textes, mais l’essentiel de ses thèses est<br />
3 Levinas, Difficile liberté, Albin Michel, coll. “ Présence du judaïsme ”, nouvelle édition aug. Paris, 1976, 3 e<br />
édit. 1983, 4 e édition 1995, 5 e édition 2006, p.406<br />
4 Dans son article « Homo philophicus », Marie-Anne Lescourret définit la phénoménologie comme « la fin de<br />
l’illusion scolastique ». Marie-Anne Lescourret, « Homo philosophicus », Joëlle Hansel, ed., Levinas : de l’Un à<br />
l’Autre, Presse universitaire de France, Paris, 2006<br />
3
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
exposé dans Totalité et Infini 5 , ouvrage principal autour duquel se bâtira l’essentiel de notre<br />
discours. Dans ce texte, il montre que la présence d’Autrui, et plus singulièrement celle du<br />
visage d’Autrui qui appelle la conscience morale à refuser toute violence à l’égard de l’Autre,<br />
est une expérience fondamentale que méconnaissent les philosophies de la Totalité dont<br />
l’activité principale est la réduction de l’« Autre » au « Même ». Levinas précise dans ce texte<br />
que ce désir de totalisation de l’Autre par le model ontologique existe depuis l’antiquité, et<br />
plus précisément avec Socrate, où le processus de la connaissance consiste à ramener<br />
l’inconnu au connu, le différent au « Même » 6 . Connaître ontologiquement, c'est trouver en<br />
quoi la chose 7 n'est plus cet étant spécifique, original et dès l'abord unique, correspond par<br />
quelque aspect, qu'on favorise, à toute une série d'autres pour former des ensembles appelés<br />
catégories ou espèces. Sous la variété, l’homme veut découvrir l'identité du genre à travers<br />
l’entremise : du « concept » avec la dialectique de Hegel, « l’intentionnalité » avec la<br />
phénoménologie de Husserl et le souci de l'« être » de l'étant chez Heidegger. Le défaut de ce<br />
processus de fusion, qui est la base du savoir, est que l’Autre, en tant qu'étant original, se<br />
trouve désagrégé, dissous, dépersonnalisé, banalisé, aphasique et objectivé dans l’univers du<br />
« Même ». Cette tendance à vouloir absorber toutes les différences en dissolvant toute altérité<br />
ne permet pas le véritable dialogue. C’est notamment ce refus de l’altérité, de l’existence de<br />
l’Autre, cette expansion de la liberté totalisante et égoïste du « Moi » qui est la cause première<br />
de l’ensauvagement que vit l’humanité aujourd’hui. Déjà à partir de cette articulation du<br />
problème, on peut constater que la relation à l’Autre est marquée par un paradoxe, car bien<br />
que l’altérité apparaisse comme une occasion offerte à chacun d’ouvrir une infinité de<br />
possible au sein de la communauté, elle nous confronte également et simultanément à un<br />
exercice contraire au « bon sens » 8 en excitant pratiquement notre aversion.<br />
Notre propos est, dans ce travail, d’examiner l’apport philosophique d’Emmanuel Levinas<br />
à la notion d’alterias 9 , de montrer que la reconsidération de ce concept est la clé fondamentale<br />
pour l’avènement d’un monde humainement viable qui passe nécessairement par la<br />
supplantation de l’« ontologie » par la « métaphysique » ; car, l’altérité est la reconnaissance<br />
5 Levinas, Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, Martinus Nijhoff, La Haye, 1961<br />
6 Levinas, Totalité et infini, Op cit., p.16<br />
7 La chose qu’il faut comprendre dans ce texte comme l’« Autre »<br />
8 Descartes, Discours de la méthode, Nathan, Paris, 1 ère parution en 1984<br />
9 « Altérité : 1697 ; ‘’changement’’ XIV e , bas latin alterias. Philo Fait d’être autre, caractère de ce qui est autre.<br />
‘’La communauté ne serait rien si elle n’ouvrait celui qui s’y expose à l’infini de l’altérité’’ (Blanchot)<br />
‘’Altérité est le concept le plus antipathique au ‘’ bon sens ‘’ (Barthes). Contr. identité.<br />
Autre : quelqu’un quelque chose de différent. Altruis 1080.<br />
Autrui : Un autre, les autres hommes. » Cf. Le nouveau Petit Robert, Paris, 2000<br />
4
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
de l’Autre dans l’essence de sa différence, contrairement à l’identité qui, sous le prisme de<br />
l’ontologie réduit le différent au « Même ». Le fait d'être autre chez Levinas est le début de la<br />
médiation interrelationnelle qui est source de dialogue et de paix. L’altérité détermine donc<br />
toute relation, tout dialogue, toute transcendance vers l’Etre. Elle détermine nos relations<br />
interhumaines que nous avons quotidiennes tendance à annihiler, à ignorer ou à ensauvager, et<br />
pourtant c’est dans cette conscientisation de l’altérité que les relations peuvent s’améliorer,<br />
s’humaniser, s’hominiser davantage. Ce projet a pour dessein de restaurer à l’homme son<br />
humanité, cette humanité qui tend à se perdre dans des relations totalisantes, symétriques et<br />
sauvages. Cette réflexion nous permettra de connaitre l’impact du langage dans notre rapport<br />
à Autrui et pourquoi « l’unité de la pluralité » est source de paix. Nous verrons à partir de<br />
cette étude que la paix que recherche tant l’humanité est possible, mais cette paix n’est<br />
possible que si elle part d’un individu vers un autre « dans le désir et la bonté où le moi, à la<br />
fois se maintien et existe sans égoïsme » 10 . L’harmonie sociale se trouve donc dans la<br />
responsabilité de l’Autre, dans la négation d’appréhender l’altérité de l'Autre en général, pour<br />
le réduire à soi, pour l'assimiler au « Même ».<br />
Pour mieux mener nos recherches, nous centrerons notre travail dans le domaine de<br />
l’éthique, en tant que philosophie première, qui nous permettra de montrer que la conscience est<br />
originellement conscience morale – conscience de l’Autre – et non pas conscience intentionnelle<br />
comme cela parait chez Husserl 11 . C’est plus précisément à partir de l’éthique d’Autrui que nous<br />
éclaircirons le sujet que nous nous sommes proposés à savoir : « La problématique de<br />
l’altérité dans Totalité et Infini. Essai sur l’altérité d’Emmanuel Levinas ».<br />
Dans ce travail, nous utiliserons la méthode analytico-herméneutique qui nous permettra<br />
d’examiner de fond en comble la pensée d’Emmanuel Levinas pour en saisir la problématique<br />
de l’altérité afin d’aboutir à la résolution du problème de la reconnaissance de l’Autre en tant<br />
qu’autre dans sa rencontre avec le Même. Rencontre qui d’après Levinas remet le Même en<br />
cause et ouvre à la transcendance. Pour ce fait, nous avons opté pour un plan dialectique.<br />
Dans un premier temps nous examinerons la question du statut de l’Autre. Notre dessein ici<br />
sera de montrer comment la question de l’Autre dans son rapport avec l’Etre a été traitée dans<br />
l’histoire, plus particulièrement dans l’histoire de la philosophie occidentale. Nous nous<br />
10 Ibid., p. 283<br />
11 L’éthique dans ce travail se comprendre comme philosophie première, car ici le de profundis de l’homme est<br />
l’idée de l’Infini ou comme le dit Levinas dans Autrement qu’être : « l’autre dans le même ». Cf. Levinas, « La<br />
conscience non intentionnelle », in Catherine Chalier ed., Emmanuel Levinas, l'Herne, Paris, 1991. pp.113--<br />
119.<br />
5
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
servirons principalement des thèses de Platon, de Descartes, de Hegel, de Husserl et de<br />
Heidegger vu par Levinas, ces thèses nous permettrons également de situer la pensée<br />
levinassienne par rapport à l’histoire de la philosophie. Ensuite dans un second temps, nous<br />
parlerons de l’éthique de l’altérité. Nous allons examiner avec Levinas les voies de possibilité<br />
d’une relation éthique entre des êtres absolument séparés. Enfin dans la dernière partie de ce<br />
travail, nous examinerons la question de l’altérité sur le plan pédagogique. Il sera plus<br />
précisément question pour nous de présenter la dimension pédagogique de l’altérité, de<br />
montrer l’importance de l’extériorité dans l’enseignement et sa participation pour l’avènement<br />
d’un monde humainement viable<br />
6
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
PREMIERE PARTIE :<br />
LE SATUT DE L’AUTRE<br />
« La singularité ne peut trouver place dans la totalité. »<br />
Emmanuel Levinas, Totalité et Infini. Essai sur<br />
l’extériorité, Deuxième édition, Martinus Nijhoff, La<br />
Haye, 1965, p.221<br />
7
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Introduction partielle<br />
Totalité et Infini est un discours continûment en face-à-face avec ce que Levinas appelle<br />
« la philosophie occidentale ». Certainement, notre auteur n’est pas toujours d’une inclémence<br />
radicale avec les auteurs dont il examine les pensées, néanmoins il a cette majestueuse valeur<br />
de recueillir de manière synthétique le soubassement de la pensée occidentale, qui n’est rien<br />
d’autre que l’instance souveraine du Même. Sa thèse principale est que tout le discours<br />
occidental s'est engagé dans une activité réductionnelle visant à comprendre l'Autre en<br />
général, pour le réduire à soi, pour l'assimiler au Même. Cette volonté de com-prendre,<br />
d’empoigner l’Autre sur le plan de la pensée, dans le but de le réduire à soi, se base sur le fait<br />
que dans la connaissance comme dans l'action, l’altérité apparait comme ce qui est contraire<br />
au sujet et que le sujet doit forcement objectiver, dominer pour se l'approprier afin d’assurer<br />
sa sécurité. Cette logique d’appropriation est le propre de l’ontologie où le différent est<br />
totalisé, désagrégé et absorbé dans l’univers du Même. Certes, la Nature promeut la<br />
différence, mais cette dernière ne s’effectue qu’à l’intérieure de la « Totalité ». Il existe dans<br />
la réalité une assimilation mutuelle de l’altérité et de l’identité. Les réalités par conséquent<br />
sont des fusions, des hybrides, des croisements de Même et d’Autre ; c’est pourquoi sous le<br />
prisme de l’ontologie, elles peuvent être connues et inclues dans un même système où l'unité<br />
englobe le différent. Cette articulation du problème veut précisément signifier qu’il<br />
n’existerait pas d’identité absolue, comme en logique, car si tel était le cas tout serait<br />
indistinct, on ne comprendrait pas pourquoi l’univers renferme autant de genres, ce serait<br />
comme si on voulait produire une musique avec une seule note. Mieux, il n’existerait pas de<br />
« Totalité », car pour qu'il existe une totalité, il est nécessaire qu'il soit la cohésion d’une<br />
diversité. De même si l’altérité était absolue, tout serait morcelé, désorganisé, séparé,<br />
fragmenté selon la représentation grecque du chaos 12 . C’est pour protéger l’univers du chaos<br />
que la philosophie occidentale depuis Socrate s’est activée à penser les contraires ensembles,<br />
à démystifier l’inconnu, à ordonner et à cosmiser l’Univers en englobant le divers dans<br />
« l’Un » au sens plotinien. Sous la multiplicité, l'esprit humain veut connaitre l'unité du genre<br />
à travers la médiation. Mais comment s’est opérée cette médiation dans l’histoire et quelles en<br />
sont les conséquences ? Peut-on véritablement parler d’altérité dans la Totalité ? Le rapport à<br />
l’Autre se fait-il dans l’unité du divers ou dans la séparation ? Une existence en dehors de<br />
l’Être est-elle possible ?<br />
12 Dans la représentation du chaos, l’altérité fait éclater la diversité.<br />
8
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
CHAPITRE I : PHILOSOPHIE DE LA TOTALITE<br />
La philosophie occidentale, d’après Levinas, est par essence une philosophie impérialiste<br />
dominée par l’idée de Totalité. Comme il le dit lui-même dans sa préface de Totalité et Infini :<br />
« La face de l’être qui se montre dans la guerre se fixe dans le concept de totalité qui domine<br />
la philosophie occidentale » 13 . L’idée de totalité ne parcourt pas la philosophie occidentale,<br />
mais elle la « domine ». Il s’agit de surplomb et de dictature qui s’exerce au moyen de<br />
l’ontologie qui met entre parenthèse la relation avec l’Autre pour accorder la primauté à la<br />
relation avec l’Etre ; relation dans laquelle la domination de l’être sensible se manifeste grâce<br />
à l’idée de totalité. Le Même dans la tradition philosophique occidentale est unique et absolu,<br />
commande, ordonne, gouverne et maitrise toute existence. Notre dessein dans ce premier<br />
chapitre est de montrer qu’effectivement l’ontologie occidentale est une philosophie<br />
impérialiste et destructrice ; par sa tension identificatrice, elle absorbe toute réalité en<br />
dissolvant toute altérité dans la Totalité. Pour mieux étayer nos propos, nous nous servirons<br />
des pensées de Socrate selon Platon, de Hegel, de Husserl et de Heidegger tel que cela parait<br />
dans Totalité et Infini 14 .<br />
I. Réduction conceptuelle et totalité hégélienne<br />
1. Réduction conceptuelle<br />
La tradition philosophique occidentale selon Levinas trouve dans la réduction de la<br />
séparation son thème propre et son dessein principal. L’incapacité à maintenir la paix et à<br />
conserver l’altérité dans la relation entre le Même et l’Autre, représente simultanément la<br />
marque caractéristique et la limite de cette pensée qui, par-delà les millénaires, trouve encore<br />
dans le logos grec le lieu de sauvegarde et de sa puissance propre.<br />
Dans la philosophie occidentale, les rivalités entre le Même et l’Autre ont été résolues<br />
grâce à la théorie – localité où, par le concept, l’Autre est réduit au Même. La théorie signifie<br />
le « […] - logos de l’être – c’est-à-dire une façon telle d’aborder l’être connu que son altérité<br />
13 Levinas, « Préface », in Totalité et Infini, Deuxième édition, Martinus Nijhoff, La Haye, 1965, p. X.<br />
14 Nous précisons qu’il n’est pas question pour nous de faire une analyse complète de la pensée de ces auteurs,<br />
notre travail ici se limite dans la compréhension de ces auteurs à travers Totalité et Infini.<br />
9
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
par rapport à l’être connaissant s’évanouit » 15 . L’activité de la connaissance se confond à ce<br />
niveau au pouvoir du chercheur qui ne trouve rien sur son chemin pouvant l’empêcher de<br />
réaliser son dessein. Cette façon de procéder prive l’être connu de son altérité et ceci n’est<br />
possible que par l’usage d’« un troisième terme – terme neutre – qui lui-même n’est pas un<br />
être » 16 . C’est sur lui que s’adoucira la confrontation entre le Même et l’Autre. Ce troisième<br />
terme peut se manifester comme un « concept pensé ». La conséquence ici est que « l’individu<br />
qui existe abdique alors dans le générale 17 » et dissout dans la généralité il perd son identité.<br />
Le primat du Même définit la philosophie occidentale restée astreinte à son origine<br />
parménidienne dans laquelle se manifeste l’être-le-même.<br />
La réduction conceptuelle est le mode principal des philosophies de la totalité, elle<br />
consiste à réduire le divers à l’unité, à englober toute forme d’altérité dans le Tout. L’Autre,<br />
en tant qu'étant particulier, se trouve liquéfié et objectivé dans le Même. La philosophie<br />
occidentale depuis l’antiquité s’est manifestée comme une ontologie : une activité totalisante<br />
visant « une réduction de l’Autre au Même, par l’entremise d’un terme moyen et neutre qui<br />
assure l’intelligence de l’être » 18 . Cette suprématie du Même fut la doctrine de Socrate qui<br />
pense qu’il ne faut rien admettre de l’Autre que ce qui est en nous, comme si nous possédions<br />
éternellement ce qui provient de l’extérieur. La liberté ici ne renvoie pas au libre arbitre :<br />
« son sens ultime tient à cette permanence dans le Même, qui est la raison » 19 . La raison étant<br />
unique et identique est également ce par quoi les choses acquièrent sens et signification. Le<br />
savoir est la manifestation de cette identité qui est liberté. Le fait que la raison soit finalement<br />
l’exercice d’une liberté, paralysant l’Autre en le totalisant, n’est pas susceptible d’étonner,<br />
depuis qu’il fut admit que la raison libre ne connait que son propre pouvoir et qu‘aucun<br />
élément externe ne peut freiner son activité. L’assimilation de l’Autre comme « thème ou<br />
objet » se fait par la voie de l’ontologie ; or connaître ontologiquement, c'est découvrir ce en<br />
quoi la chose ou l’Autre n'est plus cet étant original et unique, cependant correspond par<br />
quelque aspect, qu'on favorise, à toute une série d'autres pour former des groupes appelés<br />
catégories ou espèces. Connaitre ontologiquement, c’est ôter à l’étant ce qu’il a de<br />
particulier 20 . Chez les choses, la connaissance ontologique s’exprime à travers « la<br />
conceptualisation ». Chez les hommes, elle peut se manifester par la violence systématique<br />
15 Ibid., p.13<br />
16 Ibid., p.13<br />
17 Ibid<br />
18 Ibid., p.12<br />
19 Ibid., p.14<br />
20 Ibid.<br />
10
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
destinée à imposer un pouvoir qui pousse un homme libre à s’asservir par un autre. « Pour les<br />
choses, l’œuvre de l’ontologie consiste à saisir l’individu non pas dans son individualité, mais<br />
dans sa généralité » 21 . La relation avec l’Autre ne se réalise qu’à partir d’un troisième élément<br />
que « je trouve en moi » à partir de l’exercice de ma raison. L’idéal de la vérité socratique se<br />
trouve donc sur l’orgueil du Même, sur son égotisme, sur son narcissisme. Dans cet élan, la<br />
philosophie occidentale apparait comme « une égologie » centrée exclusivement sur le Même<br />
limité par la seule raison<br />
L’ontologie comme contemplation de l’être, asphyxie l’étant pour le connaitre. « La<br />
relation avec l’être, qui se joue comme ontologie, consiste à neutraliser l’étant pour le<br />
comprendre ou pour le saisir. Elle n’est donc pas une relation avec l’autre comme tel, mais la<br />
réduction de l’Autre au Même » 22 . En fait, il ne s’agit pas d’une relation éthique, mais de<br />
l’impérialisme du Même sur l’Autre, c’est une forme de totalisation qui se manifeste par la<br />
violence. La liberté dans l’ontologie consiste à se greffer sur l’Autre afin de garantir<br />
l’autosuffisance d’un Moi. « La thématisation et la conceptualisation, d’ailleurs inséparables,<br />
ne sont pas paix avec l’Autre, mais suppression ou possession de l’Autre. La possession, en<br />
effet, affirme l’Autre, mais au sein d’une négation de son indépendance » 23 . La connaissance<br />
présente l’Autre, mais en tant qu’être assimilé, impersonnel et « neutre ». « Je pense »<br />
signifie j’ai le pouvoir de m’emparer de ce qui existe et de tirer profit de la réalité comme bon<br />
me semble. L’ontologie comme philosophie première, est une philosophie de la force, de la<br />
puissance et la violence. « Elle aboutit à l’Etat et à la non-violence de la totalité, sans se<br />
prémunir contre la violence dont cette non violence vit et qui apparait dans la tyrannie de<br />
l’Etat » 24 . La vérité qui doit réunir les hommes existe ici mais sous une forme inconnu.<br />
« L’universalité se présente ici comme impersonnelle et il y a là une autre inhumanité », parce<br />
que les hommes sont banalisés, dépersonnalisés, flottants, sans originalités et absorbés dans le<br />
Tout. L’existence dans le Même d’après Levinas est « impersonnelle, neutre », la<br />
reconnaissance de l’Autre en tant qu’autre est absente. Cette méconnaissance de l’altérité par<br />
la réduction conceptuelle apparait également dans la philosophie de « l’Esprit » hégélien.<br />
Hegel, lu par Levinas, y avère également sa négation de l’altérité d’autrui.<br />
21 Ibid.<br />
22 Ibid., p.16<br />
23 Ibid.<br />
24 Ibid.<br />
11
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
2. Totalité hégélienne<br />
L’œuvre Totalité et Infini d’Emmanuel Levinas, de par son titre et ses divisions, manifeste<br />
une réelle influence de l’hégélianisme. Mais avant Levinas, Franz Rosenzweig dans son<br />
Etoile de la Rédemption critique la tentative d’élucidation de la totalité de l’univers à partir<br />
d’un seul principe dont tout le reste devrait être une expression comme le fait Hegel. Il<br />
oppose à « l’Esprit » hégélien une « pensée nouvelle » dans laquelle la « Révélation» est<br />
d’une utilité capitale. D’ailleurs dans la préface de son œuvre critique de la « Totalité »,<br />
Levinas reconnait l’apport conceptuel de son prédécesseur juif 25 qui, d’après Catherine<br />
Chalier, « avait expliqué comment l’idée même de Révélation traverse la philosophie en<br />
faisant éclater la totalité ». Au lieu d’exhiber des vérités incompréhensibles, la Révélation<br />
chez Rosenzweig : « oriente la pensée par une Parole immémoriale, irréductible au concept et<br />
au dogme. Cette Parole s’adresse à des singularités elles-mêmes non déductibles d’un<br />
quelconque concept et elle implique de penser positivement la séparation: comme condition<br />
de la vie en alliance » 26 . D’après Rosenzweig, le concept de Totalité dans la philosophie<br />
d’Hegel est englobant, car il annexe l’ensemble de tous les éléments de la réalité dans un<br />
système. Cette logique d’assimilation est gouvernée par la raison totalisante car chez Hegel,<br />
l’existence est l’unité du particulier et de l’universel. Levinas est d’avis avec Rosenzweig sur la<br />
critique de la totalité, puisqu’il pense que cette logique d’extension et de com-préhension<br />
gouvernée par « l’Esprit » qu’on peut déceler dans les lignes de la Phénoménologie de<br />
l’Esprit de Hegel est, la marque par excellence de l’ensauvagement de l’humanité, puisqu’elle<br />
traduit la négation de l’altérité de l’autre.<br />
Les individus s’y réduisent à des porteurs de forces qui les commandent à leur<br />
insu. Les individus empruntent à cette totalité leur sens (invisible en dehors de<br />
cette totalité). L’unicité de chaque présent se sacrifie incessamment à un avenir<br />
appelé à en dégager le sens objectif. Car seul le sens ultime compte, seul le<br />
dernier acte change les êtres en eux-mêmes. Ils sont ce qu’ils apparaîtront dans<br />
les formes, déjà plastiques, de l’épopée 27 .<br />
Dans la totalité hégélienne, les hommes sont assimilés à des objets, ce sont des comédiens,<br />
des clowns qui se déploient comme des jouets dans l’histoire, car ils sont anonymes,<br />
impersonnels comme les forces dont ils sont « porteurs ». Il s’agit ici de l’anonymat, comme<br />
cela parait dans De l’existence à l’existant à travers le concept de « l’il y a » : l’être en<br />
25 « L’opposition à l’idée de totalité, nous a frappé dans le Stern der Erlösung de Franz Rosenzweig, trop souvent<br />
présent dans ce livre pour être cité ». Cf. Levinas « Préface », in Totalité et Infini, Op Cit., p. 14.<br />
26 Catherine Chalier, « révélation et totalité », in Revue internationale de philosophie, 2006/1 - n° 235, p.3<br />
27 Levinas, « Préface », in Totalité et Infini, Op Cit., p. X<br />
12
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
général - « l’exister sans existant » 28 - l'être dans son silence absolu, dans toute « non-<br />
pensée », dans toute façon de s’extraire de l'existence est précisément le climat de l’ontologie<br />
qui se dégage à travers la philosophie hégélienne. Dans De l’existence à l’existant 29 , Levinas<br />
critique radicalement cet exister impersonnel, qui dépersonnalise le Moi, cet emprise de<br />
l’exister sur l’existant. D’après ses propres propos « le frôlement de l’il y a, c’est l’horreur» 30 ,<br />
la protection de l’altérité de l’autre passe donc par l’arrachement de l’il y a qui conduit<br />
nécessairement le sujet à mener une existence pure et autonome en dehors de l’Etre. La<br />
conscience d’après Levinas est le premier évènement qui permet de se séparer de l’horreur et<br />
de l’emprise de l’il y a, car : « Etre conscience, c'est être arraché à l'il y a, puisque l'existence<br />
d'une conscience constitue une subjectivité, puisqu'elle est sujet d'existence c'est-à-dire, dans<br />
une certaine mesure, maîtresse de l'être, déjà nom, dans l’anonymat de la nuit » 31 . La<br />
conscience 32 par son renouvellement préserve sa stabilité en vertu de sa localisation.<br />
Levinas n’est pas également d’accord avec Hegel sur le rapport entre la totalité et le<br />
temps, ou encore entre l’idée de synchronie et de diachronie. Pour le penseur juif, le temps<br />
ne se comprend pas « comme l’horizon de l’être de l’étant, mais comme mode de l’au-delà de<br />
l’être, comme relation de la pensée à l’Autre et – à travers diverses figures de la socialité en<br />
face du visage de l’autre homme […] – comme relation du Tout Autre, au Transcendant, à<br />
l’Infini » 33 . Le temps est la relation du sujet à Autrui. Il ne s’agit pas d’une relation constituée<br />
28<br />
L’il y a désigne « l’être en général » dans sa manifestation qui est « absolument impersonnel », absolu, dans<br />
toute « non-pensée », il phénoménalise l’acte d'être sans être – « l’exister sans existant » - l'être dans son silence<br />
absolu, dans toute « non-pensée », dans toute façon de s’extraire de l'existence. L’il y’a dans Le temps et l’autre<br />
de Levinas se apparait comme : « Quelque chose qui n’est ni sujet, ni substantif. Le fait de l'exister qui s'impose,<br />
quand il n'y a plus rien. Et c'est anonyme : il n'y a personne ni rien qui prenne cet existence sur lui. C'est<br />
impersonnel comme « il pleut », où « il fait chaud ». Cf. Levinas, « Le temps et l’autre », in le Choix, le monde,<br />
l’existence. Cahier du Collège philosophique, Paris, Arthaud, 1947 p. 26.<br />
29<br />
Dans De l’existence à l’existant, l’il y a est le sujet initial, l’être anonyme dont survient l’être humain, or dans<br />
Totalité et Infini, le tableau est inversé : l’abîme de l’il y a incite l’angoisse d’un sujet heureux antérieurement<br />
formé, peur permettant la possibilité de la rencontre qui se manifeste comme « révélation » ou « épiphanie » de<br />
l’Autre.<br />
30<br />
Levinas, De l’existence à l’existant, Ed. de la Revue Fontaine, Paris, 1947 ; Deuxième éd., Vrin, Paris, 1977, p.<br />
98.<br />
31<br />
Ibid.<br />
32<br />
D’après Levinas, la représentation d’une conscience établie en dehors de l’espace élaborée par l’idéalisme est<br />
inacceptable. Au contraire, la conscience est foncièrement localisée. « Elle sort d’une protubérance, d’une tête »,<br />
ou, comme le dit René Descartes de « façon admirablement précise », je suis une chose qui pense et non un être<br />
abstrait perdu dans l’air, non pas une « conscience de la localisation » mais une « localisation de la conscience ».<br />
C’est uniquement à partir de cette localisation, qui est ma base, que je peux parvenir à des vérités éternelles et<br />
universelles. Cette extraterritorialité est une maison qui nous donne la possibilité de nous reposer, dormir, fuyant<br />
de ce fait à la veille impersonnelle de l’insomnie de l’il y a. L’instant ne renvoie pas ici au passé ni à l’avenir,<br />
l’endroit ne renvoie à aucun horizon, il n’est pas à comprendre comme élément de l’espace ou du monde mais<br />
exclusivement comme la base sur laquelle repose la conscience.<br />
33<br />
Levinas, Le temps et l’Autre, Quadrige/Presse universitaire de France, 1991, p.8<br />
13
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
sur le mode du savoir, ou plus exactement l’intentionnalité 34 , car cette dernière contient la<br />
« re-présentation » et réduit l’Autre au simple phénomène et à « la co-présence ». Et pourtant,<br />
le temps dans sa « dia-chronie » 35 , désigne une relation qui n’altère pas « l’altérité de<br />
l’autre », tout en assurant sa « non-indifférence à la ‘’pensée’’ » 36 . La relation dans le temps<br />
se manifeste comme rapport avec ce qui ne se laisse pas « com-prendre » dans l’expérience,<br />
relation avec « l’In-visible » dans lequel « l’invisibilité » 37 résulte. Bref, la totalité est<br />
synchronique 38 - concerne des faits qui se passent dans le même temps et le futur y joue le rôle<br />
de synthèse, d’assimilation des instants du temps, Levinas montre après Husserl que leur<br />
nature est de passer. Le sens et la signification de l’intention se trouve dans l’acte et celui du<br />
présent se trouve dans l’avenir. Levinas évoque Hegel au niveau du jugement de l’histoire 39 ,<br />
mais il lui oppose l’idée eschatologique du jugement dont le jugement de l’histoire existerait «<br />
à tort » 40 dans la rationalisation.<br />
Historiquement […] l’eschatologie de la paix messianique viendra superposer<br />
à l’ontologie de la guerre. L’eschatologie met en relation avec l’être, par delà<br />
la totalité ou l’histoire, et non pas avec l’être par delà le passé et le présent.<br />
Non pas avec le vide qui entourerait la totalité et où l’on pourrait,<br />
arbitrairement, croire ce que l’on voudrait, et promouvoir ainsi les droits<br />
d’une subjectivité libre comme le vent. Elle est relation avec le surplus<br />
toujours extérieur à la totalité, comme si la totalité objective ne remplissait pas<br />
la vraie mesure de l’être, comme si un autre concept – le concept de l’infini –<br />
devait cette transcendance par rapport à la totalité, non-englobable dans une<br />
totalité et aussi originelle que la totalité 41 .<br />
Emmanuel Levinas utilise l’eschatologie messianique pour remettre en question la<br />
philosophie occidentale. Cette critique suscite une réévaluation et une redéfinition de<br />
l’histoire de l’ontologie comme une histoire ne tenant pas compte de « l’Infini » et de la<br />
transcendance de l’être; comme histoire de l’omission de l’idée de l’Infini et du concept<br />
d’extériorité, au bénéfice de la liberté totalisante – totalisant tout sur sa trajectoire comme cela<br />
se manifeste dans La philosophie de l’histoire de Hegel. L’eschatologie de la paix<br />
messianique amorce une dé-fondation radicale de l’ontologie, car toute seule, elle manifeste<br />
une herméneutique d’un au-delà de l’être et de l’histoire dans son intériorité.<br />
34<br />
Cf. L’intentionnalité husserlienne<br />
35<br />
Ibid., p.9<br />
36<br />
Ibid.<br />
37<br />
Ibid., p.10<br />
38<br />
Jean-François Rey, « Le maitre absolu : Hegel et Hobbes dans la pensée d’Emmanuel Levinas », in Revue<br />
internationale de philosophie, 2006/1 - n° 235, p. 7<br />
39<br />
Levinas, « Préface », in Totalité et Infini, op cit., p. XI.<br />
40 Ibid.<br />
41 Ibid., pp. X -XI<br />
14
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
L’eschatologie, en tant que l’au-delà de l’histoire arrache les êtres à la<br />
juridiction de l’histoire et de l’avenir – il les suscite dans leur pleine<br />
responsabilité et les y appelle. Soumettant au jugement l’histoire dans son<br />
ensemble, extérieure aux guerres mêmes qui en marquent la fin, il : restitue à<br />
chaque instant sa signification pleine dans cet instant même : toutes les causes<br />
sont mûres pour être entendues. Ce n’est pas le jugement dernier qui importe,<br />
mais le jugement de tous les instants dans le temps où l’on juge les vivants 42 .<br />
La vision eschatologique du jugement, d’après Levinas, suppose que les êtres ont une<br />
identité « avant » l’infinité, avant la fin de l’histoire ; les êtres sont certainement en relation,<br />
« mais à partir de soi et non pas à partir de la totalité » 43 . Levinas conteste l’idée selon<br />
laquelle l’histoire révèle la vérité de l’étant uniquement dans sa finalité 44 . Contre ce finalisme<br />
et cette borne historique, Levinas recherche les modalités de l’éclatement de la doctrine qui<br />
passe par le visage de l’autre. Subséquemment, dans la même lancée que Kierkegaard, il<br />
recherche les moyens d’une issue de l’histoire. Cependant, une rupture s’opère entre lui et le<br />
philosophe danois, car il ne perçoit pas la sortie de la totalité par le Même mais par l’Autre.<br />
Ce n’est pas l’étant qui se refuse à la totalité, comme le souligne Kierkegaard 45 , c’est plutôt<br />
l’Autre. La philosophie d’Hegel qui se dévoile sous la forme d’un système est une ontologie<br />
du Même, elle n’est nullement gouvernée par un principe de transcendance, par conséquent<br />
elle aboutit à un jugement raté. Le projet levinassien aura donc été de s’extraire d’un tel<br />
cercle.<br />
Le jugement de l’histoire chez Hegel se fait toujours en l’absence de la volonté - de<br />
l’Autre. « L’absence de la volonté à ce jugement consiste en ce qu’elle ne s’y présente qu’à la<br />
troisième personne […]. Le jugement de l’histoire s’énonce dans le visible » 46 . Les faits<br />
historiques représentent le visible : « Le visible forme une totalité ou y tend » 47 . Lorsque<br />
l’invisible se manifeste, l’histoire perd tout son sens. « Mais la manifestation de l’invisible,<br />
d’après Levinas, ne saurait signifier le passage de l’invisible au statut du visible. La<br />
manifestation de l’invisible ne ramène pas à l’évidence » 48 . Elle se réalise dans « la bonté<br />
réservée à la subjectivité », laquelle n’est pas uniquement subordonnée à « la vérité du<br />
42 Ibid., p. XI<br />
43 Ibid.<br />
44 Cette position levinassienne se hisse fermement contre celle de Hegel qui voit plutôt la rationalisation de<br />
l’histoire. La critique levinassienne de l’ontologie, montre que le système hégélien est un « cercle ontologique ».<br />
Cf. Hegel, Encyclopédie, paragraphe 181. Traduction M de Gandillac op. cit., p. 200<br />
45 Kierkegaard contrairement à Hegel pense que c’est l’individu qui est important et son importance est illimitée.<br />
La subjectivité est intériorité du sujet individuel, elle est réalisation spirituel du sujet : « devenir subjectif serait<br />
la plus haute tâche assignée à chaque homme ». Cf. Kierkegaard, Post-scriptum aux « Miettes philosophiques »,<br />
Ed. Gallimard, Paris, 2002, p. 144<br />
46 Levinas, Totalité et Infini, op cit., p.220<br />
47 Ibid.<br />
48 Ibid., p.221<br />
15
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
jugement », mais à l’origine de cette vérité. « La vérité de l’invisible, se produit<br />
ontologiquement par la subjectivité qui la dit. L’invisible n’est pas en effet le<br />
‘’provisoirement invisible’’ » 49 , ni ce qui pour un vue légère et brève demeure invisible, et,<br />
qu’un examen plus approfondie et plus méticuleux pourrait « rendre visible » ; ou ce qui reste<br />
inexprimé comme les mobilités dissimulés de l’esprit ; ou ce que, gracieusement et<br />
faiblement, on présente comme secret. « L’invisible, c’est l’offense qui inévitablement résulte<br />
du jugement de l’histoire visible, même si l’histoire se déroule raisonnablement » 50 . Le<br />
verdict énergétique de l’histoire, le jugement de « la raison pure » est cruel. Les règles<br />
universelles de ce procès détruisent l’unicité où se fait l’éloge et où elle détient ses<br />
preuves. L’invisible se manifestant en totalité violente la subjectivité, parce que, par essence,<br />
l’instance de l’histoire a pour dessein de manifester toute éloge en thèses perceptibles et à<br />
assécher l’origine infinie de la singularité radicale d’où ils découlent et dont aucune thèse ne<br />
pourrait contredire, « car la singularité ne peut trouver place dans la totalité » 51 . Son mystère<br />
et son altérité radicale la soustrait de toute activité totalisante.<br />
L’offense imperceptible qui résulte du verdict de l’histoire, procès sur « le visible »,<br />
certifiera la subjectivité antécédente au procès ou une négation du jugement, si elle se réalise<br />
strictement comme appel et contestation, si elle est éprouvée dans mon être. Elle se fait<br />
néanmoins :<br />
Comme le jugement même, quand elle me regarde et m’accuse dans le<br />
visage d’Autrui – dont l’épiphanie même est faite de cette offense subie, de<br />
ce statut d’étranger, de veuve et d’orphelin. La volonté est sous le<br />
jugement de Dieu lorsque sa peur de la mort, s’investit en peur de<br />
commettre un meurtre 52 .<br />
« Etre jugé » ainsi, ne veut pas dire écouter une sentence, se manifestant<br />
« impersonnellement » et fatalement à partir de règles universelles. Une parole pareille<br />
stopperait le discours direct de l’être a jugé, détruirait « l’apologie », et pourtant le procès où<br />
la défense est écoutée, devrait certifier en vérité la particularité de la volonté de l’être qui est<br />
jugé. Non pas par la complaisance, ce qui rendrait le verdict flou.<br />
49 Ibid., p.221<br />
50 Ibid<br />
51 Ibid<br />
52 Ibid., p.222<br />
52 Ibid.<br />
16
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
« L’exaltation de la singularité se produit précisément dans la responsabilité infinie de la<br />
volonté que le jugement suscite » 53 . Le jugement ne porte pas sur le « neutre », mais sur l’être<br />
exclusivement dans la mesure où il lui ordonne de « répondre ». En conséquence, un jugement<br />
qui se fait uniquement dans le Même, sans la volonté, ni la présence de l’Autre est un pseudo-<br />
jugement dépourvu de toute vérité, car la vérité se produit dans la réponse à l’appel d’une<br />
altérité. La vérité ne peut exister que si une personne est « appelée à la dire » 54 . La<br />
philosophie hégélienne sous un regard levinassien, à cause de sa claustration ontologique<br />
manifeste l’oubli de l’Autre, négation qui prend sa forme suprême dans l’Etat ou les<br />
individus, réduits au statut de « neutre », sont gouvernés et manipulés par des forces externes.<br />
En fait, la pensée hégélienne d’après Levinas n’a pas de transcendance véritable parce que<br />
le Même, ici, finit toujours par synthétiser l’instant de la négativité pour rejoindre finalement<br />
le territoire quiet de l’unité. Même si le dévoilement des instants de la conscience, un des<br />
desseins de la Phénoménologie de l’Esprit, présenterait une forme de transcendance de moi à<br />
moi ou de moi à l’Autre, il n’en demeure pas moins que par la fin, la globalisation finit<br />
toujours par l’emporter. Et pourtant, comme le dévoile l’une des parties de Totalité et Infini, à<br />
savoir : « La transcendance n’est pas la négativité ». La négativité poursuit encore le règne de<br />
la totalité puisque celui qui nie et celui qui est nié continuent de se poser ensemble, formant<br />
ainsi « un système ».<br />
La transcendance n’est pas analogue à la négativité par laquelle l’individu insatisfait<br />
conteste la modalité de sa demeure. « La négativité suppose un être installé, placé dans un lieu<br />
où il est chez soi ; elle est un fait économique au sens premier de cet adjectif » 55 . L’activité<br />
change le monde tout en prenant appuis sur le monde qu’il change. La matière qui ne change<br />
pas par le fait du travail a le soutien des matériaux. La résistance de l’activité est interne au<br />
Même. Le négateur et le nié forme une unité qui n’est rien d’autre que la totalité. Les hommes<br />
qui regrettent le fait de ne pas avoir atteint le statut qu’il aurait voulu s’oppose à leur situation<br />
tout en restant lié à leurs horizons. Le désespéré qui souhaite le néant ou une vie sans fin,<br />
décline totalement la condition de l’ici bas. « Dieu nous appelle toujours trop tôt à lui » 56 .<br />
Nous préférons l’existence d’ici bas. La mort, comme mouvement nous plongeant dans<br />
l’inconnu, marque la limite de la négativité. Cette manière de critiquer tout en se nichant dans<br />
53 Ibid.<br />
54 Ibid., p.223<br />
55 Ibid., p. 11<br />
56 Ibid.<br />
17
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
ce qu’on dément, montre les marques du Même ou du Moi. « L’altérité d’un monde refusé<br />
n’est pas celle de l’Etranger, mais de la patrie qui accueil et protège. La métaphysique ne<br />
coïncide pas avec la négativité » 57 . La négativité est inapte à la transcendance.<br />
II. L’intentionnalité husserlienne<br />
La pensée levinassienne a été vivement influencée par celles d’Edmund Husserl et de<br />
Martin Heidegger. Levinas a traduit les Méditations cartésiennes de Husserl et a consacré un<br />
ouvrage à savoir : En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger 58 , qui ont participé à<br />
la connaissance de ces deux auteurs en France. Toutefois dans cette articulation, nous allons<br />
nous articuler principalement sur la pensée de Husserl ; il s’agira plus précisément pour nous,<br />
de montrer comment cette pensée se dévoile à travers les lignes de Totalité et Infini et sa<br />
relation avec l’ontologie à travers le concept d’intentionnalité. Mais avant, nous allons<br />
d’abord brièvement situer Husserl dans l’histoire et plus précisément dans sa démarcation par<br />
rapport au « cogito » cartésien.<br />
Nous rappelons que Husserl conçoit la méthode de l’épochè, ou « réduction<br />
transcendantale » qui tout en se servant du doute cartésien, le dépasse par un fondement plus<br />
ferme, celui d’un ego 59 qui se découvre à partir de la vision et non exclusivement du<br />
raisonnement. La méthode de Husserl entre en contradiction avec celle de Descartes parce<br />
qu’elle intègre l’extériorité dans l’ego par la conscience qu’il en a : « La conscience est<br />
toujours conscience de quelque chose » 60 , la vie ne peut se concevoir en dehors de ce rapport<br />
intentionnelle aux objets. Dès lors, « l’opposition cartésienne du sujet et de l’objet se trouve<br />
dépassée par l’acte intentionnel qui, en ‘’visant’’ la chose, la constitue en objet me permettant<br />
ainsi de l’atteindre pour la connaître en tant que telle et non pas comme seule représentation<br />
mentale » 61 . Chez Husserl, il y’a un détachement, une ouverture à l’extériorité, car c’est<br />
l’individu qui, en visant et atteignant les objets leur donne sens. Mais comment cette visée<br />
intentionnelle est-elle appréciée par Levinas ?<br />
57<br />
Ibid.<br />
58<br />
Voir également le livre qu’il consacre aux deux auteurs: En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger,<br />
éd. Vrin, 2002.<br />
59<br />
Terme désignant le sujet qui pense, le sujet humain. En psychologie c’est « Le moi ».<br />
60<br />
Husserl, Psychologie phénoménologique, Ed. J Vrin, Paris 2001, p. 35<br />
61<br />
Dugros, L’événement de la rencontre de l’Autre. L’approche centrée sur la personne comme formation à<br />
l’altérité. Mémoire de Maîtrise, Sous la direction de Philippe Grauer, Université de Paris VIII, Département des<br />
Sciences de l’Education, 2004 – 2005<br />
18
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
La prétention de la philosophie husserlienne d’après Levinas est de nous orienter vers les<br />
vérités premières. Levinas présente la pensée husserlienne comme une révolution et une<br />
délivrance à l’égard de l’enferment que promeut la philosophie occidentale. Grâce au concept<br />
d’intentionnalité 62 qui « désigne ainsi une relation avec l’objet, mais une relation telle qu’elle<br />
porte en elle, essentiellement, un sens implicite » 63 , la phénoménologie husserlienne se serait<br />
exclue de l’horizon de la conception que critique ardemment Levinas. Dans cette perspective,<br />
l’intentionnalité en tant que « distance et proximité » possibilise la relation métaphysique.<br />
Mais dans un autre examen, Levinas montre que l’intentionnalité husserlienne, malgré son<br />
apport conceptuel demeure encore rivée dans l’horizon de la connaissance et de la<br />
«représentation, presque de part en part objectivante et incapable de faire droit à la<br />
transcendance radicale du rapport éthique » 64 .<br />
Levinas expose conjointement deux lectures différentes du concept husserlien<br />
d’intentionnalité. Dans la première, l’intentionnalité est « transcendance », au sens d’une<br />
ouverture à l’autre 65 . Elle débouche un au-delà de la représentation et possibilise la relation<br />
éthique, c’est le mode d’existence de toute la conscience, elle fait droit au sentiment, à la<br />
sensibilité et met en exergue les droits de la passivité contre l’activité objectivante. Mais dans<br />
une autre lecture, elle apparait comme un retour à la Totalité du Même et du mien, car<br />
l’altérité dans la relation intentionnel reste à la mesure de la conscience, du Même.<br />
Dans son texte « Philosophie et transcendance » 66 , Levinas montre que la transcendance<br />
intentionnelle n’est rien d’autre que le retour au Même. « Dans la transcendance<br />
intentionnelle dans laquelle le réel se tient en ce qu’il se donne à une pensée qui est savoir et<br />
pense à sa mesure, on est ramené au Même dans l’immanence de la pensée » 67 . Dans ces<br />
écrits, Levinas engage une réflexion très profonde au-delà de l’idée de représentation, vers<br />
l’objet qui est direction vers la connaissance. Il s’agit plus précisément de « l’Idée de l’infini<br />
hors de l’être ou de la présence » 68 .<br />
62 En phénoménologie, propriété qu'a la conscience d'être toujours conscience de quelque chose.<br />
63 Levinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, p. 180.<br />
64 Pagès, « Distance et proximité » : les deux lectures levinassiennes de l’intentionnalité », in Bulletin d'Analyse<br />
Phénoménologique, Volume 6 (2010) Numéro 8: Questions d'intentionnalité (Actes n°3)<br />
http://popups.ulg.ac.be/bap/document.php?id=433<br />
65 Nous allons évoquer cette ouverture dans la deuxième partie de notre devoir à travers le concept : « distance et<br />
proximité ». Mais il faut souligner que a proximité n’a pas un sens exclusif, elle peut traduire l’ouverture à<br />
l’autre mais également l’envahissement de celui-ci. Cependant ces deux lectures ne sont pas successives dans<br />
Totalité et Infini.<br />
66 Levinas, « philosophie et transcendance », in Altérité et transcendance, Fata Morgana, 1995.<br />
67 Pagès, « Distance et proximité » : les deux lectures levinassiennes de l’intentionnalité », Op cit. p.276<br />
68 Ibid.<br />
19
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Levinas explique que le progrès de la pensée occidentale s’articule autour du retour à<br />
l’immanence, rapatriement de la transcendance de l’infini dans l’univers et l’univers du<br />
Même. Et pourtant il précise que ces dispositions de pensée qu’il rélève déjà dans les<br />
représentations néoplatoniciennes apparaissent également « dans la thématique moderne<br />
hégélienne et husserlienne » :<br />
Ces structures marquent en effet le retour à soi de la pensée transcendante,<br />
l’identité de l’identique et du non-identique dans la conscience de soi se<br />
reconnaissant pensée infinie « sans autre » chez Hegel. Et selon un autre<br />
registre, elles commandent la « réduction phénoménologique » de Husserl où<br />
l’identité de la conscience pure, porte en elle, en guise du « je pense », entendu<br />
comme intentionnalité — ego cogito cogitatum — toute « transcendance », toute<br />
altérité : « toute extériorité » se réduit ou retourne à l’immanence d’une<br />
subjectivité qui, elle-même et en elle-même s’extériorise 69 .<br />
Les philosophies de Hegel et de Husserl sont liées à la philosophie moderne par le terme<br />
« je pense » qui assure la réunion et l’indépendance de la connaissance, « préfigurant l’unité<br />
systématique de la conscience et l’intégration au système et au présent ou à la synchronie —<br />
ou à l’intemporel — du système, de tout ce qui est autre » 70 . Le terme, « je pense » d’après la<br />
compréhension levinassienne exprime d’abord l’idée d’unité du Même dans laquelle toute la<br />
connaissance se suffit. Levinas pense que dans la conscience non-intentionnelle, les pensées<br />
de Hegel et de Husserl apparaissent comme deux théories de la satisfaction et de la<br />
connaissance assurée. Chez ces deux auteurs, le savoir objectivant et thématisant assure la<br />
mesure de l’intention, car : « Le psychisme du savoir théorétique constitue une pensée qui<br />
pense à sa mesure et, dans son adéquation au pensable, s’égale à elle-même, sera conscience<br />
de soi. C’est le Même qui se retrouve dans l’Autre. L’activité de la pensée a raison de toute<br />
altérité […] » 71 .<br />
Dans sa lecture de la phénoménologie husserlienne, Levinas montre que le savoir chez cet<br />
auteur est « intentionnalité : acte et volonté » 72 . D’après Levinas, Husserl expose dans sa<br />
théorie de l’intentionnalité une volonté ayant la capacité de se représenter – une volonté de<br />
l’emprise. L’intentionnalité apparait comme une « pensée qui se dé-pense à représenter ou à<br />
maîtriser la présence » 73 . Ceci est possible parce que l’être qui se manifeste est donation. Le<br />
monde serait celui des objets offerts dans un monde offert, l’univers des objets qui sont sous<br />
69<br />
Levinas, « Philosophie et transcendance », in Altérité et transcendance, op cit., pp. 27-34-55<br />
70<br />
Ibid.<br />
71<br />
Idem, « La conscience non intentionnelle », in Entre nous, Essais sur le penser-à-l’autre, Grasset, Paris, 1991,<br />
pp. 144<br />
72<br />
Idem, « Philosophie et transcendance », in Altérité et transcendance, op cit., p. 55 et p. 36.<br />
73 Ibid., p. 37.<br />
20
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
la main. Le travail de la main, l’acte de la prise, de la saisie, relève de la gestion économique<br />
de l’être. Il s’agit ici de l’acquisition des choses qu’on dépose dans sa demeure – chose<br />
transformée en avoir. Or, « La main prend et comprend, elle reconnait l’être de l‘étant,<br />
puisque c’est de la proie et non pas de l’ombre qu’elle saisit et, à la fois, le suspend, puisque<br />
l’être est son avoir » 74 . La main n’est pas uniquement le lieu où se déploie notre énergie, elle<br />
parcourt l’insondable de l’élément, « en suspend les imprévisibles surprises », renvoie la<br />
satisfaction où elle menace déjà. Le travail de la main, l’acte de la prise, de la saisie, relève de<br />
la gestion économique de l’être. Le pouvoir de la main conduit à la possession or « Posséder,<br />
c’est maintenir certes la réalité de cet autre qu’on possède, mais en suspendant précisément<br />
son indépendance » 75 .<br />
Face à cette dérive occidentale, Levinas demande à la modernité et à Husserl si : « la<br />
pensée ne pense-t-elle que comme investissement de toute altérité […] » 76 ? Contrairement à la<br />
philosophie occidentale qui pense que « la pensée est fondamentalement savoir, c’est-à-dire<br />
intentionnalité — volonté et représentation — qu’il s’agit de tracer quelques limites » 77 ,<br />
Levinas pense plutôt que la pensée peut approcher l’absolu dans un sens contraire à la<br />
connaissance. Nous exposerons cette articulation levinassienne dans la deuxième partie de<br />
notre travail.<br />
Dans son texte Altérité et transcendance, Levinas réexamine l’acte intentionnel et<br />
l’intentionnalité telle que cela parait dans la phénoménologie de Husserl, il souligne que celle-<br />
ci suppose la conformité de la pensée avec la connaissance dans sa relation à l’être. En dépit<br />
des efforts pour ressortir l’idée d’une intentionnalité qui n’est pas théorétique, celle qui<br />
appartient à l’existence affective, Husserl aurait maintenu au fondement de celle-ci l’acte<br />
objectivant. L’intentionnalité première de la conscience demeurerait un savoir, une<br />
totalisation, la satisfaction d’une intention à l’objet. Dans cette totalisation ou philosophie de<br />
l’être comblé, l’emprise sur l’être serait similaire à la structure de cet être. Dans cette<br />
trajectoire, nous ne sommes plus dans le champ de la béance mais dans l’excès de proximité,<br />
nous avons quitté la transcendance pour retourner dans l’immanence de la pensée où l’altérité<br />
est envahit. L’analyse qui suit va certainement nous permettre de mieux préciser cet<br />
argument.<br />
74<br />
Levinas, Totalité et Infini, op cit., p.135<br />
75<br />
Idem, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, Paris, 1949 ; Deuxième éd. Augmentée<br />
1967, p.168<br />
76<br />
Idem, « Philosophie et transcendance », in Altérité et transcendance, op cit., p. 55 et p. 37.<br />
77 Ibid., p. 38.<br />
21
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Dans Totalité et Infini, Levinas en vient à se demander si la jouissance en tant que modalité<br />
première de l’exister du sujet est une forme de l’intentionnalité, déterminée par Husserl, et<br />
présentée comme « fait universel de l’existence humaine » 78 . Tout instant de l’existence<br />
consciente est assurément en relation avec un autre que cet instant même. Cependant à partir<br />
du constat que l’intentionnalité est intentionnalité de l’acte objectivant 79 , Levinas pense qu’il<br />
est nécessaire de revoir cette relation qui s’établit entre intentionnalité et jouissance, car dès la<br />
première présentation de l’intentionnalité, comme d’une théorie philosophique, se dégageait<br />
« le privilège de la représentation. La thèse selon laquelle toute intentionnalité est soit une<br />
représentation, soit fondée sur une représentation — domine les Logische Untersuchungen et<br />
revient comme une obsession dans toute l’œuvre ultérieure de Husserl » 80 . Par ce point,<br />
Husserl d’après Levinas tente de faire saillir la différence entre la représentation de l’acte<br />
intentionnel objectivant et le but intentionnel de la jouissance et de la sensibilité.<br />
En fait, Levinas souligne que la domination de l’acte objectivant dans l’intentionnalité<br />
husserlienne conduit, contrairement à l'opinion commune, non à des dispositions réalistes<br />
mais à cette vision que « l’objet de la représentation est bel et bien intérieur à la pensée : il<br />
tombe malgré son indépendance, sous le pouvoir de la pensée » 81 . Certainement, il existe une<br />
différence entre l’objet de la représentation et l’acte de la représentation, cependant, l’objet de<br />
la représentation demeurerait à l’intérieure de la pensée et, malgré son autonomie, chuterait<br />
« sous le pouvoir de la pensée ». Le fait que tout se passe à l’intérieure de la pensée exclut<br />
l’extériorité et la possibilité même de toute altérité. Dans ce contexte, c’est la transmission de<br />
sens qui entreprend l’acte d’assimilation : le problème ici d’après Levinas, tient du fait que<br />
l’épuisement du sens d’une extériorité réduite à soi qui résulte de la conversion d’une<br />
extériorité en noèmes 82 « retrouver en soi et […] épuise le sens d’une extériorité, précisément<br />
convertible en noèmes. Tel est le mouvement de l’épochè husserlienne, caractéristique, à<br />
parler strictement, de la représentation. La possibilité même définit la représentation » 83 .<br />
L’extériorité de l’étant est réduite au noème, assimilation du représenté à son sens, de<br />
l’existant au noème qui selon Levinas caractérise la posture husserlienne. Le fait de donner du<br />
sens détériore l’objet de la représentation en le réduisant au statut de noème, c’est-à-dire<br />
78<br />
Levinas, Totalité et infini. Essai sur l’extériorité, Le Livre de Poche, Biblio-Essais n° 4121, Paris, 1971,<br />
(1961), p. 127.<br />
79<br />
Donner une forme concrète à.<br />
80<br />
Ibid., p.127<br />
81<br />
Ibid., p. 128<br />
82<br />
En phénoménologie, objet visé par la pensée.<br />
83 Ibid., p. 131<br />
22
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
parvient à le rendre intelligible. Dans l’intelligible, la représentation manifeste l’abrogation de<br />
l’altérité : sujet/objet, intériorité/extériorité. C’est donc pourquoi d’après Levinas<br />
« intentionnalité » et « représentation » sont des concepts similaires. « La représentation<br />
occupe ainsi, dans l’œuvre de l’intentionnalité, la place d’un événement privilégié » 84 , car<br />
elle est siège de vérité.<br />
Tous les essais de la « philosophie occidentale » pour comprendre l'autre sous la base du<br />
Même attesteraient d’après Levinas l'« insurmontable allergie », de l'effroi qu'inspire l'altérité<br />
qui demeure identique à elle-même. En réduisant l'altérité à un thème, à un concept ou à un<br />
objet, incompétente qu'elle est de le permettre d’être dans sa singularité, cette philosophie se<br />
condamne à être une ontologie, une philosophie de l'Être, de l'immanence, de la déviation<br />
caractérisée par un amour excessif de soi-même, c’est pourquoi Levinas élabore une critique<br />
amère envers tout prototype conceptuel d'objectivation de l’Autre. L'intentionnalité, malgré le<br />
transfert analogique réalisé par Husserl dans sa cinquième Méditation, n’accède pas à la<br />
connaissance de l’autre comme tel, parce qu'elle le restreint à la catégorie d'objet ou le<br />
subordonne à l'Être. La philosophie de la Totalité proclame son autorité sur l'Autre en<br />
attestant notamment la suprématie du Même. Elle touche ses cimes dans la philosophie de<br />
Heidegger 85 , qu'il s'agisse de la prédominance de l'Être par rapport à l'étant ou de l'ontologie<br />
par rapport à la métaphysique.<br />
La médiation phénoménologique prend un chemin dans lequel l’impérialisme ontologique<br />
est plus clair. « C’est l’être de l’étant qui est le medium de la vérité. La vérité concernant<br />
l’étant suppose l’ouverture préalable de l’être » 86 . Soutenir une telle idée, c’est affirmer que<br />
l’intelligibilité de l’étant est liée à notre « non-coïncidence » 87 . La vérité de l’étant est<br />
possible « dans la mesure où la pensé le transcende, pour le mesurer à l’horizon où il se<br />
profile » 88 . La phénoménologie, d’après Levinas, fait depuis Husserl l’apologie de l’idée<br />
d«’horizon » qui est similaire à celle du « concept » dans l’idéalisme classique.<br />
84 Ibid., p. 129.<br />
85 Nous expliciterons la position ontologique heideggérienne dans la troisième articulation de ce chapitre.<br />
86 Ibid., p.15<br />
87 Ibid.<br />
88 Ibid.<br />
23
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
III. Ontologie et primauté de l’Etre chez Heidegger<br />
En évoquant son séjour à Fribourg-en-Brisgau en 1928-1929, Emmanuel Levinas expose<br />
la crise qui a été à la base de son itinéraire philosophique : « La grande chose que j’ai trouvée<br />
fut la manière dont la voie de Husserl était prolongée et transfigurée par Heidegger. Pour<br />
parler un langage de touriste, j’ai eu l’impression que je suis allé chez Husserl et que j’ai<br />
trouvé Heidegger » 89 . La « voie » de Husserl, selon Levinas représente essentiellement une<br />
méthode. Malgré ses critiques qui ont suscitées des innovations de sa part et même si ses<br />
points de vue s’écartent parfois des règles admises par la phénoménologie 90 , Levinas est resté<br />
fidèle avec quelques nuances à la méthode phénoménologique qu’il a vivement admiré chez<br />
Husserl. Mais, avec Heidegger, il procède autrement. D’une part, il apprécie l’innovation des<br />
thèses philosophiques heideggérienne par rapport à la tradition classique, mais d’autre part,<br />
Levinas critique l’ontologie heideggérienne d’une manière radicale « car, au nom de l'unité de<br />
l'être, elle ramène toujours l'autre au sein du même. L'ontologie est une tautologie, une<br />
égologie qui neutralise l'autre » 91 . La primauté de la relation à l’être qui meut la philosophie<br />
heideggérienne est, pour Levinas, une infirmation de la métaphysique en faveur de<br />
l’ontologie.<br />
Jens Mattern, dans son article « Ichnocratie. La pensée du retour et antipolitique chez<br />
Benny Lévy et Martin Heidegger » 92 , affirme que la pensée heideggérienne n'est autre qu'une<br />
« déconstruction des prétentions du sujet transcendantal » 93 des modernes, une déconstruction<br />
du je pense cartésien qui est devenu la mesure de tout. Autrement dit, la compréhension de<br />
l'être humain comme « un animal rationnel » au sens aristotélicien, ou comme un « je pense »<br />
comme le précise Descartes, d’après Heidegger n'est qu'un effet de l'oubli de l'être. «<br />
Détourné de l'être et installé dans le règne des étants l'homme finit ainsi par se poser lui-<br />
même comme centre de l'être et mesure de toute chose » 94 . L'histoire de la philosophie<br />
occidentale apparait d’après Heidegger comme histoire d'un détournement de l'origine de plus<br />
en plus marqué.<br />
89<br />
François Poirié, Emmanuel Levinas, Qui êtes vous ?, Editions La Manufacture, Lyon, 1987, p. 78.<br />
90<br />
Cf. la critique de Dominique Janicaud in Le tournant théologique de la phénoménologie française. Combas:<br />
Éd. de l'Éclat, 1991<br />
91<br />
Derrida, L'écriture et la différence, Seuil, 1967, p143<br />
92<br />
In Cahier d'études levinassiennes, 2005 -- Hors serie, pp. 75-- 108.<br />
93 Ibid., p.100<br />
94 Ibid., p.99<br />
24
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Dans sa Lettre sur l'humanisme, Heidegger accentue l’importance de se séparer de la<br />
tradition de l'humanisme pour laquelle l'homme se définissait comme animal rationnel, c'est-<br />
à-dire avec la philosophie qui pensait l'être humain comme un étant rencontré à l'intérieur du<br />
monde, un étant animal, ayant des spécificités comme la faculté de parler ou la raison.<br />
L'humanisme classique apparait donc dans Être et temps au niveau d'une exposition de<br />
l'existence inauthentique du Dasein. L'oubli de l'être veut dire dans cette perspective que<br />
« l'être humain se (mé)-prend pour un étant humain, au lieu de se saisir, dans son existence<br />
même, comme le lieu où l'être advient dans sa vérité, c'est-à-dire comme Da-sein » 95 .<br />
En fait, Heidegger dans sa reprise du problème de l'être vise la « déconstruction des<br />
prétentions du sujet transcendantal » 96 exposé par les modernes ou la déconstruction du<br />
libéralisme. C'est d'ailleurs ce qui explique son adhésion au « national socialisme » à partir de<br />
1933 : Heidegger s'est engagé sans aucun équivoque dans la révolution nazie, pensant ou<br />
prévoyant y trouver une traduction politique de sa propre séparation avec « […] - voire de son<br />
évasion de - la culture moderne et ainsi la possibilité d'un autre commencement susceptible<br />
d'opérer un retour dans la proximité de l'être au niveau de l'existence collective » 97 . Heidegger<br />
voulait donc se séparer de l'idéologie libérale. Mais malheureusement cette rupture chute chez<br />
lui dans la conception d'une pensée politique ayant des prédispositions totalitaires. S’il faut le<br />
dire en un mot, la pensée heideggérienne est un retour au concept antique de l'être pour sortir<br />
du libéralisme, cependant elle n'aboutit qu'à un nivèlement des sujets dans la totalité. Le<br />
retour à l’être antique culmine dans une sorte d’ontologisme, à un surplus d'être qui asphyxie.<br />
Car, Heidegger, d’après Levinas, a réduit la vie humaine à une existence sans individu qui<br />
l'assume, une existence « anonyme », dépersonnalisée, générique, identique pour tout le<br />
monde, c’est que Levinas nomme « l'il y a ». La pensée d’Emmanuel Levinas, par rapport à<br />
celle de Martin Heidegger, et à la suite du massacre nazie, sera de ce fait une tentative de<br />
sortir de cet ontologisme, c'est-à-dire une défense de la subjectivité, que nous exposerons dans<br />
le deuxième chapitre de cette partie.<br />
95 Siméon Clotaire Mintoume. « L'éthique comme philosophie première ou la défense des droits de l'autre homme<br />
chez Emmanuel Levinas », 25 octobre 2010], disponible su World Wide<br />
Web:, [119B], ISSN1128-5478. Voire aussi : Cahier d'études<br />
levinassiennes, 2005 -- Hors série, p.101<br />
96 In Cahier d'études levinassiennes, 2005 -- Hors série, Ibid., p.100<br />
97 Ibid., p.95<br />
25
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
L’erreur heideggérienne d’après Levinas a « consisté à subordonner la vérité ontique,<br />
vérité qui se dirige vers l’autre » 98 , au problème ontologique qui s’élabore au sein du Même.<br />
L’ontologie heideggérienne, selon Levinas, est « une philosophie du Neutre », car elle<br />
subordonne au rapport avec l’Etre toute relation à l’étant. L’être en général, l’horizon dans<br />
lequel survient la compréhension de l’être, n’est pas un étant mais un « Neutre » qui agence<br />
pensée et êtres, il est « l’il y a », « l’Anonyme » à l’intérieur duquel toutes les singularités<br />
trouvent refuge, mais seulement en perdant leur identité - individualité. En tant que<br />
« philosophie du neutre », la pensée heideggérienne est incapable de maintenir la<br />
« Distance », de dialoguer avec l’Altérité, de respecter l’Autre. C’est cela que Jean-Luc<br />
Marion, spécialiste de la « Distance », reconnait lorsqu’il souligne : « jamais, semble-t-il, la<br />
question de ‘’Dieu’’ n’a subi une réduction aussi radicale à la question première de l’Être que<br />
dans l’entreprise phrénologique de Heidegger » 99 . La philosophie de Heidegger est purement<br />
réductionniste, elle est violente et amorale.<br />
Chez Heidegger, l’homme est représenté comme « Etre-là » et la compréhension de l’Etre<br />
en tant que voilé transcendant est une caractéristique de son être. Cette conception de son être<br />
veut dire que l’homme est un « être-au-monde ». Toute interrogation sur l’être doit être<br />
devancée par un examen capital du « dasein » dans sa temporalité. La question de l’Autre<br />
s’inscrit ainsi dans cette étude sur le mode du « dasein » dans la quotidienneté. D’après<br />
Heidegger cette existence montre que « l’être-là » est foncièrement et en soi être avec l’Autre.<br />
Les autres ne sont pas différents de moi, car ils sont « ceux dont le plus souvent on ne se<br />
distingue pas soi-même et parmi lesquels on se retrouve aussi » 100 . L’Autre se rencontre<br />
d’abord dans le monde, dans l’action 101 , c’est ce qui traduit cette existence simultanée. De<br />
manière succincte, « l’être-là » chez Heidegger est un « On » au quotidien, impersonnel<br />
et neutre, car la vie est réduite ici à une situation de neutralité. Il y’a une inflation de sens,<br />
puisque tout est confondu, nul n’est soi, chacun est autre.<br />
Dans la philosophie occidentale, « toute relation entre le Même et l’Autre, quand elle n’est<br />
pas l’affirmation de la suprématie du Même, se ramène à une relation impersonnelle dans un<br />
ordre universelle » 102 . La philosophie elle-même se définie par le changement d’idées par les<br />
98<br />
Silvano Petrosino, La vérité nomade. Introduction à Emmanuel Levinas, Editions La Découverte, Paris, 1984,<br />
p.134<br />
99<br />
J. L. Marion, Dieu sans l'être, PUF, Paris, 2002, p.104<br />
100<br />
Philippe Huneman, Estelle Kulic Introduction à la phénoménologie, Ed.. Armand Colin, Paris, 1997, p. 51<br />
101<br />
Le Dasein s’occupe des choses du monde, c’est un commerçant, sportif, il administre les rapports humains<br />
comme des réserves d’articles.<br />
102 Levinas, Totalité et Infini, op. cit., ibid., p.60<br />
26
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
hommes, du « thème » par « l’interlocuteur », de « l’intériorité de la relation logique » par<br />
« l’extériorité de l’interpellation ». « Les étant’s se ramènent au Neutre et l’idée, de l’être, du<br />
concept » 103 . C’est pour ne pas se soumettre à l’arbitraire de la liberté, à son extinction dans le<br />
« Neutre », que Levinas pense le moi comme païen et crée – autonome, mais ayant la capacité<br />
d’aller en deçà de sa situation – face à l’altérité qui ne peut être thématisé ou conceptualisé<br />
par le Même 104 .<br />
L’ontologie heideggérienne n’est pas fondée sur une vérité d’évidence, car il faut d’abord<br />
connaitre l’être pour connaitre l’étant. Souligner la primauté de l’être par rapport à l’étant,<br />
c’est prendre position sur la question de « l’essence de la philosophie, subordonner la relation<br />
avec quelqu’un qui est un étant à une relation avec l’être de l’étant qui, impersonnel, permet<br />
la saisie, la domination de l’étant, subordonne la justice à la liberté » 105 . L’ontologie met la<br />
liberté au dessus de l’éthique. C’est par la soumission à l’être qu’on obtient sa liberté.<br />
L’homme ne possède pas de liberté, c’est plutôt la liberté qui possède l’homme. En<br />
conséquence, la dialectique qui unit la liberté à l’obéissance dans la vérité, suppose la<br />
supériorité du Même. La neutralité du monde heideggérien, de l’être représente un danger<br />
particulièrement au moment où Heidegger exalte une divinisation du monde. Une pareille<br />
philosophie d’après Levinas est une doctrine « concomitante d’un exister païen » 106 qui cache<br />
éventuellement un monde inhumain, puisque privé de l’Autre. Levinas l’analyse ainsi :<br />
L’ontologie heideggérienne subordonne le rapport avec l’autre à la relation<br />
avec le Neutre qu’est l’Etre et, par là, elle continue à exalter la volonté de la<br />
puissance dont Autrui seul peut ébranler la légitimité et troubler la bonne<br />
conscience […] [Heidegger] maintient un régime de puissance plus inhumain<br />
que le machinisme (qu’il dénonce). L’Etre l’ordonne [le dasein] bâtisseur et<br />
cultivateur, au sein d’un paysage familier, sur une terre maternelle.<br />
Anonyme, Neutre, il l’ordonne éthiquement indifférent et comme une liberté<br />
héroïque, étrangère à toute culpabilité à l’égard d’autrui 107 .<br />
Dans l’ontologie heideggérienne, c’est l’être qui est premier et la relation avec l’autre est<br />
supplantée par la relation avec l’être. C’est exactement cette articulation heideggérienne qui<br />
réalise un abîme entre Levinas et Heidegger, puisque ce dernier méconnait l’existence<br />
éthique de l’homme, en le comprenant comme un « être-là » dont la vie est condamnée à la<br />
relation avec le monde et, ainsi, l’assèche de toute inquiétude d’Autrui. Une telle posture<br />
103<br />
Ibid.<br />
104<br />
Nous éluciderons amplement cette idée dans la deuxième partie de ce texte.<br />
105<br />
Ibid.<br />
106<br />
Jean-François Petit, Histoire de la philosophie française au XXe siècle, Ed Desclée de Brouwer, 2009, p.280<br />
107 e<br />
Levinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, J. Vrin, nouvelle édition aug. Paris, 1967, 3<br />
édition 1974, p.226<br />
27
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
d’après Levinas est le fondement de toute philosophie de la guerre, c’est d’ailleurs ce que<br />
laisse transparaitre les analyses entre le Même et l’Autre dans Totalité et Infini. La négation<br />
de l’Autre, telle que cela se manifeste chez Heidegger, est identique à la barbarie et plus<br />
précisément à l’ensauvagement et « détermine toute la civilisation occidentale de propriété,<br />
d’exploitation, de tyrannie politique et de guerre » 108 . Malgré sa dénonciation de l’oubli de<br />
l’être dans la philosophie classique, comme cheminement vers le concept de « sujet » et de<br />
force technique, Heidegger et ses confrères occidentaux comprennent la relation avec l’Autre<br />
comme une activité se manifestant dans l’entreprise des peuples sédentaires, propriétaire et<br />
technicien du sol. « La possession est la forme par excellence sous laquelle l’Autre devient<br />
Même en devenant mien » 109 . Le monde heideggérien apparait donc comme le lieu<br />
d’absorption de l’altérité de l’autre par le Même. Or, comme nous allons le voir dans la<br />
deuxième partie de ce texte, l’Autre est un mystère, il est cet Etranger que je rencontre dans le<br />
monde mais qui n’est pas dans le monde, son altérité est donc foncièrement irréductible.<br />
L’ontologie est une philosophie de l’emprise, de la puissance, en tant que philosophie<br />
première qui ne met pas le Même en question, elle « est une philosophie de l’injustice ».<br />
L’ontologie heideggérienne qui accorde le primat à la relation avec l’être en général par<br />
rapport à celle avec l’Autre, malgré qu’elle conteste « la passion technique, issue de l’oubli de<br />
l’être caché par l’étant – demeure dans l’obédience de l’anonyme et mène, fatalement, à une<br />
autre puissance, à la domination impérialiste, à la tyrannie » 110 . Dictature qui n’est pas le<br />
développement naturel et élémentaire de la méthode à des hommes transformés en chose. Elle<br />
tire ses origines de la conception païenne, de l’enracinement dans la terre, au culte que les<br />
esclaves rendent à leurs souverains. « L’être avant l’étant, l’ontologie avant la métaphysique<br />
– c’est la liberté avant la justice. C’est un mouvement dans le Même avant l’obligation à<br />
l’égard de l’Autre » 111 . L’ontologie est donc fondée sur une théorie d’équivalence de l’étant et<br />
de l’être avec pour but l’assimilation de l’altérité dans l’univers de la Totalité. Cet archétype<br />
est le fondement du Même qui est basé sur l’assimilation plus que sur l’uniformité, parce que<br />
le Même peut être voué à une dislocation ou un émiettement qui demeure néanmoins passager<br />
parce qu’il est perpétuellement condamné au retour à l’unité.<br />
Nous précisons que les concepts de Même et de Moi chez Levinas sont identiques. Le Moi<br />
se manifeste comme reconnaissance, il est « l’être dont l’exister consiste à s’identifier ». De<br />
108 Jean-François Petit, Histoire de la philosophie française au XX e siècle, op. cit., Ibid., 281<br />
109 Levinas, Totalité et Infini, op. cit., p.17<br />
110 Ibid.<br />
111 Ibid.<br />
28
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
cette posture résulte toute l’histoire de la philosophie occidentale, de l’antiquité et plus<br />
précisément de Socrate exprimant tout à partir de lui à Martin Heidegger où le « dasein » est<br />
famélique. Nous constatons dans Totalité et Infini, l’abrogation d’une aptitude solipsiste de la<br />
philosophie qui consiste à tout réduire et à ramener sous la domination et la dictature du<br />
Même 112 . C’est donc ici qu’apparait l’épreuve fatidique et vicieuse de l’ontologie, car elle<br />
veut trouver une unité sans laquelle l’étant serait égaré de par sa déflagration. Mais, c’est<br />
également là qu’apparait la supériorité de Levinas, cette critique de l’ontologie occidentale<br />
réduisant tout au Même n’est pas une négation absolue mais la découverte d’une énorme<br />
carence. Du moins, la philosophie occidentale a raté son exploration de l’étant et fut<br />
outrageusement couarde pour autoriser la nécessité de l’éclatement du Même. Il est donc<br />
capital pour Levinas de partir de cette circonstance ontologique pour atteindre la<br />
métaphysique, de passer par le Même pour que l’Autre me transcende.<br />
En fait, Levinas s’oppose radicalement à Heidegger qui subordonne à l’ontologie la<br />
relation métaphysique, il l’immobile d’ailleurs, comme si on avait la capacité de réduire, au<br />
lieu de percevoir dans « la justice et l’injustice » une ouverture originelle à l’Autre, par-delà<br />
toute ontologie. La vie de l’Autre nous implique socialement, non pas par sa participation à<br />
l’être que nous connaissons tous, non pas par sa puissance et par son autonomie que nous<br />
aurions à asservir et à user pour nous, non pas par la spécificité de ses qualités que nous<br />
aurions à dépasser dans le développement du savoir ou dans une impulsion de l’estime en<br />
nous associant avec lui et comme si sa vie était une menace. « Autrui ne nous affecte pas<br />
comme celui qu’il faut surmonter, englober, dominer, - mais en tant qu’autre, indépendant de<br />
nous : derrière toute relation que nous puissions entretenir avec lui, ressurgissant absolu » 113 .<br />
C’est cette façon de recevoir un « étant absolu » que nous constatons dans la justice et<br />
l’injustice et que réalise le discours, totalement enseignement. Le terme « accueil d’Autrui »<br />
signifie, à la fois, mouvement et inertie – qui installe le rapport avec l’Autre au-delà des<br />
séparations acceptables pour les objets : « de l’a priori et de l’a postériori, de l’activité et de<br />
la passivité » 114 .<br />
112 La philosophie aspire à une connaissance et elle affirme ce qu'il en est. Levinas dénonce un absolutisme de la<br />
raison, l'idée de souveraineté qui pilote la philosophie, la connaissance qui consiste à s’emparer de l’étant faisant<br />
partie de la communauté de genre, qui n'existe pas dans sa particularité mais dans sa généralité. Pour la<br />
philosophie, penser l'être désigne une séquestration qui se termine par la guerre parce que tout individu est prêt à<br />
faire la guerre à l'autre pour assurer sa pérennité dans son essence. Une pensée qui comprend la totalité de l'être,<br />
telle est le cas de l’ontologie traditionnelle, abouti au meurtre. La crainte du système totalisant est présent partout<br />
et en tout temps. Le désire de réintégrer l'unité d’une doctrine qui englobe les étants et détruit la pluralité est<br />
ainsi annulée.<br />
113 Ibid., pp.62-63<br />
114 Ibid., p.62<br />
29
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Levinas exprime dans Totalité et infini, comment en partant de la connaissance assimilée à<br />
la « thématisation », la vérité de cette connaissance conduit au rapport avec l’Autre, ou en<br />
d’autre terme à la justice. Ce texte consiste à critiquer l’ineffaçable certitude de toute<br />
philosophie que le savoir objectif est l’extrême rapport de la transcendance, que l’Autre, bien<br />
qu’il soit distinct des objets – « doit être objectivement connu, même si sa liberté devait<br />
décevoir cette nostalgie de la connaissance » 115 . Le dessein de Levinas n’est pas de montrer<br />
que l’Autre se dérobe de toute connaissance, mais qu’on ne peut parler ici de savoir ou<br />
« d’ignorance », parce que la justice, la transcendance par excellence et modalité de la<br />
connaissance ne sont point, comme on le souhaiterait, « une noèse corrélative d’un noème ».<br />
115 Ibid.<br />
30
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
CHAPITRE II : DERACINEMENT DU TOTALITARISME<br />
ONTOLOGIQUE<br />
Dans la tradition occidentale, l’existence est administrée par le Même, tout se passe<br />
comme si la vie reposait sur un idéal d’adéquation de l’étant et de l’être avec pour finalité la<br />
synthèse ou la totalisation de ceux-ci. Cette conception de l’existence d’après Levinas est<br />
source de violence et d’ensauvagement, car ici le sujet est assimilé à un objet, il est<br />
« anonyme », « neutre » et aphasique puisqu’il est absorbé dans un système et soumis à des<br />
forces dont il ignore la provenance. Levinas critique vivement cette conception de l’existence,<br />
parce que dans le totalitarisme ontologique l’altérité est réduite au Même, or dans la relation<br />
métaphysique, la subjectivité en tant singularité absolue est préservée dans la relation avec<br />
l’Autre. S’il faut mémoriser un point majeur de notre argumentation jusqu’ici, ce serait la<br />
volonté levinassienne de sortir du carcan ontologique, sortir de l'impersonnel de l'être, d'une<br />
totalité vers laquelle nous serions séquestrés. Mais comment penser la distance de l'altérité ?<br />
Après avoir analysé dans le chapitre précédent, la relation entre le Moi et l’Autre dans les<br />
philosophies de la totalité, et plus précisément sur son mode d’être du Moi dans la philosophie<br />
Occidentale, nous allons dans cette nouvelle articulation nous servir du « désir<br />
métaphysique », de « la jouissance » et de « l’épiphanie d’autrui dans le visage » pour<br />
montrer comment s’opère la rupture de la Totalité. Ce chapitre portera donc sur<br />
l’anthropologie levinassienne qui n’est rien d’autre qu’une sortie de l’être ou un dépassement<br />
de l’ontologie occidentale. Nous allons montrer avec Levinas que la véritable existence n’est<br />
pas conditionnée par « l’il y’a », car l’authentique vie est dans la singularité absolue 116 et<br />
celle-ci n’est possible qu’en dehors de la Totalité.<br />
116 La véritable vie d’après Levinas n’est pas dans la totalité ontologie, mais dans la relation métaphysique :<br />
L’ontologie fait référence au règne du Même et la métaphysique à celui de l’Autre La véritable vie est<br />
singularité absolue, je suis moi et je le demeure même dans mes différentes altercations.<br />
31
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
I. L’idée de l’Infini et le Désir de l’In-connu<br />
1. L’étrangeté absolue chez Descartes<br />
La réflexion émise jusqu’ici a manifesté le besoin de poursuivre ce travail en pensant tout<br />
d’abord les modalités de faisabilité d’une véritable transcendance à laquelle le système<br />
hégélien et la tradition phénoménologique n’ont pas pu aboutir malgré leur effort. En<br />
revanche, c’est dans la philosophie cartésienne que Levinas aperçoit le premier succès d’une<br />
telle opération. Le passage qui intéresse principalement notre auteur est issu de la troisième<br />
méditation métaphysique de Descartes où il souligne :<br />
Partant il ne reste que la seule idée de Dieu, dans laquelle il faut considérer s’il<br />
y a quelque chose qui n’ait pu venir de moi-même. Par le nom de Dieu j’entends<br />
une substance infinie, éternelle, immuable, indépendante, toute connaissante,<br />
toute puissante, et par laquelle moi-même, et toutes les autres choses qui sont<br />
(s’il est vrai qu’il y en ait qui existent) ont été créées et produites. Or ces<br />
avantages sont si grands et si éminents, que plus attentivement je les considère,<br />
et moins je me persuade que l’idée que j’en ai puisse tirer son origine de moi<br />
seul. Et par conséquent il faut nécessairement conclure de tout ce que j’ai dit<br />
auparavant, que Dieu existe ; car, encore que l’idée de la substance soit en moi,<br />
de cela même que je suis une substance, je n’aurais pas néanmoins l’idée d’une<br />
substance infinie, moi qui suis un être fini, si elle n’avait pas été mise en moi par<br />
quelque substance qui fût véritablement infinie 117 .<br />
Levinas garde de cette troisième méditation cartésienne l’éventualité de concevoir un<br />
ideatum 118 transcendant l’idée qu’on peut en posséder, c’est-à-dire que le concret de ce qui est<br />
pensé surpasse la pensée même qu’on peut en détenir. Ceci signifie confondre l’idée d’infini à<br />
celle de l’étrangeté absolue. Cependant le fragment de la démonstration cartésienne qui est<br />
formellement refusée par Levinas est celui qui montre le pouvoir de penser sur l’infini à partir<br />
du fini. Néanmoins, concernant la séparation que constitue l’idée de l’Infini, Levinas épouse<br />
les idées de Descartes. L’infini renvoie à une seul idée, parce qu’il est « absolument autre »,<br />
une étrangeté absolue sur laquelle aucune totalisation n’est réalisable. « L’idée de l’infini<br />
suppose, la séparation du Même par rapport à l’Autre » 119 . Cependant cette rupture ne se<br />
fonde pas sur une opposition à l’Autre, qui serait carrément contradictoire. « La thèse et<br />
l’antithèse, en se repoussant, s’appellent. Elle apparaissent dans leur opposition à un regard<br />
117 Descartes, Méditations métaphysiques ; Meditationes de prima philosophia, texte latin et traduction du duc de<br />
Luynes revue par Descartes, présentation et nouvelle traduction (en regard) par Michelle Beyssade, Le Livre de<br />
Poche, 1990, p.39<br />
118 Levinas, Totalité et Infini, Op. Cit., p.19<br />
119 Ibid., p.23<br />
32
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
synoptique qui les embrasse » 120 . Elles constituent une totalité qui rend relative, en l’ajoutant,<br />
la transcendance métaphysique révélée par l’idée d’infini. « Une transcendance absolue doit<br />
se produire comme inintégrable » 121 .<br />
Emmanuel Levinas ne voit pas l’infini uniquement en Dieu mais également en Autrui et<br />
dans la mort. En conséquence « Dieu », « Autrui » et « la mort » représentent les trois infinis<br />
exposés dans Totalité et Infini et dans les discours postérieurs de Levinas. Toutefois nous<br />
précisons que la singularité, l’originalité de cet auteur vient du fait qu’il exprime l’existence<br />
de l’Infini en Autrui. On ne peut thématiser l’Infini, ni le réduire au mode objectal, il est non<br />
englobable, comme nous venons de l’exprimer, et en conséquence, en séparation avec<br />
l’activité conceptuelle quelle que soit son degré d’ascendance. L’impossibilité de la<br />
totalisation se manifeste par « l’asymétrie métaphysique », qui souligne l’impossibilité<br />
absolue de se percevoir de l’extérieur et de discourir dans le même sens de soi aux autres. Car,<br />
« ce que je me permets d’exiger de moi-même, ne se compare pas à ce que je suis en droit<br />
d’exiger aux autres » 122 .<br />
La théorie n’admet pas l’installation de l’être connaissant dans l’être connu, la<br />
pénétration dans l’infini, par « extase ». Elle demeure savoir, relation. La représentation ne<br />
signifie pas la relation première avec l’être. Elle est néanmoins admise comme l’éventualité<br />
de se souvenir de la rupture du moi. Cela fut une des positions considérables des grecs et<br />
l’établissement de la philosophie qui a permit de remplacer l’union ésotérique des espèces par<br />
une relation spirituelle où les êtres restent à leur place, mais dialoguent entre eux. Dans les<br />
premières pages du Phédon, Socrate proscrit le suicide, conteste la fausse contemplation qui<br />
admet l’union naturelle et directe avec le divin, qu’il considère comme la marque de la<br />
« désertion ». Il affirme plutôt la quête acerbe de la connaissance partant de ce monde.<br />
« L’être connaissant demeure séparé de l’être connu » 123 . Par ailleurs, la difficulté de<br />
l’évidence première de René Descartes exposant le moi et Dieu de façon distincte, indique le<br />
sens même de la séparation. L’écart entre moi et Dieu, absolu et indispensable se réalise à<br />
l’intérieur de l’être. Sur ce plan, la transcendance philosophique ne s’assimile pas à la<br />
transcendance religieuse.<br />
120 Ibid., pp.23-24<br />
121 Ibid., p.24<br />
122 Ibid., p.24<br />
123 Ibid., p.18<br />
33
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
La relation du Même avec l’Autre, malgré la transcendance de la relation, n’unit pas les<br />
termes en un Tout chez Descartes. Le « je pense » tient avec l’Infini, qu’il ne peut englober et<br />
dont il est différent, une relation désignée « idée d’infini ». Assurément les mathématiques, la<br />
morale, les choses sont présentées aussi chez Descartes de façon distincte, mais la<br />
particularité de l’idée de l’infini est que son ideatum transcende son idée, tandis que pour les<br />
choses, la simultanéité globale de leurs existences « objective » et « formelle » 124 n’est pas<br />
rejetée. Plus explicitement, l’argument cartésien démontre l’existence distincte de l’Infini par<br />
la finitude de l’être possédant une idée de l’infini.<br />
La distance qui sépare ideatum et idée, constitue ici le contenu même. L’infini<br />
est le propre d’un être transcendant en tant que transcendance, l’infini est<br />
absolument autre. Le transcendant est le seul ideatum dont il ne peut y avoir<br />
qu’une idée en nous ; il est infiniment éloigné de son idée – c’est-à-dire<br />
extérieur – parce qu’i est infini 125 .<br />
Cogiter sur l’infini, le transcendant, l’Etranger ne signifie pas « penser un objet ». La<br />
distance de la transcendance n’a pas le même rapport que celle qui divise, dans toutes nos<br />
spéculations, l’activité intellectuelle de son objet, parce que l’intervalle auquel se tient l’objet<br />
n’admet pas, mais réellement implique la détention de l’objet, c’est à dire l’interruption de<br />
son être. L’indication générale des analyses de Totalité et Infini se fondent sur la différence<br />
entre objectivité et transcendance.<br />
La conception cartésienne de l’idée de l’infini indique une relation avec un être qui garde<br />
son extériorité intégrale « par rapport à celui qui le pense ». Elle signifie le contact de<br />
l’inviolable, relation qui ne met pas en péril « l’intégrité de ce qui est touché ». Attester<br />
l’existence en nous de l’idée de l’infini, c’est d’après Levinas admettre « comme purement<br />
abstraite et formelle la contradiction que recélerait l’idée de la métaphysique » et que Platon<br />
mentionne dans le Parménide 126 : le rapport avec l’Absolu relativiserait l’Absolu.<br />
« L’extériorité absolue de l’être extérieur, ne se perd pas purement et simplement du fait de sa<br />
manifestation ; il s’absout de la relation où il se présente » 127 .<br />
L’infini n’a pas de terme, dans notre relation à l’infini, nous faisons donc face à un cas<br />
limite de la phénoménologie. Dans ce cas extrême, le moi est en relation avec quelque chose<br />
qui est absolument supérieure à lui. Le dessein de Levinas est de préserver, le Même et<br />
124 Ibid., p.19<br />
125 Ibid., p.20<br />
126 Platon, Platon, Œuvres complètes, VIII, 1, Parménide, texte établi et traduit par Auguste Diès, Paris, 1923,<br />
Les Belles Lettres. I33 b –I33c ; I4Ic –I42b.<br />
127 Ibid., p. 21<br />
34
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
l’Autre, sains malgré leur relation. Dans l’infini, il existe une forme de relation, néanmoins<br />
d’une relation qui ne supprime pas les concentrations unies et dont nulle réflexion totalisante,<br />
ni aucune synthèse ne peut être bâtie. Cette relation à l’infini est provoquée par un désir, « le<br />
Désir métaphysique » dont nous exposerons amplement à la suite de cette articulation.<br />
Mémorisons néanmoins l’utilité foncière de l’idée d’infini qui est la modalité de « la relation<br />
métaphysique » 128 qui est l’une des mises capitale de Totalité et Infini où Levinas se propose<br />
d’exposer, dans le mouvement de la vie terrestre, de « l’existence économique » qu’il nomme<br />
aussi « relation avec l’Autre », qui ne s’achève pas en une totalité céleste ou par celle d’un<br />
humain, « une relation qui n’est pas une totalisation de l’histoire » comme le fait Hegel, mais<br />
celle de l’idée de l’infini. Une telle relation représente exactement ce que notre auteur<br />
appelle : « métaphysique ». Toutefois que faut-il entendre par Désir métaphysique ?<br />
2. Le Désir métaphysique<br />
Le désir métaphysique d’après Levinas est désir de l’In-visible, car bien que nous soyons<br />
au monde « la vrai vie est absente » 129 , elle est orientée vers l’« ailleurs », l’« autrement » et<br />
l’« autre ». Elle apparait comme une impulsion qui part du connu, « vers un hors-de-soi<br />
étranger, vers un là-bas » 130 , vers l’invisible 131 , et la finalité de ce mouvement est « l’ailleurs<br />
ou l’autre ». Aucune excursion, aucun changement d’atmosphère ni d’environnement ne peut<br />
combler le désir qui s’y tend. L’Autre dont je désire métaphysiquement, n’est pas « autre »<br />
comme le vin que je bois, comme la maison qui m’abrite, comme l’objet que je perçois ou<br />
comme moi, car ces existants peuvent combler mes désirs et apparaitre comme s’ils m’avaient<br />
naturellement manqué. « Par là même, leur altérité se résorbe dans mon identité de pensant ou<br />
de possédant. [Or] le désir métaphysique tend vers tout autre chose, vers l’absolument<br />
autre» 132 . La conception traditionnelle du désir ne permet pas de saisir ce qu’est l’absolument<br />
Autre, car le désir ici a pour base le besoin ; le désir désignerait un étant miséreux et vague ou<br />
qui a perdu la dignité qu'il possédait. Il correspondrait à l’idée de ce qui a disparu, de quelque<br />
chose qu’il faut retrouver. Il serait plus précisément regret ou douleur du retour. Le désir dans<br />
128 La relation métaphysique n’est pas une conceptualisation, si tel était le cas, l’Autre serait absorbé dans le<br />
Même. L’Autre avec lequel le Même est en relation, n’est pas dans un autre espace. L’Autre de l’altérité ne<br />
limite pas le Même, parce que le fait de délimiter ferait perdre à l’Autre son ipséité et chuter dans la totalité<br />
129 Levinas, Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, Deuxième édition, Martinus Nijhoff, La Haye, 1965, p.3<br />
130 Ibid.<br />
131 La philosophie classique par contre va de l’inconnu au connu, puisque son souci fondamental est de<br />
démystifier tout ce qui est voilé, d’éclaircir le mystère. C’est exactement ce processus que Levinas reproche à ce<br />
mode de pensée parce qu’en violent le mystère, elle débouche plutôt sur l’Etre ou le Même au lieu de déboucher<br />
sur l’Autre. Le Moi comprends à partir de lui et retourne sur lui-même.<br />
132 Ibid.., p.3<br />
35
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
un tel contexte d’après Levinas ne quitte pas l’univers du Même qui consiste à la synthèse et à<br />
l’assimilation de l’altérité par le Même. Or, le désir au sens métaphysique va absolument à<br />
l’encontre de cette conception classique du désir. La métaphysique désigne la séparation d’un<br />
univers habituel par « un hors-de-soi étranger ». Cette mobilité nous renseigne sur la structure<br />
de Totalité et Infini dont la deuxième partie, « Intériorité et économie » est réservée à l’étude<br />
de cet univers familier et journalier là où la troisième, « Le visage et l’extériorité » est réservé<br />
à l’absolument autre qui apparait dans le visage de l’Autre. En fait, la signification que<br />
Levinas donne de la métaphysique est celle d’un « absolument Autre », qui désigne également<br />
« le visage d’Autrui ». Le rapport à Autrui est de ce fait une relation métaphysique.<br />
Le désir métaphysique, n’aspire pas à un retour, car il est désir d’un pays où<br />
nous ne naquîmes point. D’un pays étranger à toute nature, qui n’a pas été<br />
notre patrie et où nous ne nous transporterons jamais. Le désir métaphysique<br />
ne repose sur aucune parenté préalable. Désir qu’on ne saurait satisfaire 133 .<br />
Le désir métaphysique au sens levinassien est fondamentalement différent de celui<br />
exposé dans la philosophie classique, car il désire l’au-delà de tout ce qui peut aisément « le<br />
combler. Il est comme la bonté – le désiré ne le comble pas, mais le creuse » 134 . Le désir<br />
métaphysique nous plonge donc dans une excursion dans un voyage en terre étrangère, dans<br />
un univers inconnu, dans l’invisible. Le problème qui se pose ici est celui de la signification<br />
du type de relation qui se fait autour de cette notion. Levinas y donne une réponse claire<br />
lorsqu’il souligne qu’il s’agit d’une relation « dont la positivité vient de l’éloignement, de la<br />
séparation […] » 135 . La relation qui s’établit entre l’Autre et Moi est une relation de creusés.<br />
Plus elle est forte et pure, plus la séparation qui s’effectue entre nous est vaste. Le fait qu’il<br />
n’existe pas de relation au sens pur du terme est en réalité une absence de relation<br />
conceptuelle qui est, comme nous l’avons vu dans le chapitre premier, une compréhension<br />
donc un impérialisme. Le Désir métaphysique est fondamentalement insatiable, ainsi, tous les<br />
désirs qui peuvent être satisfait, comme « l’amour », ne relève pas de son univers. Les désirs<br />
pouvant être l’objet d’une quelconque satisfaction correspondent au désir métaphysique<br />
uniquement lorsque la satisfaction n’a pas été accomplie ou dans la surexcitation de la « non-<br />
satisfaction » qui représente la jouissance même.<br />
Le désir métaphysique est comme la bonté qui est une clémence sustentée par le<br />
« Désiré » et, dans cette perspective, une relation qui n’est ni extinction de la « distance », ni<br />
133 Ibid.<br />
134 Ibid., p.4<br />
135 Ibid.<br />
36
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
« rapprochement », ou, pour mieux signifier la nature de la « bonté », relation dont la<br />
positivité résulte de la distance, de la « séparation », car elle vit de son envie. Cette distance<br />
est absolue uniquement lorsque le désir ne désigne pas « la possibilité d’anticiper le désirable,<br />
s’il ne le pense pas au préalable, s’il va vers lui à l’aventure, c’est-à-dire comme une altérité<br />
absolue, inanticipable, comme on va vers la mort » 136 . Le désir est radical, exclusivement<br />
lorsque le désirant est éphémère et le « Désiré, invisible. » Cependant ce n’est pas parce que<br />
le désir nous projette dans l’invisible qu’on pourrait dire qu’il désigne l’absence de relation, le<br />
désir métaphysique nous met en rapport avec l’inconnu, ce qui n’a pas d’idée : « le mystère ».<br />
La vision est la concordance entre la pensée et l’objet : compréhension qui réunit en un tout.<br />
Le défaut d’adéquation ne signifie pas simplement une négation ou une obscurité de la<br />
pensée, mais, hors de la lumière et du noir, hors du savoir mesurant des étants, le manque de<br />
mesure du Désir.<br />
« Le Désir est désir de l’absolument Autre » 137 . Le désir métaphysique n’est pas<br />
comparable à ceux du corps, de la faim ou de la soif qui trouvent satisfaction, la métaphysique<br />
désire l’Autre au-delà de la satisfaction sans qu’aucune action ne soit possible pour étancher<br />
sa soif. « Désir sans satisfaction qui, précisément, entend l’éloignement, l’altérité et<br />
l’extériorité de l’Autre. Pour le Désir cette altérité, inadéquate à l’idée, a un sens. Elle est<br />
entendue comme altérité d’Autrui et comme celle du Très-Haut » 138 . Nous précisons que la<br />
réduction même de la hauteur se fait grâce au Désir métaphysique. La particularité du Désir<br />
métaphysique est qu’il nous plonge dans une dimension de hauteur et cette dernière avec<br />
Levinas n’est pas le ciel 139 , mais « l’In-visible ». Faire de la métaphysique d’après Levinas<br />
signifie : « Mourir pour l’invisible » 140 . Néanmoins cela ne signifie pas que le Désir n’admet<br />
pas d’actes. Seulement les actes que le Désir admet ne s’apparentent pas à l’acte de<br />
consommer, ni de l’affection, ni de l’ordre des cérémonies et des prières qui constituent le<br />
service divin. La métaphysique n’est pas dans le toucher, elle est relation sociale, inquiétude<br />
pour le prochain et pour sa mort. Elle est enseignement, relation originelle avec l’extériorité<br />
qui empêche toute restauration de la totalité. Elle est liberté de celui qui se laisse enseigner<br />
par Autrui.<br />
136 Ibid.<br />
137 Ibid., p.4<br />
138 Ibid.<br />
139 « Je suis incapable d’admettre qu’il ait d’autre étude faisant regarder l’âme en haut, sinon celle qui se<br />
rapportent au réel qu’est l’invisible. » cf. Platon, République, 529 b.<br />
140 Levinas, Totalité et Infini, Op cit., p.5<br />
37
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Cette prétention levinassienne de l’invisible parait absurde, car elle va à l’encontre de<br />
l’expérience des hommes du XX e siècle qui pensent que les idées des êtres humains sont<br />
transportées par des « besoins, lesquels expliquent société et histoire ; que la faim et la peur<br />
peuvent avoir raison de toute résistance humaine et de toute liberté » 141 . Levinas ne refuse pas<br />
que le monde est fait d’objets et d’hommes cruels qui ensauvagent l’humanité. Il ajoute même<br />
que pour être homme, il faut savoir et admettre que c’est de cette manière que le monde<br />
fonctionne. « La liberté consiste à savoir que la liberté est en péril. Mais savoir ou avoir<br />
conscience, c’est avoir du temps pour éviter et prévenir l’instant d’inhumanité » 142 . C’est<br />
donc ce renvoi constant de l’instant de la traitrise – petite dissemblance entre l’être et la bête<br />
« – qui suppose le désintéressement de la bonté, le désir de l’absolument Autre ou, la<br />
noblesse, la dimension de la métaphysique » 143 .<br />
En fait, le point principal de notre analyse jusqu’à présent s’illustre par la volonté<br />
levinassienne qui est de quitter le cercle ontologique. Contrairement à la conception<br />
ontologique qui signifie toute compréhension par le Même, restreint le sens et la signification<br />
de l’existence à l’intérieur de la Totalité, Levinas élabore une pensée de l’ouverture qui se<br />
fonde sur le concept de « désir métaphysique » qui déconstruit le cercle ontologique pour<br />
chuter dans « l’In-visible ». Le Désir métaphysique est comme une perdition qui crée une<br />
ouverture dans l’Etre en projetant le désiré dans un monde étranger, inconnu et invisible où<br />
tout pouvoir d’assimilation de l’altérité par le Même est impossible. Le Désir au sens<br />
levinassien va au-delà de la conception classique, car ici l’être est en présence de l’inconnu, il<br />
montre également que l’être a la capacité de s’extraire de la totalité en désirant « l’ailleurs »,<br />
l’irrationalisable. La relation qui s’effectue dans le Désir de l’In-visible ne résulte pas de<br />
l’ordre de la com-préhension, ni du sensible. Par conséquent, toute relation autre que<br />
métaphysique est d’après Levinas une relation d’assujettissement de l’Autre par le Même. La<br />
spécificité de la relation métaphysique est d’être une relation sans lien, une relation sans<br />
concept, ou de préférence une relation dont le liant est la « séparation », relation qui dans le<br />
contexte de la logique traditionnelle est une contradiction. C’est l’an-archie interpersonnelle.<br />
C’est dans cette perspective que Levinas montre que la relation qui se fait entre le désirant et<br />
le désiré est dite asymétrique, cette « asymétrie » 144 étant perçue comme dimension de la<br />
141 Ibid.<br />
142 Ibid.<br />
143 Ibid.<br />
144 Nous expliciterons amplement ce concept dans la deuxième partie de ce travail au niveau de la « Relation<br />
asymétrique »<br />
38
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
hauteur. Ce faisant, l’invisibilité qui s’établit dans le désir métaphysique dégage une<br />
dimension de hauteur entre le désirant et le désiré. C’est ce qui permettra à Levinas dans la<br />
suite du texte d’affirmer que l’Autre est supérieur à moi, Autrui me dépasse totalement de par<br />
sa hauteur. Ce « Désir métaphysique » ou de « l’In-visible » devient réel uniquement lors de<br />
la rencontre de l’Autre et son épiphanie dans le visage. Toutefois avant d’en venir à cette<br />
thématique, nous allons d’abord dire un mot sur la disposition indispensable à la subjectivité<br />
et qui permet l’accueil de l’altérité de l’Autre, à savoir l’existence dans la jouissance.<br />
II. Jouissance comme premier événement de la séparation<br />
Le Moi compris comme exister pur et séparé de toute subsomption est une modalité<br />
indispensable pour l’élévation d’une relation forte à Autrui ou d’un rapport entre deux sujets<br />
absolument irréductibles l’une à l’autre. C’est pourquoi Levinas cherche d’abord les principes<br />
de formation d’une subjectivité « indépendante ou séparée » ; séparation par rapport à sa<br />
dépendance aux commandements de l’Être. C’est donc dans l’idée de jouissance que Levinas<br />
découvre l’axe qui permet au sujet de se séparer de l’Etre. La jouissance est le mode premier<br />
de l’exister du sujet, elle désigne « la première étape de la séparation » qui est en fait une<br />
potentialité qui permet à la subjectivité de s’extraire de son emprisonnement dans l’Etre pour<br />
aboutir à un exister libre. L’exister du sujet dans la jouissance est fondamentale opposition à<br />
l’Être.<br />
La jouissance (…) [est] le frisson même du moi. Nous nous y maintenons<br />
toujours au deuxième degré qui, cependant, n’est pas encore celui de la<br />
réflexion. Le bonheur où nous nous mouvons déjà par le simple fait de vivre,<br />
est, en effet, toujours au-delà de l’être où sont taillées les choses 145 .<br />
La jouissance est l’acte par lequel le sujet s’extrait de la totalité du Même, se sépare de<br />
l’Etre pour obtenir une indépendance et une individualité. Par la jouissance, l’étant préserve<br />
son ipséité en supplantant le statut d’existant neutre, anonyme et de dépendant qu’il arborait<br />
dans la Totalité par un exister autonome.<br />
Nous vivons de bon mets, d’oxygène, de distraction, de pensée, de lumière, de repos,<br />
d’activités, seulement là il ne s’agit pas des objets de la réflexion, car nous en jouissons. Ce<br />
qui nous permet de vivre, n’est pas aussi « un moyen de vie », comme la guitare est un moyen<br />
par rapport à la musique qu’elle permet de produire ; ni un dessein de la vie, comme la<br />
représentation est le but de l’art. Les choses qui nous permettent de vivre ne sont pas des<br />
145 Ibid., p.85<br />
39
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
objets, ni même des « ustensiles », comme le pense Heidegger. Leur existence ne se termine<br />
pas dans l’usage qu’on en fait, comme l’existence des masses, des pointes ou des appareils.<br />
Elles existent toujours, toutes formes d’objets demeurent aussi, comme objet de jouissance, se<br />
donnant à la saveur, déjà enjolivée. Par ailleurs, tandis que l’usage de l’outil suppose la<br />
finalité et désigne une subordination envers l’autre, « vivre de … » affirme plutôt la liberté<br />
même, la liberté de la jouissance et de sa félicité qui est le premier dessein de toute<br />
indépendance.<br />
Le « vivre de… » dans lequel la vie se manifeste dans son instantanéité même, en sa plus<br />
pure innocence, est l’événement de la séparation du sujet au sens général : « le besoin est le<br />
premier mouvement du Même » 146 . Le besoin est toujours sous mon contrôle, il me représente<br />
en tant que moi et non en tant qu’auxiliaire de l’Autre. Par la maîtrise de mes besoins, « je<br />
suis individué » 147 .<br />
Platon, en critiquant les plaisirs qui accompagnent la satisfaction des besoins et en les<br />
qualifiant de trompeurs, perçoit dans le besoin un aspect négatif : « il serait un moins, un<br />
manque que comblerait la satisfaction » 148 . La nature du besoin résulterait du besoin de se<br />
soulager, dans le mal. Levinas pense au contraire qu’on ne devrait pas se limiter dans une telle<br />
conception qui saisit le besoin uniquement au stade de la pauvreté, car cette dernière est un<br />
danger que court l’homme qui rompt avec la situation « animale et végétale ». Le sens du<br />
besoin, malgré ce danger, est dans cette séparation. Concevoir le besoin comme un simple<br />
manque, c’est le penser au cœur d’une communauté désorganisée qui ne lui donne ni le temps,<br />
ni la conscience. C’est l’intervalle existant entre l’être et le monde dont il appartient – qui<br />
signifie la nature du besoin. L’être se sépare du monde dont il dépend. Il s’agit là d’une libre<br />
dépendance. Dans son instantanéité, le besoin ne se souvient pas du manque, néanmoins nous<br />
installe en face, et, de ce fait, nous éloigne de ce dont nous avons besoin. « C’est la distance<br />
s’intercalant entre l’homme et le monde dont il dépend – qui constitue l’essence du besoin<br />
» 149 . Le besoin nous met en rupture : nous avons besoin de ce qui est à nous, tout en étant<br />
différent de ce dont nous avons besoin. Le besoin désigne donc le mouvement de la séparation<br />
puisque dans la séparation, l’être se défait d’un univers dont cependant il se « nourrit ». C’est<br />
ce qui nous permet d’affirmer avec Levinas que l’être humain est heureux dans ses besoins.<br />
146 Ibid., p.88<br />
147 Silvano Petrosino et Jacques Rolland, La vérité nomade, Introduction à Emmanuel Levinas, Editions La<br />
Découverte, Paris, 1984<br />
148 Levinas, Totalité et Infini, Op cit., p.88<br />
149 Ibid.<br />
40
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Ce bonheur est celui de l’instantanéité du besoin dans lequel, le sujet se séparant pour la<br />
première fois de « l’existence sans existant » - de l’Être, mute en sujet. De manière succincte,<br />
le besoin ne saurait se comprendre uniquement dans la conception platonicienne où il apparait<br />
comme un « manque », ni dans la morale Kantienne où il apparait comme « pure passivité »,<br />
car « L’être humain se plait dans ses besoins, il est heureux de ses besoins » 150 . La complexité<br />
du « vivre de quelque chose » ou comme le souligne Platon, le délire de ces satisfactions, est<br />
dans une bienveillance à l’égard de ce qui asservit la vie. « Non pas maitrise d’une part et<br />
dépendance d’autre part, mais maitrise dans cette dépendance » 151 . Dans le « vivre de… », la<br />
servitude devient autonomie, joie particulièrement égoïste.<br />
Besoin et jouissance ne sont pas des concepts qui se comprennent sous les catégories de<br />
puissance et d’acte, même s’ils sont confus dans le concept de « liberté finie ». « La<br />
jouissance, dans la relation avec la nourriture qui est l’autre de la vie, est une indépendance<br />
sui generis 152 , l’indépendance du bonheur. La vie qui est vie de quelque chose, est bonheur.<br />
La vie est effectivité et sentiment. Vivre c’est jouir de la vie 153 .» La déception dans la vie n’a<br />
de sens que parce que l’existence est, joie. La peine est un défaut du bien-être et « il n’est pas<br />
exact de dire que le bonheur est une absence de souffrance » 154 . Le besoin n’est pas constitué<br />
d’un manque de besoins dont on infirme la dictature et la spécificité infligée, mais le plaisir de<br />
tous les besoins. C’est que le défaut du besoin, n’est pas une « privation » insignifiante, mais<br />
celle dans un être qui sait l’excédent du bonheur, la suppression dans un être satisfait. « Le<br />
bonheur est accomplissement » 155 : il est dans un esprit satisfait et non dans un esprit ayant<br />
supprimé ses besoins, « âme châtrée ». C’est donc parce que l’existence est bonheur que pour<br />
Levinas, elle est strictement personnelle. « La personnalité de la personne, l’ipséité du moi,<br />
plus que la particularité de l’atome et de l’individu, est la particularité du bonheur de la<br />
jouissance » 156 .<br />
Le besoin précède toute situation d’existence, parce qu’il en est la modalité. Le dessein du<br />
« vivre de… » identique à la jouissance sera certainement signifié, mais d’une manière<br />
spécifique : dans cette équivalence elle-même. « Nous respirons pour respirer, mangeons et<br />
150 Ibid., p.88<br />
151 Ibid.<br />
152 Sui generis : Locution latine qui signifie "en son genre". Elle est employée en français pour dire "particulier",<br />
"spécial".<br />
153 Ibid.<br />
154 Ibid.<br />
155 Ibid.<br />
156 Ibid.<br />
41
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
buvons pour manger et pour boire, nous nous abritons pour nous abriter, étudions pour<br />
satisfaire à notre curiosité, nous nous promenons pour nous promener. Tout cela n’est pas<br />
pour vivre. Tout cela est vivre. Vivre est sincérité » 157 et la jouissance est cette « sincérité ».<br />
Autrement dit, la jouissance se manifeste comme la vérité du besoin, en tant qu’elle en<br />
exprime l’instantanéité. Le sujet se sépare de la pure vie en tant qu’il jouit de l’existence, en<br />
tant qu’elle lui est propre avant tout compromis entre la pensée et la vérité. On jouit d’ores et<br />
déjà, on jouit dans l’espérance de la jouissance, on jouit de jouir. « Avant toute réflexion,<br />
avant tout retour sur soi, la jouissance est jouissance de la jouissance » 158 . Par ailleurs à la<br />
question de l’homme, Levinas précise que « le monde répond à un ensemble de finalité<br />
autonome qui s’ignorent. Jouir sans utilité, en pure perte, gratuitement, sans renvoyer à rien<br />
d’autre, en pure dépense – voilà l’humain » 159 .<br />
Vivre, c’est jouer en dépit de la finalité et de la tension de l’instinct ; vivre<br />
de quelque chose sans que ce quelque chose ait le sens d’un but ou d’un<br />
moyen ontologique, simple jeu ou jouissance de la vie. […] Dans la<br />
jouissance, je suis absolument pour moi. Egoïste sans référence à autrui –<br />
je suis seul sans solitude, innocemment égoïste et seul 160 .<br />
En effet, c’est précisément dans cette solitude innocente qu’existe la positivité novatrice<br />
de la jouissance à une dimension qui vient avant « l’intentionnalité possessive ». Bien plus, la<br />
question de la possession est capitale dans la pensée levinassienne surtout dans l’intériorité<br />
économique où Levinas analyse les relations qui se produisent dans le Même et montre<br />
l’interface de la séparation. Le projet exact de la séparation n’est pas identique à celui des<br />
autres relations, car il est, à la fois, distance et unité des termes. « Dans la séparation, l’union<br />
des termes maintient la séparation dans un sens éminent. L’être, dans la relation, s’absout de<br />
la relation, est absolu dans la relation » 161 . Son sens exact, affirme la rupture comme existence<br />
interne, ou comme pensée. Cependant cette intériorité se manifestera, à son heure, comme<br />
« une présence chez soi », ce qui signifie « habitation et économie ».<br />
En fait, ce que Levinas veut montrer lorsqu’il accentue sur la différence entre l’innocence<br />
originelle et le mouvement de la possession, c’est la qualité de précédent a priori que recèle la<br />
jouissance en tant que modalité de la séparation. Le processus et la façon dont se construit le<br />
157<br />
Levinas, De l’existence à l’existant, Ed. de la revue Fontaine, Paris, 1947 ; Deuxième éd., Vrin, Paris, 1977,<br />
p.67<br />
158<br />
Idem, Autrement qu’être ou Au-delà de l’essence, M. Nijhoff, la Haye, 1974, p.92<br />
159<br />
Idem, Totalité et Infini, Op. cit., p.105<br />
160 Ibid., p.107<br />
161 Ibid , p.82<br />
42
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
duo « jouissance-innocence » étant compris, nous permet maintenant de comprendre enfin en<br />
quoi consiste, l’avènement du sujet par les termes de Levinas :<br />
L’intériorité qu’ouvre le monde de la jouissance ne s’ajoute pas comme un<br />
attribut du sujet ‘’doué’’ de vie consciente, comme propriété psychologique<br />
entre autres. L’intériorité de la jouissance est la séparation en soi, le mode<br />
selon lequel un évènement tel que la séparation peut se produire dans<br />
l’économie de l’être. Le bonheur est un principe d’individuation, l’autopersonnification,<br />
la substantialisation et l’indépendance du soi […]. La<br />
jouissance est la production même d’un être qui nait, qui rompt l’éternité<br />
tranquille de son existence séminale ou utérine pour s’enfermer en une<br />
personne, laquelle, vivant du monde, vit de soi 162 .<br />
La jouissance est la modalité première de l’exister du sujet. Nous insistons sur le terme<br />
« exister du sujet » parce que, dans la jouissance, le sujet est d’ores et déjà en opposition avec<br />
l’Être. Par la jouissance, le sujet s’évade de l’Être, il se sépare de ce dernier afin d’obtenir<br />
une souveraineté et une singularité absolue. L’origine de la subjectivité résulte de la liberté et<br />
de la « souveraineté de la jouissance». La subjectivation du sujet n’est pas entièrement<br />
accomplie dans la jouissance. Pour qu’elle puisse atteindre la réflexivité, il lui faut parvenir à<br />
la relation avec la transcendance qui apparait sous le concept de réflexion de la réflexion. Le<br />
sujet jouissant est aimanté par le « Désir métaphysique » qui l’amène à rechercher<br />
« l’absolument Autre », altérité radicale qui se dévoile dans la rencontre du visage de l’Autre.<br />
De manière succincte, le but de la jouissance est d’apprêter à la relation avec une<br />
transcendance radicale, celle de l’Autre. Il ne faut pas pour autant penser que la séparation de<br />
la subjectivité n’a pas d’exister libre, comme si son être était totalement soumis à cette<br />
préparation à l’accueil du visage d’Autrui. Au contraire, le fondement même de la subjectivité<br />
est d’être libre, ce qui fait que le sujet se manifeste chez Levinas comme pré-transcendance,<br />
c’est-à-dire un sujet pratiquement indépendant. Sans la situation liminaire de la subjectivité et<br />
la séparation de son rapport avec l’être qui en résulte, « le face-à-face » 163 avec l’Autre ne<br />
serait pas possible.<br />
162<br />
Ibid., p.121<br />
163<br />
La relation avec l’Autre se manifeste comme le « face-à-face » d’un rapport sans médiateur ou tiers, elle n’est<br />
pas union autour d’un troisième terme, vérité, dogme, œuvre, travail. Au contraire le Miteinandersein ( Etre-l’unavec-l’autre<br />
ou être ensemble) heideggérien est un « nous qui sent l’autre à côté de soi et non pas en face de soi »<br />
ou davantage une « collectivité de camarades autour de quelque chose de commun. » (EE, p. 162) Par ailleurs, «<br />
L’originalité […] de l’eros a échappé à Heidegger, qui, dans ses cours, tend à présenter la différence des sexes<br />
comme une spécification d’un genre. » (Ibid., 164.)<br />
43
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
III. L’épiphanie d’Autrui dans le visage comme rupture de la Totalité<br />
La jouissance est la manifestation première de la subjectivité. Cependant le sujet dans<br />
cette mouvance ne se sépare pas indéfiniment de la Totalité lorsqu’il en demeure encore au<br />
niveau de la jouissance, que l’on pourrait encore appeler niveau du narcissisme liminaire de la<br />
subjectivité. L’individu continue d’être sous l’emprise du Même lorsqu’il vit exclusivement<br />
de jouissance, il deviendra sujet véritable uniquement lors de sa rencontre avec le visage de<br />
l’Autre. Ainsi, c’est le visage d’Autrui qui parachève la séparation avec la Totalité. Mais, ce<br />
visage n’est pas perçu, il se dévoile plutôt sous forme d’épiphanie 164 . Il n’est pas perçu parce<br />
que la vision est domination de ce qui est perçu, elle claustre la chose vue dans un thème,<br />
c’est pourquoi Levinas s’oppose à la philosophie husserlienne qui fait de l’intentionnalité le<br />
rapport majeur et exclusif du sujet au monde. Selon Levinas, en-deçà de la relation<br />
intentionnelle, se trouve l’épiphanie d’Autrui comme visage. « Le visage arrête la<br />
totalisation» 165 , il s’oppose donc au mouvement intentionnel parce qu’il remet en cause ma<br />
volonté de domination. La relation avec le visage peut certes être dominée par la perception,<br />
mais ce qui spécifie le visage, c’est sa qualité irréductible. Ce que Levinas désigne par le<br />
terme visage, c’est précisément cette exceptionnelle manifestation de soi, sans commune<br />
mesure avec la manifestation des réalités simplement données.<br />
Penser le visage c’est penser le paradoxe et accepter de mener une existence dans des<br />
conditions limites. « Absence » et proximité 166 , face-à-face et invisibilité 167 , « droiture » et<br />
mystère 168 , sont autant de dialogues que l’épiphanie du visage engendre dans la vie de<br />
l’individu. Sentir le visage, c’est être affecté par son épiphanie avant même d’avoir eut la<br />
possibilité de le toucher du regard, parce que « le visage est présent dans son refus d’être<br />
contenu. Dans ce sens il ne saurait être compris, c’est-à-dire englobé » 169 . Il n’est ni vu, ni<br />
effleuré, parce que dans la vision ou le « tactile », l’unicité du Même englobe l’altérité de la<br />
chose qui par la suite mute en « contenu ». L’intentionnalité comme nous l’avons examiné<br />
164<br />
Fête de la manifestation de Jésus aux Mages, appelée aussi jour ou fête des Rois.<br />
165<br />
Levinas, Totalité et Infini, Op. cit., Ibid., p.258<br />
166<br />
«La relation qui va du visage à l’Absent, est en dehors de toute révélation et de toute dissimulation, une<br />
troisième voie exclue par ces contradictoires [...]. Le visage est précisément l’unique ouverture où la signifiance<br />
du Transcendant n’annule pas la transcendance pour la faire entrer dans un ordre immanent, mais où, au<br />
contraire, la transcendance se maintient comme transcendance toujours révolue du transcendant». Cf. En<br />
découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, p. 198.<br />
167<br />
«Le visage de l’homme — c’est ce par quoi l’invisible en lui est visible et en commerce avec nous». Cf.<br />
Levinas, Difficile liberté, pp. 187-188.<br />
168<br />
Le visage permet de cogiter sur la présence espacé de l’Autre. La manifestation du visage provient des<br />
hauteurs. Elle enseigne tout en admettant la possibilité de la vérité et du mensonge. Cf. Totalité et Infini, p. 62<br />
169<br />
Levinas, Totalité et Infini, Op cit., p.168<br />
44
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
chez Husserl est le pouvoir du Même, mais l’irruption du visage d’Autrui remet en cause ce<br />
pouvoir. C’est en conséquence cette remise en cause des capacités du Même qui confère à<br />
l’Autre sa transcendance vue comme « Infini », Infini qui d’après Levinas « ne saurait être<br />
thématisé et la distinction entre raisonnement et intuition ne convient pas à l’accès à l’infini.<br />
[…] l’idée de l’infini ne m’est pas objet. […] Dieu, c’est l’Autre » 170 . Si l’Autre est donc<br />
infiniment transcendant, ce n’est pas parce qu’il est plus fort que le Même, mais parce qu’il a<br />
la capacité de remettre en cause le pouvoir du Même. Grâce à sa disposition<br />
incommensurable, il demeure le seul et l’unique qui ne saurait être thématisé par le Même. Il<br />
est plus grand que moi parce qu’il s’évade de toute prise et préhension possible. Cette<br />
capacité d’extraction de la Totalité apparait dans les différentes figures contradictoires<br />
qu’Autrui peut arborer : il est simultanément la « veuve », « l’étranger » et « l’orphelin » mais<br />
également le « Maître ».<br />
En fait, « Autrui n’est pas autre d’une altérité relative comme, dans une comparaison » 171 .<br />
Les races, malgré qu’elles s’excluent, se tiennent dans le même concept de « genre » ; certes<br />
elles ne sont pas semblables du point de vue de leur nature, mais elles sont liées l'un l'autre de<br />
par ce rejet à travers l’association de genre. « L’altérité d’Autrui ne dépend pas d’une<br />
qualité quelconque qui le distinguerait de moi, car une distinction de cette nature impliquerait<br />
précisément entre nous cette communauté de genre qui annule déjà l’altérité » 172 . Autrui et<br />
moi n’appartenons à aucune catégorie, nous ne pouvons pas être inscrit dans une communauté<br />
de genre puisque nous sommes absolument distincts, non-catégorisables, non-totalisables et<br />
notre mode d’être est d’être sans concept.<br />
La relation entre Autrui et moi n’aboutit ni au nombre, ni au concept. « Autrui est<br />
infiniment transcendant, infiniment étranger, - mais son visage où se produit son épiphanie et<br />
qui en appelle à moi » 173 se sépare de l’univers qui peut nous être collectif et dont les<br />
« virtualités » s’intègrent dans notre essence et que nous exprimons également par notre vie.<br />
Mais, il faut souligner avec Levinas que « la parole procède de la différence absolue » 174 . Ou<br />
plus précisément, une différence radicale ne se réalise pas dans un processus d’identification<br />
où, « descendant de genre à espèce », la hiérarchie des rapports logiques heurte contre le<br />
170 Ibid., p.186<br />
171 Ibid., p.168<br />
172 Ibid.<br />
173 Ibid.<br />
174 Ibid.<br />
45
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
donné, lequel n’exprime pas en relations ; la dissemblance perçue demeure dépendante de<br />
l’ordre logique sur laquelle elle s’exprime et se présente sur la toile du « genre commun ».<br />
L’altérité radicale, qui reste incompréhensible dans le contexte de la « logique formelle »,<br />
se fait uniquement par le « langage ». Le langage réalise un rapport entre des termes qui<br />
détruisent l’uniformité d’un « genre ». Les notions, les interlocuteurs, « s’absolvent de la<br />
relation ou demeurent absolus dans la relation » 175 . Le langage peut donc se définir comme<br />
l’activité qui brise l’éternité de « l’être ou de l’histoire ». L’œuvre du langage consiste à<br />
manifester le transcendant. Le langage est relation entre des termes absolument séparés. À<br />
l’un tout comme à l’autre, ils peuvent certes apparaitre sous forme de thème, mais leur<br />
présence réciproque ne s’abolit pas dans cet état thématique. « La parole qui porte sur autrui<br />
comme thème semble contenir autrui. Mais déjà elle se dit à Autrui qui, en tant<br />
qu’interlocuteur, a quitté le thème qui l’englobait et surgit inévitablement derrière le dit » 176 .<br />
La parole renferme le silence qui manifeste cette disparition de l’Autre et la séparation du<br />
Même. Le discours précède toute « thématisation », il s’agit d’un rapport avec ce qui existe en<br />
dehors de toute thématisation, c’est-à-dire « le mystère », l’Autre ou l’Etranger. Précéder<br />
toute thématisation, signifie avant toute emprise ou toute ouverture sur l’Être. Ainsi, nous<br />
voyons pourquoi « le rapport avec le langage suppose la transcendance, la séparation radicale,<br />
l’étrangeté des interlocuteurs, la révélation de l’Autre à moi », que « le langage se parle là où<br />
manque la communauté entre les termes de la relation » 177 . Traduit à partir du « Dire », le<br />
langage évoque « un rapport » de communication qui devance toute communication de<br />
contenu entre des termes qui sont absolument différents. Relation qui se limite à une<br />
signification dont l’être se fait signe avant de transmettre des signes.<br />
L’épiphanie du visage est langage, car « la manifestation du visage est le premier<br />
discours» 178 qui s’illustre dans la tradition chrétienne à travers le cinquième amendement 179 .<br />
La présence du visage est parole et cette dernière n’exprime pas un univers externe, clos a<br />
priori, congédiant ainsi « une nouvelle région à comprendre ou à prendre. Elle m’appelle, au<br />
175 Ibid., p. 169<br />
176 Ibid., p.169<br />
177 Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, M. Nijhoff, La Haye, 1974, p.45<br />
178 Le langage me met en relation avec les autres. Il est manifestation du visage. Selon Levinas : «Autrui qui se<br />
manifeste dans le visage, perce, en quelque façon sa propre essence plastique, comme un être qui ouvrirait la<br />
fenêtre où sa figure pourtant se dessinait déjà. Sa présence consiste à se dévêtir de la forme qui cependant déjà le<br />
manifestait. Sa manifestation est un surplus sur la paralysie inévitable de la manifestation. C’est cela que nous<br />
décrivons par la formule : le visage parle. La manifestation du visage est le premier discours. Parler c’est, avant<br />
toutes choses, cette façon de venir de derrière son apparence, de derrière sa forme, une ouverture dans<br />
l’ouverture» : (cf. HH., p. 51) ; voir également En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, p. 194.<br />
179 Nous expliciterons cette idée dans la seconde partie de cet essai<br />
46
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
contraire, au-dessus du donné que la parole met déjà en commun entre nous » 180 . Ce qu’on<br />
offre, « ce qu’on prend, se réduit au phénomène, découvert en offert et à la prise, trainant une<br />
existence qui se suspend dans la possession » 181 . Et pourtant la manifestation du visage me<br />
met en relation avec l’être. « L’exister de cet être – irréductible à la phénoménalité, comprise<br />
comme réalité sans réalité – s’effectue dans l’ajournable urgence avec laquelle il exige une<br />
réponse » 182 . Cette réplique est différente de la « réaction » qui provoque le fait, car il n’est<br />
pas possible pour elle de demeurer « entre nous », comme lors des décisions je tiens<br />
relativement à une chose. Tout ce qui se passe dans cette relation – ce « entre nous »<br />
transcende l’espace privée pour s’installer dans l’espace public, il est à la porté de tout<br />
homme, le visage qui l’observe se tient en plein jour de l’ordre public, même si je m’en<br />
éloigne en recherchant avec la personne dont je dialogue la connivence d’une relation<br />
personnelle et secrète.<br />
« Le langage comme présence du visage » 183 , n’appelle pas à la « complicité » avec l’être<br />
aimé, au « je-tu » se suffisant et indifférent du monde. Il se refuse dans sa droiture au mystère<br />
de l’amour dans lequel il perd sa droiture et son sens et se transforme en plaisanterie. « Le<br />
tiers me regarde dans les yeux d’autrui – le langage est justice » 184 , il n’est pas voilement,<br />
mais dévoilement. Toutefois il faut souligner que le visage ne se révèle pas d’abord et que par<br />
la suite l’être qu’il manifeste, se préoccupe de justice. « L’épiphanie du visage comme visage,<br />
ouvre l’humanité. Le visage dans sa nudité de visage me présente » la misère du pauvre, de la<br />
veuve, de l’orphelin et de l’étranger ; « mais cette pauvreté et cet exil qui en appelle à mes<br />
pouvoirs comme des donnés, restent expression du visage » 185 . La condition sine qua none du<br />
langage reste et demeure l’altérité.<br />
Le discours est le fait d’un être séparé qui ne construit pas sa vérité sur l’assimilation de<br />
l’Autre dans le sens du Même, mais qui rencontre l’Autre dans un face-à-face. Le langage<br />
suppose donc la séparation du Même par rapport à l’Autre dans la pensée levinassienne. La<br />
rencontre de l’Etranger se réalise dans un intervalle radical et indispensable. Autrui,<br />
l’Etranger aborde le Moi de toute sa « hauteur », dans l’intégralité de sa transcendance. Nous<br />
précisons que « Le terme de ‘‘transcendance’’ signifie précisément le fait qu’on ne peut<br />
180<br />
Levinas, Totalité et Infini, op cit., p.187<br />
181<br />
Ibid., p.186<br />
182<br />
Ibid., p.187<br />
183<br />
Ibid.<br />
184<br />
Ibid., p.188<br />
185<br />
Ibid., p.188. Pour les deux citations<br />
47
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
penser Dieu et l’être ensemble. De même, dans la relation interpersonnelle, il ne s’agit pas de<br />
penser ensemble moi et l’autre, mais d’être en face. La véritable union ou le véritable<br />
ensemble n’est pas un ensemble de synthèse, mais un ensemble de face à face » 186 . La vérité<br />
du discours est dans la manière dont on aborde Autrui. Si la parole est assimilation,<br />
subséquemment le langage n’est que rhétorique. Dans cette perspective, le discours ne<br />
cherche pas à rencontrer l’Etranger néanmoins à violer et à abuser de lui par le mensonge<br />
manifesté dans un sophisme. Aborder Autrui de face, comme nous le verrons dans la<br />
deuxième partie de ce travail, c’est lui rendre justice en le « laissant être » sans vouloir le «<br />
dévoiler ». L’Autre est le canton de la mise en vérité du Moi.<br />
La relation entre le Même et l’Autre ne peut être renversée ni inversée, car la réversibilité<br />
d’une relation où les notions peuvent se traduire dans tous les sens, peut assimiler l’un à<br />
l’autre en les réduisant au Même. « L’altérité, l’hétérogénéité radicale de l’Autre, n’est<br />
possible que si l’Autre est autre par rapport à un terme dont l’essence est de demeurer au point<br />
de départ, de servir d’entrée dans la relation, d’être le Même non pas relativement, mais<br />
absolument » 187 . L'extériorité de l'Autre est irréductible, car Autrui en tant qu’énigme<br />
provient de l’extérieur et, par conséquent, il ne se manifeste pas dans la sphère du Même dans<br />
sa totale visibilité puisqu’il est visible-invisibilité et sans concept.<br />
L’unique éventualité d’assimiler Autrui doit nécessairement passer par le meurtre qui<br />
d’ailleurs est un échec parce qu’il porte au paroxysme l’incommensurabilité d’Autrui. La<br />
disposition est en conséquence la suivante : l’individu qui vit originellement de jouissance, et<br />
de ce fait de pouvoir, fait face à une expérience qui le transcende excessivement et qui remet<br />
en question sa volonté de domination. Cette expérience est la rencontre du visage d’Autrui qui<br />
met totalement fin au règne de la subjectivité liminaire de la jouissance et qui introduit le sujet<br />
dans la relation métaphysique 188 . Cette relation d’après Levinas est la relation la plus<br />
originelle qui soit, au sens où avant la rencontre d’Autrui, le sujet ne peut être compris comme<br />
un être pensant et moral. C’est la rencontre du visage d’Autrui qui achève la subjectivation du<br />
sujet qui avait débuté dans la jouissance. C’est grâce à la jouissance et à la séparation que le<br />
sujet fait face à la transcendance, mais c’est le fait d’être confronté à la transcendance radicale<br />
qui permet au sujet d’être un sujet fini.<br />
186 Levinas, Ethique et infini, op. cit, pp. 71-72.<br />
187 Idem, Totalité et Infini., op cit., p. 6<br />
188 Relation éthique ou métaphysique<br />
48
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Conclusion partielle<br />
Parvenu au terme de cette première analyse où il était question d’examiner la question de<br />
l’impact de l’immanence de l’Être sur l’Autre dans l’histoire de la philosophie, nous avons<br />
constaté avec Levinas que cette question a eut une résolution unique et violente en occident.<br />
Dans la philosophie occidentale, l’altérité d’Autrui n’est pas considérée comme « Autre »,<br />
mais comme « autre » parce que dans cette conception l’Etre est l’unique absolu. Toute la<br />
philosophie occidentale d’après Levinas s’est manifestée comme « une destruction de la<br />
transcendance » 189 dans la mesure où le savoir est resté assujetti à l’idée de « Totalité » au lieu<br />
de s’ouvrir, autrement, sur l’idée de l’Infini. L’occident s’est limité à mener une existence<br />
sous l’empire du Même, ne parvenant pas à s’ouvrir et à répondre à la transcendance 190 propre<br />
qui anime la métaphysique, c’est-à-dire celle de l’autre homme. L’histoire de la philosophie<br />
occidentale est une histoire de l’ontologie, de la puissance, de l’impérialisme du Même, de<br />
l’égologie, de la domination qui fut l’enseignement de Socrate qui consiste à ne rien admettre<br />
de l’Autre sinon ce qui existe en moi, comme si, de toute éternité, je détenais ce qui me vient<br />
de l’extériorité 191 . L’altérité d’Autrui dans ce mode de pensée est réduite au Même, Autrui est<br />
traité comme genre et « ramené au rien » 192 , puisque son altérité se trouve profanée par le<br />
mouvement du savoir qui consiste à réduire conceptuellement, à démystifier, l’in-connu dans<br />
l’optique de dégager ce qu’il a de plus intime. Contre cette perspective ontologique, il y a eu,<br />
peu de contestations dans l'histoire de la philosophie. C’est justement toute la marche de la<br />
philosophie occidentale aboutissant à la philosophie systématique de Hegel, laquelle,<br />
assurément, peut d’après Levinas « apparaître comme l'aboutissement de la philosophie<br />
même» 193 .<br />
La pensée de Levinas trouve certes son origine dans la philosophie phénoménologique de<br />
Husserl, puis dans celle de Heidegger, mais elle s'en dégage progressivement à cause de la<br />
tendance ontologique qui se dégage à travers les philosophés de ces auteurs. Certes, Levinas<br />
approuve l’intentionnalité dégagée dans la phénoménologie husserlienne, parce que<br />
contrairement à la philosophie classique, elle promeut l’idée d’une transcendance au sens<br />
189 Levinas, « Dieu et la philosophie », in Le Nouveau Commerce, no 30-31, printemps 1975 ; L’intrigue de<br />
l’infini, Flammarion, « Champs-L’essentiel », Paris, 1994, p. 242<br />
190 « Le terme de "transcendance" signifie précisément le fait qu'on ne peut penser Dieu et l'être ensemble. De<br />
même, dans la relation interpersonnelle, il ne s'agit pas de penser ensemble moi et l'autre, mais d'être en face. La<br />
véritable union ou le véritable ensemble n'est pas un ensemble de synthèse, mais un ensemble de face à face. »<br />
cf. Levinas, Ethique et infini, op. cit., p. 81-82.<br />
191 Idem, Totalité et infini, Op cit., pp. 13-14.<br />
192 Ibid., p.14<br />
193 Ibid.<br />
49
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
d’une ouverture sur l’altérité et l’extériorité : la conscience ici est près des choses et comme<br />
éclatée vers elles. Comme ouverture, l’intentionnalité est transcendance, elle débouche un au-<br />
delà de la représentation, la possibilité d’une relation éthique. Mais dans une autre lecture de<br />
l’intentionnalité, comme cela parait notamment dans Totalité et Infini, Levinas insiste sur la<br />
sphère de la représentation qui est « à la base de l’intentionnalité, sur la relation intentionnelle<br />
comme relation non éthique, sur le retour à l’immanence, sur le fait qu’il s’agit d’une forme<br />
de donation de sens parmi d’autres, et sur le fait qu’elle ne pense pas l’affectivité en raison du<br />
primat du théorique » 194 . La réduction phénoménologique reste encore au stade de la logique<br />
qui régit les relations entre objets, elle demeure encore au stade de l'idéalisme. Malgré la<br />
communication analogique réalisée par Husserl, l’intentionnalité n’accède ni à la<br />
connaissance, ni à la transcendance de l’Autre comme tel, car elle le réduit à la catégorie<br />
d'objet ou le met sous la dépendance de l'Être comme dans la philosophie traditionnelle.<br />
Levinas dépasse et continue le discours husserlien en pensant l’idée d'une extériorité qui<br />
échapperait à toute objectivité.<br />
Levinas remet également en cause l'ontologie fondamentale de Martin Heidegger, parce<br />
qu'elle couve les germes du totalitarisme, puisqu'elle est une philosophie du « Neutre » et,<br />
comme telle, une négation de la subjectivité humaine. La distance qui existe entre ces deux<br />
auteurs est capitale puisque, là où Heidegger cherche à éclairer l’« Etre » voilé par la<br />
métaphysique, Levinas réalise plutôt un renversement : « il veut s’évader de l’être, sortir hors<br />
d’une ontologie qu’il considère non comme la science de l’être mais comme la science du<br />
‘’je‘’. Il y a identité entre l’être et le même et le premier ramène toujours au second<br />
» 195 . Heidegger cherche à reconquérir l’être dissimulé derrière l’homme et ses desseins<br />
« inauthentiques ». Et pourtant d’après Levinas, l’ontologie de Socrate à Heidegger conduit à<br />
l’abandon de la transcendance puisqu’elle l’assimile au « Même ». L’ontologie de ce fait, « de<br />
par sa nature d’après Levinas porte un oubli de l’autre » 196 . Si Heidegger dénonce l’oubli de<br />
l’être qui se dévoile dans la philosophie classique, Levinas quant à lui dénonce l’« oubli de<br />
l’Autre et de la transcendance » 197 qui se dégage dans la philosophie occidentale de Socrate à<br />
Heidegger.<br />
194<br />
Pagès, «‘’Distance et proximité’’ : les deux lectures levinassiennes de l’intentionnalité », in Bulletin<br />
d'Analyse Phénoménologique, Op cit., p. 282<br />
195<br />
Jean-François Petit, Histoire de la philosophie française au XXe siècle, Desclée de Brouwer, 2009, p.280<br />
196 Ibid.<br />
197 Ibid.<br />
50
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
La philosophie occidentale est donc une ontologie de la violence, une ontologie du « je »<br />
narcissique et égotiste qui exclu toute différence. Face à cette dérive ontologique qui tend à<br />
tout fermer sous l’empire ontologique du Même, Levinas développe une philosophie de<br />
l’ouverture, une métaphysique du possible qui s’exprime dans la relation éthique qui est<br />
d’après Isidore Balla Oyié « le fait fondamentale de la ‘’scission ontologique’’» 198 . La<br />
découverte de l'éthique dans le visage opère une rupture systématique avec les philosophies<br />
de la Totalité, car elle restaure à l’autre homme son humanité, son altérité qui jusqu’ici était<br />
enfermée et perdue dans le cercle ontologique. Dans la relation du Même à l'Autre établie par<br />
le langage, l'Autre demeure absolument autre, puisque le Même et l'Autre ne se représentent<br />
pas l'un dans l'autre. Le langage installe une différence radicale dans laquelle les termes ne<br />
constituent pas une totalité. Je n’ai point la capacité d’exercer ma volonté de domination sur<br />
l'altérité, car elle est impénétrable, imprédictible, comme « la mort ». Même le meurtre ne<br />
peut l'atteindre, puisqu’Autrui continue d’exister même après sa mort 199 . C’est à partir de là<br />
que Jacques Derrida 200 a élaboré sa pensée sur le deuil impossible, à savoir celui qui ne<br />
pourrait jamais se réaliser totalement puisque qu’Autrui, même après sa mort, continue<br />
d’habiter le Moi comme un autre encrypté au plus profond de lui. D’ailleurs, en évoquant<br />
l’idée de « Désir métaphysique », Levinas souligne que, bien que nous soyons au monde la<br />
vraie vie demeure absente, puisqu’elle est orientée vers « l’In-visible » 201 .<br />
Penser l'absolument autre, c'est penser au-delà de l’essence et la séparation est l’activité<br />
même de la transcendance. La véritable existence n’est pas dans l’aliénation de l’Autre par le<br />
Même, mais dans la séparation de cette totalité aliénante. La critique de la totalité chez<br />
Levinas est en réalité une protection de la subjectivité. A partir de la « jouissance » et de<br />
« l’épiphanie d’autrui dans le visage », Levinas élabore les mobilités dans lesquelles une<br />
subjectivité peut s’extraire de sa claustration dans l’Etre pour accéder à un exister libre et<br />
autonome. La jouissance en tant que frisson du Même, est le premier mouvement qui permet<br />
au sujet de se séparer de l’Être afin d’obtenir une individualité. Certes grâce à la jouissance, le<br />
sujet préserve son identité en supplantant le statut d’existant « neutre », anonyme et de<br />
dépendant qu’il arborait dans la Totalité par un exister libre, mais lorsque le sujet reste à ce<br />
stade, il continue d’être sous l’emprise du Même. La véritable séparation et sortie de l’Être<br />
198 Isidore Balla Oyie, « L’irruption éthique d’autrui : corolaire de l’éthique de la justice de Etre », Annales de la<br />
FALSH, Université de Yaoundé I, Vol. 1, N°9, Nouvelle série, 2009. Premier semestre, p. 143<br />
199 Autrui est un mystère qui devient une épreuve traumatique qui forge le Même et qui laisse en lui une trace<br />
inoubliable qui se traduit par le sentiment de culpabilité au moment de sa mort.<br />
200 Derrida, « Violence et métaphysique », in L’écriture et la différence, Seuil, 1967 (nouv.ed. 1979)<br />
201 Levinas, Totalité et Infini, Op cit., Ibid., p.3<br />
51
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
s’opère avec la rencontre du visage d’Autrui dans son épiphanie. C’est cet évènement éthique<br />
qui achève définitivement la séparation de la Totalité. Être en relation avec le visage, c’est<br />
être en relation avec « le mystère », avec ce qui ne peut être « englobé » 202 . Le visage rompt<br />
avec le « logos » grec et ouvre la voie vers l’Autre. Cette séparation est incommensurable car<br />
elle est au-delà de tout système, de toute totalité. Le visage est signification, mais<br />
« signification sans contexte » 203 . Levinas s’oppose à Husserl car le visage n’est pas lié à une<br />
visée intentionnelle, il n’apparaît pas au sens strict 204 , mais il « s’exprime », il « se révèle »,<br />
« il parle » et parler c’est exactement se présenter en restant toujours extérieur à sa propre<br />
manifestation. Levinas dénonce donc dans l’ontologie occidentale la rationalisation d'une<br />
violence inséparable au projet d’assimilation de l'Autre par le Même. Com-prendre l’altérité<br />
par l’entremise du « concept » ou de « l’horizon », c'est toujours, pense-t-il, réduire l'altérité<br />
de ce qui est « autre » pour essayer de la fondre dans la neutralité identifiante du Même. Seule<br />
l’idée de l’Infini, selon Levinas, permet de lever cette caution que l'ontologie occidentale<br />
représente par rapport à toute pensée pure de l'altérité d'Autrui.<br />
202 Ibid., p.168<br />
203 Levinas, Ethique et infini, op. cit., p. 91.<br />
204 « Je ne sais si l'on peut parler de "phénoménologie" du visage, puisque la phénoménologie décrit ce qui<br />
apparaît. De même, je me demande si l'on peut parler d'un regard tourné vers le visage, car le regard est<br />
connaissance, perception. Je pense plutôt que l'accès au visage est d'emblée éthique. C'est lorsque vous voyez un<br />
nez, des yeux, un front, un menton, et que vous pouvez les décrire, que vous vous tournez vers autrui comme<br />
vers un objet. » cf. Levinas, Ethique et infini, op. cit., p. 91.<br />
52
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
DEUXIEME PARTIE :<br />
ETHIQUE DE L’ALTERITE<br />
La moralité ne nait pas dans l’égalité, mais dans le<br />
fait que, vers un point de l’univers, convergent les<br />
exigences infinies, celui de servir le pauvre,<br />
l’étranger, la veuve et l’orphelin.<br />
Emmanuel Levinas, Totalité et Infini. Essai sur<br />
l’extériorité, Deuxième édition, Martinus Nijhoff, La<br />
Haye, 1965, p.223<br />
53
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Introduction partielle<br />
Les deux grandes guerres historiques qui ont marqué horriblement le monde, à savoir la<br />
guerre de 1914-1918 d’une part, et d’autre part celle de 1939-1945, et, à l’intérieur de cette<br />
dernière, le génocide juif par l’Allemagne nazie, affirment l’incapacité de la civilisation<br />
occidentale à stopper le massacre de milliers d'hommes, à protéger les vies humaines et à<br />
préserver les générations futures. Ces deux grandes guerres dites « mondiales » dévoilent le<br />
déclin d’un ordre antique où se confirmait la stabilité de la civilisation occidentale qui, au-<br />
delà des guerres et révolutions, avait su assurer un minimal d’équilibre politique entre les<br />
Etats, un simulacre de paix où l’homme paraissait occuper sa place naturelle dans la globalité<br />
ambiante du monde. Cette chute ne désigne pas uniquement la fin d’un régime politique<br />
antique, mais également l’effondrement, de toute une culture, depuis la Grèce antique, sur la<br />
croyance en la capacité du logos d’éclaircir la rationalité ultime du réel. D’après Levinas toute<br />
la pensée occidentale a été continuellement une ontologie, c’est-à-dire une totalisation de<br />
l'Autre par le Même 205 , une absolutisation de l’intelligible, de la Raison et, également,<br />
l’homme dans cette civilisation n’acquiert sa qualité d’homme uniquement lorsqu’il est<br />
comprimé dans le « Neutre » - de l’ordre rationnel. Face au spectacle barbare auquel<br />
s’adonnent les Etats occidentaux - ces derniers « qui avaient incarnés l’idéal philosophique<br />
d’un monde régi par le Logos – il n’est plus possible d’affirmer que le réel est rationnel, ou<br />
qu’à la lumière de la Raison le chaos originel se transforme nécessairement en un cosmos<br />
intelligible » 206 . L’être humain, « censé s’épanouir comme sujet autonome dans un monde<br />
réglé par la Raison, devient, dans la logique meurtrière instaurée par la guerre, un simple objet<br />
de l’histoire, quantité négligeable, numéro matricule sans visage dans le tourbillon des<br />
batailles » 207 . Cette peinture lamentable de la conflagration de l’idéal philosophique d’un<br />
univers gouverné par le Logos nous installe dans la problématique du sens des relations<br />
humaines. Face à l’ensauvagement ambiant qui caractérise notre ère, peut-on parvenir à un<br />
monde où les relations interhumaines seront saines et sobres ? Une relation dans laquelle<br />
l’Autre préserve son altérité radicale est-elle encore possible ? Qu’est-ce que cela signifie<br />
d'être dans un monde structuré par la différence ? Existe-il des voies de possibilité pouvant<br />
engendrer un peu de bonté dans ce monde ?<br />
205 Levinas, Totalité et Infini, op cit., pp. 13-14<br />
206 Stéphane Moses, Au-delà de la guerre: trois études sur Levinas, Editions de l’éclat, 2004, p. 20<br />
207 Ibid.<br />
54
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Nous nous proposons dans cette partie de répondre à ces différentes questions à la<br />
lumière de l’étude de l’éthique de l’altérité. Ses écrits nous transporteront dans un univers<br />
habité par le visage, la transcendance – la bonté. Il sera question de repenser l’humanité à<br />
partir de la séparation et de l’Autre. C'est un instant de dignité pour essayer de s’affranchir<br />
d'une difficulté qui n'a pas été féconde dans la protection de l'Autre Homme, de l'orphelin, de<br />
la veuve et de l'Etranger, contre la violence, la haine, le meurtre, ou, plus précisément de<br />
l’ensauvagement. Si donc la philosophie recherche la vérité, l’initiative philosophique permet<br />
une ontologie du possible, ontologie qui se dévoile par l’éclatement et l’évasion de la Totalité<br />
en vue de l’ouverture à l’Autre dont la présence est de remettre le Moi en question. Cette<br />
dictature du Même critiquée de façon ubiquiste dans Totalité et Infini se nomme également<br />
« Etre ». Le « neutre » – être impersonnel qui tend à désacraliser la singularité absolu de<br />
l’étant, apparait comme la maladie de la philosophie occidentale. Face à une histoire violente<br />
et douloureuse, Levinas pense un monde humainement viable dans lequel l’Autre sera<br />
respecté et accepté dans son altérité radicale. Seulement, pour qu’Autrui se révèle comme tel<br />
— « l’autre en tant qu’autre » — il est absolument nécessaire d’inverser le sens de la relation,<br />
car l’Autre chez Levinas n’est pas celui que l’on vise, l’objet d’une intention ou le corrélat<br />
d’une cible intentionnelle, il est plutôt celui qui appelle. Ainsi, l’éthique de l’altérité n’est<br />
possible qu’après la déconstruction radicale du paradigme ontologique de la vision, toujours<br />
objectivante, à la faveur d’une relation métaphysique.<br />
Cependant comme dans le kantisme, la condition de « l’autre en tant autre » chez Levinas<br />
ne correspond pas à une attraction naturelle. Il ne s’agit pas d’une dynamique du Même qui<br />
permet de sortir de soi afin de laisser un espace à l’Autre, c’est plutôt une séparation radicale<br />
de l’Etre, un déracinement du carcan ontologique identitaire et totalitariste du Même, initiés<br />
par une expérience éthique édificatrice de la rencontre du visage. L’éthique demeure dans la<br />
relation à Autrui et non dans le jugement du sujet, car la morale commence, d’après Levinas,<br />
lorsque la liberté au lieu de se donner sens par elle-même, se sent plutôt injuste et<br />
ensauvageante. Et pourtant, ce qui me fait parvenir à la conscience de mon indignité, ce qui<br />
me dévoile le caractère fautif de ma liberté c’est, selon Levinas la rencontre de l’Autre dans le<br />
visage. Levinas va de ce fait s’articuler à décontenancer l’attitude naturelle à affirmer son<br />
être, à se privée de l’extériorité en persévérant dans son être 208 afin de lier l’aptitude morale,<br />
208 Inclinaison naturelle que l’on perçoit dans le conatus spinoziste ou l’amour de soi rousseauiste. « Le moi<br />
identifié avec la raison – comme pouvoir de thématisation et d’objectivation – perd son ipséité même. Se<br />
représenter, c’est se vider de sa substance subjective et insensibiliser la jouissance.» En pensant cette privation<br />
complète ou partielle de la sensibilité, Spinoza détruit la séparation. Cf. Levinas, Totalité et Infini, p. 92<br />
55
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
non pas à une façon d’être autrement, mais à ce qu’il nomme lui-même dans son texte<br />
Autrement qu’être ou au-delà de l’essence : un « autrement qu’être ». L’éthique d’Emmanuel<br />
Levinas est une éthique fondée sur la métaphysique. Chez cet auteur, la question de la<br />
transcendance se pose en termes d’Infini et d’altérité. Le problème de l’éthique s’articule<br />
autour de la réduction de l’Autre au Même et la reconnaissance de son caractère irréductible.<br />
La phénoménologie levinassienne est métaphysique en ce sens qu’elle propose une séparation<br />
absolue des pouvoirs de la conscience comme source originaire du sens. Après avoir pensé le<br />
sujet seul et sa rencontre avec le visage d’autrui, nous allons maintenant, par le biais de la<br />
métaphysique, montrer comment la relation éthique s’établit dans le respect de l’altérité<br />
irréductible d’Autrui. Notre réflexion dans cette articulation sera donc constituée de deux<br />
chapitres ; l’un portera sur « l’accueil du visage » et l’autre sur « l’être-pour-autrui ».<br />
56
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Nous rappelons que chez Levinas, « le social est au-delà de l'ontologie » 209 . Autrement<br />
dit, la société authentiquement humaine n'est pas une pluralité numérique, elle est plutôt une<br />
unité formée par des êtres uniques dans leur singularité absolues. Elle renvoie à une société où<br />
on peut parler, c'est-à-dire exprimer son altérité, son intériorité, sa liberté, sa dissemblance,<br />
parce que « la parole procède de la différence absolue » 210 . Le visage est parole, il est ce par<br />
quoi l’Autre se « révèle ». Il s’exprime, dans la mesure où c'est lui qui permet et débute tout<br />
discours 211 . L’idée de « visage » 212 chez Levinas désigne l’antériorité qui n’en appelle pas à<br />
ma volonté de domination ni au pouvoir de possession que manifeste ‘’la main‘’ ; il s’agit<br />
d’une « extériorité qui ne se réduit pas, comme chez Platon, à l’intériorité du souvenir, et qui,<br />
cependant sauvegarde le moi qui l’accueille » 213 . Accueillir le visage, c’est recevoir « le<br />
mystère », l’« In-connu », c’est-à-dire ce qui est de nature irréductible à une prise, à une<br />
perception prédatrice, ce qui est aliénable et qui par le seul fait d’être proclame déjà<br />
l’interdiction au meurtre 214 . Dans Totalité et Infini, Levinas montre évidemment que depuis<br />
l’époque des philosophes classique, le dessein de la métaphysique se réalise uniquement dans<br />
la moralité. Et que son unique abord, « c’est l’accueil du visage, accueil rendu tel par l’idée de<br />
l’infini mise en nous par l’Infini lui-même lors de la création. […] en ce sens, Autrui, est<br />
l’étant par excellence et le visage (de) l’étant absolu » 215 . Le visage d’Autrui reçu et hébergé<br />
dans la moralité est l’unique signification qui se fait « sans contexte ». Cependant comment<br />
établir une relation éthique non conceptuelle et non contextuelle avec l’altérité de ce qui n’est<br />
ni une image pure ni un concept désincarné ? Comment penser une relation avec ce qui<br />
échappe à toute rationalisation ? Sur quelle base fonder la relation avec l’Autre ?<br />
209<br />
Levinas, Éthique et infini. Dialogues avec Philippe Nemo, Fayard, 1982, p.50<br />
210<br />
Idem, Totalité et Infini, op cit., p.168<br />
211<br />
Idem, Ethique et infini, (dialogues d'Emmanuel Levinas et Philippe Nemo), Fayard, coll. “ L'Espace intérieur<br />
”, Paris, 1982, p. 92<br />
212<br />
«Le visage de l’homme — c’est ce par quoi l’invisible en lui est visible et en commerce avec nous» : Levinas,<br />
Difficile liberté, Albin Michel, coll. “ Présence du judaïsme ”, nouvelle édition aug. Paris, 1976, 3 e édit. 1983, 4 e<br />
édition 1995, 5 e édition 2006, pp. 187-188.<br />
213<br />
Isidore Balla Oyie, « L’irruption éthique d’autrui : corolaire de l’éthique de la justice de Etre », Annales de la<br />
FALSH, Université de Yaoundé I, Vol. 1, N°9, Nouvelle série, 2009. Premier semestre, pp. 143-144<br />
214<br />
Levinas, Ethique et infini, op. cit., p. 91.<br />
215 Ibid., p.144<br />
CHAPITRE I : L’ACCUEIL DU VISAGE<br />
57
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
I. Le face-à-face et l’asymétrie relationnelle<br />
1. Le face-à-face<br />
Le face-à-face dans la pensée levinassienne se démarque de la compréhension ordinaire.<br />
Affirmer que deux individus sont face-à-face, peut renfermer une inflation de sens : il peut<br />
s'agir de manière condensée soit d'un face-à-face vécu comme duel ou d'un face-à-face vécu<br />
comme union des affections. Le face-à-face chez Levinas ne renvoie pas à ces différentes<br />
significations. Pour saisir le sens du concept de « face-à-face » exprimer dans la philosophie<br />
levinassienne, il faut se mettre dans la perspective de la mise en cause de la liberté, car « […]<br />
c’est dans cette mise en question, qu'autrui est prochain » 216 . Il s'agit ici d'une approche<br />
éthique et plus précisément de la critique de l'ontologie.<br />
Le face-à-face entre le Même et Autrui se manifeste sans nier le Même. Cependant au lieu<br />
d’altérer la liberté du Même, il l'appelle à la responsabilité et l'édifie. « Le face-à-face »<br />
comme relation métaphysique, comme épiphanie du visage d’Autrui, indique que c'est la<br />
transcendance de l’Autre qui rend compte de la liberté du Même. Dans le face-à-face, les<br />
subjectivités demeurent dans leur séparation tout en entretenant une relation.<br />
En fait, cette analyse part de l’idée de l’Infini en nous tout en mettant en exergue l’idée de<br />
séparation, puisque « pour avoir l’idée de l’Infini, il faut exister comme séparé » 217 . Cette<br />
rupture ne peut pas se réaliser comme effectuant exclusivement « écho à la transcendance de<br />
l’Infini ». Autrement, la séparation se ferait dans une relation qui rétablirait l’unité et ferait<br />
que la transcendance soit utopique. Et pourtant, « l’idée de l’Infini, c’est la transcendance<br />
même » 218 , le dépassement d’une idée « adéquat ». Si donc la totalité ne peut se réaliser, c’est<br />
parce que l’Infini ne peut être l’objet d’une quelconque totalisation. Il est par conséquent<br />
nécessaire de souligner et de mémoriser que chez Levinas : « ce n’est pas l’insuffisance du<br />
moi qui empêche la totalisation, mais l’Infini d’Autrui » 219 .<br />
Il est impossible d’après Levinas que le Même et l’Autre intègrent une connaissance qui<br />
les engloberait, puisque « la relation qu’entretient l’être séparé avec ce qui le transcende ne se<br />
produit pas sur le fond de la totalité, ne se cristallisent pas en système » 220 . La doctrine<br />
formelle du terme qui les appelle « ensemble » existe déjà dans un discours ou dans une<br />
216 Levinas, De dieu qui vient à l’idée, J.Vrin, 2 e édit. revue et aug, Paris, 1992, p. 245<br />
217 Idem, Totalité et Infini, Op. cit., p.52<br />
218 Ibid.<br />
219 Ibid.<br />
220 Ibid., p.53<br />
58
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
situation de transcendance, brisant avec la totalité. La situation entre le Même et l’Autre dans<br />
l’espace où leur proximité verbale se manifeste, est « l’accueil de front et de face de l’Autre<br />
par moi » 221 . Condition qui ne peut être réduite à la totalité, parce que la position de « vis-à-<br />
vis » n’est pas une transformation de l’« à-coté-de… » : le « vis-à-vis » - le « face-à-face » est<br />
éthique, or l’« à-coté-de… » relève du domaine de l’ontologie. Même si nous relions le Même<br />
à l’Autre par la conjonction « et», la position frontale demeurera toujours, car « le face-à-face<br />
demeure la situation ultime » 222 .<br />
Le « face-à-face » résulte d’une relation ultime et « irréductible » que nul concept ne<br />
saurait embrasser ou englober. Cette forme de non corrélation ouvre tous les rapports sociaux.<br />
D’ailleurs les relations sociales, chez Levinas, sont la manifestation authentique de la relation<br />
qui ne se donne plus au regard qui engloberait ses termes, cependant se réalise de Moi à<br />
l’Autre dans le face-à-face.<br />
Le face-à-face est d'une grande importance dans l'approche de la relation<br />
métaphysique qui le rend possible. Il contribue sans contexte au maintien<br />
de l'infini intervalle de la séparation du même et de l'autre, tout en jouant<br />
un rôle déterminant dans la lutte contre toutes formes de totalisation. Le<br />
face-à-face rend possible l'athéisme qui, marque le fait même, la rupture<br />
de la possibilité de se rechercher une justification, c'est-à-dire une<br />
dépendance à l'égard d'une extériorité 223 .<br />
D’après Levinas, le retour à l’extériorité, à l’Etre au sens pur, désigne l’incursion dans la<br />
droiture du face-à-face. Par ailleurs, dans ses Quatre lectures talmudiques, « la droiture »<br />
désigne ce qui est « plus fort que la mort ». Elle manifeste la nécessité d'une visée, conduisant<br />
à l’Autre et non pas un perpétuel retour sur soi. « La droiture du face-à-face » consiste donc à<br />
aller vers l’Autre ; droiture radicale qui est également critique absolue de soi, perçue dans le<br />
regard de celui qui est le terme de cette droiture et dont la vision me met en question. Par<br />
conséquent, le retour à l’extériorité, à l’être au sens pur du terme désigne l’introduction dans<br />
la droiture du « face-à-face ». Néanmoins, s’interroger sur la problématique du « face-à-face »<br />
ne pourrait dissimuler l’influence que recèle l'idée de l'Infini, puisque la signification du face-<br />
à-face peut se réaliser comme une situation en face du Moi qui suppose une opposition<br />
radicale, « qui ne se peut que comme mise en cause de la morale » 224 .<br />
221 Ibid.<br />
222 Ibid.<br />
223 Matuka , L'accueil d'autrui comme abandon de la liberté totalisante et appel à la responsabilité, Université<br />
St Pierre Canisius – DEUG, 2002<br />
224 Levinas, Totalité et Infini, Op. Cit., p.20<br />
59
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
« Les relations qu'entretient l'être séparé avec ce qui le transcende ne se produisent pas<br />
sur le fond de la totalité, ils ne se cristallisent pas en système » 225 . Dans notre existence<br />
quotidienne, l'idée de l'infini équivaut au langage qui se matérialise comme relation éthique.<br />
Dans cette perspective, la relation métaphysique destitue le Moi du siège qu'il usait dans la<br />
philosophie occidentale, siège dans lequel ses droits étaient illimités comme ceux du<br />
« Léviathan » 226 hobbesien. Ce mouvement de déracinement du Moi inclus une situation<br />
entre le Même et Autrui dans laquelle leur proximité qui déjà se fixe, est l'accueil de front et<br />
de face de l'Etranger par le Même.<br />
En fait, la rencontre de l’Autre en tant que rencontre frontale ou de « face-à-face » est le<br />
commencement de toute relation éthique chez Emmanuel Levinas. Cette relation à l’Autre est<br />
en fait une relation avec « l’absolument autre », entrevue du Mystère, de l’Étranger qui,<br />
comme ce protagoniste de l’idylle qui vient d’autres cieux et qui perpétuellement « est ailleurs<br />
[…], n’appartenant pas à notre horizon et ne s’inscrivant sur aucun horizon représentable » 227 .<br />
C’est précisément cette venue d’«ailleurs » qui fait qu’Autrui soit, d’ores et déjà, la hauteur<br />
face à laquelle je n’ai aucune puissance. Même dans cette rencontre, dans laquelle je suis<br />
contraint à une responsabilité irréfutable, Autrui reste inassimilable, hermétique, absolument<br />
séparé de Moi et, en tant que tel, infigurable, me paraît-il, au sens où, débordant « l’idée de<br />
l’Autre en moi » 228 , je ne puis me le représenter par la pensée. Je ne peux pas me convertir en<br />
Autre, l’idée d’Autrui; en quoi on pourrait affirmer que cette relation à l’Autre « me rapporte<br />
à ce qui me dépasse et m’échappe » 229 , il me transcende et me met hors de moi. Autrui, dans<br />
sa radicale singularité, m’échappe inlassablement et d’après Levinas, je ne suis « jamais<br />
assez proche ».<br />
Cependant, c’est cette façon de s’affranchir de mon pouvoir en me regardant, cette<br />
manière par laquelle Autrui se manifeste à moi dans la proximité que Levinas appelle<br />
« visage ». « Cette façon ne consiste pas à figurer comme thème sous mon regard » 230 , car<br />
conceptualiser l’idée du visage de l’autre homme, le représenter ou le catégoriser, c’est déjà le<br />
déformer, le méjuger, l’ignorer même. Ceci voudrait justement dire que ce visage que je<br />
rencontre, ne se réduit pas au domaine esthétique, ni à l’image ou encore à son faciès. Pour<br />
225 Ibid., p.55<br />
226 Dans la mythologie, monstre aquatique symbolisant le paganisme. Entité administrative ou politique exerçant<br />
un pouvoir centralisé, gigantesque, tentaculaire comme cela parait dans le Léviathan de Hobbes<br />
227 Emmanuel Levinas, Ethique et infini, op. cit., pp. 74-75<br />
228 Idem, Totalité et Infini, Op. Cit., p.43<br />
229 Idem, Ethique et infini, Op. Cit. p.75<br />
230 Idem, Totalité et Infini, Op. Cit., p.43<br />
60
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
exprimer la présence d’Autrui dans le visage, Levinas précise qu’elle « consiste à se dévêtir<br />
de la forme qui cependant déjà le manifestait […], comme un être qui ouvrirait la fenêtre où<br />
sa figure pourtant se dessinait déjà » 231 . C’est dans cette perspective que Levinas comprend «<br />
la manifestation du visage comme le premier discours », c’est ce qu’il affirme par ces termes:<br />
« Le visage parle». Le face-à-face crée le langage et dans cette relation frontale, chaque<br />
visage proclame sa responsabilité infinie pour l’Autre. Parler, c’est donc « avant toute chose,<br />
cette façon de venir derrière son apparence, derrière sa forme » 232 , une ouverture dans<br />
l’ouverture. Affirmer que le visage parle, c’est dire que de tous les êtres que nous rencontrons,<br />
le visage de l’Autre est le seul qui met le Même en cause et ouvre à la transcendance, à<br />
l’altérité, à l’existence des autres, à la conscience morale. Le visage est nu, abstrait, informe et<br />
dénudé de sa propre image comme de sa figure. Toutefois quelle est la condition systématique<br />
de la relation avec l’Etranger ?<br />
2. Relation asymétrie<br />
La condition fondamentale de la relation avec Autrui c’est « l’asymétrie » qui renvoie à un<br />
défaut de symétrie 233 , l’absence d’harmonie résultant d’une disposition régulière ou la<br />
difformité d’une correspondance d'éléments disposés de façon similaire par rapport à un axe.<br />
Levinas utilise ce concept pour illustrer le sens de la difformité dans la relation éthique. Dans<br />
la relation éthique, le « face à face », sous sa forme « bidimensionnelle inégale » 234 , chaque<br />
individu conserve son individualité. L’Autre et moi, ne sommes pas dans une situation dans<br />
laquelle nous pouvons être permutables de telle manière que je puisse assurer sa fonction, vice<br />
versa. Cette asymétrie définit principalement la relation éthique, c’est-à-dire les dispositions<br />
que les individus doivent prendre pour que leur relation ait un caractère éthique. Si jamais<br />
l’asymétrie devient symétrie, automatiquement l’Etranger, le pauvre, la veuve seront absorbés<br />
par le Même. Ce mouvement modifiera le domaine et le sens de cette permutation fera<br />
intervenir le règne des catégories hétérogènes.<br />
La relation asymétrique dans la philosophie levinassienne se dévoile dans des peintures<br />
réelles. L’altérité résulte indéfiniment de l’Autre, pas du Même et n’est jamais comprise<br />
comme caractéristique de son essence. Elle représente au contraire pour le Moi, la non-<br />
231<br />
Levinas, Humanisme de l’autre homme, Le Livre de poche, coll. « Biblio-essais », Paris, 1994 [1972], p. 51<br />
232<br />
Ibid.<br />
233<br />
Le principe de la symétrie est très important dans les domaines de la biologie, des mathématiques et de la<br />
minéralogie.<br />
234<br />
Bensussan , « Levinas et la question politique », Noesis [En ligne] , N°3 | 2000 , mis en ligne le 15 mars 2004,<br />
Consulté le 05 octobre 2011. URL : http://noesis.revues.org/index9.html<br />
61
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
indifférence à l’altérité de l’Autre. En guise de précision, l’Autre dont Levinas parle n’est ni<br />
biologique, ni sociologique, il serait donc abject d’utiliser la pensée levinassienne de l’altérité<br />
dans des perspectives différentialistes ou pour affirmer son droit à une quelconque différence,<br />
car le concept de personne différente ou séparée que nous avons étudié dans la peinture et la<br />
signification de « la jouissance et qui se pose dans l’indépendance du bonheur – se distingue<br />
de la notion de personne telle que la forge la philosophie de la vie ou de la race » 235 . Dans la<br />
conception de l’existence biologique, la personne apparait comme produit du genre ou de<br />
l’existence « impersonnelle » qui recourt au sujet pour garantir sa victoire impersonnel 236 .<br />
« L’unicité du moi, d’après Levinas, son statut d’individu sans concept disparait dans cette<br />
participation à ce qui le dépasse » 237 . La pensée levinassienne n’est pas différentialiste au sens<br />
où la représentation d’une catégorie pourrait attester le droit à une différence. Néanmoins,<br />
l’aspect exclusif que Levinas rejoint dans le libéralisme différentialiste consiste à penser<br />
l’homme comme un être absolument singulier, qui ne ressemble à rien, qui n’admet pas le<br />
terme « comme » puisqu’il n’entre dans aucune catégorie, un être authentique et sans concept.<br />
En fait, dans la relation asymétrique, Autrui parle et sa parole est appelle, quoique je fasse,<br />
je suis obligé de répondre car la forme répondante de ma subjectivité m’expose à l’Autre dans<br />
un « me voici ! » qui ne peut être cédé, au sens risqué de l’élection, elle m’embarque dans une<br />
épreuve dont j’ignorais même ma responsabilité 238 . Cet appel que le Moi sent, provient de<br />
l’Etranger, il est interpellé depuis le visage d’Autrui dont la vulnérabilité soumet par la<br />
hauteur transcendante d’où elle le conditionne à l’urgence, à l’immanence d’une assistance ou<br />
d’un secours. Face à cette transcendance du visage, c’est-à-dire à l’altérité d’Autrui<br />
transcendant et perforant toute représentation sensible, le Moi ne saurait répondre par<br />
exhibition de sa transcendance également, ni de son altérité ou de son visage. Le refus de cet<br />
appel s’envelopperait dans un monstrueux irréalisme. Affirmer que l’Autre est indéfiniment et<br />
formellement, plus à côté de Dieu que moi, c’est introduire ma réponse dans une<br />
indispensable instantanéité urgence matérielle, qui consiste comme le souligne Levinas à<br />
235 Levinas, Totalité et Infini, Op. Cit., pp. 92 -93<br />
236 Cf. Kurt Schelling, «Einführung in die Staats und Rechtsphilosophie », in Rechtswissenschaftliche Grundrisse,<br />
herausgegeben von Otto Koelireuter. Junker und Dunhaupt Verlag Berlin, 1939. Les concepts d’individualité et<br />
de socialité dans ce livre typique de la philosophie raciste apparaissent comme des événements de la vie qui<br />
précédent les individus et les créent pour mieux s’adapter, pour pouvoir vivre.<br />
237 Levinas, Totalité et Infini, Op. Cit., p.93<br />
238 Idem, Humanisme de l’autre homme, Fata Morgana, 1972 ; rééd. Paris, Le Livre de poche, coll. « Biblio »,<br />
Montpellier, 1994, p. 49.<br />
62
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
« vêtir », à « nourrir », à « ouvrir son porte-monnaie » à cet individu venu des lointains, cette<br />
posture proscrit également toute « hypocrisie du sermon » 239 .<br />
L’éthique est éthique exclusivement lorsqu’elle se déploie de manière asymétrique : elle<br />
désigne une relation dans laquelle le Moi est conditionné par l’altérité de l’Autre. Ceci<br />
implique que, si jamais on transpose la qualité de cette relation, c’est-à-dire au lieu qu’elle<br />
soit asymétrique, elle devient plutôt symétrique, il n’y aurait plus d’éthique. La permutation<br />
asymétrique de l’asymétrie manifeste une disposition dans laquelle le Moi affirme son<br />
identification par rapport à l’Autre dans l’expression : « lui, c’est moi », l’Etranger et moi<br />
formons un « Nous », et dans cette posture un appel surviendrait pour avertir à tout individu<br />
qui me fait face de répondre à mes commandements – prototype des circonstances de<br />
l’histoire humaine, où un individu peut se dit autre, où on n’est plus capable de signifier<br />
l’Autre en contestant la signification et finit par lui interdire tout espace - racisme. Ce que<br />
l’asymétrie présente comme étant dissidente de toute universalisation par accroissement<br />
circonscrit un centre éthique, une société plurielle, dans laquelle le Moi est gouverné par<br />
l’Etranger et réduit, dans ce commandement même, à son irrépréhensible singularité.<br />
Cependant cette authenticité, originelle et non transférable, ne saurait estomper la<br />
problématique de la pluralité qu’elle devance, admet et, en quelque manière, interpelle. Elle<br />
en meut de préférence, et de manière spécifique, les endroits et les origines. La multiplicité<br />
humaine, qui d’ailleurs révèle le sens de la communauté, et aussitôt qu’elle est comprise à<br />
partir d’une instantanéité qui lui précédent et la pose comme problématique, peut déboucher<br />
dans une idée d’humanité qui n’existerait pas comme répartition d’un commun antérieur et<br />
donné, mais l’expérience de la mise en commun de ce qui serait réparti, séparé, éparpillé çà et<br />
là sans identité. La question éthique manifeste l’origine : à côté de l’Etranger, il y a un autre<br />
étranger que Levinas désigne par le terme « tiers ». L’Etranger n’est jamais seul face au Moi :<br />
la relation éthique n’abolit point en elle ce qui la précède; elle en est plutôt la modalité.<br />
Par ailleurs, il est possible même que « le tiers » ait été victime de l’Etranger à qui le Moi<br />
réponds et qu’il rencontre. Il n’est donc injustifiable pour le Moi d’accepter d’être gouverner<br />
par l’Autre, sans toutefois se demander comment va « le tiers », et qui est certainement le<br />
« prochain » de l’Autre. La relation éthique ou de « face-à-face » est un appel à la rectification<br />
du rapport symétrique afin d’aboutir à une asymétrique relationnelle. Elle me contraint à<br />
239 Levinas, De l’Existence à l’existant, J. Vrin, Paris, 1993, p. 69. Levinas perçoit même la « grande force » et la<br />
« sincérité essentielle » de la philosophie de Karl Marx dans la négation absolue de cette « Hypocrisie ».<br />
63
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
apprécier les difficultés de cet Autre en face de moi et les doléances du « tiers » face à<br />
l’Etranger, à m’introduire en conséquence dans un registre spécifique, ayant pour dessein de<br />
saisir en ma responsabilité les exigences de la comparaison afin de « pré-venir » d’éventuels<br />
ensauvagements ou l’instant de déchéance futur. La politique, ainsi, s’intègre uniquement<br />
dans la symétrisation de toutes les relations, ce qui agréera la réalisation de l’égalité, la<br />
symétrie des droits et des devoirs dans l’anonymat de l’interchangeabilité des positions et des<br />
rôles des individus. La politique commence donc avec la constitution d’une comparabilité<br />
globale, et non dans un accord bâtisseur ou un sens historique, commencement ou finalité par<br />
rapport à tel ou tel régime édifié donnera lui-même la dimension universelle de son système<br />
selon le degré d’abandon du pouvoir de la singularité en faveur de la totalité. Autrement dit, la<br />
politique commence lorsqu’un individu pleinement responsable abandonne la question<br />
éthique qui pourrait s’énoncé à travers cette interrogation : ‘’ai-je le droit d’être et de<br />
persévérer dans cet être ?’’ -, pour se limiter à la question politique qui s’illustre dans cette<br />
interrogation : ‘’ai-je le droit de me soustraire des interrogations issues de la pluralité<br />
conflictuelle des actions humaines et de leur organisation ?’’ – ou dans la mesure où il part<br />
« de la responsabilité au problème » 240 . Toutefois, l’éthique de l’altérité peut-elle se réaliser<br />
sans langage ? Quelle est la place du langage dans la relation éthique ?<br />
II. Langage comme mode de relation avec la transcendance<br />
Dans l’accueil de l’Autre, le langage occupe une place capitale car en tant que dia-logos, il<br />
permet la relation entre deux êtres absolument séparés. L’altérité absolue de l’Autre, qui<br />
demeure incompréhensible dans le contexte de la « logique formelle », se produit<br />
exclusivement par le langage. Le langage établit une relation avec le « mystère » et cette<br />
«relation de l'altérité n'est ni spatiale ni conceptuelle » 241 . La relation que permet le langage<br />
dépasse la cadre conceptuelle, parce qu’il nous met face à des êtres insaisissable et dont l’être<br />
transcende notre champs conceptuel : le langage, d’après Levinas, réalise une relation entre<br />
des locuteurs qui détruisent le caractère unique d’un genre. « Les termes, les<br />
interlocuteurs, s’absolvent de la relation ou demeurent absolus dans la relation. Le langage se<br />
définit, d’après Levinas, comme le pouvoir de rompre la continuité de l’être ou de l’histoire<br />
» 242 . Il est séparation par excellence et expression libre entre des êtres absolument séparés.<br />
240 « Telle est la voie », ajoute Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, La Haye, M. Nijhoff, 1974,<br />
p. 205.<br />
241 Levinas, Le temps et l'autre, op. cit., p. 75<br />
242 Levinas, Totalité et Infini, Op. Cit., p.169<br />
64
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Le langage manifeste le transcendant, il exprime une relation entres les termes séparés et<br />
non-thématisable. « La parole qui porte sur autrui comme thème semble contenir autrui. Mais<br />
déjà elle se dit à autrui qui, en tant qu’interlocuteur, a quitté le thème qui l’englobait et surgit<br />
inévitablement derrière le dit » 243 . La parole renferme le silence qui manifeste cette<br />
disparition de l’Autre. Le savoir qui absorbe Autrui se tient aussitôt dans le message que je lui<br />
transmets. « Parler, au lieu de laisser être sollicite autrui. La parole tranche sur la vision » 244<br />
qui a pour particularité de vouloir donner des significations ou de regrouper en thème de<br />
façon analogique l’objet vu. Dans le langage par contre, la distance qui se présente<br />
incontestablement entre « Autrui comme mon thème et Autrui comme mon interlocuteur »,<br />
évadé du thème qui paraissait pendant un moment le contenir, nie immédiatement la<br />
signification que je donne à la personne qui dialogue avec moi. Dans cette dynamique d’idées,<br />
la charpente absolue du langage proclame « l’inviolabilité éthique d’Autrui » 245 .<br />
Cependant le fait que le visage par le discours soit en relation avec moi ne l’englobe pas<br />
dans la sphère du Même. « Il reste absolu dans la relation » 246 . La dialectique qui présente le<br />
sujet comme la seule réalité du psychisme, constamment susceptible de son emprisonnement<br />
dans le Même, s’arrête. La relation morale qui fonde le langage, n’est pas, une ramification du<br />
psychisme dont la trajectoire part du Moi. Elle questionne plutôt le Moi et « cette mise en<br />
question part de l’Autre » 247 .<br />
Le langage a pour particularité d’établir la relation avec ce qui est transcendant.<br />
Autrement dit, le langage parachève la transcendance qui résultait de la rencontre du visage<br />
d’Autrui. L’activité langagière dans la philosophie levinassienne traduit donc le mode de<br />
donation éthique de l’épiphanie d’Autrui comme visage. Levinas rejette fermement la vision,<br />
car elle relève toujours de la sphère du Même. Autrui dans son visage chez Levinas,<br />
représente simultanément l'extériorité, la transcendance et l'Infini qui se révèlent à moi.<br />
C’est lorsque vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton, et que vous<br />
pouvez les décrire que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet. La<br />
meilleure manière de rencontrer autrui, c’est de ne même pas regarder la<br />
couleur de ses yeux ! Quand on observe la couleur des yeux, on n'est pas en<br />
relation sociale avec autrui 248 .<br />
243 Ibid.<br />
244 Ibid.<br />
245 Ibid., p.169<br />
246 Ibid.<br />
247 Ibid.<br />
248 Levinas, Ethique et infini, Op. Cit., p. 91.<br />
65
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Lorsque je dévisage ou regarde la couleur de la peau ou des yeux de quelqu’un, je ne suis<br />
pas en relation sociale avec lui, mais dans un rapport d’aliénation, d’assimilation, car « la<br />
vision mue en prise » 249 . La vision peint une mesure franchissable, invite la main à la prise par<br />
le contact. La vision du ciel présentant les étoiles n’est pas une vision de la hauteur. « Les<br />
formes des objets appellent la main et la prise. Par la main, l’objet est en fin de compte<br />
compris, touché, pris, porté et rapporté à d’autres objets, revêt une signification, par rapport à<br />
d’autre objet » 250 . Le vide est l’exigence de cette relation. « La vision n’est pas une<br />
transcendance » 251 . Elle fournit une « signification » par le rapport qu’elle possibilise. Elle ne<br />
présente aucune connaissance, par delà le Même qui serait parfaitement autre, plus<br />
précisément « en soi ». La lumière détermine les rapports entre « donnés » – elle possibilise la<br />
« signification des objets qui se côtoient. Elle ne permet pas de les aborder en face ». Dans<br />
une vue globale, l’intuition n’est pas contraire à la pensée des rapports. Elle est même rapport,<br />
parce qu’en tant que vision, elle distingue le lieu par lequel les choses se déplacent les unes<br />
les autres. « L’espace au lieu de transporter au-delà assure simplement la condition de la<br />
signification latérale des choses dans le Même » 252 . La conscience se renferme sur elle-même,<br />
tout en s’évadant dans la vision. Malheureusement pour voir la chose sombre, le Même a<br />
besoin que la surface soit éclairée, or « Il faut une lumière pour voir la lumière. […] En<br />
réalité, la profondeur de la chose ne peut avoir d’autre signification que celle de sa matière et<br />
la révélation de la matière est essentiellement superficielle » 253 .<br />
En fait, la vision malgré sa superficialité reste dans l’univers du Même, elle ne permet<br />
pas d’établir une relation éthique, car elle se mue toujours en prise et c’est cette volonté<br />
d’assimilation qui fait en sorte qu’elle soit dépourvue de toute signification. Or le langage,<br />
parce qu’il ouvre à l’Autre et au temps, il est à l’origine de toute signification, il est le sens<br />
originaire antérieur à la sinngebung husserlienne et il préserve l’Infini avec l’Autre tout en<br />
approfondissant la relation. Approfondir la relation par le langage, c’est approfondir<br />
l’intervalle qui me sépare de l’Autre. Si éloigné si adjacent, le langage se révèle comme le<br />
paradoxe et l’essence du rapport à l’altérité. Le langage comme moyen privilégié du rapport à<br />
l’Autre prend source dans l’appel d’Autrui. La présence du visage d’Autrui est langage,<br />
langage qui en même temps est un appel à la relation.<br />
249 Idem, Totalité et Infini, Op. Cit., p.164<br />
250 Ibid., p.165<br />
251 Ibid.<br />
252 Ibid., p.166<br />
253 Ibid., p.167<br />
66
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Levinas définit le langage dans Totalité et Infini comme la mise en question éthique du<br />
Même, coextensive à la manifestation de l’Autre dans le visage. Loin d’être une signification<br />
fortuite, cette définition du langage se justifie à partir de la disposition initiale dans laquelle la<br />
totalité formée par le thème du discours se trouve perturbée en ce que le discours, quel que<br />
soit l’idée qu’il exprime, s’adresse à l’Autre au-delà de tout concept 254 . Mais ce rapport entre<br />
l’éthique et le langage ne traduit pas uniquement le fait phénoménal d’un discours s’adressant<br />
à l’Autre ; il manifeste au contraire la signification même du langage à l’œuvre dans tout<br />
discours. L’essentiel du langage demeure donc dans le fait que celui qui parle assiste lui-<br />
même à son propre discours ou par sa seule présence manifeste ce discours lui-même 255 . Ceci<br />
veut simplement dire que l’individu détient un sens au-delà de l’idée évoqué par le discours,<br />
le sens et la signification de l’individu dépasse toute pensée. Le visage est une manifestation<br />
animée et dialogique. La vie langagière consiste à détruire la forme où l’étant, s’extériorisant<br />
comme « thème », se dérobe par là même. « Le visage parle. La manifestation du visage est<br />
déjà discours » 256 . Celui qui parle, vient en aide à sa propre personne, il détruit à tout moment<br />
la forme qu’il donne. Cette manière de détruire la mêmeté du Même pour s’extérioriser<br />
comme autre, « c’est signifier ou avoir un sens. Se présenter en signifiant, c’est parler » 257 .<br />
La signification tranche sur tout élément intuitif, car signifier ne veut pas dire donner. La<br />
signification n’est pas un rapport donné à « l’intuition intellectuelle », encore semblable en<br />
cela à la perception donnée à l’ouïe. « Elle est par excellence la présence de l’extériorité » 258 .<br />
Le discours n’est pas uniquement « une modification de l’intuition » ou une simplement<br />
modification de la pensée, mais un rapport originel avec l’extériorité. Il n’est pas un manque<br />
d’un être privé d’intuition intellectuelle, « il est la production de sens » 259 . Le sens ne se<br />
réalise pas comme une essence idéale, il est affirmé et révélé par la présence, et<br />
l’enseignement ne se limite pas à « l’intuition sensible ou intellectuelle, qui est la pensée du<br />
Même ». Donner un sens à son existence est un fait « irréductible à l’évidence ». Il<br />
n’appartient pas au règne de l’intuition. Il est simultanément, présence perceptible et éloignée<br />
de l’Autre. Présence supérieur à celui qui l’accueille, survenant des hauteurs, accidentelle et,<br />
de ce fait, enseignant son innovation même. Elle est la franche expression d’un étant qui a la<br />
254<br />
Levinas, « Le Moi et la Totalité », in Revue de Métaphysique et de Morale, n°4, octobre-décembre 1954,<br />
p.369<br />
255<br />
Idem, « La philosophie et l’idée de l’Infini », in En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Paris,<br />
Vrin, 1967, p.173 et dans Totalité et Infini, p.71<br />
256 Levinas, Totalité et Infini, Op. Cit., p.37<br />
257 Ibid.<br />
258 Ibid., p.38<br />
259 Ibid.<br />
67
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
capacité de « mentir », c’est-à-dire dispose de l’idée qu’il donne, sans être capable de<br />
dissimuler sa « franchise d’interlocuteur », combattant toujours de façon ouverte. L’œil ne<br />
briller pas, il converse. La possibilité de « la vérité et du mensonge, de la sincérité et de la<br />
dissimulation, est le privilège de celui qui se tient dans la relation d’absolue franchise, dans<br />
l’absolue franchise qui ne peut se cacher » 260 .<br />
L’action ne parle pas. Elle a un sens qui nous conduit vers celui qui agit en son absence.<br />
Aborder donc un sujet à partir des œuvres, nous dit Levinas, « c’est entrer dans son intériorité,<br />
comme par effraction ». L’Autre est pris à l'improviste dans son intériorité, où il se manifeste<br />
certainement, mais ne parle pas, comme les personnages qu’on évoque généralement dans<br />
l’histoire. Les œuvres décrivent leur auteurs, mais d'une manière indirecte 261 , par le « il » ou<br />
le « on », or rencontrer l’Autre d’après Buber 262 , c’est entrer en relation avec son « Tu » et<br />
non pas avec « Il » ou « Elle » qui sont des termes ordinaires qui ne correspondent pas à la<br />
réalité d’une relation véritablement vécue avec être spécifique. Etre en relation avec le « Tu »<br />
c’est ainsi voir, écouter cet Autre en ce qu’il est d’original et d’exclusif. Ce soif d’être perçu<br />
et reconnu comme un être humain par une autre être humain et non pas d’être considéré<br />
comme un objet, comme un accident, ou une citerne de connaissances, comme un « Cela » est<br />
une nécessité vitale.<br />
Nous pouvons certainement entrevoir le langage comme une action, comme un<br />
mouvement comportemental. Cependant dans cette trajectoire, on oublie ce qui est<br />
fondamental dans le langage : la simultanéité du dialogueur et du dialogué dans le visage, qui<br />
se réalise en se situant en altitude par rapport à nous « – en enseignant ». En revanche, faits,<br />
exploits exprimés peuvent se transformer en parole, « révélation » ; enseignement, tandis que<br />
le rétablissement du personnage à partir de ses manifestation est l’œuvre de l’histoire conçue<br />
par l’homme.<br />
Le désir de connaitre et de toucher Autrui, se réalise dans la relation avec l’Autre, qui se<br />
manifeste dans la relation langagière dont le principal est « l’interpellation, le vocatif ».<br />
L’Autre se conserve et s’affirme dans son altérité dès qu’on l’interpelle, même si c’est pour<br />
lui signifier qu’on ne peut dialoguer avec lui, pour le ranger comme inapte, pour l’affirmer sa<br />
détention à mort ; malgré qu’il soit happé, estropié, combattu, il est honoré. L’Autre chez<br />
260 Ibid.<br />
261 Levinas, Totalité et Infini, Op. Cit., p.38<br />
262 Martin Buber, Je et Tu, Ed. Aubier, France, 1969<br />
68
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Levinas n’est pas ce que je saisie : « il n’est pas sous catégorie » 263 , il est celui à qui je<br />
m’adresse, sa référence se limite en lui, il n’a pas de « quiddité ». Cependant la charpente<br />
formelle de l’interpellation doit être élaborée.<br />
L’objet du savoir est toujours réalisé, déjà réalisé et désuet. L’interpellé est invité au<br />
dialogue, « sa parole consiste à ‘’porter secours’’ à sa parole – à être présent » 264 . Ce présent<br />
n’est pas constitué d’instants énigmatiquement figés dans le temps, mais d’un<br />
recommencement permanent d’instants qui se déploient par une présence qui les aide, qui en<br />
est responsable. « Cette incessante produit le présent, est la présentation, - la vie – du présent<br />
» 265 . La parole est actualisation du présent. Le présent se manifeste dans le combat contre le<br />
passé, dans l’actualisation. L’actualité indivisible de la parole l’extrait de la condition dans<br />
laquelle elle se présente et qu’elle parait continuer. Elle apporte l’excédent indispensable qui<br />
n’existe pas dans le discours écrit : « la maitrise ». La parole est enseignement, mieux qu’un<br />
simple symbole elle est foncièrement « magistrale. Elle enseigne avant tout cet enseignement<br />
même, grâce auquel elle peut seulement enseigner (et non pas, comme la maïeutique éveille<br />
en moi) choses et idées » 266 . C’est grâce à la parole, à l’enseignement du Maitre, comme nous<br />
allons le montrer à la troisième partie de ce texte, que les idées m’instruisent, ma<br />
connaissance des choses repose de ce fait sur l’enseignement. La remise en cause des choses<br />
dans un dialogue, n’est pas le fait du changement de leur sens, car elles concordent déjà avec<br />
leur « objectivation ». La chose se donne à nous lorsque nous ouvrons notre porte à celui qui<br />
vient d’« ailleurs».<br />
Le langage ne commande pas la conscience sous le motif qu’il donne à la « conscience de<br />
soi » un avatar dans un projet objectif qui serait le langage, comme le penseraient les partisans<br />
de la doctrine hégélienne. Le caractère externe que révèle le langage qui se traduit dans la<br />
relation avec l’Autre, n’est pas n’est pas similaire à l’extériorité d’une œuvre, « car<br />
l’extériorité objective de l’œuvre se situe déjà dans le monde qu’instaure le langage, c’est-à-<br />
dire la transcendance » 267 .<br />
La pensée occidentale a couramment lutté comme « sceptique », la vision de l’homme<br />
comme mesure de toutes choses évoqué par Protagoras, bien que cette idée soutienne « l’idée<br />
de la séparation athée » et l’une des bases du discours. Le moi sentant, selon lui, n’est pas<br />
263 Levinas, Totalité et Infini, Op. Cit., p.41<br />
264 Ibid.<br />
265 Ibid.<br />
266 Ibid., p.41<br />
267 Ibid., p.42<br />
69
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
capable de fonder la Raison, car la signification du moi résulte de la raison. Cependant, la<br />
raison s’exprimant à la première personne, « je », n’établit pas le dialogue avec l’Autre, car<br />
elle monologue, elle ontologise. Et dans le sens contraire, elle ne touche pas la vraie<br />
individualité, c’est en devenant universelle qu’elle retrouve le pouvoir particulier de<br />
l’individu libre. Les chercheurs opposés ne sont vraiment raisonnables uniquement lorsque<br />
leurs activités individuelles de penser participent comment instant de ce discours exclusif et<br />
universel. Il n’y a de raison dans l’homme d’après Levinas que lorsqu’il est présent dans son<br />
propre discours, ou lorsque la pensée l’englobe.<br />
Cependant comprendre le penseur comme un instant de la pensée, c’est borner la fonction<br />
révélatrice du discours à sa cohérence expliquant le rapport logique des idées. Le moi<br />
consubstantiel du penseur dans cette « cohérence » s’évapore. « La fonction du langage<br />
reviendrait à supprimer ‘’l’autre’’ rompant cette cohérence et, par là même, essentiellement<br />
irrationnelle » 268 . Le langage dans cette perspective consiste à effacer l’Autre, en le faisant<br />
adhérer à la pensée du Même. Un débat dans lequel la parole du Même est posée comme<br />
absolue, supprime par ce fait l’existence même de l’Autre. Et pourtant, dans son activité<br />
communicationnelle, le langage protège l’Autre à qui le discours est voué. Assurément, le<br />
langage n’a pas pour fonction d’invoquer l’Autre comme « être représenté ou pensée ». C’est<br />
donc pourquoi le langage établit « une relation irréductible à la relation sujet-objet : la<br />
révélation de l’Autre » 269 . C’est exclusivement dans cette révélation que le langage comme<br />
ensemble de signes, peut se réaliser. Celui auquel on adresse la parole n’est pas un thématisé,<br />
ni un donné, il n’est non plus un particulier, par un coté donné à la totalisation . Le langage ne<br />
suppose pas l’universalité, ni la généralité, il permet simplement leur possibilité. « Le langage<br />
suppose des interlocuteurs, une pluralité » 270 , il se faits entre des altérités, il suppose des<br />
individus distincts. Leur échange ne luit pas dans la signification du Même par l’Autre, ni<br />
dans une coopération à l’universalité, au plan ordinaire du langage, car leur rapport est plutôt<br />
et simplement éthique.<br />
268 Ibid., p.45<br />
269 Ibid., p.45<br />
270 Ibid.<br />
70
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
III. L’interdiction au meurtre corollaire à la violence désorientée<br />
1. L’exigence éthique proscrit le meurtre<br />
La particularité du visage, comme nous ne cessons de le fortifier dans ce texte et comme<br />
cela parait dans toute l’œuvre de Levinas est qu’il « se refuse à la possession, à mes pouvoirs.<br />
Dans son épiphanie, dans l’expression, le sensible, encore insaisissable se mue en résistance<br />
totale de la prise » 271 . Cette transformation n’est possible que par la perspective d’un nouveau<br />
degré. Le refus de la possession ne se réalise pas comme un refus indépassable, comme<br />
fermeté de la masse de pierre escarpée contre laquelle la puissance de la main se fracture,<br />
comme distanciation d’une image dans l’étendue considérable de l’espace. « L’expression que<br />
le visage introduit dans le monde ne défie pas la faiblesse de mes pouvoir, mais mon pouvoir<br />
de pouvoir » 272 . Le visage, comme chose faisant partie des choses, perfore la forme qui<br />
néanmoins le circonscrit. Cet acte veut simplement dire que, le visage s’adresse à moi et par<br />
là m’appelle à une relation qui ne se mesure pas avec une force qui se déploie, qu’elle soit<br />
satisfaction ou connaissance.<br />
Cette nouvelle ampleur s’inscrit dans la manifestation du visage. L’ouverture continue des<br />
périphéries de sa forme dans le dit encellule dans une esquisse cette parodie qui fait exploser<br />
la forme. Le visage à la frontière de la béatitude et de la parodie se donne encore de ce fait<br />
dans un sens à ses capacités. Exclusivement dans une perspective : l’abysse qui se manifeste<br />
dans cette émotivité change l’essence même de la force, qui dès lors n’a plus la capacité<br />
d’empoigner, mais peut tuer. Le crime s’articule autour du sensible, « le meurtre vise encore<br />
une donnée sensible » 273 et pourtant il se tient en face d’un fait dont l’existence ne saurait<br />
s’immobiliser en captivité ou par toute forme d’ensauvagement. Il se trouve en face d’une<br />
donnée non-totalisable. La « négation » accomplie par la prise et l’utilisation demeure<br />
toujours imparfaite. La saisie qui réfute l’autonomie de la chose la préserve pour le Même.<br />
« Ni la destruction des choses, ni la chasse, ni l’extermination de vivants – ne visent le visage<br />
qui n’est pas du monde » 274 . Elles découlent encore du travail, elles ont une visée et sont la<br />
résultante d’un besoin. « Le meurtre seul prétend à la négation totale » 275 , il vise la mort<br />
absolue, l’anéantissement de l’altérité. Seulement, tuer n’est pas commander mais détruire,<br />
annihiler, abolir radicalement la quête de la com-préhension. « Le meurtre, selon Levinas,<br />
271 Ibid., p.172<br />
272 Ibid.<br />
273 Ibid., p.172<br />
274 Ibid.<br />
275 Ibid.<br />
71
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
exerce un pouvoir sur ce qui échappe au pouvoir » 276 ; il se fait sur le visage parce que, grâce<br />
à son incommensurable possibilité, il peut s’évader de toute prise. Aussi puissante, parce que<br />
le visage se manifeste dans le sensible pourtant déjà vulnérable, parce que le visage éventre le<br />
sensible. L’altérité qui se manifeste dans le visage procure la substance exclusive pouvant<br />
permettre la suppression totale. « Je ne peux vouloir tuer qu’un étant absolument indépendant,<br />
celui qui dépasse infiniment mes pouvoirs et qui par là ne s’y oppose pas, mais paralyse le<br />
pouvoir même de pouvoir » 277 . Autrui est l’unique être que je peux désirer assassiner. Sur ce,<br />
il est nécessaire d’établir une distinction entre le désir de tuer une bête et celui du meurtre.<br />
Nous pouvons attraper les animaux, les séquestrer, les tuer et les consommer, mais le meurtre<br />
d’Autrui est la certification que ce dernier se dérobe irrémédiablement de toute possession –<br />
c’est la reconnaissance d’une impuissance capitale du Même - c’est donc pourquoi nous le<br />
recherchons pour le tuer dans l’espoir d’en finir totalement avec lui. Mais Levinas nous avise<br />
et précise que l’exigence éthique proscrit le meurtre.<br />
Il n’est pas nécessaire de continuer à préciser la médiocrité de l’homicide qui dévoile<br />
l’opposition presque caduque de la difficulté. Cette épisode la plus médiocre de l’histoire de<br />
l’homme renvoie à une alternative unique, parce qu’elle suppose la suppression totale d’un<br />
être humain. Elle ne s’articule pas autour du pouvoir qu’un être peut détenir en tant<br />
qu’élément du monde. Autrui qui a la capacité absolue de contester mon offre, mais toute sa<br />
force inébranlable chute malheureusement face à l’épée tranchante du gladiateur ou à la balle<br />
qui transperce son cœur. Dans le contexte mondain, il n’a aucun pouvoir, cependant « il peut<br />
m’opposer une lutte, c’est-à-dire opposer à la force qui le frappe non pas une force de<br />
résistance, mais l’imprévisibilité même de sa réaction » 278 . Il m’objecte non pas un pouvoir<br />
supérieur, mais une vigueur considérable et qui se dévoile par conséquent comme si elle<br />
faisait partie d’une totalité, mais le dépassement même de son être par rapport à cette totalité;<br />
« l’infini de sa transcendance ». Cet Infini, supérieur au crime, qui « nous résiste déjà dans<br />
son visage, est son visage, est l’expression originelle, est le premier mot : « tu ne commettras<br />
pas de meurtre » 279 . L’infini neutralise la puissance par le refus illimité de l’assassinat, qui,<br />
solide et indomptable, brille dans le visage 280 d’Autrui, dans la « nudité » intégrale de son<br />
regard, sans protection, dans la nudité de l’embrasure absolue de Dieu. « L’Autre […], c’est<br />
276 Ibid.<br />
277 Ibid., p.173<br />
278 Ibid., p.173<br />
279 Ibid.<br />
280 Le visage est simultanément, par son principe de faiblesse, appel au meurtre et commandement de ne pas tuer.<br />
Cette tendance au meurtre ne peut s’exciter que face à ce qui se dissimule inlassablement.<br />
72
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
l’Infini : c’est Dieu qui effectivement met son idée en moi lors de la création » 281 , c’est<br />
pourquoi la relation éthique ou métaphysique a une base inébranlable. Il existe ici une relation<br />
qui n’est pas faite avec une résistance plus immense, mais avec quelque chose de<br />
radicalement « Autre : la résistance de ce qui n’a pas de résistance – la résistance éthique » 282 .<br />
L’épiphanie du visage incite cette possibilité d’évaluer l’infini de l’envie du meurtre, mais pas<br />
simplement comme une envie de néantisation absolue, mais comme une impuissance,<br />
totalement éthique, de cette tension au meurtre. La relation avec l’altérité radicale peut se<br />
transformer en combat, cependant elle dépasse l’idée de « lutte ».<br />
L’épiphanie du visage est éthique. La lutte dont ce visage peut menacer<br />
présuppose la transcendance de l’expression. Le visage menace de lutte<br />
comme éventualité, sans que cette menace épuise l’épiphanie de l’infini, sans<br />
qu’elle en formule le premier mot. La guerre suppose la paix, la présence<br />
préalable et non-allergique d’Autrui ; elle ne manque pas le premier<br />
évènement de la rencontre 283 .<br />
L’inaptitude au meurtre n’a pas un sens uniquement négatif et idéal; « la relation avec<br />
l’infini ou l’idée de l’infini en nous, la conditionne positivement » 284 . L’infini se manifeste<br />
comme visage dans la « résistance éthique » qui neutralise mes forces et se tient ferme et<br />
radical du fond des yeux sans protection dans sa « nudité et sa misère ». La saisie de cette<br />
avidité établit l’altérité même de l’Autre. Toutefois c’est de cette manière que « l’épiphanie de<br />
l’infini est expression et discours » 285 . La nature première du verbe et du discours n’est pas<br />
dans le message qu’il communique sur un univers interne et voilé. « Dans l’expression un être<br />
se présente lui-même. L’être qui se manifeste assiste à sa propre manifestation et par<br />
conséquent en appelle à moi » 286 . Ce secours n’est pas le « neutre » d’une représentation, mais<br />
une invitation qui s’adresse à moi de son indigence et de son altitude. S’adresser à moi<br />
signifie surmonter à tout instant, ce qui existe comme « plastique » dans la présentation.<br />
Se manifester comme visage, c’est s’imposer par delà la forme, manifestée<br />
et purement phénoménale, de présenter d’une façon, irréductible à la<br />
manifestation, comme la droiture même du face à face, sans intermédiaire<br />
d’aucune image dans sa nudité, c’est-à-dire dans sa misère et dans sa<br />
281 Balla Oyie, « L’irruption éthique d’autrui : corolaire de l’éthique de la justice de Etre », Annales de la<br />
FALSH, Université de Yaoundé I, Vol. 1, N°9, Nouvelle série, 2009. Premier semestre, pp. 145 - 146<br />
282 Levinas, Totalité et Infini, Op cit., p.173<br />
283 Idem, Totalité et Infini, Op cit., p.174<br />
284 Ibid.<br />
285 Ibid.<br />
286 Ibid.<br />
73
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
faim. Dans le Désir se confondent les mouvements qui vont vers la<br />
Hauteur et l’Humilité d’Autrui 287 .<br />
L’expression ne luit pas comme un éclat qui se propage sans que l’être luisant le sache, ce<br />
qui pourrait être la signification de la « beauté ». Se présenter en participant à sa propre<br />
présentation signifie appeler l’interlocuteur et s’abandonner à sa réponse et à sa mise en<br />
cause. Le parler ne se manifeste pas comme une image véridique, ni comme un fait. « L’être<br />
donné dans la représentation vraie demeure possibilité d’apparence » 288 , pour que la relation<br />
avec l’Autre soit éthique, il est donc indispensable que le stade de la vision soit dépassé. Je ne<br />
dois pas seulement me contenter d’observer le visage de l’Etranger, au-delà de ce mouvement,<br />
il est capitale pour moi de me sentir responsable de lui, contraint par son indigence, à la nudité<br />
primordiale de son visage exposé à la violence de répondre à son appel. « La peau du visage<br />
est celle qui reste la plus nue, […] bien que d’une nudité descente. Il y a dans le visage une<br />
exposition sans défense. Une pauvreté essentielle […] La preuve en est qu’on essaie de<br />
masquer cette pauvreté en se donnant des poses, une contenance » 289 . Cependant quel que soit<br />
l’accoutrement qu’on arbore, le visage demeure nu. Car, la nudité dont parle Levinas n’est pas<br />
celle du dévêtue ou du déshabillée, mais celle de la révélation de la vulnérabilité dans le<br />
visage d’Autrui.<br />
La manifestation du visage ne présente pas l’Autre sous la forme d’un thème ou comme<br />
un agencement de qualité constituant une image. Le visage échappe à toute catégorisation, il<br />
ne s’exprime pas par ces « qualités ». Le visage n'est pas objet d'une expérience au sens<br />
ordinaire du mot, car une expérience a ordinairement pour objet quelque chose de présent. En<br />
effet, une figure est présente avec quelques caractéristiques et structures objectivables. Le<br />
«visage», en revanche, dépouillé de ses qualités objectivables, «le visage dans sa nudité»,<br />
comme aime le notifier Levinas, est une absence. Le visage, n'a pas de statut, n'a pas de<br />
fonction à l'intérieur de l'horizon du monde; il dérange plutôt l'ordre narcissique de mon<br />
monde. C'est justement à cause de cette articulation que le visage d’Autrui me fascine, qu'il<br />
est pour moi une visitation, qu'il me parle — même sans mots — d'une mystérieuse hauteur.<br />
Le visage est innocent et sans défense. Il est un appel, une sollicitation qui est un<br />
commandement. « Voir le visage, c’est parler. La transcendance n’est pas une optique, mais le<br />
premier geste éthique » 290 . La présence est parole, le visage parle et son premier enseignement<br />
287 Ibid., p.174<br />
288 Ibid.<br />
289 Levinas, Ethique et Infini, Op. Cit., p.90<br />
290 Idem, Totalité et Infini, Op cit., p.149<br />
74
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
est dans le : « Tu ne tueras point » ; il affirme l’interdit au meurtre et le devoir infini de<br />
responsabilité pour Autrui. Le visage me montre que je ne suis pas seul au monde, il me<br />
signifie que dans ce monde, je suis avec-les-autres. Autrui par son visage se manifeste au moi<br />
non pas comme alter ego mais comme une autorité, car il me juge, il me juge sans me détruire<br />
et c’est ce jugement éthique que Levinas traduit par l’expression « mise en question » qui<br />
ouvre à l’humain ou à la moralité. Il n’est pas facile de faire preuve de mutisme face à la<br />
présence de l’Autre, car nous parlons soit par le regard ou par les mots et cette réponse<br />
représente chez Levinas une prise en charge, car répondre à l’appel de l’Etranger c’est déjà<br />
répondre de lui. Cependant comment cette responsabilité envers l’Etranger parvient-elle à<br />
déposséder le moi de sa souveraineté ?<br />
2. Vulnérabilité et non violence<br />
Nous rappelons en prélude que la manifestation du visage est langage. Face au visage, le<br />
Moi est mis en question par l’Infini de l’immanence de celui qui s’offre à la vision. Dans son<br />
indépendance d’être-au-monde, le Moi se découvre injuste, usurpateur d’un espace et<br />
assassin. Traumatisé par cette posture en présence de l’Infini, le Moi est fréquenté par<br />
l’Etranger. La « Révélation » n’est pas semblable à une irruption céleste ; elle est l’excursion<br />
de l’humilité dans toute sa sublimité. L’Infini chez Levinas, c’est l’Autre dépourvue de tout<br />
voile et déguisement ; c’est le visage dans sa nudité, sa pauvreté et sa vulnérabilité. L’unique<br />
présence de l’Etranger suffit pour rappeler au Moi son obligation de répondre.<br />
L’autre, le libre est aussi l’étranger. La nudité de son visage se prolonge dans<br />
la nudité du corps qui a froid et qui a honte de sa nudité. […] Ce regard qui<br />
supplie et exige – qui ne peut supplier que parce qu’il exige – privé de tout<br />
parce qu’ayant droit à tout et qu’on reconnaît en donnant (tout comme on<br />
« met les choses en question en donnant ») – ce regard est précisément<br />
l’épiphanie du visage comme visage. La nudité du visage est dénuement.<br />
Reconnaître autrui, c’est reconnaître une faim. Reconnaître Autrui – c’est<br />
donner. Mais c’est donner au maître, au Seigneur, à celui que l’on aborde<br />
comme ‘’vous’’ dans une dimension de hauteur 291 .<br />
La présence du visage est discours et, ce discours est celui de la veuve, de l’orphelin ou<br />
de l’étranger. Je suis appelé et conditionné moralement à le secourir l’Autre, car son visage<br />
me rappelle mes impératifs et me « juge ». L’être qui se présente dans le visage provient<br />
d’une « dimension de hauteur », étendue de la transcendance où il peut se manifester comme<br />
étranger, sans se présenter à moi, comme adversité ou rival. Celui qui rend hospitalité au<br />
291 Levinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Op cit., pp.194-195.<br />
75
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
visage édifié la liberté dans la trajectoire de la bonté et de la fraternité. Etre Moi veut dire être<br />
incapable de refouler cette responsabilité qu’offre cet appel de l’Etranger, je n’ai non plus le<br />
pouvoir de me dérober de cette présence ni de me soustraire par « le silence ». Mon devoir est<br />
d’accueillir et de trouver des ressources pour la survie du miséreux. Pour mieux signifier cette<br />
responsabilité, Levinas cite Rabbi Yohanna dans le Talmud qui stipule que « laisser des<br />
hommes sans nourriture - est une faute qu’aucune circonstance n’attenue ; à elle ne s’applique<br />
pas la distinction du volontaire et de l’involontaire » 292 . Etre inhospitalier, manger sans même<br />
penser ni donner à l’autre est un crime qu’aucun tribunal éthique ne peut pardonner. Face à la<br />
famine des êtres humains la responsabilité ne s’évalue qu’« objectivement ». Elle est<br />
indiscutable. Le visage instaure le discours premier dont le mot originel est « obligation » que<br />
nulle « intériorité » ne permet d’échapper. Discours qui contraint à faire partie du discours,<br />
début du discours que le rationalisme nomme, « forces » qui convainc même « les gens qui ne<br />
veulent pas entendre » 293 et réalise ainsi la véritable globalité de la raison.<br />
Cependant, il faut bien noter que la parole ne se réalise pas comme l’affirmation d’une<br />
« forme intelligible » qui unirait des termes entre eux pour établir, à travers l’écart, le<br />
rapprochement des fractions dans une totalité. La parole précède tous ces effets qui établissent<br />
des liaisons et qui sont perceptibles à un tiers. « L’évènement propre de l’expression consiste<br />
à porter témoignage de soi en garantissant ce témoignage » 294 . Cette certification de soi, se<br />
manifeste uniquement comme « visage, c’est-à-dire comme parole » 295 . Toutefois, le langage<br />
n’est exclusivement possible que lorsque la parole abandonne nécessairement cette « fonction<br />
d’acte » et lorsqu’elle rejoint son essence première qui est « expression.»<br />
Parler ne revient pas à dénommer l’intériorité de l’Autre, car Autrui grâce à son<br />
incommensurable mesure, ne se donne pas dans son expression et par conséquent garde sa<br />
liberté.<br />
La présentation de l’être dans le visage n’a pas le statut d’une valeur. Ce que<br />
nous appelons visage est précisément cette exceptionnelle présentation de soi<br />
par soi, sans commune mesure avec la présentation de réalités simplement<br />
données, toujours suspecte de quelque supercherie, toujours possiblement<br />
rêvées 296 .<br />
292<br />
Traité Talmudique synhedrin, 104 b<br />
293<br />
Platon, République, 327b<br />
294<br />
Levinas, Totalité et Infini, Op. Cit, Ibid., p.176<br />
295<br />
Ibid.<br />
296<br />
Idem, Totalité et Infini, Op cit., p.177<br />
76
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Le visage n’arbore pas le « statut de valeur » puisque la manifestation du visage n’accepte<br />
pas l'ambivalence entre le vrai et le faux que sous-tend toute valeur. Autrement dit, par<br />
l’épiphanie de son visage, l’Etranger se manifeste dans une relation originale qui transcende<br />
le domaine consensuel et corrélatif des valeurs. En fait, l'altérité, c'est-à-dire « l'être-pour-<br />
autrui » ne se fonde pas, d’après Levinas, sur des valeurs établies d’avance à l’exclusion de la<br />
bonté du moi: «Être-pour-autrui, ne doit pas suggérer une finalité quelconque et n'implique<br />
pas la position préalable ou la valorisation d'une je ne sais quelle valeur. Être pour autrui -<br />
c'est être bon » 297 . Nous expliquerons amplement cette idée dans le chapitre suivant.<br />
La « non-violence » conserve la différence du Même et de l’Autre. « Elle est paix. Le<br />
rapport avec l’Autre – absolument autre – qui n’a pas de frontière avec le Même, ne s’expose<br />
pas à l’allergie qui afflige le Même dans une totalité et sur laquelle la dialectique repose » 298 .<br />
L’Autre n’est pas pour la raison un éclat qui fait exécuter la dialectique, mais le premier<br />
enseignement raisonnable, l’exigence même de tout enseignement. Le supposé désordre de<br />
l’altérité, présume « l’identité tranquille du Même », une indépendance certaine de ses<br />
capacités qui s’active sans inquiétudes et à qui l’Autre, c’est-à-dire « l’étranger n’apporte que<br />
gène et limitation » 299 comme cela parait dans la philosophie hégélienne et hobbesienne 300 .<br />
Cette identité pure affranchie de toute coopération, liberté dans le Moi, peut néanmoins<br />
abimer sa sérénité si l’Etranger, au lieu de la blesser en se manifestant sur la même dimension<br />
qu’elle, « lui parle, c’est-à-dire se montre dans l’expression, dans le visage et vient de haut<br />
» 301 . L’autonomie de l’individu s’escamote de ce fait non pas comme désagrégée par une<br />
force d’opposition, mais comme injustifiée, « coupable et timide ; mais dans la culpabilité elle<br />
s’élève à la responsabilité. La contingence, c’est-à-dire l’irrationnel ne lui apparait pas hors<br />
d’elle dans l’autre, mais en elle » 302 . Ce n’est donc pas la délimitation par l’Etranger qui<br />
forme l’irrationalité, mais l’égoïsme, comme arbitraire par lui-même. Le rapport avec l’Autre<br />
assimilable à la relation avec sa transcendance – le rapport avec l’Etranger qui conteste<br />
l’ensauvagement immédiat de sa destinée inévitable, introduit en l’homme ce qui n’était pas<br />
en lui, quelque chose de nouveau. Cependant cette activité sur la liberté du moi stoppe<br />
l’ensauvagement et la vicissitude, et, dans cette même optique, établit la raison. Autrui ne se<br />
révèle pas à la raison sous la forme d’un scandale qui incite son mouvement dialectique<br />
297 Ibid., p.239<br />
298 Ibid., p.178<br />
299 Ibid.<br />
300 Cf. Hobbes, Léviathan, Vrin, 2005.<br />
301 Levinas, Totalité et Infini, op cit., p.178<br />
302 Idem, Totalité et Infini, Op cit., p.178<br />
77
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
comme cela parait manifestement chez Hegel, il est plutôt « le premier enseignement ». Il<br />
s’agit précisément d’un être qui a reçu en lui « l’idée d’Infini », parce que vu son<br />
incommensurable hauteur, elle ne peut résulter de lui. « Penser, chez Levinas, c’est avoir<br />
l’idée de l’Infini » 303 ou être éduqué par le Maître. Toute pensée raisonnable renvoie à cet<br />
enseignement qui résulte de l’Infini dont le sens et la signification sont indéfinissable. Par<br />
cette approche, Levinas ouvre une perspective novatrice, une ontologie 304 du possible, une<br />
éthique dans lequel seule la force du Même face à l’Autre peut porter préjudice.<br />
Le langage ne convie pas à la complicité, il est justice. En lui le visage de l’Autre est<br />
présent et parle, et cette parole est une invitation à la non violence. Dans sa « nudité », le<br />
pauvre ou l'étranger sont égales à moi. Leur pauvreté en appelle à mes possibilités, ils sont<br />
sous ma responsabilité, ils remettent en question ma liberté et s’appuient sur « le tiers » qui<br />
m’observe dans les yeux de l’Autre et qui est présent dans notre rencontre. L’Etranger vient<br />
vers moi pour que je me défasse des acquis qui m'entourent et qui m’enlisent afin de devenir<br />
« autrement qu’être ». L'épiphanie du visage ouvre donc l'humanité et m'invite à<br />
l’enseignement. Grâce au langage, elle édifie une société humaine dans laquelle les<br />
interlocuteurs demeurent parfaitement séparés, mais accueillants et hospitaliers.<br />
303 Ibid., pp. 178-179<br />
304 Ontologie au sens de métaphysique, c’est-à-dire relation avec l’autre<br />
78
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Rester muet, neutre face à l’appel de l’Etranger, face au visage de l’orphelin, de la veuve<br />
qui demande secours représente l’en-sauvage-ment par excellence; qui n’est rien d’autre<br />
qu’un rejet, un dégout en face d’une présence étrangère, une négation totale, l’inhospitalité,<br />
une disposition insensible et inhumaine face à la souffrance de l’Autre. Quoique, nous<br />
précisons que l’ouverture à l’Autre n’est pas naturelle, mais lorsque nous éconduisons cette<br />
ouverture à cause des présupposés ensauvageants, nous adoptons une attitude bestiale 305 . La<br />
responsabilité est le mouvement qui conduit au désintéressement - passage de l’égoïsme à la<br />
bonté. Cette responsabilité dont nous parle Levinas, n’est pas assimilable à celle de Kant qui<br />
est la conséquence d’un raisonnement articulé autour de l’impératif catégorique, ni<br />
comparable à la solution d’un calcul économique comme chez Stuart Mill, mais uniquement<br />
une expérience de l’Autre qui nous appelle à partir du devoir-être à l’« autrement qu’être ».<br />
Levinas nous invite à la « bonté éternelle », à une bonté « an-archique», c’est-à-dire sans<br />
concepts, à une bonté qui « est hors de tout système, de toute religion, de toute organisation<br />
sociale » 306 . Cette nouvelle approche met donc en exergue le problème de l’égoïsme. La<br />
critique levinassienne de l'égoïsme engage à comprendre le sujet autrement, c'est à-dire à<br />
partir de l'autre homme. Si je mange, est ce que cela veut forcement dire que l’Étranger et le<br />
tiers mangent? Être est-ce être égoïste? Quelles ordonnances peuvent permettre au Moi de<br />
partir de l’être-pour-soi à l’être-pour-autrui ?<br />
I. Respecter l’Autre<br />
Contre « l’égologie propre à la philosophie occidentale », cette façon pour le « logos »<br />
philosophique de se dire et de se penser comme la transcription même de l’individu dans<br />
l’être, cette forme d’identification principale qu’est l’activité même de la connaissance dont la<br />
tension est tyrannique, universalisante et totalisante, Levinas veut décontenancer l’en-<br />
sauvage-ment d’une pensée qui croit avoir la capacité de tout totaliser en une sagesse de<br />
l’indétermination qui trouve sa provenance dans une subjectivité manifestée comme<br />
305 Être bête, c’est se refermer sur soi. C’est se fier à son propre savoir, croire tout connaître. En somme, la<br />
bêtise c’est pouvoir toujours interpréter l’Autre, l’analyser, le reconnaître par les traits de son visage, sa classe,<br />
son appartenance ethnique, son idéologie, sa particularité.<br />
306 Levinas, « La proximité de l'autre », in Altérité et Transcendance, Fata Morgana, coll. “ Essais ”,<br />
Montpellier, 1995, p.117<br />
CHAPITRE II : ETRE-POUR-AUTRUI<br />
79
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
vulnérabilité, modalité de toutes figures de respect, comme non-indifférence à l’existence<br />
traumatisante d’Autrui dans son absolu différence.<br />
Face à l’opprimé, l’orphelin et à la veuve, face à leur vulnérabilité, à leur situation<br />
estropié, nous sommes touchés de l’intérieur et c’est ce qui nous amènes à éprouver de la<br />
considération et du respect envers ces autres hommes. Cependant il est clair que cette<br />
expérience du respect, par-delà la pitié et l’amitié, nous fait ressentir comme une fissure au<br />
fond de notre âme que nous n’arrivons généralement pas à signifier. Et pourtant, c’est<br />
précisément par cette fissure de l’esprit corollaire à la « ‘’scission ontologique’’ en concepts<br />
langagiers » 307 que Levinas examine et définit la subjectivité dont le statut est nécessairement<br />
le point focal de sa pensée polyvalente et hermétique, réflexion imperméable pour réfléchir<br />
sur l’imperméabilité elle-même. Néanmoins il faut souligner que la vulnérabilité se réalise<br />
uniquement si l’être en face de l’Autre est troublé, altérée par la rencontre de l’Autre 308 .<br />
Le dessein levinassien est de supplanter cette pensée de la violence où l’irrespect conduit<br />
à l’oubli de l’Autre par une philosophie de la caresse dans laquelle l’Etranger est respecté<br />
dans sa différence. Mais pour réaliser ce projet, il est nécessaire de briser le lien qui nous lie à<br />
la philosophie du savoir sans toutefois négliger l’exigence constamment insatisfaite du<br />
discernement et de la rationalité. Cette rupture est d’autant nécessaire car l’ontologie<br />
traditionnelle par son réductionnisme intelligible assimile l’Autre au Même, ce dernier qui<br />
renvoie à la Totalité et qui se manifeste par le savoir théorique, l’objectivité, la politique<br />
d’expansion du syncrétisme simpliste et ensauvageant qui se résume par l’ontologisation qui<br />
outrepasse l’inviolabilité éthique d’Autrui, le meurtre, la guerre, les philosophies du système<br />
tel est le cas express de Hegel. Face à ces concepts d’intégration, d’unification, de<br />
globalisation, d’ajustement structurel corollaire à la mondialisation, à la totalisation qui<br />
habitent la philosophie occidentale, Levinas oppose l’idée d’Infini - l’Autre dans son<br />
irréductible altérité et en tant qu’entité sans concepts. Levinas nous invite à la vigilance, au<br />
307 Balla Oyie, « L’irruption éthique d’autrui : corolaire de l’éthique de la justice de Etre », Annales de la<br />
FALSH, Université de Yaoundé I, Vol. 1, N°9, Nouvelle série, 2009. Premier semestre, p. 143<br />
308 C’est dans le même sillage que Scheler, Buber et Rosenzweig que Levinas fait découler la subjectivité de<br />
l’intersubjectivité mais avec quelques différences. Pour Buber, « au commencement est la relation » et le sujet<br />
ne peut se connaître et vivre dans son entièreté exclusivement dans la rencontre de l’autre. Cette rencontre réalise<br />
par le dialogue qui est symétrie et chacun s’y trouve responsable. Etre responsable, d’après lui c’est donner une<br />
réponse réelle au discours de l’autre que l’on confronte dans la rencontre réelle. L’être humaine vit toujours dans<br />
un contexte relationnel : soit la relation « Je-Tu » ou dans la relation « Je-Cela ». Le « Je », le « Tu » et le<br />
« Cela » n’existent que d’après Buber dans le champ de la relation et non pas séparément comme chez Levinas.<br />
C’est dans la relation que naissent également le « Je » et le « Tu » que le « Je » et le « Cela. » Cf. Martin Buber<br />
, Je et Tu, Ed. Aubier, France, 1969, op. cit., p. 38<br />
80
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
renouveau et à l’attention, ou selon les termes de Maurice Blanchot, à l’« appel de la raison à<br />
l’éveil d’une autre raison ». Assurément, l’Etranger qui demande abris, la veuve et l’orphelin<br />
sont vulnérables, il m’incombe dans cette mesure de leur devoir du respect. Mais ce que<br />
Levinas veut nous montrer dans cette approche de la vulnérabilité est que ce respect que je<br />
concède à l’Autre ne résulte pas de moi ou de l’obéissance d’un impératif catégorique<br />
quelconque comme Kant semble le montrer, c’est plutôt l’Autre qui m’intime du respect, car<br />
je suis son « otage ». Le fait que Levinas pense le Moi comme « otage de l’autre » produit une<br />
révolution féconde au sein de la pensée philosophique, cette posture infiniment éthique<br />
déplante la rationalité universelle. La rencontre de l’Etranger dans son visage est l’exigence<br />
sine qua none qui débouche sur l’infini, or l’universalité censure ce débordement, elle envahie<br />
tout l’espace. Et, envahir l’étendu est pour Levinas, une manifestation substantielle de<br />
l’irrespect - violence.<br />
La vulnérabilité du visage nous prend en « otage » malgré nous, car nous sommes<br />
responsables d’Autrui. Sentir, endurer cette responsabilité et la prendre sur soi est une des<br />
formes suprêmes du respect. Cependant, le respect chez Levinas ne se traduit pas dans l’acte<br />
par lequel un individu s’incline face à une loi, mais dans l’inclinaison d’un être face à un<br />
Autre qui l’ordonne de réaliser un travail. « Mais pour que ce commandement ne comporte<br />
aucune humiliation – qui m’enlèverait la possibilité même de respecter –, le commandement<br />
que je reçois doit être aussi le commandement de commander celui qui me commande » 309 .<br />
L’acte de commander n’est la propriété de personne, nul n’est au dessus du commandement,<br />
car en commandant, je suis commandé par celui ou ceux que je commande. Le<br />
commandement consiste plus précisément, « à commander à un être de me commander. Cette<br />
référence d’un commandement à un commandement, c’est le fait de dire Nous, de constituer<br />
un parti. Par cette référence d’un commandement à l’autre, Nous n’est pas le pluriel de Je » 310 .<br />
Toutes les fois que je dis « Nous », je suis commandé par l’Autre 311 .<br />
Par ailleurs, la subjectivité du sujet d’après Levinas se lie dans l’instantanéité du sensible,<br />
cette posture conteste l’ambition de l’idéalisme qui subsume que la subjectivité est totalement<br />
pensée et concept. « L’immédiateté du sensible qui ne se réduit pas au rôle gnoséologique<br />
assumé par la sensation, est exposition à la blessure et à la jouissance, ce qui permet<br />
309<br />
Levinas, Entre nous. Essais sur le penser - à - l’autre, Grasset, Paris, 1991, p. 46<br />
310<br />
Ibid.<br />
311<br />
Nous rappelons que, chez Levinas l’éthique comme philosophie première précède l’ontologie. Son objectif est<br />
de déconstruire le rapport sujet-objet et la primauté de la conscience, de l’ego et de la présence, afin d’être<br />
attentif au « dire » d’une sensibilité originelle et infinie.<br />
81
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
d’atteindre la subjectivité du sujet se complaisant en soi et se posant pour soi » 312 . La<br />
subjectivité est fragilité du sensible, « adversité ramassée dans la corporéité susceptible de<br />
douleur dite physique, exposée à l’outrage et à la blessure, à la maladie et à la vieillesse, mais<br />
adversité dès la fatigue des premiers efforts du corps » 313 . La subjectivité est donc<br />
vulnérabilité, c’est-à-dire déracinement de la jouissance, sacrifice en faveur d’Autrui.<br />
« L’immédiateté du sensible » est l’ouverture à l’Autre, la contiguïté du visage. La<br />
subjectivité est, en dépit de soi, pour Autrui. Dans la pénombre de son intériorité, dans la<br />
quarantaine de la jouissance, elle définit d’ores et déjà la signification éthique : l’immédiateté<br />
de la sensibilité est vulnérabilité, c’est-à-dire sa disposition à la tendresse pour Autrui.<br />
Comme le souligne Levinas dans son Ethique et infini, ma responsabilité-pour-Autrui est sans<br />
retour : « Je suis responsable d’autrui sans attendre de réciproque, dût-il m’en coûter la vie ».<br />
C’est donc parce que le rapport entre le Même et l’Autre se fait sans réciprocité que le Même<br />
est assujetti par l’Autre - la responsabilité du Moi est toujours supérieure à celle des autres.<br />
Je suis d’emblée le serviteur du prochain, déjà en retard et coupable de<br />
retard, je suis comme ordonné du dehors – traumatiquement commandé sans<br />
intérioriser par la représentation et le concept l’autorité qui me commande.<br />
Cette persécution traumatisante est assumée comme l’essence de la<br />
subjectivité, toujours accusée et coupable et punie avant d’avoir rien fait 314 .<br />
Toute existence est responsabilité, et cette dernière n’est pas pensée car elle précède toute<br />
liberté pensante. Mon existence est conditionnée et commandée par Autrui en tant<br />
qu’extériorité absolue. La conséquence de cette persécution de l’extériorité est qu’ici, je suis<br />
toujours coupable, seul mon pouvoir d’action sur l’Autre est immoral. Ici, le châtiment ne<br />
s’additionne pas à la subjectivité mais appartient à l’intimité du soi, simultanément,<br />
contradictoirement, de l’essence de l’individu et celle d’Autrui. Dans cette monomanie<br />
incessante, précède la réalité phénoménale, qui habite le centre de la subjectivité vulnérable,<br />
se trouve la responsabilité la plus excellente. Le respect de l’autre homme ne résulte pas d’un<br />
rationalisme autonome, il est perpétuellement déjà là. « Le visage du prochain me signifie une<br />
responsabilité irrécusable, précédent tout consentement libre, tout pacte, tout contrat » 315 . Le<br />
respect dont la responsabilité pour Autrui est le fondement, n’est pas une manœuvre de la<br />
raison. Mon respect pour Autrui ne dépend pas de moi. Ce qui m’incombe de respecter Autrui<br />
m’est ordonné par la seule manifestation de son visage qui est incontournable, par sa seule<br />
312 Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Nijhoff, La Haye, p. 81<br />
313 Ibid., p. 71<br />
314 Ibid., p. 110<br />
315 Ibid., p. 112.<br />
82
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
proximité et non par un horizon d’altérité universelle. Il n’est donc pas question ici de faire<br />
preuve d’hypocrisie ou de faire comme si on respectait un impératif soi-disant catégorique ou<br />
une formalité morale, car cette tension au respect de la vulnérabilité est en dépit de notre<br />
vouloir. Néanmoins malheureusement, les civilisations capitalistes et en-sauvageantes ont<br />
balayé d’un revers cette tension pour Autrui qui nous invite depuis le tréfonds de notre<br />
extrême intériorité au respect de la vulnérabilité de l’Etranger pour laisser libre cours à la<br />
bestialité qui permet même de justifier l’injustifiable, c’est-à-dire le meurtre d’Autrui ou la<br />
glorification horrible de l’assassinat d’un être humain.<br />
L’éthique levinassienne nous convie à un mouvement non relatif, radical, interne à<br />
l’individu, qui se traduit par le passage du Moi au Soi ou alors du volontaire au non-<br />
volontaire. Cette responsabilité pour Autrui se manifeste de manière asymétrique et dans cette<br />
dernière nul ne peut se substituer à l’Autre. La responsabilité-pour-autrui est une exigence<br />
incommensurable, elle est une contrainte et non un loisir. Le Moi est assujetti par Autrui et<br />
faible d’une faiblesse qui le voue à Autrui. Pour mieux étayer cette perspective, Levinas cite<br />
généralement l’écrivain russe Fiodor Dostoïevski dans son roman les Frères Karamazov 316 ,<br />
qui stipule que « chacun de nous est coupable devant tous pour tous et pour tout, et moi plus<br />
que les autres » 317 . Cette posture marque l’exigence excessive de la responsabilité pour<br />
Autrui que nous allons mieux expliquer dans la troisième partie de ce texte. Néanmoins<br />
Levinas prend sur soi cette responsabilité dans son discours puisque l’éthique, d’après lui, est<br />
une obligation illimitée, une obligation du Moi pour l’Autre et sans réciprocité.<br />
II. Être au service de l’humanité<br />
Le recours au tiers ne nous amène pas abandonner la proximité de l’Autre ; c’est au<br />
contraire dans cette altérité que s’effectue un partage entre Autrui et moi. Nous rappelons que<br />
cette réciprocité est établie par l’Autre qui m’ordonne de gouverner, et également une parité<br />
entre l’Autre et moi en faveur du tiers. Cependant est-il possible d’agrandir l’étendue de cette<br />
égalité dans l’humanité ? Car, même dans les conditions suprêmes dans lesquelles tous les<br />
étrangers et moi serions unis et égaux en faveur du tiers, ce dernier demeurerait incompris<br />
dans notre égalité et c’est cette exclusion qui est source d’ensauvagement envers les autres<br />
316 « Les Frères Karamazov (en russe : Братья Карамазовы) est le dernier roman de l'écrivain russe Fiodor<br />
Dostoïevski. Il a été publié sous forme de feuilleton dans le magazine Ruskii Vestnik (Le Messager russe) de<br />
janvier 1879 à novembre 1880. Les Frères Karamazov est un roman philosophique qui explore des thèmes tels<br />
que Dieu, le libre arbitre ou la moralité. Il s'agit d'un drame spirituel où s'affrontent différentes visions morales<br />
concernant la foi, le doute, la raison et la Russie moderne. » Cf. Encyclopédie Wilkipédia<br />
317 Fiodor Dostoïevski, Les Frères Karamazov, traduction d’Ely Halpérine-Kaminsky et Charles Morice, 1888,<br />
Livre VI/II<br />
83
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
hommes expulsés injustement dans un tiers-monde. Quelle disposition humanitaire doit régner<br />
afin que toute exclusion du monde soit prohibée ?<br />
Sur la question de l’égalité, Levinas précise que « le pauvre, l’étranger se présente comme<br />
égal. Son égalité dans cette pauvreté essentielle, consiste à se référer au tiers, ainsi présent à la<br />
rencontre et que, au sein de sa misère, Autrui sert déjà » 318 . Il se racole à moi afin que je le<br />
serve, « il me commande comme Maître. Commandement qui ne peut me concerner qu’en<br />
tant que ce que je suis maître moi-même, commandement, par conséquent, qui me commande<br />
de commander. Le tu se pose devant un nous » 319 . Etre nous, conserver notre ipséité ne<br />
consiste pas à s’ensauvager ou à se « côtoyer » autour d’un travail commun. « La présentation<br />
du visage – l’infini de l’Autre – est dénuement, présence du tiers (c’est-à-dire de toute<br />
l’humanité qui nous regarde) et commandement qui commande de commander » 320 . Pour plus<br />
de précision, le tiers est « toute l’humanité qui nous regarde » 321 à travers les yeux de<br />
l’Etranger. Dans la philosophie levinassienne, le tiers n’est nullement expulsé du groupe<br />
d’égaux qui s’aménagerait à son service, cependant il permet au Moi d’être ouvert et<br />
responsable envers tous les autres et non exclusivement pour l’Autre. L’inclusion du tiers<br />
dans le règne de la communauté d’égalité permet de redéfinir le monde humain, le monde<br />
avec Autrui, le tiers et moi signifie tous les autres, plus précisément les êtres humains à<br />
l’exception de moi ; parce que bien que je sois avec les autres, ma tâche est unique, je<br />
demeure responsable de l’Autre, dont je suis responsable avant tous les autres hommes et qui<br />
me joint à lui pour être des servus, des serviteurs du tiers et de toute la communauté humaine.<br />
Pour donc parler d’humanité, il faut que le concept de tiers-exclu soit supplanté par ma<br />
responsabilité pour tous les autres à partir du commandement du pauvre, de l’étranger et de<br />
mon prochain.<br />
L’humanité telle que nous venons de l’envisager avec Levinas n’est réalisable si et<br />
seulement si tout être humain se considère comme membre d’une filialité ou d’une unique<br />
famille, cependant nous précisons qu’il ne faut pas comprendre la famille dont nous parlons<br />
au niveau biologique, même si « la biologie fournit les prototypes de toutes ces relations » 322 ,<br />
ni au niveau théologique, malgré l’interprétation de Dieu ici comme le père par excellence de<br />
tous les êtres humains. D’ailleurs le fait « que tous les hommes soient frère ne s’expliquent<br />
pas par leur ressemblance – ni par une cause commune dont ils seraient l’effet comme des<br />
318 Levinas, Totalité et Infini, op cit., p.188<br />
319 Ibid.<br />
320 Ibid.<br />
321 Ibid.<br />
322 Ibid., p.256<br />
84
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
médailles qui renvoient au même coin qui les a frappées » 323 . L’existence humaine comme<br />
famille 324 renvoie donc à une communauté d’êtres parlants, plus distinctement, une<br />
communauté dans laquelle toute la descendance est engendrée par un unique père :<br />
La fraternité humaine a ainsi un double aspect, elle implique des individualités<br />
dont le statut logique ne se ramène pas au statut de différences ultimes dans un<br />
genre […] Elle implique d’autre part la communauté de père, comme si la<br />
communauté du genre ne rapprochait pas assez 325 .<br />
Le père est celui qui aime ses enfants mais d’un sentiment de choix et qui commande.<br />
C’est quelqu’un qui considère tous ses fils comme fils unique et leur donne un amour<br />
spécifique. Certes, « le fils reprend l’unicité du père » mais il reste extérieur et différent du<br />
père : « le fils est fils unique. Non pas par le nombre. Chaque fils du père, est fils unique, fils<br />
élu » 326 . L’amour du père pour l’enfant réalise l’unique relation possible avec la singularité<br />
même d’un autre et, dans cette perspective, « tout amour doit s’approcher de l’amour<br />
paternel 327 .» Toutefois, cette relation que le père entretient avec son enfant, ne vient pas<br />
s’additionner à l’être de l’enfant qui est déjà formé, comme une bonne richesse. L’Eros<br />
paternel assiège uniquement la singularité du fils – son identité en tant que fils commence<br />
dans l’élection et non dans la jouissance. « Il est unique pour soi, parce qu’il est unique pour<br />
son père » 328 . C’est pourquoi, il a la capacité, en tant qu’enfant, de ne pas être à « son<br />
compte », mais de dépendre de ses parents. Egalement, parce que l’enfant détient sa<br />
singularité de l’élection du père qu’il peut être instruit et éduqué, « commandé et peut obéir »,<br />
et que la mystérieuse condition de la famille est réalisable. C’est donc grâce à cette élection<br />
que, en tant que fils unique bien que je ne sois point l’unique fils de la famille, je suis<br />
responsable de tous les autres membres de la famille qui forment l’humanité. C’est parce que<br />
j’ai été choisi par mon Père qui est plus haut que moi et, qui me commande depuis cette<br />
hauteur, que je peux commander moi également. Le père m’ordonne de « commander », de<br />
conduire par le « face-à-face », face aux autres hommes qui sont mes frères, « mes proches »,<br />
« mon Peuple », les autres pour qui je réclame justice 329 . Ces étrangers peuvent être toute<br />
323<br />
Ibid., p.189<br />
324<br />
D’après Levinas : « Le monothéisme signifie cette parenté humaine, cette idée de race humaine qui remonte à<br />
l’abord d’autrui dans le visage, dans une dimension de hauteur, dans la responsabilité pour soi et pour autrui ».<br />
Cf. Totalité et Infini, p. 190<br />
325<br />
Ibid., p.189<br />
326<br />
Ibid., p. 256<br />
327<br />
Ibid.<br />
328<br />
Ibid.<br />
329<br />
Levinas veut mettre ici en exergue la violence commis par Autrui à son propre peuple. Cf. Ethique et Infini.,<br />
p.106<br />
85
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
l’humanité, puisque la paternité du père se réalise comme un futur pluriel 330 , plus exactement,<br />
dans le temps de la proximité, comme ouverture à l’infinie multiplicité des frères, tout le<br />
monde étant paradoxalement identique à lui, unique, authentique et tous égaux malgré les<br />
individualités. La relation à l’humanité ordonnée par le « commandement » du père est<br />
langage, voie par laquelle j’offre le monde aux autres. Etre au service de l’humanité, c’est<br />
faire passer les autres avant soi, c’est préférer les autres plutôt que soi.<br />
III. Etre hospitalier<br />
L’hospitalité fait partie des concepts de l'éthique, elle est une valeur, un commandement et<br />
une prescription permettant de garantir l'accueil de l'Etranger. L'hospitalité se présente sur ce<br />
point comme une prescription qui conteste tout rejet de l'altérité et, se hisse contre les<br />
civilisations sauvages qui lui sont contraires et que certifierait la consanguinité des racines<br />
étymologiques hospes comme hôte et hostis comme ennemi. L'hospitalité, conversion de la<br />
violence en son opposé, de l'hostis en hospes est en conséquence chargée de menaces, c’est<br />
pourquoi elle peut se convertir sans interruption en son opposé. Subséquemment, au problème<br />
du statut de l’Etranger dans la société, l’éthique philosophique répond par un impératif<br />
d'inconditionnalité au sens derridien, l’exigence de répondre à l’appel de l’arrivant comme<br />
nous l’avons développé tout au long de cette partie apparait chez Levinas comme la modalité<br />
absolue de l'être et de l'accès à la conscience morale. Dans cette mobilité d’élévation de<br />
l’Autre, c’est plus précisément le soi, compris comme ouverture, béance, inégal, qui a muté<br />
son statut. Cette transmutation amène le soi à être l’émigré, l'otage face à la présence de<br />
l'Etranger. Cette posture marque donc une brisure avec la conception de la politique qui<br />
conçoit plutôt l'hospitalité comme un fondement rationnel et conditionnel de normalisation<br />
des périphéries entre nations indépendantes, et s’active à en éclaircir les frontières. Toutefois<br />
qu’est-ce qui justifie fondamentalement l’accueil, l’hospitalité et le fait d’avoir le souci de<br />
l’Etranger ?<br />
Dans un monde désillusionné, il est plausible que l’hôte que l’on vient d’accueillir ne se<br />
présentera jamais comme un roi en aventure, ni comme Dieu métamorphosé. Mais<br />
certainement comme un mystère toujours inconnu, ou comme un pauvre infiniment incapable<br />
de rembourser un jour ce qu’on lui aura donné. Mais il faut préciser que cette réciprocité de<br />
l’hospitalité n’est pas dans la prescription levinassienne. Le principe de réciprocité est à<br />
prohiber dans la donation éthique. Etre accueillant et hospitalier, c’est dégager la bonté dans<br />
330 Idem, Totalité et Infini, Op cit., p.256<br />
86
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
tous ses contours sans attendre une réciprocité a-venir. « L’hospitalité, d’après Maurice<br />
Blanchot, consiste moins à nourrir l’hôte qu’à lui rendre le goût de la nourriture en le<br />
rétablissant au niveau du besoin, dans une vie où l’on peut dire et supporter d’entendre dire :<br />
« ‘’Et maintenant, n’oublions pas de manger’’. Sublime parole » 331 . L’hospitalité est langage,<br />
discours qui consiste à appeler l’Autre à table et à promouvoir tous discours promouvant le<br />
partage. L’inhospitalité par contre se traduit dans le refus du partage, dans l’incapacité d’offrir<br />
à autrui ce qu’on possède ou ce que l’on croit posséder.<br />
Il faut préciser que l’hôte, celui qui reçoit et donne l'hospitalité à l’Etranger, n’est ni le<br />
chef des lieux, ni le propriétaire de la maison, car malgré son occupation première des lieux, il<br />
demeure d’une manière ou d’une autre reçu dans sa « propre » maison : il reçoit l’hospitalité<br />
qu’il offre à la veuve, à l’orphelin et au pauvre. En conséquence, l’hôte est aussi un étranger<br />
qui accueille un Etranger, un être cosmopolite qui ouvre « sa » maison aux autres êtres<br />
cosmopolites. La frontière ici n’équivaut pas à la séparation de deux régions inconnues et<br />
indépendantes dans leurs terroirs respectifs, mais deux univers anonymes, deux pays d’exil.<br />
Par conséquent, ce que nous nommons fréquemment par le terme « le chez-moi », ce soi<br />
disant « chez-nous » n’est jamais pur puisqu’il est un lieu de passage aussi bien pour<br />
l’Etranger que pour moi. Cependant le seul espace où je pourrais avoir l’illusion rationnelle<br />
d’être le véritable propriétaire, c’est mon corps, parce que dans mon corps j’ai l’impression de<br />
tout maitriser, et pourtant dans mon corps également je suis : « moi tout en vivant dans l’autre<br />
» 332 . Même si je suis heureux dans l’espace où je vis, je reste séparé de tout ce qui m’entoure,<br />
car comme le souligne Levinas : « Le moi […], demeure dans le non-moi; il est jouissance<br />
d’« autre chose », jamais de soi. Autochtone, c’est-à-dire enraciné dans ce qu’il n’est pas, et<br />
cependant, dans cet enracinement, indépendant et séparé » 333 . Tout être vivant n’est qu’un<br />
passant, nous ne sommes que des passants, des nomades, des singularités illimitées en transit<br />
perpétuel.<br />
La grandeur de l'être humain, au-delà de sa faiblesse, demeure comme le montre Pascal,<br />
dans la conscience d'être un mortel, dans sa conscience d'être un étranger sur terre. Cette<br />
conscience n'ouvre sa porte uniquement face au visage d’Autrui qui demande secours. C'est<br />
l'Autre qui me révèle ce message sauveur. Parce que, le visage désigne, « avant toute<br />
mimique, dans sa droiture de visage, une exposition sans défense à l'esseulement mystérieux<br />
331 Maurice Blanchot, L’Entretien infini, Gallimard, 1969<br />
332 Levinas, Totalité et Infini, Op cit., p.90<br />
333 Ibid., p.116<br />
87
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
de la mort » 334 . C'est la mort qui m’observe dans le visage de l'Etranger avant d'être la mort<br />
qui me dévisage à mon tour qui met mon nombrilisme en question et me rappelle que je suis<br />
un éternel étranger sur la terre.<br />
Tout comme l’Etranger, celui qui l’accueille est sans identité, sans racine, il est flottant<br />
remarque Derrida dans son Adieu — à Emmanuel Levinas : « Comme l’arrivant n’a pas<br />
encore d’identité, son lieu d’arrivée s’en trouve désidentifié : on ne sait pas encore ou on ne<br />
sait pas comment nommer, quel est le pays, le lieu, la nation, la famille, la langue, le chez-soi<br />
en général qui accueille l’arrivant absolu » 335 . L’Etranger, plus précisément celui qui vient<br />
sans avertir et sans être attendu, celui dont la présence est éruptive, sollicite un accueil dans<br />
lequel il sera simplement considéré comme autre, comme altérité pure, sans alliage ou<br />
ressemblance avec quoique ce soit. Celui qui vient « d’ailleurs » n’est pas un invité au sens<br />
étymologique, puisqu’il vient sans prévenir, il arrive sans préavis ou quand lorsqu’on l’attend,<br />
on l’attend sans rien attendre, sans se soucier de connaître qui ou quoi l’on attend — cette<br />
disposition est l’essence même de l’hospitalité. Ce désir du « mystère », cet accueil et<br />
responsabilité du moi pour « l’in-connu ».<br />
L’éthique de l’altérité au sens levinassien est une invitation à penser, à l’encontre de la<br />
philosophie classique, que la responsabilité au sens éthique est première, avant toute mêmeté<br />
et toute liberté, en tant qu’elle est d’emblée dirigée nécessairement vers l’Autre, l’originalité<br />
de l’Autre, et assignable à l’Autre en quelque sorte. La philosophie levinassienne est une<br />
invitation à la bonté, bonté qui est en fait une invitation à partir de l’être-pour-soi à l’être-<br />
pour-autrui. Mais, exister-pour-l’Autre ne doit pas se traduire comme un projet quelconque et<br />
n’engage pas la situation préalable de l’accroissement d’une quelconque valeur. « Etre-pour-<br />
Autrui, c’est être bon. […] Le fait que, existant pour autrui, j’existe autrement qu’en existant<br />
pour moi – est la moralité elle-même » 336 . Cependant, le « sujet » éthique, sujet séparé et<br />
soumis à une responsabilité pour Autrui, est au-delà de l’éthique de la loi, du rationalisable,<br />
étant soumis à l’impossible possibilité envers l’Autre et requis absolument par une peine<br />
incommensurable, infinie. La responsabilité illimitée, c’est-à-dire au-delà de l’éthique se<br />
définit comme expérience de l’irréalisable, relation sans relation avec la singularité inconnue,<br />
sous peine de se réduire à une opération arithmétique, un programme préétabli, et de ce fait<br />
forcément limité. En fait, la responsabilité à laquelle Levinas nous invite est une<br />
334<br />
Levinas, « De l'Un à l'Autre. Transcendance et temps », in Cathérine Chalier ed., Emmanuel Levinas,<br />
L'Herne, p. 92<br />
335<br />
Jacques Derrida, Adieu — à Emmanuel Levinas, Galilée, coll. « Incises », Paris, 1997, pp. 53-54<br />
336 Levinas, Totalité et Infini, Op cit., p.239<br />
88
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
responsabilité hyper-éthique qui se définit comme une prise en charge du visage : elle est une<br />
réponse radicale, sans excuse, précédant toute action, à l’angoissante étrangeté de l’Etranger.<br />
Autrui, parce qu’il est absolument autre, m’offusque et me fait sortir énergiquement de<br />
mon intériorité, c’est-à-dire simultanément de toute connaissance de ce monde et de toute<br />
jouissance sentie dans l’amabilité de soi à soi vécue au sein de mon extraterritorialité : ma<br />
maison, mon économie. Dans cette dynamique, Autrui me conditionne forcément et<br />
péniblement à manifester une béance en vers lui, à exécuter une « dénucléation » comme le<br />
dit Levinas, à quitter mon univers jouissant, et, de ce fait à me rendre responsable de lui, à<br />
prendre soin de lui, à le soigner, à partir de l’être-pour-soi à l’être-pour-autrui, en le faisant<br />
passer avant moi, à lui accorder hospitalité – ordonnance qui suscite l’expulsion de toute<br />
tension au meurtre. Pour renchérir cette position, Levinas cite le décalogue 337 tout au long de<br />
son discours plus exactement le cinquième commandement : « tu ne tueras point », ou Isaïe<br />
qui exhorte le « partage » en ces termes : « partage ton pain avec celui qui a faim, et fais<br />
entrer dans ta maison les malheureux sans asile ; si tu vois un homme nu, couvre le, et ne te<br />
détourne pas de ton semblable » 338 . Il n’est donc pas exclusivement question ici d’une simple<br />
copie d’un texte ecclésiastique, aussi cet excédent de l’Autre se dévoile nécessairement dans<br />
l’immanence d’une rencontre purement éthique : c’est en deçà de toute connaissance,<br />
conquise ou « révélée », et pour tout être humain, quelles que soient sa race, sa culture, son<br />
obédience religieuse, que l’Etranger contraint à l’accueillir et à prendre sur soi la<br />
responsabilité de son avenir. Le matérialisme de celui qui a faim n’est de ce fait jamais infect,<br />
c’est uniquement le nôtre, nous qui sommes gavés. Autrui n’a jamais tort, c’est nous qui<br />
avons tort de ne pas prendre sur nous son tort. Ce conditionnement de celui qui a faim nous<br />
convie en conséquence à l’acte gratuit, gratuité qui s’exprime à travers le don – don exclusif<br />
et pur, c’est-à-dire sans publicité. La formule de politesse par excellence d’après Levinas face<br />
à l’Etranger est : « Après vous ! ».<br />
Le problème de la faim est lié à la possession, à la propriété des choses. « Le problème du<br />
monde affamé ne peut se résoudre que si la nourriture des possédants et des pourvus cesse de<br />
leur apparaître comme leur propriété inaliénable, mais se reconnaît comme un don reçu dont<br />
on a à rendre grâce et auquel les autres ont droit » 339 . Cet énoncé parait complexe puisqu’il y<br />
est simultanément question de quitter le droit pour discourir sur le don qui n’est pas un dû, et<br />
d’ériger un autre droit qui sera celui des pauvres : complexité du rapport entre justice-charité.<br />
337 Décalogue aussi appelé les dix commandements ou les « dix paroles » de Dieu qui se trouvent dans la Bible<br />
338 La Bible en français, version Louis Segond, 1910, Ancien testament, Isaïe : chapitre 58 – verset 7<br />
339 Levinas, Difficile liberté, Op cit., p. 77<br />
89
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Levinas dans tous ses textes y compris Totalité et Infini, veut généralement rappeler qu’avant<br />
le droit il y a un en-deçà « an-archique » qui désigne la responsabilité pour l’Etranger et le<br />
tiers, et sans lequel le « droit » se simplifierait à une normalisation primaire certifiant le fait,<br />
la relation de force 340 . Il perçoit dans l’effort d’abandonner son extrémum de droit la formalité<br />
personnelle de l’effort des communautés en faveur des nécessiteux. Cet effort manifeste<br />
l’abnégation à mes droits. C’est la conscience morale qu’il faut créer ou de préférence<br />
reconnaître un excédent de devoirs par rapport à mes droits pour que les ressources<br />
matérielles du monde terrestre puissent nourrir toute la planète, il est donc nécessaire qu’avant<br />
toute normalisation des Etats chacun accepte de ne pas user de tous ses droits, car « faire<br />
manger ceux qui ont faim, d’après Levinas, suppose une élévation spirituelle » 341 . La<br />
question de la propriété doit se comprendre d’après Levinas comme une « propriété non<br />
romaine », c’est-à-dire une propriété qui n’est jamais totalement privée, au sens où les autres<br />
hommes en seraient absolument privés, néanmoins offerte, dans la dimension du don au-delà<br />
du droit divin. Cette posture nous conduit dans un monde cosmopolite où tout le monde à une<br />
place et vit à satiété.<br />
La rencontre de l’Etranger suscite de ce fait une ordonnance contraignante de l’accueil,<br />
une prescription qui consiste à prendre soin de l’Autre, puisque le sujet est un « hôte », c’est-<br />
à-dire un être capable d’hospitalité et de familiarité. Mais il faut souligner qu’« Autrui qui<br />
accueille dans l’intimité n’est pas le vous qui se révèle dans une dimension, de hauteur – mais<br />
précisément le tu de la familiarité : langage sans enseignement, langage silencieux, entente<br />
sans mots, expression sans secret » 342 . D’après Martin Buber 343 , l’être peut vivre sans<br />
dialoguer cependant celui qui n’a jamais rencontré un « Tu » n’est pas à proprement parler un<br />
être humain. Mais, celui qui entre dans le monde du dialogue prend un risque immense parce<br />
que la relation « Je-Tu » recommande une béance totale du « Je », qui s’expose ainsi à une<br />
négation et à un rejet total. La réalité subjective « Je-Tu » s’enracine dans le langage, pendant<br />
que la relation instrumentale « Je-cela » s’harponne dans le monologue, qui thématise,<br />
métamorphose l’univers et l’homme en objet ou en meuble. Dans le contexte monologique,<br />
comme nous l’avons montré en traitant la question égologique de la philosophie<br />
occidentale 344 , Autrui est dépersonnalisé et chosifié, il est perçu et exploité – et pourtant dans<br />
le langage, il est rencontré, reconnu dans sa singularité absolue. Cependant, Levinas souligne<br />
340 Idem, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Martinus Nijhoff, La Haye, 1974, p. 203<br />
341 Idem, « jeunesse d’Israël », in Du sacré au saint, Les éditions de Minuit, 1977, p.77<br />
342 Idem, Difficile liberté, Op. Cit., Ibid., p.129<br />
343 Buber Martin, Je et Tu, trad., Aubier-Montaigne, 1992<br />
344 Cf. Première partie de ce texte, voir le chapitre portant sur les philosophies de la totalité<br />
90
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
que « le je-tu où Buber aperçoit la catégorie de la relation interhumaine n’est pas la relation<br />
avec l’interlocuteur, mais avec l’altérité féminine » 345 . Cette altérité est sur une dimension<br />
différente de celle du langage et elle ne manifeste pas un langage originel. Tout au contraire,<br />
le caractère discret de cette manifestation, englobe toutes « possibilités de la relation<br />
transcendante avec autrui ». Elle se connait et ne pratique son rôle « d’intériorisation » que sur<br />
le lieu de l’entière « personnalité humaine » mais, qui, dans la femme, peut concrètement se<br />
garder pour dégager l’étendue de l’intériorité. Et c’est là « une possibilité nouvelle et<br />
irréductible », une faiblesse agréable dans l’être et « source de la douceur en soi » 346 .<br />
La joie de l’hospitalité se manifeste premièrement à travers le visage de la féminité<br />
accueillante qui exprime l’allégresse de l’accueil. La femme manifeste cette force radieuse de<br />
l’accueil et de l’attention, plus nettement cette disposition à transformer la souffrance ou<br />
l’infect de l’Etranger en jovialité du partage de la familiarité 347 et du repas commun.<br />
« L’Autre dont la présence est discrètement une absence et à partir de laquelle s’accomplit<br />
l’accueil hospitalier par excellence qui décrit le champ de l’intimité, est la Femme » 348 . Cette<br />
dernière grâce sa sensibilité représente l’hospitalité par excellence, elle est l’exigence<br />
fondamentale du recueillement, de la vie intérieure de la Maison et du domicile. Cependant, il<br />
faut souligner que l’évocation que Levinas fait de la femme, pour signifier sa douceur en<br />
relation avec la maison, ne veut pas dire que toute maison en fait suppose une femme. Levinas<br />
évoque la dimension féminine uniquement pour marquer « l’accueil même de la demeure » 349 ,<br />
ce recueillement isolé dans un monde pleinement humain.<br />
La sensibilité, comprise comme exposition et vulnérabilité à l’Autre, est un atout<br />
indispensable contre la violence de la raison libre, dont la posture rationnalisante advient<br />
même à blanchir l’horreur, à justifier l’injustifiable, l’en-sauvage-ment fait à l’Autre. Cette<br />
position levinassienne astreint toute posture égotiste, toute sensation d’« être dans son bon<br />
droit » ; car face au visage de l’Autre, je tourne en rond parce que je ne sais plus qui je suis, je<br />
ne sais plus où je suis - je suis positivement perdu, « voué au dehors » et dans un tel contexte<br />
c’est uniquement l’Autre qui peut se prévaloir d’un « bon droit ». Cependant une telle vision<br />
ne pourrait avoir d’effet au sens politique :<br />
345<br />
Levinas, Totalité et Infini, Op cit., p.129<br />
346<br />
Ibid.<br />
347<br />
« La familiarité et l’intimité se produisent comme une douceur qui se répand sur la face des choses (…).<br />
L’intimité que la familiarité suppose - est une intimité avec quelqu’un ». cf. p128<br />
348<br />
Levinas, Totalité et Infini, Op cit., p. 128<br />
349 Ibid., p.130<br />
91
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
- Premièrement, parce que la relation hospitalière est une relation duale à Autrui qui<br />
conditionne exclusivement ma responsabilité de sujet face à son visage, et pourtant la<br />
politique suppose continûment la justice, c’est-à-dire un « tiers », et instantanément la<br />
suppression de cette contrainte infinie d’hospitalité.<br />
- Deuxièmement, parce que si l’hospitalité ne peut quitter cette dualité, le projet dont<br />
évoque Levinas est non strictement éthique mais ne l’est qu’à partir de la résignation<br />
de la condition de la politique. La politique est interminablement politique de l’être, et<br />
pourtant l’Etre – le Même, d’après Levinas, c’est la guerre.<br />
Dans cette dynamique d’idées, se lancer dans l’expérience éthique c’est obligatoirement<br />
refuser de légiférer parce qu’il est exclusivement question ici d’endosser passivement la loi de<br />
l’Autre homme qui est la prescription unique et qui ne peut être inscrit dans un code juridique.<br />
D’ailleurs le lexique même de la politique dite « éthique », celui qui se traduit par le vocable<br />
de l’inculpation, de l’imputation, du châtiment, écœure l’éthique de l’hospitalité et lui est<br />
même radicalement contradictoire.<br />
L’hospitalité éthique désigne le désir de liberté dans la paix et l’hospitalité collective<br />
réalise en acte ce désir. L’accueil du visage s’exprime plus précisément par « l’idée de<br />
l’infini, le débordement de la pensée finie par son contenu – effectue la relation de la pensée,<br />
avec ce qui dépasse sa capacité, avec ce qu’à tout moment elle apprend sans être heurtée » 350<br />
et c’est cette disposition que Levinas nomme « accueil du visage ». La réalisation de l’idée<br />
d’Infini n’est pas externe à la société, car elle se réalise dans « l’opposition du discours, dans<br />
la socialité » 351 . La relation avec le visage avec « l’absolument autre que je ne saurais<br />
contenir », avec Autrui, dans cette perspective, Infini, est néanmoins ma conception, un<br />
« commerce ». « Mais la relation se maintient sans violence - dans la paix avec cette altérité<br />
absolue. La ‘’résistance’’ de l’Autre ne fais pas violence, n’agit pas négativement ; elle a une<br />
structure positive : éthique » 352 . L’irruption initiale de l’Autre, envisagée dans tous les autres<br />
rapports avec lui, ne veut pas dire l’empoigner, le con-vaincre ou chercher à « le saisir dans sa<br />
résistance négative et à le circonvenir par la ruse » 353 . Je ne me bats pas contre une divinité<br />
sans visage, mais réponds à son appel avec la porte béante – je suis conditionné depuis les<br />
tréfonds de mon être à porter secours à Autrui, à ouvrir ma porte afin que cet autre homme<br />
venu « d’ailleurs », sous ma responsabilité, trouve refuge, soin, nourriture et cela dans la<br />
stricte gratuité.<br />
350 Ibid., p.171<br />
351 Ibid.<br />
352 Ibid.<br />
353 Ibid.<br />
92
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Conclusion partielle<br />
L’éthique de l’altérité corollaire au visage d’Autrui dans la philosophie lévinassienne<br />
pose le problème fondamental de la rencontre de l’Autre liée à la relation avec l’Infini. Il<br />
s’agissait plus précisément pour nous de réfléchir sur les modes et les possibilités pouvant<br />
permettre une rencontre sobre et saine entre des êtres absolument séparés et radicalement<br />
distincts. Difficile entreprise qui nous a mis face au visage de l’Autre dans son épiphanie, face<br />
à cet être venu « d’ailleurs », venu d’un Univers inconnu et inaccessible au pouvoir de la<br />
raison, face à cet être incommensurable et plurivalent dont l’appellation s’illustre dans un<br />
lexique également pluriel : Autre, Autrui, mon maître, absolument autre, Infini 354 , veuve,<br />
orphelin, prochain, « Inconnu », mystère et étranger. La philosophie novatrice d’Emmanuel<br />
Levinas, pour qui l’éthique n’est pas une branche de la philosophie, mais « la philosophie<br />
première », se démarque de l’ontologie occidentale où l’Autre se trouve réduit au Même, elle<br />
s’écarte de toute philosophie de la violence. La pensée levinassienne d’après Derrida, apparait<br />
comme la sortie de la Grèce 355 , sortie qui s’illustre à travers la supplantation de l’ontologie ou<br />
l’être se prive de l’autre en s’enfermant dans « un isolement » par la relation métaphysique.<br />
« Se priver de l’autre » n’est rien d’autre que mettre en œuvre une pensée de la violence,<br />
de la force et, ultimement, de l’en-sauvage-ment. Levinas supplante la « Totalité » par<br />
« l’Infini » et advient à l’éveil de l’Autre par le « bonjour ! » 356 qui précède toute pensée,<br />
toute prise, sur soi et sur le monde, en conséquence, le soi n’est pas substance mais réponse et<br />
responsabilité. Levinas met en exergue dans Totalité et Infini la politique « messianique » de<br />
l’hospitalité pour l’étranger, pour le marginal, pour le « migrant nu » dirait Edouard<br />
Glissant 357 . En explorant la pensée de Martin Buber, il examine le dialogue du Moi au Toi<br />
hors de l’union égotiste, hors de cette circonférence dans laquelle l’Autre termine absorbé par<br />
l’« Un » tel que cela parait dans la philosophie plotinienne. L’œuvre de Buber a permis à<br />
Levinas d’examiner la fécondité de cette relation dans son discours de l’accueil, cette étude<br />
éclaircit la notion d’altérité asymétrique 358 . Ce concept engage une position de hauteur,<br />
354<br />
Balla Oyie, « L’irruption éthique d’autrui : corolaire de l’éthique de la justice de Etre », Annales de la FALSH,<br />
Université de Yaoundé I, op cit., p. 146<br />
355<br />
Cette sortie de la Grece, avait été, chez Levinas, dès 1930, discrètement anticipée dans La Théorie de<br />
l’intuition dans la Phénoménologie de Husserl et poursuivie par une étude critique de Martin Heidegger qui,<br />
d’après Levinas, garantit encore la primauté de « l’être par rapport à l’étant ».<br />
356<br />
F. Poirié , Emmanuel levinas, qui êtes-vous ?, La Manufacture, Lyon 1987 pp. 107-108.<br />
357<br />
Chevrier, « Poétique d’Edouard Glissant », Poétique d’Edouard Glissant : actes du Colloque international,<br />
Paris Sorbone, mars 1998, pp.11-13<br />
358<br />
Cf. Levinas, Noms propres, Fata Morgana, Montpellier, 1976, pp.29-55 et Totalité et Infini, pp.190-191<br />
93
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
disposition seigneuriale, d’Autrui par rapport au Même, mais également la fidèle régularité<br />
d’un ou du Tiers entre le Moi et le Toi-Autre – puisque l’Autre est, lui/elle pareillement,<br />
l’autre d’un Autre, de divers autres. La relation à Autrui est expérience éthique par excellence.<br />
C'est la disproportion entre l’Autre et Moi, qui constitue la conscience morale.<br />
L’irruption du visage d’Autrui m’appelle à la responsabilité de ce visage d’où me vient<br />
l’interdit du meurtre. « Autrui me concerne avant toute dette que j’aurais contractée à son<br />
égard, je suis responsable de lui indépendamment de toute faute commise vis-à-vis de lui.<br />
Cette relation où l’obligation à l’égard d’Autrui prime tout ce que je pourrais attendre de lui<br />
est essentiellement asymétrique » 359 . L’Autre est plus important que moi. Le sens de mon<br />
existence est conditionné par ma responsabilité envers l’humanité. Il est capital pour nous de<br />
mémoriser que si la relation avec Autrui est fondamentale, c'est simplement parce que tout<br />
homme est étranger pour tout autre homme. En conséquence, tout le monde est absolument<br />
étranger. La responsabilité que nous devons avoir à l'égard de l'autre homme doit de ce fait<br />
être entière, et elle doit transcender le lien parental, qui renvoie au « genre » auquel l'Autre<br />
appartient, je suis responsable de l’Autre tout simplement parce qu’il est homme. « L'autre<br />
homme, d’après Levinas, est autre comme unique dans son genre, et, comme aimé, unique au<br />
monde. Dès que vous l'apercevez individu de son genre, il est pour vous déjà "espèce de" ... »<br />
360 . Pour que l’Autre ne soit pas compris comme une « "espèce de" ... », Levinas recommande<br />
qu’on l’aborde dans son « unicité humaine », qu’on le regarde sans le re-garder, qu’on<br />
l’accueille et l’accepte dans sa différence radicale. La responsabilité chez Levinas est infinie<br />
puisque le Moi est responsable de tout le monde, même de l’In-connu qui passe dans la rue. Je<br />
suis unique dans ma responsabilité de l’Autre. Je suis exceptionnel en tant que non<br />
substituable, en tant qu'élu pour répondre de l’Autre : « Responsabilité vécue comme élection.<br />
Le responsable ne pouvant passer l'appel reçu et son rôle à quelqu'un d'autre ; éthiquement, la<br />
responsabilité est irrécusable. Le moi responsable est irremplaçable, non-interchangeable,<br />
ordonné à l'unicité » 361 . Si cette responsabilité du Moi envers l’humanité est illimitée, ce n'est<br />
pas à cause de sa dimension manifeste, c'est parce qu'elle s'augmente au fur et à mesure<br />
qu'elle s'assume. Autrement dit, plus le Moi accomplit ses obligations, moins il a des droits;<br />
359<br />
Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale, Sous la direction de Monique Canto-Sperber, ed. PUF, Paris,<br />
1996, p. 825.<br />
360<br />
Levinas, qui êtes-vous ? op. cit., p. 115.<br />
361<br />
Ibid., pp. 115-116. Levinas précise : « J'ai appelé cette unicité du moi dans la responsabilité, son élection.<br />
Dans une grande mesure, bien entendu, il y a ici le rappel de l'élection dont il est question dans la Bible. C'est<br />
pensé comme l'ultime secret de ma subjectivité. Je suis moi, non pas en tant que maître qui embrasse le monde et<br />
qui le domine, mais en tant qu'appelé d'une manière incessible, dans l'impossibilité de refuser cette élection,<br />
accomplissant le mal en la refusant. »<br />
94
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
plus il est juste et plus il est coupable. La place du Moi est irremplaçable, nul ne peut le<br />
substituer dans l’exercice de ses responsabilités. C’est ici que se réalise son apologie<br />
personnelle – son élection. Les nécessités infinies dans cet axe tendent vers le même point. Le<br />
Moi va vers les ressources de son intériorité, qui sont illimitées. Son individualité est<br />
métamorphosée. Au-delà de la justice des préceptes universels, le Moi entre sous le jugement<br />
par le fait d'être bon.<br />
La relation symétrique n’a donc pas de sens purement éthique puisque l'égalité entre<br />
individus qu’elle sous-tend ne désigne rien par elle-même. Elle a un sens économique qui se<br />
traduit de manière empirique par la ruse, le mensonge, l’emprise et l’exploitation de l’un par<br />
l’autre, or la justice commence par l’Autre. La justice est désir de l'extériorité qui conduit à la<br />
vérité, elle me contraint d'aller au-delà de la droiture de la loi, dans l’univers de la bonté, là où<br />
la responsabilité transcende, dans un éternel effort du Moi pour se défaire de tout penchant<br />
égoïste afin de s’ouvrir à l’humanité. Autrui ne nous aborde pas comme celui qu'il faut<br />
violenter, totaliser, commander, mais en tant qu'absolument autre et indépendant de nous,<br />
auquel nous avons accès initialement par le langage. Mais accueillir Autrui 362 , ne veut pas<br />
dire le connaître, c'est plutôt le laisser nous aborder par la parole qui est l’avènement même de<br />
« justice » 363 . Accueillir l’Autre, c’est ouvrir sa porte au monde, c’est se défaire du soi égoïste<br />
qui est source de totalité, pour se laisser envahir par la joie de l’hospitalité.<br />
La joie qu’on éprouve dans l’accueil de l’Etranger n’est pas assimilable au bonheur et à<br />
l’acception de Spinoza du gaudium qui est l’accroissement de puissance, elle relève plutôt<br />
d’une autre dimension. L’expérience de l’hospitalité est une source qui n’engendre rien et<br />
exclut tout fondement. Elle est absolument, et strictement de façon assumée, sans « mains »,<br />
sans artilleries de guerre et sans concepts. Assumer donc le droit de l’accueil de l’Etranger,<br />
c’est renoncer à tout désir de s’autoproclamer législateur, c’est plutôt effectuer une remise en<br />
question du quant-à-soi égoïste du Moi, c’est faire passer les autres avant soi, c’est<br />
« autrement qu’être », c’est rompre avec l’ insensibilité afin de susciter « l'un-pour-l'autre »,<br />
qui est l'événement éthique, c’est « être-pour-autrui », c’est « se-vouer-à-l'autre […] sacrifice,<br />
jusqu'à la possibilité de mourir pour lui » 364 , c’est être bon qui se manifeste simplement par<br />
l’exhortation d'un « exister-pour-autrui plus fort que la menace de la mort » 365 .<br />
362<br />
Levinas, Totalité et Infini, Op cit., p.77. « Autrui est le lieu même de la vérité métaphysique et indispensable à<br />
mon rapport avec Dieu. »<br />
363<br />
Ibid., p.188<br />
364<br />
Idem, Entre nous. Essais sur le penser-à-l'autre, Grasset, Paris, 1991, p.10<br />
365 Ibid., p.11<br />
95
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
TROISIEME PARTIE :<br />
LA DIMENSION PEDAGOGIQUE<br />
DE L’ALTERITE<br />
L’enseignement n’est pas une espèce d’un genre<br />
appelé domination, une hégémonie se jouant au sein<br />
d’une totalité, mais la présence de l’infini faisant<br />
sauter le cercle clos de la totalité.<br />
Emmanuel Levinas, Totalité et Infini. Essai sur<br />
l’extériorité, Deuxième édition, Martinus Nijhoff, La<br />
Haye, 1965, p.146<br />
96
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Introduction partielle<br />
L’école est constituée d’univers étrangers les uns aux autres, de frontières entre les<br />
pensées, entre les sciences, entre les adultes et les enfants. C’est un espace de rencontres qui<br />
se traduisent régulièrement, plus ou moins, par des voyages, par des migrations à l’intérieur<br />
de soi-même suivant de diverses figures : l’enseigné dans l’enseignant, l’enseignant dans<br />
l’enseigné, l’enseignant pour l’enseigné, l’enseignant au service de l’enseigné, l’enseigné<br />
esclave de l’enseignant, l’enseignant otage de l’enseigné. Entrer dans une salle de classe, c’est<br />
affronter le différent, « l’In-connu » - le « mystère » - « l’ailleurs », c’est faire face au risque<br />
de la mésintelligence et du conflit, mais également à l’accueil affable et optimiste de l’Élève.<br />
L’école, c’est l’expérience de la présence d’Autrui, mais aussi celle de la découverte et de la<br />
perpétuelle redéfinition de soi. Un Enseignant, c’est celui qui a infiniment du temps pour<br />
franchir des frontières, c’est celui qui va vers ceux qui peuvent être considérés comme<br />
absolument Etrangers, ceux qui ne sont pas d’ici mais « d’ailleurs », ceux qui se révèlent<br />
comme inconnus, qui à cause de leur différence ne sont pas désirés et que pourtant on<br />
voudrait tant faire connaître aux autres, pour partager leurs symboles et en transmettre les<br />
sagesses voilées. La situation pédagogique se traduit à travers l’altérité qui est relation à<br />
Autrui, relation dans laquelle les termes sont absolument indispensables et séparés, interaction<br />
libre et pacifique dans laquelle le Maître donne infiniment ce qu’il possède à l’Élève et dans<br />
le pur respect. Mais dans le discours pédagogique contemporain, c’est l’activité de l’être qui<br />
apprend qui est privilégié, il est moins un enseigné qu’une personne à qui l'on enseigne<br />
quelque chose d’inédit. Toutefois, si apprendre c’est faire face à l’extériorité comme le<br />
souligne Levinas, si c’est forcément acquérir de nouvelles connaissances qui sont<br />
nécessairement différentes de ce que l’individu possédait déjà, ne rate-t-on pas l’altérité et<br />
l’acte d’apprendre en soi lorsqu’on part de l’acte d’appropriation par lequel celui qui apprend<br />
va vers l’Autre pour retourner à lui-même ?<br />
Face à cette interrogation qui taraude l’histoire de la pensée éducative, Levinas effectue<br />
une innovation majeure dans laquelle il inverse la position des termes : au lieu d’accorder la<br />
priorité à l’Élève, il l’accorde plutôt au Maître en tant qu’autre qui endosse sur lui la<br />
responsabilité infinie de l’Élève. L’enseignement est langage et l’acte du langage désigne : «<br />
la coïncidence du révélateur et du révélé dans le visage, qui s’accomplit en se situant en<br />
hauteur par rapport à nous – en enseignant » 366 . Levinas pense d’une manière novatrice la<br />
366 Levinas, Totalité et Infini, op cit., p. 62<br />
97
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
dissymétrie entre Enseignant et Enseigné. L’Autre est le Maître qui interpelle l’élève et le met<br />
en question. Dans le discours levinassien, seul l’Autre enseigne, non pas à travers la<br />
maïeutique socratique, mais en s’installant dans une verticalité quasi sainte qui est en même<br />
temps vulnérabilité. Autrui est le Maître qui interpelle l’élève et qui le met en question.<br />
Éthique difficile, à cause de ce visage de l’Enseignant d’ailleurs très équivoque,<br />
simultanément intouchable et persécuteur, comme l’articule Levinas lui-même. Toutefois,<br />
permet-elle l’ouverture et le développement de l’élève ou l’écrase-t-elle ? Est-il encore<br />
possible de parler de nos jours d’enseignement dans un monde surchargé d’informations, un<br />
monde dans lequel une nouvelle traque l’autre, où une information en vaut une autre, où<br />
communication et transmission sont en tension ? Si malgré toute cette affluence<br />
l’enseignement demeure, c’est pour autant dire qu’il y a de l’altérité. Cependant où se trouve<br />
véritablement cette altérité enseignante et quel est son statut dans la situation pédagogique<br />
actuelle ? Comment penser l’enseignement aujourd’hui ? Notre discours dans cette partie<br />
portera sur la nécessité humanitaire de cette pensée levinassienne de l’enseignement tout en<br />
tenant compte de son ambiguïté. Pour mieux étayer nos propos, nous examinerons d’une part<br />
la question de l’altérité enseignante à travers le rapport entre enseignement et extériorité ; il<br />
sera question pour nous de donner l’origine et la signification de l’enseignement chez<br />
Levinas. D’autre part, à partir du chapitre intitulé : Autrement que selon le mode de l’être,<br />
nous montrerons que le dessein de tout enseignement éthique par delà toute difficulté est<br />
d’aboutir à un autrement qu’être pédagogique.<br />
98
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Le premier acte de tout enseignement est présence, car se présenter c’est parler et<br />
s’exprimer, c’est s’adresser à un visage. Le visage et le langage sont inséparables dans la<br />
philosophie levinassienne, puisque le visage traduit simultanément une présence vivante et<br />
une parole qui est le contraire d’une image fixe et immobile dans sa forme. Enseigner, c’est<br />
rencontrer le visage dans son épiphanie et rencontrer l’Autre signifie être tenu en éveil par un<br />
« mystère » 367 . « L’extériorité – ou, si l’on préfère, l’altérité » 368 dans l’enseignement<br />
s’exprime par le face-à-face, relation plurielle dans laquelle Enseignant et Enseigné<br />
demeurent absolument séparés. La différence du sujet avec le sujet est l’espace qui permet à<br />
l’être humain de fonder son existence à partir d’Autrui et pour Autrui. Toutefois, si l’altérité<br />
désigne la relation avec Autrui, comment caractériser cette relation au plan pédagogique ?<br />
Comment la présence de l’Autre arrive-t-elle à engendrer un processus éducatif ? L’altérité<br />
enseignante relève-t-elle du Maitre est-elle exclusive ? Que faut-il entendre par enseignement<br />
chez Levinas ?<br />
CHAPITRE I : ENSEIGNEMENT ET EXTERIORITE<br />
I. L’Autre mon enseignant<br />
Le concept d’altérité d’après Paul Ricœur 369 renvoie à une dimension hors pair car il<br />
relève d’un discours transcendantal. D’ailleurs dans Le Sophiste, Platon ne manque pas<br />
d’intégrer l’autre dans sa conception des cinq genres : le mouvement et le repos, le même et<br />
l’autre, l’être. S’il n’y avait rien d’autre que l’être, il serait impossible de signifier les exposés<br />
qui ne parviennent pas à établir la différence entre l’être et le non être. C’est pourquoi dans Le<br />
Sophiste, l’Étranger d’Élée affirme que « les genres » s’entremêlent simultanément,<br />
Que l’être et l’autre passent à travers tous les genres, et réciproquement, l’un<br />
par rapport à l’autre ; que l’autre participe à l’être et qu’il existe grâce à cette<br />
participation, mais qu’il n’est pas ce à quoi il participe, mais autre, et, comme<br />
il est autre que l’être, il est nécessairement, et de toute évidence, non être 370 .<br />
367<br />
Autrui comme « mystère », apparait dans Le temps et l’Autre de Levinas<br />
368<br />
Ibid., P.266<br />
369<br />
Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, p. 346.<br />
370<br />
Platon, Le Sophiste, 259a-b, trad. N.-L. Cordero, Flammarion (GF ; n° 687), Paris, 1993, p. 185.<br />
99
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
L’altérité n’est réalisable qu’en tant qu’autre et comme le précise Platon : « tout ce qui est<br />
simplement autre, l’est nécessairement par rapport à autre chose » 371 . Cette articulation de<br />
notre problématique veut tout simplement monter que l’Autre est toujours vue dans le sens de<br />
la relativité. C’est cette pensée de l’Autre qui a parcouru toute la philosophie occidentale ; et<br />
c’est exactement cette conception de l’altérité au sens relatif que critique ardemment l’auteur<br />
de Totalité et Infini. Nous rappelons, en effet, que l’Autre n’est pas de manière simpliste mon<br />
alter égo, il est d’après Levinas « l’absolument autre ».<br />
Dans la première partie de Totalité et Infini, Levinas réexamine la question du couple<br />
platonicien du Même et de l’Autre bien qu’il ne cite pas Le Sophiste ; il examine la<br />
maïeutique 372 socratique mais il la range du côté du Même. Levinas perçoit dans cette<br />
exercice « la primauté du Même » 373 , il voit dans la maïeutique socratique, la suffisance<br />
ontologique du Même. La maïeutique, d’après lui, prend son sens dans la critique de la<br />
rhétorique qui aborde Autrui, cependant pas dans l’optique du « face-à-face », mais de biais.<br />
Seulement, entre la violence du « discours pédagogique ou psychagogique » 374 et l’éveil<br />
socratique à travers le langage interne de l’esprit avec lui-même, Levinas réhabilite le<br />
discours magistral et l’idée de l’enseignement comme « transmission ». Enseigner, c’est<br />
insérer de l’extérieur et de la hauteur de l’Enseignant, dans la conscience de l’enseigné ce qui<br />
n’est pas en lui. Ainsi, seule l’altérité enseigne et cet enseignement est « une transitivité non<br />
violente » 375 . La relation avec l’Autre se définit comme une relation avec « la transcendance<br />
» 376 . Cette relation « […] introduit en moi ce qui n’était pas en moi. Mais cette « action » sur<br />
ma liberté met précisément fin à la violence et à la contingence et, dans ce sens aussi, instaure<br />
la Raison 377 . Soutenir que le transfert d’un élément, d’un être à un autre s’accomplit « sans<br />
violence que si la vérité enseignée par le maitre se trouve, de toute éternité, chez l’élève, c’est<br />
371 Ibid., 255d, p. 175.<br />
372 Dans le Menon, Socrate met en pratique la maïeutique pour amener un jeune serviteur de Menon à discerner le<br />
résultat d’une difficulté géométrique par lui-même. « En ce cas, dit Socrate, sans que personne ne lui ait donné<br />
d’enseignement, mais parce qu’on l’a interrogé, il en arrivera à connaître, ayant recouvré lui-même la<br />
connaissance en la tirant de son propre fond.» Cf. Platon, Ménon, 85a-c, trad. M. Canto-Sperber, Paris,<br />
Flammarion (GF ; n°491), 1991, p. 169.<br />
373 Levinas, Totalité et Infini, op cit., pp. 13-14.<br />
374 Ibid., p. 42 : «Notre discours pédagogique ou psychagogique est rhétorique, dans la position de celui qui ruse<br />
avec son prochain. […] Renoncer à la psychagogie, à la démagogie, à la pédagogie que la rhétorique comporte,<br />
c’est aborder autrui de face, dans un véritable discours. »<br />
375 Ibid., p. 22.<br />
376 « Le terme de ‘‘transcendance’’ signifie précisément le fait qu’on ne peut penser Dieu et l’être ensemble. De<br />
même, dans la relation interpersonnelle, il ne s’agit pas de penser ensemble moi et l’autre, mais d’être en face.<br />
La véritable union ou le véritable ensemble n’est pas un ensemble de synthèse, mais un ensemble de face à<br />
face.» cf. Levinas, Ethique et infini, LGF, Le Livre de poche, coll. “ Biblio-essais ”, Paris, 1984, pp. 71-72.<br />
377 Levinas, Totalité et Infini, op cit., p.178<br />
100
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
extrapoler la maïeutique au-delà de son usage légitime » 378 . L’idée de l’infini en l’homme,<br />
mêlant un contenu qui ne peut être englobé dans un contenant, se sépare de l’idée de la<br />
maïeutique sans toutefois couper son lien avec le rationalisme, parce que l’idée de l’infini,<br />
« loin de violer l’esprit, conditionne la non-violence même c’est-à-dire instaure l’éthique. »<br />
L’Autre est le premier enseignement et non un évènement qui incite le mouvement<br />
dialectique de la raison.<br />
Un être recevant l’idée de l’Infini – recevant puisqu’il ne peut la tenir de soi –<br />
est un être enseigné d’une façon non maïeutique – un être dont l’exister même<br />
consiste dans cette incessante réception de l’enseignement, dans cet incessant<br />
débordement de soi (ou temps). Penser c’est avoir l’idée de l’infini ou être<br />
enseigné. La pensée raisonnable se réfère à cet enseignement 379 .<br />
Tout rapport avec l’idée de l’Infini est enseignement et cet enseignement n’est pas<br />
assimilable à la maïeutique socratique qui reste encore sous l’emprise de l’ontologie. Dans<br />
l’activité pédagogique, il ne s’agit pas de faire ressortir ce qui est enfoui dans l’Élève, mais<br />
d’introduire quelque chose de nouveau et c’est cette introduction de la nouveauté dans l’Autre<br />
que Levinas appelle précisément « enseignement ». « L’enseignement, d’après Levinas, ne<br />
revient pas à la maïeutique. Il vient de l’extérieur et m’apporte plus que je ne contiens » 380 et<br />
c’est grâce au Discours du Maitre en tant qu’extériorité que l’Élève apprend - apprentissage<br />
qui n’est rien d’autre que la réception du donné externe - l’Élève reçoit ce qui est au-delà de<br />
sa capacité réceptive, car dans la situation d’enseignement, il accueille Autrui, le Maître et son<br />
enseignement. « Le Discours est ainsi expérience de quelque chose d’absolument étranger,<br />
‘’connaissance’’ ou ‘’expérience’’ Pure, traumatisme de l’étonnement. L’absolument étranger<br />
seul peut nous instruire » 381 . L’altérité étrangère, transcendante et enseignante est celle du<br />
Maitre, cette altérité est séparée, irréductible et inassimilable par l’Élève. L’altérité du Maître<br />
est radicale, parce que le dessein de l’enseignement éthique est « la justice [qui] consiste à<br />
reconnaître en autrui mon maître » 382 . Il existe entre le Maître et l’Élève une asymétrie et une<br />
non-mutualité irréductibles : hauteur et préexcellence incomparables de l’Enseignant dans son<br />
altessité et dans son altiérité selon les propos de Mattéi 383 . Mais si l’Enseignant n’est pas<br />
simplement un adepte de la maïeutique, s’il n’est pas seulement un « facilitateur » comme<br />
378 Ibid.<br />
379 Ibid., p. 178-179.<br />
380 Ibid., p. 22.<br />
381 Ibid., p. 46.<br />
382 Ibid., p. 44.<br />
383 « On doit ici parler […] d’altessité, et non d’altérité ; car l’Autre, cette Altesse, est toute Hauteur. […] cet être<br />
altier, […], son altiérité », affirme J.-F. Mattéi dans « La rame et le couteau : la question de l’“Autre” chez<br />
Levinas », Revue philosophique, n o 2, 2005, p. 210.<br />
101
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
cela se dit aujourd’hui dans ‘’la nouvelle approche pédagogique’’, sa magistralité n’est pas<br />
non plus une dictature, ni même une puissance dominatrice. L’Enseignant se présente en<br />
classe dans le « face-à-face » et dans la nudité du « Visage » ; sa hauteur n’est pas ce qu’elle<br />
semble dévoilée, c’est-à-dire une puissance dominatrice, elle exprime paradoxalement une<br />
impuissance, faiblesse de l’altérité du Maître que Levinas joint à celle du pauvre, de<br />
l’étranger, de la veuve et de l’orphelin 384 . Cette relation paradoxale qui se fait entre le Maitre<br />
et l’Élève est certainement comme le dit Guibal, une reconnaissance, entre l’altérité<br />
institutrice du Maître et l’altérité contraignante du faible 385 .<br />
La présence du Maître est langage, langage exprimé en fait par la parole qui est son<br />
empire. La parole se traduit dans la relation de « face-à-face » où l’écart et la rupture sont<br />
conservés. La « distance » et la « séparation » sont indispensables en matière d’enseignement<br />
parce que c’est grâce à eux que l’on peut être certain que l’éducation à laquelle nous faisons<br />
face ne se limite pas à un simple conditionnement psychologique de l’enseigné par le maitre<br />
et ainsi à une reproduction du Même ou à une totalisation de l’Autre par le Même, mais à une<br />
pédagogie formative et « critique » dans la mesure où elle forme la faculté de juger de<br />
l’enseigné dans l’optique de le rendre libre et affranchi de l’autorité du Maitre. Cette<br />
perspective pédagogique levinassienne rejoint la devise kantienne exprimée dans Qu’est-ce<br />
que les Lumières ? 386 : « Sapere aude ! (Ose penser) Aie le courage de te servir de ton propre<br />
entendement.» Le but en fait de tout enseignement n’est pas de claustrer l’enseigné sous<br />
l’autorité du Maître, mais de donner à l’Élève les outils nécessaire qui lui permettront de<br />
penser par lui-même et au-delà de toute Totalité.<br />
Levinas se sert de la définition que Platon attribue au discours verbal comme étant, selon le<br />
Phèdre, « celui qui, transmettant un savoir […] est capable de se défendre tout seul » 387 . « La<br />
parole », précise Levinas, « consiste à s’expliquer sur la parole. Elle est enseignement » 388 . La<br />
parole est première dans le domaine de l’enseignement, car en parlant, l’Enseignant « se<br />
présente en défaisant, sans cesse, l’équivoque de sa propre image, de ses signes verbaux » 389 .<br />
La parole précède tout enseignement, elle se manifeste d’après Levinas comme la présence<br />
384 Cf. E. Levinas, Totalité et Infini, op cit., p. 229 : « Autrui en tant qu’autrui se situe dans une dimension de la<br />
hauteur et de l’abaissement – glorieux abaissement ; il a la face du pauvre, de l’étranger, de la veuve et de<br />
l’orphelin, et, à la fois, du Maître appelé à investir et à justifier ma liberté. »<br />
385 Guibal, Approches d’Emmanuel Levinas. L’inspiration d’une écriture, PUF, Paris, 2005, p. 24.<br />
386 Emmanuel Kant, Qu’est-ce que les Lumières ? (1784)<br />
387 Platon, Phèdre, 276a, trad. L. Brisson, Paris, Flammarion (GF ; n o 488), 1989, p. 181.<br />
388 Levinas, Totalité et Infini, op cit., p. 71.<br />
389 Ibid., p. 179<br />
102
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
d’un être portant secours à sa propre parole, présence qui permet au Maître grâce à sa parole<br />
de rompre avec le passé 390 afin d’enseigner les concepts et les pensées : « Les idées<br />
m’instruisent à partir du maître qui me les présente : qui les met en cause ; l’objectivation et<br />
le thème, auxquels accède la connaissance objective, reposent déjà sur l’enseignement » 391 .<br />
L’Enseignant est cet être à la fois proche et lointain qui m’apporte la nouveauté, c’est<br />
l’emblème même du savoir. Sans lui, point d’apprentissage. Le Maitre est indispensable dans<br />
l’enseignement car c’est lui qui insère en moi la connaissance, c’est lui qui me montre<br />
comment voir et comment porter un jugement critique sur les choses, comment orienter ma<br />
pensée dans le bon sens. Seulement, il faut souligner que l’enseignement éthique qui se lit à<br />
travers la pensée levinassienne n’est pas assimilable à l’enseignement des mathématiques, car<br />
l’enseignement éthique ne se réduit pas à la simple transmission des formules à assimiler<br />
comme en mathématiques. L’enseignement éthique chez Levinas apparait comme une<br />
transmission de ce qui n’est pas transmissible : « traumatisme de ce qui ne passe pas,<br />
transmission de l’intransmissible et réception de ce qui ne peut être reçu » 392 comme l’affirme<br />
Lamarre. Cette perspective remet en question l’idée même de « transmission » 393 , car notifier<br />
que la connaissance éthique résulte de la simple transmission revient à dire que l’Élève est<br />
absent dans l’élaboration du savoir éthique, que ce mouvement pédagogique se fait sans sa<br />
participation, que son être se limite dans l’acquisition des connaissances que lui procure le<br />
Maitre, or cette disposition est exactement la mobilité du conditionnement ontologique qui est<br />
critiqué ardemment dans Totalité et Infini. Pour simplement le dire comme Agostini Marie,<br />
« ce qui se transmet, ce n’est pas tant l’éthique que la possibilité de l’éthique : le Maître ouvre<br />
la pensée de l’Élève à l’idée d’Infini, idée qui s’impose à lui en faisant l’expérience de<br />
l’altérité et dans sa persistance dans l’acte de parole » 394 . En d’autres termes, l’Enseignant ne<br />
transmet pas une quelconque connaissance éthique, il excite l’esprit et fait naitre<br />
l’interrogation éthique mais sans en définir le contenu. Soutenir que l’enseignement éthique<br />
appartient au domaine de l’intransmissible, c’est affirmer la manifestation de l’idée de l’Infini<br />
dans le discours éthique. Pour être plus précis, l’enseignement éthique ne se fait pas de<br />
390 La parole est actualisation du présent. Le présent se manifeste dans le combat contre le passé, dans<br />
l’actualisation. Cf. Levinas, Totalité et Infini, p. 41.<br />
391 Ibid ., p. 41.<br />
392 Lamarre, « Seule l'altérité enseigne », Le Télémaque, Presses universitaires de Caen, 2006/1 - n°29, p. 76.<br />
393 « L’idée de « transmission » va de pair avec l’idée d’endoctrinement et l’enseignement serait alors du côté de<br />
la « Totalité ». C’est pourquoi, en matière d’éthique, il ne saurait être question de « transmission » car y aurait-il<br />
encore un sens à parler d’une « éducation éthique » sans prise de responsabilité, sans engagement consciencieux<br />
de l’Elève ? » Cf. Agostini Marie, « L'éducation morale : Socrate et Levinas », Le Télémaque, 2009/2 n° 36,<br />
p.121<br />
394 Ibid., p.121<br />
103
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
manière dogmatique, dans cette transmission de l’intransmissible, l’Élève apparait comme<br />
responsable de sa propre éthique. L’éducation éthique a donc pour dessein de donner à<br />
l’enseigné la capacité de devenir libre et auteur de cet éthique.<br />
Le monde est offert et recommandé par la parole du Maître ; le discours oral ouvre et<br />
possibilise l’espace de la remise en cause, du débat et du savoir. « La proposition qui pose et<br />
offre le monde, ne flotte pas en l’air, mais promet une réponse à celui qui reçoit cette<br />
proposition et qui se dirige vers Autrui puisqu’il reçoit, dans sa proposition, la possibilité de<br />
questionner » 395 . L’étonnement n’est pas le seul mobile qui explique le questionnement,<br />
puisque la question se comprend également par la présence du sujet à qui elle s’adresse. La<br />
proposition s’exprime dans la tension qui se fait entre les questions et les réponses. « La<br />
proposition » est une annonce qui déjà s’interprète, qui apporte sa propre solution. « Cette<br />
présence de la clef qui interprète dans le signe à interpréter – est précisément la présence de<br />
l’Autre dans la proposition, la présence de celui qui peut porter secours à son discours, le<br />
caractère enseignant de toute parole » 396 , c’est pourquoi pour Levinas « le discours oral est la<br />
plénitude du discours.» L’Enseignant interpelle l’Élève, il l’invite à donner toute son attention<br />
au discours, attention notamment au Maître qui précède et conditionne l’attention aux objets<br />
et aux concepts. La conscience dans cet abord apparait comme « l’attention et la pensée<br />
explicite » qu’elle possibilise et non comme un affinement de cette dernière. Cependant c’est<br />
cette attention absolument autonome dans le sujet qui répond, d’après Levinas,<br />
« Essentiellement […] à un appel » 397 . Si donc l’attention peut être comprise comme attention<br />
à l’extériorité, c’est parce qu’elle est attention à Autrui. L’école est le lieu où les pensées sont<br />
exprimées clairement et distinctement, c’est pourquoi selon Levinas, elle « conditionne la<br />
science », puisque c’est en son sein que se révèle l’Autre, « l’extériorité du Maître » qui<br />
parachève la liberté au lieu de l’altérer. Le sens et la signification d’une pensée selon Levinas<br />
se réalisent exclusivement dans le discours, qui met en rapport deux ou plusieurs personnes.<br />
Nonobstant il ne s’agit pas dans le dialogue de rechercher ce dont on disposait déjà, mais de<br />
fouiller, de rechercher la nouveauté. Cependant au-delà de tous ces propos, nous le rappelons<br />
que chez Levinas : « le premier enseignement de l’enseignant, c’est sa présence même<br />
d’enseignant à partir de laquelle vient la représentation » 398 .<br />
395 Ibid ., p. 89<br />
396 Ibid.<br />
397 Ibid.<br />
398 Ibid., p.73.<br />
104
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Cependant, le Discours oral ou magistral chez Levinas n’est pas assimilable au « cours<br />
magistral » au sens du développement « d’une logique interne préfabriquée » 399 .<br />
L’enseignement que procure le Maître n’est pas de prime abord celui d’une connaissance<br />
objective et neutre ; non, l’enseignant « ne transmet pas simplement un contenu abstrait et<br />
général, déjà commun à moi et à Autrui » 400 . Le Discours magistral est préliminairement<br />
l’enseignement du Même par l’Autre. En d’autre terme, l’éthique vient avant tout et c’est elle<br />
également qui possibilise la connaissance. Ce n’est donc pas la liberté de l’Élève qui endosse<br />
exclusivement la responsabilité de la connaissance vraie car le Maitre questionne sa liberté.<br />
En fait, « Le rapport moral avec le Maître qui me juge, sous-tend la liberté de mon adhésion<br />
au vrai » 401 . Seule l’altérité du Maitre est porteuse d’enseignement.<br />
II. Problématique de l’altérité enseignante<br />
1. Les positions de Paul Ricœur, Jacques Derrida et de Maurice Blanchot<br />
Nous rappelons que la pesée levinassienne s’oppose à l’ontologie, car cette dernière tend<br />
à réduire l’Autre en l’enveloppant dans le Même. Contre cette perspective totalisante,<br />
Levinas centre son discours sur l’Autre qui, d’après lui, jouit d’une altérité absolue,<br />
irréductible et inassimilable. Dans le contexte pédagogique, il dévoile l’enseignement comme<br />
transmission. Seulement, il ne comprend pas cette dernière comme une simple transmission,<br />
mais comme la transmission de l’intransmissible 402 et l’acquisition de ce qui dépasse toute<br />
réception. L’idée d’apprentissage par soi-même relative à celle de l’altérité institutrice comme<br />
altérité éducatrice du soi de l’Élève n’a de sens, d’après Levinas, exclusivement que dans une<br />
constance du Même dans son identité « égoïste » 403 . Le moi d’après Levinas, n’est pas un être<br />
qui demeure fixe, « mais l’être dont l’exister consiste à s’identifier, à retrouver son identité à<br />
travers tout ce qui lui arrive […]. Le Moi est identique jusque dans ses altérations » 404 .<br />
Autrui en tant qu’« absolument Autre » 405 est le seul à détenir une altérité pure. D’après<br />
Levinas c’est exclusivement l’altérité d’Autrui en tant que Maître qui enseigne, par<br />
conséquent tous les autres cas d’altérité sont formels et déjà assimilés, totalisés et inclus dans<br />
399 Ibid., p. 45.<br />
400 Ibid., p. 71.<br />
401 Ibid., p. 74.<br />
402 L’idée d’Infini<br />
403 Ibid., p. 16).<br />
404 Ibid., p. 6. La distinction que Paul Ricœur fait sur l’identité dans son texte Soi-même comme un autre, en<br />
parlant de « mêmeté » et d’« ipséité » entre idem et ipse n’a aucun sens dans le cadre de la pensée<br />
levinassienne. (cf. Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, p. 12)<br />
405 Levinas, Totalité et Infini, op cit., p. 9.<br />
105
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
le Maître ; ils apparaissent simplement comme des incitations au mouvement dialectique. La<br />
mort comme Levinas l’explique dans Le temps et l’autre n’a également d’altérité qu’en<br />
Autrui. L’unique relation entre le Même et l’Autre dans laquelle la séparation demeure est la<br />
relation langagière. Selon Levinas, le discours par les textes est déjà privé de compréhension<br />
et les œuvres ne sont en soi que l’expression d’un discours aphasique. Ils enseignent<br />
uniquement par l’activité de l’Enseignant qui nous les présente « comme si la présence de<br />
celui qui parle inversait le mouvement inévitable qui conduit le mot proféré vers le passé du<br />
mot écrit » 406 . Cependant, l’écriture est-elle véritablement dénuée de la magistralité de<br />
l’enseignement ?<br />
Jacques Derrida pense qu’il est possible d’inverser tous les propos de Levinas sur cette<br />
question, car selon lui le problème de la magistralité et le défaut de magistralité ne se fait pas<br />
entre le discours textuel et le discours oral, mais dans leur intériorité mutuelle. Comme il le<br />
souligne dans Violence et Métaphysique : « l’écriture peut se porter secours, car elle a le<br />
temps et la liberté, échappant mieux que la parole à l’urgence empirique […]. L’écrivain<br />
s’absente mieux, c’est-à-dire s’exprime mieux comme autre, et s’adresse mieux à l’autre que<br />
l’homme de parole […] » 407 . L’écriture chez cet auteur en tant qu’autre peut assumer la même<br />
fonction que l’absolument Autre levinassien. En conséquence, tous les privilèges accordés à<br />
Autrui en tant que Maître peuvent être également accordés au discours textuel. Néanmoins si<br />
parler c’est être capable de se secourir dans sa propre parole, Blanchot dans son examen de<br />
Totalité et Infini, affirme :<br />
Que ce privilège du langage parlé appartient également à Autrui et à moi et les<br />
rend ainsi égaux […]. C’est le propre de tout langage – parlé, mais aussi bien,<br />
et peut-être à un plus haut degré, écrit – de toujours prêter assistance à luimême,<br />
ne disant jamais seulement ce qu’il dit, mais toujours plus et toujours<br />
moins 408 .<br />
La culture n’est pas formée de partie semblable. Il existe dans la culture des écrits et des<br />
œuvres dont le contenu est au-delà du contenant et de ce fait enseignent aussi au sens où<br />
comme le dit Lamarre en commentant Levinas que « seule l’altérité enseigne » 409 . L’altérité<br />
des textes et des œuvres : altérités qu’il ne faut pas comprendre seulement au sens du passé ou<br />
aux sens des cultures exotiques, mais dans l’optique où elles stoppent le flux des nouvelles et<br />
des discours pratiques, le flux des concepts et des représentations dépourvues de sens;<br />
406 Ibid., p. 41.<br />
407 Derrida, Violence et Métaphysique, in L’Écriture et la Différence, Seuil, Paris, 1967, pp. 150-151.<br />
408 Blanchot, L’Entretien infini, Gallimard, Paris, 1969, pp. 81-82.<br />
409 Lamarre, « Seule l'altérité enseigne », Le Télémaque, art. op cit., p. 77.<br />
106
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
altérités au sens où, mystérieuses et surprenantes, elles n’en ont jamais terminé de nous<br />
procurer de la matière à penser et à transformer nos vies, et où nous n’en avons jamais achevé<br />
de les appréhender. C’est donc dans la difficulté de compréhension que nous faisons face à<br />
l’altérité des textes. Par conséquent comme le souligne Paul Ricœur « comprendre, c’est se<br />
comprendre devant le texte. Non point imposer au texte sa propre capacité finie de<br />
comprendre, mais s’exposer au texte et recevoir de lui un soi plus vaste 410 […] un soi instruit<br />
par les œuvres de la culture qu’il s’est appliquées à lui-même » 411 . Ricœur trouve dans le<br />
texte une altérité enseignante tout comme l’altérité enseignante du Maitre révèle par Levinas.<br />
La relation entre le texte et le Maitre n’est pas conditionnée par l’Enseignant, parce que face<br />
au texte l’Enseignant reçoit une infinité de connaissances. Le Maitre chez Ricœur n’est rien<br />
d’autre que celui qui expose l’Enseigné à l’altérité de l’écrit ou de l’œuvre. Le dessein du<br />
Maître également d’après Blanchot, n’est pas d’égaliser la sphère des relations, mais de les<br />
désorganiser ; non pas dans le sens de simplifier les voies de la connaissance, mais de prime<br />
abord de les rendre non seulement plus hermétiques,<br />
Mais proprement infrayables ; ce que la tradition orientale de la maîtrise<br />
montre assez bien. Le maître ne donne rien à connaître qui ne reste déterminé<br />
par l’« inconnu » indéterminable qu’il représente, inconnu qui ne s’affirme pas<br />
par le mystère, le prestige, l’érudition de celui qui enseigne, mais par la<br />
distance infinie entre A et B 412 .<br />
Cette distance incommensurable n’existe pas uniquement par la séparation entre le Même<br />
et l’Autre comme le pense Levinas, mais également par la démesure des écrits et des ouvrages<br />
différents, excédent qui transperce et s’ouvre dans la culture. L’altérité du texte se révèle<br />
certainement dans la figure de l’inqualifiable ou dans celle de l’insondable.<br />
En effet, nous constatons entre un court chemin de l’enseignement, celui du « face-à-face »<br />
levinassien entre l’Enseignant et l’Élève, et un long chemin, celui qui accomplit la déviation<br />
par l’étude des textes exposés par Ricœur et Blanchot. Si donc l’Enseignant est celui qui, par<br />
sa présence et par son discours interprétatif, rend actuel l’alternative éducatrice du texte,<br />
celui-ci, en ce que dans son indépendance il fait médiation entre l’enseignant et l’enseigné,<br />
« ouvre un espace de liberté par rapport à ce que la maîtrise peut comporter de<br />
domination. Seule l’altérité enseigne, celle du maître et celle des œuvres » 413 . Par cette<br />
410 Ricœur, Du texte à l’action, Seuil, Paris, 1985, pp. 116-117.<br />
411 Ricœur, Temps et Récit, t. III, Seuil, Paris, 1985, p. 356.<br />
412 Blanchot, L’Entretien infini, op cit., p. 5.<br />
413 Lamarre, « Seule l'altérité enseigne », Le Télémaque, art. op cit., p. 77.<br />
107
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
approche critique, Ricœur et Blanchot questionnent et ouvrent la pensée de Levinas en posant<br />
l’altérité des œuvres.<br />
2. De la critique levinassienne de l’altérité plurielle<br />
Dans la philosophie levinassienne seule l’altérité du Maitre enseigne, c’est exclusivement<br />
« l’enseignement de Moi par l’Autre [qui] crée la raison » 414 . Les articulations de Ricœur, de<br />
Derrida et de Blanchot sont certes fructueuses parce qu’elles ouvrent d’autres horizons au<br />
concept d’altérité, mais le problème est que ces conceptions ouvrent une inflation de sens du<br />
concept d’altérité. L’altérité enseignante n’apparait plus exclusivement dans le visage du<br />
Maître comme le montre Levinas, mais également dans les œuvres. Ces conceptions<br />
envisagent certes de nouvelles perspectives, mais dans leur entreprise elles finissent par<br />
fermer la porte qu’elles ouvrent, car au lieu d’aboutir à un « autrement qu’être », elles<br />
demeurent dans une vision autre ou plus précisément dans un être autrement qui n’est rien<br />
d’autre qu’une manifestation de l’Être sous une forme autre, attitude ontologique que critique<br />
entièrement l’œuvre d’Emmanuel Levinas.<br />
Les œuvres n’enseignent pas, seul l’absolument Autre en tant que Maître enseigne 415 .<br />
L’enseignement dans Totalité et Infini se manifeste comme une relation entre le Maitre et<br />
l’Élève. Cette relation est particulièrement langage – langage dans lequel les termes ne<br />
constituent pas une totalité, mais demeurent absolument séparés. Enseigner chez Levinas,<br />
comme nous allons le voir dans la troisième articulation de ce chapitre, c’est donner par la<br />
parole et cet enseignement n’est possible que par la présence du visage, or comme toute<br />
activité artistique, et comme tout objet, les réalisations artistiques n'ont pas de visage.<br />
Transformables et compréhensibles, elles se déclinent comme le patrimoine d'une volonté<br />
morte. Les œuvres d’art ont un prix parce qu’elles peuvent être réduites à l'anonymat et<br />
livrées à l’existence économique. Elles restent d’après Levinas dans la sphère du Même. Les<br />
œuvres artistiques ont une même finalité que les objets, ce sont des représentations neutres,<br />
impersonnelles, statiques, qui relèvent du domaine de la sensibilité – inconciliable avec la<br />
pensée. Comme les fétiches, aucune impulsion vitale ne les meut. Elles sont claustrées sur<br />
elles-mêmes, finies, incapables de s'ouvrir à l'extériorité et de recevoir l'enseignement<br />
d'Autrui. Si les œuvres d’arts transmettent des connaissances, cette situation pédagogique est<br />
d’un moindre degré par rapport à l’homme, car ce dernier n’est pas une substance inerte et<br />
414 Levinas, Totalité et Infini, op cit., p.230<br />
415 Ibid., p. 46.<br />
108
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
étendue, il s’agit d’un être pensant qui sait en pensant qu’il est entrain de penser 416 .<br />
Contrairement aux œuvres dont la nature est de demeurer fixe dans l’attente d’un quelconque<br />
lecteur, l’homme quant à lui demeure dynamique et dans les situations pédagogiques, il parle,<br />
explique, cherche à comprendre ce qui fait problème dans la compréhension de l’Autre ce qui<br />
n’est pourtant pas le cas dans le contexte textuel. Cette dynamique humaine est une activité<br />
que ni le livre ni l’œuvre d’art ne peuvent entreprendre. Les textes sont certes utiles, mais on<br />
peut se passer des écrits dans les situations pédagogiques. D’ailleurs, pourquoi Socrate n’a-t-il<br />
pas écrit ? Parce que l’écriture trahis le logos, tel que Platon l’affirme dans le Phèdre 417 en<br />
soulignant le défaut de l’écriture ; pour lui cette dernière trahit la pensée et s’oppose à<br />
l’enseignement oral, seul ayant la capacité de transmettre l’art de philosopher.<br />
« L’être est extériorité » 418 et cette extériorité ne se manifeste uniquement que par le<br />
langage 419 , langage qui suppose la présence d’un Autre. La société parlante manifeste la<br />
présence de l’être. La chose en soi se révèle dans le langage, sa vérité ne se « dévoile pas »<br />
car « la chose en soi s’exprime ». La parole révèle la présence de l’être, « elle est, de soi,<br />
présence d’un visage et dès lors, appel et enseignement, entrée en relation avec moi – relation<br />
éthique » 420 . Cependant la parole ne révèle pas davantage la présence de l’être en régressant<br />
du symbole au contenu conceptuel, elle présente simplement le ‘’signifiant ‘’. Le signifiant,<br />
c’est-à-dire ce qui révèle ‘’le signe’’ – n’est pas signifié. Il faut avoir été en communauté de<br />
signifiants pour que le signe puisse se manifester comme signe. Le signifiant doit donc<br />
précéder tout ‘’signe’’, par lui-même, c’est-à-dire « présenter le visage » 421 , or le texte n’a pas<br />
de visage.<br />
« La parole, en effet, une manifestation hors pair : elle n’accomplit pas le mouvement<br />
partant du signe pour aller au signifiant et au signifié » 422 . Elle défait et explicite plutôt ce que<br />
tout signe ou symbole voile au même instant où il ouvre le chemin qui conduit au ‘’signifié ‘’,<br />
en permettant au signifiant d’être présent au moment du dévoilement du signifié. Cette<br />
présence du signifiant dans la manifestation du signifié dévoile effectivement la supériorité et<br />
la primauté du discours oral ou magistral sur le discours écrit redevenu symbole. Pour le dire<br />
416<br />
Cf. René Descartes, Méditations métaphysiques. « Meditationes de prima philosophia », Texte latin et<br />
traduction du duc de Luynes revue par Descartes, présentation et nouvelle traduction (en regard) par Michelle<br />
Beyssade, Le Livre de Poche, 1990<br />
417<br />
Platon, Phèdre, GF – Flammarion, Paris, 1992<br />
418<br />
Levinas, Totalité et Infini, op cit., p.266<br />
419<br />
L’être chez Platon (Cf. Le Sophiste) tout comme chez Levinas est langage.<br />
420 Ibid., p.157<br />
421 Ibid.<br />
422 Ibid.<br />
109
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
comme Levinas : « cette assistance mesure le surplus du langage parlé sur le langage écrit<br />
redevenu signe. Le signe est un langage muet. Un langage empêché. [Or] Le langage ne<br />
groupe pas les symboles en systèmes, mais déchiffre les symboles » 423 . Seulement ceci n’est<br />
possible que lorsque la révélation de l’Autre dans son visage s’est déjà effectuée, au moment<br />
où, dans une situation pédagogique, l’Enseignant s’est « présenté » et a porté secours à sa<br />
propre présence, tous les symboles autres que les signes verbaux peuvent être utilisés dans le<br />
langage. Mais il faut souligner que la parole de l’Enseignant elle-même ne reçoit pas toujours<br />
l’accueil qu’il convient de donner à la parole, car elle renferme du non-dit, de ‘’la non-<br />
parole’’ et son expression peut être ainsi similaire à celui des objets et des ustensiles,<br />
l’Enseignant a donc le devoir de bien parler. Par la manière de prononcer les mots, par le style<br />
verbal, la parole apparait comme une activité et comme un produit. « Elle est à la parole pour<br />
ce que l’écriture offerte aux graphologues est à l’expression écrite offerte aux lecteurs » 424 .<br />
La parole comme travail, comme activité pédagogique d’un Maître exprime comme les objets<br />
et les ustensiles. « Elle n’a pas la transcendance totale du regard dirigé sur le regard, la<br />
franchise absolue du face-à-face qui se tend au fond de toute parole » 425 . De ma parole<br />
comme travail, « parole-activité », je suis absent tout comme je le suis dans mes œuvres.<br />
Cependant, malgré cette absence et contrairement aux œuvres quelle que soient leur nature, je<br />
reste et demeure « la source intarissable de ce déchiffrement toujours renouvelé. Et ce<br />
renouvellement est précisément la présence ou mon assistance à moi-même » 426 . Les œuvres<br />
écrites certes nous transmettent des connaissances, mais malheureusement ne nous permettent<br />
pas d’être en face des volontés car, « toute volonté se sépare de son œuvre » 427 .<br />
« Les œuvres de l’homme ont toutes un sens, mais l’être humain s’en absente aussitôt et<br />
se devine à partir d’elles, se donne, lui aussi, dans l’articulation du ‘’en tant que’’» 428 . Entre<br />
l’activité qui se termine par des œuvres ayant un sens pour les autres hommes, et que ces<br />
derniers peuvent avoir – déjà objet de commerce représenté dans l’argent - et le discours où<br />
j’assiste à ma propre présentation, unique et attentif, le fossé est immense. Cependant ce<br />
gouffre ouvert par « l’en-ergie » de la manifestation attentive qui ne quitte pas le visage.<br />
« Elle n’est pas à l’expression ce que la volonté est à son œuvre » dont elle se détache en la<br />
donnant à son destin et s’aperçoit avoir désiré « un tas de choses » qu’elle n’avait pas désiré.<br />
423 Ibid., p.157<br />
424 Ibid.<br />
425 Ibid.<br />
426 Ibid.<br />
427 Ibid., p.202<br />
428 Ibid., p.274<br />
110
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Parce que « l’absurdité de ces œuvres » ne résulte pas d’une défectuosité de l’esprit qui les a<br />
accompli ; elle provient de « l’anonymat » où chute cette volonté, de l’ignorance de l’artiste<br />
qui découle de cet anonymat indispensable. Jankélévitch n’a donc pas tort d’affirmer que le<br />
travail n’est pas expression 429 . « En acquérant l’œuvre, je désacralise le prochain qui l’a<br />
produit » 430 . L’homme n’est réellement à part, « non-englobable », que dans le visage où il est<br />
capable de « porter secours » à sa propre présentation.<br />
L’œuvre ne permet pas au moi de s’extérioriser, il s’y dérobe plutôt, s’immobilise comme<br />
s’il ne dialoguait pas avec Autrui, n’émettait pas des signes et ne répondait pas, mais cherchait<br />
dans son travail le luxe, la vie privée et le repos. En réalisant mon projet, je réalise même les<br />
choses que je n’ai pas projeté – l’œuvre apparait dans les « déchets du travail. L’ouvrier ne<br />
tient pas en main tous les fils de sa propre action. Il s’extériorise par des actes en un sens déjà<br />
manqué » 431 . Si l’œuvre apparait de ce fait dans les décombre du travail, la présence de<br />
l’auteur de l’œuvre ou du Maître est indispensable, car c’est uniquement ces derniers qui<br />
peuvent orienter l’élève dans son apprentissage, car l’élève bien qu’il soit par essence un être<br />
parlant, en situation pédagogique, il se dévoile sous le visage de l’infans 432 , c’est-à-dire sous<br />
le visage de celui qui ne parle pas encore. Le Maître a donc la lourde et périlleuse tâche<br />
d’apprendre à parler. C’est donc avec une stricte tension épistémologique qu’il faut prendre la<br />
définition de la philosophie qui se dégage dans l’Eloge de la philosophie 433 de Maurice<br />
Merleau-Ponty en ces termes : « philosopher c’est d’abord savoir ce que parler veut dire.»<br />
Les œuvres d’après Levinas définissent leurs auteurs de manière indirecte, c’est-à-dire « à<br />
la troisième personne » 434 . Le discours que procure les œuvres est d’un moindre degré par<br />
rapport au discours magistral, car à partir des œuvres, l’auteur « est seulement déduit et déjà<br />
mal entendu, trahi plutôt qu’exprimé (…). Autrui se signale mais ne se présente pas. Les<br />
œuvres le symbolisent. (…). S’exprimer par sa vie, par ses œuvres, c’est précisément se<br />
refuser à l’expression. Le travail demeure économique » 435 . Levinas inverse la mobilité des<br />
Méditations cartésiennes de Husserl : ce n’est pas parce que le « je » est un « autre » qu’il<br />
peut penser quelque chose comme Autre. C’est plutôt l’altérité, l’extériorité qui est première,<br />
ce que Descartes avait pressenti, lorsqu’il évoquait l’idée de l’Infini débordant la finitude<br />
429<br />
Jankélévitch, L’austérité et la vie morale, Flammarion, Paris, 1956, p.84<br />
430<br />
Levinas, Totalité et Infini, op cit., p.274<br />
431<br />
Ibid., p.150<br />
432<br />
Enfant vient du mot latin « Infant » qui signifie un bébé, jeune enfant c’est-à-dire celui qui ne parle pas<br />
encore.<br />
433<br />
Merleau-Ponty, Eloge de la philosophie, Gallimard, 1989<br />
434<br />
Levinas, Totalité et Infini, op cit., p.38<br />
435 Ibid., p.151<br />
111
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
même du sujet. Par conséquent, seul l’Autre enseigne chez Levinas, non pas par la maïeutique<br />
socratique, mais par l’activité langagière s’articulant autour de la transmission de<br />
l’intransmissible. L’Autre est indispensable dans le processus pédagogique, car comme le dit<br />
Levinas : c’est l’enseignement du Même par l’Autre qui crée la raison.<br />
III. Enseigner c’est donner par la parole<br />
« La relation avec Autrui ne se développe pas en dehors du monde, mais met le monde<br />
possédé en question. La relation avec Autrui, la transcendance, consiste à dire le monde à<br />
Autrui » 436 , c’est-à-dire à enseigner - « Assistance de l’être à sa présence – la parole est<br />
enseignement » 437 . Enseigner, c’est offrir le monde à un Autre et cette offrande n’est possible<br />
que par le langage. Le langage réalise « la mise en commun originelle – laquelle se réfère à la<br />
possession et suppose l’économie ». Le caractère universel qu’une chose acquiert du mot qui<br />
l’arrache de l’ici et maintenant, atrophie son mystère dans la perspective éthique où loge le<br />
langage. Le langage comme mode par lequel l’enseignement survient, « n’extériorise pas une<br />
représentation préexistent en moi – il met en commun un monde mien. Le langage effectue<br />
l’entrée des choses dans un éther nouveau où elles reçoivent un nom et deviennent concept,<br />
premier geste du travail, action sans action » 438 , même si la parole renferme l’effort de<br />
l’activité, « si, pensée incarnée », il nous introduit dans l’univers, dans les dangers possibles<br />
de tout acte.<br />
Le langage désigne « la mise en question de moi, coextensive de la manifestation<br />
d’Autrui dans le visage » 439 et l’enseignement, la hauteur d’où provient le langage. Langage et<br />
enseignement sont donc liés. « La maïeutique socratique, d’après Levinas, avait raison d’une<br />
pédagogie qui introduit des idées dans un esprit en violant ou en séduisant (ce qui revient au<br />
même) cet esprit » 440 . Elle ne supprime pas la béance de l’ampleur même de l’infini qui se<br />
manifeste comme altitude dans le visage du Magister. Cette voix résultant d’ailleurs est<br />
l’enseignement de la transcendance. L’enseignement renvoie en conséquence à l’intégralité de<br />
l’infini de l’extériorité. Cependant cet infini de l’extériorité ne se réalise pas d’abord et<br />
enseigne par la suite, puisque « l’enseignement est sa production même. L’enseignement<br />
premier enseigne cette hauteur même équivaut à son extériorité éthique » 441 . Grâce à<br />
436 Ibid., p.148<br />
437 Ibid., p.70<br />
438 Ibid., p.149<br />
439 Ibid., p.146<br />
440 Ibid.<br />
441 Ibid.<br />
112
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
ce mouvement avec l’infini de l’extériorité, l’innocence de l’être qui se manifeste comme une<br />
puissance mouvante, éprouve du déshonneur face à sa propre naïveté. Elle se perçoit comme<br />
« une violence », cependant ici, elle se tient dans une autre dimension. Le dialogue avec<br />
l’altérité de l’Infini, n’estropie pas comme « l’opinion ». Il ne limite pas une conscience d’une<br />
manière inacceptable pour le philosophe, car la limitation se fait uniquement dans une<br />
totalité, tandis que la relation avec Autrui détruit le dôme de la totalité. La relation éthique est<br />
fondamentalement « pacifique. L’Autre ne s’oppose pas à moi comme une autre liberté, mais<br />
semblable à la mienne et, par conséquent hostile à la mienne » 442 .<br />
L’Autre n’est pas une autre liberté aussi « arbitraire » que la mienne, sans quoi elle<br />
traverserait immédiatement l’infini qui m’en sépare pour pénétrer sous la même notion. Sa<br />
différence se révèle dans une puissance pacifique qui enseigne. Enseigner chez Levinas ne<br />
veut pas dire dominer, manipuler, violenter l’Élève. « L’enseignement n’est pas une espèce<br />
d’un genre appelé domination, une hégémonie se jouant au sein d’une totalité, mais la<br />
présence de l’infini faisant sauter le cercle clos de la totalité » 443 . L’enseignement se fait entre<br />
deux êtres absolument séparés. Enseigner c’est offrir, transmettre, communiquer, faire des<br />
dons, donner ses connaissances dans la stricte gratuité tout en laissant à l’Autre la possibilité<br />
de les remettre en question, de les accepter ou de les refuser. La relation entre le Maitre et<br />
l’Élève est strictement pacifique et ouverte, par conséquent, tout enseignement se présentant<br />
sous le paravent de la totalité est en-saignement, c’est-à-dire en-sauvage-ment – dictature du<br />
Même sur l’Autre, négation et annihilation de l’altérité, assimilation de l’Autre dans la<br />
Totalité où il se perd en se fondant dans le « neutre ».<br />
L’en-saignant par son activité barbare assimile l’Autre dans un monde aphasique, or la<br />
condition première de l’enseignement est langage. L’enseignement ne peut se dérouler que<br />
dans le respect de la singularité absolue de l’Autre, il n’est pas question ici de con-vaincre<br />
l’Autre afin de l’intégrer dans l’unité de l’Esprit dialectique au sens hégélien, mais d’user de<br />
la parole pour lui offrir le monde ; l’Enseignant est celui-là qui aborde l’enseigné toujours les<br />
mains pleines, car « aucun visage ne saurait être abordé les mains vides et la maison fermée<br />
» 444 . L’Enseignant n’est pas un mal-faiteur, c’est plutôt un bien-faiteur qui ouvre sa maison à<br />
l’Élève de manière respectueuse. Le respect de l’Autre en matière d’enseignement est donc un<br />
442 Ibid.<br />
443 Ibid.<br />
444 Ibid.<br />
113
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
impératif capital, cependant chez Levinas ce respect ne résulte pas d’une loi fixe et immuable,<br />
mais de l’Autre 445 .<br />
« L’enseignement est un discours où le maître peut apporter à l’élève ce que l’élève ne<br />
sait pas encore » 446 . Sa méthode n’est pas similaire à celle de la maïeutique, mais continue la<br />
mise en l’homme de l’idée de l’Infini. « La Relation avec Autrui n’a pas le même statut que<br />
les relations offertes à la pensée objectivante et où la distinction des termes en reflète aussi<br />
l’union » 447 . La relation entre le Maître et l’Élève n’a pas la même forme que « la logique<br />
formelle » perçoit dans tous les rapports. Le rapport avec Autrui est l’unique relation qui<br />
dépasse la compréhension de la logique formelle parce qu’elle est sans concept, offrande et<br />
transcendance, irruption dans l’Infini qui est externe à toute catégorisation.<br />
En outre, la représentation détient son autonomie, à l’égard de l’univers qui l’alimente, du<br />
rapport absolument éthique – avec l’Autre. « La morale ne s’ajoute pas aux préoccupations du<br />
moi, pour les ordonner ou pour les faire juger – elle les met en question et à distance de soi, le<br />
moi lui-même » 448 . La représentation ne débute pas par la manifestation d’une chose donnée<br />
à ma « violence », néanmoins « échappant » de façon expérimentale à ma puissance, mais<br />
dans ma capacité de critiquer cette violence, dans une éventualité se réalisant de par « le<br />
commerce avec l’infini ». Le développement positif de ce rapport pacifique sans limite ou<br />
« sans négativité aucune, avec l’Autre, se produit dans le langage. Le langage n’appartient pas<br />
aux relations qui puissent transparaitre dans les structures de la logique formelle : il est<br />
contact à travers une distance, rapport avec ce qui ne se touche pas, à travers un vide » 449 . Il<br />
se situe dans l’ampleur du « désir absolu » par lequel le Maître est en relation avec un élève,<br />
qui n’est pas ce que le Maître avait perdu. Le touché ou le regard ne se définissent pas comme<br />
des comportements prototypes de la loyauté. « Autrui n’est ni initialement, ni ultérieurement<br />
ce que nous saisissons pour ce dont nous faisons notre thème ». Cependant la vérité n’est pas<br />
dans ce que je vois ou dans ce que je maitrise – « modes de la jouissance, de la sensibilité et<br />
de la possession. […] Elle est dans la transcendance où l’extériorité absolue se présente en<br />
s’exprimant, dans un mouvement qui consiste à reprendre et à déchiffrer, à tout moment, les<br />
signes mêmes qu’elle délivre » 450 .<br />
445 Levinas, Entre nous. Essais sur le penser - à - l’autre, op cit., p. 46<br />
446 Idem, Totalité et Infini, Op. Cit, p.155<br />
447 Ibid., p.155 « L’idée de l’Infini implique une âme capable de contenir plus qu’elle ne peut tirer de soi.»<br />
448 Ibid., p.146<br />
449 Ibid., p.147<br />
450 Ibid.<br />
114
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
« L’être est un monde où l’on parle et dont on parle. La société est la présence de l’être<br />
» 451 . Nous remémorons que chez Levinas, penser c’est être enseigné ou avoir l’idée de<br />
l’infini 452 . Toute relation avec l’idée d’infini est donc enseignement. L’enseignement est<br />
parole. Mais il est capital de souligner que « la parole ne s’instaure pas dans un milieu<br />
homogène ou abstrait, mais dans un monde où il faut secourir et donner » 453 . Ceci explique<br />
pourquoi, le premier dessein de l’en-sauvage-ment est la destruction de toute possibilité du<br />
recours à la parole, car par elle, l’être est appelé à donner. La parole suppose donc un moi,<br />
une vie autre dans sa jouissance et qui ne reçoit pas le visage et sa parole provenant d’une<br />
autre périphérie, sans présent. La pluralité dans l’être qui ne se donne pas dans la totalité,<br />
néanmoins se présente comme « fraternité et discours », ne s’installe exclusivement que dans<br />
un univers « asymétrique ».<br />
L’être chez Levinas est extériorité et cette extériorité se manifeste par la parole.<br />
« L’existence de l’homme demeure phénoménale, tant qu’elle reste intériorité ». Nous<br />
rappelons que l’instant où l’être séparé se dévoile sans s’exprimer dans l’espace où il se<br />
manifeste, mais n’est pas présent dans sa présence, désigne le phénomène. « Le phénomène,<br />
chez Levinas, c’est l’être qui apparait, mais demeure absent. Pas apparence, mais réalité qui<br />
manque de réalité, encore infiniment éloignée de son être » 454 . Le discours qui permet à un<br />
être d’exister-pour-Autrui, « est son unique possibilité d’exister d’une existence qui est plus<br />
que son existence intérieure » 455 . L’excédent que comprend le langage par rapport à toutes les<br />
activités et les « œuvres » qui extériorisent un homme, mesure la distance entre l’être vivant et<br />
l’être mort, l’unique pourtant que « l’histoire – qui aborde objectivement dans son œuvre ou<br />
dans son héritage – reconnaisse » 456 .<br />
Le retour à l’être unique à partir des signes et des symboles de la vie phénoménale, ne<br />
consiste pas à s’englober dans la totalité, telle que la pensée le conçoit et telle que « la<br />
politique » l’établit. La liberté de l’être séparé s’y perd et se trouve assujettie. « Le retour à<br />
l’être extérieur, à l’être à sens univoque – à un sens qui ne cache aucun autre sens – c’est<br />
entrer dans la droiture du face-à-face » 457 . Seulement, il ne s’agit pas d’un reflet, mais de ma<br />
responsabilité, qui désigne une vie déjà conditionnée. Elle situe le centre de pesanteur d’un<br />
451 Ibid.<br />
452 Ibid., p.179<br />
453 Ibid., p.191<br />
454 Ibid., p.156<br />
455 Ibid.<br />
456 Ibid., p.158<br />
457 Ibid., p.158<br />
115
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
être à l’extérieur de cet être. « Le dépassement de l’existence phénoménale ou intérieure, ne<br />
consiste pas à recevoir la reconnaissance d’Autrui, mais à lui offrir son être. Etre en soi, c’est<br />
exprimer, c’est-à-dire déjà servir autrui. Le fond de l’expression de la bonté » 458 . Etre – c’est<br />
être bon et cette bonté se manifeste par l’enseignement. Etre, c’est être vrai et<br />
« l’enseignement est une façon pour la vérité de se produire telle, qu’elle ne soit pas mon<br />
œuvre, que je ne puisse pas la tenir de mon intériorité » 459 .<br />
458 Ibid.<br />
459 Ibid., p. 271<br />
116
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
CHAPITRE II :<br />
AUTREMENT QUE SELON LE MODE DE L’ETRE<br />
De Totalité et Infini à Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, le chemin, bien que<br />
prévu, ne cesse de surprendre. L'abandon de l'ontologie encore en exercice, et énergiquement,<br />
dans Totalité et infini, se traduit par une radicalisation menant à une dessiccation engendrant<br />
l'obsession affective du Moi par Autrui. La responsabilité pour l’Autre, l’obsession pour le<br />
prochain désigne cette « élection anachronique ». Le moi ne débute pas dans « l'auto<br />
affection d'un moi souverain, susceptible dans un deuxième temps de compatir pour autrui,<br />
mais à travers le traumatisme sans commencement, antérieur à toute auto-affectivité, du<br />
surgissement d'autrui. Ici, l'un est affecté par l'autre » 460 . Il se fait une tension de l'un par<br />
l'autre qui ne saurait se penser à partir de l’idée de causalité, une inspiration au-delà de toute<br />
inspiration, une tension dans laquelle ‘’l’après vous’’ est premier, où la priorité revient à<br />
l’Autre et où le Moi est otage avant d’être hôte. Toutefois, « l’autrement qu’être » levinassien<br />
ne signifie pas « être autrement », car « être autrement » c’est être encore un « être » d’une<br />
qualité différente, c’est toujours conserver la primauté de l’ontologie tout en faisant<br />
manœuvrer une variable, comme si l’on souhaitait tout de bonne foi corriger une ontologie par<br />
une autre. Pour mieux signifier le dessein levinassien il faut, en le paraphrasant, parler de<br />
préférence d’un autrement que selon le mode l’être. Si être selon le mode de l’être en situation<br />
pédagogique, c’est ensauvager par l’en-saignement l’existence de l’Élève, peut-on envisager<br />
un « autrement que selon le mode de l’être » dans lequel le Maître gardera toute son<br />
humanité en devenant un être de raison, de « Désir », de bonté et donneur de paix ?<br />
460 Levinas, Dieu, la mort et le temps, Grasset, Paris, 1993, p. 205.<br />
117
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
I. Difficile Levinas : l’emprise traumatique du Maître<br />
La philosophie levinassienne est certes fructueuse mais sa tension à l’Autre porte<br />
véritablement problème. Notamment, dans Autrement qu’être ou au-delà de l’essence,<br />
Levinas radicalise l’exigence de la priorité de l’Autre jusqu’à lui concéder une dimension<br />
« paroxystique » 461 . Pour exprimer la passivité radicale, c’est-à-dire la passivité précédente à<br />
toute réceptivité, Levinas se sert de la « tropologie de la violence infligée » 462 de Paul Ricœur<br />
: il pousse à bout la sensibilité, car il quitte le vocabulaire non agressif de l’enseignement et<br />
de l’accueil pour un vocabulaire de la « violence traumatique » et de « la persécution par un<br />
otage » 463 . Ce texte comme il le souligne lui-même : « interprète le sujet comme otage » 464 . Le<br />
discours levinassien est une inversion absolue de la philosophie politique, l’infime humanité<br />
qu’on trouve dans le monde apparait pour lui dans les actions de reconnaissance :<br />
reconnaissance et solidarité avec Autrui. Selon lui, « c’est de par la condition d’otage qu’il<br />
peut y avoir dans le monde pitié, compassion, pardon et proximité […]. L’incondition d’otage<br />
n’est pas le cas limite de la solidarité, mais la condition de toute solidarité » 465 . Le sujet est<br />
donc « otage » avant d’être hospitalier. Seulement, le problème qui se pose ici est que l’Autre<br />
en tant que mon enseignant devient également mon persécuteur. A quoi renvoie la<br />
« persécution » au sens levinassien et quel est son impact dans le contexte pédagogique ?<br />
La persécution précise Levinas « ne constitue pas ici le contenu d’une conscience devenue<br />
folie; elle désigne la forme selon laquelle le Moi s’affecte et qui est une défection de la<br />
conscience. Cette inversion de la conscience est sans doute passivité » 466 . Cependant il s’agit<br />
d’une « passivité en deçà de toute passivité », d'une exposition intégrale à la loi de l'Autre,<br />
d'une dénudation sacrificielle qui a aucunement le même sens que l’intentionnalité où le subir<br />
parait toujours comme un « assumer », c’est-à-dire un procédé perpétuellement anticipé et<br />
« consentie ». Néanmoins, il faut noter que la persécution ne s’additionne pas à la subjectivité,<br />
car cette dernière en tant que « l’autre-dans-le-même » 467 est, dans l’emprise traumatique de la<br />
brimade, le « me voici ! » 468 de l’outragé répondant de l’outrageux, le détroit de la peine<br />
461 Ricœur, Soi-même comme un autre, op cit., pp. 390<br />
462 Ricœur, Autrement, PUF, Paris, 1997, p. 26<br />
463 Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, op cit., p. 163. Voir aussi. p. 18 : «Vulnérabilité,<br />
exposition à l’outrage, à la blessure – passivité plus passive que toute patience, passivité de l’accusatif,<br />
traumatisme de l’accusation subie jusqu’à la persécution par un otage, mise en cause, dans l’otage, de l’identité<br />
se substituant aux autres : Soi – défection ou défaite de l’identité du Moi. Voilà, poussée à bout, la sensibilité. »<br />
464 Ibid., p. 232<br />
465 Ibid., p. 150<br />
466 Ibid., p. 128-129.<br />
467 Ibid., p. 32.<br />
468 Ibid., p. 151<br />
118
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
endurée à la responsabilité pour l’outrageux. D’après les propres mots de Levinas : « Subir<br />
par autrui, n’est patience absolue que si ce “par autrui” est déjà “pour autrui”. Ce transfert<br />
[…] est la subjectivité même » 469 . Si donc dans Totalité et Infini, c’est l’accueil de<br />
l’Enseignant par l’enseigné qui précède et détermine le débat et l’interactivité des questions et<br />
des solutions ; dans Autrement qu’être, c’est plutôt la responsabilité pour le persécuteur, «<br />
responsabilité antérieure au dialogue, à l’échange de questions et de réponses, à la<br />
thématisation du Dit […] » 470 . En conséquence, il nous apparait que de Totalité et Infini à<br />
Autrement qu’être, le passage pacifique de l’enseignement de l’Enseignant se renverse,<br />
comme le dit Lamarre, « en violence du traumatisme de la persécution » 471 . Autrement dit,<br />
l’acte de transmettre mute en persécution. Dans cette perspective, il apparait que c’est<br />
uniquement l’altérité désagréable et persécutive qui est source d’enseignement.<br />
L’enseignement du Maître, dans son surcroît débordant ma capacité réceptive s’avère<br />
effarante et face à ce débordement je reste inlassablement en retard et coupable de ce retard.<br />
Comme nous l’avons examiné, dans Totalité et Infini, l’Autre est l’altérité, l’éloigné,<br />
l’extériorité, par contre dans Autrement qu’être, il est le « prochain », celui qui est près de moi<br />
jusqu’à la « persécution ». Dans L’Écriture du désastre, Maurice Blanchot explicite ce que<br />
signifie un renversement du lointain en prochain en précisant la différence entre les deux<br />
relations, de « moi à Autrui » et « d’Autrui à moi ». D’après lui dans la relation de« moi à<br />
Autrui », Autrui représente l’éternellement lointain, c’est-à-dire « ce que je ne puis atteindre,<br />
le Séparé, le Très-Haut, ce qui échappe à mon pouvoir et ainsi le sans-pouvoir, l’étranger et le<br />
démuni » 472 . Cependant, dans la relation « d’Autrui à moi », tout semble s’inverser :<br />
Le lointain devient le prochain, cette proximité devient l’obsession qui me lèse, pèse<br />
sur moi, me sépare de moi, comme si la séparation (qui mesurait la transcendance de<br />
moi à Autrui) faisait son œuvre en moi-même, me désidentifiant, m’abandonnant à une<br />
passivité, sans initiative et sans présent. Et alors autrui devient plutôt le Pressant, le<br />
Suréminent, voire le Persécuteur […] 473 .<br />
La persécution, dans cette analyse de Blanchot, fait apparaître une équivoque, un<br />
domaine apparemment non levé par Levinas, car « lorsqu’autrui m’écrase jusqu’à l’aliénation<br />
radicale, est-ce à autrui que j’ai encore affaire, n’est-ce pas plutôt au « je » du maître, à<br />
l’absolu de la puissance égoïste, au dominateur qui prédomine et qui manie la force jusqu’à la<br />
469 Ibid., p. 141.<br />
470 Ibid., p. 142.<br />
471 Lamarre, « Seule l'altérité enseigne », Le Télémaque, op cit., p. 74<br />
472 Blanchot, L’Écriture du désastre, Gallimard, Paris, 1980, p. 36<br />
473 Ibid., pp. 36-37.<br />
119
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
persécution inquisitoriale » 474 ? La persécution à bien regarder ne pose-t-elle pas d’ambigüité<br />
pédagogique entre le magister et le dominus ? Dans la persécution, je ne suis point en relation<br />
avec le magister mais avec le dominus qui s’exprime par le « je » de l’Enseignant. Cependant<br />
il faut souligner que l’altérité du dominus n’est pas l’altérité radicale, non dialectisable et<br />
irréductible du magister qui est protégée dans Totalité et Infini, mais l’altérité relative aux<br />
relations interindividuelles, plus précisément celle qui parait dans la dialectique du maître et<br />
de l’esclave exposé par Hegel corollaire à l’idée de « Totalité ». Face à cette ambigüité,<br />
Blanchot souligne la nécessité de la présence d’« au moins deux langages ou deux exigences,<br />
l’une dialectique, l’autre non dialectique […] » 475 , qui se traduisent en situation pédagogique<br />
par l’infinie patience et la résistance renvoyant au combat pour la reconnaissance.<br />
Autrement dit, la persécution qui m’ouvre à la plus longue patience et qui<br />
est en moi la passion anonyme, je ne dois pas seulement en répondre en<br />
m’en chargeant hors de mon consentement, mais je dois aussi y répondre<br />
par le refus, la résistance et le combat, revenant au savoir (revenant, s’il est<br />
possible – car il se peut qu’il n’y ait pas de retour), au moi qui sait, et qui<br />
sait qu’il est exposé, non à Autrui, mais au « Je » adverse, à la Toute-<br />
Puissance égoïste, la Volonté meurtrière 476 .<br />
Levinas est contre toute réciprocité, Autrui ne peut se muter en un « je ». Aussi que<br />
l’Autre soit celui à qui on peut faire confiance, c’est-à-dire le Maître – magister, mais qu’il<br />
puisse également être le tyran, le dominus, le parricide est impossible car l’Autre demeure<br />
identique dans toute ses altercations. Le mal quant lui en situation pédagogique ne saurait<br />
être du coté de l’Elève, mais du coté du dominus en tant que Même car « la force d’Autrui est<br />
d’ores et déjà morale » 477 . Si la conception levinassienne évoquée dans Autrement qu’être et<br />
interprétée par Paul Ricœur laisse entendre que la responsabilité pour le persécuteur précède<br />
et conditionne le concours pour la reconnaissance, cela voudrait dire que le sujet levinassien<br />
n’est pas un simple sujet et parler de responsabilité dans un lieu où le Maitre est otage avant<br />
d’être hôte s’avère ambigüe. Dans Soi-même comme un autre, Paul Ricœur pense au sujet «<br />
une capacité d’accueil, de discrimination et de reconnaissance » 478 . Il met l’accent sur la<br />
nécessité du discernement qui permettra d’établir, dans toute situation pédagogique, la<br />
différence entre le « Maitre » et le « bourreau », de reconnaitre le magister dans sa<br />
« supériorité ». Par ailleurs, cette distinction du magister et du dominus qui se révèle chez<br />
474 Ibid., p. 38.<br />
475 Ibid.<br />
476 Ibid.<br />
477 Levinas, Totalité et Infini, op cit., p.201<br />
478 Ricœur, Soi-même comme un autre, op cit., p. 391<br />
120
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Blanchot met en exergue la priorité de la loi morale, en tant que celle-ci s’impose aussi bien à<br />
l’Enseignant qu’à l’Enseigné. Malgré le fait que le Maitre et l’Élève ne soient pas égaux, nul<br />
n’est tenu de faire le mal, d’ailleurs : « la moralité, d’après Levinas, ne nait pas dans l’égalité,<br />
mais dans le fait que, vers un point de l’univers, convergent les exigences infinies, celui de<br />
servir le pauvre, l’étranger, la veuve et l’orphelin » 479 . En fait, c’est uniquement par la<br />
moralité dans le monde et sous-tendu par l’enseignement que se réalise la société<br />
humainement viable.<br />
II. Responsabilité et substitution pour Autrui<br />
1. De la responsabilité pour l’Élève<br />
Les actes que je pose, nul ne peut les exécuter à ma place, car en tant que « fils unique,<br />
fils élu » 480 , ma charge est également unique. Le cœur de l’individualité, c'est la<br />
responsabilité. A partir de l’idée d’élection, nous comprenons que la question de la<br />
responsabilité pour Autrui se pose de manière singulière à chacun d'entre nous. Elle<br />
m'interpelle et me déconcerte. La responsabilité chez Levinas apparait comme la charpente<br />
initiale et cardinale de la subjectivité, elle se conçoit comme responsabilité pour l’Autre, pour<br />
« le mystère », pour « le prochain », pour ce qui est approché par moi comme visage.<br />
L’unique regard de l’Élève me conditionne déjà, je suis responsable de lui malgré moi et sans<br />
même avoir pris des responsabilités à son égard. « Le lien avec autrui ne se noue que comme<br />
responsabilité, que celle-ci, d'ailleurs, soit acceptée ou refusée, que l'on sache ou non<br />
comment l'assumer, que l'on puisse ou non faire quelque chose de concret pour autrui » 481 . La<br />
responsabilité en situation pédagogique à une direction unique, elle implique essentiellement<br />
le Maître, celle que l’Élève pourrait avoir à son égard ne le concerne pas. La responsabilité<br />
pour l’Élève est sans retour, le Maître est responsable de l’Élève sans attendre une quelconque<br />
récompense de sa part. C'est précisément parce que le rapport entre l’Élève et le Maitre n'est<br />
nullement réciproque qu’il est comme le dit Levinas : « […] sujétion à autrui » 482 .<br />
Face à l’Autre, dans la proximité qui me ramène à lui comme à son visage, je suis déjà<br />
appelé et contraint de répondre avant tout jugement. « Dans la proximité s’entend un<br />
commandement venu comme d’un passé immémorial : qui ne fut jamais présent, qui n’a<br />
479 Levinas, Totalité et Infini, op cit., p.223<br />
480 Levinas, Totalité et Infini, op cit., p. 256<br />
481 Idem, Ethique et infini, éd. Le Livre de poche, 1982, p. 93<br />
482 Idem, Totalité et Infini, Martinus Nijhoff, La Haye, 1980, p.95.<br />
121
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
commencé dans aucune liberté » 483 . Ceci veut dire que je suis toujours et déjà responsable,<br />
que cette responsabilité, de toute façon, me précède à jamais et que ma réponse, dans ce<br />
mouvement, absent à l’appel, comme si j’étais toujours en retard, dans un retard où se dévoile<br />
ma non-contemporanéité avec le visage de l’Autre. « Il me réclamait avant que je vienne.<br />
Retard irrécupérable » 484 . Retard qu’on ne pourrait restaurer et qui me rend coupable à<br />
l’infini, coupable de mon absence face à l’appel d’Autrui.<br />
La présence du visage venant « d’ailleurs », m'engageant dans la fraternité humaine sans<br />
me foudroyer comme essence numineuse qui fait frémir et se fait redouter 485 . Autrui selon<br />
Levinas me concerne même s'il me méconnait ou me regarde avec désintéressement.<br />
L'éthique me contraint de quitter le stade, agressif et forcément déloyal, du combat pour la<br />
reconnaissance, de la concurrence et de la revanche. La vulnérabilité dévoilé par le visage de<br />
l’Autre et de celui qui n'hésite pas à me rejeter à cause de ses intérêts, m'assigne<br />
originellement à la responsabilité, me tourmente et me met en cause même s'il refuse<br />
résolument de me reconnaître. La relation avec l’Autre – mon Élève ne se fait que comme<br />
responsabilité. Cette responsabilité m’exhorte, d’une part, à répondre à l’appel de l’Élève, et<br />
d'autre part, à pouvoir dire : « me voici ! », acte non réciproque qui m’embarque dans une<br />
responsabilité infinie pour Autrui 486 , une relation qui fait de moi un homme. Il faut souligner<br />
que l’’homme chez Levinas, c’est la réalisation de l’Infini dans son existence terrestre.<br />
Cependant il existe une transcendance créatrice qu’on ne peut véritablement nommer.<br />
La compréhension du concept de responsabilité dans la pensée levinassienne marque une<br />
limite qui détache et sépare : l’humanisme de l’autre homme. La différence du sujet avec le<br />
sujet est le lieu qui permet à l’être humain de fonder son existence à partir de l’Autre et pour<br />
l’Autre. L’authentique métaphysique est donc socialité 487 . Tout en posant des questions sur<br />
Dieu, elle se tient dans la relation avec l’Autre. La métaphysique se manifeste ou se réalise<br />
dans la relation sociale, dans nos rapports avec les autres. La connaissance de Dieu n’est<br />
exclusivement possible que dans la relation humaine. L’Autre est l’espace exact de la vérité<br />
métaphysique et nécessaire à ma relation avec Dieu. Il n’est pas l’intermédiaire. « Autrui n’est<br />
pas l’incarnation de Dieu, mais précisément par son visage, où il est désincarné, la<br />
483<br />
Idem, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Le Livre de poche, coll. « Biblio-essais », Paris, 1990<br />
[1974], p. 141<br />
484<br />
Ibid., p. 141<br />
485<br />
Ibid., p.190.<br />
486<br />
Levinas, Humanisme de l’autre homme, Montpellier, Fata Morgana, 1972 ; rééd. Le Livre de poche, coll.<br />
« Biblio », Paris, 1994, p. 49.<br />
487<br />
Armengaud, « Entretien avec Emmanuel Levinas », in Revue de Métaphysique et de Morale, n°90, 1985,<br />
p.299.<br />
122
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
manifestation de la hauteur où Dieu se révèle » 488 . La réalisation de la primauté de l’éthique,<br />
de la relation interpersonnelle, l’enseignement de la justice, primat d’un non-totalisable<br />
auquel se fonde les autres structures est l’un des desseins de Totalité et infini. La relation que<br />
Levinas établit avec le divin traverse celle qui se fait avec les hommes et correspond à la<br />
justice sociale. « La responsabilité personnelle de l’homme à l’égard de l’homme est telle que<br />
Dieu ne peut l’annuler » 489 . D’après Levinas, l’Autre ne se manifeste pas comme une<br />
incitation à la violence, il est plutôt celui qui par l’expression de son visage ouvre à l’au-delà,<br />
appel au dialogue et provoque une vigilance éthique 490 . Être-pour-Autrui, c’est se mettre en<br />
cause et « redouter le meurtre plus que la mort » affirme Balla Oyié 491 , c’est se poser la<br />
question : que signifie être ?<br />
Être chez Levinas, ce n’est pas entreprendre un discours au nominatif par le pronom<br />
personnel « je », c’est plutôt répondre à l’appel de l’Autre par l’accusatif « me ». Être moi,<br />
c’est indéfiniment répondre de et à Autrui et me dérober de cet appel, c’est perde mon ipséité.<br />
Au plan métaphysique où se situe Levinas c’est la responsabilité qui donne sens à l’identité.<br />
Levinas opère une inversion catégorielle, car chez lui ce n’est pas la liberté qui est première<br />
mais la responsabilité. La responsabilité précède la liberté et la séquence s’inscrit comme suit<br />
: responsabilité, identité, liberté. Etre, c’est « être-pour-l’autre », c’est « se-vouer-à-l'autre», se<br />
préoccuper de l’Autre, « une préoccupation de l'autre jusqu'au sacrifice, jusqu'à la possibilité<br />
de mourir pour lui ; une responsabilité pour autrui » 492 . Le Maitre est au service de l’Élève, il<br />
endosse sur lui la responsabilité infinie des Élèves, de ce fait, il doit inlassablement dialoguer,<br />
être patient, attentif et sensible à l’appel de l’Élève, car « quelque soit le message transmis par<br />
le discours, le parler est contact » 493 . Le discours est contact, approche et toucher,<br />
cependant toucher « l’envers, sans s’interroger sur l’endroit » 494 . Le toucher est un accueil et<br />
un rapprochement sain, où se manifeste une relation non assimilable à toute activité de la<br />
rencontre et de la proximité. La vocation pour Autrui traduit donc une rupture totale de<br />
488 Levinas, Totalité et Infini. Deuxième édition, Martinus Nijhoff, La Haye, 1965., op cit., p.51. Levinas affirme<br />
également dans En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger (p.174), que « Autrui est plus près de Dieu<br />
que Moi ».<br />
489 Idem, Difficile liberté, op cit., p.36.<br />
490 Cf. Levinas, De Dieu qui vient à l'idée, Paris, J.Vrin, 2 e édit. revue et aug. 1992, p. 187 Pour être plus précis :<br />
«La question de l’Autre retourne en responsabilité pour autrui, et la crainte de Dieu – aussi étrangère à l’effroi<br />
devant le sacré qu’à l’angoisse devant le néant– en crainte pour le prochain et pour sa mort.»<br />
491 Balla Oyie, « L’irruption éthique d’autrui : corolaire de l’éthique de la justice de Etre », in Annales de la<br />
FALSH, Université de Yaoundé I, Vol. 1, N°9, Nouvelle série, 2009. Premier semestre, p.143<br />
492 Levinas, Entre nous. Essais sur le penser-à-l'autre, Grasset, Paris, 1991, p.11<br />
493 Idem, En découvrant l’existant avec Husserl et Heidegger, Vrin, Paris, 1967, p.244<br />
494 Idem, Totalité et Infini, op cit., p.109<br />
123
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
l'indifférence et « la possibilité de l'un-pour-l'autre, qui est l'événement éthique » 495 par<br />
excellence.<br />
Contrairement à Jean Paul Sartre 496 , Autrui chez Levinas n’est pas d’abord un regard<br />
pointé sur moi, c’est un visage qui me conditionne et dont je dois répondre. L’existence de<br />
l’Autre, ses yeux que je croise m’annoncent mon obligation à son égard. Je suis<br />
perpétuellement responsable d’Autrui : « au même échoit l’accueil de front et de face et la<br />
responsabilité de sa réponse » 497 . Le visage d’Autrui se révèle dans sa nudité et dans sa<br />
vulnérabilité. Il m’adresse un commandement : « tu ne tueras point ». Je suis consacré à<br />
l’Autre, en obligation à son égard ; mon existence est « pour autrui ». D’ailleurs la «<br />
subjectivité » chez Levinas est ouverture à Autrui, appel à répondre de l’Autre, « expiation »<br />
pour Autrui. La responsabilité est quelque chose qui s’impose à moi et malgré moi à la vue du<br />
visage d’Autrui, elle est le passage au désintéressement : passage de l’égoïsme à la bonté.<br />
Ainsi, endosser la charge de l’Autre sur soi, c’est être bon. La responsabilité n’est pas dans un<br />
calcul, dans un quelconque contrat pédagogique entre Élève et Enseignant, car pour Levinas<br />
l’Enseignant est toujours plus responsable que les autres. Il est selon les termes de Fiodor<br />
Dostoïevski, « coupable de tout et de tous devant tous » 498 , il est totalement responsable et<br />
auteur de tout le mal qui peut survenir en situation de classe. L’enseignement éthique doit<br />
donc précéder tout enseignement, car c’est uniquement par l’éthique que la société parviendra<br />
à un autrement qu’être pédagogique.<br />
L’éthique suppose que l’être humain se mesure à l’Infini 499 . L’idée de l’infini va au-delà<br />
de la pensée, elle se pose comme ce qui reste toujours extérieure à la pensée, c’est le principe<br />
de tout jugement et de toute « vérité objective » : « l’idée d’infini, c’est l’esprit avant qu’il<br />
s’offre à la distinction de ce qu’il découvre par lui-même et de ce qu’il reçoit de l’opinion<br />
» 500 . La relation avec l’Infini ne peut pas s’expliquer de façon empirique ou en « termes<br />
d’expériences objectives », parce que l’infini au-delà de la pensée qui le pense. L’expérience<br />
495 Idem, Entre nous. Essais sur le penser-à-l'autre, op cit., p.11<br />
496 « L’enfer c’est les autres » Sartre, Huis clos, Gallimard, 18 février 2000<br />
497 Simone Plourde, Emmanuel Levinas, Altérité et responsabilité, Ed. du Cerf, Paris, 1996, p. 22<br />
498 Fiodor Dostoïevski, Les Frères Karamazov, traduction d’Ely Halpérine-Kaminsky et Charles Morice, 1888,<br />
Livre VI/II. « Les Frères Karamazov (en russe : Братья Карамазовы) est le dernier roman de l'écrivain russe<br />
Fiodor Dostoïevski. Il a été publié sous forme de feuilleton dans le magazine Ruskii Vestnik (Le Messager russe)<br />
de janvier 1879 à novembre 1880. Les Frères Karamazov est un roman philosophique qui explore des thèmes<br />
tels que Dieu, le libre arbitre ou la moralité. Il s'agit d'un drame spirituel où s'affrontent différentes visions<br />
morales concernant la foi, le doute, la raison et la Russie moderne. » Cf.<br />
fr.wikipedia.org/wiki/Les_Frères_Karamazov<br />
499 Levinas, Totalité et Infini, op cit., pp.82-83.<br />
500 Ibid., p. XIII<br />
124
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
se présente comme le rapport avec ce qui dépasse continuellement la pensée. C’est donc par<br />
la relation avec l’Infini que se réalise le plus haut degré de l’expérience.<br />
La responsabilité éthique est une responsabilité de l’idée de l’Infini telle qu’elle s’exprime<br />
en l’Autre. Dans l’antiquité Socrate, enseignant de vertu, provoque et encourage le<br />
questionnement éthique 501 sans toutefois répondre, car ce serait céder à la propension égotiste<br />
de la réduction de l’Autre au Même et ne faire des enseignés que de pâles reflets de lui-même.<br />
Il n’est nullement question de tuer ses Élèves en tant qu’Autres, mais de répondre au<br />
commandement : « tu feras vivre ton prochain » 502 . La responsabilité de l’Enseignant est de<br />
ce fait simultanément double: en tant qu’être humain, il est responsable de l’Autre et de sa<br />
pérennité en tant qu’autre homme, et en tant que Maître, il est responsable de « la<br />
transmission de l’intransmissible » ou plus précisément de l’éveil de l’esprit de son Élève à<br />
l’idée de l’Infini. Décidément, transmettant l’intransmissible, c’est la responsabilité, inhérente<br />
à l’idée d’Infini, ou de préférence un appel à la responsabilité qui est transmise à l’enseigné.<br />
Néanmoins il faut souligner que la mission de l’Enseignant en situation pédagogique se limite<br />
dans l’émission de l’appel, la manière dont l’enseigné décidera d’y répondre, la manière dont<br />
l’enseigné estimera d’assumer cette responsabilité ne revient qu’à lui et non au Maître.<br />
En fait, en situation pédagogique la responsabilité incombe exclusivement au Maitre.<br />
L’enseignant est le seul et unique coupable en matière pédagogique. Il est coupable de tout et<br />
de la manière la plus extrême. La véritable responsabilité pour l’Autre chez Levinas précède<br />
et assiège une liberté qui, sans elle, n’aurait aucun visage. La pure liberté se voit en<br />
conséquence rénovée, corrigée, agitée, c'est-à-dire troublée par une responsabilité illimitée<br />
pour l'autre homme. Il est nécessaire de noter que le primat de la responsabilité n'est exclusif<br />
de la liberté, uniquement dans la mesure où la liberté se manifeste toujours comme une liberté<br />
pour l’Autre. Cette liberté pour Autrui veut dire que l’Enseignant n’est pas libre parce qu’il<br />
ne se soucie pas de sa liberté, mais qu’il est libre parce qu’il s’engage pour l’Élève et cette<br />
liberté participe à son identité, en tant qu'elle est à comprendre comme être-pour-l’Eleve. Face<br />
à cette lourde tâche, l’Enseignant se doit d’être un éternel étudiant, il doit penser son<br />
amélioration, car « Vouloir, c’est prévenir le danger » 503 . Il doit perpétuellement penser<br />
l’avenir de ses Élèves, puisque « concevoir l’avenir, c’est pré-venir.» Il doit travailler afin<br />
501 Plusieurs passages des dialogues de Platon peuvent ici être cités, notamment : L’apologie de Socrate, 21c-e, p.<br />
33 ; Le Banquet, 214e, p. 91 ; Le Philèbe, 13c, p. 274 ; Ménon, 71d (trad. B. Piettre, Paris, Nathan, 2000) ;<br />
Gorgias, 447c (trad. M. Canto-Sperber, Flammarion (GF ; n° 465), Paris, 1987, p. 122).<br />
502 Levinas, Altérité et transcendance, Saint-Clément-la-Rivière, Fata Morgana, 1995, p. 135.<br />
503 Idem, Totalité et Infini, op cit., p.140<br />
125
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
d’ajourner son avilissement puisque « travailler, c’est retarder sa déchéance » 504 . Nous<br />
précisons en somme que la subjectivité, se constituant dans la mobilité même où à elle<br />
incombe la responsabilité pour l’Élève, va jusqu'à la substitution pour l’Autre. Toutefois, à<br />
quoi renvoie le concept de substitution dans la philosophie levinassienne et quel peut être son<br />
apport dans l’optique pédagogie ?<br />
2. De la substitution pour Autrui<br />
L’idée de substitution dans la pensée levinassienne n'est compréhensible et acceptable<br />
d’après Simonne Plourde, uniquement si elle résulte de « la créaturialité et de l'élection » 505 ;<br />
elle n'a de sens uniquement si elle renvoie à la sphère d'une subjectivité dont la singularité<br />
coupe à la base la tentation d’abroger son invitation à la responsabilité. Chez Levinas, la<br />
substitution est effectivement suspendue au « Dire créateur » 506 et, ainsi, elle renvoie à un<br />
type spécifique du langage, distinct de celui manifesté dans la relation intersubjective, parce<br />
que ce « Dire créateur », pensé d’après Levinas dans un temps qui détaché de tout souvenir,<br />
n'est pas émis dans une parole compréhensible, mais est perçue comme une expression du<br />
visage d'Autrui : « À travers le masque, écrit Levinas, percent les yeux, l'indissimulable<br />
langage des yeux. L'œil ne luit pas, il parle » 507 . Le message que l’œil communique dans son<br />
discours sans expression, c'est l’appel à l’interdiction au meurtre, discours de la nudité et de<br />
la vulnérabilité de l'autre homme. La réponse : « Me voici ! » que l'élection anime à la<br />
Subjectivité est un geste éthique relevant du seul Moi qui, en tant que Moi, n'est jamais<br />
interchangeable avec cet Autre qui lui fait face et dont il est responsable.<br />
Il existe à la base du concept de substitution, un fondement an-archique qui perturbe d’une<br />
manière absolue le concept d’être 508 . Anarchiquement, ce désordre corporel et de l’esprit est<br />
« obsession », c’est-à-dire caresse comme toucher et contact comme langage. Il faut<br />
néanmoins noter que caresser chez Levinas veut dire ne rien attraper, vouloir ce qui s’éloigne<br />
continument de sa « forme vers un avenir – jamais assez avenir – à solliciter ce qui se dérobe<br />
comme s’il n’était pas encore » 509 . L’individu ne peut signifier ce qu’il touche, encore moins<br />
ce qui le touche, et pourtant au centre de l’obsession d’Autrui le subir comme persécution<br />
504<br />
Ibid.<br />
505<br />
Plourde, « Emmanuel Levinas : une éthique déconcertante », Laval théologique et philosophique, vol. 55, n°<br />
2, 1999, p. 206<br />
506<br />
Concernant cette idée, voir Simonne Plourde, Emmanuel Levinas. Altérité et responsabilité. Guide de lecture,<br />
Paris, Cerf (coll. « La nuit surveillée »), 1996, p. 141-147.<br />
507<br />
Levinas, Totalité et Infini, op cit., p.38<br />
508<br />
Idem, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, op cit., p. 200.<br />
509 Idem, Totalité et Infini., op cit., p.235<br />
126
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
assume déjà pleinement l’Autre. Etre en soi, c’est être perturbé dans son corps, une façon<br />
extrême d’être exposé. Dans la substitution, la passivité de la subjectivité sous-tend un<br />
individu «qui n’a jamais pu [eu à] s’écarter de soi pour rentrer ensuite dans ses limites et pour<br />
s’identifier en se reconnaissant dans son passé, mais dont la [récurrence est ma] contraction<br />
est [,] une allée en deçà de l’identité [rongeant cette identité même –identité se rongeant– dans<br />
un remords] » 510 .<br />
Hanté par une responsabilité qu’il n’aurait certainement pas assurée en son temps, Levinas<br />
soumet sa propre liberté au fait de la fraternité humaine. Pour lui, le «c’est comme ça» ou le<br />
«je n’ai rien fait» n’entrent en cause. La responsabilité chez Levinas, comme nous ne cessons<br />
de le dire dans ce travail, n’est nullement l’effet d’un engagement autonome suite à une<br />
situation dans laquelle le Maître pourrait être en relation causale avec l’Élève, car exister<br />
même, être en vie c’est déjà être en cause, c’est-à-dire responsable de ce qui survient à<br />
l’Autre.<br />
La substitution n’est pas un acte, mais tout le contraire de l’acte, c’est la<br />
passivité inconvertible en acte, l’en deçà de l’alternative acte-passivité [...].<br />
Non-être c’est porter la charge de la misère et de la faillite de l’autre et<br />
même la responsabilité que l’autre peut avoir de moi : être «soi», c’est<br />
toujours avoir un degré de responsabilité de plus. La responsabilité pour<br />
autrui est peut-être l’événement concret que désigne le verbe «non-être»<br />
quand on veut le distinguer du néant et du produit de l’imagination<br />
transcendantale 511 .<br />
L'idée de la substitution fait référence au fardeau écrasant de la responsabilité. Si la<br />
subjectivité est fragile, sensible et passivité, sa responsabilité ne peut se traduire que dans un<br />
‘’se donner’’. C'est un ‘’se donner’’ qui est supplice, subjectivité-otage, une bonté malgré<br />
elle, et ouverture à une irréfutable responsabilité. Dans l'idée de substitution, le Maître est<br />
invitée à aller au-delà du destin étroit et égotiste de celui qui n'est que pour lui. Le Maître<br />
n’est pas asservie, mais il demeure otage, destitué malgré lui, vidé de sa liberté totalisante et<br />
exclu de l'être, mais dans son corps 512 . L’idée de substitution est totalement étrangère à<br />
l'ontologie qui commence et se termine dans l'être, dans l’esprit du Maître.<br />
La substitution évoque l’idée d’une relation intersubjective asymétrique. Elle insère le<br />
Maître dans une responsabilité qui humainement l'incombe et qu'il ne saurait décliner.<br />
Autrement dit, le Maître devient un moi non interchangeable, puisque son être est et existe<br />
510 Levinas, « La substitution », in Revue Philosophique de Louvain, n° 66, 1968, p.499<br />
511 Ibid., p.502 ; Voir également Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, pp.185-186.<br />
512 Plourde, Emmanuel Levinas, op cit., p. 77.<br />
127
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
exclusivement dans la mesure où il est responsable. Cette responsabilité qu'on peut désigner<br />
par l’expression responsabilité de soi dans l'obsession, est en défaillance : « sa récurrence fait<br />
éclater les limites de l'identité, le principe de l'être en moi, l'intolérance repose en soi. Elle est<br />
responsabilité du moi pour ce que le moi n'avait pas voulu, c'est-à-dire pour les autres » 513 .<br />
Cette anarchie est comme nous l’avons dit une passivité endurée dans la proximité, par ce<br />
que, par delà la mouvance normal de l'acte et de la passion où se fixe l'identité de l'être, en<br />
deçà des frontières de l'identité, l'ipséité dans la passivité sans le principe initial de l'identité<br />
est otage.<br />
Dans cette substitution dans laquelle l'identité se renverse asymétriquement, passivité plus<br />
passive que toute passivité, par-delà l'identique, le soi se délie du soi. Il s'agit d'une liberté<br />
différente de celle de la volonté, c'est-à-dire « le pardon » qui, par la substitution aux élèves,<br />
échappe au rapport avec ces derniers. En conséquence, l'Autre en tant qu’Élève n'est plus<br />
rivalité mais il est maintenu par ce qu'il rivalise. Le Maître peut se substituer à tous ses élèves,<br />
mais personne parmi eux ne peut se substituer à lui. C’est cette perspective que Dostoïevski<br />
évoque dans son idée de responsabilité infinie 514 .<br />
Au total, l’idée de substitution désigne paradoxalement le sens extrême de la<br />
responsabilité éthique. Elle nous insère malgré nous dans une passivité qui est assimilable à<br />
une « an-archie » 515 , qui s’énonce exclusivement de manière éthique. S’il faut le dire au sens<br />
pédagogique, elle introduit le Maître dans une situation d'otage, qui paradoxalement s'inscrit<br />
dans un désir provoqué par l'appel de l'Élève, avec lequel bien qu’étant séparé, s'est effectuée<br />
une relation par le langage.<br />
III. Le vivre ensemble : Fraternité et Paix<br />
Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, l’humanité se trouve devant le difficile<br />
challenge de réaliser d’une manière novatrice l’unité et l’harmonie entre les hommes sur la<br />
base d’une pluralité. À la conclusion de Totalité et Infini, Emmanuel Levinas pense l’idée de<br />
paix et il la considère comme le socle constitutif de la structure d’un Etat lié à une telle œuvre.<br />
La paix éthique – paix de l’altérité – est la condition sine qua non d’un être qui va vers<br />
l’Autre, dans son unicité et son irréductibilité. L’humain inclut l’idée d’humanité. Le concept<br />
513<br />
Levinas, La substitution, in Revue philosophique de Louvain, Tome 66, 1968, p. 500<br />
514<br />
Dostoïevski : « Nous sommes tous responsables de tout et tous devant tous, et moi plus que tous les autres ».<br />
Cité par Levinas dans Ethique et infini, p. 98.<br />
515<br />
Le concept d’« an-archie » chez Levinas renvoie à ce qui est en deçà de toute origine et excède l’économie du<br />
Même.<br />
128
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
d’homme ne saurait se réduire à la singularité du Même. L’homme n’est réellement à part,<br />
« non-englobable », que dans le visage où il est capable de « porter secours » à sa propre<br />
présentation 516 . Aimer l’Autre c’est craindre pour sa personne et porter secours à sa<br />
vulnérabilité. « L’amour vise Autrui, il le vise dans sa faiblesse. […] Aimer, c’est craindre<br />
pour autrui, porter secours à sa faiblesse » 517 . Etre bon envers Autrui n’équivaut pas à une<br />
liberté sans équivoques mais à l’absolu commandement de se tenir en toute franchise en<br />
présence de l’Autre. « Le moi en tant que moi se tient donc tourné éthiquement vers le visage<br />
de l'autre – la fraternité est la relation même avec le visage où s’accomplit à la fois mon<br />
élection et l’égalité, c’est-à-dire la maîtrise exercée sur moi par l’Autre » 518 . L’élection du<br />
moi, son identité même, s’expose comme prérogative et dépendance – puisqu’elle ne<br />
s’installe pas parmi les autres « élus », mais exactement « en face d’eux », pour les « servir »<br />
et que nul ne peut se changer en lui pour évaluer l’ampleur de ses « responsabilités ».<br />
Garantie par l’Etat, la paix ne saurait être le seul fait de la fin des combats, des couvre-<br />
feux, voire des honneurs accordés aux soldats. La paix ne se laisse pas comprendre par les<br />
jardins de mémoire ou les empires universels. Elle n’est ni bonne conscience ni relâchement<br />
du soldat. La paix est « déracinement ». Socialité originelle, sa constance est dans une justice<br />
« qui me juge et non pas dans l’amour qui m’excuse » 519 .<br />
Toute parole est déracinement. Toute institution raisonnable est déracinement.<br />
La constitution d’une véritable société est un déracinement – le terme d’une<br />
existence où le ‘chez soi’ est absolu, où tout vient de l’intérieur. Le paganisme<br />
– c’est l’enracinement, presque au sens étymologique du terme. L’avènement<br />
de l’Ecriture n’est pas la subordination de l’esprit à la lettre, mais la<br />
substitution de la lettre au sol. L’esprit est libre dans la lettre et il est enchaîné<br />
dans la racine. C’est sur le sol aride du désert où rien ne se fixe, que le vrai<br />
esprit descendit dans un texte pour s’accomplir universellement 520 .<br />
Le « déracinement », la suppression de toute concupiscence, le Désir de l’au-delà est<br />
source de paix. La paix se lit dans la faiblesse, elle est présence perpétuelle du dialogue et<br />
avènement de la pluralité – ouverture à l’extériorité – relation avec le visage qui se produit<br />
comme bonté, car l’homme authentique est Désir et Bonté - voué à l’extériorité.<br />
« L’extériorité de l’être c’est la pluralité elle-même » 521 qui se réalise en un exister multiple.<br />
L’existence sociale suppose une multiplicité de tiers et une soumission ontologique à l’égard<br />
516<br />
Levinas, Totalité et Infini, op cit., p.274<br />
517<br />
Ibid., p.233<br />
518<br />
Ibid., p.256<br />
519<br />
Ibid., p.281<br />
520<br />
Idem, Difficile liberté, op cit,, p.183<br />
521<br />
Idem, Totalité et Infini, op cit., p.278<br />
129
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
du tiers. Le délit sociale se réalise à l’insu de l’individu et se traduit dans le préjudice causé<br />
plutôt que dans « l’irrespect ». La véritable société est fondée sur une morale du « respect ».<br />
Elle tient compte qu’un tiers assiste estropié au « dialogue amoureux » : « amour du prochain<br />
au hasard de la proximité, et, par conséquent, amour d’un être au détriment d’un autre,<br />
toujours privilège, même s’il n’est pas préférence » 522 . Être vigilant et porté vers Autrui<br />
suppose un excédent de conscience à l’appel de l’Autre : conscience des droits de l’Autre<br />
homme et de sa propre responsabilité en tant qu’individualité.<br />
L’histoire de l’humanité est traversée par l’existence de guerres et de combats sans fin. Il<br />
n’existe pas une seule période dans l’histoire où la guerre est absente. Tout se passe comme<br />
si, décidément, la guerre, synonyme d’horreurs de batailles ensanglantés et d’en-sauvagement,<br />
ne pouvait ne pas avoir lieu. On assimile généralement dans l’espace politique quelques<br />
périodes de trêve à la paix. Mais, une telle conception de la paix doit formellement être remise<br />
en cause puisqu’elle sous-tend en fait que la guerre est inévitable et de ce fait rendrait<br />
impossible l’accomplissement de la paix. C’est pourquoi, Emmanuel Levinas dans Totalité et<br />
Infini, souligne que la paix ne peut s’identifier à la fin des conflits qui s’arrêtent faute de<br />
soldats, ni par la « par la défaite des uns et la victoire des autres, c'est-à-dire avec les<br />
cimetières ou les empires universels futurs. La paix doit être ma paix, dans une relation qui<br />
part d’un moi et va vers l’Autre, dans le désir et la bonté où le moi, à la fois se maintient et<br />
existe sans égoïsme » 523 . La paix est le résultat d’une relation métaphysique réussite. Elle<br />
s’accomplit comme exister pluriel, car d’après Levinas « c’est l’unité de la pluralité » 524 qui<br />
constitue la paix et non la cohésion d’éléments formant la pluralité. La paix impose une<br />
relation avec Autrui, c'est-à-dire un dialogue entre des peuples ayant un destin socialement<br />
commun. Le langage dont l’essence est dans la relation avec Autrui est donc indispensable, il<br />
est la source même de tout compromis. La paix est celle d’un Moi dans sa direction vers<br />
l’Autre, elle est offrande, donation au sens éthique.<br />
La Paix est Désir de l’Autre dans le dialogue, car « l’essence du langage est bonté, […]<br />
amitié et hospitalité » 525 . C’est exclusivement par le langage que des êtres séparés peuvent<br />
être en relation, et également demeurer absolus dans ce rapport, sans supprimer cette<br />
séparation qui consiste à la réduire à l’unité d’une totalité, d’un genre, d’un thème, d’un<br />
monde, d’un concept. L’humanité qui nous observe dans les yeux de l’Autre n’est pas<br />
522<br />
Levinas, Entre nous. Essais sur le penser - à - l’autre, op cit., p. 31.<br />
523<br />
Ibid., p.283<br />
524<br />
Idem, Totalité et Infini, op cit., p.283<br />
525 Ibid., p.282<br />
130
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
aphasique, c’est plutôt une humanité fraternelle et qui parle. C’est précisément cette humanité<br />
qui est enseignée et présente dans la prescription de l’Etranger. « La communauté humaine<br />
qui s’instaure par le langage » 526 est celle que proclame la relation à l’Etranger, non pas<br />
comme prophétie d’un instant futur, puisque cette déclaration ne se produit pas dans le temps<br />
linéaire de la subjectivité et de l’histoire, dans lequel l’avenir est accessible à partir du<br />
présent, mais comme notification d’un temps déjà présent et ouvert dans le visage de l’’Autre<br />
et dans son « commandement », bien que la conscience et l’histoire ne l’ont pas encore<br />
acquise. C’est dans cette optique que la parole de l’Etranger qui se manifeste dans son visage<br />
et, qui permet la communauté humaine du langage, est :<br />
[…] non seulement la mise en question de ma liberté, l’appel venant de l’Autre<br />
pour m’appeler à la responsabilité, non seulement la parole par laquelle je me<br />
dépouille de la possession qui m’enserre, en énonçant un monde objectif et<br />
commun ; mais aussi la prédication, l’exhortation, la parole prophétique. La<br />
parole prophétique répond essentiellement à l’épiphanie du visage, double tout<br />
discours, non pas comme un discours sur des thèmes moraux, mais comme<br />
moment irréductible du discours suscité essentiellement par l’épiphanie du<br />
visage en tant qu’il atteste la présence du tiers, de l’humanité tout entière, dans<br />
les yeux qui me regardent 527 .<br />
En fait, toute relation sociétale, comme une dérivée, remonte à l’exposition de l’Autre au<br />
Même, sans aucun médiateur d’image ou de symbole, par la seule manifestation du visage.<br />
L’essence de la société se dissout si on l’assimile au « genre » qui joint les êtres analogues.<br />
Certainement, il existe une espèce humaine comme espèce biologique commune à tous les<br />
hommes. Cependant la société humaine qui se fait par le langage dans lequel les interlocuteurs<br />
demeurent radicalement séparés – ne constitue pas « l’unité du genre ». Elle manifeste plutôt<br />
la « parenté des hommes ». Mais il faut souligner que la parenté des hommes chez Levinas ne<br />
se traduit ni par « la ressemblance », ni par l’effet d’une relation causale. La paternité ne<br />
renvoie pas à un rapport de cause à effet auquel les hommes collaboreraient inexplicablement<br />
et qui signifierait, par une non moins secrète conséquence, un fait de dépendance mutuelle.<br />
C’est plutôt :<br />
526 Ibid., p.189<br />
527 Ibid., p.188<br />
Ma responsabilité en face d’un visage me regardant comme absolument<br />
étranger – et l’épiphanie du visage coïncide avec ces deux moments – qui<br />
constituent le fait originel de la fraternité. La paternité n’est pas une<br />
131
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
causalité : mais l’instauration d’une unicité avec laquelle l’unicité du père<br />
coïncide et ne coïncide pas 528 .<br />
La non-concordance désigne, exactement, dans ma posture comme frère, comprend<br />
d’autres « unicités de mes cotés », de telle manière que « mon unicité de moi résume »<br />
simultanément « la suffisance de l’être comme visage ». Dans cette réception ou bienvenue du<br />
visage - qui demeure déjà dans ma responsabilité envers Autrui et où, il me contact à partir<br />
d’une sphère élevée dans laquelle il me commande – s’établit « l’égalité ». Autrement dit,<br />
« l’égalité, d’après Levinas, se produit là où l’Autre commande le Même et se révèle à lui<br />
dans la responsabilité » ; sinon l’égalité n’est simplement qu’un concept intellectuelle. On ne<br />
saurait la séparer de « l’accueil du visage dont elle est un moment » 529 .<br />
« Le monothéisme », d’après Levinas, désigne « cette parenté humaine, cette idée de race<br />
humaine qui remonte à l’abord d’autrui dans le visage, dans une dimension de hauteur, dans la<br />
responsabilité pour soi et pour autrui » 530 . Être avec les autres, c’est être en famille, c’est être<br />
perpétuellement responsable de l’Etranger et du tiers. Le vivre ensemble ou vivre-avec chez<br />
Levinas se traduit donc dans une relation de face-à-face, dans une relation fraternelle, dans<br />
une relation d’otage, dans l’asservissement et le sacrifice de soi pour les autres. La paix que<br />
l’humanité recherche tant passe nécessairement par l‘enseignement de l’éthique, car cette<br />
dernière par delà toute certitude manifeste la structure de l’extériorité même. Seulement,<br />
l’éthique chez Levinas désigne la ‘’philosophie première’’, par conséquent, « la morale n’est<br />
pas une branche de la philosophie, mais la philosophie première » 531 . Par cette conception<br />
Levinas opère une révolution fondamentale au sein de la philosophie, car ici l’être n’est plus<br />
premier comme chez les classiques, il n’a plus un statut de fondation ; mais, au contraire, la<br />
philosophie première est métaphysique parce qu’elle concerne l’Autre de l’être, c’est-à-dire<br />
Autrui, parce qu’il est plus important que tout, moi y compris.<br />
En fait, vivre ensemble chez Levinas, c’est vivre en face de l’Autre, c’est se vouer à<br />
Autrui, c’est se sacrifier pour l’humanité, c’est préférer l’Autre plutôt que soi, c’est accepter<br />
la pluralité dans son entière diversité. La séparation du Même est un événement éthique, car<br />
« l’humanité, comme le dit Ella, n’est pas monocolore, monoraciale, monoethnique,<br />
528 Ibid., p.189 - voir aussi p.255<br />
529 Ibid., p.189<br />
530 Ibid., p.190<br />
531 Ibid., p.281<br />
132
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
monoreligieuse ou monopolitique » 532 . Cette conception phénoménologique se confirme par<br />
l’expérience quotidienne, qui est en fait une expérience descriptive. Au quotidien, nous<br />
rencontrons des individus différents par leur couleur, leur race, leurs pensées politiques ou<br />
leur appartenance religieuse. La différence est le fait fondamental qui spécifie les hommes<br />
dans la mesure où nous ne pouvons pas penser de la même façon, croire aux mêmes choses,<br />
encore moins avoir exactement les mêmes yeux ou le même regard. Ces dissemblances ne<br />
sont pas seulement source de fécondité pour l’humanité, mais aussi la preuve que le Même en<br />
tant que tel ne peut vivre sans l’idée qu’il y ait Autrui dans son altérité radicale. Que cette<br />
altérité qui se révèle dans le visage d’Autrui soit là, s’impose inévitablement à nous et<br />
s’affirme d’une importance capitale. Si les droits de l’Homme malgré ses carences essayent<br />
d’établir l’égalité de tous, l’éthique levinassienne, quant à elle, instaure l’inégalité dans une<br />
sorte de « relation asymétrique », c’est-à-dire que la priorité ici n’est pas accordée au Même,<br />
mais à l’Autre.<br />
L’autrement que selon le mode de l’être que nous avons exposé dans ce texte se traduit par<br />
une innovation majeure qui porte toute l’attention sur l’Autre. Bouleversement ontologique,<br />
déracinement de l’être par l’irruption du visage d’Autrui. L’autrement qu’être conduit au droit<br />
de l’Autre homme plutôt qu’aux droits de l’homme. La spécificité de l’idée des droits<br />
d’Autrui en situation pédagogique se traduit par le fait que seul l’Élève a des droits, le Maître<br />
n’a que des devoirs, ou que, d’après Levinas, « tous les devoirs m’incombent à moi [Maître],<br />
tous les droits d’abord dus aux autres [élèves] » 533 et à l'avenir l’inverse devient éphémère.<br />
Toute intervention pédagogique doit donc avoir pour but ultime la transmission de l’idée de<br />
fraternité, d’amour et de crainte pour Autrui.<br />
532 Ella, « Des droits de l’homme aux droits de l’autre homme », in Conférence prononcée au Groupe de<br />
Recherches et d’Etudes Epistémologiques, à la Maison d’Auguste Comte, sise 10 rue Monsieur-le-Prince, Ier<br />
étage, 75006 Paris<br />
533 Levinas, Hors Sujet, Fata Morgana, coll. « biblio/essais », Montpellier, 1987, p. 119.<br />
133
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Conclusion partielle<br />
La réflexion émise dans cette partie avait pour dessein de dégager la valeur pédagogique<br />
de l’altérité. Pour mieux étayer nos propos, nous avons articulé notre discours sur deux<br />
chapitres, le premier « Enseignement et Extériorité », et le second « Autrement que selon le<br />
mode de l’être ».<br />
Dans le premier chapitre, il était question pour nous de réfléchir sur le rapport entre<br />
enseignement et extériorité, il s’agissait plus précisément de réfléchir sur la nature et l’origine<br />
de l’enseignement. Cette étude nous a permis de constater que la condition première de tout<br />
enseignement chez Levinas, c’est l’altérité. Enseigner ou être enseigné, c’est faire face à un<br />
homme, au visage d’Autrui, à l’altérité enseignante du Maître, « avoir un sens, c’est enseigner<br />
ou être enseigné, parler ou pouvoir être dit » 534 . L’enseignement chez Levinas est magistral et<br />
c’est uniquement l’altérité du Maître qui enseigne, de ce fait nul ne peut ontologiquement<br />
s’auto enseigner, car l’enseignement est relation avec l’extériorité, relation dans laquelle<br />
l’Élève reçoit la nouveauté, c’est-à-dire l’idée de l’Infini transmise par le Maître. La présence<br />
du Maître est fructueuse puisqu’elle permet de briser « la sorcellerie anarchique des faits » 535<br />
et rend le monde « objet». Par la parole, le Maître reprend ce qui fut simplement jeté,<br />
actualise et éclaire ce qui fut opaque dans le dit. L’enseignement est langage, il résulte<br />
exclusivement du discours magistral exposé par le Maître et non du discours exposé dans les<br />
œuvres, car « l’évènement propre de l’expression consiste à porter témoignage de soi en<br />
garantissant ce témoignage » 536 . Cette affirmation de soi, se manifeste exclusivement comme<br />
« visage, c’est-à-dire comme parole » 537 or les œuvres n’ont pas de visage. L’enseignement<br />
chez Levinas se fait dans une relation sujet – sujet ou Maître – Élève, relation dans laquelle<br />
l’Élève est enseigner par le Maître, par conséquent l’enseignement ne se fait pas dans la<br />
relation objet – sujet ou œuvres - Élève, parce que les œuvres n’expriment pas l’être, elles le<br />
symbolisent uniquement. D’ailleurs à partir de l’œuvre, précise Levinas, l’être «est déduit et<br />
déjà mal entendu, trahi plutôt qu’exprimé » 538 . La présence du Maître est le premier acte de<br />
tout enseignement. Enseigner, c’est offrir ses connaissances au autres, c’est donner ce que<br />
l’on possède à Autrui dans une relation de face-à-face et asymétrique, et cet acte n’est<br />
possible que par le langage réalisé entre des êtres absolument séparés.<br />
534 Levinas, Totalité et Infini, Op. Cit, p.70<br />
535 Ibid., p.72<br />
536 Ibid., p.176<br />
537 Ibid.<br />
538 Ibid., p.151<br />
134
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Dans le deuxième chapitre, nous avons mis en exergue un certain nombre de problèmes<br />
qui surgissent dans les situations de classe, plus précisément le dégagement égotiste des<br />
interlocuteurs qui conduit généralement à l’en-saignement plutôt qu’à l’enseignement. Notre<br />
objectif ici était d’évaluer les voies de possibilité d’un autrement qu’être pédagogique.<br />
Comme le fait ressentir le titre de ce deuxième chapitre, il était question de faire ressortir la<br />
substance pensante qui se dégage dans la pensée levinassienne, substance ayant pour dessein<br />
de permettre à l’enseignant d’être authentiquement pédagogique, cependant ceci ne veut<br />
aucunement dire que l’enseignant doit être autrement ou qu’il doit se comporter autrement en<br />
situation de classe, l’enseignant doit être plutôt autrement que selon le mode de l’être, c’est-à-<br />
dire être éthiquement correct. Cette tâche herculéenne implique de nombreux sacrifices, mais<br />
pas des sacrifices d’êtres humains car Levinas est contre le meurtre, il s’agit de « l’expiation »<br />
volontaire de soi pour Autrui. Ceci dit l’autrement qu’être pédagogique ne s’adresse pas à<br />
l’Élève, il s’adresse exclusivement au Maître, car chez Levinas c’est ce dernier qui est<br />
l’unique responsable et de ce fait coupable de toutes les dérives qui peuvent survenir en<br />
situation de classe. Le Maître est responsable des élèves de manière infinie, accepter d’être<br />
enseignant, c’est accepter d’être « l’otage » et « l’hôte » de l’Autre. L’enseignement chez<br />
Levinas n’est donc pas un jeu, il s’agit d’une situation traumatique et parfois persécutante<br />
mais éthiquement correct, car ici l’enseignant se fait violence pour le bonheur des autres, il<br />
s’agit d’un évènement qui se traduit par l’expression « non-être » 539 . Le pédagogiquement<br />
« non-être » signifie que le processus d’ontologisation du Maître n’est pas encore achevé, il<br />
suppose une ouverture métaphysique dans laquelle le Maître endosse sur lui « la charge de la<br />
misère et de la faillite » de l’Élève et même la responsabilité que l’Élève peut lui devoir. Le<br />
pédagogiquement « non-être » renvoie au « être ‘’soi’’ », c’est-à-dire avoir perpétuellement<br />
un degré de responsabilité de plus par rapport à l’Élève. La relation entre élève et professeur<br />
se réalise uniquement sous le prisme de la responsabilité, responsabilité verticale, non<br />
réciproque et exclusivement articulée sur le Maître qui est commandé par le pouvoir qui le<br />
commande de commander, pouvoir absolu qui le contraint de répondre à l’appel des élèves<br />
par le « me voici », je suis là, près de vous et disposé à vous servir !<br />
539 Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, op cit., pp.185-186.<br />
135
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
CONCLUSION GENERALE<br />
Poser l’être comme Désir et comme bonté, ce n’est<br />
pas isoler au préalable un moi qui tiendrait ensuite<br />
vers un au-delà. C’est affirmer que se saisir de<br />
l’intérieur – se produire comme moi – c’est se saisir<br />
par le même geste qui se tourne déjà vers l’extérieur<br />
pour extra-verser et manifester – pour répondre de ce<br />
qu’il saisit – pour exprimer ; que la prise de<br />
conscience est déjà langage ; que l’essence du<br />
langage est bonté, ou encore, l’essence du langage est<br />
amitié et hospitalité.<br />
136
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Emmanuel Levinas, Totalité et Infini. Essai sur<br />
l’extériorité, Deuxième édition, Martinus Nijhoff, La<br />
Haye, 1965, p.282<br />
L’engagement dans l’histoire de la philosophie et plus précisément dans l’histoire de la<br />
philosophie occidentale à l’égard du problème de « l’aso-ciation » par le langage, et encore<br />
plus à l’égard de ce que l’on pourrait appeler la protection authentique des individualités du<br />
Même et de l’Autre, nous a introduit dans une complexité opaque dans laquelle il nous a paru<br />
important de repenser l’impensé de la relation intersubjective. Activité herculéenne, mais<br />
indispensable pour l’avènement d’un monde humainement viable. C’est grâce aux textes<br />
d’Emmanuel Levinas et plus particulièrement de Totalité et Infini que nous avons pesé les<br />
différents aspects du rapport à l’Autre, entre différence et identité, ce qui nous a permis de<br />
mettre en évidence la problématique de l’altérite.<br />
La question de l’altérité fait problème dans l’histoire de la philosophie parce qu’elle<br />
renvoie chez Emmanuel Levinas à l’extériorité, à la révélation de « l’être » 540 dans le langage<br />
et le visage en tant que manifestation de cette extériorité, ne correspond pas à une image ni à<br />
une intuition, il ne le devient jamais. Comme le souligne Levinas, « ce qui est spécifiquement<br />
visage, c’est ce qui ne s’y réduit pas », et ainsi ce « visage est sens à lui seul. Toi, c’est toi. En<br />
ce sens, on peut dire que le visage n’est pas ‘’vu’’. Il est ce qui ne peut devenir un contenu,<br />
que votre pensée embrasserait ; il est l’incontenable, il vous mène au-delà » 541 . Autrui dans<br />
son visage transcende le Même, de telle sorte que la relation qui s’établit entre eux demeure<br />
séparation et non proprement comme une totalisation de l’altérité par le Même. L’expression<br />
du visage, à travers laquelle l’Autre se révèle à moi, manifeste « l'expérience de quelque<br />
chose d'absolument étranger, expérience pure qui me fait sortir de l'expérience, « traumatisme<br />
de l’étonnement » 542 . L’altérité en tant qu’Autre renvoie au « mystère », à « l’In-connu », à<br />
quelque chose venu « d’ailleurs » et que malgré tout, nous devons être en relation. La<br />
difficulté majeure qui secoue l’histoire de la philosophie est que dans le texte intitulé « Le<br />
visage et l’extériorité » 543 , Levinas fait ressortir, sur le fond des stratégies de la nécessité du<br />
540 Levinas, Totalité et Infini, Op cit., p.266<br />
541 Idem, Éthique et Infini, Le Livre de poche, coll. «biblio essais », 1997, pp. 80-81.<br />
542 Idem, Totalité et infini, Op cit., p. 71<br />
543 Idem, « Le visage et l’extériorité», in Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, Le Livre de poche, coll.<br />
«biblio essais», 1998, p. 201-277.<br />
137
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
« passer à l’autre de l’être » 544 , la question de la rencontre d’Autrui. Levinas ouvre cette<br />
perspective parce qu’il constate que de Socrate à Heidegger, la philosophie par sa tournure<br />
ontologique a oublié l’Autre. Le tournant ontologique consiste non à admettre l’existence pure<br />
de l’Autre, mais à le réduire en l’introduisant dans la « Totalité ».<br />
Dans la « Totalité », l’Autre en tant qu’être Absolu n’y est pas, puisque l’altérité<br />
envisagée dans la « Totalité » arbore le statut de « neutre », d’impersonnel, d’aliéné, d’être<br />
aphasique et flottant parce que soumis à l’impérialisme du Même. Il n’existe pas à proprement<br />
parler d’altérité radicale dans la Totalité, car l’Être en tant que Même représente « l’Un » au<br />
sens plotinien, il est unique et indivisible. Simplement par le fait d’exister, nous faisons déjà<br />
partie de « l’Un », du Tout, de « l’Etre universel » ou de la Totalité : « […] tous les êtres,<br />
d’après Plotin, aspirent à l'unité, forment une unité, tendent à l'unité » 545 . L’existence se<br />
déploie ici comme le retour à « l’Un », à « l’Etre universel ». Le problème dans cette<br />
conception est que le désir n’est pas orienté vers l’Autre mais vers l’Etre, en conséquence,<br />
nous assistons à une forme d’inhumanité qui se traduit par l’oubli de l’Autre, puisque que tout<br />
est orienté vers l’Etre. La vie, comme cela apparait chez Hegel devient, l’unité du particulier<br />
et de l’universel. L’Autre n’est pas Absolu, car l’absolu suprême ici c’est l’Etre. L’éthique au<br />
sens levinassien n’est pas possible ici, car c’est le règne du chacun-pour-soi et de Dieu-pour-<br />
tous. L’égocentrisme, l’égotisme, l’égoïsme, le narcissisme sont exaltés et posés comme des<br />
valeurs suprêmes. Levinas s’oppose absolument contre cette conception égologique de<br />
l’existence, car d’après lui : « l’existence pour soi, n’est pas le dernier sens du savoir, mais la<br />
remise en question de soi, le retour vers l’avant soi, en présence d’Autrui. La présence<br />
d’Autrui – hétéronomie privilégiée – ne heurte pas la liberté, mais l’investie » 546 . La honte de<br />
son être, l’existence et le Désir d’Autrui, ne renvoient pas à la suppression de la connaissance<br />
puisque la connaissance est leur lien. « L’essence de la raison ne consiste pas à assurer à<br />
l’homme un fondement et des pouvoirs, mais à le mettre en question et à l’investir à la<br />
justice » 547 , justice qui implique la relation éthique avec Autrui et avec « le tiers ». L’un des<br />
544 Au fondement du fait d’être, il existe une manière d’être à l’Autre, de faire survenir l’étrangeté à soi comme si<br />
être, tout simplement, n’était pas s’engloutir en-soi-même, mais être part de l’autrement qu’être. Alors, « [s]i la<br />
transcendance a un sens, elle ne peut signifier que le fait, pour l’événement d’être – pour l’esse –, pour l’essence,<br />
de passer à l’autre de l’être. » cf. Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Le Livre de poche, coll. «<br />
biblio essais », 2001, p. 13.<br />
545 Plotin, Les Ennéades, VI, Livre V, « L'Etre Un et identique est partout présent tout entier », II. Tome III,<br />
Traduction française : M.-N. Bouillet, L. Hachette, Paris, 1857, p. 1<br />
546 Levinas, Totalité et Infini, Op. cit., p.60<br />
547 Ibid., p.61<br />
138
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
desseins de Totalité et Infini est de montrer que la relation avec l’Autre est plus importante<br />
que la relation avec l’être.<br />
L’être, d’après Levinas est extériorité 548 et « l’extériorité de l’être c’est la pluralité elle-<br />
même » 549 . Cependant, la pluralité dont parle Levinas ne fait pas référence aux êtres<br />
appartenant à un même genre, à une même espèce, ni à une même catégorie, cette pluralité<br />
évoque plutôt l’idée d’êtres dont le statut est d’être sans concept dans une relation également<br />
sans concept. C’est cette absence d’univers commun qui fait d’Autrui - « Etranger » ; étranger<br />
qui bouleverse le chez soi. Mais « Etranger » veut également dire libre 550 . La multiplicité ne<br />
peut s’accomplir que si les sujets conservent leur « mystère », uniquement si la relation qui les<br />
rassemble en pluralité n’est pas visible à partir de l’extérieur, mais évolue d’un sujet à un<br />
autre. Pourtant l’ontologie occidentale refuse totalement ce mouvement, puisque dans cette<br />
posture, les étants non seulement sont inconnus, ils ont également la capacité de se soustraire<br />
de l’autorité rationnel du Même. Pour dépasser cet obstacle dit « insécurisant », la philosophie<br />
occidentale s’est articulée dans une perspective ontologique qui consiste à réduire le Divers à<br />
« l’Un », réduction conceptuelle et cognitive ayant pour but de démystifier la structure<br />
ambivalente de l’Autre pour le connaitre afin de mieux le contrôler et le manipuler. Cette<br />
trajectoire occidentale est extrêmement violente aux yeux de Levinas car « posséder,<br />
connaître, saisir sont des synonymes du pouvoir » 551 , or ce qui fait que l’Autre soit autre c’est<br />
son mystère et profaner cet univers est synonyme de barbarie. Toute réduction de l’altérité,<br />
comme cela parait dans les philosophies de la totalité, manifeste non seulement l’oubli de<br />
l’Autre, mais également la violence contre l’autre homme. Face à cette posture éthiquement<br />
sauvage, Levinas opère une distance fondamentale.<br />
Cette séparation par rapport à la tradition occidentale trouve certainement sa source dans<br />
les pensées bibliques et hébraïques, à partir desquels il est possible de dédire la validité d'une<br />
théorie générale de l'être, prédominée par l’idée de « Totalité ». La « Totalité » est en effet<br />
source d'ensauvagement, en tant qu'elle refuse l'altérité ; tout doit infiniment se dissoudre dans<br />
le Même considéré comme un absolu comme cela apparait notamment dans la philosophie de<br />
« l’Esprit » hégélienne. Il est donc nécessaire d’opposer à la Totalité le principe d’altérité,<br />
mais celui-ci s’évade aux prises de la raison, qui se détermine par le fait qu'elle tend à<br />
548 Ibid., p.266<br />
549 Ibid., p.278<br />
550 Levinas, Totalité et Infini, Op. cit., p.9<br />
551 Idem., Le temps et l'autre, op. cit., p. 83 : « Si on pouvait posséder, saisir et connaître l'autre, il ne serait pas<br />
l'autre »<br />
139
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
identifier les dissemblances plutôt qu'à les accepter comme telles. La raison dans la<br />
philosophie levinassienne est de ce fait incapable de penser l'altérité, qui se révèle de manière<br />
singulière dans la relation métaphysique, c'est-à-dire dans une relation à Autrui, où l’Autre est<br />
reconnu, accueilli, hébergé et respecté. L’éthique levinassienne en redonnant sens à l’autre<br />
homme se révèle comme une véritable révolution copernicienne qui crée une déchirure entre<br />
le monde philosophique et celui des prophètes. L’être humain, c’est le sujet « de chair et de<br />
sang » qui se déplace, qui a conscience de soi et qui, dans le temps qui lui reste à vivre, essaye<br />
en conséquence d’éviter que de prévenir l’ensauvagement de l’humanité. L’humain chez<br />
Levinas est le domaine de l’éthique – l’origine 552 – et le commencement d’une « ouverture » à<br />
l’Autre dans la communication. « Le rapport à l’autre est socialité, l’origine de l’Entre nous,<br />
de l’Etre-entre-nous. » C’est pourquoi Levinas affirme « que l’être-entre-nous, à savoir, l’être<br />
séparé, est beaucoup plus que l’être-uni » 553 .<br />
La pensée de Levinas est une « critique de la totalité » 554 qui est survenue à la suite d’une<br />
violence politique qui a marqué le monde. Et cette expérience est celle de l’ensauvagement<br />
nazie 555 , violence contre l’autre homme qui a été motivé par la civilisation du plus avoir<br />
alimentée par les philosophies de la Totalité. La critique de la Totalité chez Emmanuel<br />
Levinas est en réalité une protection de la subjectivité. Contrairement aux exposés de Socrate,<br />
de Hegel, de Husserl et de Heidegger qui sont formellement rattachés à l’être, Levinas<br />
supplante l’ontologie par le métaphysique, activité qui permet de penser un autrement qu’être<br />
dans laquelle la subjectivité humaine n’est plus pensée dans la Totalité, mais comme<br />
extériorité absolue. C'est donc ce déracinement de l'être qui est le fil conducteur de la pensée<br />
levinassienne. Dans De l'existence à l'existant, Levinas oppose « la jouissance » à l'existence<br />
anonyme de Heidegger qu'il désigne par le concept de « l'il y a » - l’être en générale. Dans<br />
Totalité et Infini, il montre que la jouissance est le premier acte de la séparation et que par<br />
elle, la subjectivité est capable de survenir à un exister absolument autonome. Cependant, il<br />
laisse entrevoir qu’une existence exclusivement réduite à la jouissance ne permet pas au sujet<br />
de s’extraire complètement de la totalité ontologique du Même, c’est plutôt dans le langage -<br />
expression du visage d’Autrui dans son épiphanie - et la conscience morale que s’effectue la<br />
séparation définitive de la Totalité. La conscience morale permet donc au sujet d’effectuer<br />
552<br />
Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, op cit., p. 125.<br />
553<br />
A. Münster (dir.), La différence comme non-indifférence. Ethique et altérité chez Emmanuel Levinas, Paris<br />
1995, 140.<br />
554<br />
Idem., Éthique et infini, op cit., p.73<br />
555<br />
Dans Difficile liberté, Levinas affirme que sa vie a été « dominée par le pressentiment et le souvenir de<br />
l'horreur nazie », p. 406.<br />
140
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
« une expérience qui n’est à la mesure d’aucun cadre a priori – une expérience sans concept<br />
» 556 dans laquelle ma liberté est mise en question par l’Autre.<br />
La conscience morale d’après Levinas désigne l’accueille de l’Autre, accueil qui se réalise<br />
dans un une relation de « face-à-face » et asymétrique où le moi est mis en cause par l’Autre.<br />
Cependant, cette mise en cause du Même n'est pas une conscience de la mise en cause, elle<br />
n'est pas un exercice de la pensée, mais elle s’accomplit positivement face au visage d’Autrui<br />
qui « incarne l’interdit du meurtre », la protection de la vulnérabilité et la considération de<br />
l’Autre comme tel. Dans le rapport intersubjectif, l’individu n'est plus définit par son identité,<br />
mais par la relation qu'il entretient avec l'Autre, dans l’assomption de sa totale responsabilité.<br />
Le Même est responsable de l'Autre, quel qu'il soit, Autrui, la veuve, l’orphelin l'incombe et le<br />
regarde dans tout les sens possible. Levinas nous invite à faire preuve de compassion face à la<br />
vulnérabilité d’Autrui, à effectuer une critique profonde de Soi pour l’ouverture à Autrui, à<br />
réaliser un remodelage éthique de notre mode d’être, à quitter l’être-pour-soi pour l’être-pour-<br />
Autrui qui consiste à faire preuve de « Bonté » en faisant passer l’Autre avant soi, tout en<br />
étant capable de mourir pour les autres. La pensée levinassienne s’articule dans le don de Soi<br />
pour la survie d’Autrui – responsabilité infinie et irrécusable pour Autrui.<br />
Levinas dans Totalité et Infini nous invite au dialogue et à l’enseignement. Seulement<br />
l’enseignement chez lui n’est pas une sorte de dictature, une situation ontologique dans<br />
laquelle le Maître totalise l’Élève, mais « la présence de l’infini » faisant éclater le cercle clos<br />
de la totalité. « Le rapport avec Autrui ou le Discours, est un rapport non allergique, un<br />
rapport éthique, mais ce discours accueilli est un enseignement » 557 . Néanmoins il ne faut pas<br />
comprendre cette enseignement dans la sphère de la maïeutique socratique, mais comme une<br />
mobilité qui résulte de l’altérité enseignante du Maître et apporte à l’Élève plus que ce qu’il<br />
ne contient. L’enseignement n’est donc pas un retournement réflexif et ontologique sur soi<br />
dans lequel l’Élève s’enseigne soi-même, mais une ouverture à l’extériorité, rapport dans<br />
lequel l’Élève reçoit la nouveauté. Chez Levinas, seule l’altérité du Maître enseigne et c’est<br />
cet « […] enseignement de Moi par l’Autre [qui] crée la raison » 558 . L’originalité de la pensée<br />
levinassienne est que sur le plan pédagogique, elle s’articule exclusivement sur le Maître.<br />
L’enseignant est infiniment responsable des élèves et nul ne peut le remplacer dans cette<br />
tâche, il est l’unique coupable de toutes les dérives qui peuvent survenir en situation de classe.<br />
556 Idem,, Totalité et infini, op cit., p.74<br />
557 Levinas, Totalité et infini, op cit., p.22<br />
558 Ibid., p.229<br />
141
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Levinas nous invite a une prise de conscience, activité qui nous permettra de « pré-venir »<br />
l’instant d’inhumanité. Et être conscient, c’est vivre séparé tout en étant capable de dialoguer<br />
avec l’Autre. La vérité ne relève que de ce dialogue, dans la dissemblance qui sépare et<br />
rassemble le Même et l’Autre, sans qu’ils puissent être ni comparés, ni rationalisés, ni réduits,<br />
ni assimilés. Contrairement à l’ontologie, la métaphysique est éthique. L’éthique suppose que<br />
l’être humain se mesure à l’Infini. L’évolution dans le domaine de la vérité se trouve dans la<br />
reconnaissance et le respect de l’altérité d’Autrui, et l’expérience au cours duquel on fait face<br />
à cette altérité, c’est-à-dire à ce qui se dérobe de toute prise pas accidentellement mais<br />
naturellement s’appelle « transcendance » ou Dieu en tant que visage d’Autrui. Dieu c’est, la<br />
relation à Autrui en tant qu’il ne peut être réduit à soi. La relation avec le visage se produit<br />
comme Bonté, c’est « l’expérience éthique par excellence » 559 car ici l’altérité est préservée<br />
dans toute son entièreté.<br />
559 Ibid., p. 85<br />
142
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
I. OUVRAGES DE LEVINAS<br />
1. Livres<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
- De l'Évasion, Fata Morgana, Montpellier, 1962<br />
- Totalité et Infini, Essai sur l’extériorité, Deuxième édition, Martinus Nijhoff, La<br />
Haye, 1965<br />
- En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, J. Vrin, nouvelle édition, Paris,<br />
aug. 1967<br />
- Quatre lectures talmudiques, Minuit, Paris, 1968<br />
- Difficile liberté, Albin Michel, coll. “ Présence du judaïsme ”, nouvelle édition aug.<br />
Paris, 1976<br />
- Noms propres, Fata Morgana, Montpellier, 1976<br />
- Du Sacré au saint : cinq nouvelles lectures talmudiques, Minuit, coll. “ Critique ”,<br />
Paris, 1977<br />
- De l'Existence à l'existant, J. Vrin, Paris, 1978<br />
- Le Temps et l'Autre, Fata Morgana, Montpellier, 1980<br />
- Ethique et infini, (dialogues d'Emmanuel Levinas et Philippe Nemo), Fayard, coll. “<br />
L'Espace intérieur ”, Paris, 1982<br />
- A l'heure des nations, les Ed. de Minuit, Paris, 1988<br />
- Théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl. 6 e éd. Vrin, Paris, 1989<br />
- Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, LGF, Le Livre de poche, coll. “ Biblioessais<br />
”, Paris, 1990<br />
143
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
- Entre nous. Essais sur le penser-à-l'autre, Grasset, Paris, 1991<br />
- De Dieu qui vient à l'esprit, J.Vrin, 2 e édit. revue et aug. Paris, 1992<br />
- Dieu, la mort et le temps, Grasset, Paris, 1993<br />
- Humanisme de l’autre homme, Le Livre de poche, coll. « Biblio-essais », Paris, 1994<br />
- Les imprévus de l'histoire, Fata Morgana, 1994<br />
- Altérité et transcendance, Fata Morgana, coll. “ Essais ”, Montpellier, 1995<br />
- L'intrigue et l'infini. textes réunis et présentés par Marie-Anne Lescourret.<br />
Flammarion, Paris, 1995<br />
- Transcendance et intelligibilité, Labor et Fides, Genève, 1996<br />
- Hors Sujet, LGF, Le Livre de Poche, coll. “ Biblio-essais ”, 1997<br />
2. Articles et conférences<br />
- « Le temps et l’autre », in Le Choix, le monde, l’existence. Cahier du Collège<br />
philosophique, Arthaud, Paris, 1947<br />
- « Le Moi et la Totalité », in Revue de Métaphysique et de Morale, n°4, octobre-<br />
décembre, 1954, pp. 353-373<br />
- « Dieu et la philosophie », in Le Nouveau Commerce, no 30-31, Printemps, 1975, pp.<br />
97-128.<br />
- « La conscience non intentionnelle », in Catherine Chalier ed. Emmanuel Levinas,<br />
l'Herne, Paris, 1991. pp.113--119.<br />
II. ETUDES SUR LEVINAS<br />
1. Livres<br />
- BAILHACHE, (G.), Le sujet chez Emmanuel Levinas, Presses universitaires de<br />
France, Paris, 1994.<br />
- CHALIER, (C.), Levinas, l'utopie de l'humain, A. Michel, Paris, 1993<br />
144
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
- DE BAUW, (C.), L'envers du sujet : lire autrement Emmanuel Levinas, Ousia,<br />
Bruxelles, 1996<br />
- DERRIDA, (J.), Adieu — à Emmanuel Levinas, Galilée, coll. « Incises », Paris, 1997<br />
- GUIBAL, (F.), Approches d’Emmanuel Levinas. L’inspiration d’une écriture, Presses<br />
universitaires de France, Paris, 2005<br />
- HABIB, (S.), La responsabilité chez Sartre et Levinas. préf. de Catherine Chalier.<br />
l'Harmattan, Paris, 1998.<br />
- HAYAT, (P.), Emmanuel Levinas, éthique et société, Ed. Kimé, Paris, 1995<br />
- MOSES, (S.), Au-delà de la guerre: trois études sur Levinas, Editions de l’éclat, 2004<br />
- MUYEMBE MUMONO, (B.), Le regard et le visage de l'altérité chez Jean-Paul<br />
Sartre et Emmanuel Levinas, Préf. d'Emmanuel Levinas. Berne, P.Lang, 1991<br />
- OUAKIM, (M.-A.), Méditations érotiques : essai sur Emmanuel Levinas, Balland,<br />
Paris, 1992.<br />
- PETROSINO, (S.) et ROLLAND, (J.), La vérité nomade, Introduction à Emmanuel<br />
Levinas, Editions La Découverte, Paris, 1984<br />
- PLOURDE, (S.), Emmanuel Levinas, Altérité et responsabilité, Ed. du Cerf, Paris,<br />
1996<br />
- POIRIE, (F.), Emmanuel Levinas, Qui êtes vous ?, Editions La Manufacture, Lyon,<br />
1987<br />
- ZIELINSKI, (A.), Levinas, la responsabilité est sans pourquoi. Presses universitaires<br />
de France, Paris, 2004<br />
2. Articles<br />
- AGOSTINI, (M.), « L'éducation morale : Socrate et Levinas », in Le Télémaque,<br />
2009/2 n° 36, pp. 113-124.<br />
- ARMENGAUD, « Entretien avec Emmanuel Levinas », in Revue de Métaphysique et<br />
de Morale, n°90, 1985, pp. 296-310<br />
- <strong>BALLA</strong> OYIE, (I.), « L’irruption éthique d’autrui : corolaire de l’éthique de la justice<br />
de Etre », Annales de la FALSH, Université de Yaoundé I, Vol. 1, N°9, Nouvelle série,<br />
2009. Premier semestre, pp. 137-150<br />
145
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
- CHALIER, (C.), « révélation et totalité », in Revue internationale de philosophie,<br />
2006/1 - n° 235, pp. 5- 14<br />
- CHEVRIER, (J.), « Poétique d’Edouard Glissant », in Poétique d’Edouard Glissant :<br />
actes du Colloque international, Paris Sorbonne, mars 1998, pp. 11-13<br />
- ELLA, (S.E.), « Des droits de l’homme aux droits de l’autre homme », in Conférence<br />
prononcée au Groupe de Recherches et d’Etudes Epistémologiques, à la Maison<br />
d’Auguste Comte, sise 10 rue Monsieur-le-Prince, Ier étage, 75006 Paris<br />
- FRANCIS JACQUES, « E. Levinas : entre le primat phénoménologique du moi et<br />
l'allégeance éthique à autrui », in Etudes phénoménologiques, 1990, pp. 101-140.<br />
- LAMARRE, (J.-M.), « Seule l'altérité enseigne », in Le Télémaque, Presses<br />
universitaires de Caen, 2006/1 - n° 29, pp. 69-78.<br />
- MATTEI, (J.-F.), « La rame et le couteau : la question de l’“Autre” chez Levinas », in<br />
Revue philosophique, n o 2, 2005, pp. 203-211.<br />
- MATTERN, (J.), « Ichnocratie. La pensée du retour et antipolitique chez Benny Lévy<br />
et Martin Heidegger », in Cahier d'études levinassiennes, 2005 -- Hors série, pp. 75-<br />
108<br />
- PAGES, (C.), « ‘’Distance et proximité’’ : les deux lectures levinassiennes de<br />
l’intentionnalité», in Bulletin d'Analyse Phénoménologique, VI 8, 2010 (Actes 3), pp.<br />
264-283<br />
- PAUL OLIVIER, « Ontologie et métaphysique chez Emmanuel Levinas », in Annales<br />
de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Nice, 1985, pp. 145-180.<br />
- PEPERZAK, (A.T.) « Une introduction à la lecture de Totalité et Infini », in Revue des<br />
sciences philosophiques et théologiques, 1987, pp. 191-218.<br />
- PETITDEMANGE, (G.), « Emmanuel Levinas ou la question d'autrui », in Etudes,<br />
1972, pp.757-772<br />
- PLOURDE, (S.), « Emmanuel Levinas : une éthique déconcertante », in Laval<br />
théologique et philosophique, vol. 55, n° 2, 1999, pp. 205-213.<br />
- PLOURDE, (S.), « Le thème de la responsabilité éthique chez Emmanuel Levinas »,<br />
in Cahiers Ethicologiques de l'UQAR, 1986, pp. 101-111.<br />
- REY, (J.-F.), « Le maitre absolu : Hegel et Hobbes dans la pensée d’Emmanuel<br />
Levinas », in Revue internationale de philosophie, 2006/1 - n° 235, pp. 75 – 89<br />
- ROLLAND, (J.), « Pas de conseils pour le tyran. Levinas et la question politique », in<br />
Revue philosophique de Louvain, 2002, pp. 32-64.<br />
146
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
III. OUVRAGES COMPLEMENTAIRES<br />
- BLANCHOT, (M.), L’Écriture du désastre, Gallimard, Paris, 1980<br />
- BLANCHOT, (M.), L’Entretien infini, Gallimard, Paris, 1969<br />
- BUBER, (M.), Je et Tu, Ed. Aubier, France, 1969<br />
- BRIANÇON Muriel, L’Altérité enseignante. D’un penser sur l’autre à l’Autre de la<br />
pensée, Éditions Publibook, rue des Volontaires 75015, Paris – France, 2012<br />
- DERRIDA, (J.), L'écriture et la différence, Seuil, 1967<br />
- DESCARTES, (R.), Méditations métaphysiques ; Meditationes de prima philosophia,<br />
texte latin et traduction du duc de Luynes revue par Descartes, présentation et nouvelle<br />
traduction (en regard) par Michelle Beyssade, Le Livre de Poche, 1990<br />
- DESCARTES, (R.), Discours de la méthode, Nathan, Paris, 1 ère parution en 1984<br />
- DOSTOÏEVSKI, (F.), Les Frères Karamazov, traduction d’Ely Halpérine-Kaminsky<br />
et Charles Morrice, 1888<br />
- FOUCAULT, (M.), Les mots et les choses, Gallimard, Paris, 1966<br />
- JANICAUD, (D.), Le tournant théologique de la phénoménologie française, Combas:<br />
Éd. de l'Éclat, 1991<br />
- JANKELEVITCH, (V.), L’austérité et la vie morale, Flammarion, Paris, 1956<br />
- HEGEL, (G.W.F.), Phénoménologie de l’Esprit, traduction J. Hyppolite T.I, Aubier,<br />
Paris, 1939<br />
- HEGEL, (G.W.F.), Leçons sur la philosophie de l'histoire, trad. Jean Gibelin, Vrin,<br />
1937<br />
- HOBBES, (T.), Léviathan, Vrin, 2005<br />
- HUNEMAN, (P.) et KULIC, (E.), Introduction à la phénoménologie, Ed. Armand<br />
Colin, Paris, 1997<br />
- HUSSERL, (E.), Psychologie phénoménologique, Ed. J. Vrin, Paris, 2001<br />
- KIERKEGAARD, (S.), Post-scriptum aux « Miettes philosophiques », Ed. Gallimard,<br />
Paris, 2002<br />
147
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
- MARION, (J. L.), Dieu sans l'être, Presses universitaires de France, Paris, 2002<br />
- MERLEAU-PONTY, (M.), Eloge de la philosophie, Gallimard, 1989<br />
- PLATON, Menon, 85a-c, trad. M. Canto-Sperber, Flammarion (GF ; n°491), Paris,<br />
1991<br />
- PLATON, Le Sophiste, 259a-b, trad. N.-L. Cordero, Flammarion (GF ; n° 687), Paris,<br />
1993<br />
- PLATON, Phèdre, 276a, trad. L. Brisson, Flammarion (GF ; n° 488), Paris, 1989<br />
- PLATON, Œuvres complètes, VIII, 1, Parménide, texte établi et traduit par Auguste<br />
Diès, Le Belles Lettres, Paris, 1923<br />
- PLOTIN, Les Ennéades, VI, Livre V, « L'Etre Un et identique est partout présent tout<br />
entier », II. Tome III, Traduction française : M.-N. Bouillet, L. Hachette et Cie, Paris,<br />
1857<br />
- RICŒUR, (P.), Soi-même comme un autre, Seuil, Paris, 1990<br />
- RICŒUR, (P.), Du texte à l’action, Seuil, Paris, 1985<br />
- RICŒUR, (P.), Temps et Récit, t. III, Seuil, Paris, 1985<br />
- RICŒUR, (P.), Autrement, Presses universitaires de France, Paris, 1997<br />
- ROSENZWEIG, (F.), Etoile de la Rédemption [Der Stern der Erlösung, 1919], Ed. du<br />
Seuil, Paris, 2003<br />
- SARTRE (J.P.), Huis clos, suivi de "Les Mouches", Gallimard, 18 février, 2000<br />
IV. <strong>MEMOIRE</strong>S<br />
- DUGROS, (G.), L’événement de la rencontre de l’Autre. L’approche centrée sur la<br />
personne comme formation à l’altérité. Mémoire de Maîtrise, Sous la direction de<br />
Philippe Grauer, Université de Paris VIII, Département des Sciences de l’Education,<br />
année académique : 2004 – 2005<br />
- MATUKA, (R.), L'accueil d'autrui comme abandon de la liberté totalisante et appel<br />
à la responsabilité. Une lecture de Totalité et infini d'Emmanuel Levinas, Université St<br />
Pierre Canisius – DEUG, 2002<br />
V. USUEL<br />
148
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
- Dictionnaire d'éthique et de philosophie morale, Sous la direction de Monique Canto-<br />
Sperber, Presses universitaires de France, Paris, 1996<br />
TABLE DES MATIERES<br />
DEDICACE……………………………………………………………………………….......I<br />
REMERCIEMENTS………………………………………………………………………….II<br />
RESUME……………………………………………………………………………………..IV<br />
ABSTRACT…………………………………………………………………………………..V<br />
INTRODUCTION GENERALE ................................................................................................ 1<br />
PREMIERE PARTIE : LE SATUT DE L’AUTRE<br />
Introduction partielle .................................................................................................................. 8<br />
CHAPITRE I : PHILOSOPHIE DE LA TOTALITE ................................................................ 9<br />
I. Réduction conceptuelle et totalité hégélienne ..................................................................... 9<br />
1. Réduction conceptuelle ....................................................................................................... 9<br />
2. Totalité hégélienne ............................................................................................................ 12<br />
II. L’intentionnalité husserlienne ........................................................................................... 18<br />
III. Ontologie et primauté de l’Etre chez Heidegger ........................................................... 24<br />
CHAPITRE II : DERACINEMENT DU TOTALITARISME ONTOLOGIQUE .................. 31<br />
I. L’idée de l’Infini et le Désir de l’In-connu ....................................................................... 32<br />
1. L’étrangeté absolue chez Descartes .................................................................................. 32<br />
2. Le Désir métaphysique ..................................................................................................... 35<br />
II. Jouissance comme premier événement de la séparation ................................................... 39<br />
III. L’épiphanie d’Autrui dans le visage comme rupture de la Totalité .............................. 44<br />
Conclusion partielle .................................................................................................................. 49<br />
DEUXIEME PARTIE : ETHIQUE DE L’ALTERITE<br />
149
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
Introduction partielle ................................................................................................................ 54<br />
CHAPITRE I : L’ACCUEIL DU VISAGE ............................................................................. 57<br />
I. Le face-à-face et l’asymétrie relationnelle ........................................................................ 58<br />
1. Le face-à-face .................................................................................................................... 58<br />
2. Relation asymétrie ............................................................................................................ 61<br />
II. Langage comme mode de relation avec la transcendance ................................................ 64<br />
III. L’interdiction au meurtre corollaire à la violence désorientée ...................................... 71<br />
1. L’exigence éthique proscrit le meurtre ............................................................................. 71<br />
2. Vulnérabilité et non violence ............................................................................................ 75<br />
CHAPITRE II : ETRE-POUR-AUTRUI ................................................................................. 79<br />
I. Respecter l’Autre .............................................................................................................. 79<br />
II. Être au service de l’humanité ............................................................................................ 83<br />
III. Etre hospitalier .............................................................................................................. 86<br />
Conclusion partielle .................................................................................................................. 93<br />
TROISIEME PARTIE : LA DIMENSION PEDAGOGIQUE DE L’ALTERITE<br />
Introduction partielle ................................................................................................................ 97<br />
CHAPITRE I : ENSEIGNEMENT ET EXTERIORITE ......................................................... 99<br />
I. L’Autre mon enseignant ................................................................................................... 99<br />
II. Problématique de l’altérité enseignante .......................................................................... 105<br />
1. Les positions de Paul Ricœur, Jacques Derrida et de Maurice Blanchot ........................ 105<br />
2. De la critique levinassienne de l’altérité plurielle ........................................................... 108<br />
III. Enseigner c’est donner par la parole ........................................................................... 112<br />
CHAPITRE II : AUTREMENT QUE SELON LE MODE DE L’ETRE ............................. 117<br />
I. Difficile Levinas : l’emprise traumatique du Maître ...................................................... 118<br />
II. Responsabilité et substitution pour Autrui ...................................................................... 121<br />
1. De la responsabilité pour l’Élève .................................................................................... 121<br />
2. De la substitution pour Autrui ......................................................................................... 126<br />
150
La problématique de l’altérite dans Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité d’Emmanuel Levinas<br />
III. Le vivre ensemble : Fraternité et Paix ......................................................................... 128<br />
Conclusion partielle ................................................................................................................ 134<br />
CONCLUSION GENERALE ................................................................................................ 136<br />
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................. 143<br />
TABLE DES MATIERES ..................................................................................................... 149<br />
151