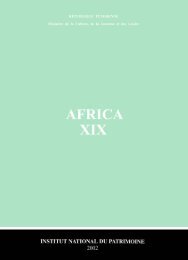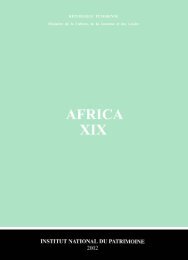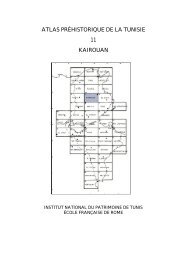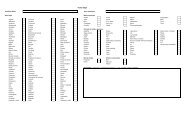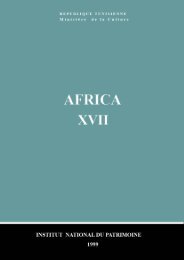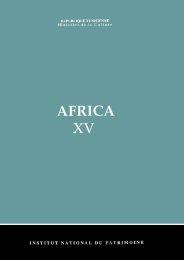9: 1960-1961 - Institut National du Patrimoine
9: 1960-1961 - Institut National du Patrimoine
9: 1960-1961 - Institut National du Patrimoine
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PARALIPOMENA PUNICA<br />
KL T (sic, avec un et) au lieu de KL H T. Quant à SGT c'est un substantif<br />
féminin, que nous retrouvons au masculin en hébreu tardif : s e yâg « clôture,<br />
enceinte ». B SGT HMQM signifie donc « dans l'enceinte <strong>du</strong> lieu sacré ».<br />
Au risque de m'écarter de mon sujet, je voudrais signaler d'autres problèmes<br />
encore, que soulève ce texte. Tout d'abord quelle en est la date?<br />
Clermont-Ganneau, pour des raisons d'ordre paléographique, le plaçait après<br />
les inscriptions 1 et 3; or ces deux inscriptions, à peu près contemporaines<br />
l'une de l'autre (même écriture et même mention <strong>du</strong> MZR mizra , sorte<br />
d'association cultuelle), seraient à situer d'après G. Picard (1) , entre 50 et 55<br />
après notre ère. Si l'on admet l'ordre chronologique des inscriptions soutenu<br />
par Clermont-Ganneau, il faudrait descendre pour l'inscription 2 jusqu'aux<br />
environs de 100 après notre ère, c'est-à-dire à une époque où Mactar est<br />
sinon romanisée, <strong>du</strong> moins en pleine romanisation, comme le prouve la<br />
célèbre inscription des juvenes, dès l'année 88. Une telle hypothèse se heurte<br />
selon moi à de graves difficultés. En premier lieu l'onomastique de ce texte<br />
est presque exclusivement punique et numide (2) : or dans l'inscription des<br />
juvenes (en + 88), comme dans l'inscription n° 1, la proportion des noms<br />
latins est beaucoup plus forte. Mais surtout comment admettre que le temple<br />
magnifique, décrit si complaisamment dans l'inscription n° 1 de Mactar (3) ,<br />
que G. Picard place aux environs de + 50, ait eu besoin, au bout d'une<br />
cinquantaine d'années, d'être rebâti si complètement qu'aucune mention<br />
n'en est faite dans le texte 2? Enfin la teneur même de l'inscription n° 2, telle<br />
que nous venons de l'élucider : « ... ont bâti ce temple... dans l'enceinte <strong>du</strong><br />
lieu sacré», semble bien indiquer qu'il s'agit d'une création ex nihilo.<br />
En résumé, à une date indéterminée, mais qui semble quelque peu antérieure<br />
au début de notre ère, quatre généreux donateurs, dont trois au moins<br />
(et peut-être tous les quatre) portent des noms puniques (deux et peut-être<br />
trois des pères sont dans le même cas), font construire un temple, sur un<br />
emplacement sacré, mâqôm, à une divinité carthaginoise Hô ermescar. Celle-ci<br />
était-elle déjà adorée sur ce mâqôm? Je n'en sais rien. Édifié avec des ressources<br />
limitées, ce bâtiment devait être assez mesquin. Il fut remplacé, vers le milieu<br />
<strong>du</strong> I er siècle de notre ère, entre + 50 et + 55, par un ensemble architec-<br />
tural (temple, chapelle, statue monumentale, etc.) : l'ampleur de la transformation<br />
explique que l'inscription qui décrit la nouvelle construction n'ait<br />
pas mentionné l'ancienne, qui fut probablement purement et simplement<br />
jetée à bas. Ce second temple fut construit aux frais <strong>du</strong> mizra , sorte d'asso-<br />
(1) Civ. Mact., p. 77 et suiv. Dans un article qui paraîtra prochainement, M. G.-Ch. Picard<br />
établira que la date exacte est comprise entre 50 et 55 de notre ère pour l'inscription n° 1.<br />
(2) Sur une quinzaine de noms propres figurant dans l'inscription, je n'en vois que deux qui<br />
puissent à la rigueur être latins : MSWLY (Massylius?) et QP Y.<br />
(3) Voir J.-G. FÉVRIER, Semitica, VI, p. 15-31.<br />
35