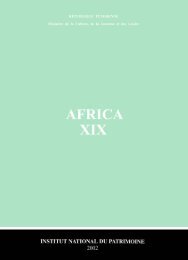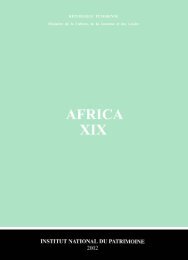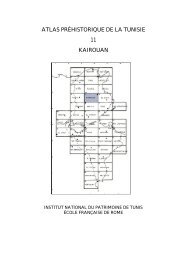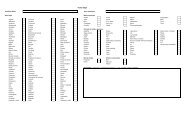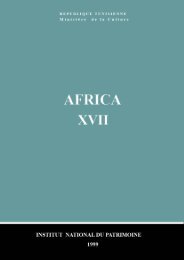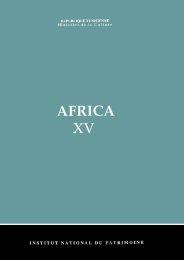9: 1960-1961 - Institut National du Patrimoine
9: 1960-1961 - Institut National du Patrimoine
9: 1960-1961 - Institut National du Patrimoine
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CHAPITEAUX À BÉLIERS ET À AIGLES<br />
sième, conservé au musée de Leyde (pl. II), aurait été découvert en 1822 à<br />
Tunis (1) ; enfin, les deux derniers ont été exhumés depuis peu à Amphi-<br />
polis (2) .<br />
Le chapiteau chrétien à protomes de béliers n'est pas une pure création<br />
de l'esprit concrétisée sous le ciseau des artistes qui ont réalisé les premiers<br />
modèles. Très tôt en Orient, certains animaux furent figurés sur des membres<br />
d'architecture dont la fonction principale était de servir de points d'appui;<br />
ils en exprimaient l'idée et, le plus souvent, une signification religieuse ou<br />
symbolique leur était associée. Dans les palais hittites, des groupes d'animaux<br />
protecteurs, traités vigoureusement en ronde bosse et aux muscles accentués,<br />
servaient de bases aux colonnes (3) . Dès le VIII e siècle av. J.-C. en Paphla-<br />
gonie, de gros piliers appartenant à des façades rupestres sont ornés de motifs<br />
emblématiques, sculptés à l'image d'avant-trains de lions, de taureaux ou<br />
de béliers, qui soutiennent les linteaux (4) . Mais il semble bien que ce soit<br />
<strong>du</strong> décor bicéphale <strong>du</strong> couronnement des supports dans les monuments<br />
achéménides, surtout les apadânas, que le chapiteau chrétien à têtes d'animaux<br />
tire l'origine de son parti (5) . La solution, remarquable par la logique,<br />
le caractère et l'élégance des proportions, qu'ont donnée au chapiteau les<br />
artistes perses, ne paraît pas avoir joui de tout le rayonnement auquel il eût<br />
été normal de s'attendre.<br />
Cependant, ce thème est passé dans l'art de l'Inde ancienne, où il ne semble<br />
pas avoir été toujours bien compris, au moins en ce qui concerne son<br />
sens architectural (6) . Il reparaît assez fréquemment à l'époque hellénis-<br />
cf. Nezih FiRETLI, Découverte de trois églises byzantines à Istanbul, dans Cahiers archéologiques<br />
publiés par André Grabar, V, 1951, p. 170, pl. IV b, et p. 175, n° 6.<br />
(1) Il porte la référence H B 51 dans l'inventaire <strong>du</strong> musée de Leyde. Dimensions : hauteur :<br />
0,373 m ; largeur mesurée dans la partie la plus étroite de l'abaque : 0,35 m. « Trouvé dans une<br />
excavation faite pour construire une citerne dans la maison <strong>du</strong> ministre Soliman Kaya, à l'endroit<br />
dit Tabgghin, dans la partie septentrionale de la ville de Tunis et près des murs <strong>du</strong> côté de l'Est.<br />
« Le chapiteau a été trouvé au commencement <strong>du</strong> déblai des terres ; à 27 pieds sous terre, on<br />
trouvait deux tombeaux romains tardifs, dont le mobilier se trouve à Leyde. » (Extrait <strong>du</strong> dossier<br />
de M. J.-E. Humbert conservé au musée de Leyde.)<br />
Je dois à l'obligeance de M. Salomonson, conservateur au musée de Leyde, tous les renseignements<br />
concernant ce chapiteau, que cet aimable savant a bien voulu me signaler.<br />
(2) Georges DAUX, Chronique des fouilles et découvertes archéologiques en Grèce en 1959,<br />
dans B.C.H., LXXXIV, <strong>1960</strong>, II, p. 797 et 798, fig. 7.<br />
(3) Edmond POTTIER, L'art hittite, 1 er fasc., Paris, 1926, p. 44-57.<br />
(4) Cf. Eugen VON MERCKLIN, Antike Stierkapitelle in Mitteilungen des deutschen Archaeolo-<br />
gischen <strong>Institut</strong>s, Heidelberg, 1953-1954, vol. 60-61, p. 185.<br />
(5) Pl. III, fig. 1, nous donnons un croquis de la partie supérieure d'un chapiteau de colonne<br />
<strong>du</strong> palais d'Artaxerxès Memnon. G. Perrot attribuait à juste titre aux animaux adossés de ce<br />
soutien d'entablement un caractère sacré, presque divin. PERROT et CHIPIEZ, Histoire de<br />
l'art dans l'Antiquité, t. V, p. 519. Anna ROES, Greek geometric art : its symbolism and its<br />
origin, Haarlem-London, 1953, p. 93-99.<br />
(6) J. HACKIN, Nouvelles recherches archéologiques à Bégram, dans Mémoires de la Délégation<br />
39