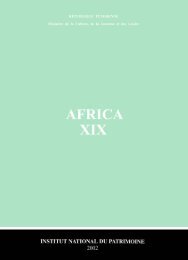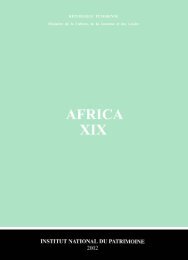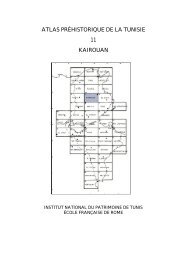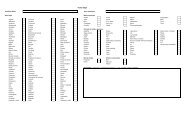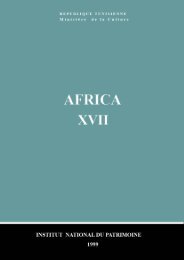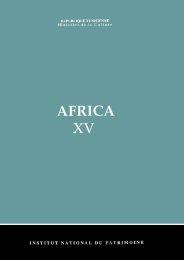9: 1960-1961 - Institut National du Patrimoine
9: 1960-1961 - Institut National du Patrimoine
9: 1960-1961 - Institut National du Patrimoine
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CHAPITEAUX À BÉLIERS ET À AIGLES<br />
Le chapiteau représenté pl. IV et V a été remonté au moyen de quatre<br />
grands fragments, dont les cassures s'ajustent avec précision; il manque<br />
deux faces et la base est détériorée; dans l'état actuel, la plus grande dimen-<br />
sion verticale mesure 0,36 m. Il appartient encore au type des chapiteaux<br />
à corbeille; mais si l'on cherche à restituer le gabarit de son épannelage, on<br />
peut se rendre compte qu'il possède cependant une certaine analogie avec<br />
le « Faltkapitelle » de l'époque justinienne. L'abaque très endommagé se<br />
rattache par ses grandes lignes à celui <strong>du</strong> style corinthien dont le profil<br />
canonique, constitué par un quart de rond, un listel et un cavet, est ré<strong>du</strong>it<br />
ici à un simple bandeau de 0,05 m de large, sur lequel deux sillons en V<br />
ont été gravés. La zone inférieure comportait une rangée de huit feuilles<br />
d'acanthe théodosienne à fines dentelures ; quatre d'entre elles ont été entièrement<br />
détruites; les lobes <strong>du</strong> bas de celles qui subsistent sont brisés. A l'exécution,<br />
il a été fait un assez large usage <strong>du</strong> trépan : les trous laissés après le<br />
travail de la mèche sont visibles au fond des évidements et dans les yeux<br />
entre les folioles; cependant, ils sont assez peu apparents, le modelé ayant<br />
été achevé au ciseau. Afin d'éviter la rencontre des corps d'animaux soumis<br />
à une symétrie assez rigoureuse, et peut-être aussi pour une raison symbolique,<br />
des cornes d'abondance, d'où semblent s'échapper des fruits stylisés, les<br />
séparent dans l'axe des faces. L'un de ces motifs présente une gaine treillissée<br />
sur un culot d'acanthes; dans l'autre, une grappe surmonte une sorte de<br />
faisceau cannelé. On s'est bien gardé de chercher à exprimer par un artifice<br />
de ren<strong>du</strong> toute la toison des bêtes, comme au chapiteau de Saint-Marc de<br />
Venise, d'esprit plus romain (1) . La composition est assez homogène; l'ordonnance<br />
des masses est heureuse et la mise en place correcte; la position des<br />
béliers semble naturelle; toutefois, la manière avec laquelle ils ont été traités<br />
dans le marbre relève de la sculpture en ronde bosse bien adaptée à l'économie<br />
de l'architecture; au jeu des forces correspond celui des formes; la structure<br />
et le décor révèlent des rapports sensibles; on ne saurait parler d'art réaliste,<br />
qui d'ailleurs serait ici déplacé, comme le serait une fresque ren<strong>du</strong>e à la manière<br />
d'un tableau de chevalet de l'école impressioniste. La matière formelle exprime<br />
sans ambiguïté une pensée décorative. Les détails sont traités à une échelle<br />
qui convient à cette plastique ornementale et leur indication n'est pas dépourvue<br />
d'intérêt; il semblerait que la taille ait été d'abord confiée à des praticiens,<br />
puis qu'un maître d' uvre assez habile ait ensuite achevé l'ouvrage, en reprenant<br />
aussi quelques grands plans pour donner au modelé à la fois plus de simplicité<br />
(1) Ce chapiteau bien daté <strong>du</strong> IV e siècle par Louis Bréhier est encore de la sculpture romaine;<br />
les protomes d'animaux font en quelque sorte plus « moutons » que décor architectural : cf. Louis<br />
BRÉHIER, Études sur l'histoire de la sculpture byzantine, dans Nouvelles archives des Missions<br />
scientifiques et littéraires, fasc. 3, Paris, 1911, p. 33 et fig. 1, pl. I.<br />
41