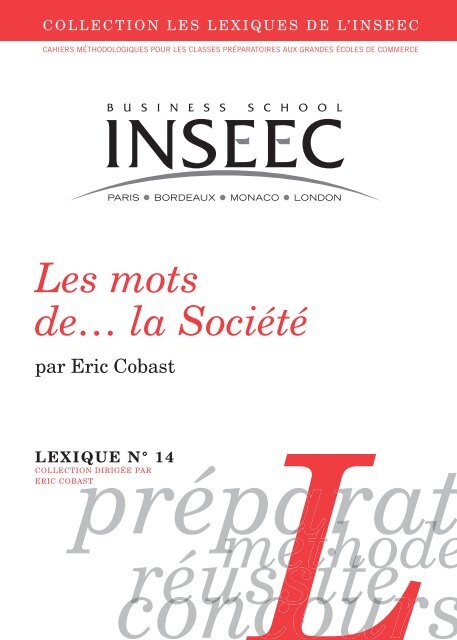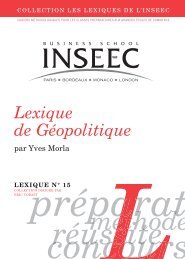Les mots de la Société (Eric Cobast) - INSEEC Business School
Les mots de la Société (Eric Cobast) - INSEEC Business School
Les mots de la Société (Eric Cobast) - INSEEC Business School
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
COLLECTION LES LEXIQUES DE L’<strong>INSEEC</strong><br />
CAHIERS MÉTHODOLOGIQUES POUR LES CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES DE COMMERCE<br />
<strong>Les</strong> <strong>mots</strong><br />
<strong>de</strong>… <strong>la</strong> <strong>Société</strong><br />
par <strong>Eric</strong> <strong>Cobast</strong><br />
LEXIQUE N° 14<br />
COLLECTION DIRIGÉE PAR<br />
ERIC COBAST
<strong>Les</strong> Lexiques <strong>de</strong> l’<strong>INSEEC</strong><br />
Consultables au quotidien, ces lexiques pourront accompagner utilement l’année<br />
sco<strong>la</strong>ire : ce sont en effet <strong>de</strong>s <strong>mots</strong>, <strong>de</strong>s notions, qui structurent le programme <strong>de</strong><br />
l’année mais c’est aussi le plus souvent sur un terme précis que se joue <strong>la</strong> réussite<br />
d’un p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> dissertation… L’idée <strong>de</strong>s Lexiques s’impose dès lors que l’on prend<br />
en compte ces révisions répétées auxquelles les « DS » et les « Concours B<strong>la</strong>ncs »<br />
soumettent les préparationnaires. Éric <strong>Cobast</strong>, qui dirige ce projet à l’<strong>INSEEC</strong><br />
<strong>de</strong>puis <strong>de</strong> très nombreuses années, a donc retrouvé l’équipe <strong>de</strong>s professeurs <strong>de</strong><br />
prépa qui avaient déjà travaillé aux « Mémentos », une équipe é<strong>la</strong>rgie à <strong>de</strong> nouveaux<br />
venus, tous professeurs confi rmés et reconnus, qui ont mis leur expérience<br />
au service <strong>de</strong> cette collection.<br />
L’<strong>INSEEC</strong> souhaite ainsi contribuer activement à votre succès et, en mobilisant<br />
toutes ses compétences, mieux vous faire connaître son attachement à <strong>la</strong> méthodologie<br />
et à <strong>la</strong> culture générale.<br />
Avec tous nos encouragements pour cette année déterminante et passionnante<br />
à <strong>la</strong> fois.<br />
Catherine <strong>Les</strong>pine<br />
Directrice Générale du Groupe <strong>INSEEC</strong>
<strong>Les</strong> <strong>mots</strong> <strong>de</strong>…<br />
<strong>la</strong> <strong>Société</strong><br />
Par <strong>Eric</strong> <strong>Cobast</strong><br />
Professeur agrégé <strong>de</strong> l’Université<br />
Professeur <strong>de</strong> Littérature dans les C<strong>la</strong>sses<br />
<strong>de</strong> Première Supérieure du lycée Ma<strong>de</strong>leine Daniélou<br />
Professeur <strong>de</strong> Culture Générale à l’Ecole Nationale<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Magistrature<br />
1
LES LEXIQUES DE L’<strong>INSEEC</strong><br />
Sommaire<br />
Du bon usage d’un lexique ....................................................... 3<br />
Introduction : La <strong>Société</strong>… d’un mot ....................................... 4<br />
Première Partie : Anthropologie .............................................. 6<br />
Deuxième partie : Politique .................................................... 13<br />
Troisième Partie : Sociologie .................................................. 21<br />
2
Du bon usage d’un lexique<br />
« Définir », c’est toujours ce par quoi commence le Socrate que P<strong>la</strong>ton met en<br />
scène dans ses dialogues.<br />
Sans délimiter avec précision le sens <strong>de</strong>s <strong>mots</strong>, comment s’entendre ? Sans<br />
débuter par cet accord contractuel sur le <strong>la</strong>ngage, comment parvenir à penser<br />
ensemble ? A dialoguer enfi n ?<br />
Or, rien n’est moins simple. Circonscrire <strong>la</strong> surface sémantique d’une notion<br />
réc<strong>la</strong>me souvent bien davantage qu’un simple dictionnaire. Il faut aller, certes<br />
à l’usage, mais aussi à <strong>la</strong> source même <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation du terme. Or si l’étymologie<br />
ne dit pas nécessairement – et contrairement à ce qu’elle annonce – <strong>la</strong><br />
vérité d’un mot, elle en indique <strong>la</strong> pente, elle en découvre « l’arrière-goût »<br />
souvent indispensable à l’appréciation connotative.<br />
Bref, il est utile <strong>de</strong> maîtriser le sens <strong>de</strong>s <strong>mots</strong> du champ notionnel dans lequel<br />
on travaille, ne serait-ce que pour analyser correctement les énoncés <strong>de</strong>s<br />
sujets proposés, cerner avec justesse les enjeux <strong>de</strong>s textes dont <strong>la</strong> lecture et<br />
l’étu<strong>de</strong> sont conseillées, pour argumenter enfi n sans craindre l’imprécision.<br />
Ce<strong>la</strong> passe nécessairement par une étu<strong>de</strong> lexicale et notionnelle à l’occasion<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>quelle on peut déjà suggérer une mise-en-problème, un début <strong>de</strong> questionnement,<br />
un commencement <strong>de</strong> réfl exion.<br />
C’est dire que chacune <strong>de</strong>s entrées proposées est conçue à <strong>la</strong> fois comme une<br />
défi nition précise <strong>de</strong> <strong>la</strong> notion citée et comme un premier exercice <strong>de</strong> problématisation.<br />
On trouvera souvent également en appui une citation qui amorce<br />
une première argumentation.<br />
L’ambition <strong>de</strong> ce petit lexique est donc <strong>de</strong> fournir <strong>de</strong>s informations nécessaires<br />
mais aussi d’inciter déjà à <strong>la</strong> réfl exion, d’apporter les défi nitions attendues<br />
mais également <strong>de</strong> surprendre parfois à l’occasion d’une entrée plus originale.<br />
3
LES LEXIQUES DE L’<strong>INSEEC</strong><br />
Introduction :<br />
La <strong>Société</strong>… d’un mot<br />
La notion, pour évi<strong>de</strong>nte qu’elle puisse paraître, offre toutefois <strong>de</strong>s nuances <strong>de</strong><br />
signifi cation qui <strong>de</strong>vront être bien sûr exploitées dans le cadre <strong>de</strong>s concours.<br />
Si, étymologiquement, <strong>la</strong> « société » désigne en effet ceux qui ont fait alliance,<br />
qui ont passé un accord pour vivre ensemble, on doit par exemple d’emblée<br />
distinguer un sens abstrait – rapports, re<strong>la</strong>tion, commerce existant entre <strong>de</strong>s<br />
personnes : il aime <strong>la</strong> société <strong>de</strong>s artistes et <strong>de</strong>s gens <strong>de</strong> lettres – d’un sens<br />
concret – ensemble d’individus entre lesquels existent <strong>de</strong>s rapports organisés,<br />
milieu humain dans lequel est intégré un individu en tant qu’ensemble <strong>de</strong><br />
forces hiérarchisées et organisées qui agissent sur lui.<br />
<strong>Les</strong> jeux d’oppositions sémantiques conduisent à distinguer société et communauté,<br />
<strong>la</strong> première résultant d’une volonté, quand <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> est imposée par<br />
<strong>la</strong> nature. Dire que nous vivons dans une société, c’est affi rmer que celle-ci<br />
résulte d’un choix, qu’il est possible <strong>de</strong> <strong>la</strong> réformer, d’en changer, <strong>de</strong> <strong>la</strong> quitter<br />
alors que l’on appartient littéralement à une communauté. En fonction <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
nature <strong>de</strong> l’appréciation idéologique portée sur l’idée <strong>de</strong> liberté, on appréciera<br />
ou dépréciera l’une ou l’autre.<br />
Le sociologue et philosophe allemand Ferdinand Tönnies, en 1922, dans un<br />
ouvrage intitulé précisément Communauté et société explique :<br />
Tout ce qui est confi ant, intime, vivant exclusivement ensemble est compris<br />
comme <strong>la</strong> vie en communauté. La société est ce qui est public ; elle est le mon<strong>de</strong> ;<br />
on se trouve au contraire en communauté avec les siens <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> naissance, lié<br />
à eux dans le Bien comme dans le Mal. On met l’adolescent en gar<strong>de</strong> contre « <strong>la</strong><br />
mauvaise société » mais l’expression « mauvaise communauté » sonne comme<br />
une contradiction.<br />
La secon<strong>de</strong> opposition intéressante confronte société et politique, principalement<br />
par le biais <strong>de</strong>s adjectifs dérivés. L’adjectif social s’entend certes au<br />
sens <strong>la</strong>rge comme ce qui concerne <strong>la</strong> société (on parle ainsi par exemple <strong>de</strong><br />
« contrat social ») mais aussi par opposition au mot « politique ». La justice<br />
sociale, le progrès social et tant d’autres expressions qui rappellent que <strong>la</strong><br />
question sociale interroge les inégalités, ou mieux les asymétries, alors que <strong>la</strong><br />
question politique, surtout quand elle est posée dans le cadre d’une démocratie,<br />
s’adresse à <strong>de</strong>s égaux, <strong>de</strong>s concitoyens.<br />
Le plus souvent, les connotations attachées au mot société sont positives, ce<br />
qui n’est évi<strong>de</strong>mment pas le cas pour le mot politique. Pourtant, <strong>la</strong> notion est<br />
4
sans doute moins lisse qu’on pourrait le croire. C’est ce qui résulte notamment<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lecture précise du second discours <strong>de</strong> Rousseau, Discours sur l’origine<br />
et les fon<strong>de</strong>ments <strong>de</strong> l’inégalité parmi les hommes (1755), par quoi il serait<br />
vraiment pru<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> commencer le travail <strong>de</strong> l’année. On y découvre en effet<br />
que <strong>la</strong> société s’est sans doute imposée par le besoin. Si les hommes entrent<br />
en société c’est pour <strong>de</strong> bonnes raisons mais pas <strong>de</strong> bons sentiments. La vie<br />
en société témoigne par sa seule réalité du manque, <strong>de</strong> l’absence, <strong>de</strong> ce creux<br />
qui habitent les hommes. Je suis par nature incapable <strong>de</strong> vivre seul dans <strong>la</strong><br />
Nature et partant je cherche à m’associer à d’autres qui m’ai<strong>de</strong>nt et me complètent.<br />
L’imperfection <strong>de</strong>s hommes est <strong>la</strong> condition nécessaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie en<br />
société. Frappée du sceau, dès l’origine, du négatif, comment <strong>la</strong> société pourrait-elle<br />
être heureuse ?<br />
La notion « mord » trois champs d’étu<strong>de</strong> distincts : l’anthropologie et l’ethnologie,<br />
<strong>la</strong> politique et enfi n <strong>la</strong> sociologie. D’où nos trois parties. Certaines entrées<br />
auraient pu toutefois glisser d’une partie dans l’autre et mes choix sont essentiellement<br />
<strong>de</strong> composition.<br />
5
LES LEXIQUES DE L’<strong>INSEEC</strong><br />
Première Partie :<br />
Anthropologie<br />
Agressivité :<br />
Le rappel <strong>de</strong> cette disposition à l’attaque dont tous les êtres vivants sont dotés,<br />
à un <strong>de</strong>gré plus ou moins important il est vrai, vaut surtout ici pour rappeler<br />
le travail <strong>de</strong> Konrad Lorenz (qui reçut en 1973 avec Karl Von Frisch le prix<br />
Nobel <strong>de</strong> Physiologie pour récompenser ses travaux sur « l’organisation et <strong>la</strong><br />
mise en évi<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> comportement individuel »). Dans son ouvrage,<br />
publié en Allemagne en 1963, L’agression, une histoire naturelle du Mal, il<br />
établit que les hommes à l’instar <strong>de</strong>s animaux sont sujets à cet instinct. Mais<br />
l’agressivité ne doit pas être comprise comme une priorité donnée à <strong>la</strong> violence<br />
ni même aux tensions <strong>la</strong>tentes <strong>de</strong>s rapports <strong>de</strong> force. Il s’agit davantage d’une<br />
énergie dont les diverses cultures optimisent les formes d’expression sociale.<br />
En société, les hommes vivent <strong>de</strong> façon « agressive », comme les animaux sur<br />
leur territoire ou dans leur milieu. Est-ce à dire que pour comprendre le comportement<br />
<strong>de</strong>s hommes il suffi t d’étudier celui <strong>de</strong>s bêtes ?<br />
Banc :<br />
Assemb<strong>la</strong>ge, amas <strong>de</strong> différentes matières selon une surface p<strong>la</strong>ne. Un banc<br />
<strong>de</strong> poissons, c’est une gran<strong>de</strong> quantité <strong>de</strong> poissons.<br />
Ban<strong>de</strong> :<br />
Du germanique « bandwa », l’étendard. Il s’agit dès lors d’un groupe d’hommes<br />
qui combattent ensemble sous <strong>la</strong> même bannière, <strong>de</strong>rrière un même chef. Plus<br />
<strong>la</strong>rgement : groupe <strong>de</strong> personnes ayant un point commun.<br />
C<strong>la</strong>n :<br />
Du gaélique « c<strong>la</strong>nn » qui signifie <strong>la</strong> famille. Tribu <strong>de</strong> familles écossaises ayant<br />
un ancêtre commun.<br />
6
Commerce :<br />
Derrière le sens premier <strong>de</strong> « marché commun » se loge l’idée <strong>de</strong> sociabilité,<br />
d’échanges pas seulement matériels mais aussi spirituels. Une personne d’un<br />
commerce agréable, c’est quelqu’un dont <strong>la</strong> société est p<strong>la</strong>isante.<br />
Communauté :<br />
La communauté, c’est ce qui est commun, ce que l’on partage et partant ceux<br />
avec lesquels je partage. De fait, communis s’oppose en <strong>la</strong>tin à proprius, ce qui<br />
est en propre, c’est-à-dire ce qui n’appartient qu’à un seul. Vivre en communauté,<br />
c’est renoncer à toute forme <strong>de</strong> propriété privée, d’appropriation personnelle.<br />
La vie en communauté à <strong>la</strong>quelle P<strong>la</strong>ton <strong>de</strong>stine ses gardiens dans<br />
La République élimine toute dimension privée <strong>de</strong> l’existence, toute re<strong>la</strong>tion en<br />
propre entre ces mêmes gardiens, interdits <strong>de</strong> famille et <strong>de</strong> conjugalité.<br />
Ethnie :<br />
Le mot appartient au registre <strong>de</strong> <strong>la</strong> sociologie. C’est l’ensemble <strong>de</strong>s individus<br />
appartenant peut-être à <strong>de</strong>s nations différentes mais qui sont unis par une<br />
civilisation et une <strong>la</strong>ngue commune. L’ethnie française, par exemple, englobe<br />
<strong>la</strong> Belgique wallonne et <strong>la</strong> Suisse roman<strong>de</strong>.<br />
Ethnocentrisme :<br />
Si le mot a été vulgarisé par C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> Lévi Strauss pour lui donner d’ailleurs<br />
une portée universelle, c’est l’anthropologue W.G. Summer qui en 1907 le forge<br />
pour désigner <strong>la</strong> tendance, plus ou moins consciente, à privilégier les valeurs et<br />
les formes culturelles du groupe ethnique auquel on appartient.<br />
Ethologie :<br />
C’est l’étu<strong>de</strong> du comportement animal. Le mot a été inventé par Geoffroy<br />
Saint-Hi<strong>la</strong>ire en 1854. La question qui se pose aujourd’hui.<br />
7
LES LEXIQUES DE L’<strong>INSEEC</strong><br />
Exogamie :<br />
L’exogamie est une règle matrimoniale imposant <strong>de</strong> chercher son conjoint à<br />
l’extérieur <strong>de</strong> son groupe social (c<strong>la</strong>n, groupe territorial, caste, société, milieu<br />
social).<br />
Har<strong>de</strong> :<br />
Troupe <strong>de</strong> bêtes sauvages qui vivent ensemble. Ne s’emploie que par métaphore<br />
s’il s’agit <strong>de</strong> désigner <strong>de</strong>s humains.<br />
Hor<strong>de</strong> :<br />
Groupe composé <strong>de</strong> douze à quinze individus.<br />
Inceste :<br />
Du <strong>la</strong>tin incestus qui signifi e « impur ». L’inceste caractérise une re<strong>la</strong>tion<br />
sexuelle entre membres d’une même famille. Sauf exceptions, souvent hiérogamiques<br />
comme dans l’Egypte pharaonique, l’inceste est prohibé. Cette prohibition<br />
est une condition du passage <strong>de</strong> <strong>la</strong> hor<strong>de</strong> primitive à <strong>la</strong> tribu puis à<br />
<strong>la</strong> société puisqu’elle contraint les mâles à chercher une femelle à l’extérieur<br />
du groupe.<br />
Insociable (sociabilité) :<br />
L’expression appartient à Emmanuel Kant, elle apparaît dans Idée d’une<br />
Histoire Universelle au point <strong>de</strong> vue cosmopolitique. Il s’agit <strong>de</strong> comprendre<br />
l’origine <strong>de</strong>s confl its qui déchirent l’humanité. De fait, selon le philosophe les<br />
hommes ont une inclination à entrer en société, inclination qui est cependant<br />
doublée d’une répulsion générale à le faire, menaçant constamment <strong>de</strong> désagréger<br />
cette société.<br />
Et il ajoute :<br />
Remercions donc <strong>la</strong> nature pour cette humeur peu conciliante, pour <strong>la</strong> vanité<br />
rivalisant dans l’envie, pour l’appétit insatiable <strong>de</strong> possession ou même <strong>de</strong><br />
domination. Sans ce<strong>la</strong> toutes les dispositions excellentes <strong>de</strong> l’humanité seraient<br />
étouffées dans un éternel sommeil.<br />
8
Matriarcat :<br />
Ce mot, qui à l’origine désigne un système <strong>de</strong> parenté matrilinéaire, fut rapi<strong>de</strong>ment<br />
compris comme le pendant du patriarcat, c’est-à-dire un système<br />
social dominé par les hommes. Le matriarcat renverrait ainsi à <strong>de</strong>s organisations<br />
<strong>de</strong> société où ce sont les femmes qui détiennent le pouvoir. Or, <strong>de</strong> telles<br />
sociétés n’ont jamais existé.<br />
Il y a matriarcat au sens propre si <strong>la</strong> société est matrilocale (l’époux va habiter<br />
dans le vil<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> l’épouse) et matrilinéaire (<strong>la</strong> transmission du statut social<br />
passe par <strong>la</strong> lignée maternelle, avec le nom et les biens). Un système politique<br />
où les femmes détiennent et exercent le pouvoir porte le nom <strong>de</strong> gynocratie. Ce<br />
type <strong>de</strong> société relève <strong>de</strong> l’utopie.<br />
Paraître :<br />
Le paraître, ce n’est pas tout-à-fait l’apparence. En effet, il y a dans l’usage <strong>de</strong><br />
ce verbe substantivé une nuance d’ostentation, <strong>de</strong> démonstration. Le paraître,<br />
c’est <strong>la</strong> valorisation <strong>de</strong> l’apparence. Le terme entre également dans un couple<br />
antonymique, il y a l’Etre et le Paraître comme il y a <strong>la</strong> surface et <strong>la</strong> profon<strong>de</strong>ur,<br />
<strong>la</strong> superfi cie et l’intimité.<br />
La société, très rapi<strong>de</strong>ment dans le discours <strong>de</strong>s moralistes et <strong>de</strong>s satiristes,<br />
impose le paraître sur l’Etre, dès lors l’homme vrai, l’homme naturel, y disparaît.<br />
Perfectibilité :<br />
Disposition naturelle <strong>de</strong> l’homme à se parfaire sans cesse. Parce qu’il est « inachevé<br />
», c’est-à-dire incapable <strong>de</strong> vivre tel qu’il est né dans <strong>la</strong> nature, l’homme,<br />
dit Kant, a besoin d’un maître. Il lui faut apprendre à vivre et à transformer<br />
cette nature à <strong>la</strong>quelle il est inadapté. Elle <strong>de</strong>vient alors culture. Et cette<br />
culture se manifeste notamment à travers <strong>la</strong> constitution <strong>de</strong>s sociétés. Cette<br />
aptitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’homme à se « parfaire », c’est-à-dire à développer ses aptitu<strong>de</strong>s,<br />
est <strong>la</strong> condition <strong>de</strong>s progrès que réalise l’espèce humaine au nombre <strong>de</strong>squels<br />
on peut raisonnablement compter le perfectionnement <strong>de</strong> ces mêmes sociétés<br />
visant le « bien vivre ensemble », le bonheur.<br />
Phratrie :<br />
Division à l’intérieur d’une tribu. <strong>Les</strong> phratries sont généralement exogames.<br />
9
LES LEXIQUES DE L’<strong>INSEEC</strong><br />
Ruche :<br />
Une ruche est une structure qui abrite une colonie d’abeilles. L’essaim rassemble<br />
un nombre important <strong>de</strong> ces insectes. La ruche et l’essaim sont souvent<br />
utilisés comme métaphores <strong>de</strong>stinées à représenter une société où <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion est très active. C’est le bourdonnement <strong>la</strong>borieux <strong>de</strong>s abeilles qui<br />
est alors mis en valeur. Le célèbre romancier espagnol Camilo José Ce<strong>la</strong> fi le<br />
<strong>la</strong> métaphore dès le titre <strong>de</strong> son roman le plus connu : La Colmena (1953),<br />
littéralement « La ruche ». Plus <strong>de</strong> trois cents personnages se croisent dans le<br />
Madrid <strong>de</strong>s années quarante, le texte restitue bien cette impression <strong>de</strong> bourdonnement,<br />
<strong>de</strong> grouillement insensé.<br />
Sauvage (enfant) :<br />
Victor <strong>de</strong> l’Aveyron, étudié par le Docteur Jean Itard en 1798, donne à l’Enfant<br />
sauvage sinon un nom du moins un prénom ainsi qu’une existence « scientifi<br />
que », lui permettant <strong>de</strong> sortir du registre <strong>de</strong> <strong>la</strong> fi ction (Tarzan) ou <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
légen<strong>de</strong> (Romulus et Remus). Pourtant, l’imposture du pseudo texte autobiographique<br />
<strong>de</strong> Misha Defonseca, publié en français en 1997 sous le titre Survivre<br />
avec les loups qui racontait comment une petite fi lle avait vécu parmi<br />
les loups pendant <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> guerre mondiale pourrait calmer les ar<strong>de</strong>urs<br />
<strong>de</strong> tous ceux qui cherchent à prouver – grâce aux enfants sauvages – que<br />
<strong>la</strong> société n’est pas pour les hommes une nécessité vitale. Diffi cile en effet<br />
<strong>de</strong> faire disparaître le soupçon d’escroquerie. <strong>Les</strong> corps examinés <strong>de</strong>s enfants<br />
prétendus sauvages – c’est-à-dire ayant vécu strictement dans <strong>la</strong> nature sans<br />
autre assistance que celle <strong>de</strong>s bêtes – n’ont jamais révélé rien d’autre que <strong>de</strong>s<br />
signes <strong>de</strong> maltraitance humaine en guise <strong>de</strong> cicatrices <strong>de</strong>stinées à prouver <strong>la</strong><br />
vie sauvage. La liste est pourtant très longue <strong>de</strong> ces enfants exhibés dans les<br />
foires ou dans les cours d’Europe : <strong>de</strong> l’enfant-mouton d’Ir<strong>la</strong>n<strong>de</strong> (1640) à Natacha,<br />
<strong>la</strong> fi llette <strong>de</strong> cinq élevée par <strong>de</strong>s chiens en Sibérie (2009), en passant par<br />
les fi llettes-louves, Ama<strong>la</strong> et Kama<strong>la</strong>, découvertes en In<strong>de</strong> (1920) ou <strong>la</strong> petite<br />
Slovaque vivant parmi les ours (1762). Aucun <strong>de</strong> ces cas n’est aujourd’hui<br />
reconnu.<br />
Sé<strong>de</strong>ntarisation :<br />
Phénomène par lequel une popu<strong>la</strong>tion se fi xe sur un territoire et cesse d’être<br />
noma<strong>de</strong>. Le développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> société passe en effet par le renoncement au<br />
mouvement. On évoque ainsi aisément une tribu noma<strong>de</strong>, moins une « société<br />
10
noma<strong>de</strong> ». L’idée <strong>de</strong> société impose celle <strong>de</strong> stabilité. La société suppose un<br />
rapport à l’avoir qui serait fi xé. D’où <strong>la</strong> formule <strong>de</strong> Rousseau qui fait du premier<br />
homme qui « enclot un terrain » le véritable fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> société civile.<br />
La société permet d’immobiliser les biens qui <strong>de</strong>viennent alors « immobilier ».<br />
Structure :<br />
Généralement, <strong>la</strong> structure, c’est l’agencement <strong>de</strong>s éléments constitutifs d’un<br />
système. Il y a structure parce qu’il y a construction d’un réseau fonctionnel<br />
d’interactions entre ces éléments. Privilégier <strong>la</strong> structure, c’est privilégier<br />
<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion invariante entre <strong>de</strong>s éléments qui eux sont variables. La société<br />
obéit-elle à une structure commune alors à toutes les formes <strong>de</strong> société ? C’est<br />
ce que pense C<strong>la</strong>u<strong>de</strong> Lévi Strauss, pour qui ce qui importe c’est l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
cette structure (qui rendrait évi<strong>de</strong>mment intelligible le phénomène étudié) et<br />
non celle <strong>de</strong>s hommes qui vivent dans cette société. Selon l’hypothèse vieille<br />
comme Darwin qui fut le premier à <strong>la</strong> formuler : <strong>la</strong> prohibition <strong>de</strong> l’inceste et<br />
l’obligation <strong>de</strong> donner sépulture aux morts constituent <strong>de</strong>ux invariants qui<br />
« structurent » <strong>la</strong> société.<br />
Tabou :<br />
Il s’agit d’un mot d’origine polynésienne qui signifi e “interdit”.<br />
C’est Freud qui en vulgarise l’usage en Occi<strong>de</strong>nt et pour qui : Le tabou est un<br />
acte prohibé, vers lequel l’inconscient est poussé par une tendance très forte…<br />
Totem et tabou.<br />
Le tabou entre tous, c’est celui <strong>de</strong> l’inceste, sans lequel il n’y aurait pas <strong>de</strong><br />
société possible.<br />
Tribu :<br />
Subdivision d’hommes prétendant <strong>de</strong>scendre d’un même ancêtre. Il s’agit à<br />
l’origine <strong>de</strong>s 12 tribus d’Israël formées <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>scendance <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong>s 12 fi ls<br />
<strong>de</strong> Jacob. Au sens <strong>la</strong>rge, il faut entendre par tribu un groupe d’individus unis<br />
par un style <strong>de</strong> vie, un <strong>la</strong>ngage, une mo<strong>de</strong>.<br />
11
LES LEXIQUES DE L’<strong>INSEEC</strong><br />
Totem :<br />
Le mot est emprunté aux Indiens d’Amérique du Nord et il désigne l’animal<br />
(ce<strong>la</strong> peut-être parfois, mais plus rarement un végétal) qui représente l’ancêtre<br />
fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> tribu. Il protège le groupe mais il est aussi <strong>la</strong> source<br />
d’interdits, <strong>de</strong> proscriptions <strong>de</strong> tabous. Le totem symbolise <strong>la</strong> fi gure du père<br />
disparu et dont les fi ls ont désiré et/ou organisé le meurtre.<br />
Violence :<br />
La société semble se fon<strong>de</strong>r sur un principe d’éviction <strong>de</strong> <strong>la</strong> violence, c’est-àdire<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> puissance <strong>de</strong>structrice <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature. Elle est pourtant travaillée <strong>de</strong><br />
l’intérieur par une violence humaine que même l’invention <strong>de</strong> l’Etat ne parvient<br />
pas à résorber, celle par exemple <strong>de</strong>s passions.<br />
12
Deuxième partie : Politique<br />
Amitié :<br />
Sentiment d’attachement qui lie <strong>de</strong>s individus, enclins à se retrouver, à partager<br />
<strong>la</strong> même compagnie. L’amitié est un premier principe <strong>de</strong> rassemblement<br />
fondé sur une similitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> goûts, <strong>de</strong> valeurs, d’intérêts : qui se ressemble<br />
dans l’amitié s’assemble.<br />
Anachorète :<br />
Contemp<strong>la</strong>tif qui se retire du mon<strong>de</strong> et <strong>de</strong> <strong>la</strong> société. Telle est <strong>la</strong> stricte traduction<br />
du mot grec. Au quatrième siècle après Jésus-Christ, quelques religieux déci<strong>de</strong>nt<br />
<strong>de</strong> se retirer et <strong>de</strong> vivre dans <strong>la</strong> solitu<strong>de</strong> et le dénuement du désert égyptien. Le<br />
prince perse Onuphre qui vécut soixante-dix ans sous un palmier (jusqu’à ce que<br />
ses vêtements tombassent en poussière ! L’iconographie pieuse le représente souvent<br />
totalement nu, recouvert <strong>de</strong> sa longue barbe b<strong>la</strong>nche) en est l’un <strong>de</strong>s représentants<br />
les plus fameux. Siméon qui vécut au sommet d’une colonne et qu’on<br />
appelle pour ce<strong>la</strong> « le stylite »; Antoine… L’anachorète est un ermite, d’ailleurs ce<br />
<strong>de</strong>rnier terme est formé sur le mot grec erêmos qui signifi e désert. Il s’oppose au<br />
religieux qui fait le choix <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie en communauté, le cénobite.<br />
Si <strong>la</strong> démarche <strong>de</strong>s anachorètes du désert est sans équivoque – fuir les hommes<br />
et leurs petitesses pour vivre dans <strong>la</strong> solitu<strong>de</strong> un face-à-face avec Dieu – en<br />
revanche, le phénomène qu’ils ont fi ni par constituer est ambigu : <strong>la</strong> plupart<br />
d’entre eux <strong>de</strong>vinrent <strong>de</strong> véritables curiosités et on organisait ainsi <strong>de</strong>s<br />
pèlerinages pour les observer, dans certains cas les rencontrer. La fuite « au<br />
désert », si elle apparaît autant comme un acte <strong>de</strong> foi qu’un rejet du mon<strong>de</strong>, fut<br />
aussi un « phénomène <strong>de</strong> société ».<br />
Association :<br />
Du <strong>la</strong>tin socius, l’allié. L’association réunit dans un but commun <strong>de</strong>s alliés,<br />
c’est-à-dire <strong>de</strong>s individus qui déci<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> se lier les uns aux autres dans le cadre<br />
strictement défi ni d’un projet ou d’une activité particulière fi xé à l’avance.<br />
La société est bien ainsi une forme d’association. Mais ce que l’on appelle<br />
aujourd’hui « association » relève d’un statut juridique. C’est en France <strong>la</strong> loi<br />
du premier juillet 1901, mise en p<strong>la</strong>ce par Wal<strong>de</strong>ck Rousseau qui <strong>la</strong> défi nit :<br />
13
LES LEXIQUES DE L’<strong>INSEEC</strong><br />
L’association est <strong>la</strong> convention par <strong>la</strong>quelle <strong>de</strong>ux ou plusieurs personnes mettent<br />
en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans<br />
un but autre que <strong>de</strong> partager <strong>de</strong>s bénéfi ces. Elle est régie, quant à sa validité,<br />
par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations.<br />
Bourgeois :<br />
De l’allemand burg, cita<strong>de</strong>lle. Le bourgeois vit ainsi protégé dans l’enceinte<br />
du château.<br />
De cette origine, le mot conserve un lien avec l’idée <strong>de</strong> confort, <strong>de</strong> sécurité matérielle<br />
(appréciation positive) mais il est aussi porteur <strong>de</strong> connotations péjoratives<br />
qui trouvent leur explication dans <strong>la</strong> frilosité et le manque <strong>de</strong> courage que<br />
révèle ce besoin <strong>de</strong> protection. Mais ce que l’on appelle <strong>la</strong> « société bourgeoise »,<br />
c’est, à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> dénomination hégélienne, <strong>la</strong> société dominée, selon Marx,<br />
par une c<strong>la</strong>sse sociale spécifi que appelée « bourgeoisie ». Le Manifeste du Parti<br />
Communiste en <strong>de</strong>ssine l’historique et en analyse les caractéristiques :<br />
L’histoire <strong>de</strong> toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire <strong>de</strong> luttes <strong>de</strong><br />
c<strong>la</strong>sses.<br />
(…)<br />
La société bourgeoise mo<strong>de</strong>rne, élevée sur les ruines <strong>de</strong> <strong>la</strong> société féodale, n’a<br />
pas aboli les antagonismes <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sses. Elle n’a fait que substituer <strong>de</strong> nouvelles<br />
c<strong>la</strong>sses, <strong>de</strong> nouvelles conditions d’oppression, <strong>de</strong> nouvelles formes <strong>de</strong> lutte à<br />
celles d’autrefois.<br />
(…)<br />
Partout où elle a conquis le pouvoir, elle a détruit les re<strong>la</strong>tions féodales, patriarcales<br />
et idylliques. Tous les liens complexes et variés qui unissent l’homme féodal<br />
à ses « supérieurs naturels », elle les a brisés sans pitié pour ne <strong>la</strong>isser<br />
subsister d’autre lien, entre l’homme et l’homme, que le froid intérêt, les dures<br />
exigences du « paiement au comptant ». Elle a noyé les frissons sacrés <strong>de</strong> l’extase<br />
religieuse, <strong>de</strong> l’enthousiasme chevaleresque, <strong>de</strong> <strong>la</strong> sentimentalité petitebourgeoise<br />
dans les eaux g<strong>la</strong>cées du calcul égoïste. Elle a supprimé <strong>la</strong> dignité<br />
<strong>de</strong> l’individu <strong>de</strong>venu simple valeur d’échange ; aux nombreuses libertés dûment<br />
garanties et si chèrement conquises, elle a substitué l’unique et impitoyable<br />
liberté du commerce. En un mot, à <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> l’exploitation que masquaient<br />
les illusions religieuses et politiques, elle a substitué une exploitation ouverte,<br />
éhontée, directe, brutale.<br />
14
Civile (société)<br />
La signifi cation <strong>de</strong> l’expression suit l’évolution historique du couple antithétique<br />
dans lequel elle s’inscrit : d’abord défi nie en opposition avec l’état <strong>de</strong><br />
nature, elle est aujourd’hui confrontée à <strong>la</strong> société « politique ».<br />
En effet, ce qui est civil au XVIIe siècle, c’est précisément ce qui n’est plus<br />
« naturel ». De fait, « société civile » peut être alors ressentie comme un véritable<br />
pléonasme. Aujourd’hui, « société civile » désigne le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie<br />
sociale qui est indépendant <strong>de</strong> l’Etat, autosuffisant et autonome. Mais c’est<br />
aussi le corps social qui s’oppose à <strong>la</strong> « c<strong>la</strong>sse politique ». De fait, lorsqu’au<br />
gouvernement entrent aux côtés <strong>de</strong>s politiciens professionnels <strong>de</strong>s membres<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> « société civile », ce<strong>la</strong> témoigne d’une volonté d’ouverture et d’un souci<br />
d’éviter l’image d’un exercice partisan du pouvoir. <strong>Les</strong> représentants <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
société civile, ce sont alors <strong>de</strong>s professionnels reconnus, <strong>de</strong>s personnalités au<br />
statut moral ou intellectuel établi.<br />
C<strong>la</strong>sses (sociales) :<br />
C’est François Quesnay qui introduit en 1758, dans son Tableau économique,<br />
le concept <strong>de</strong> « c<strong>la</strong>sse », opposant <strong>la</strong> « c<strong>la</strong>sse productive », celle qui fait renaître<br />
par <strong>la</strong> culture du territoire, les richesses annuelles <strong>de</strong> <strong>la</strong> nation, à <strong>la</strong> fois à <strong>la</strong><br />
« c<strong>la</strong>sse <strong>de</strong>s propriétaires » et à <strong>la</strong> « c<strong>la</strong>sse stérile ». Il faut alors entendre par<br />
« c<strong>la</strong>sse » un ensemble d’individus qui ont <strong>de</strong>s caractéristiques communes. On<br />
parle naturellement d’une « c<strong>la</strong>sse d’âge » (ce qui est d’ailleurs conforme à<br />
l’étymologie <strong>la</strong>tine, « c<strong>la</strong>ssis », <strong>la</strong> flotte <strong>de</strong> guerre composée <strong>de</strong> citoyens ayant à<br />
peu près le même âge). Mais le sens se spécialise dans le registre économique,<br />
notamment avec Marx, qui souligne <strong>de</strong>ux critères : un premier critère, objectif:<br />
font partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> même c<strong>la</strong>sse sociale ceux qui occupent <strong>la</strong> même position dans<br />
le système économique. Et puis un second critère, subjectif, qui renvoie à <strong>la</strong><br />
conscience collective <strong>de</strong> cette position, conscience qui passe nécessairement<br />
par une interprétation <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions sociales comme étant nécessairement<br />
confl ictuelles.<br />
Des années soixante à nos jours, le débat s’est structuré autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> question<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> disparition (R. Nisbet) puis du retour <strong>de</strong>s « c<strong>la</strong>sses sociales » (L.Chauvel).<br />
15
LES LEXIQUES DE L’<strong>INSEEC</strong><br />
Contrat :<br />
Du <strong>la</strong>tin cum (ensemble) trahere (tirer).<br />
Le contrat résulte, dit l’étymologie, d’un effort collectif. Mais c’est aussi comme<br />
le précise le Co<strong>de</strong> Civil : une convention par <strong>la</strong>quelle une ou plusieurs personnes<br />
s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas<br />
faire quelque chose.<br />
Dans ces conditions qu’appelle-t-on « Contrat Social » ? L’expression nous est<br />
familière grâce au texte célèbre <strong>de</strong> Rousseau, rédigé en 1762, Du Contrat<br />
Social, texte où se trouve défi nie <strong>la</strong> nécessité d’un Peuple <strong>de</strong>venu souverain<br />
et <strong>de</strong> l’affi rmation <strong>de</strong> l’Intérêt Général que revendique une Volonté Générale<br />
<strong>de</strong>vant <strong>la</strong>quelle doivent plier les volontés particulières. Cette œuvre majeure<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> philosophie politique mo<strong>de</strong>rne s’inscrit dans un courant qu’on appelle<br />
le « contractualisme » qui utilise, avec Hobbes et Locke notamment, <strong>la</strong> métaphore<br />
du « contrat » pour penser <strong>la</strong> nature <strong>de</strong> <strong>la</strong> société. Il s’agissait ainsi <strong>de</strong><br />
rompre avec <strong>la</strong> conception antique <strong>de</strong> <strong>la</strong> société perçue comme obéissant à<br />
un ordre naturel (P<strong>la</strong>ton, Aristote). Avec l’idée <strong>de</strong> « contrat », les mo<strong>de</strong>rnes<br />
mettent en avant le rôle fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> volonté. La société est bien issue<br />
d’une volonté <strong>de</strong>s hommes – et pas seulement un besoin, ou une nécessité –<br />
elle est aussi ce que les hommes en font, libre à eux par conséquent d’en modifi<br />
er les fon<strong>de</strong>ments ou l’organisation.<br />
Cosmopolite :<br />
Du grec cosmos, le tout organisé et polis, <strong>la</strong> Cité.<br />
Au sens propre, l’adjectif cosmopolite qualifi e ce qui se défi nit comme appartenant<br />
à une Cité bien particulière puisqu’elle a <strong>la</strong> dimension du mon<strong>de</strong>. Mais<br />
une société « cosmopolite », c’est autre chose : il s’agit d’une société composée<br />
– et partant composite – d’individus venus d’ailleurs, <strong>de</strong> voyageurs, d’étrangers,<br />
une société multiculturelle, c’est-à-dire au sein <strong>de</strong> <strong>la</strong>quelle coexistent <strong>de</strong>s<br />
cultures différentes, où l’on parle plusieurs <strong>la</strong>ngues, où différentes nations<br />
vivent ensemble. On peut dire ainsi <strong>de</strong> <strong>la</strong> société romaine qu’elle est cosmopolite<br />
: dans les rues <strong>de</strong> Rome sous l’Empire, on entend plus d’une cinquantaine<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>ngues.<br />
16
État :<br />
Du verbe stare, se tenir fermement <strong>de</strong>bout. L’État, c’est ce qui dure, ce qui<br />
résiste. Il est <strong>la</strong> forme organisée <strong>de</strong>s sociétés mo<strong>de</strong>rnes. Le philosophe Hegel<br />
voit dans l’Etat <strong>la</strong> forme d’organisation <strong>la</strong> plus é<strong>la</strong>borée. Pour lui, l’Etat met<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> raison dans <strong>la</strong> vie civile, il oblige à transcen<strong>de</strong>r les intérêts particuliers<br />
qui s’affrontent dans <strong>la</strong> société civile, il donne son sens au « vouloir-vivreensemble<br />
». Mais l’Etat est-il vraiment cet aboutissement, cet achèvement <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> construction sociale ?<br />
Pierre C<strong>la</strong>stres, en 1974, publie La société contre l’Etat, texte qui affi rme que<br />
les sociétés dites primitives, ces « sociétés sans Etat », auraient délibérément<br />
choisi un mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> développement leur permettant d’éviter l’Etat. De fait, il<br />
serait naïf <strong>de</strong> croire que l’absence d’Etat est un manque, c’est au contraire<br />
une volonté :<br />
L’histoire <strong>de</strong>s peuples sans histoire, c’est [...] l’histoire <strong>de</strong> leur lutte contre l’État.<br />
C’est que l’Etat se révèle peut-être surtout un moyen d’opprimer <strong>la</strong> société.<br />
D’ailleurs les régimes statolâtres sont le plus souvent <strong>de</strong>s régimes totalitaires,<br />
c’est-à-dire qui visent à contrôler <strong>la</strong> totalité <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie sociale.<br />
On connaît bien sûr l’analyse que partagent libéraux et socialistes : l’Etat<br />
n’est pas une fi n mais un moyen <strong>de</strong> domination (le plus souvent par l’usage et<br />
le développement d’une bureaucratie), ne serait-ce que parce qu’il dispose du<br />
monopole <strong>de</strong> <strong>la</strong> violence légale. Alors pourquoi les sociétés libérales acceptentelles<br />
<strong>de</strong> fi nancer <strong>de</strong>s états ? Pour être protégées. L’historien Marc Bloch voyait<br />
dans <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion société civile/état une survivance du pacte vassalique. Que<br />
se passe-t-il lorsque, par incompétence, l’Etat ne protège plus et se contente<br />
d’arbitrer ? La société lui échappe et se trouve exposée.<br />
Ou bien l’Etat est fort et il nous écrase, écrit Paul Valéry, ou bien il est faible et<br />
nous périssons.<br />
Fracture sociale :<br />
L’expression apparaît pour <strong>la</strong> première fois dans une note <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fondation<br />
Saint-Simon en 1994, Aux origines du ma<strong>la</strong>ise politique français, signée d’Emmanuel<br />
Todd. Elle est reprise ensuite en 1995 par Jacques Chirac en campagne.<br />
La métaphore <strong>de</strong> <strong>la</strong> fracture est intéressante dans <strong>la</strong> mesure où elle<br />
suggère un choc brutal et une société brisée, rompue. Elle permet toutefois <strong>de</strong><br />
préserver l’avenir et <strong>de</strong> ne pas limiter le constat à l’échec défi nitif : une fracture,<br />
ce<strong>la</strong> fi nit par se « réduire ».<br />
17
LES LEXIQUES DE L’<strong>INSEEC</strong><br />
Hérisson :<br />
Le besoin <strong>de</strong> se réchauffer pousse les hérissons à se regrouper mais alors le<br />
contact <strong>de</strong> leurs piquants les fait s’écarter les uns <strong>de</strong>s autres : Quand le besoin<br />
<strong>de</strong> se réchauffer les eut rapprochés <strong>de</strong> nouveau, le même inconvénient se renouve<strong>la</strong>,<br />
<strong>de</strong> sorte qu’ils étaient ballotés <strong>de</strong> çà et <strong>de</strong> là entre les <strong>de</strong>ux <strong>mots</strong> jusqu’à<br />
ce qu’ils eussent fi ni par trouver une distance moyenne qui leur rendît <strong>la</strong> situation<br />
supportable. Ainsi le besoin <strong>de</strong> société né du vi<strong>de</strong> et <strong>de</strong> <strong>la</strong> monotonie <strong>de</strong> leur<br />
vie intérieure pousse les hommes les uns vers les autres ; mais leurs nombreuses<br />
manières d’être antipathiques et leurs insupportables défauts les dispersent <strong>de</strong><br />
nouveau. La distance moyenne qu’ils fi nissent par découvrir et à <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> vie en<br />
commun <strong>de</strong>vient possible, c’est <strong>la</strong> politesse et les belles manières. Schopenhauer<br />
Justice (sociale) :<br />
Une société est juste si elle donne aux moins favorisés le maximum <strong>de</strong> bienêtre<br />
possible. C’est l’égalité <strong>de</strong>s chances. Pour le philosophe américain John<br />
Rawls, l’auteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Théorie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Justice, les inégalités justes sont celles qui<br />
améliorent <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> tous y compris <strong>de</strong> celles <strong>de</strong>s moins favorisés.<br />
Luxe :<br />
Du <strong>la</strong>tin luxus, excès. L’emploi du mot se spécialise pour désigner un mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> vie.<br />
Le luxe est un excès mais un excès démonstratif, ostentatoire parce qu’il est<br />
signe <strong>de</strong> richesse et <strong>de</strong> supériorité sociale : On ne jouit du luxe qu’en le montrant<br />
écrit Rousseau. Le p<strong>la</strong>isir n’est pas <strong>de</strong> dominer mais <strong>de</strong> montrer cette<br />
domination, d’en faire un spectacle pour <strong>la</strong> société. Le débat sur le luxe qui<br />
agite <strong>la</strong> société <strong>de</strong>s Lumières rappelle celui sur <strong>la</strong> société <strong>de</strong>s apparences, où<br />
le spectacle <strong>de</strong> l’inégalité est partout.<br />
Misère :<br />
La misère, ce n’est pas seulement <strong>la</strong> pauvreté, et <strong>la</strong> pauvreté ce n’est pas<br />
nécessairement l’indigence ou l’absence <strong>de</strong> ressources. Il faut rappeler ainsi<br />
quelques précisions terminologiques.<br />
La misère, c’est au sens propre le malheur. <strong>Les</strong> misérables le sont aussi parce<br />
qu’ils n’ont « pas <strong>de</strong> chance ». Le pauvre, c’est le faible – chez les <strong>la</strong>tins l’antonyme<br />
<strong>de</strong> pauper est potens – un « pauvre vieux » n’est pas nécessairement<br />
18
impécunieux, c’est surtout un homme fragile et vulnérable. Voilà pourquoi<br />
traiter <strong>de</strong> <strong>la</strong> misère dans <strong>la</strong> société c’est avant tout abor<strong>de</strong>r l’inégalité <strong>de</strong>s<br />
« chances », mais celles-ci ne sont pas seulement économiques, elles sont<br />
aussi culturelles, sanitaires… bref, sociales !<br />
Nature (état <strong>de</strong>) :<br />
A propos <strong>de</strong> cette « fi ction normative » dont les contractualistes font l’usage,<br />
Hobbes donne dans Léviathan <strong>la</strong> plus juste défi nition :<br />
Un état qui n’existe plus, qui n’a peut-être point existé, qui probablement<br />
n’existera jamais, et dont il est pourtant nécessaire d’avoir <strong>de</strong>s notions justes<br />
pour bien juger <strong>de</strong> notre état présent.<br />
Hobbes choisit d’imaginer cet état <strong>de</strong> nature, à <strong>la</strong> différence <strong>de</strong> Rousseau,<br />
comme un état <strong>de</strong> violence permanente. <strong>Les</strong> hommes y vivent dans <strong>la</strong> terreur<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> mort brutale :<br />
Ils sont dans cette condition qui se nomme guerre, et cette guerre est guerre <strong>de</strong><br />
chacun contre chacun.<br />
Précarité :<br />
A nouveau, il faut corriger les abus <strong>de</strong> <strong>la</strong>ngage : <strong>la</strong> précarité n’est pas l’indigence,<br />
elle ressemble davantage à <strong>la</strong> pauvreté au sens où nous l’avons précé<strong>de</strong>mment<br />
défi nie. Mais précisément ce qui est précaire, c’est ce qui ne s’obtient<br />
que par <strong>la</strong> prière (prex, en <strong>la</strong>tin). Dès lors, <strong>la</strong> précarité dans <strong>la</strong> société,<br />
ce sera celle d’une « position » obtenue par faveur ou par fortune. Cette précarité<br />
sociale se manifeste dans l’instabilité et dans l’incertitu<strong>de</strong>, <strong>la</strong> crainte<br />
du len<strong>de</strong>main. Aux positions que l’on occupe (et on notera l’importance du<br />
vocabu<strong>la</strong>ire militaire), il faut opposer les « statuts » garantis, soli<strong>de</strong>s.<br />
Propriété :<br />
Est-elle <strong>la</strong> raison d’être <strong>de</strong> <strong>la</strong> société ? Comme le pensent Locke et Rousseau ?<br />
En tous cas, <strong>la</strong> question sociale est le plus souvent formulée en <strong>de</strong>s termes<br />
qui interrogent toujours ce que l’on appelle <strong>la</strong> « propriété », ce qui appartient<br />
« en propre » et non « en commun », ni <strong>de</strong> façon contingente et fugitive comme<br />
<strong>la</strong> possession.<br />
19
LES LEXIQUES DE L’<strong>INSEEC</strong><br />
Trifonctionnelle (idéologie)<br />
C’est une représentation sur <strong>la</strong>quelle reposent les sociétés anciennes et qui<br />
justifi ent <strong>la</strong> division sociale par trois fonctions essentielles qui se doivent<br />
d’être occupées et structurées :<br />
Dans toute société, on doit trouver une caste <strong>de</strong> guerriers qui protègent le<br />
groupe, les bel<strong>la</strong>tores que P<strong>la</strong>ton nomme du titre générique <strong>de</strong> gardien, un<br />
ensemble <strong>de</strong> prêtres qui entretiennent <strong>la</strong> dimension spirituelle (sciences et<br />
religion) et éducative, les oratores, clergé ou rois-philosophes et enfi n tous les<br />
autres qui travaillent, les <strong>la</strong>boratores. Ainsi Noblesse, Clergé et Tiers-Etat se<br />
trouvent-ils défi nis en fonction d’une utilité sociale.<br />
Utopie :<br />
Il s’agit d’un modèle <strong>de</strong>stiné à rendre intelligible <strong>la</strong> réalité sociale. Plus ou<br />
moins fantaisiste, elle assume toujours <strong>la</strong> fonction théorique que dissimule<br />
pourtant son aspect ludique. En imaginant <strong>la</strong> société possible, elle permet<br />
d’évaluer <strong>la</strong> société réelle, ne serait-ce que par <strong>la</strong> mesure d’un écart.<br />
C’est en 1515 que Thomas More forge le néologisme pour intitulé un texte<br />
qui <strong>de</strong>viendra emblématique : L’Utopie ou le traité <strong>de</strong> <strong>la</strong> meilleure forme <strong>de</strong><br />
gouvernement.<br />
20
Troisième Partie : Sociologie<br />
Altruisme :<br />
Le mot appartient à Auguste Comte, comme d’ailleurs celui <strong>de</strong> « sociologie ».<br />
Il est employé pour <strong>la</strong> première fois en 1854, dans le Catéchisme positiviste<br />
pour désigner une attitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> vénération quasi instinctive envers autrui. Il<br />
s’agit alors d’imaginer un antonyme effi cace au mot « individualisme » et une<br />
alternative à ce qu’il signifi e.<br />
Caste :<br />
Groupe social hiérarchisé, endogame et héréditaire.<br />
Civilité :<br />
La civilité désigne l’ensemble <strong>de</strong>s liens unissant le citoyen à <strong>la</strong> Cité. Elle est à<br />
distinguer <strong>de</strong> <strong>la</strong> « sociabilité » qui est faite <strong>de</strong>s liens interindividuels.<br />
Consommation :<br />
Quel point commun entre une « consommation » commandée à <strong>la</strong> terrasse d’un<br />
café, un « mariage consommé » et « Cinquante millions <strong>de</strong> consommateurs » ?<br />
Cum Summa : faire <strong>la</strong> somme <strong>de</strong> <strong>la</strong> totalité <strong>de</strong> ce que l’on a pu obtenir.<br />
« Consommer », c’est donc en fi nir. La « consommation » est un aboutissement,<br />
un achèvement et partant un terme.<br />
Mais le sens bouge au dix-neuvième siècle et se “spécialise” en quelque sorte<br />
dans le registre <strong>de</strong> l’économie. Ainsi Jean-Baptiste Say affirme-t-il en 1841 :<br />
La consommation n’est pas une <strong>de</strong>struction <strong>de</strong> matière mais une <strong>de</strong>struction<br />
d’utilité.<br />
Le propos introduit <strong>de</strong>ux nuances d’importance. D’une part, <strong>la</strong> consommation<br />
n’est plus perçue comme une addition et d’une certaine façon une plénitu<strong>de</strong>.<br />
Quelque chose s’achève (et l’on retrouve ici le double sens du verbe achever,<br />
parfaire et terminer) parce que quelque chose disparaît. Say emploie le mot<br />
<strong>de</strong>struction. C’est un usage qui se trouve consommé, un service. Ainsi <strong>la</strong> société<br />
<strong>de</strong> consommation n’est-elle pas simple lieu d’échange <strong>de</strong>s besoins premiers,<br />
21
LES LEXIQUES DE L’<strong>INSEEC</strong><br />
elle suppose que se négocient <strong>de</strong>s usages, elle se révèle par conséquent complexe<br />
et “développée”. La société <strong>de</strong> consommation, d’une certaine façon, porte<br />
à un niveau d’accomplissement une société <strong>de</strong> l’échange <strong>de</strong>s besoins <strong>de</strong>venus<br />
complexes.<br />
Délinquance :<br />
Il s’agit <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s infractions commises, et par infraction il faut<br />
entendre au sens <strong>la</strong>rge « vio<strong>la</strong>tion d’un interdit légal ». Un acte <strong>de</strong> délinquance<br />
postule donc un texte légal ou réglementaire qui prévoit et réprime un comportement.<br />
La délinquance est donc à l’image exacte <strong>de</strong> <strong>la</strong> société où elle se<br />
manifeste. Etudier ainsi, non pas tant <strong>la</strong> manière dont on punit mais ce que<br />
l’on punit, est extrêmement révé<strong>la</strong>teur.<br />
Démocratie :<br />
La gran<strong>de</strong> intuition <strong>de</strong> Tocqueville fut <strong>de</strong> comprendre qu’un certain type <strong>de</strong><br />
régime politique sécrète un certain type <strong>de</strong> société. Il est évi<strong>de</strong>nt que si, à présent,<br />
on évoque <strong>la</strong> démocratie, ce sera davantage pour parler du mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> vie<br />
spécifi que que produisent <strong>de</strong>s institutions démocratiques et qui conduit à une<br />
société libérale, égalitaire et individualiste.<br />
Distinction :<br />
Action <strong>de</strong> distinguer, c’est-à-dire i<strong>de</strong>ntifi er, remarquer et partant estimer. Mais<br />
il s’agit aussi du titre que le sociologue Pierre Bourdieu donne à l’ouvrage qu’il<br />
consacre en 1979 à l’étu<strong>de</strong> sociologique du goût. Le goût est un critère <strong>de</strong> distinction<br />
social subtil et effi cace, puisqu’il prétend exprimer l’intime quand il<br />
s’agit en fi n <strong>de</strong> compte d’appartenance collective.<br />
Division (sociale) :<br />
Considérons d’abord <strong>de</strong> quelle manière vont vivre les gens ainsi organisés. Ne<br />
vont-ils pas produire du blé, du vin, faire <strong>de</strong>s habits, <strong>de</strong>s chaussures se bâtir <strong>de</strong>s<br />
maisons ? Pendant l’été ne travailleront-ils pas ordinairement à <strong>de</strong>mi vêtus et<br />
sans chaussures, et pendant l’hiver vêtus et chaussés comme il convient ? Pour<br />
se nourrir ils fabriqueront sans doute soit avec <strong>de</strong> l’orge soit avec du froment <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> farine qu’ils feront griller ou qu’ils pétriront (…) ils se régaleront eux et leurs<br />
22
enfants, buvant du vin, <strong>la</strong> tête couronnée <strong>de</strong> fl eurs et chantant les louanges <strong>de</strong>s<br />
dieux ; ils vivront ensemble joyeusement rég<strong>la</strong>nt sur leurs ressources le nombre<br />
<strong>de</strong> leurs enfants, dans <strong>la</strong> crainte <strong>de</strong> <strong>la</strong> pauvreté et <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre.<br />
République,livre II. P<strong>la</strong>ton.<br />
Socrate imagine pour ses interlocuteurs <strong>la</strong> naissance et le développement<br />
d’une Cité : P<strong>la</strong>ton propose ainsi le premier « modèle » politique, au sens quasi<br />
scientifi que du terme.<br />
La diversité <strong>de</strong>s besoins humains conduit les hommes à se répartir les tâches :<br />
tout commence bien par <strong>la</strong> « division du travail ». Le lien social est donc imposé<br />
par cette nécessité. En soi, <strong>la</strong> division n’est pas mauvaise si elle résulte d’une<br />
spécialisation qui aboutit à une véritable harmonie. Mais à mesure qu’elle<br />
se développe, <strong>la</strong> société verra naître <strong>de</strong>s divisions préjudiciables, celles qui<br />
opposent et conduisent à l’exclusion et à l’injustice. Ces divisions se nourrissent<br />
<strong>de</strong> l’inégalité <strong>de</strong>s conditions, du désir <strong>de</strong> domination et d’une tendance peut-être<br />
naturelle à rejeter l’autre, celui dont pourtant <strong>la</strong> présence est une nécessité.<br />
Elites :<br />
Ceux qui dans un groupe sont reconnus comme les meilleurs.<br />
Il s’agit dès lors d’une minorité qui occupe une p<strong>la</strong>ce privilégiée dans un<br />
groupe. Ceux qui <strong>la</strong> composent détiennent l’autorité, jouissent du prestige<br />
et exercent le pouvoir. Plus les élites se constituent par héritage, plus cette<br />
société est fermée. Or le <strong>de</strong>stin <strong>de</strong>s élites est <strong>de</strong> se renouveler, écrit V. Pareto<br />
qui théorise <strong>la</strong> nécessité pour une société <strong>de</strong> développer ses élites. De fait, c’est<br />
moins l’existence <strong>de</strong>s élites que leur reproduction qui est mal ressentie.<br />
Exclusion :<br />
Le mot a été <strong>la</strong>rgement employé <strong>de</strong>puis René Lenoir (<strong>Les</strong> exclus, un Français<br />
sur dix, 1974) pour désigner le mécanisme par lequel certains se trouvent rejetés<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> société. L’exclusion n’est pas un phénomène neuf : expulsion, déportation,<br />
exil, etc. ont marqué l’histoire <strong>de</strong>s sociétés <strong>de</strong>puis l’Antiquité. Mais ce<br />
furent <strong>de</strong>s « décisions », impliquant volonté et responsabilité. Il y a au contraire<br />
dans l’exclusion, telle que nous l’entendons aujourd’hui, une dimension « mécanique<br />
» : elle ne serait voulue par personne, personne n’en serait alors responsable.<br />
Involontaire, l’exclusion révèle l’irresponsabilité <strong>de</strong> notre société.<br />
23
LES LEXIQUES DE L’<strong>INSEEC</strong><br />
Famille :<br />
Du <strong>la</strong>tin famulus, le serviteur.<br />
À Rome, familia, avant même <strong>la</strong> parentèle, désigne l’ensemble <strong>de</strong>s individus<br />
qui dépen<strong>de</strong>nt d’un même pater familias, chef <strong>de</strong> famille. Ce<strong>la</strong> recouvre<br />
femmes, enfants, serviteurs et clients.<br />
Le discours philosophique trouve dans <strong>la</strong> famille une intéressante forme <strong>de</strong><br />
communauté humaine qui parvient à faire cohabiter <strong>de</strong>s individus <strong>de</strong> manière<br />
en apparence non confl ictuelle. À ce titre, <strong>la</strong> famille incarne à <strong>la</strong> fois <strong>la</strong> promesse<br />
<strong>de</strong> re<strong>la</strong>tions pacifi ques entre les hommes et un modèle effi cacement<br />
comparable aux autres formes d’association.<br />
Folie :<br />
C’est <strong>la</strong> société qui fait exister <strong>la</strong> folie, en défi nit les délinéaments et à travers<br />
elle se constitue et s’affi rme. C’est ce que montre le philosophe Michel Foucault,<br />
lorsqu’il étudie l’invention <strong>de</strong> l’Hôpital Général en 1656 :<br />
La folie ne peut se trouver à l’état sauvage. La folie n’existe que dans une société,<br />
elle n’existe pas en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s formes <strong>de</strong> <strong>la</strong> sensibilité qui l’isolent et <strong>de</strong>s formes<br />
<strong>de</strong> répulsion qui l’excluent ou <strong>la</strong> capturent.<br />
Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Folie à l’âge c<strong>la</strong>ssique. (1961)<br />
Gang :<br />
Etudié très tôt par l’Ecole <strong>de</strong> Chicago, le phénomène <strong>de</strong>s gangs reste diffi cile à<br />
cerner. C’est le sociologue américain Fre<strong>de</strong>ric Thrasher qui en 1927 les étudie<br />
à Chicago où il en dénombre plus <strong>de</strong> 1 300 regroupant plus <strong>de</strong> 25 000 adolescents<br />
et jeunes hommes. Il les défi nit ainsi :<br />
Un gang <strong>de</strong> rue est n’importe quelle organisation qui possè<strong>de</strong> une i<strong>de</strong>ntité « <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> rue » incluant une participation dans <strong>de</strong>s activités illégales.<br />
La guerre <strong>de</strong>s gangs qui sévit à partir <strong>de</strong> 1924 pousse les pouvoirs publics<br />
à encourager ces étu<strong>de</strong>s sociologiques pour comprendre un phénomène totalement<br />
nouveau. Le rapport Lan<strong>de</strong>sco jette alors les bases d’une approche<br />
sociologique <strong>de</strong> <strong>la</strong> criminalité :<br />
24
De <strong>la</strong> même manière que le bon citoyen, le gangster est un produit <strong>de</strong> son environnement.<br />
Le bon citoyen a été élevé dans une atmosphère <strong>de</strong> respect et d’obéissance<br />
à <strong>la</strong> loi. Le gangster a fréquenté un quartier où <strong>la</strong> loi est au contraire<br />
enfreinte constamment.<br />
Organized crime in Chicago<br />
Hédoniste (société) :<br />
<strong>Société</strong> fondée sur <strong>la</strong> recherche du p<strong>la</strong>isir. Cette société est matérialiste et<br />
valorise le corps.<br />
Holiste (société) :<br />
<strong>Société</strong> organisée <strong>de</strong> telle sorte que le Tout prévaut toujours sur les parties<br />
qui le composent. Ainsi y repère-t-on davantage <strong>de</strong> <strong>de</strong>voirs que <strong>de</strong> droits. Elle<br />
s’oppose à <strong>la</strong> société individualiste dans <strong>la</strong>quelle au contraire chacune <strong>de</strong>s<br />
parties a plus <strong>de</strong> prix que <strong>la</strong> société dans son ensemble.<br />
Incivilité :<br />
Manque <strong>de</strong> civilité, c’est-à-dire <strong>de</strong> politesse. La théorie dite <strong>de</strong> « <strong>la</strong> vitre brisée<br />
» postule que <strong>la</strong> plus petite incivilité peut entraîner, si elle n’est pas réprimée,<br />
une augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> délinquance : quand une vitre est brisée, il faut<br />
immédiatement <strong>la</strong> remp<strong>la</strong>cer. C’est prendre sinon le risque d’une dégradation<br />
rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong> tout l’immeuble. Tolérance zéro.<br />
Industrielle (société) :<br />
Le confort, l’effi cacité, <strong>la</strong> raison, le manque <strong>de</strong> liberté dans un cadre démocratique,<br />
voilà ce qui caractérise <strong>la</strong> civilisation industrielle avancée et témoigne<br />
pour le progrès technique.<br />
L’Homme unidimensionnel Herbert Marcuse<br />
25
LES LEXIQUES DE L’<strong>INSEEC</strong><br />
Intérêt :<br />
L’intérêt est, en effet, ce qu’il y a <strong>de</strong> moins constant au mon<strong>de</strong>. Aujourd’hui il<br />
m’est utile <strong>de</strong> m’unir à vous ; <strong>de</strong>main <strong>la</strong> même raison fera <strong>de</strong> moi votre ennemi.<br />
Une telle cause ne peut donc donner naissance qu’à <strong>de</strong>s rapprochements passagers<br />
et à <strong>de</strong>s associations d’un jour.<br />
De <strong>la</strong> division du travail social Durkheim.<br />
Pour le sociologue français, on ne « fait pas société » seulement par intérêt.<br />
Loisirs (société <strong>de</strong>s) :<br />
En 1962, le sociologue français Joffre Dumazedier publie Vers une civilisation<br />
du loisir ? Un ouvrage qui annonce une société nouvelle toute entière consacrée<br />
aux loisirs, centrée sur les loisirs :<br />
Le loisir, bien que conditionné par <strong>la</strong> consommation <strong>de</strong> masse et <strong>la</strong> structure <strong>de</strong><br />
c<strong>la</strong>sse est <strong>de</strong> plus en plus le centre d’é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> valeurs nouvelles, surtout<br />
chez les jeunes.<br />
Mafi a :<br />
L’origine du mot est mystérieuse : mafi a dériverait <strong>de</strong> l’arabe muâfat, protection.<br />
Il semble s’être imposé dans les documents offi ciels dans les années 1860.<br />
Et son étymologie révèle <strong>la</strong> structure féodale <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong> société parallèle.<br />
Marge :<br />
Du <strong>la</strong>tin margo, le bord. La marge, c’est donc « ce qui est en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> » mais<br />
c’est aussi ce qui simultanément « se rapporte à ». En marge <strong>de</strong> ce récit… ce<strong>la</strong><br />
annonce une digression qui en tant que telle se situe par rapport au récit en<br />
question. La marginalité est donc solidaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> normalité sociale, l’une et<br />
l’autre se défi nissent mutuellement.<br />
Mais ce qui est en marge, ce n’est pas seulement ce qui est décentré, c’est aussi<br />
ce qui n’est pas central…<br />
Mépris :<br />
Dans le prolongement <strong>de</strong> <strong>la</strong> théorie hégélienne <strong>de</strong> <strong>la</strong> reconnaissance, le philosophe<br />
contemporain Axel Honneth parle <strong>de</strong> société du Mépris pour évoquer <strong>la</strong> nature <strong>de</strong>s<br />
re<strong>la</strong>tions sociales fondées sur une requête insistante <strong>de</strong> reconnaissance.<br />
26
Mondaine (société) :<br />
<strong>Société</strong> qui rassemble <strong>de</strong>s familles qui appartiennent aux c<strong>la</strong>sses les plus favorisées<br />
et aux yeux <strong>de</strong> qui le respect d’un certain nombre d’usages est un élément<br />
fondamental <strong>de</strong> reconnaissance. En 1903, <strong>la</strong> société Didot-Bottin publie le premier<br />
Bottin Mondain, imitant le très sélectif High Life britannique. Il s’agit d’un<br />
annuaire mondain qui répertoriait, à l’origine, 12 000 noms et adresses à Paris ou<br />
dans certaines communes proches (Neuilly, Saint-Germain-en-Laye, Versailles).<br />
Ordre :<br />
Organisation <strong>de</strong> personnes qui se caractérise par <strong>de</strong>s règles <strong>de</strong> vie (ordre<br />
monacal), une déontologie (<strong>la</strong> transmission d’un savoir théorique et le contrôle<br />
<strong>de</strong> sa pratique) ou un statut politique (les ordres <strong>de</strong> l’ancien Régime).<br />
Post-industrielle (société) :<br />
<strong>Société</strong> dans <strong>la</strong>quelle, selon le sociologue américain Daniel Bell récemment<br />
disparu, ce n’est plus <strong>la</strong> production <strong>de</strong>s biens qui apporte <strong>la</strong> richesse mais leur<br />
conception. La société post-industrielle est une société dans <strong>la</strong>quelle le capital<br />
intellectuel et culturel est fondamental. Elle encourage notamment le développement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche et <strong>de</strong> toutes les formes <strong>de</strong> créativité.<br />
Religion :<br />
Toute société a besoin <strong>de</strong> croyances communes. C’est ce que montre dans <strong>Les</strong><br />
formes élémentaires <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie religieuse en 1912 le sociologue Emile Durkheim.<br />
Risque :<br />
Dans <strong>la</strong> mo<strong>de</strong>rnité avancée, <strong>la</strong> production sociale <strong>de</strong> richesses est systématiquement<br />
corrélée à <strong>la</strong> production sociale <strong>de</strong> risques. Voilà pourquoi le sociologue<br />
allemand Ulrich Beck parle <strong>de</strong> <strong>la</strong> société du risque dans un ouvrage <strong>de</strong> 1986.<br />
Le risque correspond à <strong>la</strong> probabilité qu’un évènement malheureux arrive à<br />
une popu<strong>la</strong>tion.<br />
Désormais, le risque caractérise le groupe : par exemple, si le risque d’être ma<strong>la</strong><strong>de</strong><br />
était naguère une affaire d’ordre individuel, il est <strong>de</strong>venu à présent une affaire <strong>de</strong><br />
société, quand ce n’est pas franchement même une « affaire d’Etat », puisque 30 %<br />
du revenu national est aujourd’hui consacré à <strong>la</strong> gestion collective <strong>de</strong>s risques.<br />
27
LES LEXIQUES DE L’<strong>INSEEC</strong><br />
On pourrait donc lire l’histoire du développement <strong>de</strong> l’organisation sociale<br />
comme <strong>la</strong> somme <strong>de</strong>s efforts entrepris pour assurer les citoyens contre les<br />
risques successifs auxquels ils se sont progressivement découverts exposés :<br />
contre l’insécurité immédiate et physique, l’Etat mo<strong>de</strong>rne développe police et<br />
armée, contre l’insécurité sociale c’est tout un dispositif juridico-administratif<br />
qui s’est constitué dès <strong>la</strong> fi n du dix-neuvième siècle pour conduire à l’organisation<br />
<strong>de</strong> l’assurance et <strong>de</strong> <strong>la</strong> solidarité par l’Etat-Provi<strong>de</strong>nce. Dans une certaine<br />
mesure, « <strong>la</strong> société du risque », c’est d’abord le retour <strong>de</strong> <strong>la</strong> précarité généralisée<br />
et <strong>la</strong> faillite <strong>de</strong> l’Etat dans ses fonctions <strong>de</strong> tutelle héritées du contrat<br />
vassalique.<br />
Sociologie :<br />
Par sociologie, il faut entendre l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s sociétés. Dans ces conditions, <strong>la</strong><br />
sociologie existe <strong>de</strong>puis longtemps : d’Hérodote à Montesquieu en passant<br />
par tous les moralistes du Grand Siècle, nombreux sont ceux, historiens, satiristes,<br />
essayistes ou romanciers, qui ont cherché à décrire le fonctionnement<br />
<strong>de</strong>s sociétés, à en pointer les travers. Mais c’est Saint Simon qui au début du<br />
XIX e siècle crut en une approche scientifi que <strong>de</strong>s phénomènes sociaux et il<br />
donna à cette discipline nouvelle le nom <strong>de</strong> Physiologie sociale (physiologie<br />
au sens que Balzac donne aussi à ce mot quand il parle d’une Physiologie du<br />
mariage). Mais c’est son secrétaire, Auguste Comte, qui crée le mot sociologie,<br />
<strong>la</strong> science qui étudie les sociétés, comme <strong>la</strong> biologie étudie les organismes<br />
vivants, en 1854 dans son Système <strong>de</strong> politique positive.<br />
Solidarité :<br />
Du <strong>la</strong>tin solidus, consistant, soli<strong>de</strong>. La solidarité, c’est ce qui rend un groupe<br />
soli<strong>de</strong>. <strong>Les</strong> parties d’un tout sont solidaires lorsqu’elles sont interdépendantes.<br />
Durkheim distingue alors les solidarités mécaniques (elles s’effectuent d’ellesmêmes)<br />
<strong>de</strong>s solidarités organiques (il faut les susciter et les organiser). Dans<br />
une société individualiste, les individus ne sont pas naturellement enclins à <strong>la</strong><br />
solidarité, l’Etat se doit <strong>de</strong> les y contraindre.<br />
28
Spectacle (société du) :<br />
Et sans doute notre temps… préfère l’image à <strong>la</strong> chose, <strong>la</strong> copie à l’original, <strong>la</strong><br />
représentation à <strong>la</strong> réalité, l’apparence à l’être… Ce qui est sacré pour lui, ce<br />
n’est que l’illusion, mais ce qui est profane, c’est <strong>la</strong> vérité. Mieux, le sacré grandit<br />
à ses yeux à mesure que décroît <strong>la</strong> vérité et que l’illusion croît, si bien que le<br />
comble <strong>de</strong> l’illusion est aussi pour lui le comble du sacré.<br />
Feuerbach (Préface à <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième édition, L’Essence du christianisme)<br />
C’est par cette citation que débute le texte <strong>de</strong> Guy Debord, La société du spectacle,<br />
publié en 1967 qui développe <strong>la</strong> critique mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong> <strong>la</strong> représentation.<br />
Nous vivons ainsi le temps <strong>de</strong> l’Illusion et du Mensonge parce que notre<br />
société sacralise l’image.<br />
Tout est désormais spectacle ou plutôt : le réel a besoin aujourd’hui plus que<br />
jamais d’être mis-en-scène pour être simplement « reconnu ». Tout commence<br />
par les marchandises qui pour être consommées doivent être désirées. Or, le<br />
procédé a contaminé toutes les dimensions <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie en société ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie<br />
privée, au point qu’il n’y a plus <strong>de</strong> lien social qui ne doive être tissé par le spectacu<strong>la</strong>ire.<br />
Debord définit d’ailleurs le spectacle comme un rapport social entre<br />
<strong>de</strong>s personnes, médiatisé par <strong>de</strong>s images (La société du spectacle, §4).<br />
Suici<strong>de</strong> :<br />
Le suici<strong>de</strong> varie en fonction inverse du <strong>de</strong>gré d’intégration <strong>de</strong>s groupes sociaux<br />
dont fait partie l’individu. Le Suici<strong>de</strong> Emile Durkheim, 1897.<br />
S’agit-il vraiment d’un choix individuel ? Trois types <strong>de</strong> suici<strong>de</strong>s sont i<strong>de</strong>ntifi<br />
és par le sociologue français : le suici<strong>de</strong> « altruiste », le suici<strong>de</strong> « égoïste » et<br />
enfi n le suici<strong>de</strong> « anomique ». Le premier ne supporte plus <strong>de</strong> faillir aux règles<br />
du groupe, le second est provoqué par un défaut d’intégration et le troisième<br />
enfi n apparaît dans <strong>de</strong>s sociétés qui conduisent les individus à trop espérer et<br />
à ne plus être capables <strong>de</strong> contenir leurs désirs.<br />
29
LES LEXIQUES DE L’<strong>INSEEC</strong><br />
Notes<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
30
Notes<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
31
LES LEXIQUES DE L’<strong>INSEEC</strong><br />
Notes<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
..................................................................................................................................................................................................................................<br />
32
BCE - CONCOURS 2012<br />
<strong>Les</strong> épreuves écrites<br />
Coef.<br />
L’<strong>INSEEC</strong> utilise les épreuves <strong>de</strong> <strong>la</strong> BCE selon <strong>la</strong> grille ci-<strong>de</strong>ssous.<br />
Choix <strong>de</strong>s<br />
épreuves écrites<br />
Option<br />
Scientifique<br />
Option Économique<br />
À l’issue <strong>de</strong>s épreuves écrites, le jury d’admissibilité <strong>de</strong> l’<strong>INSEEC</strong> se réunit et arrête <strong>la</strong> liste <strong>de</strong>s candidats admissibles.<br />
Ceux-ci sont convoqués soit à Paris soit à Bor<strong>de</strong>aux en fonction <strong>de</strong> l’académie d’appartenance <strong>de</strong> leur c<strong>la</strong>sse préparatoire<br />
et d’une décision arrêtée par le jury d’admissibilité, dans le but d’équilibrer au mieux les calendriers <strong>de</strong> passage. Des<br />
dérogations sont possibles sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> expresse du candidat. <strong>Les</strong> résultats d’admissibilité sont transmis aux candidats<br />
dès <strong>la</strong> mi-juin.<br />
<strong>Les</strong> épreuves orales<br />
<strong>Les</strong> épreuves orales se déroulent sur une journée, soit à Paris soit à Bor<strong>de</strong>aux. <strong>Les</strong> jurys sont composés <strong>de</strong> manière<br />
équilibrée <strong>de</strong> professeurs <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sses préparatoires, <strong>de</strong> cadres d’entreprises, d’enseignants ou d’Anciens Élèves <strong>de</strong> l’<strong>INSEEC</strong>.<br />
<strong>Les</strong> épreuves orales <strong>de</strong> l’<strong>INSEEC</strong> ont un double objectif :<br />
• discerner l’aptitu<strong>de</strong> du candidat à réussir et bénéfi cier pleinement <strong>de</strong>s projets et programmes qui lui seront proposés :<br />
ouverture internationale, goût pour <strong>la</strong> communication et l’argumentaire, esprit d’entreprendre, sens <strong>de</strong> l’équipe…<br />
• susciter une première rencontre entre le candidat et l’École.<br />
Entretien<br />
individuel<br />
Entretien<br />
collectif<br />
Langues<br />
Vivantes 1<br />
Langues<br />
Vivantes 2<br />
Coefficients <strong>INSEEC</strong> - Paris - Bor<strong>de</strong>aux 12 6 7 5 30<br />
L’admission et l’inscription<br />
L’inscription se fait par <strong>la</strong> procédure centralisée SIGEM 2012.<br />
Quel que soit votre rang <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssement (liste principale + liste complémentaire),<br />
c’est vous qui déci<strong>de</strong>rez d’intégrer soit PARIS, soit BORDEAUX.<br />
Coef.<br />
Option<br />
Technologique Coef.<br />
Contraction <strong>de</strong> texte Épreuve HEC 2 Épreuve HEC 2 Épreuve HEC 2<br />
Première <strong>la</strong>ngue IENA 6 IENA 6 IENA 4<br />
Deuxième <strong>la</strong>ngue IENA 5 IENA 5 IENA 3<br />
Dissertation <strong>de</strong> culture générale Épreuve ESCP Europe 5 Épreuve ESCP Europe 5 Épreuve ESC 4<br />
Dissertation littéraire - - -<br />
Dissertation philosophique - - -<br />
Mathématiques Épreuve<br />
EM-Lyon<br />
6 Épreuve<br />
EM-Lyon<br />
5 Épreuve ESC 4<br />
Histoire, Géographie<br />
et Géopolitique<br />
Épreuve EM-Lyon 6 - -<br />
Analyse économique<br />
et historique<br />
- Épreuve EM-Lyon 7 -<br />
Économie-Droit - - Épreuve ESC 5<br />
Histoire - - -<br />
Gestion-Management - - Épreuve ESC 8<br />
Épreuve à option<br />
Total coefficients 30 30 30<br />
TOTAL
LES LEXIQUES<br />
DE L’<strong>INSEEC</strong><br />
COLLECTION DIRIGÉE PAR<br />
ERIC COBAST<br />
<strong>Les</strong> « Lexiques <strong>de</strong> l’<strong>INSEEC</strong> » viennent compléter le dispositif<br />
conçu au service <strong>de</strong>s étudiants initié par « <strong>Les</strong> Mémentos<br />
». Ils ont été rédigés par une équipe <strong>de</strong> professeurs <strong>de</strong>s<br />
C<strong>la</strong>sses Préparatoires et <strong>de</strong>s Gran<strong>de</strong>s Écoles, particulièrement<br />
sensibles aux diffi cultés rencontrées par les candidats.<br />
L’ambition <strong>de</strong> ces « Lexiques » n’est pas évi<strong>de</strong>mment <strong>de</strong> se<br />
substituer d’une manière ou d’une autre aux cours annuels<br />
mais <strong>de</strong> proposer tout simplement <strong>de</strong>s instruments effi -<br />
caces pour réussir les concours.<br />
Collection <strong>Les</strong> Lexiques <strong>de</strong> l’<strong>INSEEC</strong> 2012<br />
N° 14 : <strong>Les</strong> <strong>mots</strong> <strong>de</strong>… <strong>la</strong> <strong>Société</strong><br />
N° 15 : Lexique <strong>de</strong> Géopolitique<br />
N° 16 : Lexique d’Ang<strong>la</strong>is<br />
N° 17 : Formu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> Mathématique (voie S)<br />
<strong>INSEEC</strong><br />
Secrétariat <strong>de</strong> <strong>la</strong> Collection <strong>Les</strong> Lexiques<br />
H16 – quai <strong>de</strong> Baca<strong>la</strong>n – CS 9104<br />
33 300 Bor<strong>de</strong>aux<br />
Tél. : 05 56 01 77 26