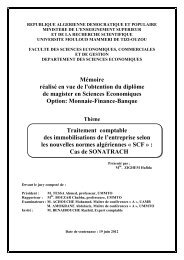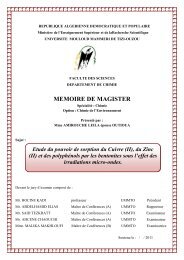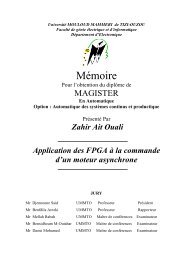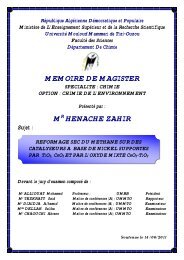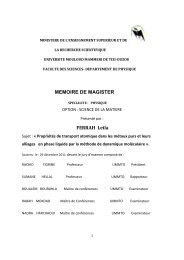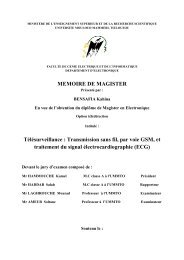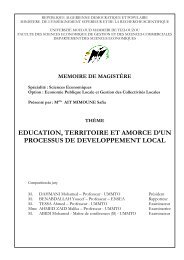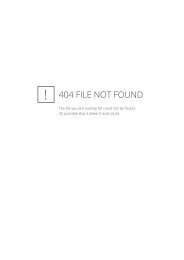Les Pratiques et monuments funéraires protohistoriques en Algérie ...
Les Pratiques et monuments funéraires protohistoriques en Algérie ...
Les Pratiques et monuments funéraires protohistoriques en Algérie ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>monum<strong>en</strong>ts</strong> à chapelle <strong>et</strong> les tombes <strong>en</strong> forme de silos) <strong>et</strong> qui, de ce fait, ne trouve pas de<br />
place dans c<strong>et</strong>te classification.<br />
La seconde critique est d’ordre classificatoire, on ne voit pas <strong>en</strong>core de distinction <strong>en</strong>tre les<br />
<strong>monum<strong>en</strong>ts</strong> de type Bazinas est les tumulus. L’auteur fait la distinction <strong>en</strong>tre Chouch<strong>et</strong>,<br />
Dolm<strong>en</strong>s, Cromlechs <strong>et</strong> tumulus, appart<strong>en</strong>ant à la catégorie des tombes <strong>en</strong> pierres sèches,<br />
alors que la Bazina est inclus dans la typologie des tumulus. Autrem<strong>en</strong>t dit, le mode<br />
constructif des Bazinas, n<strong>et</strong>tem<strong>en</strong>t développé que celui des tumulus est simplem<strong>en</strong>t occulté.<br />
La dernière est d’ordre géographique, le fait que le Sahara n’est pas intégré dans la zone<br />
d’étude porte un préjudice, certes involontaire, mais crucial à la compréh<strong>en</strong>sion de c<strong>et</strong>te<br />
frange de notre patrimoine.<br />
3.3. Classification de Gabriel Camps 1961<br />
Malgré la pertin<strong>en</strong>ce du résultat auquel il a abouti grâce à l’introduction de la donne<br />
géographique, le tableau que nous propose G. Camps pose de nombreuses interrogations.<br />
En premier lieu, la terminologie adoptée par l’auteur prête à confusion <strong>et</strong> peut induire <strong>en</strong><br />
erreur car, nous savons que la quasi-totalité des bazinas, Chouch<strong>et</strong> <strong>et</strong> dolm<strong>en</strong>s pour ne citer<br />
que ceux la, possèd<strong>en</strong>t des aménagem<strong>en</strong>ts cultuels (des allées, des bras, des ant<strong>en</strong>nes ou<br />
autres), par conséqu<strong>en</strong>t, nous pouvons aussi les considérer comme des sépultures à forme<br />
évoluée <strong>et</strong> non élém<strong>en</strong>taire comme le suggère l’auteur.<br />
Sur un autre registre, il est de notoriété que les dolm<strong>en</strong>s nord africains, malgré leur<br />
ressemblances avec ceux de la rive nord de la méditerranée, prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t, égalem<strong>en</strong>t, des<br />
différ<strong>en</strong>ces de taille : le fait de ne pas avoir de tumulus à l’origine représ<strong>en</strong>te un hiatus<br />
monum<strong>en</strong>tale pour leur attribuer le qualificatif de « sépulture importé » <strong>en</strong> référ<strong>en</strong>ce aux<br />
dolm<strong>en</strong>s europé<strong>en</strong> qui <strong>en</strong> possédai<strong>en</strong>t une couverture tumulaire à l’origine. Une autre<br />
constatation corroborant c<strong>et</strong>te hypothèse est l’abs<strong>en</strong>ce de dolm<strong>en</strong>s prés du littoral ou du moins<br />
<strong>en</strong> termes d’int<strong>en</strong>sité par rapport à l’intérieur du pays, comme le constate G. Camps luimême<br />
: « les dolm<strong>en</strong>s atteign<strong>en</strong>t le littoral algéri<strong>en</strong>, <strong>en</strong> Tunisie, ils ne pénètr<strong>en</strong>t guère dans le<br />
massif du Nord de la Medjedra <strong>et</strong> sont rare au cap bon ».<br />
En dernier, nous pouvons ajouter que la non-intégration des sépultures sahari<strong>en</strong>nes dans<br />
c<strong>et</strong>te classification est un handicap majeur, car ces dernières sont indissociables des sépultures<br />
du nord vu que le mode d’<strong>en</strong>sevelissem<strong>en</strong>t est le même au Nord comme au Sahara.<br />
3.4. La nécessité d’une nouvelle classification<br />
Comme nous v<strong>en</strong>ons de le voir, il n’existe pas une seule méthode typologique de<br />
classification. Le corpus, dans le cas nous concernant, prés<strong>en</strong>te des caractéristiques qui<br />
compliqu<strong>en</strong>t l’analyse : l’irrégularité des formes, très importante dans certains cas, peut<br />
am<strong>en</strong>er à plus de confusion lors de la distinction des types. C’est pourquoi une méthode<br />
<strong>en</strong>tièrem<strong>en</strong>t fondée sur des rapports de mesure a été exclue pour c<strong>et</strong>te première étude, ajouté à<br />
cela la contrainte du temps. Par contre, nous lui avons préféré une approche pr<strong>en</strong>ant <strong>en</strong><br />
compte des critères visuels. Notre ignorance sur les associations-types n’a <strong>en</strong> ri<strong>en</strong> <strong>en</strong>travé<br />
notre approche, au contraire, elle nous a permis une meilleure lecture comparative <strong>en</strong>tre<br />
typologies.