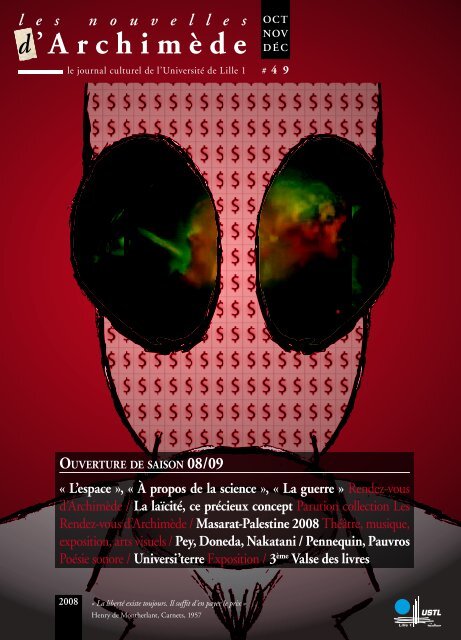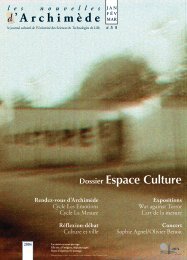les nouvelles d'Archimède #43 - Espace culture de l'université de ...
les nouvelles d'Archimède #43 - Espace culture de l'université de ...
les nouvelles d'Archimède #43 - Espace culture de l'université de ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
l e s n o u v e l l e s<br />
d<br />
’ Archimè<strong>de</strong> OCT<br />
NOV<br />
DÉC<br />
le journal <strong>culture</strong>l <strong>de</strong> l’Université <strong>de</strong> Lille 1<br />
Ou v e r t u r e d e s a i s O n 08/09<br />
« L’espace », « À propos <strong>de</strong> la science », « La guerre » Ren<strong>de</strong>z-vous<br />
d’Archimè<strong>de</strong> / La laïcité, ce précieux concept Parution collection Les<br />
Ren<strong>de</strong>z-vous d’Archimè<strong>de</strong> / Masarat-Pa<strong>les</strong>tine 2008 Théâtre, musique,<br />
exposition, arts visuels / Pey, Doneda, Nakatani / Pennequin, Pauvros<br />
Poésie sonore / Universi’terre Exposition / 3 ème Valse <strong>de</strong>s livres<br />
2008<br />
« La liberté existe toujours. Il suffit d’en payer le prix »<br />
Henry <strong>de</strong> Montherlant, Carnets, 1957<br />
# 49<br />
Lille 1
LNA#49 / édito<br />
2<br />
Nabil EL-HAGGAR<br />
Vice-prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Université <strong>de</strong><br />
Lille 1, chargé <strong>de</strong> la Culture, <strong>de</strong> la<br />
Communication et du Patrimoine<br />
Scientifique<br />
1 Hurbert Marcuse, L’homme unidimensionnel,<br />
éd. <strong>de</strong> Minuit, 1989.<br />
L’équipe<br />
Françoise POINTARD<br />
directrice <strong>de</strong> l’<strong>Espace</strong> Culture<br />
Delphine POIRETTE<br />
chargée <strong>de</strong> communication<br />
Edith DELBARGE<br />
chargée <strong>de</strong>s éditions et communication<br />
Julien LAPASSET<br />
concepteur graphique et multimédia<br />
Audrey BOSquETTE<br />
assistante aux éditions<br />
Mourad SEBBAT<br />
chargé <strong>de</strong>s initiatives étudiantes et associatives<br />
Martine DELATTRE<br />
assistante initiatives étudiantes et associatives<br />
Dominique HACHE<br />
responsable administratif<br />
Angebi ALuwANGA<br />
assistant administratif<br />
Johanne wAquET<br />
secrétaire <strong>de</strong> direction<br />
Antoine MATRION<br />
chargé <strong>de</strong> mission patrimoine scientifique<br />
Jacques SIGNABOu<br />
régisseur<br />
Joëlle MAVET<br />
café <strong>culture</strong><br />
Pas d’avenir sans diversité <strong>culture</strong>lle<br />
Le mon<strong>de</strong> est inquiet : avenir incertain,<br />
inégalités grandissantes, accroissement<br />
<strong>de</strong> la pauvreté et <strong>de</strong>s violences,<br />
régulation quasi inexistante… La politique<br />
et le modèle social européen sont dépassés.<br />
L’économie <strong>de</strong> marché est le maître<br />
absolu <strong>de</strong> « l’économie mon<strong>de</strong> ».<br />
Imaginée et développée par l’Occi<strong>de</strong>nt,<br />
cette mondialisation n’épargne pas la<br />
qualité <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s Occi<strong>de</strong>ntaux.<br />
L’unification <strong>de</strong>s marchés, l’uniformisation<br />
<strong>de</strong>s consommations et <strong>de</strong> la production,<br />
ainsi que la mondialisation <strong>de</strong>s médias et<br />
le développement <strong>de</strong> l’Internet touchent<br />
directement la diversité et la richesse <strong>culture</strong>l<strong>les</strong>.<br />
Si <strong>les</strong> spécificités socio<strong>culture</strong>l<strong>les</strong><br />
résistent à cette uniformisation, c’est en<br />
revanche le processus <strong>de</strong> nivellement <strong>culture</strong>l<br />
qui est entamé. Ce que H. Marcuse,<br />
déjà en 1964, bien avant la mondialisation<br />
économique, craignait en parlant <strong>de</strong> la<br />
technique et <strong>de</strong> la science prises dans<br />
l’engrenage d’une croissance illimitée qui<br />
annihile <strong>les</strong> hommes et leur esprit critique…,<br />
et d’ajouter : « Après la disparition <strong>de</strong> l’esprit<br />
critique, la société n’est plus qu’un espace<br />
clos unidimensionnel » 1 .<br />
C’est pourquoi le combat pour l’accès à la<br />
<strong>culture</strong> et à l’éducation est plus que jamais<br />
une priorité.<br />
Sur tous <strong>les</strong> continents, <strong>de</strong>s sociétés entières<br />
sont inquiètes sur l’avenir <strong>de</strong> la diversité<br />
<strong>culture</strong>lle et <strong>de</strong>s spécificités loca<strong>les</strong>. El<strong>les</strong><br />
se sentent menacées dans leur existence<br />
propre par l’uniformisation au niveau<br />
mondial. Si, par le passé, <strong>de</strong>s <strong>culture</strong>s dominantes<br />
ont ethnocidé <strong>culture</strong>llement <strong>de</strong>s<br />
sociétés entières, l’uniformisation – aussi<br />
mondialisée soit-elle – ne peut que faiblir<br />
<strong>de</strong>vant cette diversité <strong>culture</strong>lle que l’on<br />
sait inhérente à l’homme par rapport au<br />
mon<strong>de</strong>. L’avenir <strong>de</strong> l’homme n’est ainsi<br />
concevable que dans la différence.<br />
La Laïcité<br />
Le 19 ème ouvrage <strong>de</strong> la collection Les<br />
Ren<strong>de</strong>z-vous d’Archimè<strong>de</strong> paraîtra en<br />
novembre 2008 aux éditions l’Harmattan.<br />
Je rappelle à nos lecteurs que tous<br />
<strong>les</strong> ouvrages <strong>de</strong> cette collection – dont la<br />
<strong>de</strong>rnière parution en <strong>de</strong>ux tomes, À propos<br />
<strong>de</strong> la <strong>culture</strong> – peuvent être consultés<br />
librement à l’<strong>Espace</strong> Culture et sont en<br />
vente dans <strong>les</strong> librairies.<br />
Les Ren<strong>de</strong>z-vous d’Archimè<strong>de</strong><br />
Comme chaque saison, nous proposons<br />
trois thèmes au public que nous espérons<br />
encore plus nombreux :<br />
La guerre : un cycle <strong>de</strong> sept conférences<br />
et une journée d’étu<strong>de</strong>s consacrée à la<br />
problématique Guerre et religions ;<br />
L’espace : un cycle <strong>de</strong> douze conférences,<br />
dont quatre dans le cadre <strong>de</strong> l’Année<br />
Mondiale <strong>de</strong> l’Astronomie ;<br />
À propos <strong>de</strong> la science : un cycle <strong>de</strong> sept<br />
conférences, dont quatre dans le cadre<br />
<strong>de</strong> l’Année Internationale <strong>de</strong> la Planète<br />
Terre.<br />
Nous abor<strong>de</strong>rons, lors <strong>de</strong>s Cafés-sciences,<br />
<strong>de</strong>s thèmes liés à l’actualité scientifique et<br />
technique.<br />
L’invité, la Pa<strong>les</strong>tine<br />
Masarat-Pa<strong>les</strong>tine 2008 est un projet mené<br />
à l’initiative du Commissariat Général<br />
aux Relations Internationa<strong>les</strong> et <strong>de</strong> la<br />
Délégation Générale <strong>de</strong> la Pa<strong>les</strong>tine auprès<br />
<strong>de</strong> l’Union Européenne, <strong>de</strong> la Belgique et<br />
du Luxembourg, sous le haut patronage <strong>de</strong><br />
la Ministre <strong>de</strong>s Relations Internationa<strong>les</strong> <strong>de</strong><br />
la Communauté française <strong>de</strong> Belgique et <strong>de</strong><br />
Mahmoud Darwish.<br />
Masarat-Pa<strong>les</strong>tine déconstruit <strong>les</strong> clichés<br />
qui nous habitent – télévisuels, journalistiques<br />
– voire même <strong>les</strong> représentations<br />
<strong>les</strong> plus familières venues <strong>de</strong> la militance.<br />
Masarat-Pa<strong>les</strong>tine à Lille 1 se veut parcours<br />
et chemins pluriels en opérant<br />
un focus sur la production visuelle et<br />
plastique à travers la présentation d’une<br />
exposition, du cinéma, du théâtre, <strong>de</strong> la<br />
musique...<br />
Mahmoud Darwish nous a quitté le 9 août<br />
2008. Porte-parole <strong>de</strong> la tragédie pa<strong>les</strong>tinienne,<br />
pilier <strong>de</strong> la littérature pa<strong>les</strong>tinienne<br />
et arabe, il fut le chant <strong>de</strong>s oiseaux migrateurs<br />
qui atten<strong>de</strong>nt éternellement le retour,<br />
il restera la voix <strong>de</strong> la misère <strong>de</strong>s enfants aux<br />
pieds nus <strong>de</strong>s camps <strong>de</strong> réfugiés...<br />
La citation<br />
Henry <strong>de</strong> Montherlant nous accompagne<br />
tout au long <strong>de</strong> cette saison 2008-<br />
2009, avec ces mots : « La liberté existe<br />
toujours. Il suffit d’en payer le prix ».
L’espace<br />
4-5 La genèse <strong>de</strong> l’espace chez l’enfant par Gérard Vergnaud<br />
6-8 De l’invention <strong>de</strong> la perspective à la construction <strong>de</strong> l’espace et <strong>de</strong> l’infini<br />
actuel par Jean-Pierre Le Goff<br />
À propos <strong>de</strong> la science<br />
9 Le géosystème et la prose, vous connaissez ? par Francis Meilliez<br />
La guerre<br />
10-11 Où va la guerre ? par Alain Cambier<br />
Rubriques<br />
12-13 Paradoxes par Jean-Paul Delahaye<br />
14-16 Mémoires <strong>de</strong> science par Robert Locqueneux<br />
17-19 Repenser la politique par Alain Cambier<br />
20-21 À lire par Rudolf Bkouche<br />
22-23 À lire par Bernard Maitte<br />
24-25 Jeux littéraires par Robert Rapilly<br />
26-27 Vivre <strong>les</strong> sciences, vivre le droit… par Jean-Marie Breuvart<br />
28-29 L’art et la manière par Corinne Melin<br />
30-31 Questions <strong>de</strong> sciences socia<strong>les</strong> par Jacques Lemière<br />
Libres propos<br />
32-33 Nanotechnologies par Louis Laurent<br />
34-36 Qu’est-ce, au juste, qu’un philosophe ? Hommage à Jean-François<br />
Lyotard par Jean-François Rey<br />
Au programme<br />
37-38 Ouverture <strong>de</strong> saison<br />
39 Ren<strong>de</strong>z-vous d’Archimè<strong>de</strong> : Cycle « L’espace »<br />
40 Ren<strong>de</strong>z-vous d’Archimè<strong>de</strong> : Cycle « À propos <strong>de</strong> la science »<br />
41 Ren<strong>de</strong>z-vous d’Archimè<strong>de</strong> : Cycle « La guerre »<br />
42 Collection Les Ren<strong>de</strong>z-vous d’Archimè<strong>de</strong> : nouvelle parution<br />
« La laïcité, ce précieux concept »<br />
43 Question <strong>de</strong> sens : Cycle « Chemins d’humanisation »<br />
44 Les enjeux d’une politique patrimoniale universitaire<br />
45 Exposition : Universi’terre<br />
46-47 Poésie sonore : Pey - Doneda - Nakatani / Pennequin - Pauvros<br />
48-49 Masarat-Pa<strong>les</strong>tine 2008<br />
50 Valse <strong>de</strong>s livres / Les soirées du Premier Quartier<br />
51 Atelier danse Butô<br />
À noter pages 48-49 :<br />
Masarat-Pa<strong>les</strong>tine<br />
2008<br />
sommaire / LNA#49<br />
LES NOUVELLES D’ARCHIMÈDE<br />
Directeur <strong>de</strong> la publication : Philippe ROLLET<br />
Directeur <strong>de</strong> la rédaction : Nabil EL-HAGGAR<br />
Comité <strong>de</strong> rédaction : Rudolf BKOUCHE<br />
Youcef BOUDJEMAI<br />
Jean-Marie BREUVART<br />
Alain CAMBIER<br />
Jean-Paul DELAHAYE<br />
Bruno DURIEZ<br />
Rémi FRANCKOWIAK<br />
Robert GERGONDEY<br />
Jacques LEMIÈRE<br />
Bernard MAITTE<br />
Corinne MELIN<br />
Françoise POINTARD<br />
Robert RAPILLY<br />
Jean-François REY<br />
Rédaction - Réalisation : Delphine POIRETTE<br />
Edith DELBARGE<br />
Julien LAPASSET<br />
Impression : Imprimerie Delezenne<br />
ISSN : 1254 - 9185<br />
3
LNA#49 / cycle l'espace<br />
4<br />
La genèse <strong>de</strong> l’espace chez l’enfant<br />
Le développement <strong>de</strong>s compétences spatia<strong>les</strong> est important<br />
chez l’enfant, et précoce : à l’âge <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ans,<br />
<strong>les</strong> enfants disposent déjà <strong>de</strong> compétences différenciées en<br />
matière <strong>de</strong> localisation <strong>de</strong>s objets, <strong>de</strong> reconnaissance <strong>de</strong>s<br />
configurations spatia<strong>les</strong>, d’orientation <strong>de</strong>s parcours. Ces<br />
compétences reposent sur <strong>de</strong>s concepts non explicites mais<br />
néanmoins opératoires. Ce sont <strong>de</strong>s concepts-en-acte. Le<br />
langage n’est pas encore véritablement impliqué dans <strong>les</strong><br />
processus <strong>de</strong> conceptualisation. Il le sera plus tard.<br />
Une première idée importante est que le développement<br />
<strong>de</strong>s représentations spatia<strong>les</strong> est étroitement associé à<br />
la conceptualisation <strong>de</strong>s objets (ce sont eux qui occupent<br />
et structurent l’espace) et à l’activité gestuelle et<br />
perceptive <strong>de</strong> l’enfant, qui témoigne justement <strong>de</strong>s changements<br />
<strong>de</strong> représentation. Mon premier exemple n’intervient<br />
qu’au cours <strong>de</strong> la <strong>de</strong>uxième année ; il est particulièrement<br />
spectaculaire et il met bien en évi<strong>de</strong>nce ce qu’est une<br />
prise <strong>de</strong> conscience dans le domaine <strong>de</strong> l’espace.<br />
Le miroir : un bébé qui se regar<strong>de</strong> dans un miroir n’a pas<br />
pleinement conscience que c’est lui, le bébé dans le miroir.<br />
Il croit d’abord que c’est un autre bébé, qu’il pourrait toucher<br />
en avançant la main vers le miroir, ou retrouver en<br />
contournant le miroir. Si on fait une marque repérable sur<br />
son front, le bébé n’interprète pas cette marque comme<br />
étant sur son front, mais sur celui du bébé dans le miroir,<br />
et il essaye <strong>de</strong> l’effacer en avançant la main vers le miroir.<br />
Vers 15 ou 18 mois, dans le meilleur <strong>de</strong>s cas, l’enfant prend<br />
conscience que c’est bien sur son propre front qu’est inscrite<br />
la marque, et il y porte la main. Cette prise <strong>de</strong> conscience<br />
est définitive, ce qui témoigne d’une conceptualisation nouvelle.<br />
Les singes d’espèces supérieures acquièrent aussi cette<br />
compétence (mais pas toutes <strong>les</strong> espèces) et <strong>de</strong>s recherches<br />
relativement récentes ont mis cette compétence en évi<strong>de</strong>nce<br />
chez <strong>les</strong> éléphants. Beaucoup d’animaux réputés intelligents<br />
en restent privés.<br />
Après <strong>de</strong>ux ans, et même s’ils n’hésitent pas à porter la main<br />
à leur front pour effacer la tache qui s’y trouve, <strong>les</strong> bébés<br />
hésitent encore sur le statut du personnage du miroir et peuvent<br />
encore imaginer le rencontrer en contournant le miroir.<br />
La prise <strong>de</strong> conscience complète peut donc <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r plusieurs<br />
étapes.<br />
La coordination <strong>de</strong>s gestes et <strong>de</strong>s espaces : en amont <strong>de</strong><br />
cette prise <strong>de</strong> conscience, <strong>les</strong> nourrissons apprennent à coordonner<br />
leurs gestes pour attraper un objet, ou pour trouver<br />
un moyen <strong>de</strong> le rapprocher, ou encore pour le frapper avec<br />
Par Gérard VERGNAUD<br />
Directeur <strong>de</strong> recherche émérite au CNRS<br />
En conférence le 18 novembre<br />
une main en le tenant avec l’autre main. Ils découvrent<br />
ainsi, progressivement, que l’espace exploré par le regard,<br />
celui exploré par la main droite et celui exploré par la main<br />
gauche sont un seul et même espace. Cela ne se fait pas en<br />
un jour. Dans le même temps, <strong>les</strong> changements d’apparence<br />
d’un objet selon son orientation et selon le point <strong>de</strong> vue d’où<br />
l’enfant le perçoit (sous tel ou tel angle, plus ou moins éloigné)<br />
sont intégrés dans une vision unique : c’est le premier<br />
invariant opératoire.<br />
L’objet permanent : une autre découverte importante du<br />
bébé, relevée par Piaget 1 puis par <strong>de</strong> nombreux autres chercheurs,<br />
concerne la conviction, acquise assez tardivement,<br />
qu’un objet disparu <strong>de</strong>rrière un écran peut être retrouvé<br />
soit en déplaçant l’écran, soit en contournant l’obstacle, et<br />
en annulant ainsi la disparition <strong>de</strong> l’objet par <strong>de</strong>s déplacements.<br />
La conceptualisation <strong>de</strong>s déplacements est constitutive<br />
du concept d’espace. Avant la prise <strong>de</strong> conscience par<br />
le bébé, vers 8 ou 9 mois, que l’objet disparu peut ainsi être<br />
retrouvé, celui-ci cesse pratiquement d’exister. Si l’on interpose<br />
<strong>de</strong>ux écrans au lieu d’un, le bébé reste troublé jusque<br />
vers 18 mois. Le concept d’invariant opératoire prend ainsi<br />
un relief nouveau, puisqu’il concerne alors un objet non<br />
accessible à la perception. Dans <strong>les</strong> sciences, <strong>de</strong> nombreux<br />
objets <strong>de</strong> pensée résultent d’une construction hypothétique<br />
et ne sont donc pas accessib<strong>les</strong> à la perception. Leur conceptualisation<br />
en est plus redoutable.<br />
La coordination <strong>de</strong> points <strong>de</strong> vue différents : une autre<br />
expérience spectaculaire <strong>de</strong> Piaget, reprise <strong>de</strong> nombreuses<br />
fois par <strong>les</strong> chercheurs, consiste dans la disposition <strong>de</strong> plusieurs<br />
objets sur une table ron<strong>de</strong>, et <strong>de</strong> plusieurs « photographes<br />
» autour <strong>de</strong> la table, <strong>de</strong> telle sorte que certains<br />
photographes ne puissent pas voir tous <strong>les</strong> objets, <strong>les</strong> uns<br />
étant cachés par <strong>les</strong> autres. Piaget met en évi<strong>de</strong>nce que <strong>les</strong><br />
enfants, jusqu’à 7 ou 8 ans, ont tendance à privilégier leur<br />
point <strong>de</strong> vue propre et à attribuer aux photographes placés<br />
ailleurs la vue qui est la leur, et qui ne respecte donc pas<br />
<strong>les</strong> relations <strong>de</strong>vant/<strong>de</strong>rrière et gauche/droite perçues par<br />
l’autre photographe. Cet égocentrisme ne fait place que<br />
très lentement à la décentration. L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s erreurs montre<br />
que cette décentration implique <strong>de</strong>s calculs relationnels<br />
1 Piaget J., Inhel<strong>de</strong>r B., La représentation <strong>de</strong> l’espace chez l’enfant, Paris, Presses<br />
Universitaires <strong>de</strong> France, 1948.
elativement complexes, qui témoignent <strong>de</strong> la coexistence<br />
<strong>de</strong> plusieurs géométries : celle <strong>de</strong>s figures, celle <strong>de</strong>s positions,<br />
celle <strong>de</strong>s transformations.<br />
L’expression langagière <strong>de</strong>s relations spatia<strong>les</strong> : lorsque<br />
l’enfant commence à parler et à échanger avec son entourage,<br />
le lexique <strong>de</strong>s relations spatia<strong>les</strong> et la syntaxe <strong>de</strong> l’énonciation<br />
vont <strong>de</strong>voir se développer pendant plusieurs années.<br />
On peut désigner cette question par la relation entre la forme<br />
opératoire et la forme prédicative <strong>de</strong>s connaissances<br />
spatia<strong>les</strong>. La phase <strong>de</strong> l’apprentissage <strong>de</strong>s prépositions et<br />
<strong>de</strong>s adverbes relatifs à l’espace peut durer plusieurs années,<br />
comme d’ailleurs l’apprentissage <strong>de</strong> la langue maternelle :<br />
pourtant, à 4 ans et <strong>de</strong>mi, <strong>les</strong> enfants en ont une connaissance<br />
convenable. Cela ne signifie pas, bien entendu, qu’ils<br />
n’ont plus rien à apprendre, en particulier concernant l’expression<br />
<strong>de</strong>s propriétés géométriques <strong>de</strong> l’espace mais, pour<br />
l’essentiel, le rapport est fait entre <strong>les</strong> ressources langagières<br />
et <strong>les</strong> ressources issues <strong>de</strong> l’activité perceptivo-gestuelle. Est<br />
notamment concerné l’emploi <strong>de</strong>s expressions près <strong>de</strong>, loin<br />
<strong>de</strong>, <strong>de</strong>vant, <strong>de</strong>rrière, en face <strong>de</strong>, dans le dos <strong>de</strong>, à gauche, à<br />
droite, avant, après, en avant, en arrière, en <strong>de</strong>ssus, en <strong>de</strong>ssous,<br />
sur, sous, à, contre, dans, hors <strong>de</strong>, en <strong>de</strong>dans, en <strong>de</strong>hors…<br />
La thèse principale <strong>de</strong> Van<strong>de</strong>loise 2 , dans son livre L’espace<br />
en français, est que la <strong>de</strong>scription géométrique <strong>de</strong> l’espace<br />
et la <strong>de</strong>scription logique <strong>de</strong>s relations spatia<strong>les</strong> (du type symétrie<br />
ou asymétrie) ne ren<strong>de</strong>nt pas compte <strong>de</strong> leur sémantique,<br />
et qu’il faut s’intéresser aux aspects fonctionnels <strong>de</strong>s<br />
mouvements du corps dans l’espace. À côté <strong>de</strong>s trois directions<br />
qui structurent l’espace géométrique, et dont nous<br />
avons une représentation utile avec le repère égocentré, l’axe<br />
vertical et <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux directions frontale et latérale, il faut<br />
ajouter l’orientation du mouvement <strong>de</strong> l’objet par rapport<br />
auquel on s’exprime, la ligne du regard, l’importance relative<br />
<strong>de</strong> la cible (dont on parle) et du site (par rapport auquel<br />
on situe la cible), le caractère tridimensionnel ou non du<br />
site, ou encore le caractère accessible ou non <strong>de</strong> l’objet.<br />
L’enfant est <strong>de</strong>rrière la voiture peut être entendu <strong>de</strong> plusieurs<br />
manières : il est <strong>de</strong> l’autre côté <strong>de</strong> la voiture par rapport à<br />
l’endroit où se trouve le locuteur ou le <strong>de</strong>stinataire, ou bien il<br />
est du côté <strong>de</strong> l’arrière <strong>de</strong> la voiture.<br />
Les bijoux sont dans la boîte présuppose que le contenant<br />
est tridimensionnel, ce qui n’est pas le cas <strong>de</strong> l’énoncé nous<br />
faisions la queue dans la même file.<br />
2 Van<strong>de</strong>loise C., L’espace en français, Paris, éd. du Seuil, 1986.<br />
cycle l'espace / LNA#49<br />
La bicyclette est <strong>de</strong>vant la maison se dit, tandis que la maison<br />
est <strong>de</strong>rrière la bicyclette ne se dit pas. En d’autres termes, <strong>les</strong><br />
coup<strong>les</strong> <strong>de</strong> prépositions R et R’ qui vont par <strong>de</strong>ux, comme<br />
<strong>de</strong>vant/<strong>de</strong>rrière ou gauche/droite, ne permettent pas tous<br />
d’inférer bR’a à partir <strong>de</strong> aRb, en tout cas pas toujours : il<br />
existe <strong>de</strong>s conditions, <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> ne relèvent ni <strong>de</strong> la logique<br />
ni même <strong>de</strong> la géométrie seulement.<br />
De même, on ne peut pas dire que la table est au-<strong>de</strong>ssus du<br />
ballon, même si le ballon est au-<strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> la table.<br />
Van<strong>de</strong>loise retient plusieurs idées :<br />
La ligne du regard est un trait important <strong>de</strong> l’activité perceptive.<br />
L’accès à la perception notamment est fondamental<br />
dans l’usage <strong>de</strong>s prépositions : le coffre-fort est <strong>de</strong>rrière le<br />
tableau, ou sous le tableau. Toutes <strong>de</strong>ux expriment le non<br />
accès à la perception tout en indiquant la position <strong>de</strong> l’objet<br />
recherché. Le mot sous n’a plus rien à voir avec la dimension<br />
verticale <strong>de</strong> l’espace.<br />
Les relations contenant/contenu contribuent au sens <strong>de</strong><br />
plusieurs relations : il y a du vin dans le verre ; il y a une mouche<br />
dans le verre ; il y a un oiseau dans l’arbre ; mais il y a <strong>de</strong>s<br />
extensions possib<strong>les</strong> : l’arbre est dans le pot ou encore dans<br />
la terre ; le fil est dans l’aiguille. La relation porteur/porté<br />
joue un rôle également, notamment pour <strong>les</strong> prépositions<br />
relatives à la verticalité sur, sous, au-<strong>de</strong>ssus, au-<strong>de</strong>ssous.<br />
Une autre idée concerne la rencontre potentielle : dans un<br />
mouvement, on peut faire dire à la même préposition <strong>de</strong>s<br />
sens apparemment opposés. Par exemple, le maillot jaune<br />
est avant le maillot vert (dans un sprint) indique le fait que<br />
le maillot jaune précè<strong>de</strong> le maillot vert (<strong>les</strong> <strong>de</strong>ux sont en<br />
mouvement) ; par contre, l’antiquaire est avant la cathédrale<br />
indique le fait que la rencontre du magasin <strong>de</strong> l’antiquaire<br />
précè<strong>de</strong> la rencontre <strong>de</strong> la cathédrale (c’est le locuteur et le<br />
<strong>de</strong>stinataire du message qui sont potentiellement en mouvement).<br />
Un autre exemple est celui du caractère fixe ou mobile <strong>de</strong> la<br />
cible et du site : regar<strong>de</strong> l’étoile filante, près du clocher se dit ;<br />
regar<strong>de</strong> le clocher, près <strong>de</strong> l’étoile filante ne se dit pas.<br />
En conclusion, Van<strong>de</strong>loise avance la thèse suivante : « Plus<br />
que la <strong>de</strong>scription formelle d’un mon<strong>de</strong> statique, le<br />
langage est adapté à la <strong>de</strong>scription fonctionnelle d’un<br />
mon<strong>de</strong> en mouvement ».<br />
5
LNA#49 / cycle l'espace<br />
6<br />
De l’invention <strong>de</strong> la perspective<br />
à la construction <strong>de</strong> l’espace et <strong>de</strong> l’infini actuel<br />
Le Quattrocento italien va (ré- ?)inventer la perspective<br />
centrale : puis, <strong>de</strong>ux cents ans plus tard, Girard Desargues 1<br />
réalisera la synthèse <strong>de</strong> cette science perspective et <strong>de</strong> la théorie<br />
<strong>de</strong>s coniques fondée par <strong>les</strong> Grecs : c’est ce qu’affirme, non<br />
sans raison, l’histoire récurrente <strong>de</strong>s origines. Cependant, dans<br />
cette version <strong>de</strong>s faits, historiens d’art et historiens <strong>de</strong>s sciences<br />
occultent souvent certains aspects <strong>de</strong> la question :<br />
- le procès <strong>de</strong> production réel <strong>de</strong> cette scientia nova, en particulier<br />
la diversité et la multitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s approches, <strong>de</strong>s étapes,<br />
voire <strong>de</strong>s impasses, pour ne retenir que la voie royale supposée.<br />
Selon l’histoire classique<br />
<strong>de</strong>s origines, pour ne<br />
prendre que cet exemple,<br />
tout découlerait <strong>de</strong> l’invention<br />
du point <strong>de</strong> fuite central<br />
– ce point du sujet, comme<br />
le nommera Jean Pèlerin<br />
Viator au début du XVI ème<br />
siècle –, point donné comme<br />
naturel et d’évi<strong>de</strong>nce ;<br />
et le débat porte alors quasi<br />
uniquement sur le moment<br />
et/ou le lieu <strong>de</strong> cette invention<br />
: le Trecento, chez<br />
Giotto par exemple ? La tradition<br />
italienne, qui serait<br />
caractérisée par un point <strong>de</strong><br />
fuite central, ou celle d’Europe<br />
du Nord, qui aurait eu<br />
l’intuition <strong>de</strong>s tiers-points<br />
dans ses vues d’angle ? Le<br />
moment théorique – une<br />
sorte <strong>de</strong> rupture épistémologique<br />
– qu’auraient institué<br />
Brunel<strong>les</strong>chi et Alberti<br />
dans la Florence <strong>de</strong>s années<br />
1420-30 ?<br />
Cette approche relève, selon<br />
nous (fig. 1), d’une vision rétrospective – au double sens du<br />
terme « vision », visuel et conceptuel, ici intimement liés – ;<br />
1 Girard Desargues (1591-1661), ingénieur, géomètre et architecte lyonnais, ami<br />
<strong>de</strong> René Descartes, qui lui accor<strong>de</strong> une gran<strong>de</strong> estime. Il rédigea un Brouillon<br />
Project… sur <strong>les</strong> coniques où il définit <strong>les</strong> éléments à l’infini <strong>de</strong> ce qui <strong>de</strong>viendra<br />
la géométrie projective avec Poncelet au XIX ème siècle, et un invariant numérique<br />
dans <strong>les</strong> transformations <strong>de</strong> cette géométrie, l’involution <strong>de</strong> six points, qui préfigure<br />
le birapport <strong>de</strong> quatre points <strong>de</strong> Poncelet. Il eut pour élève, en géométrie,<br />
Blaise Pascal (1623-1662), auteur d’un traité <strong>de</strong>s coniques aujourd’hui perdu.<br />
Par Jean-Pierre LE GOFF<br />
Professeur <strong>de</strong> mathématiques et historien <strong>de</strong>s sciences<br />
à l’IUFM et l’IREM <strong>de</strong> l’Université <strong>de</strong> Caen (Basse-Normandie)<br />
Figure 1. – Point n’est besoin du point F – point <strong>de</strong> fuite <strong>de</strong>s<br />
apparences <strong>de</strong> droites « fuyant » au droit du regard, perpendiculairement<br />
au plan <strong>de</strong> projection, et donc parallè<strong>les</strong> entre el<strong>les</strong> dans<br />
la réalité, pour donner l’illusion d’une dégradation <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>urs<br />
« en accord » avec ce que la vision semble indiquer ; une simple<br />
réduction proportionnelle sur une subdivision <strong>de</strong> AB reconduite<br />
sur CD (si AB et CD sont éga<strong>les</strong> dans le réel) permet <strong>de</strong> donner<br />
l’illusion d’un « plancher » ou d’une série d’arca<strong>de</strong>s. Certes, <strong>les</strong><br />
lignes <strong>de</strong> jonction <strong>de</strong>s points qui subdivisent AB et CD convergent<br />
alors en un point F (sans existence physique si le plancher<br />
se limite à CD en profon<strong>de</strong>ur), mais il n’est pas nécessaire <strong>de</strong> le<br />
convoquer comme un point <strong>de</strong> construction pour la subdivision<br />
<strong>de</strong> CD et la métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> réduction proportionnelle est beaucoup<br />
plus conforme à l’esprit <strong>de</strong> la géométrie euclidienne que l’usage<br />
<strong>de</strong> lignes fictives (ici en pointillés). L’effet <strong>de</strong> fuite est analogue,<br />
que AB et CD aient une médiatrice commune ou non, ou que<br />
la figure à réduire soit une ligne droite ou une figure complexe.<br />
Le point <strong>de</strong> fuite central apparaît donc comme une conséquence<br />
<strong>de</strong> pratiques empiriques plus en accord avec <strong>les</strong> conceptions géométriques<br />
du temps, plutôt que comme un point <strong>de</strong> départ <strong>de</strong> la<br />
métho<strong>de</strong>, un passage initial obligé.<br />
En conférence le 9 décembre<br />
- <strong>les</strong> conditions épistémologiques <strong>de</strong> ce procès, qui supposent<br />
<strong>de</strong> prendre en compte <strong>les</strong> connaissances géométriques<br />
– théoriques et pratiques – effectives <strong>de</strong>s inventeurs <strong>de</strong> la<br />
première Renaissance, qui obligent l’historien à se dépouiller<br />
<strong>de</strong>s connaissances accumulées <strong>de</strong>puis l’invention, voire<br />
même ce que cette invention comporte en soi <strong>de</strong> conséquences<br />
reconnues et assimilées, <strong>de</strong>venues « secon<strong>de</strong> nature » en<br />
quelque sorte. Les histoires <strong>de</strong> la perspective font fi <strong>de</strong> ce<br />
qu’est la géométrie euclidienne, au sens d’une géométrie <strong>de</strong><br />
la doxa euclidienne, au Moyen Âge et à la Renaissance ; <strong>les</strong><br />
effets <strong>de</strong> cette doxa sont encore<br />
sensib<strong>les</strong> aux XVII ème<br />
et XVIII ème sièc<strong>les</strong>, c’est-àdire<br />
après la mise en scène<br />
<strong>de</strong> la Nouvelle Analyse <strong>de</strong><br />
Descartes ; <strong>les</strong> Éléments,<br />
faut-il le rappeler, sont, après<br />
la Bible, l’ouvrage le plus fréquemment<br />
réédité jusqu’au<br />
XX ème siècle, dans le mon<strong>de</strong><br />
occi<strong>de</strong>ntal : même si l’ordre<br />
synthétique euclidien d’exposition<br />
est régulièrement<br />
remis en cause quant à ses<br />
prétendues vertus pédagogiques,<br />
par exemple par <strong>les</strong><br />
théoriciens <strong>de</strong> Port-Royal<br />
(Arnaud et Nicole), dans<br />
certains ordres enseignants<br />
(l’Oratorien B. Lamy, v. g.),<br />
ou chez tel ou tel esprit <strong>de</strong>s<br />
Lumières (Clairaut, v. g.).<br />
Certes, il est indéniable<br />
que l’innovation <strong>de</strong> l’architecte<br />
Brunel<strong>les</strong>chi, vers<br />
1420, relève d’une prise <strong>de</strong><br />
position <strong>de</strong> l’humain comme<br />
maître et possesseur <strong>de</strong> la nature, ou du moins <strong>de</strong> sa représentation<br />
illusionniste non empirique : une sorte <strong>de</strong> vi<strong>de</strong>o ergo<br />
sum, avant la lettre <strong>de</strong> Descartes. Et que, creusant le même<br />
sillon, peintres, ingénieurs et architectes européens, et particulièrement<br />
le géomètre lyonnais Desargues, ont jeté <strong>les</strong><br />
fon<strong>de</strong>ments <strong>de</strong> concepts et d’objets nouveaux, puis <strong>les</strong> ont<br />
construits et donnés à voir et à entendre tout au long <strong>de</strong> ce<br />
procès <strong>de</strong> production – 400 ans séparent <strong>les</strong> idées d’Alberti<br />
<strong>de</strong> cel<strong>les</strong> <strong>de</strong> Poncelet –, à savoir : l’espace homogène antérieur
à la matière qui l’habite et l’infini actuel, réifiable – puisque<br />
représenté par <strong>les</strong> fameux points et autres lignes <strong>de</strong> fuite –,<br />
au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la cosa mentale.<br />
Notons que le déploiement <strong>de</strong> ces innovations radica<strong>les</strong><br />
contribuera amplement à l’émergence <strong>de</strong> la rationalité au<br />
Grand Siècle, puis à l’industrialisation du mon<strong>de</strong> occi<strong>de</strong>ntal,<br />
dans la mesure où el<strong>les</strong> vont engendrer d’autres représentations<br />
géo-(maî)-trisées du réel – perspectives parallè<strong>les</strong>,<br />
cavalière, militaire, axonométriques, par exemple, où l’œil<br />
du « spectateur » est « rejeté à l’infini », comme un œil divin<br />
sur sa création – : cel<strong>les</strong>-ci autorisent, en effet, la restitution<br />
du réel ou du fabriqué et, par voie <strong>de</strong> conséquence, sa reproductibilité<br />
à l’i<strong>de</strong>ntique ; même si <strong>les</strong> projections perspectives<br />
ne sont pas bijectives, <strong>les</strong> doub<strong>les</strong> projections donnent<br />
la maîtrise <strong>de</strong> la troisième dimension : c’est, en résumé, ce<br />
qu’énonce Gaspard Monge avec sa Géométrie <strong>de</strong>scriptive, à<br />
la fin du XVIII ème siècle. C’est un point qui fait question :<br />
l’histoire <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> représentation, à laquelle participent<br />
ces mathématiciens (d’un genre si particulier, comme Piero<br />
<strong>de</strong>lla Francesca, qu’on oublie parfois <strong>de</strong> <strong>les</strong> mentionner es<br />
qualité), est minorée au regard <strong>de</strong>s « gran<strong>de</strong>s découvertes »<br />
<strong>de</strong> la Renaissance : l’imprimerie ou le recul <strong>de</strong>s limites du<br />
mon<strong>de</strong> méditerranéen découvrant <strong>de</strong>s In<strong>de</strong>s sur son occi<strong>de</strong>nt<br />
et <strong>les</strong> nommant « nouvel<strong>les</strong> », puisque différentes <strong>de</strong> cel<strong>les</strong><br />
qu’il connaît en son orient, ou encore, au Grand Siècle, l’avènement<br />
<strong>de</strong> l’algèbre littérale, <strong>de</strong> la géométrie analytique et<br />
du calcul infinitésimal.<br />
Pour autant, il serait préjudiciable à une histoire non fictionnelle<br />
<strong>de</strong> la perspective d’accepter sans examen <strong>de</strong>s déclarations<br />
tel<strong>les</strong> que : « Giotto – ou : le Trecento – a inventé<br />
l’espace » ; ou encore : « dans <strong>les</strong> vedute <strong>de</strong>s peintres <strong>de</strong> la<br />
première Renaissance, le point <strong>de</strong> fuite principal est souvent surcadré<br />
par telle porte ou telle fenêtre ; c’est donc que ces <strong>de</strong>rnières<br />
‘ouvrent sur l’infini’ ». Que Giotto donne à voir, si ce n’est<br />
l’espace, du moins une « boîte d’espace », est un fait ; <strong>de</strong>rechef,<br />
que <strong>les</strong> dites vedute pointent l’infini, a posteriori, est<br />
encore un fait ; mais que ces faits manifestent une pensée<br />
conceptuelle consciente <strong>de</strong> la rupture qu’ils consomment et<br />
<strong>de</strong> leur irréductibilité avec le mon<strong>de</strong> commun <strong>de</strong>s contemporains<br />
du moment est tout autre chose : « l’espace » d’un<br />
Giotto ou d’un Alberti n’est pas défini comme forme a priori.<br />
Ne serait-ce que parce que la distinction entre matière et<br />
étendue, figure primitive <strong>de</strong> ce que nous appelons l’espace,<br />
ne s’opère guère, en particulier en termes géométriques,<br />
qu’au début du XVII ème siècle, sous l’influence <strong>de</strong> la pensée<br />
arguésienne sur Blaise Pascal et ses amis jansénistes <strong>de</strong> Port-<br />
Royal ; pour donner un contre-exemple et non <strong>de</strong>s moindres,<br />
Descartes lui-même, anti-scholastique s’il en est, philosophe<br />
d’une nouvelle métaphysique qu’il lui faut élaborer sur une<br />
nouvelle physique et à l’ai<strong>de</strong> d’une Métho<strong>de</strong> inspirée <strong>de</strong><br />
cycle l'espace / LNA#49<br />
sa Nouvelle analyse (sa Géométrie <strong>de</strong> 1636), reste attaché au<br />
principe aristotélo-thomiste qui affirme que « la Nature a<br />
horreur du vi<strong>de</strong> ».<br />
Un peu d’étymologie permet <strong>de</strong> replacer <strong>les</strong> concepts en<br />
contexte : espace nous vient <strong>de</strong> spatium, c’est-à-dire <strong>de</strong> l’idée<br />
d’intervalle, celui qui se trouve situé entre <strong>les</strong> soli<strong>de</strong>s, fait<br />
d’air ou d’éther, matière volatile ou « subtile », puisque toute<br />
étendue est matière, faite <strong>de</strong> l’un <strong>de</strong> ses cinq états ou d’un<br />
autre : Descartes ne dit rien d’autre avec ses « tourbillons »,<br />
qui peuvent seuls expliquer le mouvement <strong>de</strong>s corps cé<strong>les</strong>tes par<br />
frottement et entraînement, tant il est vrai que toute autre<br />
hypothèse supposerait <strong>de</strong>s forces « occultes ».<br />
Quant à l’infinitum, c’est l’interminé, l’inachevé, plus que<br />
l’interminable ou l’inépuisable, c’est-à-dire la marque d’une<br />
déception, d’un manque, d’une imperfection plus que d’une<br />
qualité positive (encore en <strong>de</strong>venir comme attribut du divin,<br />
par exemple) : <strong>les</strong> philosophes et géomètres grecs développaient<br />
une conception <strong>de</strong> l’infini dans laquelle celui-ci était<br />
considéré comme essentiellement potentiel, tandis qu’Aristote<br />
imposait une vision géocentrique et finitiste du cosmos,<br />
limité – mais peut-être parfait du fait <strong>de</strong> sa rotondité supposée<br />
– par la sphère <strong>de</strong>s fixes, sorte <strong>de</strong> voûte cé<strong>les</strong>te porteuse<br />
d’étoi<strong>les</strong> comme autant <strong>de</strong> lumignons marquant <strong>les</strong> confins<br />
du mon<strong>de</strong> avec le néant extérieur. Dans ce contexte, la géométrie<br />
euclidienne reconnaît et intègre l’infini potentiel<br />
mais s’arrête aux rives <strong>de</strong> l’infini actuel : on sait la circonspection<br />
avec laquelle <strong>les</strong> géomètres grecs appréhendaient<br />
tout processus à l’infini, <strong>de</strong>puis que l’école <strong>de</strong>s Éléates avait<br />
montré à quel<strong>les</strong> contradictions pouvait conduire son usage<br />
immodéré ou inattentif : sont, à cet égard, exemplaires le<br />
recours à la démonstration par l’absur<strong>de</strong> et la métho<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>scente sous un seuil donné – dite d’exhaustion au XVII ème<br />
siècle et fondée sur l’axiome d’Eudoxe/Archimè<strong>de</strong> – utilisées<br />
pour toute proposition <strong>de</strong> type pré-infinitésimal, et que<br />
l’on trouve exposées et mises en application par Eucli<strong>de</strong><br />
(III ème siècle av. J.-C.) et par Archimè<strong>de</strong> (287-212).<br />
Cependant, <strong>de</strong>s objets plus élémentaires, tirés <strong>de</strong> la géométrie<br />
d’Eucli<strong>de</strong>, permettront <strong>de</strong> comprendre la différence<br />
essentielle <strong>de</strong>s conceptions antique et mo<strong>de</strong>rne : la ‘ligne<br />
droite’, le ‘plan’ ou le ‘soli<strong>de</strong>’ sont conçus comme finis et<br />
seulement prolongeab<strong>les</strong> ad libitum par Eucli<strong>de</strong> d’Alexandrie,<br />
Archimè<strong>de</strong> <strong>de</strong> Syracuse ou Apollonios <strong>de</strong> Pergè (262-<br />
190). Pour faire simple, la ‘ligne droite’ d’Eucli<strong>de</strong>, c’est ce<br />
que nous appelons un segment. C’est avec Desargues, puis<br />
Pascal, dans son esquisse d’une nouvelle géométrie à l’usage<br />
<strong>de</strong>s « studieux », qu’une droite, un plan ou l’espace <strong>de</strong> la géométrie<br />
dite encore euclidienne sont définis comme supports,<br />
respectivement rectiligne, plan ou volumique <strong>de</strong> toute portion,<br />
segment, figure plane rectiligne ou corps soli<strong>de</strong>, d’un espace conçu<br />
d’emblée dans son infinie extension. Et c’est seulement avec<br />
7
LNA#49 / cycle l'espace<br />
8<br />
Kant que s’imposera une définition d’un espace homogène,<br />
antérieur à la matière qui l’habite et structuré par droites et<br />
plans immatériels comme autant <strong>de</strong> fibres et <strong>de</strong> feuil<strong>les</strong>.<br />
Une histoire <strong>de</strong> cet avènement <strong>de</strong> la perspective et <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux <strong>de</strong><br />
ses nombreux rejetons conceptuels – espace et infini – doit<br />
éviter l’urgence <strong>de</strong> la rétrospection, d’autant plus qu’une lecture<br />
épistémologique <strong>de</strong>s traces porte sur un « discours » par<br />
formes et par figures, illustrations ou productions plastiques<br />
– <strong>de</strong>ssins, gravures, peintures, décors plafonnants, décors<br />
<strong>de</strong> théâtre, anamorphoses, etc. –, autant, voire plus, que sur<br />
l’écrit linéaire <strong>de</strong>s traités <strong>de</strong> perspective, d’architecture ou<br />
<strong>de</strong> peinture.<br />
Si l’on veut donc reconstruire<br />
<strong>les</strong> fils <strong>de</strong> chaine, mais<br />
aussi <strong>de</strong> trame, d’une histoire<br />
revisitée <strong>de</strong> la perspective,<br />
il faut se poser plusieurs<br />
questions que ne manquent<br />
pas <strong>de</strong> soulever la lecture assidue<br />
<strong>de</strong>s textes fondateurs<br />
ou didactiques, mais aussi,<br />
et surtout, la confrontation<br />
aux images, peintures et<br />
gravures, schémas <strong>de</strong> principe<br />
et <strong>de</strong>ssins préparatoires,<br />
qui jalonnent une histoire<br />
mêlée <strong>de</strong> théories et <strong>de</strong> pratiques<br />
et que celle-ci donne<br />
à voir. Parmi ces questions,<br />
figurent au premier chef cel<strong>les</strong>-ci,<br />
auxquel<strong>les</strong> nous avons<br />
eu l’heur <strong>de</strong> trouver <strong>de</strong>s réponses<br />
ou <strong>de</strong>s embryons <strong>de</strong><br />
réflexion fondée sur l’analyse<br />
géométrique <strong>de</strong>s textes<br />
et <strong>de</strong>s figures :<br />
- comment la perspectiva<br />
antique et médiévale, faite<br />
d’optique géométrique et<br />
physiologique, a-t-elle pu accoucher<br />
d’une scientia perspectiva,<br />
science <strong>de</strong> la représentation<br />
? Cette <strong>de</strong>rnière,<br />
dite parfois artificialis, par<br />
opposition à une perspectiva naturalis, science <strong>de</strong> la vision,<br />
<strong>de</strong>venue science <strong>de</strong> la lumière et <strong>de</strong>s causes <strong>de</strong>s apparences,<br />
que l’on nommera bientôt systématiquement optica, et que<br />
l’on scin<strong>de</strong>ra en optique, catoptrique et dioptrique ;<br />
- comment est-on passé <strong>de</strong> la juxtaposition d’objets physiques,<br />
empiriquement et localement figurés, à la représentation du<br />
continuum (qui <strong>les</strong> englobe tous) ?<br />
- quel<strong>les</strong> sont <strong>les</strong> voies qui conduisent à la construction dite<br />
légitime, dès lors qu’elle s’accor<strong>de</strong>, selon Alberti, à tout ou<br />
partie <strong>de</strong> l’optique dite euclidienne, ou qu’elle sera validée<br />
more geometrico par Piero <strong>de</strong>lla Francesca ? Sont-el<strong>les</strong> théoriques<br />
Figure 2. – Planche <strong>de</strong> la Scenographiæ sive Perspectivæ <strong>de</strong> Hans<br />
Vre<strong>de</strong>man <strong>de</strong> Vries (Anvers, 1560), réimprimée, à <strong>de</strong> nombreuses<br />
reprises, sous <strong>de</strong>s titres divers : Artis Perspectivæ (Anvers, 1568),<br />
Perspectiva (Ley<strong>de</strong>, 1604) et rééditée en français avec <strong>de</strong>s corrections<br />
par Samuel Marolois : La Tres-Noble Perspective… inventée par<br />
Jean Vre<strong>de</strong>man Frison (Amsterdam, 1619), suivie <strong>de</strong> La Perspective<br />
<strong>de</strong> Samuel Marolois, samielois… Cette planche présente, d’après sa<br />
légen<strong>de</strong>, divers soli<strong>de</strong>s (donnés pour être <strong>de</strong>s parallélépipè<strong>de</strong>s rectang<strong>les</strong>)<br />
disposés <strong>de</strong> diverses manières ; l’auteur semble tenir pour<br />
acquis que tous ont toutes leurs arêtes fuyant sur l’horizon ; or,<br />
trois d’entre ces soli<strong>de</strong>s sont inclinés au regard du sol – et donc <strong>de</strong><br />
l’horizon « naturel » – ; en conséquence, huit (en particulier <strong>les</strong><br />
quatre plus longues) <strong>de</strong>s douze arêtes <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux d’entre eux, non<br />
parallè<strong>les</strong> au tableau, <strong>de</strong>vraient fuir en <strong>de</strong>s points hors <strong>de</strong> l’horizon ;<br />
et, pour le soli<strong>de</strong> incliné, situé le plus à droite <strong>de</strong> la figure, quatre<br />
(<strong>les</strong> plus longues) <strong>de</strong>vraient fuir hors <strong>de</strong> l’horizon, tandis que <strong>les</strong><br />
huit autres convergent vers le point <strong>de</strong> fuite central. Cette erreur,<br />
relevée par Marolois, sera corrigée dans son édition. Elle manifeste<br />
le fait que la question <strong>de</strong>s points et <strong>de</strong>s lignes <strong>de</strong> fuite n’est pas maîtrisée<br />
dans toute sa généralité au milieu du XVI ème siècle.<br />
ou théorisées a posteriori à partir <strong>de</strong> pratiques d’atelier ?<br />
Convergent-el<strong>les</strong> ? Ou s’opposent-el<strong>les</strong> un temps, avant que<br />
leur équivalence ne se manifeste ? Y a-t-il <strong>de</strong>s pratiques ou<br />
<strong>de</strong>s procédés, satisfaisants à l’œil, mais en contradiction avec<br />
<strong>les</strong> conséquences que l’on est en droit légitimement d’attendre<br />
d’eux (le cas <strong>de</strong> Peruzzi, puis <strong>de</strong> Raphaël et <strong>de</strong> Serlio<br />
sont, à cet égard, exemplaires) ?<br />
- l’irruption du point <strong>de</strong> fuite central et d’une construction légitime<br />
implique <strong>de</strong> facto l’existence d’une infinité <strong>de</strong> points et<br />
<strong>de</strong> lignes <strong>de</strong> fuite dans la théorie qui en découle. Mais qu’en<br />
est-il <strong>de</strong> l’apparition réelle, et surtout progressive puisqu’étalée<br />
sur <strong>de</strong>ux sièc<strong>les</strong>, <strong>de</strong>s autres points <strong>de</strong> fuite, et <strong>de</strong> la prise <strong>de</strong><br />
conscience <strong>de</strong> la multiplicité<br />
<strong>de</strong>s « horizons » (fig. 2) ?<br />
À cet égard, l’illumination<br />
que le graveur Abraham<br />
Bosse doit à son maître<br />
Desargues, lorsqu’il s’exclame<br />
que « le perspectif est<br />
conforme au géométral », est<br />
significative à la fois d’un<br />
aboutissement et d’une première<br />
intuition <strong>de</strong> ce qu’est<br />
une transformation géométrique,<br />
dont Desargues<br />
exhibera l’invariant en étu-<br />
diant <strong>les</strong> coniques.<br />
Et c’est cela, sans doute,<br />
le paradoxe auquel est<br />
confronté l’historien : la<br />
compréhension <strong>de</strong> l’espace<br />
euclidien est passée<br />
par l’acceptation <strong>de</strong> ce<br />
qu’Eucli<strong>de</strong> réfutait, sans<br />
pour autant pouvoir démontrer<br />
ce qu’il dût alors<br />
nommer son cinquième<br />
postulat : il y a intersection<br />
<strong>de</strong>s lignes droites parallè<strong>les</strong>,<br />
dont on « voit bien »,<br />
<strong>de</strong>puis que <strong>les</strong> peintres<br />
nous l’ont donné à voir,<br />
qu’el<strong>les</strong> se rencontrent ad<br />
infinitum. Juste retour <strong>de</strong>s<br />
choses : sans géométrie<br />
projective, point <strong>de</strong> cadre pour <strong>les</strong> géométries non-euclidiennes<br />
; mais ceci est une autre histoire.<br />
À voir sur le même sujet : Colloque Inventer l’espace<br />
(Octobre 2006 - Maison <strong>de</strong>s Sciences <strong>de</strong> l’Homme : 54, Boulevard Raspail<br />
75006 Paris)<br />
http://www.archivesaudiovisuel<strong>les</strong>.fr/FR/_vi<strong>de</strong>o.asp?id=862&ress=2797<br />
&vi<strong>de</strong>o=63234&format=22
Le géosystème et la prose, vous connaissez ?<br />
Lorsque j’ouvre un robinet d’eau chez moi, lorsque je rejette<br />
<strong>de</strong>s eaux usées, j’interviens dans le fonctionnement<br />
du géosystème auquel je participe. Exactement comme Monsieur<br />
Jourdain, en 1670, découvrait qu’il faisait <strong>de</strong> la prose dès<br />
lors qu’il s’exprimait. À l’époque, ni son maître <strong>de</strong> philosophie,<br />
ni son maître d’armes ne lui ont révélé que, <strong>de</strong> surcroît,<br />
il participait à un géosystème. Eux, d’ailleurs, n’en étaient pas<br />
conscients non plus. Pourtant, ils n’étaient guère excusab<strong>les</strong> :<br />
en tirant l’eau du puits, ils savaient que la ressource est localisée<br />
dans le sous-sol ; en jetant l’eau dans la cour, ils la voyaient<br />
s’écouler puis s’infiltrer peu à peu. Ils pouvaient donc accé<strong>de</strong>r<br />
à l’expérience <strong>de</strong> la ressource puisée pour satisfaire un besoin<br />
d’êtres vivants puis, souillée par ceux-ci, s’en retourner au gisement<br />
en s’épurant par filtration.<br />
Oui mais, en 1670, notre connaissance <strong>de</strong>s milieux naturels<br />
était encore bien pauvre, alors que la disponibilité <strong>de</strong>s observations<br />
était plus facile qu’elle ne l’est aujourd’hui. Leuwenhoek<br />
n’avait pas encore mis au point son microscope et la seule<br />
observation d’êtres vivants invisib<strong>les</strong> par notre œil n’était<br />
même pas encore à portée d’intuition. Quant à démontrer la<br />
réalité <strong>de</strong> leur action, il faudrait attendre Pasteur, <strong>de</strong>ux cents<br />
ans plus tard. Combien <strong>de</strong> mala<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> morts a-t-il fallu<br />
pour établir une relation <strong>de</strong> cause à effet entre la proximité<br />
d’une eau putri<strong>de</strong> et <strong>les</strong> affections issues <strong>de</strong> sa consommation ?<br />
Et pourtant, l’observation était à portée <strong>de</strong> regard, mais la<br />
métho<strong>de</strong> manquait.<br />
En 1670, la France ne comptait que vingt-cinq millions d’habitants<br />
environ. Et <strong>de</strong>venir sexagénaire n’était guère plus fréquent<br />
que <strong>de</strong>venir centenaire aujourd’hui. La faible <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong> population<br />
n’imposait pas <strong>de</strong> construire n’importe quoi n’importe<br />
où, comme permet <strong>de</strong> le faire la technologie d’aujourd’hui. Les<br />
fonds <strong>de</strong> vallées, plats, étaient réservés au bétail qui pouvait<br />
paître en tranquillité… entre <strong>de</strong>ux inondations. Sur <strong>les</strong> plateaux<br />
crayeux et limoneux (Artois, Ternois, Haut-Boulonnais,<br />
Cambrésis), <strong>les</strong> zones boisées le disputaient à la <strong>culture</strong>, sans<br />
engrais, sans pestici<strong>de</strong>s, mais avec <strong>de</strong> faib<strong>les</strong> ren<strong>de</strong>ments. Les<br />
villages s’égrenaient le long <strong>de</strong>s flancs <strong>de</strong> vallée, là où, l’été, <strong>les</strong><br />
sources alimentaient <strong>les</strong> hommes et la rivière. Dans <strong>les</strong> plaines<br />
alluvia<strong>les</strong>, argileuses, inondées chaque année, une eau souterraine<br />
<strong>de</strong> qualité était accessible à peu près partout, à faible<br />
profon<strong>de</strong>ur, permettant la dispersion <strong>de</strong> l’habitat. La plus petite<br />
éminence <strong>de</strong> terrain, en relief <strong>de</strong> 1 à 2 m par rapport au<br />
voisinage, accueillait le logement. Une <strong>culture</strong> <strong>de</strong> quasi jardinage,<br />
enserrée entre forêt et zone inondable, mettait à profit<br />
<strong>les</strong> apports alluvionnaires annuels. Par cumul d’expérience au<br />
cycle à propos <strong>de</strong> la science / LNA#49<br />
Par Francis MEILLIEZ<br />
Professeur <strong>de</strong> géologie, Université <strong>de</strong> Lille 1<br />
En conférence le 16 décembre<br />
fil <strong>de</strong>s générations, un réseau <strong>de</strong> ruisseaux artificiels (becques,<br />
rus, …) tentait <strong>de</strong> faciliter le drainage <strong>de</strong> l’eau en excès. Mais<br />
il ne serait venu à personne l’idée <strong>de</strong> réclamer contre le risque<br />
d’inondation, ou <strong>les</strong> effets <strong>de</strong>structeurs <strong>de</strong>s alternances sécheresse/saturation…<br />
que d’ailleurs on ignorait.<br />
En 1670, l’ingénieur militaire Vauban savait déjà qu’en franchissant<br />
la barrière naturelle <strong>de</strong>s collines d’Artois il découvrirait<br />
un pays déjà très habité, comptant <strong>de</strong> nombreuses zones<br />
humi<strong>de</strong>s et d’eau à faible circulation, favorisant la diffusion <strong>de</strong><br />
fièvres qui affectaient <strong>les</strong> trop nombreuses troupes <strong>de</strong> passage.<br />
Il élaborait son pré carré, achevant la cita<strong>de</strong>lle <strong>de</strong> Lille qu’il<br />
considérait comme « la fille aînée dans la fortification ». Il<br />
avait compris que l’orientation naturelle du réseau hydrographique,<br />
coulant vers le nord-est, permettait <strong>de</strong> progresser dans<br />
l’intérieur <strong>de</strong>s terres avec <strong>de</strong>s barques plates, mais gênait considérablement<br />
<strong>les</strong> déplacements transverses. Il entreprit alors la<br />
construction <strong>de</strong> liaisons transverses : le canal d’Aire, le canal<br />
<strong>de</strong> Neufossé, le canal reliant la Scarpe à la Deûle. Il mettait<br />
en place ainsi un ouvrage <strong>de</strong> régulation hydraulique d’importance<br />
régionale et une voie <strong>de</strong> communication transversale,<br />
totalement nouvelle. Aujourd’hui, ce tracé a été repris par le<br />
canal à grand gabarit qui relie Dunkerque à Bouchain, et qui<br />
sera partiellement emprunté par le lien Seine - Mer du Nord<br />
dans <strong>les</strong> prochaines années.<br />
Vauban observait un paysage et l’utilisait selon ses objectifs. Il a<br />
compris le fonctionnement <strong>de</strong> la partie superficielle <strong>de</strong> chaque<br />
géosystème qu’il visitait, mais sans en avoir la conscience que<br />
nous pouvons en avoir aujourd’hui. Admettre qu’aucun paysage<br />
n’est immuable et chercher à comprendre <strong>les</strong> mécanismes<br />
naturels qui le font évoluer n’étaient pas encore <strong>de</strong>s questions<br />
pertinentes. Le problème d’aujourd’hui – et <strong>de</strong> l’avenir si nous<br />
ne tirons pas profit <strong>de</strong> l’analyse <strong>de</strong>s expériences passées – est<br />
que nous avons créé, et que nous créons encore, <strong>de</strong>s situations<br />
à risque pour l’individu à l’échelle <strong>de</strong> quelques années, et pour<br />
l’agglomération à l’échelle du siècle. Nos ouvrages <strong>de</strong> protection<br />
nous mettent à l’abri d’effets <strong>de</strong>structeurs mais nous font<br />
aussi perdre la conscience que ces effets sont <strong>de</strong>s conséquences<br />
naturel<strong>les</strong> <strong>de</strong> dispositifs dont nous sommes <strong>les</strong> auteurs.<br />
Toutes nos constructions masquent une bonne part <strong>de</strong> ce<br />
qui était naturellement observable. Nos « lunettes » mo<strong>de</strong>rnes<br />
améliorent la précision <strong>de</strong> notre capacité <strong>de</strong> vision, mais il<br />
semble que, corrélativement, el<strong>les</strong> en restreignent le champ. Il<br />
nous faut réapprendre à observer, apprendre la prose du géosystème.<br />
9
LNA#49 / cycle la guerre<br />
10<br />
Où va la guerre ?<br />
Abor<strong>de</strong>r le thème <strong>de</strong> la guerre ne peut, à première vue,<br />
que mettre mal à l’aise : la façon dont on en parle ne<br />
revient-elle pas à justifier l’injustifiable ? Pourtant, s’interroger<br />
sur <strong>les</strong> raisons que se donne la guerre permet aussi d’en<br />
mettre au jour <strong>les</strong> tenants et <strong>les</strong> aboutissants pour en cerner<br />
<strong>les</strong> métamorphoses et passer au crible ses alibis. Car nous<br />
vivons une époque où la menace <strong>de</strong> guerre n’a pas vraiment<br />
régressé, même si elle ne dit plus vraiment son nom. Non<br />
seulement elle prend <strong>de</strong>s formes techniques nouvel<strong>les</strong>, mais<br />
la façon dont elle est aujourd’hui théorisée tend à occulter<br />
sa vraie nature.<br />
Il est <strong>de</strong> bon ton <strong>de</strong> recourir aujourd’hui à Carl Schmitt<br />
pour penser la guerre : « La distinction spécifique du politique,<br />
à laquelle peuvent se ramener <strong>les</strong> actes et <strong>les</strong> mobi<strong>les</strong><br />
politiques, c’est la discrimination <strong>de</strong> l’ami et <strong>de</strong> l’ennemi » 1 .<br />
Ainsi, le couple ami-ennemi serait fondamentalement celui<br />
<strong>de</strong> la politique : cette activité humaine serait suspendue à la<br />
relation à l’ennemi. Mais, ici, le risque est grand <strong>de</strong> réduire<br />
l’action politique exclusivement à la guerre. Certes, Machiavel<br />
avait déjà souligné 2 qu’elle est l’art supérieur du Prince<br />
et qu’elle constitue un moyen privilégié pour garantir la<br />
cohésion d’une collectivité humaine. L’unité politique impliquerait<br />
l’existence d’un possible ennemi, car elle ne s’impose<br />
qu’en s’opposant aux autres et suppose donc l’existence<br />
simultanée d’une autre unité politique rivale : le mon<strong>de</strong><br />
humain est un pluriversum, et non un universum. Carl<br />
Schmitt a pris soin lui-même <strong>de</strong> distinguer l’ennemi privé –<br />
inimicus – et l’ennemi public – hostis –, mais la guerre renvoie<br />
chez lui à une conception tragique <strong>de</strong> l’existence, marquée<br />
par une tendance irrépressible au conflit qui caractériserait<br />
inéluctablement la condition humaine. Ainsi, Carl Schmitt<br />
insiste sur l’enjeu existentiel <strong>de</strong> la guerre qui constituerait<br />
alors l’épreuve cruciale à laquelle toute collectivité humaine<br />
se retrouve un jour nécessairement confrontée : « Le cas<br />
<strong>de</strong> guerre est resté, jusque dans le présent, l’épreuve décisive<br />
par excellence. En cette occasion comme en beaucoup<br />
d’autres, on peut dire que c’est la situation d’exception qui<br />
revêt une signification particulièrement déterminante, révélatrice<br />
du fond <strong>de</strong>s choses » 3 . Le <strong>de</strong>uxième élément qui<br />
accentue, pour lui, le caractère existentiel <strong>de</strong> la guerre est la<br />
1 Carl Schmitt, La Notion <strong>de</strong> politique, éd. Calmann-Lévy, 1972, p. 66.<br />
2 Cf. Le Prince, chapitres X à XIV.<br />
3 Carl Schmitt, op. cit., p. 75.<br />
Par Alain CAMBIER<br />
Docteur en philosophie, professeur<br />
en classes préparatoires, Faidherbe - Lille<br />
confrontation à la mort : « La guerre, <strong>les</strong> hommes qui se battent<br />
prêts à mourir, le fait <strong>de</strong> donner la mort à d’autres hommes<br />
qui sont, eux, dans le camp ennemi, rien <strong>de</strong> cela n’a <strong>de</strong><br />
valeur normative. Il s’agit, au contraire, <strong>de</strong> valeurs purement<br />
existentiel<strong>les</strong>, insérées dans la réalité effective d’une lutte effective<br />
contre un ennemi réel (…). Car si, à l’origine <strong>de</strong> cet<br />
anéantissement physique <strong>de</strong>s hommes, il n’y a pas la nécessité<br />
vitale <strong>de</strong> maintenir sa propre forme d’existence face à une négation<br />
tout aussi vitale <strong>de</strong> cette forme, rien d’autre ne saurait<br />
la justifier » 4 . La guerre nous ferait donc prendre conscience<br />
<strong>de</strong> notre « être-pour-la-mort ». La menace <strong>de</strong> mort qui pèse<br />
dans l’inimitié politique nous ferait prendre conscience que<br />
notre avenir n’est possible qu’en passant par la guerre et mettrait<br />
au jour le nœud du vital et du mortel. Nous cernons ici<br />
l’ambiguïté fondamentale <strong>de</strong> la problématique schmittienne :<br />
tout en insistant sur le caractère foncièrement politique <strong>de</strong> la<br />
guerre, son approche débouche sur un existentialisme politique<br />
propice à toutes <strong>les</strong> dérives. Ainsi, la guerre exacerberait le<br />
décisionnisme dont Schmitt se réclame et nous confirmerait<br />
que la situation exceptionnelle est la règle. Bien plus, la guerre<br />
préserverait le mon<strong>de</strong> humain <strong>de</strong> sombrer dans <strong>les</strong> « divertissements<br />
» frivo<strong>les</strong>. C’est pourquoi Schmitt voit dans la guerre<br />
une source <strong>de</strong> salut : il commente <strong>les</strong> paro<strong>les</strong> <strong>de</strong> Cromwell qui<br />
désignait comme ennemi pour son peuple l’Espagne papiste :<br />
« L’Espagnol est votre ennemi, enmity is put into him by God ;<br />
il est ‘the natural enemy, the provi<strong>de</strong>ntial enemy’, et qui le<br />
tient pour un acci<strong>de</strong>ntal enemy ne connaît ni l’Écriture, ni <strong>les</strong><br />
choses <strong>de</strong> Dieu qui a dit ‘je mettrai une inimitié entre ta postérité<br />
et la sienne (Genèse III, 15) 5 ’ ». Aussi n’est-il pas étonnant<br />
que l’existentialisme politique <strong>de</strong> Schmitt conduise à un<br />
historicisme mystique qui s’articule sur la notion <strong>de</strong> katechon,<br />
reprise <strong>de</strong> Saint-Paul et censée désigner celui qui retient et qui<br />
retar<strong>de</strong> la venue <strong>de</strong> l’AntéChrist : la guerre aurait donc, en fin<br />
<strong>de</strong> compte, un rôle ré<strong>de</strong>mpteur 6 . Chez Schmitt, la politique<br />
<strong>de</strong> la guerre présuppose une théologie.<br />
L’approche schmittienne a tendance à faire <strong>de</strong> la guerre la<br />
finalité même <strong>de</strong> la politique. Or, au XIX ème siècle, tout l’effort<br />
<strong>de</strong> Von Clausewitz a consisté, au contraire, à souligner<br />
que la guerre pouvait être régulée par la politique : pour<br />
4 Carl Schmitt, op. cit., p. 92.<br />
5 Carl Schmitt, op. cit. p. 115.<br />
6 Cf. Carl Schmitt : Le Nomos <strong>de</strong> la terre, éd. PUF, et Excaptivitate salus,<br />
éd. Vrin.
ce <strong>de</strong>rnier, « la guerre n’est qu’une partie <strong>de</strong>s rapports politiques<br />
et par conséquent nullement quelque chose d’indépendant<br />
(…) Nous affirmons que la guerre n’est rien d’autre<br />
que la continuation <strong>de</strong> la politique par d’autres moyens (…)<br />
Il est vrai qu’elle a sa propre grammaire, mais non sa propre<br />
logique » 7 . Ainsi, la guerre totale comme pure montée aux<br />
extrêmes, déchaînant une violence illimitée, serait absur<strong>de</strong>.<br />
Von Clausewitz refusait <strong>de</strong> considérer la guerre comme<br />
une réalité qui se suffirait à elle-même : elle n’était, pour<br />
lui, qu’un moyen extrême. La guerre possè<strong>de</strong> certes un but<br />
(Ziel) qui correspond à un acte <strong>de</strong> violence en vue d’imposer<br />
à un adversaire l’accomplissement <strong>de</strong> notre volonté, mais<br />
ce but ne se confond pas avec sa fin (Zweck) et la fin <strong>de</strong> la<br />
guerre se trouve en <strong>de</strong>hors d’elle-même. Certes, la guerre<br />
montre <strong>les</strong> limites du droit formel, mais en même temps,<br />
elle se réclame d’un droit qui s’enracine alors dans la raison<br />
d’État. Elle révèle que la politique relève d’une logique<br />
<strong>de</strong> puissance qui a trouvé son accomplissement spécifique<br />
dans l’État mo<strong>de</strong>rne, dans la mesure où celui-ci a poussé à<br />
son paroxysme le principe <strong>de</strong> souveraineté. En se présentant<br />
comme le monopole <strong>de</strong> la violence légitime, l’État a normalisé<br />
l’art <strong>de</strong> la guerre et l’a soumis à <strong>de</strong>s règ<strong>les</strong>. Dans le<br />
contexte du Ius publicum europeum, qui est celui <strong>de</strong> l’État<br />
mo<strong>de</strong>rne, le moment spécifiquement politique <strong>de</strong> la guerre<br />
s’est affirmé. En même temps qu’elle <strong>de</strong>venait un instrument<br />
<strong>de</strong> politique pure, elle apparaissait nécessairement comme<br />
une expérience forcément limitée, à côté <strong>de</strong> la diplomatie.<br />
Car la logique <strong>de</strong> la guerre doit toujours l’emporter sur la<br />
grammaire <strong>de</strong> la guerre. La politique est ce qui pouvait<br />
à la fois donner un sens à ce déchaînement <strong>de</strong> violence et<br />
le modérer. Mais s’il y a bien une logique <strong>de</strong> la guerre au<br />
sens <strong>de</strong> Von Clausewitz, c’est aussi parce qu’elle-même reste<br />
soumise à <strong>de</strong>s lois qui s’imposent aux individus quels qu’ils<br />
soient. Ainsi, ce n’est pas un hasard si l’offensive d’Hannibal<br />
s’est arrêtée aux portes <strong>de</strong> Rome, et celle <strong>de</strong> Napoléon<br />
<strong>de</strong>vant Moscou, mais en raison d’une loi fondamentale <strong>de</strong><br />
la guerre qui implique, dans la durée, la supériorité <strong>de</strong> la<br />
défensive sur l’offensive. Bien plus, pour Von Clausewitz, il<br />
serait possible <strong>de</strong> prévoir l’issue d’une guerre à partir <strong>de</strong> ce<br />
type <strong>de</strong> lois. Dès lors, le décisionnisme – fût-il celui <strong>de</strong> l’individu<br />
qui se prétendrait le plus héroïque – se retrouve ici<br />
invalidé. Une logique stricte <strong>de</strong> la guerre s’impose à tous <strong>les</strong><br />
7 Von Clausewitz, De la guerre, éd. <strong>de</strong> Minuit, 1970, pp. 703-704. Relevons que,<br />
dès le § 24 du livre 1 <strong>de</strong> son ouvrage, Von Clausewitz précisait que la guerre est<br />
la « simple continuation » <strong>de</strong> la politique : l’expression bloss (simple) a une signification<br />
restrictive et signifie « rien que ».<br />
cycle la guerre / LNA#49<br />
protagonistes et la Realpolitik consiste précisément à savoir<br />
la prendre en compte plutôt que <strong>de</strong> s’élancer à l’aventure.<br />
Mais aujourd’hui la guerre se réclame non plus du politique<br />
en tant que tel, mais d’autres sources <strong>de</strong> justifications qui<br />
conduisent aux effets <strong>les</strong> plus pervers : ce n’est certes pas la<br />
première fois, mais el<strong>les</strong> donnent encore lieu aux mêmes<br />
errances. Déjà, avant la mo<strong>de</strong>rnité, la religion avait été la<br />
source <strong>de</strong> croisa<strong>de</strong>s et <strong>de</strong> guerres fanatiques : la naissance <strong>de</strong><br />
l’État avait permis d’y mettre partiellement fin. Au XX ème<br />
siècle, l’expérience du pouvoir d’un parti unique – en lieu<br />
et place <strong>de</strong> l’État – a conduit à <strong>de</strong>s guerres fondées sur <strong>de</strong>s<br />
idéologies totalitaires qui n’ont pas hésité à préconiser l’extermination<br />
<strong>de</strong> masse <strong>de</strong>s prétendus ennemis <strong>de</strong> race ou <strong>de</strong><br />
classe. Or, en ce début du XXI ème siècle, la dimension politique<br />
<strong>de</strong> la guerre est remplacée par l’invocation morale,<br />
qui transforme l’ennemi en brigand ou délinquant et l’État<br />
récalcitrant en « État voyou ». Cette prétendue moralisation<br />
<strong>de</strong> la guerre voudrait faire croire que le temps <strong>de</strong> celle-ci est<br />
révolu et que ne s’ouvrirait désormais plus que celui <strong>de</strong>s opérations<br />
<strong>de</strong> police, à l’échelle internationale : dans le contexte<br />
<strong>de</strong> la mondialisation, l’ennemi politique est alors caricaturé<br />
et réduit au statut <strong>de</strong> « coupable ». Cette idéologie <strong>de</strong> l’ennemi<br />
« injuste », contre laquelle Kant lui-même s’était élevé 8 ,<br />
fait surgir <strong>de</strong>s notions hybri<strong>de</strong>s très discutab<strong>les</strong> comme celle<br />
<strong>de</strong> « guerre <strong>de</strong> légitime défense préventive ». Recourir à la<br />
morale en guise <strong>de</strong> politique conduit à dénier tout statut<br />
humain à l’ennemi et à en faire la figure du Mal : tel fut<br />
le sort réservé par l’administration Bush aux prisonniers<br />
<strong>de</strong> Guantanamo, mais que la Cour suprême a désavoué 9 .<br />
L’humanité ne peut atteindre une paix fiable en dénaturant<br />
le sens politique <strong>de</strong> la guerre et en faisant comme si celleci<br />
ne pouvait plus exister, mais plutôt en reconnaissant <strong>les</strong><br />
causes et <strong>les</strong> raisons profon<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s conflits. C’est pourquoi<br />
une réflexion sur la guerre s’avère légitime et une clarification<br />
<strong>de</strong> ses enjeux se révèle indispensable, pour mieux<br />
comprendre <strong>les</strong> agissements <strong>de</strong> tous <strong>les</strong> « va-t-en-guerre »<br />
d’aujourd’hui.<br />
8 Cf. Kant, Projet <strong>de</strong> paix perpétuelle, 1 ère section, § 6, où Kant affirme que, lors<br />
d’une guerre, « aucune <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux parties ne peut être qualifiée d’ennemi injuste<br />
(cela présumant une sentence <strong>de</strong> juge), mais c’est l’issue qui déci<strong>de</strong> (tout comme<br />
dans <strong>les</strong> jugements dits <strong>de</strong> Dieu [i.e. l’ordalie]) <strong>de</strong> quel côté se trouve le droit ».<br />
9 Cf. le <strong>de</strong>rnier arrêt <strong>de</strong> la plus haute juridiction <strong>de</strong>s États-Unis rendu le 12 juin<br />
2008, accordant aux prisonniers <strong>de</strong> la base le droit à l’habeas corpus, à disposer <strong>de</strong>s<br />
raisons pour <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> ils se trouvent là et à <strong>les</strong> contester <strong>de</strong>vant <strong>les</strong> tribunaux.<br />
11
LNA#49 / paradoxes<br />
12<br />
Paradoxes<br />
Rubrique <strong>de</strong> divertissements mathématiques pour ceux qui aiment se prendre la tête<br />
* Laboratoire d’Informatique<br />
Fondamentale <strong>de</strong> Lille,<br />
UMR CNRS 8022, Bât. M3<br />
Par Jean-Paul DELAHAYE<br />
Professeur à l’Université <strong>de</strong> Lille 1 *<br />
Les paradoxes stimulent l’esprit et sont à l’origine <strong>de</strong> nombreux progrès mathématiques. Notre but est <strong>de</strong> vous<br />
provoquer et <strong>de</strong> vous faire réfléchir. Si vous pensez avoir une explication <strong>de</strong>s paradoxes proposés, envoyez-la moi<br />
(faire parvenir le courrier à l’<strong>Espace</strong> Culture ou à l’adresse électronique <strong>de</strong>lahaye@lifl.fr).<br />
LE PARADOxE PRéCéDENt :<br />
UN CALCUL RéVOLUtIONNAIRE<br />
Rappel <strong>de</strong> l’énoncé<br />
Calculer la racine carrée d’un nombre n <strong>de</strong> 80 chiffres n’est<br />
pas très simple, même si on sait que l’entier n est un carré<br />
parfait (n = m 2 ). Calculer la racine treizième d’un nombre n<br />
<strong>de</strong> 100 chiffres est encore plus compliqué, même si on sait<br />
que n est une puissance treizième exacte d’entier (n = m 13 ).<br />
C’est même certainement impossible <strong>de</strong> tête. Que penser<br />
alors du calcul <strong>de</strong> la racine 1789-ème d’un nombre n <strong>de</strong><br />
7000 chiffres, même en sachant que n est une puissance<br />
1789-ème exacte (n = m 1789 ). Réussir un tel calcul <strong>de</strong> tête<br />
constituerait une révolution !<br />
Le troisième exercice est pourtant le plus simple. Le second<br />
calcul est difficile sans papier, mais quelques amateurs <strong>de</strong><br />
calcul mental en sont capab<strong>les</strong>. Le premier exercice, lui, n’est,<br />
semble-t-il, pas humainement possible <strong>de</strong> tête : même <strong>les</strong> plus<br />
grands calculateurs prodiges <strong>de</strong> l’histoire n’ont jamais réussi<br />
l’extraction <strong>de</strong> la racine carrée <strong>de</strong> nombres <strong>de</strong> 80 chiffres. Ce<br />
qui semble le plus difficile, à première vue, est en réalité le<br />
plus facile : c’est le paradoxe <strong>de</strong> la fausse difficulté.<br />
Vous <strong>de</strong>vez expliquer pourquoi il en est ainsi, et découvrir<br />
la métho<strong>de</strong> permettant <strong>de</strong> calculer la racine 1789-ème d’un<br />
nombre <strong>de</strong> 7000 chiffres.<br />
Si vous trouvez cela trop compliqué, attaquez-vous d’abord<br />
au paradoxe lexical suivant. Pourquoi est-il faux que la<br />
racine treizième du nombre a est le nombre b qui, multiplié<br />
treize fois par lui-même, donne a ?<br />
Solution<br />
Merci à Éric Wegrzynowski, Henri Bocquet, Nicolas Decock<br />
et Jef van Staeyen qui m’ont fait parvenir leurs solutions au<br />
paradoxe.<br />
La racine treizième du nombre a est le nombre b qui, élevé<br />
à la puissance treize, donne a, et donc... c’est le nombre qui,<br />
multiplié douze fois par lui-même, donne a.<br />
Précisons bien que, dans <strong>les</strong> exercices mentionnés, on sait<br />
que le résultat recherché est un entier. Cela signifie que le<br />
nombre qu’on vous soumet – <strong>de</strong> 80 chiffres pour la racine<br />
carrée, <strong>de</strong> 100 chiffres pour la racine treizième, <strong>de</strong> 7000<br />
chiffres pour la racine 1789-ème – est la puissance exacte<br />
d’un nombre entier.<br />
La difficulté du problème dépend <strong>de</strong> la taille du nombre<br />
que vous <strong>de</strong>vez retrouver, car c’est la quantité d’informations<br />
manquantes. La difficulté ne dépend donc pas <strong>de</strong> la longueur<br />
<strong>de</strong>s données, comme on est tenté <strong>de</strong> le croire. Elle<br />
n’est pas non plus dans le fait <strong>de</strong> rechercher la racine k-ème<br />
pour un k élevé. Nous allons voir que la taille du nombre m<br />
à trouver va en décroissant d’un exercice à l’autre et que c’est<br />
donc bien le troisième exercice qui est le plus facile.<br />
Commençons par lui : comment calculer la racine 1789-ème<br />
d’un nombre <strong>de</strong> 7000 chiffres ? Un petit calcul algébrique<br />
ou un petit travail d’exploration, aidé d’un ordinateur, montre<br />
que <strong>les</strong> seuls nombres entiers qui, élevés à la puissance 1789,<br />
donnent <strong>de</strong>s entiers ayant exactement 7000 chiffres sont :<br />
8171, 8172, 8173, 8174, 8175, 8176, 8177, 8178, 8179, 8180.<br />
Les nombres inférieurs à 8171 ont une puissance 1789-ème<br />
possédant moins <strong>de</strong> 7000 chiffres. Les nombres au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong><br />
8180 ont une puissance 1789-ème possédant plus <strong>de</strong> 7000<br />
chiffres.<br />
De plus, si vous élevez 0, 1, 2, ..., 9 à la puissance 1789,<br />
vous constaterez que le <strong>de</strong>rnier chiffre <strong>de</strong>s résultats est, dans<br />
le même ordre, 0, 1, 2, ..., 9. Il en résulte immédiatement<br />
qu’en élevant à la puissance 1789 un nombre se terminant<br />
par le chiffre i, on trouve un nombre qui se termine encore<br />
par le chiffre i : le <strong>de</strong>rnier chiffre d’un entier élevé à la<br />
puissance 1789 se conserve. (Plus généralement, on montre<br />
que tout nombre entier, élevé à une puissance <strong>de</strong> la forme<br />
4n + 1, gar<strong>de</strong> le même <strong>de</strong>rnier chiffre en base 10.)<br />
Pour calculer la racine 1789-ème d’un nombre <strong>de</strong> 7000<br />
chiffres, il suffit donc <strong>de</strong> regar<strong>de</strong>r le <strong>de</strong>rnier <strong>de</strong>s 7000 chiffres<br />
et <strong>de</strong> repérer sur la liste [8171, 8172, 8173, 8174,<br />
8175, 8176, 8177, 8178, 8179, 8180] le nombre qui a le<br />
même <strong>de</strong>rnier chiffre. Apprendre cette liste est à la portée<br />
<strong>de</strong> tout le mon<strong>de</strong>, et donc tout le mon<strong>de</strong> peut, <strong>de</strong> tête, extraire<br />
la racine 1789-ème d’un nombre <strong>de</strong> 7000 chiffres !<br />
Considérons maintenant le problème <strong>de</strong> l’extraction d’une<br />
racine treizième d’un nombre <strong>de</strong> 100 chiffres. L’ordinateur<br />
vous indique que si un nombre, élevé à la puissance 13, pos-
sè<strong>de</strong> 100 chiffres, alors il est compris entre <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux nombres<br />
suivants :<br />
41246264 49238826<br />
Si un nombre <strong>de</strong> 100 chiffres est une puissance treizième<br />
exacte, vous savez donc, sans même le regar<strong>de</strong>r, qu’il commence<br />
par un 4. De plus, élever à la puissance treize ne<br />
change pas le <strong>de</strong>rnier chiffre (comme pour la puissance<br />
1789). Le travail nécessaire pour trouver la racine 13-ème<br />
d’un nombre <strong>de</strong> 100 chiffres consiste donc à déterminer <strong>les</strong><br />
6 chiffres manquants entre le 4 du début et le <strong>de</strong>rnier chiffre<br />
facile à trouver. Quelques astuces arithmétiques ren<strong>de</strong>nt<br />
cela possible et ceux qui <strong>les</strong> connaissent et s’entraînent un<br />
peu n’ont besoin que <strong>de</strong> quelques minutes ou même <strong>de</strong> quelques<br />
secon<strong>de</strong>s pour réaliser l’extraction <strong>de</strong> la racine treizième<br />
<strong>de</strong> nombres <strong>de</strong> 100 chiffres. L’exploit <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’entraînement<br />
et peut-être même un don particulier en calcul<br />
mental, mais ce n’est pas un exploit fantastique. Il a été<br />
réalisé entre autres par Herbert <strong>de</strong> Grote, Wikhelm Klein,<br />
Gert Mittring et Alexis Lemaire. Ceux qui le pratiquent en<br />
se présentant comme <strong>de</strong>s génies mathématiques exploitent<br />
l’ignorance du public qui, en général, ne comprend pas très<br />
bien ce qu’est une racine treizième et encore moins la facilité<br />
qu’introduit le fait que <strong>les</strong> nombres proposés soient <strong>de</strong>s<br />
puissances exactes.<br />
Alexis Lemaire – parfois présenté comme le plus grand<br />
calculateur <strong>de</strong> tous <strong>les</strong> temps – est capable <strong>de</strong> mieux que<br />
l’extraction <strong>de</strong>s racines treizièmes <strong>de</strong> nombres <strong>de</strong> 100 chiffres<br />
: il pratique l’extraction <strong>de</strong>s racines treizièmes <strong>de</strong> nombres<br />
<strong>de</strong> 200 chiffres. Précisons cependant qu’il réalise cette<br />
extraction pour certains nombres et pas pour tous – sans<br />
doute parce que <strong>les</strong> astuces qu’il met en œuvre ne sont pas<br />
assez généra<strong>les</strong> – et qu’il est totalement incapable d’extraire<br />
la racine treizième d’un nombre <strong>de</strong> 201 chiffres ou même<br />
<strong>de</strong> 199 chiffres ! Dans la mesure où on ne connaît pas <strong>les</strong><br />
algorithmes utilisés par Alexis Lemaire, il est impossible <strong>de</strong><br />
savoir s’il réalise vraiment un exploit exceptionnel <strong>de</strong> calcul<br />
mental où s’il met en œuvre une recette que d’autres pourraient<br />
appliquer.<br />
Les media qui en parlent semblent victimes du paradoxe <strong>de</strong> la<br />
fausse difficulté et l’on peut être certain qu’ils seraient encore<br />
plus émerveillés et épatés par le génie qui réussirait le calcul<br />
révolutionnaire consistant à extraire la racine 1789-ème<br />
d’un nombre <strong>de</strong> 7000 chiffres…, calcul que pourtant tout<br />
le mon<strong>de</strong> peut effectuer.<br />
Le premier exercice (extraire la racine carrée d’un nombre <strong>de</strong><br />
80 chiffres) est le plus difficile <strong>de</strong>s trois exercices proposés. Le<br />
calcul <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en effet <strong>de</strong> retrouver 40 chiffres inconnus.<br />
Le grand mathématicien John Wallis (1616-1703) pouvait,<br />
semble-t-il, extraire la racine carrée <strong>de</strong> nombres <strong>de</strong> 55 chiffres.<br />
Zacharias Dase (1824-1861) pouvait extraire la racine<br />
carrée d’un nombre <strong>de</strong> 60 chiffres. Il réussit aussi l’exploit<br />
<strong>de</strong> multiplier <strong>de</strong> tête <strong>de</strong>ux nombres <strong>de</strong> 100 chiffres l’un par<br />
l’autre... en 8 heures 45 minutes. À ma connaissance, personne<br />
n’a jamais pu extraire <strong>de</strong> tête <strong>les</strong> racines carrées <strong>de</strong>s<br />
nombres <strong>de</strong> 80 chiffres.<br />
NOUVEAU PARADOxE : UNE tROUBLANtE<br />
éQUAtION DU SECOND DEGRé<br />
paradoxes / LNA#49<br />
Un théorème important <strong>de</strong> l’algèbre indique qu’une équation<br />
polynomiale <strong>de</strong> <strong>de</strong>gré n (n entier ≥ 1) à coefficients<br />
réels possè<strong>de</strong> au plus n solutions : une équation <strong>de</strong> <strong>de</strong>gré 1<br />
possè<strong>de</strong> au plus une solution ; une équation <strong>de</strong> <strong>de</strong>gré 2 possè<strong>de</strong><br />
au plus <strong>de</strong>ux solutions, etc.<br />
(Si, à la place <strong>de</strong> considérer <strong>de</strong>s nombres réels, on considère<br />
<strong>de</strong>s nombres complexes – pour <strong>les</strong> coefficients et pour <strong>les</strong><br />
solutions – et si on prend en compte la multiplicité <strong>de</strong>s racines,<br />
le théorème fondamental <strong>de</strong> l’algèbre indique alors que<br />
toute équation polynomiale <strong>de</strong> <strong>de</strong>gré n possè<strong>de</strong> exactement<br />
n solutions.)<br />
Dans le cas réel qui seul nous concernera ici, une équation<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>gré 2 possè<strong>de</strong> donc au plus 2 solutions différentes.<br />
Souvenez-vous, pour l’équation ax2 + bx + c = 0, <strong>les</strong> racines<br />
sont données par :<br />
∆ = b2 - 4ac x = (-b + √∆)/2a x = (-b - √∆)/2a<br />
1 2<br />
Pourtant, voici une exception à cette règle. Considérons<br />
trois nombres réels a, b et c fixés et <strong>de</strong>ux à <strong>de</strong>ux distincts<br />
(si vous le souhaitez, prenez a = 1, b = 2, c = 3). Analysons<br />
l’équation suivante :<br />
(x − a)(x − b) (x − b)(x − c) (x − a)(x − c)<br />
+ +<br />
(c − a)(c − b) (a − b)(a − c) (b− a)(b − c) =1<br />
C’est une équation <strong>de</strong> <strong>de</strong>gré 2 en l’inconnue x car c’est une<br />
somme, chaque terme étant un polynôme <strong>de</strong> <strong>de</strong>gré 2.<br />
Le nombre a est solution <strong>de</strong> l’équation car, quand on remplace<br />
x par a, le premier terme s’annule, <strong>de</strong> même que le<br />
troisième, alors que le second prend la valeur 1. Notons<br />
qu’aucun dénominateur ne s’annule, nous respectons bien<br />
<strong>les</strong> règ<strong>les</strong> <strong>de</strong> calcul qu’impose ce genre <strong>de</strong> manipulations.<br />
Le nombre b et le nombre c, pour <strong>de</strong>s raisons analogues,<br />
sont aussi solutions <strong>de</strong> cette équation qui possè<strong>de</strong> donc trois<br />
solutions. Puisque a, b et c ont été supposés distincts, nous<br />
avons donc une équation du <strong>de</strong>gré 2 possédant 3 solutions<br />
différentes.<br />
Est-ce la trace d’un paradoxe au cœur <strong>de</strong> l’algèbre élémentaire,<br />
et faut-il entreprendre le rappel <strong>de</strong>s millions <strong>de</strong> livres<br />
<strong>de</strong> mathématiques qui mentionnent l’énoncé du théorème<br />
fondamental <strong>de</strong> l’algèbre ?<br />
13
LNA#49 / mémoires <strong>de</strong> science : rubrique dirigée par Rémi Franckowiak et Bernard Maitte<br />
14<br />
Henri Bouasse, un regard sur l’enseignement<br />
et la recherche pendant la troisième République<br />
L’œuvre scientifique<br />
La carrière d’Henri Bouasse coïnci<strong>de</strong> presque avec la durée<br />
<strong>de</strong> la troisième République. Sa thèse <strong>de</strong> physique porte sur<br />
la torsion <strong>de</strong>s fils fins. Ce thème <strong>de</strong> recherche s’inscrit dans<br />
le cadre <strong>de</strong> recherches sur <strong>les</strong> phénomènes irréversib<strong>les</strong> liés<br />
au frottement, à la viscosité, à l’hystérésis et aux déformations<br />
permanentes qui sont, selon Duhem, <strong>de</strong>s « branches<br />
aberrantes qui se détachent du tronc <strong>de</strong> l’énergétique ».<br />
De 1911 à 1932, Bouasse érige un monument <strong>de</strong> 45 volumes,<br />
la Bibliothèque scientifique <strong>de</strong> l’ingénieur et du physicien ; il<br />
y abor<strong>de</strong>, la relativité mise à part, tous <strong>les</strong> domaines <strong>de</strong> la<br />
physique. La collection commence par <strong>de</strong>ux ouvrages <strong>de</strong><br />
mathématiques écrits pour <strong>les</strong> physiciens et <strong>les</strong> mathématiciens<br />
; elle abor<strong>de</strong> la mécanique rationnelle et expérimentale,<br />
l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s soli<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s flui<strong>de</strong>s, la thermodynamique, le<br />
magnétisme et l’électricité, l’optique, l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s symétries<br />
et l’optique cristalline, l’électroptique – c’est-à-dire l’étu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s oscillations électriques, <strong>de</strong>s on<strong>de</strong>s hertziennes, la propagation<br />
<strong>de</strong> la lumière, l’émission – l’acoustique, l’astronomie<br />
théorique et pratique ; et, pour clore cette collection, la<br />
Géographie mathématique. Ajoutons que celle-ci fait une<br />
large place aux nouvel<strong>les</strong> techniques et à la physique mo<strong>de</strong>rne.<br />
Dans son ouvrage sur <strong>les</strong> Applications du magnétisme et <strong>de</strong><br />
l’électricité, paru en 1919, Bouasse étudie <strong>les</strong> principes <strong>de</strong><br />
fonctionnement <strong>de</strong>s télégraphes et <strong>de</strong>s téléphones ; l’étu<strong>de</strong><br />
du vol <strong>de</strong>s avions est développée dans l’ouvrage sur la<br />
Résistance <strong>de</strong>s flui<strong>de</strong>s, paru en 1925. Dans Émission, Chaleur<br />
solaire, Éclairage, paru en 1925, Bouasse interprète la distribution<br />
spectrale d’énergie du corps noir avec <strong>les</strong> quanta <strong>de</strong><br />
Planck et <strong>les</strong> règ<strong>les</strong> <strong>de</strong> dénombrement statistique utilisées<br />
par Jeans en 1910 ; il interprète <strong>les</strong> spectres <strong>de</strong> raies avec<br />
<strong>les</strong> hypothèses <strong>de</strong> Planck-Bohr <strong>de</strong> 1913, il donne même la<br />
théorie <strong>de</strong> la structure fine <strong>de</strong> Sommerfeld, qui substitue<br />
aux trajectoires circulaires <strong>de</strong>s électrons <strong>de</strong> l’atome <strong>de</strong> Bohr,<br />
<strong>de</strong>s ellipses ouvertes. Bouasse présente la « vieille » théorie<br />
<strong>de</strong>s quanta dans <strong>de</strong>s termes proches <strong>de</strong> ceux que l’on trouve<br />
dans la Thermodynamique et dans l’Optique <strong>de</strong> Bruhat, <strong>de</strong>s<br />
termes que Kastler conservera dans <strong>les</strong> premières rééditions<br />
<strong>de</strong> l’après-guerre.<br />
Dans <strong>les</strong> années 1920, c’est l’acoustique qui retient l’attention<br />
<strong>de</strong> Bouasse, et plus particulièrement <strong>les</strong> instruments à<br />
vent : six volumes <strong>de</strong> la Bibliothèque scientifique portent sur<br />
l’acoustique. Dans ce domaine, on reproche communément<br />
à Bouasse d’avoir contesté l’utilité <strong>de</strong>s analogies électriques<br />
dans l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s instruments à vent notamment parce que,<br />
pour le calcul <strong>de</strong> l’effet <strong>de</strong>s orifices, cel<strong>les</strong>-ci ignoraient <strong>les</strong><br />
Par Robert LOCQUENEUx<br />
Professeur émérite, Université <strong>de</strong> Lille 1<br />
*<br />
effets non-linéaires et tourbillonnaires. On lui reproche<br />
aussi <strong>de</strong> ne pas avoir été attentif aux travaux <strong>de</strong> ses contemporains,<br />
ceux, par exemple, d’Yves Rocard sur <strong>les</strong> oscillateurs<br />
et <strong>les</strong> pavillons. Mais, en ce domaine, <strong>les</strong> innombrab<strong>les</strong><br />
expériences effectuées par Bouasse et ses collaborateurs<br />
gar<strong>de</strong>nt un grand intérêt, même si <strong>les</strong> interprétations qu’il<br />
en a données peuvent être discutées. À partir <strong>de</strong> 1932,<br />
Bouasse s’attache à une science qu’il n’avait que traversée :<br />
la mécanique <strong>de</strong>s flui<strong>de</strong>s, « un édifice si mal bâti qu’on<br />
peut travailler à son aise sans crainte qu’on vous <strong>de</strong>vance ».<br />
« Il est curieux, écrivait-il, à quel point <strong>les</strong> phénomènes <strong>les</strong><br />
plus classiques que l’on croyait définitivement résolus sont<br />
incomplètement étudiés : il faut <strong>les</strong> reprendre <strong>de</strong> temps en<br />
temps. On veut que <strong>les</strong> phénomènes soient tels ou tels : en<br />
conséquence on oublie <strong>de</strong> <strong>les</strong> regar<strong>de</strong>r. Sur <strong>les</strong> sujets traités<br />
par <strong>les</strong> mathématiciens, <strong>les</strong> physiciens ferment systématiquement<br />
<strong>les</strong> yeux. Souvent ces phénomènes réservent <strong>de</strong>s<br />
surprises et sont exactement le contraire <strong>de</strong> ce qu’on pourrait<br />
raisonnablement prévoir. Toutes <strong>les</strong> expériences <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt<br />
<strong>de</strong> la patience, <strong>de</strong> l’habileté sans idée préconçue. J’étudie<br />
<strong>de</strong>s phénomènes classiques et je constate que mes prédécesseurs<br />
n’en ont pas vu la moitié, médusés qu’ils étaient<br />
par le désir <strong>de</strong> vérifier <strong>de</strong>s théories : <strong>les</strong> schémas donnés par<br />
la théorie classique <strong>de</strong>s flui<strong>de</strong>s parfaits n’ont aucun rapport<br />
avec <strong>les</strong> résultats <strong>de</strong>s expériences. On s’aperçoit bien vite <strong>de</strong><br />
l’incertitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s explications qui semblent <strong>de</strong> tout repos ».<br />
Réflexions sur <strong>les</strong> métho<strong>de</strong>s et l’histoire <strong>de</strong> la physique<br />
Aux environs <strong>de</strong> 1900, la science et ses fon<strong>de</strong>ments occupent<br />
une place centrale en philosophie. Alors Bouasse,<br />
suivant l’exemple <strong>de</strong> Duhem, publie ses réflexions sur l’objet<br />
et la métho<strong>de</strong> en physique, sur <strong>les</strong> domaines <strong>de</strong> validité <strong>de</strong>s<br />
théories physiques et, parce qu’il considère que cel<strong>les</strong>-ci ne<br />
peuvent pas représenter <strong>les</strong> choses mais qu’el<strong>les</strong> n’en peuvent<br />
être que <strong>de</strong>s anamorphoses, il regar<strong>de</strong> avec suspicion toute<br />
idée <strong>de</strong> bouleversements périodiques qui conduiraient à<br />
considérer que toute vérité en science n’est que provisoire :<br />
« Mon scepticisme sur la réalité <strong>de</strong> ce que supposent <strong>les</strong><br />
théories est trop complet pour trouver un inconvénient à<br />
exposer successivement <strong>de</strong>ux théories contradictoires [l’optique<br />
ondulatoire classique et la théorie Planck-Bohr], à la<br />
condition qu’il soit entendu qu’el<strong>les</strong> sont contradictoires<br />
et que l’ancienne n’a aucune raison pour cé<strong>de</strong>r le pas à la<br />
nouvelle. Sans vouloir établir une hiérarchie d’importance<br />
entre <strong>les</strong> phénomènes, je n’admets pas que l’ensemble <strong>de</strong>s
mémoires <strong>de</strong> science : rubrique dirigée par Rémi Franckowiak et Bernard Maitte / LNA#49<br />
phénomènes d’interférence, <strong>de</strong> diffraction, <strong>de</strong> double réfraction…<br />
soit négligeable <strong>de</strong>vant la classification <strong>de</strong> certaines<br />
raies spectra<strong>les</strong> ». Comme Duhem, Bouasse se tourne vers<br />
l’histoire <strong>de</strong>s sciences, mais, au rebours <strong>de</strong> Duhem,<br />
il bannit toute érudition <strong>de</strong> l’histoire et la généalogie<br />
<strong>de</strong>s idées en sciences ne l’intéresse<br />
pas. L’histoire <strong>de</strong> la physique n’est, pour<br />
Bouasse, que l’une <strong>de</strong>s voies <strong>de</strong> formation<br />
du physicien par l’analyse<br />
précise <strong>de</strong> mémoires bien choisis,<br />
tels le Traité <strong>de</strong>s machines <strong>de</strong> Descartes,<br />
<strong>les</strong> Règ<strong>les</strong> pour construire<br />
<strong>de</strong>s thermomètres <strong>de</strong> Réaumur,<br />
ou <strong>les</strong> passages d’ouvrages, par<br />
exemple le Traité <strong>de</strong> dynamique<br />
<strong>de</strong> d’Alembert, le Discours sur<br />
<strong>les</strong> lois <strong>de</strong> la communication du<br />
mouvement <strong>de</strong> Jean (I) Bernoulli.<br />
C’est que <strong>les</strong> réflexions<br />
méthodologiques et historiques<br />
<strong>de</strong> Bouasse ne visent qu’à la formation<br />
du physicien. Ajoutons à<br />
ce tableau que le positivisme propre<br />
à Bouasse ne saurait s’accommo<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong> la foi dans la perfectibilité indéfinie<br />
<strong>de</strong> l’humanité, une perfectibilité<br />
qui serait liée à l’évolution indéfinie <strong>de</strong>s<br />
sciences et à sa valeur morale ; ainsi Bouasse<br />
heurte-t-il une opinion fort commune en son<br />
temps, une opinion qui se nourrit <strong>de</strong>s écrits <strong>de</strong>s Renan, Berthelot<br />
et autres grands maîtres <strong>de</strong> l’idéologie républicaine.<br />
Un regard sur l’enseignement<br />
Bouasse manifesta une véritable vocation pour l’enseignement,<br />
d’où un vif engagement dans <strong>les</strong> projets <strong>de</strong> réforme<br />
<strong>de</strong> l’enseignement secondaire, pour une nécessaire réorganisation<br />
<strong>de</strong> l’enseignement supérieur et l’ouverture <strong>de</strong>s facultés<br />
<strong>de</strong>s sciences aux sciences appliquées. En 1910, Bouasse<br />
publie Bachot et bachotage ; cet ouvrage est un plaidoyer pour<br />
un enseignement élitiste : il <strong>de</strong>man<strong>de</strong> que soit substituée<br />
la sélection par l’intelligence à la sélection par l’argent (l’enseignement<br />
<strong>de</strong>s collèges et <strong>de</strong>s lycées est alors payant et <strong>les</strong><br />
boursiers n’y sont qu’en faible nombre) : ne réclame-t-il pas<br />
l’accès <strong>de</strong> l’Université aux titulaires du brevet supérieur,<br />
dénonçant <strong>de</strong>s discours républicains qui couvrent <strong>de</strong>s<br />
intérêts <strong>de</strong> caste ? En publiant sa Bibliothèque scientifique,<br />
Bouasse a contribué, plus que tout autre, à l’ouverture <strong>de</strong><br />
l’enseignement <strong>de</strong>s facultés <strong>de</strong>s sciences aux techniques <strong>de</strong><br />
l’ingénieur ; dans Mécanique rationnelle et expérimentale et<br />
Mécanique physique, il a clairement défini <strong>les</strong> rapports <strong>de</strong>s<br />
sciences théoriques et <strong>de</strong>s sciences appliquées. Aussi a-t-il<br />
violemment combattu tout ce qui pouvait s’opposer à ce<br />
projet ; d’où sa dénonciation du rôle <strong>de</strong>s mathématiciens<br />
dans l’enseignement : « Ils [<strong>les</strong> mathématiciens]<br />
ont perverti <strong>les</strong> enseignements<br />
fondamentaux. Celui <strong>de</strong> la Mécanique<br />
n’existe plus en France, parce que <strong>les</strong><br />
professeurs <strong>de</strong> Mécanique ne sont<br />
que <strong>de</strong>s mathématiciens camouflés,<br />
connaissant peut-être <strong>les</strong> équations<br />
<strong>de</strong> la Mécanique, mais ignorants<br />
comme <strong>de</strong>s carpes <strong>de</strong>s phénomènes<br />
qu’el<strong>les</strong> représentent.<br />
Nulle part en France la Théorie<br />
<strong>de</strong> l’Élasticité n’est exposée<br />
d’une façon raisonnable, parce<br />
que <strong>les</strong> mathématiciens qui s’en<br />
chargent ignorent ses relations<br />
avec la Théorie <strong>de</strong> la Résistance<br />
<strong>de</strong>s Matériaux. L’Hydrostatique,<br />
l’Hydrodynamique <strong>de</strong>viennent<br />
prétexte à développements mathématiques<br />
n’ayant avec le réel pas<br />
le moindre rapport. Bref, toutes <strong>les</strong><br />
sciences qui sont à la base <strong>de</strong> l’art <strong>de</strong><br />
l’Ingénieur sont en France <strong>de</strong>s repaires à<br />
équations, <strong>de</strong>s antres à théorèmes, <strong>de</strong>s formes<br />
vi<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>s caricatures du bon sens ». Le lecteur peut<br />
penser que Bouasse exagère, qu’il lise donc l’analyse que fit<br />
Duhem <strong>de</strong> la Thermodynamique <strong>de</strong> Poincaré dans la Revue<br />
<strong>de</strong>s questions scientifiques en 1892. Mais, la trop gran<strong>de</strong><br />
multiplication <strong>de</strong>s instituts <strong>de</strong> sciences appliquées attira <strong>les</strong><br />
foudres du bouillant professeur : « nous avons [en France]<br />
cinquante instituts complets ou soi-disant tels sans augmentation<br />
du budget <strong>de</strong> l’état ni du personnel, mais avec<br />
un éparpillement, une dispersion, un gâchis corrélatif dont<br />
rien, pas même la politique, ne peut donner une idée ! […].<br />
S’ils sont capab<strong>les</strong> <strong>de</strong> vendre <strong>de</strong>s diplômes […], ils sont aussi<br />
incapab<strong>les</strong> <strong>de</strong> fournir <strong>de</strong> bons élèves que <strong>de</strong> recruter <strong>de</strong>s professeurs<br />
compétents ».<br />
On comprend que, par ses écarts <strong>de</strong> langage, Bouasse se soit<br />
attiré <strong>de</strong> nombreuses inimitiés dans le milieu scientifique. En<br />
un temps où la physique engrange une abondante moisson<br />
<strong>de</strong> faits nouveaux, Bouasse déplore une frénésie dans leur<br />
recherche et, corrélativement, un développement superficiel<br />
<strong>de</strong> la science, « <strong>les</strong> problèmes posés restent en plan :<br />
on <strong>les</strong> résout jusqu’à un certain point, après quoi l’on s’occupe<br />
d’autres choses ». Il constate que tous ces phénomènes<br />
furent l’objet <strong>de</strong> multip<strong>les</strong> interprétations, aussi caduques<br />
15
LNA#49 / mémoires <strong>de</strong> science : rubrique dirigée par Rémi Franckowiak et Bernard Maitte<br />
16<br />
qu’el<strong>les</strong> étaient précipitées, <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> semblent épisodiquement<br />
mettre en péril <strong>les</strong> théories <strong>les</strong> plus pérennes. Aussi,<br />
Bouasse redoute-t-il par-<strong>de</strong>ssus tout le désintérêt <strong>de</strong>s étudiants<br />
pour l’enseignement d’une physique dont <strong>les</strong> vérités<br />
leur sembleraient éphémères. Ainsi, en s’arrêtant au plaidoyer<br />
<strong>de</strong> Bouasse pour l’enseignement et la recherche en physique<br />
classique et à sa critique <strong>de</strong> la relativité, l’opinion universitaire<br />
du temps feignit <strong>de</strong> croire qu’il était ennemi <strong>de</strong> la<br />
physique mo<strong>de</strong>rne et qu’il était réfractaire à tout progrès<br />
technique ; d’où une méconnaissance consternante <strong>de</strong> son<br />
œuvre par <strong>de</strong>s physiciens et <strong>de</strong>s historiens <strong>de</strong> bonne foi, qui<br />
ont cru un peu vite à quelques formu<strong>les</strong> ramassées ici ou<br />
là. Dans une étu<strong>de</strong> fort sérieuse sur l’ouverture <strong>de</strong>s facultés<br />
<strong>de</strong>s sciences à l’industrie en France entre 1860 et 1939, nous<br />
sommes au cœur <strong>de</strong> notre sujet, Harry W. Paul, un historien<br />
américain, ne cite-t-il Bouasse, « un physicien fantasque » [a<br />
whimsical physicist], « ennemi <strong>de</strong> la physique quantique et<br />
<strong>de</strong> la relativité », que parce que, dans « un accès <strong>de</strong> mauvaise<br />
humeur » [a peevish outburst], il a déclaré que « <strong>les</strong> mathématiques<br />
sont inuti<strong>les</strong> à la formation <strong>de</strong> l’esprit ». On<br />
trouve, sous la plume <strong>de</strong> Pierre-Gil<strong>les</strong> <strong>de</strong> Gennes et <strong>de</strong> ses<br />
collaborateurs, « L’ouvrage français classique sur la capillarité<br />
est celui d’Henri Bouasse [Capillarité-Phénomènes superficiels,<br />
1924]. Ce Toulousain était célèbre parmi nous, non<br />
seulement pour ses textes, mais aussi pour ses préfaces vengeresses,<br />
dans <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> il pourfendait certains collègues, et<br />
notamment <strong>les</strong> professeurs au Collège <strong>de</strong> France – astreints<br />
à très peu <strong>de</strong> cours, et intéressés par <strong>de</strong>s sujets ésotériques<br />
comme la (naissante) physique quantique. Bouasse n’a pas<br />
compris la révolution physique du XX ème siècle, mais il a<br />
construit, avec enthousiasme, <strong>de</strong>s mises au point durab<strong>les</strong><br />
sur la physique classique, et en particulier ce livre sur <strong>les</strong><br />
phénomènes <strong>de</strong> surface » 1 . Nos auteurs ne ménagent pas<br />
leur admiration pour cet ouvrage que Bouasse a publié en<br />
1924 : « Or, quatre-vingts ans plus tard, la capillarité est encore<br />
une science en mouvement ! […] Et il y a maintenant<br />
un véritable foisonnement : d’où la tentation d’écrire un<br />
nouveau livre. Nous avons voulu le faire en gardant l’esprit<br />
<strong>de</strong> Bouasse, c’est-à-dire en nous adressant à <strong>de</strong>s étudiants.<br />
Il ne s’agit pas ici d’un inventaire <strong>de</strong>s recherches <strong>les</strong> plus<br />
récentes, mais plutôt d’un recueil <strong>de</strong> principes. Et, comme<br />
Bouasse, nous ne prétendons pas fournir une bibliographie<br />
détaillée : au fil <strong>de</strong>s chapitres, nous ne donnons que quelques<br />
références majeures, sans respect pour <strong>les</strong> priorités historiques.<br />
Nous avons essayé d’être simp<strong>les</strong>, moins mathématiques<br />
que ne l’était Bouasse avec ses cycloï<strong>de</strong>s, etc. Notre but<br />
est d’illustrer <strong>de</strong>s idées, plutôt que <strong>de</strong> faire <strong>de</strong>s <strong>de</strong>scriptions<br />
quantitatives ». Et encore : « La capillarité est l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
1 Pierre-Gil<strong>les</strong> <strong>de</strong> Gennes, et al., Gouttes, bul<strong>les</strong>, per<strong>les</strong> et on<strong>de</strong>s, 2002.<br />
interfaces entre <strong>de</strong>ux liqui<strong>de</strong>s non miscib<strong>les</strong>, ou entre un<br />
liqui<strong>de</strong> et l’air. Les interfaces sont mobi<strong>les</strong>, et capab<strong>les</strong> <strong>de</strong><br />
se déformer pour minimiser leur énergie <strong>de</strong> surface. Cette<br />
science est née au début du XIX ème siècle, avec Pierre Simon<br />
<strong>de</strong> Laplace (1749-1827) et Thomas Young (1773-1829). Elle<br />
a été racontée dans un livre admirable par Henri Bouasse<br />
(1924). C’est elle qui nous permet <strong>de</strong> comprendre <strong>les</strong> jeux<br />
<strong>de</strong> l’eau qui viennent briser la mélancolie <strong>de</strong>s jours <strong>de</strong> pluie,<br />
ou <strong>de</strong> s’amuser en faisant la vaisselle ! Plus sérieusement, elle<br />
joue un rôle majeur dans <strong>de</strong> nombreux domaines scientifiques<br />
(science <strong>de</strong>s sols, climat, biologie végétale, physique<br />
<strong>de</strong>s surfaces, etc.) et industriels en chimie fine (formu lation<br />
en pharmacologie et cosmétique, industrie du verre, automobile,<br />
textile, etc.) ».<br />
Une vision humaniste du mon<strong>de</strong><br />
On pourrait croire, <strong>de</strong>vant l’œuvre monumentale <strong>de</strong> Bouasse,<br />
que celui-ci a passé sa vie entière dans son laboratoire, or, cet<br />
homme fut un grand voyageur. Loin <strong>de</strong>s sentiers battus, il a<br />
parcouru l’Italie et la Grèce, le Moyen-Orient, vu l’Égypte<br />
puis l’In<strong>de</strong> ; il a parcouru le Sahara avec un gui<strong>de</strong> et quelques<br />
chameaux : « Livingstone, Stanley, Barth, Huc, etc., me sont<br />
connus ; j’ai voyagé sur le Niger ; <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s randonnées à<br />
cheval m’ont permis <strong>de</strong> comprendre leurs <strong>de</strong>scriptions. De<br />
tout ce qu’ils racontent, résulte qu’ils accomplissent avec<br />
beaucoup <strong>de</strong> peine, <strong>de</strong> souffrances, <strong>de</strong> soucis matériels et moraux,<br />
ce que <strong>les</strong> indigènes font tous <strong>les</strong> jours, aisément, sans<br />
y penser ». Les quelques évocations <strong>de</strong> ses voyages que l’on<br />
trouve dans ses préfaces laissent percer une profon<strong>de</strong> estime<br />
pour ceux qu’on nomme alors <strong>de</strong>s indigènes, un sentiment qui<br />
contraste avec la con<strong>de</strong>scendance dont ceux-ci sont ordinairement<br />
l’objet ; il est évi<strong>de</strong>nt que Bouasse ne voit en la mission<br />
civilisatrice <strong>de</strong> la France qu’un alibi à la colonisation. Dans<br />
le même ordre d’idée, le récit d’une injustice commise envers<br />
une étudiante juive polonaise, conté quelques années après<br />
l’affaire Dreyfus, nous dit <strong>de</strong> quel côté allait sa sympathie.<br />
* Robert Locqueneux, Henri Bouasse, un regard sur l’enseignement et la recherche,<br />
préface <strong>de</strong> Nicole Hulin, Paris, diffusé par la librairie scientifique et technique<br />
Albert Blanchard, 2008.
Politique, civilisation et religion<br />
Invoquer la notion <strong>de</strong> civilisation a pu apparaître comme<br />
une manœuvre <strong>de</strong> diversion, quand l’activisme politique<br />
régnant s’est heurté à la résistance <strong>de</strong>s dures réalités économiques<br />
et socia<strong>les</strong>. Pourtant, il faut prendre au sérieux<br />
<strong>les</strong> déclarations qui ont alors été faites 1 : « Depuis trop<br />
longtemps la politique se réduit à la gestion, restant à<br />
l’écart <strong>de</strong>s causes réel<strong>les</strong> <strong>de</strong> nos maux, qui sont souvent<br />
plus profon<strong>de</strong>s. J’ai la conviction que dans l’époque où<br />
nous sommes, nous avons besoin <strong>de</strong> ce que j’appelle une<br />
politique <strong>de</strong> civilisation ». Derrière l’appropriation sauvage<br />
d’une expression d’Edgar Morin 2 , il faut y voir le désir<br />
d’imposer une révision <strong>de</strong>s valeurs sur <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> repose<br />
notre société, une prétention à « revoir <strong>les</strong> fondamentaux<br />
sur <strong>de</strong>s bases qui soient plus qualitatives que quantitatives<br />
» 3 . L’instrumentalisation <strong>de</strong> la notion <strong>de</strong> civilisation<br />
renforce le soupçon <strong>de</strong> la menace d’une véritable régression<br />
idéologique.<br />
Civilisation et progrès<br />
La notion <strong>de</strong> civilisation est ambiguë : alors que celle <strong>de</strong><br />
<strong>culture</strong> désigne une manière d’être ou un état, celle <strong>de</strong> civilisation<br />
renvoie à un processus, comme l’indique son suffixe<br />
en –tion. Or, ce processus a longtemps prétendu être porteur<br />
d’une valeur normative. Si <strong>les</strong> <strong>culture</strong>s – au sens ethnologique<br />
– apparaissent comme <strong>de</strong>s réalités <strong>de</strong> fait, marquées du<br />
sceau du particularisme et appelant <strong>de</strong>s jugements strictement<br />
<strong>de</strong>scriptifs, la civilisation correspondrait à la poursuite<br />
d’un idéal d’émancipation vis-à-vis <strong>de</strong> la nature sauvage et<br />
<strong>de</strong> la bestialité animale auquel <strong>de</strong>vrait adhérer l’ensemble<br />
du genre humain. Ce n’est pas un hasard si la notion est<br />
apparue au cours du XVIII ème siècle, dans un ouvrage du<br />
marquis <strong>de</strong> Mirabeau 4 . Elle est contemporaine <strong>de</strong> l’esprit<br />
<strong>de</strong>s Lumières et tributaire <strong>de</strong> l’émergence <strong>de</strong> l’idéologie<br />
du progrès. Elle culmine chez Condorcet qui présente la<br />
conquête coloniale comme une tâche d’éducation et <strong>de</strong> libération<br />
<strong>de</strong>s peup<strong>les</strong> exotiques, censés être incapab<strong>les</strong> d’accé<strong>de</strong>r<br />
par eux-mêmes aux lumières <strong>de</strong> la raison : « Le zèle pour<br />
1 Vœux adressés par le Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la République aux Français, le 31-12-2007.<br />
2 Cf. Pour une politique <strong>de</strong> civilisation, ouvrage d’Edgar Morin coécrit avec Sami<br />
Naïr, éd. Arlea, 2002.<br />
3 Précisions apportées par Laurent Wauquiez, porte-parole du gouvernement, en<br />
janvier 2008, dans Le Mon<strong>de</strong>.<br />
4 Mirabeau (père <strong>de</strong> l’orateur révolutionnaire célèbre), L’Ami <strong>de</strong>s hommes ou<br />
Traité <strong>de</strong> la population, publié en 1756.<br />
Par Alain CAMBIER<br />
Docteur en philosophie, professeur<br />
en classes préparatoires, Faidherbe - Lille<br />
la vérité est aussi une passion, et il doit porter ses efforts<br />
vers <strong>les</strong> contrées éloignées, lorsqu’il ne verra plus autour <strong>de</strong><br />
lui <strong>de</strong> préjugés grossiers à combattre, d’erreurs honteuses à<br />
dissiper. Ces vastes pays lui offriront ici <strong>de</strong>s peup<strong>les</strong> nombreux,<br />
qui semblent n’attendre pour se civiliser, que <strong>de</strong> recevoir<br />
<strong>de</strong> nous <strong>les</strong> moyens, et <strong>de</strong> trouver <strong>de</strong>s frères dans <strong>les</strong><br />
Européens, pour <strong>de</strong>venir leurs amis et leurs discip<strong>les</strong> » 5 .<br />
Condorcet se fait ici le porte-voix du mythe d’un progrès<br />
universel <strong>de</strong> l’humanité dont la clef se trouverait entre <strong>les</strong><br />
mains <strong>de</strong> nations éclairées : il témoigne, en réalité, <strong>de</strong> la<br />
face sombre du siècle <strong>de</strong>s Lumières dont nous retrouverons<br />
l’écho dans <strong>les</strong> propos <strong>de</strong> Ju<strong>les</strong> Ferry, à la fin du XIX ème siècle,<br />
sur un prétendu <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> civiliser <strong>les</strong> races inférieures<br />
et sur « la mission éducatrice et civilisatrice qui appartient<br />
à la race supérieure ». En France, le privilège idéologique<br />
accordé à la conception normative <strong>de</strong> civilisation – au détriment<br />
<strong>de</strong> celle <strong>de</strong> <strong>culture</strong> – a perduré plus qu’ailleurs, au<br />
point <strong>de</strong> constituer un véritable obstacle épistémologique<br />
au développement d’une ethnologie scientifique mo<strong>de</strong>rne<br />
qui requiert davantage une approche relativiste et pluraliste<br />
<strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vie humains. Il a fallu attendre Marcel Mauss<br />
pour que la notion <strong>de</strong> civilisation soit vidée <strong>de</strong> ses connotations<br />
normatives et ne désigne plus qu’une similitu<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
traits communs propres à <strong>de</strong>s sociétés différentes. Expurgés<br />
<strong>de</strong> tout jugement <strong>de</strong> valeur, ceux-ci ne sont plus alors censés<br />
relever d’une essence dont ils seraient <strong>les</strong> indices, mais d’un<br />
air <strong>de</strong> famille dont il faut simplement prendre acte 6 : avec<br />
Mauss, nous sommes enfin passés du normatif au <strong>de</strong>scriptif,<br />
débarrassés ainsi <strong>de</strong> tout ethnocentrisme.<br />
Or, la « politique <strong>de</strong> civilisation », à laquelle on nous <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
d’adhérer aujourd’hui, renoue avec cette vision normative<br />
qui conduit à <strong>de</strong>s jugements chargés <strong>de</strong> préjugés idéologiques<br />
: « Le drame <strong>de</strong> l’Afrique, c’est que l’homme africain<br />
n’est pas assez entré dans l’histoire (…) Dans cet imaginaire<br />
où tout recommence toujours, il n’y a <strong>de</strong> place ni pour<br />
l’aventure humaine, ni pour l’idée <strong>de</strong> progrès (…) Jamais il<br />
ne s’élance vers l’avenir. Jamais il ne vient à l’idée <strong>de</strong> sortir<br />
<strong>de</strong> la répétition pour s’inventer un <strong>de</strong>stin » 7 . Il apparaît<br />
5 Cf. Condorcet, Esquisse d’un tableau historique <strong>de</strong>s progrès <strong>de</strong> l’esprit humain,<br />
Dixième époque.<br />
6 Cf. Marcel Mauss, Les civilisations : éléments et formes dans Essais <strong>de</strong> sociologie,<br />
coll. Points-Essais.<br />
repenser la politique / LNA#49<br />
7 Discours du Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la République française du 26 juillet 2007 à l’Université<br />
Cheikh Anta Diop, Dakar.<br />
17
LNA#49 / repenser la politique<br />
18<br />
ici que, pour celui qui tient un tel discours, parler <strong>de</strong> la<br />
civilisation revient à réduire celle-ci à sa propre vision <strong>de</strong><br />
l’histoire pour la présenter comme une sorte d’état <strong>de</strong><br />
choses idéal et réel à la fois, causal et final en même temps,<br />
qu’un progrès dont on ne doute pas <strong>de</strong>vrait dégager nécessairement<br />
peu à peu.<br />
Civilisation et religion<br />
Mais ce n’est pas non plus le moindre paradoxe que, pour<br />
se donner un contenu, cette « politique <strong>de</strong> civilisation » recourt<br />
à <strong>de</strong>s thèmes vis-à-vis <strong>de</strong>squels la notion même <strong>de</strong><br />
civilisation avait voulu fondamentalement rompre. Dans le<br />
contexte <strong>de</strong>s Lumières, la notion <strong>de</strong> civilisation s’est imposée<br />
contre l’obscurantisme <strong>de</strong> la religion. Condorcet lui-même<br />
ne s’était pas privé d’opposer sa conception d’un progrès<br />
universel <strong>de</strong> l’humanité au prosélytisme <strong>de</strong>s missions chrétiennes<br />
d’outre-mer. Il se servait <strong>de</strong>s épithètes traditionnellement<br />
réservées aux barbares (« sanguinaires », « tyranniques<br />
», « stupi<strong>de</strong>s ») pour désigner <strong>les</strong> missionnaires et ceux<br />
qui restaient attachés aux anciennes « superstitions ». Le sacré<br />
<strong>de</strong> la civilisation prenait résolument et avantageusement<br />
la relève du sacré <strong>de</strong> la religion.<br />
La substitution <strong>de</strong> la civilisation à la religion se présentait<br />
comme une exigence pour soustraire la nation à la tutelle<br />
<strong>de</strong> l’Église <strong>de</strong> Rome. Cette exigence, tout à la fois républicaine<br />
et chargée d’intensité sacrée, s’est retrouvée exprimée<br />
<strong>de</strong> manière emblématique chez Hugo : « On peut dire que<br />
dans notre siècle il y a <strong>de</strong>ux éco<strong>les</strong>. Ces <strong>de</strong>ux éco<strong>les</strong> con<strong>de</strong>nsent<br />
et résument en el<strong>les</strong> <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux courants contraires qui<br />
entraînent la civilisation en sens inverse, l’un vers l’avenir,<br />
l’autre vers le passé ; la première <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux éco<strong>les</strong> s’appelle<br />
Paris, l’autre s’appelle Rome. Chacune <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux éco<strong>les</strong> a<br />
son livre ; le livre <strong>de</strong> Paris, c’est la Déclaration <strong>de</strong>s Droits <strong>de</strong><br />
l’homme ; le livre <strong>de</strong> Rome, c’est le Syllabus. Ces <strong>de</strong>ux livres<br />
donnent la réplique au Progrès. Le premier lui dit Oui ; le<br />
second lui dit Non. Le Progrès, c’est le : pas <strong>de</strong> Dieu » 8 .<br />
Or, la « politique <strong>de</strong> civilisation » dont on nous parle<br />
aujourd’hui met systématiquement en avant le rôle <strong>de</strong> la<br />
religion : cet amalgame ne peut apparaître que comme une<br />
régression par rapport à ceux-là mêmes qui se sont réclamés<br />
<strong>de</strong> cette notion pour rendre compte <strong>de</strong> l’émancipation <strong>de</strong>s<br />
8 Victor Hugo, Œuvres politiques complètes, éd. Francis Bouvet, Paris, Pauvert.<br />
peup<strong>les</strong>. Dire que « l’instituteur ne pourra jamais remplacer<br />
le pasteur ou le curé parce qu’il lui manquera toujours la<br />
radicalité du sacrifice <strong>de</strong> sa vie et le charisme d’un engagement<br />
porté par l’espérance » sonne, non seulement comme<br />
une injure vis-à-vis <strong>de</strong> ces laïques convaincus qui – comme<br />
Jean Cavaillès – sont morts <strong>de</strong>vant le peloton d’exécution<br />
nazi, mais surtout comme une remise en question radicale<br />
<strong>de</strong> notre esprit républicain. Le discours <strong>de</strong> Latran, puis celui<br />
<strong>de</strong> Ryad ont ressassé l’idée <strong>de</strong> la « reconnaissance du fait<br />
religieux comme un fait <strong>de</strong> civilisation » : ils ne faisaient<br />
même pas référence à une quelconque religion civile, mais<br />
bien à la religion monothéiste, celle du Dieu caché censé<br />
être « le rempart contre l’orgueil démesuré et la folie <strong>de</strong>s<br />
hommes ». Ces discours transgressent la déontologie <strong>de</strong><br />
l’homme d’État mo<strong>de</strong>rne.<br />
Civilisation et État<br />
Si la civilisation correspond à un progrès, celui-ci n’est possible<br />
que sur la base d’un procès réflexif critique vis-à-vis<br />
<strong>de</strong> ce qui constitue « la substance éthique » d’un peuple,<br />
c’est-à-dire vis-à-vis du système <strong>de</strong> valeurs qui s’établit, grâce<br />
à la coutume, comme une secon<strong>de</strong> nature 9 . L’homme<br />
est toujours <strong>culture</strong>llement conditionné par une tradition<br />
qui l’influence <strong>de</strong> manière irréfléchie, grâce aux habitu<strong>de</strong>s<br />
contractées. Or, la religion constitue le socle même <strong>de</strong> cette<br />
tradition qui nous façonne <strong>de</strong> manière mécanique : sa liturgie<br />
produit <strong>de</strong>s automatismes qui nous persua<strong>de</strong>nt à notre insu.<br />
Or, chacun ne peut progresser, se former qu’en effectuant<br />
une distanciation critique vis-à-vis <strong>de</strong> cette <strong>culture</strong> transmise<br />
<strong>de</strong> manière catéchistique. Le processus attribué à la<br />
civilisation ne peut d’abord consister qu’en celui effectué<br />
par chaque individu lorsqu’il se réapproprie la substance<br />
éthique dans laquelle il se trouve d’abord immergé et qu’il<br />
revivifie grâce à sa propre expérience critique. L’individu<br />
qui veut affirmer sa personnalité ne peut se contenter d’être<br />
l’émanation passive <strong>de</strong> sa <strong>culture</strong> maternelle.<br />
Ce n’est donc pas sans raison si la notion même <strong>de</strong> civilisation<br />
a émergé dans le contexte du développement <strong>de</strong> la<br />
société civile, dont le dynamisme repose sur la reconnaissance<br />
<strong>de</strong> la personne individuelle. La prise <strong>de</strong> conscience<br />
d’un processus <strong>de</strong> civilisation fut concomitante du passage<br />
9 L’expression est <strong>de</strong> Hegel. Sur <strong>les</strong> rapports entre civilisation et <strong>culture</strong>, cf. notre<br />
article « Culture et civilisation » publié dans À propos <strong>de</strong> la <strong>culture</strong>, tome 1,<br />
éd. L’Harmattan, 2008.
<strong>de</strong> la société organisée comme Gemeinschaft – c’est-à-dire<br />
comme communauté historique fondée sur la tradition –<br />
à une société comme Gesellschaft – c’est-à-dire considérée<br />
comme une association libre d’individus autonomes procédant<br />
à <strong>de</strong>s échanges conscients et réfléchis. Si la civilisation<br />
correspond à un progrès, celui-ci tient donc dans cet écart<br />
qui se crée lorsque <strong>les</strong> individus se réapproprient leur <strong>culture</strong><br />
ambiante et sont alors en mesure <strong>de</strong> porter un jugement<br />
critique sur elle. Dans un tel contexte, le ciment social ne<br />
peut plus être fourni par la religion : seul l’État se présente<br />
comme l’unité réfléchie <strong>de</strong> la collectivité, consciemment<br />
voulue par <strong>de</strong>s individus qui se sont élevés à la citoyenneté.<br />
Si le religieux a pu auparavant servir <strong>de</strong> liant social, il n’a pu<br />
le faire que sous la forme traditionaliste <strong>de</strong> religions du rite<br />
et dans le cadre <strong>de</strong> sociétés holistes. Et lorsque la religion a<br />
reconnu elle-même l’esprit <strong>de</strong> libre examen en son propre<br />
sein pour se réclamer d’une foi toute personnelle – comme<br />
dans le cas du protestantisme –, elle a alors revendiqué <strong>de</strong><br />
son propre chef son indépendance vis-à-vis du politique et<br />
<strong>de</strong> la sphère publique 10 . Affirmer que « Dieu n’asservit pas<br />
l’homme mais le libère » pourrait paraître légitime tant que<br />
l’on se place du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> la sphère <strong>de</strong> l’homme privé<br />
qui peut éventuellement puiser ses repères dans la religion<br />
monothéiste, mais ce rôle ne peut en aucun cas être présenté<br />
comme un <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> citoyen ou comme une profession <strong>de</strong><br />
foi <strong>de</strong> l’État, à moins d’effectuer une terrible régression vers<br />
une conception archaïque <strong>de</strong>s mœurs et <strong>de</strong> la politique.<br />
Dialogue ou clash ?<br />
La notion <strong>de</strong> civilisation est nécessairement ambivalente et<br />
mérite mieux qu’un traitement idéologique qui ferait <strong>de</strong> la<br />
religion son trait fondamental. Une telle politique reviendrait<br />
à dépossé<strong>de</strong>r <strong>les</strong> citoyens <strong>de</strong> leur prise sur la <strong>de</strong>stinée <strong>de</strong> leur<br />
société, pour s’en remettre <strong>de</strong> nouveau à <strong>de</strong>s « maîtres du<br />
sens » invisib<strong>les</strong> et à leurs prétendus interprètes. En restaurant<br />
le confort <strong>de</strong>s dogmes et la chaleur maternelle <strong>de</strong>s rituels,<br />
elle ferait régresser l’esprit critique. Mais surtout, une politique<br />
<strong>de</strong> la religion se révélerait en porte-à-faux avec une<br />
politique <strong>de</strong> l’État, au sens mo<strong>de</strong>rne du terme, c’est-à-dire<br />
10 Cf. le rôle joué par le théologien puritain anglais Robert Brown (1550-1630).<br />
Le brownisme se transforma, sous l’influence <strong>de</strong> John Robinson, en « indépendantisme<br />
» dont <strong>les</strong> principes étaient la séparation <strong>de</strong> l’Église et <strong>de</strong> l’État.<br />
De même, en Amérique, Roger Williams, pasteur <strong>de</strong> Salem, puis fondateur <strong>de</strong><br />
Provi<strong>de</strong>nce, lutta pour la séparation <strong>de</strong> l’Église et <strong>de</strong> l’État.<br />
repenser la politique / LNA#49<br />
articulée sur cet auxiliaire rationnel qu’est le droit. Mettre<br />
en avant la notion <strong>de</strong> civilisation et l’articuler sur celle <strong>de</strong><br />
religion revient à favoriser <strong>de</strong>s amalgames au détriment <strong>de</strong><br />
la notion d’État.<br />
Bien plus, considérer la religion comme déterminant l’i<strong>de</strong>ntité<br />
d’une <strong>culture</strong> conduit à s’inscrire tôt ou tard dans une<br />
logique <strong>de</strong> conflits <strong>de</strong> civilisations. L’erreur <strong>de</strong> Huntington 11<br />
est d’avoir conçu <strong>les</strong> civilisations comme <strong>de</strong>s substances<br />
éthiques constituant autant <strong>de</strong> blocs monolithiques générateurs<br />
<strong>de</strong> tous <strong>les</strong> intégrismes, alors que le propre d’une<br />
civilisation est d’asseoir son progrès éventuel sur la capacité<br />
que possè<strong>de</strong> une <strong>culture</strong> à réfléchir <strong>de</strong> manière critique son<br />
i<strong>de</strong>ntité. L’homme peut s’élever alors <strong>de</strong> la communication<br />
intra<strong>culture</strong>lle irréfléchie à <strong>de</strong>s échanges inter<strong>culture</strong>ls<br />
volontaires et s’ouvrir à d’autres visions du mon<strong>de</strong>. La religion<br />
comme tradition a tendance à enfermer l’homme<br />
dans le cercle étroit <strong>de</strong> ses dogmes, alors que le processus <strong>de</strong><br />
civilisation requiert plutôt une ouverture <strong>de</strong>s mentalités à<br />
d’autres expériences <strong>de</strong> spiritualité. La distanciation critique<br />
vis-à-vis du rôle accordé à la religion dans la détermination<br />
<strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong>s communautés humaines est la condition<br />
irréfragable pour infirmer le prétendu fatalisme du clash <strong>de</strong>s<br />
civilisations.<br />
11 Cf. Samuel P. Huntington, Le Choc <strong>de</strong>s civilisations, éd. Odile Jacob, 1997.<br />
19
LNA#49 / à lire<br />
20<br />
Neurosciences et enseignement<br />
Le désir <strong>de</strong> réduire la connaissance à la cognition 1 et<br />
<strong>les</strong> sciences cognitives aux neurosciences peut être relié<br />
à l’usage ambigu du terme « matière », terme que l’on retrouve<br />
dans <strong>les</strong> sciences <strong>de</strong> la nature et dans <strong>les</strong> diverses philosophies<br />
dites matérialistes, comme si le terme « matière »<br />
avait une signification bien définie, libre <strong>de</strong> toute confusion.<br />
C’est cette confusion que l’on retrouve dans cette profession<br />
<strong>de</strong> foi matérialiste <strong>de</strong> Pierre Jacob qui proclame :<br />
« Souscrire au monisme matérialiste, c’est admettre que <strong>les</strong> processus<br />
chimiques, psychologiques, linguistiques, économiques,<br />
sociologiques et <strong>culture</strong>ls sont <strong>de</strong>s processus physiques. » 2<br />
La matière joue ici le même rôle que <strong>les</strong> Idées platoniciennes,<br />
et le monisme matérialiste que propose Pierre Jacob relève<br />
plus <strong>de</strong> la croyance que <strong>de</strong> la science.<br />
C’est via ce réductionnisme plus métaphysique que scientifique<br />
3 qu’il faut comprendre <strong>les</strong> tentatives d’explication<br />
biologique <strong>de</strong> l’apprentissage renvoyant aux neurosciences,<br />
réductionnisme d’autant plus fort que s’y entremêlent<br />
le désir théorique <strong>de</strong> comprendre comment l’homme<br />
apprend et le désir pratique <strong>de</strong> définir <strong>les</strong> conditions d’un<br />
enseignement réussi. Ainsi s’ajoute au projet scientifique <strong>de</strong>s<br />
neurosciences, celui <strong>de</strong> comprendre l’activité cérébrale qui<br />
accompagne tout acte <strong>de</strong> pensée, un projet pratique, celui<br />
d’énoncer <strong>les</strong> bonnes règ<strong>les</strong> <strong>de</strong> l’enseignement. Les neurosciences<br />
prennent ici la relève <strong>de</strong>s théories <strong>de</strong> l’apprentissage en y<br />
ajoutant une image <strong>de</strong> scientificité plus canonique.<br />
Nous ne nous prononçons pas ici, en ce qui concerne l’acte<br />
<strong>de</strong> connaissance, sur le matérialisme et <strong>les</strong> diverses idéologies<br />
qui s’en réclament, nous nous proposons seulement<br />
<strong>de</strong> mettre l’accent sur <strong>les</strong> limites <strong>de</strong> cette naturalisation <strong>de</strong><br />
l’acte <strong>de</strong> connaissance qui, sous prétexte <strong>de</strong> mieux le comprendre,<br />
conduit à réduire <strong>les</strong> obstac<strong>les</strong> épistémologiques à<br />
l’appréhension d’un contenu <strong>de</strong> connaissance à <strong>de</strong> simp<strong>les</strong><br />
mouvements neuronaux. On confond ainsi <strong>les</strong> contraintes<br />
liées à l’apprentissage d’un domaine <strong>de</strong> la connaissance et<br />
<strong>les</strong> contraintes imposées par l’élaboration <strong>de</strong>s neurosciences<br />
comme étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’activité cérébrale ; on continue ainsi, sous<br />
1 On peut considérer la cognition comme l’ensemble <strong>de</strong>s phénomènes psychologiques<br />
et biologiques qui accompagnent l’acte <strong>de</strong> connaître.<br />
2 Pierre Jacob, Pourquoi <strong>les</strong> choses ont-el<strong>les</strong> un sens ?, éd. Odile Jacob, Paris,<br />
1997, p. 9.<br />
3 Si le réductionnisme joue un rôle essentiel dans l’activité scientifique, tout<br />
réductionnisme ne relève pas <strong>de</strong> la science.<br />
une forme différente, la confusion introduite par Piaget entre<br />
ce qu’il considérait comme <strong>les</strong> structures profon<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la<br />
cognition et <strong>les</strong> mo<strong>de</strong>s d’apprentissage, confusion renforcée<br />
ici par un matérialisme simpliste, <strong>les</strong> structures profon<strong>de</strong>s se<br />
rattachant à l’activité cérébrale.<br />
Pourtant, s’il y a un apport <strong>de</strong>s neurosciences à l’enseignement,<br />
il s’appuie sur l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s dysfonctionnements du cerveau qui<br />
peuvent s’opposer à l’apprentissage. On pourrait, par exemple,<br />
citer le discours sur la dyslexie qui mêle <strong>de</strong>s problèmes réels<br />
<strong>de</strong> dysfonctionnement cérébral et <strong>les</strong> difficultés créées par certaines<br />
formes d’enseignement <strong>de</strong> la lecture, comme l’explique<br />
Colette Ouzilou dans son ouvrage Dyslexie, une vraie fausse<br />
épidémie 4 . On peut voir ici comment <strong>les</strong> neurosciences<br />
permettent <strong>de</strong> distinguer <strong>les</strong> difficultés qui proviennent <strong>de</strong><br />
dysfonctionnements cérébraux <strong>de</strong> cel<strong>les</strong> qui proviennent <strong>de</strong><br />
mauvaises métho<strong>de</strong>s d’enseignement.<br />
Stéphane Dehaene abor<strong>de</strong> cette question dans Les Neurones<br />
<strong>de</strong> la Lecture 5 , mais il l’accompagne <strong>de</strong> considérations<br />
sur l’apprentissage <strong>de</strong> la lecture qui dépassent le cadre <strong>de</strong>s<br />
neurosciences. Même si nous partageons ses conclusions<br />
sur la nécessité d’user <strong>de</strong> la métho<strong>de</strong> alphabétique dans<br />
l’apprentissage <strong>de</strong> la lecture, nous ne pouvons accepter ses<br />
arguments qui renvoient moins à la langue qu’à l’activité<br />
neuronale. Même si on reconnaît que la lecture, comme<br />
toute activité humaine, a un fon<strong>de</strong>ment biologique, on<br />
ne peut la réduire à ce seul aspect biologique. En ce qui<br />
concerne <strong>les</strong> langues et leur diversité, il faudrait avoir une<br />
théorie biologique <strong>de</strong> cette diversité, ce qui reviendrait à<br />
réduire l’histoire humaine à une suite <strong>de</strong> phénomènes biologiques,<br />
et seulement biologiques.<br />
On peut rappeler que <strong>les</strong> premières écritures historiquement<br />
connues ne sont pas alphabétiques, et qu’aujourd’hui encore<br />
existent <strong>de</strong>s systèmes d’écritures non alphabétiques. Sauf à<br />
considérer que le passage <strong>de</strong> l’écriture idéographique à l’écriture<br />
alphabétique relève d’une mutation génétique <strong>de</strong> l’espèce<br />
humaine, on ne peut accepter une quelconque naturalité <strong>de</strong><br />
l’écriture alphabétique ; on ne peut que prendre acte du fait<br />
historique <strong>de</strong> l’apparition <strong>de</strong> l’écriture alphabétique, <strong>de</strong> la<br />
facilité <strong>de</strong> lecture et d’écriture qu’elle a apportée et <strong>de</strong> son<br />
4 Colette Ouzilou, Dyslexie, une vraie fausse épidémie, éd. Presses <strong>de</strong> la Renais-<br />
sance, 2001.<br />
Par Rudolf BKOUCHE<br />
Professeur émérite, Université <strong>de</strong> Lille 1<br />
5 Stéphane Dehaene, Les Neurones <strong>de</strong> la Lecture, préface <strong>de</strong> Jean-Pierre<br />
Changeux, éd. Odile Jacob, Paris, 2007.
développement ultérieur. Il faut alors prendre en compte,<br />
dans l’enseignement <strong>de</strong> la lecture, ou plutôt <strong>de</strong> la lectureécriture<br />
6 , le caractère <strong>de</strong> la langue : la métho<strong>de</strong> alphabétique<br />
s’impose dès lors qu’une langue est alphabétique. Et l’on sait<br />
que l’apprentissage reste fonction <strong>de</strong> la langue, particulièrement<br />
<strong>de</strong> la correspondance « graphème - phonème », correspondance<br />
qui peut être plus ou moins simple ou complexe<br />
suivant <strong>les</strong> langues. Stéphane Dehaene souligne, dans son<br />
ouvrage, <strong>les</strong> distinctions entre l’italien où la correspondance<br />
est biunivoque, la langue française où la correspondance est<br />
déjà plus complexe et la langue anglaise où cette correspondance<br />
se complique 7 ; ainsi, même dans le cas d’une langue<br />
alphabétique, l’apprentissage ne peut être réduit à un problème<br />
<strong>de</strong> neurones, tout au plus sait-on, et c’est un apport<br />
<strong>de</strong>s neurosciences, que l’apprentissage impose au cerveau <strong>de</strong>s<br />
reconfigurations neurona<strong>les</strong> qui dépen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s connaissances<br />
apprises.<br />
Piaget pensait déjà à la possibilité d’une explication biologique<br />
<strong>de</strong>s activités cognitives mais, explique Olivier Houdé,<br />
il lui manquait <strong>les</strong> moyens techniques d’observer in vivo<br />
l’activité cérébrale, à savoir l’imagerie cérébrale fonctionnelle<br />
8 . L’utilisation <strong>de</strong> cette nouvelle technique a permis <strong>de</strong><br />
nouvel<strong>les</strong> observations <strong>de</strong> l’activité cérébrale accompagnant<br />
<strong>les</strong> actes <strong>de</strong> raisonnement, permettant <strong>de</strong> corriger certaines<br />
erreurs <strong>de</strong> Piaget, mettant en évi<strong>de</strong>nce <strong>les</strong> inhibitions qui<br />
accompagnent tout apprentissage 9 . En ce qui concerne le<br />
raisonnement logique, Houdé rappelle, ce que l’on savait<br />
bien avant <strong>les</strong> neurosciences, <strong>les</strong> contradictions entre<br />
perception sensible et raisonnement logique 10 . Mais la question<br />
reste celle <strong>de</strong> la validité d’une explication neurologique<br />
pour comprendre ce qui se joue dans ces contradictions.<br />
Alors que Piaget en appelait à la métho<strong>de</strong> historico-critique,<br />
même si, pour respecter <strong>les</strong> dogmes <strong>de</strong> l’épistémologie génétique,<br />
il tordait l’histoire à sa convenance 11 , celle-ci n’intervient<br />
pas dans le discours <strong>de</strong> Houdé. La naturalisation<br />
6 Michel Delord, http://michel.<strong>de</strong>lord.free.fr/lecture.html<br />
7 Stéphane Dehaene, Les Neurones <strong>de</strong> la Lecture, o.c. p. 305-306.<br />
8 Olivier Houdé, La psychologie <strong>de</strong> l’enfant, « Que sais-je ? », éd. PUF, Paris,<br />
2004-2005, p. 97.<br />
9 Ibid, p. 72.<br />
10 Ibid, p. 91-96.<br />
11 Jean Piaget <strong>de</strong> Rolando Garcia, Psychogenèse et Histoire <strong>de</strong>s Sciences, « Nouvelle<br />
Bibliothèque et Histoire <strong>de</strong>s Sciences », éd. Flammarion, Paris, 1983.<br />
<strong>de</strong>s obstac<strong>les</strong> épistémologiques <strong>de</strong>vient ici un obstacle à leur<br />
compréhension. On retrouve, en outre, une erreur classique<br />
<strong>de</strong>s théories <strong>de</strong> l’apprentissage, la réduction <strong>de</strong>s questions<br />
d’apprentissage aux seuls enfants, même si Houdé pose la<br />
question <strong>de</strong>s erreurs <strong>de</strong> raisonnement chez <strong>les</strong> adultes. Au<br />
discours <strong>de</strong> Houdé, nous pouvons objecter <strong>les</strong> « erreurs »<br />
commises par <strong>les</strong> mathématiciens au cours <strong>de</strong> l’histoire, ce<br />
qui montre que la réduction neurologique est insuffisante<br />
pour comprendre le rôle <strong>de</strong>s obstac<strong>les</strong>. Sauf à chercher, par<br />
exemple, une explication biologique <strong>de</strong>s démonstrations<br />
du postulat <strong>de</strong>s parallè<strong>les</strong>, démonstrations dans <strong>les</strong>quel<strong>les</strong><br />
on peut voir la prégnance <strong>de</strong> ce que Houdé appelle<br />
l’appariement perceptif. Les inventeurs <strong>de</strong> la géométrie noneuclidienne<br />
seraient-ils <strong>de</strong>s mutants comme l’auraient été,<br />
à l’aube <strong>de</strong> l’histoire, <strong>les</strong> inventeurs <strong>de</strong> l’écriture alphabétique<br />
? Et Cauchy, démontrant que la limite d’une suite <strong>de</strong><br />
fonctions continues est une fonction continue, était-il atteint<br />
<strong>de</strong> lésions cérébra<strong>les</strong> ?<br />
Il n’est pas question <strong>de</strong> remettre en cause <strong>les</strong> apports <strong>de</strong>s<br />
neurosciences dans la compréhension <strong>de</strong> l’activité intellectuelle.<br />
Mais on ne saurait, au nom d’une caricature <strong>de</strong><br />
matérialisme, réduire l’activité intellectuelle à l’activité cérébrale<br />
qui l’accompagne. Quant à chercher dans <strong>les</strong> neurosciences<br />
une explication <strong>de</strong> ce que l’on appelle <strong>les</strong> difficultés<br />
<strong>de</strong>s élèves, cela nous semble relever <strong>de</strong> l’angélisme scientiste.<br />
Mais cet angélisme, en se proposant <strong>de</strong> naturaliser <strong>les</strong><br />
obstac<strong>les</strong> épistémologiques, prend le risque <strong>de</strong> créer <strong>de</strong>s<br />
difficultés artificiel<strong>les</strong> et <strong>de</strong> faire ainsi écran à la compréhension<br />
<strong>de</strong>s disciplines enseignées, continuant ainsi la tradition<br />
<strong>de</strong>s théories <strong>de</strong> l’apprentissage.<br />
à lire / LNA#49<br />
21
LNA#49 / à lire<br />
22<br />
Histoire <strong>de</strong> la thermodynamique classique,<br />
<strong>de</strong> Carnot à Gibbs *<br />
* Robert Locqueneux, Paris, éd. Belin, 2008.<br />
Tous <strong>les</strong> historiens <strong>de</strong>s Sciences connaissent <strong>les</strong> ouvrages<br />
<strong>de</strong> Robert Locqueneux, notamment son Histoire <strong>de</strong> la<br />
physique 1 , sa Préhistoire et Histoire <strong>de</strong> la thermodynamique<br />
classique 2 , son Ampère, encyclopédiste et métaphysicien 3<br />
qui vient <strong>de</strong> paraître, ainsi que son Henri Bouasse, un<br />
regard sur l’enseignement et la recherche 4 . Ce sont <strong>de</strong>s<br />
œuvres admirab<strong>les</strong>, savantes, riches et concises à la fois.<br />
C’est donc avec un réel bonheur que nous verrons paraître<br />
prochainement « Une histoire <strong>de</strong> la thermodynamique<br />
classique, <strong>de</strong> Carnot à Gibbs », que vont lire avec<br />
empressement et profit <strong>les</strong> enseignants <strong>de</strong> physique – qui<br />
pourront éclairer <strong>les</strong> connaissances actuel<strong>les</strong> à la lumière<br />
<strong>de</strong>s problématiques développées dans le passé –, mais aussi<br />
<strong>les</strong> historiens <strong>de</strong>s Sciences et <strong>de</strong>s Techniques et le public<br />
cultivé.<br />
L<br />
’histoire <strong>de</strong>s sciences peut-être présentée <strong>de</strong> trois manières<br />
différentes dans <strong>les</strong> livres. Les uns sélectionnent<br />
<strong>les</strong> épiso<strong>de</strong>s qui semblent conduire à notre science contemporaine<br />
et en font une suite d’éléments classés <strong>de</strong> manière<br />
chronologique qui mènent à un savoir achevé : le nôtre.<br />
D’autres énumèrent comme un catalogue <strong>les</strong> prétendues<br />
opinions <strong>de</strong>s uns et <strong>de</strong>s autres, sans que le sens <strong>de</strong>s travaux<br />
énoncés apparaisse. C’est à la troisième catégorie qu’appartient<br />
l’ouvrage <strong>de</strong> Robert Locqueneux. Celui-ci nous y fait<br />
accé<strong>de</strong>r à son immense <strong>culture</strong> en nous donnant <strong>les</strong> gril<strong>les</strong><br />
intellectuel<strong>les</strong> qui permettent, à chaque époque, d’interpréter<br />
<strong>les</strong> phénomènes où le chaud et le froid sont impliqués. Il<br />
peint <strong>les</strong> contextes, <strong>les</strong> présupposés, <strong>les</strong> œuvres <strong>de</strong>s hommes<br />
et <strong>les</strong> intègre dans leurs visions du mon<strong>de</strong> : el<strong>les</strong> donnent<br />
naissance à <strong>de</strong>s systèmes physiques continûment remis en<br />
causes. Ainsi, l’auteur prend-il en compte, dans <strong>les</strong> œuvres<br />
<strong>de</strong> Clausius, Boltzmann et quelques autres, la part qui substitue<br />
à l’éternel retour <strong>de</strong>s choses – caractéristique <strong>de</strong> la vision<br />
laplacienne du mon<strong>de</strong> – l’idée <strong>de</strong> la mort annoncée <strong>de</strong> l’univers.<br />
Il souligne la place prise par la thermodynamique dans<br />
l’énergétique d’Ostwald, laquelle prétend rendre compte <strong>de</strong><br />
tous <strong>les</strong> domaines <strong>de</strong> l’activité humaine ; il montre l’implication<br />
scientiste <strong>de</strong> certains acteurs <strong>de</strong> cette histoire.<br />
1 Que sais-je, éd. PUF.<br />
2 Cahiers d’histoire et <strong>de</strong> philosophie <strong>de</strong>s Sciences.<br />
3 EDP Sciences.<br />
4 Albert Blanchard.<br />
Par Bernard MAIttE<br />
Professeur d’histoire <strong>de</strong>s sciences et d’épistémologie<br />
à l’Université <strong>de</strong> Lille 1<br />
La science est ainsi présentée comme œuvre diverse et collective,<br />
comme pensée vivante sur le mon<strong>de</strong>. Pour nous<br />
faire comprendre ces problématiques où <strong>les</strong> frontières<br />
<strong>de</strong> nos actuel<strong>les</strong> disciplines n’existent pas, où <strong>les</strong> sens <strong>de</strong>s<br />
mots attachés aux concepts diffèrent, Robert Locqueneux a<br />
choisi <strong>de</strong> nous donner <strong>de</strong>s textes significatifs <strong>de</strong> la manière<br />
dont on peut, tout au long du XIX ème siècle, raisonnablement<br />
et contradictoirement, se représenter <strong>les</strong> phénomènes<br />
où le chaud et le froid interviennent. Ces textes sont insérés<br />
dans l’histoire elle-même, la complètent, l’illustrent,<br />
montrent l’inci<strong>de</strong>nce du discours scientifique sur la façon<br />
<strong>de</strong> penser du temps, <strong>de</strong> même que la façon <strong>de</strong> penser du<br />
temps agit sur le discours scientifique. Au milieu du XIX ème<br />
siècle, nul ne fait <strong>de</strong> la physique sans avoir recours à l’analyse<br />
mathématique : ce serait trahir la pensée <strong>de</strong>s auteurs<br />
qui ont élaboré <strong>les</strong> thermodynamiques phénoménologique<br />
et statistique que <strong>de</strong> donner leurs textes sans leur formalisme<br />
mathématique. L’auteur nous permet donc d’entrer dans ce<br />
qu’il a été convenu d’appeler la « physique mathématique »,<br />
mais c’est son grand mérite <strong>de</strong> l’avoir fait <strong>de</strong> telle manière<br />
que le lecteur plus intéressé par l’histoire <strong>de</strong>s idées que par<br />
l’histoire <strong>de</strong> la physique puisse enjamber <strong>les</strong> formu<strong>les</strong> citées<br />
sans vergogne.<br />
En voulant ainsi donner idée <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong>s connaissances en<br />
physique aux différents moments <strong>de</strong> cette histoire, Robert<br />
Locqueneux met en scène <strong>de</strong>s conflits et montre que diverses<br />
interprétations peuvent parfois être faites d’un même phénomène,<br />
sans que <strong>les</strong> connaissances du temps permettent<br />
<strong>de</strong> <strong>les</strong> départager. Il décrit à égalité <strong>les</strong> différentes tendances<br />
qui s’affrontent en une époque : cel<strong>les</strong> qui rétrospectivement<br />
ont marqué l’évolution vers nos mo<strong>de</strong>rnes théories, cel<strong>les</strong><br />
qui ont conduit à une impasse, cel<strong>les</strong> qui ont été oubliées,<br />
cel<strong>les</strong> qui se sont révélées – beaucoup plus tard – fécon<strong>de</strong>s...<br />
Cette manière <strong>de</strong> faire nous incite à beaucoup <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>stie,<br />
d’une part parce que l’on peut se rendre compte que la<br />
pertinence d’une recherche ne se mesure pas à l’aune <strong>de</strong> sa<br />
mathématisation, ensuite parce que nous découvrons que<br />
<strong>les</strong> recherches <strong>les</strong> plus contemporaines pourraient gagner en<br />
épaisseur et en fécondité en reformulant d’anciennes questions,<br />
en se nourrissant aux sources <strong>de</strong>s auteurs du passé.<br />
L’auteur n’a pas voulu terminer son ouvrage sur l’établissement<br />
<strong>de</strong>s thermodynamiques phénoménologique et statistique,<br />
dont <strong>les</strong> formalisations mathématiques restent en<br />
gran<strong>de</strong> partie <strong>les</strong> nôtres, la clarté <strong>de</strong>s exposés en moins : il<br />
montre le rôle central qu’el<strong>les</strong> ont joué dans la crise <strong>de</strong> la
physique aux environs <strong>de</strong> 1900, alors que beaucoup <strong>de</strong> physiciens<br />
pensaient que la physique était achevée, comme déjà<br />
avant eux d’autres avaient pu penser <strong>de</strong> même... La physique<br />
actuelle bénéficie elle aussi d’une présentation consensuelle<br />
; elle fait chaque jour preuve <strong>de</strong> sa fécondité. Est-elle<br />
pour autant garantie contre toute remise en cause ? Le livre<br />
<strong>de</strong> Robert Locqueneux permet <strong>de</strong> suggérer que nos connaissances<br />
en physique nous font percevoir certains phénomènes<br />
d’une manière telle que nous ne puissions <strong>les</strong> utiliser pour<br />
rechercher d’autres formalisations ou, peut-être, une autre<br />
physique fondée sur d’autres principes... Ainsi est-il pertinent<br />
<strong>de</strong> se <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r si ce livre magistral, qui nous présente<br />
l’histoire <strong>de</strong> la thermodynamique classique, constitue une<br />
leçon d’histoire ou une leçon <strong>de</strong> physique. Il faut lire et<br />
relire ce récit <strong>de</strong> l’invention <strong>de</strong>s thermodynamiques. La leçon<br />
<strong>de</strong> physique que nous donne Robert Locqueneux nous<br />
répète que notre science, si dogmatisée, n’est pas achevée et<br />
ne saurait épuiser le réel. La leçon d’histoire nous montre<br />
que l’évolution <strong>de</strong>s idées en physique est toujours faite, à<br />
toute époque, <strong>de</strong> continuités et <strong>de</strong> ruptures, mais surtout <strong>de</strong><br />
tensions contraires.<br />
Ludwig Boltzmann<br />
Sadi Carnot<br />
à lire / LNA#49<br />
23
LNA#49 / jeux littéraires<br />
Mallarmé par Toffeur http://toffeur.canalblog.com<br />
24<br />
Roubaud plagié par Mallarmé<br />
Les poètes aiment à dire la chose, mais la nommer autrement<br />
; n’appellent-ils prosodie la science qui s’occupe<br />
<strong>de</strong> versification, <strong>de</strong> métrique, d’accentuation, <strong>de</strong> mélodie ?<br />
Monsieur Jourdain s’y perdrait d’entendre le Maître <strong>de</strong><br />
Philosophie enseigner que « la prosodie concerne tout ce qui<br />
n’est point prose mais vers ».<br />
François <strong>de</strong> Malherbe, le premier en France, édicte à la<br />
charnière du XVII e siècle <strong>de</strong>s règ<strong>les</strong> prosodiques stab<strong>les</strong>.<br />
Chaque fois qu’ils écriront en vers, Molière et tous <strong>les</strong> autres<br />
s’y soumettront. Puis Théodore <strong>de</strong> Banville enrichit la discipline<br />
d’un p e t i t t r a i t é d e p o é s i e f r a nç a i s e dévolu à<br />
la seule pureté technique, ouvrage qui a trouvé lecteur<br />
assidu en Stéphane Mallarmé. L’auteur du Coup <strong>de</strong> dés, celui<br />
pour qui « la poésie doit être une rupture <strong>de</strong> toutes nos habitu<strong>de</strong>s<br />
» 1 n’en souscrit pas moins aux préceptes <strong>de</strong> Malherbe<br />
et Banville. Les rares entorses mallarméennes obéissent à<br />
une nécessité supérieure, par exemple plagier par anticipation<br />
l’Oulipo :<br />
Voix étrangère au bosquet<br />
Ou par nul écho suivie,<br />
L’oiseau qu’on n’ouït jamais<br />
Une autre fois en la vie.<br />
C’est nous qui avons souligné <strong>les</strong> syllabes -quet et -mais.<br />
Scandale ces <strong>de</strong>ux syllabes, car Malherbe et Banville<br />
exigent que <strong>les</strong> consonnes fina<strong>les</strong> « riment »... y compris<br />
1 Gaston Bachelard, Le droit <strong>de</strong> rêver, éd. PUF, 1970.<br />
& par anticipation<br />
par Robert Rapilly http://robert.rapilly.free.fr/<br />
« On a touché au vers »<br />
(Stéphane Mallarmé, conférences à Oxford et Cambridge)<br />
muettes ! Parcourons nos classiques : aucun jusqu’Apollinaire<br />
ne déroge à cette survivance orthographique <strong>de</strong>s prononciations<br />
révolues ; nul donc ne ferait rimer « bosquette »<br />
et « jamaisse », surtout pas Mallarmé hanté <strong>de</strong> perfection.<br />
Alors, pourquoi déroger soudain, et dans ce seul quatrain -<br />
le second <strong>de</strong> pe t i t a ir ii ?<br />
Reprenons la strophe d’un trait : « voix étrangère au bosquet<br />
ou par nul écho suivie, l’oiseau qu’on n’ouït jamais une<br />
autre fois en la vie ». C’est tout simple, quatre vers ne chantent<br />
rien d’autre que : voici la rime qui ne rime pas, celle que<br />
l’on n’a jamais entendue. Limpidité conjuguée <strong>de</strong> la forme et<br />
du fond ! À <strong>de</strong>ssein vertigineux, Mallarmé souscrit au premier<br />
principe <strong>de</strong> Jacques Roubaud : « Un texte écrit suivant<br />
une contrainte parle <strong>de</strong> cette contrainte ».<br />
Et Paul Bénichou 2 , auditeur perspicace, perçoit ici « au<br />
lieu <strong>de</strong> multip<strong>les</strong> essais, un seul chant, décisif et fatal ».<br />
*<br />
Ve n d r e d i 10 o c t o b r e 2008 :<br />
Za Zi e Mo d e d’eM p l o i au pr at o<br />
Récrivons un poème d’osk a r pa r t i o r suivant 100 000<br />
milliards <strong>de</strong> tours oulipiens et dans toutes <strong>les</strong> langues et<br />
dialectes <strong>de</strong> l’univers. Car à la rentrée, ZaZ i e Mo d e d’eMp<br />
l o i mettra à l’honneur le grand poète né en 1927, entré à<br />
l’Oulipo en 1992, couronné l’année <strong>de</strong> son décès du plus<br />
prestigieux prix littéraire allemand, le Georg-Büchner-Preis<br />
2006.<br />
Musique <strong>de</strong> table. Tino est dans le jardin et<br />
voit une orange. Il dit qu’est-ce que c’est comme<br />
fleur. Il <strong>de</strong>man<strong>de</strong> ce que c’est comme nuage. Le<br />
père dit qu’une fleur est une fleur. Tino prend<br />
l’orange et dit papa pèle-moi le nuage. Le père<br />
pèle la fleur et donne six tranches à Tino. Le<br />
père mange une tranche et dit qu’une tranche<br />
est une tranche. Tino mange. Il dit c’est une<br />
tranche <strong>de</strong> nuage elle a un goût <strong>de</strong> fleur. Il<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> ce que c’est comme fleur. Le père dit<br />
qu’un nuage est un nuage et qu’une orange est<br />
une orange. Tino voit une limace. Le père voit<br />
2 Selon Mallarmé, éd. Gallimard, 1995.
un petit chien <strong>de</strong> Calabre. Le père dit qu’est-ce<br />
que c’est que cette pluie dans le jardin. Il <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
qu’est-ce que c’est que cette comète dans<br />
le jardin. Tino dit ce n’est pas une queue <strong>de</strong><br />
comète dans le jardin c’est une orange avec <strong>de</strong>ux<br />
cornes. Le père pèle l’orange et dit voici une<br />
tranche <strong>de</strong> pluie voici une tranche <strong>de</strong> neige et<br />
voici une tranche <strong>de</strong> patatras. Chouette dit Tino<br />
et il donne l’orange au ramoneur.<br />
(Extrait <strong>de</strong> Après l’est et l’ouest, Textuel, collection L’œil du poète, 2001, traduction<br />
Alain Jadot, version originale dans Höricht, Klaus Ramm, 1975).<br />
Multip<strong>les</strong> réécritures sur www.zazipo.net<br />
Et retrouvons-nous vendredi 10 octobre 2008, lors <strong>de</strong> la<br />
n u i t d e l’é c r i t au pr at o, pour décliner <strong>de</strong> 666 666 façons<br />
la s e x t i n e , manière poétique <strong>de</strong>s troubadours qui passionna<br />
osk a r pa s t i o r ! Affiche exceptionnelle, lisez donc :<br />
- À 19 heures : ça s’a ppe l l e se x t i n e , lecture étincelante par<br />
Jacques ro u b a u d, Marcel bé n a b o u, Frédéric fo r t e , Paul<br />
fo u r n e l , Hervé le te l l i e r, Ian Mo n k et Olivier sa l o n.<br />
- De 20h30 à minuit dans tout l’espace du pr at o (salle <strong>de</strong><br />
spectacle, coulisses, bar, jardin…) : cabaret, soupe, lectures<br />
<strong>de</strong> Gil<strong>les</strong> <strong>de</strong> f a c q u e et Parviz la k, ateliers d’écriture avec <strong>les</strong><br />
Oulipiens, <strong>de</strong> ban<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssinée avec Étienne lé c r o a r t, peinture<br />
par Clau<strong>de</strong> ch au ta r d, chorale par Martin Gr a n G e r, etc.<br />
- Le len<strong>de</strong>main, ateliers d’écriture et <strong>de</strong> ban<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssinée à la<br />
Médiathèque <strong>de</strong> Moulins.<br />
Renseignements, réservations, contributions, etc. encore<br />
sur www.zazipo.net<br />
jeux littéraires / LNA#49<br />
Opé r a s-m i n u t e<br />
d e Fr é dé r ic FO r t e<br />
Ce qu’invente fr é d é r i c<br />
fo r t e , ca<strong>de</strong>t <strong>de</strong> l’OuLiPo,<br />
est promis à <strong>de</strong>venir classique.<br />
Ses opé r a s-M i n u t e<br />
(Théâtre typographique, 2005)<br />
annoncent un potentiel<br />
incalculable d’écriture, <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ssin, <strong>de</strong> calligraphie…<br />
On y trouve à lire, à compter<br />
et conter, entendre et<br />
chanter, toucher, mesurer.<br />
fo r t e apporte une réponse inusitée à l’injonction sibylline<br />
<strong>de</strong>s Poésies II d’Isidore Ducasse : « La poésie doit être faite<br />
par tous », où « tous » désigne non d’abord l’humanité mais<br />
« <strong>les</strong> phénomènes <strong>de</strong> l’âme ». Chaque page, divisée en scène<br />
et coulisse, accomplit l’exploit d’inventer une forme poétique<br />
inédite. Et nous tous, machinistes complices du haut du<br />
grill, sommes poètes en même temps.<br />
25
LNA#49 / vivre <strong>les</strong> sciences, vivre le droit...<br />
26<br />
Les statistiques, ou <strong>les</strong> histoires du « compteur »<br />
Les problématiques conduisant à <strong>de</strong>s questions <strong>de</strong> nature<br />
statistique sont variées. La prise en compte <strong>de</strong> l’aléatoire<br />
a gagné presque tous <strong>les</strong> domaines : le contrôle <strong>de</strong><br />
qualité en milieu industriel, la prévision <strong>de</strong>s petits et<br />
<strong>de</strong>s grands risques, l’élaboration <strong>de</strong> politiques <strong>de</strong> santé<br />
publique, <strong>les</strong> calculs financiers, etc. 1<br />
Lorsque Durkheim, que l’on peut considérer comme<br />
le père <strong>de</strong> la sociologie, voulait étudier le phénomène<br />
social du suici<strong>de</strong>, il se référait certes à <strong>de</strong>s statistiques officiel<strong>les</strong>,<br />
mais ne se situait pas lui-même dans une optique<br />
expressément politique. Il voulait seulement comprendre<br />
un fait <strong>de</strong> société, ses tenants et aboutissants, et ne pouvait<br />
le faire sans mesurer <strong>les</strong> comportements individuels, examinés<br />
à l’échelle <strong>de</strong> faits sociaux que l’on peut alors corréler, en<br />
fonction <strong>de</strong> l’état civil, <strong>de</strong> l’âge, bref <strong>de</strong> toutes <strong>les</strong> variab<strong>les</strong><br />
qui peuvent être significatives sur la question étudiée.<br />
Or, ce qui caractérise notre époque, c’est que l’approche<br />
statistique ne se limite plus à l’étu<strong>de</strong> désintéressée <strong>de</strong> phénomènes<br />
sociaux globaux. Elle s’est soumise à <strong>de</strong>s objectifs<br />
plus particuliers <strong>de</strong> l’action humaine sensée, par exemple<br />
ceux du travail, <strong>de</strong> la santé, <strong>de</strong> la politique 2 . À la conception<br />
probabiliste <strong>de</strong> la statistique s’est peu à peu ajoutée une visée<br />
ouvrant à <strong>de</strong>s perspectives d’action. À l’époque actuelle, il<br />
n’est pas <strong>de</strong> ministère qui ne dispose <strong>de</strong> son service statistique<br />
en vue d’une action, que ce soit même dans le domaine<br />
<strong>de</strong> la communication, <strong>de</strong> la <strong>culture</strong> ou <strong>de</strong> l’éducation. Plus<br />
généralement, tous <strong>les</strong> grands acteurs sociaux se dotent <strong>de</strong><br />
ces moyens puissants pour régir une réalité mouvante et lui<br />
appliquer éventuellement <strong>de</strong> nouvel<strong>les</strong> orientations, afin <strong>de</strong><br />
justifier une stratégie déterminée.<br />
1 Introduction au rapport d’étape Statistique et probabilités <strong>de</strong> la commission<br />
<strong>de</strong> réflexion sur l’enseignement <strong>de</strong>s mathématiques (avril 2001).<br />
Cette commission s’était constituée à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s associations <strong>de</strong><br />
mathématiciens (avec lettre <strong>de</strong> mission du Ministre <strong>de</strong> l’éducation<br />
nationale J. Lang en avril 1999) pour réfléchir aux conditions <strong>de</strong> « l’enseignement<br />
<strong>de</strong>s mathématiques <strong>de</strong> l’école élémentaire à l’université ».<br />
Un chapitre avait été rédigé sur Statistiques et probabilités. Le rapport<br />
définitif <strong>de</strong> ce chapitre date du 15 mars 2003.<br />
2 Encore que <strong>les</strong> premières étu<strong>de</strong>s sur l’applicabilité <strong>de</strong>s statistiques aux<br />
secteurs socio-politiques remontent à la fin du XIX ème siècle (cf. Daniel<br />
J. Denis & Kara R. Docherty : Late Nineteenth Century Britain : A<br />
Social, Political and Methodological Context for the Rise of Multivariate<br />
Statistics, in Journ@l Electronique d’Histoire <strong>de</strong>s Probabilités et <strong>de</strong> la<br />
Statistique, Vol. 3, n° 2, décembre 2007).<br />
Par Jean-Marie BREUVARt<br />
Philosophe<br />
Encore faut-il que <strong>les</strong> corrélations retenues soient réel<strong>les</strong>, et<br />
non le fruit du hasard. Comme le recomman<strong>de</strong> la commission<br />
<strong>de</strong> réflexion évoquée au début, « une corrélation forte<br />
n’implique pas nécessairement une causalité », ce qui s’énonce<br />
aussi : si un nuage <strong>de</strong> points est presque rectiligne, cela n’implique<br />
pas nécessairement <strong>de</strong> relation <strong>de</strong> cause à effet entre le<br />
phénomène mesuré par <strong>les</strong> abscisses et celui qui est mesuré par<br />
<strong>les</strong> ordonnées. Les rapporteurs donnent alors l’exemple d’une<br />
fausse corrélation entre le nombre d’entrées aux cinémas<br />
projetant <strong>de</strong>s films violents et le nombre d’agressions sur la<br />
voie publique. En l’absence <strong>de</strong> toute hypothèse précise, une<br />
telle corrélation relèverait <strong>de</strong> l’aléatoire.<br />
Pourtant, c’est sur <strong>de</strong> tel<strong>les</strong> liaisons douteuses que se définissent<br />
parfois ce que <strong>les</strong> statisticiens appellent une modélisation,<br />
une représentation fictive <strong>de</strong> la réalité, conduisant<br />
elle-même à <strong>de</strong>s projections à plus ou moins long terme. Or,<br />
une telle fiction peut être suscitée par d’autres intérêts que<br />
ceux <strong>de</strong> la recherche, comme cela se manifeste dans le domaine<br />
spécifique du politique, pour la définition <strong>de</strong>s grands<br />
axes à mettre en place. C’est à ce niveau que peuvent se<br />
glisser <strong>de</strong>s visées <strong>de</strong> pouvoir fort peu compatib<strong>les</strong> avec une<br />
métho<strong>de</strong> scientifique. Sans revenir sur l’abus <strong>de</strong>s sondages<br />
en politique, avec une interprétation <strong>de</strong>s côtes <strong>de</strong> popularité<br />
montantes et <strong>de</strong>scendantes, il suffit <strong>de</strong> voir, par exemple,<br />
comment se définissent <strong>les</strong> gran<strong>de</strong>s orientations du corps<br />
électoral. La représentation fictive <strong>de</strong> la population est celle<br />
d’un grand corps social, traversé <strong>de</strong> pulsions qu’il s’agit <strong>de</strong><br />
satisfaire ou <strong>de</strong> maîtriser. Cette fiction vient s’interposer<br />
entre la réalité <strong>de</strong>s « gens » et la vision que l’on en a. Les<br />
statistiques risquent alors <strong>de</strong> supplanter ce qui faisait jadis la<br />
valeur du politique : el<strong>les</strong> permettent <strong>de</strong> faire l’impasse sur<br />
d’autres valeurs, notamment sur la préservation <strong>de</strong>s biens<br />
<strong>les</strong> plus élémentaires pour tous et la prise en compte <strong>de</strong> la<br />
vie du désir en chacun.<br />
On dira que <strong>les</strong> gran<strong>de</strong>s entreprises <strong>de</strong> consommation<br />
semblent alors prendre le relais du politique et considérer<br />
ces désirs <strong>de</strong>s citoyens. Mais <strong>de</strong> quel désir s’agit-il alors, sinon<br />
celui d’une jouissance <strong>de</strong> possession, y compris pour <strong>les</strong><br />
objets dits « <strong>culture</strong>ls », envisagés simplement sous l’angle<br />
<strong>de</strong> leur rentabilité ? On est ainsi passé du simple goût<br />
durkheimien pour la recherche désintéressée à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> ce<br />
que l’on pourrait appeler un pouvoir sur la façon <strong>de</strong> possé<strong>de</strong>r.<br />
Les statistiques permettent alors d’agir sur l’éventuel<br />
client, en choisissant <strong>les</strong> variab<strong>les</strong> <strong>les</strong> plus aptes à développer
ses appétits d’objets. La fiction est ici celle d’un immense<br />
corps consumériste, dont il faut comprendre <strong>les</strong> désirs <strong>les</strong><br />
plus « rentab<strong>les</strong> » afin <strong>de</strong> <strong>les</strong> satisfaire.<br />
Mais <strong>les</strong> statistiques produisent d’autres fictions, comme<br />
celle d’un corps collectif qui serait unique et cohérent,<br />
par exemple le corps <strong>de</strong>s citoyens mécontents <strong>de</strong> telle mesure<br />
politique, ou celui <strong>de</strong>s spectateurs <strong>de</strong> tel ou tel film.<br />
Comptabiliser, par exemple, le nombre d’entrées à un film,<br />
sur une pério<strong>de</strong> donnée, serait certes très utile lorsque l’on<br />
veut définir le type <strong>de</strong> spectacle qui attire le public, voire<br />
le taux <strong>de</strong> fréquentation <strong>de</strong>s sal<strong>les</strong>. Mais il y a, sans doute,<br />
autant <strong>de</strong> raisons d’aller au cinéma que <strong>de</strong> spectateurs. De<br />
plus, cette comptabilité <strong>de</strong>vient elle-même un instrument<br />
<strong>de</strong> promotion commerciale lorsqu’elle est répétée à longueur<br />
<strong>de</strong> semaines, sur le mo<strong>de</strong> du slogan selon lequel tout le mon<strong>de</strong><br />
utilise le produit « x », donc il est bon. Tout se passe donc<br />
comme si l’on considérait <strong>les</strong> gens sondés ou comptabilisés<br />
comme un simple faisceau <strong>de</strong> quelques propriétés : cel<strong>les</strong><br />
que l’on tente <strong>de</strong> corréler selon la « loi <strong>de</strong>s grands nombres »,<br />
et dans l’intention <strong>de</strong> peser ainsi sur <strong>les</strong> comportements.<br />
Outre qu’el<strong>les</strong> ignorent <strong>les</strong> détails individuels, <strong>les</strong> statistiques<br />
peuvent également être faussées par l’impossibilité<br />
même d’en tirer un enseignement directement exploitable.<br />
Envisageons, par exemple, le cas d’une évaluation <strong>de</strong>s ressources<br />
<strong>de</strong> la planète, en vue <strong>de</strong> définir un avenir et <strong>de</strong> laisser<br />
une terre riche et fécon<strong>de</strong> à nos <strong>de</strong>scendants. Le discours<br />
est souvent entendu et majoritairement admis. La fiction du<br />
« réservoir » en train <strong>de</strong> se vi<strong>de</strong>r plus ou moins rapi<strong>de</strong>ment<br />
selon <strong>les</strong> zones géographiques laisse entière la question :<br />
comment changer significativement <strong>de</strong> comportement, en<br />
cessant précisément <strong>de</strong> considérer la terre comme un simple<br />
réservoir <strong>de</strong> ressources ?<br />
Une autre fiction statistique est celle du « grand mala<strong>de</strong> »<br />
que représente la Sécurité Sociale. Il faut soigner ce corps<br />
souffrant collectif comme on le ferait pour un patient ordinaire.<br />
Les statistiques permettent certes <strong>de</strong> faire un diagnostic<br />
détaillé sur <strong>les</strong> maux dont il souffre. Mais quel mé<strong>de</strong>cin<br />
pourrait venir à son chevet ? Pour cela, il faudrait, ici aussi,<br />
accé<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>s informations que ne délivre pas nécessairement<br />
la métho<strong>de</strong> statistique, tant <strong>les</strong> champs <strong>de</strong> dépenses<br />
sont nombreux et parfois difficilement appréciab<strong>les</strong>. Peuton,<br />
par exemple, réellement corréler la pollution ou le stress<br />
aux chances <strong>de</strong> vie <strong>de</strong> ce grand mala<strong>de</strong> ? Peut-on, surtout,<br />
vivre <strong>les</strong> sciences, vivre le droit... / LNA#49<br />
agir en conséquence sur ces <strong>de</strong>ux fléaux <strong>de</strong>s temps mo<strong>de</strong>rnes ?<br />
Ici également, on en est réduit à <strong>de</strong>s hypothèses selon la<br />
fiction <strong>de</strong> départ.<br />
Que dire <strong>de</strong> domaines difficilement déterminab<strong>les</strong> scientifiquement,<br />
comme ceux <strong>de</strong> la politique ou <strong>de</strong> la religion ?<br />
Ainsi, faire reposer sur une enquête d’opinion l’affirmation<br />
d’appartenance à telle ou telle religion ne retient <strong>de</strong> la foi religieuse<br />
que son côté public sans, du reste, que soit toujours<br />
mis le même sens sous cette affirmation. Et l’on sait qu’en<br />
fait <strong>de</strong> « couleur » politique, la chose est encore plus patente,<br />
et <strong>les</strong> catégories classiques <strong>de</strong> plus en plus incertaines entre<br />
droite et gauche.<br />
On peut donc en inférer que plus <strong>les</strong> techniques <strong>de</strong> numération<br />
se développent, plus se creuse la distance entre le cours<br />
social <strong>de</strong> la vie et sa manifestation concrète dans <strong>de</strong>s vies<br />
individuel<strong>les</strong> dites « inestimab<strong>les</strong> » à tous <strong>les</strong> sens du mot.<br />
Pourtant, émerge en même temps, dans nos vies tant <strong>de</strong> fois<br />
« estimées », la possibilité <strong>de</strong> désirer cet « inestimable », voire<br />
d’oser y trouver plaisir. Comme dans d’autres domaines,<br />
l’excès et le manque disent la même chose : trop <strong>de</strong> numération,<br />
dans <strong>de</strong>s domaines réputés comme n’en relevant pas,<br />
conduira sans doute à la peur <strong>de</strong> toute numérisation. Et si<br />
l’appareil juridique n’avait pas d’autre sens <strong>de</strong>rnier que celui<br />
<strong>de</strong> protéger un tel inestimable contre toutes <strong>les</strong> volontés plus<br />
ou moins masquées <strong>de</strong> pouvoir ?<br />
27
LNA#49 / l'art et la manière<br />
28<br />
Bétonsalon, premier centre d’art et <strong>de</strong> recherche<br />
en lien avec l’université<br />
Depuis novembre 2007 s’est ouvert dans le 13 ème<br />
arrondissement <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Paris, non loin <strong>de</strong> la<br />
Bibliothèque Nationale, le premier Centre d’Art et <strong>de</strong><br />
Recherche (CAR) pensé en regard <strong>de</strong> l’université, ici<br />
l’université pluridisciplinaire Paris Di<strong>de</strong>rot / Paris 7<br />
(Lettres, Langues, Sciences Socia<strong>les</strong> ; Sciences : Physique,<br />
Chimie, Mathématiques ; Mé<strong>de</strong>cine, Odontologie ; Arts<br />
et Cinéma…). Dirigé par l’association Bétonsalon, ce<br />
CAR se veut un lieu où la transmission du savoir et <strong>de</strong>s<br />
pratiques est revisitée selon une certaine dynamique.<br />
La refondation <strong>de</strong> l’université Paris Di<strong>de</strong>rot sur la rive<br />
gauche (travaux commencés en 2001) a pour objectif<br />
principal d’inscrire « l’université dans la ville ». Afin <strong>de</strong><br />
garantir une vie <strong>de</strong> quartier pendant et en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s<br />
pério<strong>de</strong>s d’activité universitaire, ses différents bâtiments ont<br />
été disséminés entre <strong>les</strong> logements, <strong>les</strong> bureaux et <strong>les</strong> équipements<br />
publics 1 et plusieurs espaces en rez-<strong>de</strong>-chaussée<br />
ont été réservés par la municipalité pour y insérer <strong>de</strong>s commerces<br />
ou <strong>de</strong>s activités associatives. C’est dans un <strong>de</strong> ces<br />
espaces, en rez-<strong>de</strong>-chaussée <strong>de</strong> la Halle aux Farines, face<br />
aux Grands Moulins, que la ville (adjoints à l’éducation et<br />
à la <strong>culture</strong>) a proposé à l’association Bétonsalon, qui existe<br />
<strong>de</strong>puis 2004, d’animer un espace <strong>de</strong> 250 m2 2 . Une subvention<br />
annuelle <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong> 53 000 euros lui est<br />
versée par la ville et l’université apporte un soutien matériel<br />
à l’association. En d’autres termes, le CAR est un projet<br />
issu <strong>de</strong> la volonté <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Paris ; une convention a été<br />
passée avec l’université mais le CAR n’y est pas directement<br />
rattaché, l’université a son propre espace <strong>culture</strong> voire, dans<br />
certaines universités, un propre espace d’expositions.<br />
Ce centre d’art et <strong>de</strong> recherche n’a pas pour vocation <strong>de</strong><br />
fonctionner non plus comme un centre d’art contemporain 3<br />
classique mais, par son implantation sur le site universitaire,<br />
<strong>de</strong> fonctionner comme un pôle d’attraction, d’échanges<br />
et d’expérimentations entre artistes et universitaires, riverains,<br />
curieux, amateurs d’art et <strong>de</strong> science, et étudiants.<br />
Pour cela, Bétonsalon développe un projet où l’exposition<br />
1 Pour la refonte <strong>de</strong> l’université et du quartier, la ville <strong>de</strong> Paris (Maire : Bertrand<br />
Delanoë) a investi environ 300 millions d’euros.<br />
2 Le Centre d’Art et <strong>de</strong> Recherche a été entièrement financé par la ville pour une<br />
somme <strong>de</strong> 500 000 mille euros et aménagé par la SEMAPA.<br />
3 Un centre d’art ne possè<strong>de</strong> pas <strong>de</strong> collections. Il est entièrement dédié à la<br />
production d’œuvres d’artistes vivants donc et à la diffusion.<br />
Par Corinne MELIN<br />
Historienne d’art contemporain<br />
<strong>de</strong>vient un espace <strong>de</strong> co-construction par le biais d’une<br />
médiation permanente, <strong>de</strong>s ateliers <strong>de</strong>stinés à tous publics<br />
(enfants, adultes, étudiants), <strong>de</strong>s conférences ou encore <strong>de</strong>s<br />
cours qui poursuivent, développent, questionnent, etc., <strong>les</strong><br />
œuvres exposées et/ou la thématique qui <strong>les</strong> réunit. L’espace<br />
d’exposition <strong>de</strong>vient le théâtre <strong>de</strong> la dynamique recherchée<br />
par la directrice <strong>de</strong> Bétonsalon, Mélanie Bouteloup, pour<br />
établir <strong>de</strong>s liens vraisemblab<strong>les</strong> et somme toute tangib<strong>les</strong><br />
entre un certain art contemporain et une université pluridisciplinaire.<br />
La première exposition « In the stream of life » (novembre<br />
2007/février 2008) a rassemblé une exposition, un cycle <strong>de</strong><br />
conférences, <strong>de</strong> performances et <strong>de</strong> projections. Son titre est<br />
emprunté au film <strong>de</strong> l’artiste conceptuel américain Lawrence<br />
Weiner, « Plowmans Lunch » (1982), dans lequel un personnage<br />
dit : « une idée n’a <strong>de</strong> sens que dans le courant <strong>de</strong> la<br />
vie ». Cela correspond bien à l’idée <strong>de</strong> Bétonsalon : expérimenter<br />
<strong>les</strong> interrogations, <strong>les</strong> concepts, <strong>les</strong> pratiques <strong>de</strong> l’art<br />
contemporain avec <strong>les</strong> publics. Pour aller en ce sens, l’exposition<br />
s’intéressait à la circulation <strong>de</strong> l’œuvre d’art : comment<br />
une œuvre peut-elle être activée, racontée ? Comment<br />
penser l’œuvre en termes <strong>de</strong> narration et d’expériences ?<br />
L’exposition 4 Argument <strong>de</strong> la diagonale est une exposition<br />
qui, selon <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux commissaires, Isabelle le Normand et<br />
Florence Osten<strong>de</strong>, « s’intéresse aux méthodologies qui bifurquent,<br />
aux stratégies obliques et autres analogies vertigineuses.<br />
Hommage à une performance d’Éric Duyckaerts<br />
et référence à la célèbre démonstration du mathématicien<br />
Georg Cantor, Argument <strong>de</strong> la diagonale reflète la méthodologie<br />
en zig zag <strong>de</strong> cette exposition. Pour comprendre<br />
ce projet, il suffira d’imaginer une petite danse en pas <strong>de</strong><br />
crabe, un jardin aux sentiers qui bifurquent ou <strong>les</strong> principes<br />
fondamentaux <strong>de</strong> la théorie <strong>de</strong>s graphes ». Cette exposition<br />
informe par métaphores sur la façon dont bétonsalon<br />
construit sa relation aux territoires qui l’environnent. Ce<br />
sont bien <strong>de</strong>s territoires car ils se divisent en autant <strong>de</strong> surfaces<br />
qu’il y a <strong>de</strong> publics potentiels. Dans la présentation <strong>de</strong><br />
leur projet, Bétonsalon souligne qu’une vitrine écran fait le<br />
lien (symbolique) avec <strong>les</strong> bâtiments universitaires et <strong>les</strong> habitations<br />
qui l’environnent. Sur cette vitrine sont projetés,<br />
selon <strong>les</strong> expositions, <strong>les</strong> intervenants <strong>de</strong>s vidéos, <strong>de</strong>s propositions<br />
<strong>de</strong> dialogue. Ce lien infra mince témoigne <strong>de</strong> la<br />
volonté d’échanger avec son milieu sans autoritarisme, mais<br />
4 Exposition qui se déroulait à Bétonsalon lors <strong>de</strong> la rédaction <strong>de</strong> cet article.
Vue du site (projet).<br />
en fonction d’un chemin qui se trace au fur et à mesure <strong>de</strong>s<br />
expériences que le CAR met en chantier.<br />
Chaque semaine sont proposés <strong>de</strong>s ateliers, <strong>de</strong>s conférences,<br />
<strong>de</strong>s rencontres. La particularité <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>nse programmation<br />
est que chacune <strong>de</strong> ces activités est traversée par la<br />
démarche et l’esthétique <strong>de</strong>s artistes invités, qu’ils soient<br />
danseurs, plasticiens, hommes <strong>de</strong> théâtre, scientifiques…<br />
La forme <strong>de</strong>s conférences est, en ce sens, non classique : ce<br />
sont <strong>de</strong>s conférences performées. Aux côtés <strong>de</strong>s conférences<br />
universitaires, le CAR agite <strong>les</strong> savoirs et <strong>les</strong> pratiques. Comment<br />
<strong>les</strong> artistes restituent une parole, un savoir, une pratique ?<br />
Pourquoi le jeu, le glissement, la fiction tiennent autant <strong>de</strong><br />
place dans cette forme <strong>de</strong> communication singulière ?<br />
Le projet artistique qui, sans doute, cristallise cette démarche<br />
est le cours proposé <strong>de</strong>puis janvier 2008, tous <strong>les</strong> jeudis à<br />
20h, par l’artiste Jochen Dehn, « l’école pour <strong>de</strong>venir invisible<br />
». Chaque cours propose une possibilité « <strong>de</strong> <strong>de</strong>venir<br />
moins concret, plus diffus, <strong>de</strong> se dissoudre sans disparaître ».<br />
Jochen Dehn intervient dans <strong>de</strong>s lieux pour y effectuer <strong>de</strong>s<br />
démonstrations théoriques et pratiques au moyen <strong>de</strong> la parole,<br />
d’objets ou <strong>de</strong> personnes… Il utilise ce qu’il trouve<br />
sur place et que beaucoup ne voient pas ou alors amène <strong>de</strong>s<br />
accessoires sujets à subir diverses transformations. Il s’agit<br />
<strong>de</strong> montrer ce que l’on ne voit pas, faire apparaître, sous nos<br />
yeux, cette disparition. « Le scientifique, lorsqu’il observe<br />
un phénomène à travers son microscope, constate la même<br />
apparition, seulement il peut utiliser <strong>de</strong>s outils très performants<br />
et spécialisés alors que Jochen Dehn s’amuse à détourner<br />
<strong>les</strong> usages <strong>de</strong>s objets qui nous entourent 5 ». Prenons<br />
<strong>de</strong>s exemp<strong>les</strong> <strong>de</strong> cours : « cours 4 : comment s’accrocher à<br />
une surface <strong>de</strong> manière élégante / cours 5 : tracer <strong>de</strong>s lignes<br />
droites, avancer sans être vu dans la ville / cours 9 : tentative<br />
<strong>de</strong> lévitation entre <strong>de</strong>ux tab<strong>les</strong> et cours <strong>de</strong> cuisine abstractoconcrète…<br />
». Jochen Dehn invite également <strong>de</strong>s amis ou<br />
le public à enseigner avec lui. Ainsi, le 13 février 2008 par<br />
exemple, il a invité, pour une conférence-danse, <strong>les</strong> compagnies<br />
<strong>les</strong> Gelitin et <strong>les</strong> Moms. Cette soirée était dédiée<br />
aux membranes et leurs transits. Il invite aussi une personne<br />
extérieure issue d’une autre discipline, comme ici l’actrice<br />
Tarita Teripaia. Certains <strong>de</strong>s cours à venir seront construits<br />
avec <strong>de</strong>s étudiants en sciences <strong>de</strong> l’université Paris 7.<br />
5 Mélanie Bouteloup, directrice <strong>de</strong> Bétonsalon, in édito du bs n° 3, Argument <strong>de</strong><br />
la diagonale, Journal <strong>de</strong> Bétonsalon, juin/août 2008.<br />
D’autres liens art et université sont actuellement à l’étu<strong>de</strong><br />
comme « initier une collaboration avec l’université par la<br />
mise en place d’une rési<strong>de</strong>nce au sein d’un laboratoire scientifique,<br />
basé sur un réel processus <strong>de</strong> travail en commun 6 ».<br />
On espère que le CAR interrogera un modèle <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nce<br />
qui puisse prendre en compte <strong>les</strong> spécificités <strong>de</strong> la recherche<br />
universitaire et celle <strong>de</strong>s arts ; on sait combien il est difficile<br />
<strong>de</strong> faire cohabiter ces <strong>de</strong>ux mon<strong>de</strong>s sur le projet <strong>de</strong> la<br />
recherche.<br />
Centre d’Art et <strong>de</strong> Recherche<br />
47-51 quai Panhard et Levassor<br />
Esplana<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Grands Moulins<br />
Rez-<strong>de</strong>-Chaussée <strong>de</strong> la Halle aux Farines 75013 Paris<br />
www.betonsalon.net / info@betonsalon.net<br />
6 Mélanie Bouteloup dans l’édito <strong>de</strong> bs n° 1, journal <strong>de</strong> Bétonsalon, novembre<br />
2007/janvier 2008.<br />
l'art et la manière / LNA#49<br />
Vue <strong>de</strong> l’exposition « In the Stream of Life » au Bétonsalon<br />
(17 novembre 2007 - 2 février 2008).<br />
Faça<strong>de</strong> <strong>de</strong> Bétonsalon, 13 ème arrondissement,<br />
Paris, Rive gauche, 2007.<br />
29
LNA#49 / questions <strong>de</strong> sciences socia<strong>les</strong> : rubrique dirigée par Bruno Duriez et Jacques Lemière<br />
30<br />
Mai 68 : histoire, mémoire, politique<br />
« La question se pose à chaque commémoration : Mai 68 estil<br />
en passe <strong>de</strong> <strong>de</strong>venir un objet d’histoire ? Il ne s’agit pas <strong>de</strong><br />
mettre en question l’honnêteté <strong>de</strong>s travaux existants, mais<br />
il faut considérer en premier lieu qu’ils n’abon<strong>de</strong>nt pas. Ils<br />
sont, par ailleurs, confrontés dans leur rareté à <strong>de</strong>ux écueils<br />
massifs : d’une part, <strong>les</strong> médias et leur machine commémorative<br />
; <strong>de</strong> l’autre, le mur d’interprétations et <strong>de</strong> commentaires<br />
qui a été bâti <strong>de</strong>vant <strong>les</strong> événements au cours <strong>de</strong>s quarante<br />
<strong>de</strong>rnières années et qui leur sont <strong>de</strong>venus quasiment indissociab<strong>les</strong>.<br />
On en veut pour preuve l’obligation où se trouvent<br />
<strong>les</strong> auteurs <strong>de</strong> se positionner comme si le face-à-face avec l’archive<br />
était impossible. En somme, l’histoire doit faire avec la<br />
mémoire », écrit Bénédicte Delorme-Montini 1 .<br />
Ajoutons : « Et la mémoire avec la politique ». Car, en<br />
l’espèce, la mémoire est toujours sous juridiction <strong>de</strong> la<br />
politique. Celle <strong>de</strong> Mai 68 y est d’autant plus soumise que<br />
l’hétérogénéité <strong>de</strong>s figures subjectives qui sont à l’œuvre dans<br />
l’événement est maximale, ce qui en démultiplie <strong>les</strong> lectures<br />
possib<strong>les</strong> (et <strong>les</strong> lectures/écran) : subjectivité du grand mouvement<br />
revendicatif (la grève générale) ; subjectivité <strong>de</strong> la<br />
réforme, éventuellement radicale (la crise <strong>de</strong> l’Université, <strong>de</strong><br />
la société) ; subjectivité du changement <strong>de</strong>s mœurs (<strong>les</strong> rapports<br />
entre <strong>les</strong> sexes, la famille) ; subjectivité <strong>de</strong> l’invention <strong>de</strong><br />
pratiques et d’organisations politiques nouvel<strong>les</strong> 2 (le maoïsme<br />
d’après Mai, qui ne se réduit pas à la Gauche Prolétarienne).<br />
La définition/périodisation <strong>de</strong> « Mai 68 » est problématique,<br />
et on adoptera plutôt la nomination « 68 », car on<br />
peut contester la définition <strong>de</strong> « 68 » par le seul « Mai » : la<br />
tria<strong>de</strong> mouvement étudiant, grève générale syndicale, crise<br />
du régime. On peut considérer que le noyau <strong>de</strong> la nouveauté<br />
politique <strong>de</strong> 68 se situe en juin, plutôt qu’en mai, quand <strong>de</strong>s<br />
étudiants et <strong>de</strong>s jeunes ouvriers se trouvent engagés ensemble,<br />
dans certaines usines du pays, dans l’opposition à la reprise<br />
du travail préconisée par la CGT après <strong>les</strong> négociations <strong>de</strong><br />
Grenelle. (« Les ouvriers prendront <strong>de</strong>s mains fragi<strong>les</strong> <strong>de</strong>s étudiants<br />
le drapeau <strong>de</strong> la lutte contre le régime anti-populaire »,<br />
énonçait, le 16 mai, la ban<strong>de</strong>role <strong>de</strong> la manifestation qui se<br />
rendit <strong>de</strong> la Sorbonne à Renault-Billancourt, pour y trouver<br />
une usine bouclée par la CGT).<br />
1 Regards extérieurs sur Mai 68, Le Débat, n° 149, éd. Gallimard, 2008.<br />
2 Propos d’un quadragénaire dans Grands soirs et petits matins (W. Klein), filmés<br />
dans une discussion, dans une rue du Quartier Latin au début <strong>de</strong> mai : « On n’a<br />
plus que foutre <strong>de</strong>s élections. On a besoin d’un mouvement révolutionnaire, que<br />
ce ne soit plus comme <strong>les</strong> vieux partis où la vérité vient d’en haut. On n’a pas<br />
besoin d’un parti électoraliste ».<br />
Par Jacques LEMIèRE<br />
Professeur agrégé <strong>de</strong> sciences socia<strong>les</strong><br />
Institut <strong>de</strong> sociologie et d’anthropologie, Université <strong>de</strong> Lille 1<br />
Membre du CLERSE-CNRS<br />
« Mai 68 » <strong>de</strong>vient « Juin ». Et « 68 », ne se limitant plus à l’année<br />
68, s’étend, en termes <strong>de</strong> mobilisations politiques inédites,<br />
sur la décennie qui suit, <strong>de</strong>venant « <strong>les</strong> années 1968 » 3 .<br />
Dans la mémoire courante qui s’est fixée <strong>de</strong> cette hétérogénéité<br />
<strong>de</strong> 68, <strong>de</strong>ux images, l’image émeutière <strong>de</strong>s barrica<strong>de</strong>s<br />
du Quartier Latin, et l’image syndicaliste <strong>de</strong> la grève générale<br />
4 , dissimulent ce noyau événementiel, qui consiste en une<br />
inédite ouverture <strong>de</strong>s possib<strong>les</strong> ne trouvant son siège ni dans<br />
la seule violence anti-policière, ni dans le seul mouvement<br />
gréviste, puisque portée par l’idée d’un déplacement <strong>de</strong>s<br />
pratiques politiques et <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> pensée <strong>de</strong> la politique.<br />
Déplacement <strong>de</strong> la pensée et <strong>de</strong> la pratique qui induisent,<br />
en province comme à Paris, d’authentiques déplacements<br />
dans la conscience comme dans la vie <strong>de</strong>s sujets, la jeunesse<br />
intellectuelle pouvant quitter son site assigné (la vie sociale<br />
<strong>de</strong> la petite bourgeoisie) et son <strong>de</strong>stin assigné (<strong>de</strong>venir <strong>les</strong><br />
cadres dirigeants et <strong>culture</strong>ls <strong>de</strong> la société), et la jeunesse<br />
ouvrière, dans son site assigné (l’usine), quittant le cadre<br />
institué <strong>de</strong> la protestation (celui <strong>de</strong>s appareils et <strong>de</strong>s chefs<br />
syndicaux, sur l’unique question <strong>de</strong>s salaires : <strong>les</strong> « Charlot,<br />
<strong>de</strong>s sous ! » et « Pompidou, tu navigues sur nos sous ! » <strong>de</strong>s<br />
défilés syndicaux <strong>de</strong>s années 60). Rappelons ce plan du film<br />
Oser lutter, oser vaincre, où un jeune ouvrier <strong>de</strong> l’usine <strong>de</strong><br />
Renault-Flins, en juin 1968, prépare, pour une manifestation<br />
à Mantes-la-Jolie, <strong>de</strong>ux pancartes sur <strong>les</strong>quel<strong>les</strong> il a<br />
écrit : « Le capital à l’humanité » et « La terre aux paysans » ;<br />
passe un responsable syndical qui lui dit, sur la première,<br />
« Cela ne veut rien dire » et, sur la secon<strong>de</strong>, « Ce ne sont pas<br />
nos revendications ».<br />
Cette autorité <strong>de</strong> la politique sur la mémoire, qui vaut pour<br />
<strong>les</strong> acteurs, vaut aussi pour <strong>les</strong> circonstances entourant chacune<br />
<strong>de</strong>s opérations commémoratives : le 10 ème anniversaire<br />
marqué par le reflux, déjà sensible, <strong>de</strong>s mobilisations <strong>de</strong>s<br />
« années rouges » 1968-1978, et par l’échec <strong>de</strong> la gauche aux<br />
élections <strong>de</strong> mars ; le 20 ème , en 1988, marqué par l’atmos-<br />
3 Ce fut le paradigme adopté en avril 2004, au Méliès, par la 11 ème Journée<br />
cinématographique <strong>de</strong> sociologie et d’ethnologie, Mai 68, déclinée en 3 séquences :<br />
« Avant Mai : 1967. La Chinoise, <strong>de</strong> J-L. Godard » ; « Mai 68, c’est Juin 68. Reprise<br />
du travail aux usines Won<strong>de</strong>r, film IDHEC, 1968, et Oser lutter, oser vaincre,<br />
15 mai-18 juin 1968, film <strong>de</strong> J-P. Thorn, 1969 » ; et « Après Mai : 68 continue<br />
après 68. Tout va bien, <strong>de</strong> Godard, 1972 ».<br />
4 Il est significatif que <strong>les</strong> documents <strong>de</strong>s collectifs engagés à Lille dans le 40 ème<br />
anniversaire <strong>de</strong> 68 se partagent <strong>les</strong> images <strong>de</strong> ce couple : le collectif nordiste<br />
« Autour <strong>de</strong> Mai 68 » choisit celle <strong>de</strong> la grève générale, et l’AMUL, à Lille 1,<br />
« Mai 68, 40 ans après », celle <strong>de</strong> l’étudiant lanceur <strong>de</strong> pavés.
questions <strong>de</strong> sciences socia<strong>les</strong> : rubrique dirigée par Bruno Duriez et Jacques Lemière / LNA#49<br />
phère désabusée du début du 2 nd septennat <strong>de</strong> Mitterrand ;<br />
le 30 ème par le retour, sous l’effet <strong>de</strong>s mouvements sociaux <strong>de</strong><br />
1995-1996 (cheminots, puis sans-papiers <strong>de</strong> Saint-Bernard),<br />
<strong>de</strong> nouvel<strong>les</strong> figures et énergies militantes ; et ce 40 ème anniversaire<br />
par une évi<strong>de</strong>nte volonté <strong>de</strong> réponse au « il faut<br />
liqui<strong>de</strong>r Mai 68 » <strong>de</strong> Sarkozy.<br />
À partir du milieu <strong>de</strong>s années 70 s’était imposée une explication<br />
du 68 français, non par la seule concordance <strong>de</strong>s trois<br />
phénomènes <strong>de</strong> Mai – le soulèvement étudiant, la grève générale<br />
<strong>de</strong>s travailleurs et la crise du régime –, mais par leur<br />
rencontre avec une discordance entre <strong>de</strong>ux termes : l’intensité<br />
et la rapidité <strong>de</strong> la mo<strong>de</strong>rnisation gaulliste <strong>de</strong> l’infrastructure<br />
économique du pays, contredites par la fixité et<br />
l’archaïsme du système <strong>de</strong> codification <strong>de</strong>s valeurs et <strong>de</strong>s<br />
mœurs. Régis Debray concentra cette lecture dans la formule<br />
« Trois ont fait un, parce qu’un faisait <strong>de</strong>ux », dans Mo<strong>de</strong>ste<br />
contribution aux discours et cérémonies officiel<strong>les</strong> du dixième<br />
anniversaire (1978), où il systématisait la thèse <strong>de</strong> « la bourgeoisie<br />
[qui] se trouvait politiquement et idéologiquement<br />
en retard sur la logique <strong>de</strong> son propre développement économique<br />
» et <strong>de</strong>s « contestataires <strong>de</strong> Mai » qui, se battant<br />
contre cette bourgeoisie, l’aidèrent à combler ce retard :<br />
c’est la thèse <strong>de</strong> l’ajustement, par un 68 « libéral-libertaire »<br />
(expression apparue en 1978 précisément), <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong>s<br />
mœurs aux besoins du capital.<br />
On sait que certains <strong>de</strong>s acteurs principaux <strong>de</strong> 68,<br />
adoptant, après le passage <strong>de</strong> la « nouvelle philosophie »,<br />
une position idéologique <strong>de</strong> reniement <strong>de</strong> leurs radicaux<br />
engagements <strong>de</strong> jeunesse, et bénéficiant d’une position sociale<br />
<strong>de</strong> notoriété éditoriale ou médiatique, ont contribué<br />
à enraciner cette interprétation <strong>de</strong> 68 par sa dimension<br />
<strong>culture</strong>lle et par l’effet <strong>de</strong> « génération », où <strong>les</strong> années<br />
1968, cel<strong>les</strong> <strong>de</strong> l’hédonisme et l’individualisme, <strong>de</strong>viennent<br />
<strong>les</strong> « sixties ». Dans cette lecture culturaliste qui fonctionne<br />
contre une définition politique, en profon<strong>de</strong>ur, <strong>de</strong><br />
l’événement et qui fut dominante pendant presque une<br />
trentaine d’années 5 , on verra la version dépolitisée <strong>de</strong> ce<br />
qui est curieusement nommé l’ « héritage » <strong>de</strong> 68, cette<br />
dépolitisation résultant aussi d’une parlementarisation <strong>de</strong><br />
ce qui a existé, en 68, comme posture <strong>de</strong> distance à la<br />
question du pouvoir et à l’État 6 .<br />
5 Michelle Zancarini-Fournel, qui a étudié le corpus <strong>de</strong> manuels scolaires en<br />
usage <strong>de</strong> 1998 à 2004 (programmes <strong>de</strong> 1995 et <strong>de</strong> 2002), note que cette interprétation<br />
est fortement relayée par l’enseignement secondaire, qui en assure la<br />
postérité (Le moment 68. Une histoire contestée, éd. Le Seuil, 2008).<br />
6 Les manifestations <strong>de</strong> 68 évitent toujours <strong>les</strong> lieux du pouvoir d’État, au grand<br />
étonnement du préfet <strong>de</strong> police Grimaud (En mai, fais ce qu’il te plaît, 1977),<br />
et le mouvement voit venir <strong>les</strong> élections législatives <strong>de</strong> juin comme un piège<br />
(« Élections, piège à cons »).<br />
Le 40 ème anniversaire s’est présenté, sarkozysme oblige, comme<br />
un essai <strong>de</strong> repolitisation <strong>de</strong> l’ « héritage ». Sans surprise,<br />
mais au risque d’arrangements avec l’histoire, et d’une<br />
sérieuse édulcoration <strong>de</strong>s conflits <strong>de</strong> l’époque entre PC-<br />
CGT et extrême gauche, une volonté s’est signalée, sur le<br />
versant <strong>de</strong> la gauche mouvementiste et <strong>de</strong> l’extrême gauche<br />
militante, <strong>de</strong> ramener la lecture <strong>de</strong> 68 du côté <strong>de</strong> la grève<br />
générale, <strong>de</strong>s thèmes du « tous ensemble » et <strong>de</strong> la « convergence<br />
<strong>de</strong>s luttes », dans un curieux rêve <strong>de</strong> recommencement<br />
puisque « Mai 68, ce n’est toujours qu’un début... »,<br />
disaient <strong>les</strong> affiches et <strong>les</strong> flyers.<br />
Sur l’autre versant, celui <strong>de</strong> certaines entreprises historiennes,<br />
on fera l’hypothèse d’un glissement interprétatif en<br />
cours, quant à une mémoire autorisée <strong>de</strong> l’ « héritage » <strong>de</strong><br />
68, par le passage <strong>de</strong> la thèse <strong>de</strong> l’héritage dépolitisé à celle <strong>de</strong><br />
l’héritage impossible, selon l’expression du sociologue Jean-<br />
Pierre Le Goff 7 . « Mai 68 est un événement <strong>de</strong>venu opaque<br />
: il est tout autant réactif que mo<strong>de</strong>rnisateur », écrit-il<br />
dans la suite <strong>de</strong> son livre publié en 1998 8 . 68 <strong>de</strong>vient alors<br />
« un moment <strong>de</strong> catharsis d’une société considérablement<br />
bouleversée par une mo<strong>de</strong>rnisation qui semble avoir bien<br />
rompu le fil qui la reliait encore à la tradition ». Cette « révolte<br />
du peuple ado<strong>les</strong>cent » serait l’événement paradoxal<br />
qui, « s’offrant le luxe, l’espace <strong>de</strong> quelques semaines, d’une<br />
fuite dans l’imaginaire harmonisant tous <strong>les</strong> possib<strong>les</strong> », refuse<br />
le passage à une mo<strong>de</strong>rnité qui implique « l’État <strong>de</strong><br />
droit, le suffrage universel et <strong>les</strong> médiations institutionnel<strong>les</strong> »<br />
au lieu du « retour aux formes du pouvoir révolutionnaire<br />
<strong>de</strong> type fusionnel ».<br />
Cette thèse <strong>de</strong> l’héritage impossible, qui fait <strong>de</strong> 68 un événement<br />
politique réactif, plutôt qu’un ajustement <strong>culture</strong>l<br />
mo<strong>de</strong>rne, semble prendre acte d’une conjoncture où, dans le<br />
nouveau paysage militant <strong>de</strong> l’après 1995, s’est rouvert un<br />
intérêt pour ce qui constituait le noyau politique <strong>de</strong> l’événement<br />
68. Elle marque ainsi, chez <strong>les</strong> avocats <strong>de</strong> la « réconciliation<br />
<strong>de</strong> la France avec son histoire et avec la mo<strong>de</strong>rnité »,<br />
l’impossibilité <strong>de</strong> continuer à tenir, sur 68, la thèse d’un<br />
héritage dépolitisé.<br />
7 Mai 68. L’héritage impossible, éd. La Découverte, 1998.<br />
8 « Mai 68 : la France entre <strong>de</strong>ux mon<strong>de</strong>s », Le Débat, n° 149.<br />
Juillet 2008 9<br />
9 Ce texte contient une part <strong>de</strong>s thèmes développés dans une conférence le 15 mai<br />
2008 à l’<strong>Espace</strong> Culture, à l’invitation <strong>de</strong> l’Association <strong>de</strong>s Amis <strong>de</strong> Lille 1 (AMUL).<br />
31
LNA#49 / libres propos<br />
32<br />
Nanotechnologies<br />
Plus qu’une discipline, <strong>les</strong> nanotechnologies sont une manière<br />
<strong>de</strong> représenter une partie <strong>de</strong> la recherche fondamentale<br />
et appliquée avec, comme point focal, l’unité <strong>de</strong> longueur<br />
qu’est le nanomètre. À cette échelle, physique, chimie et biologie<br />
convergent et s’enrichissent mutuellement par la mise<br />
en commun <strong>de</strong> problématiques, <strong>de</strong> métho<strong>de</strong>s expérimenta<strong>les</strong><br />
et <strong>de</strong> concepts. Le prisme « nano » présente un intérêt<br />
certain, en permettant <strong>de</strong> brasser <strong>les</strong> idées, en suscitant<br />
<strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> recherche pluridisciplinaires ou en mettant<br />
en perspective recherche et application. Ces caractéristiques<br />
font que la plupart <strong>de</strong>s états financent désormais <strong>de</strong>s<br />
programmes <strong>de</strong> recherche en nanotechnologie 1 .<br />
De même, le mot « nanotechnologies » a le pouvoir <strong>de</strong> mettre<br />
en perspective progrès et craintes associées. On pourrait<br />
même dire que cela se fait <strong>de</strong> manière exacerbée, à cause du<br />
caractère invisible <strong>de</strong>s objets concernés, mais aussi <strong>de</strong>s promesses<br />
inouïes souvent associées à ces technologies.<br />
Ce sont ces <strong>de</strong>ux facettes du sujet qu’il convient désormais<br />
<strong>de</strong> prendre en compte.<br />
Les nanotechnologies, pour quoi faire ?<br />
Cet engouement pour l’échelle « nano » a été à l’origine d’un<br />
renouveau <strong>de</strong>s sciences dures et on ne peut que constater<br />
la forte croissance <strong>de</strong>s publications sur le sujet et <strong>de</strong>s financements<br />
accordés à ce type <strong>de</strong> recherche. Ce secteur n’est<br />
toutefois pas aussi monolithique qu’on voudrait le croire :<br />
- Un certain nombre <strong>de</strong> disciplines <strong>de</strong> recherche ou d’activités<br />
industriel<strong>les</strong> flirtent avec l’échelle nanométrique<br />
« <strong>de</strong>puis toujours ». Il s’agit <strong>de</strong> la chimie, <strong>de</strong>s matériaux,<br />
<strong>de</strong> la biologie, <strong>de</strong> l’énergie, etc. En termes d’applications,<br />
on cherche à utiliser la compréhension <strong>de</strong> l’échelle<br />
« nano » pour améliorer <strong>de</strong>s produits ou <strong>de</strong>s procédés.<br />
Il serait exagéré <strong>de</strong> parler <strong>de</strong> révolution dans tous <strong>les</strong><br />
secteurs, mais <strong>les</strong> enjeux peuvent être d’importance :<br />
conversion d’énergie (cellu<strong>les</strong> photovoltaïques, batteries,<br />
éclairage), nano-mé<strong>de</strong>cine.<br />
- Certaines branches <strong>de</strong> l’industrie ont une feuille <strong>de</strong><br />
route <strong>les</strong> conduisant à une miniaturisation toujours plus<br />
poussée, comme la microélectronique, qui produit <strong>de</strong>s<br />
composants toujours plus petits (65 nm en 2007), la<br />
production <strong>de</strong> mémoires <strong>de</strong> masse tels <strong>les</strong> disques ma-<br />
1 Dans ce texte, on ne distinguera pas <strong>les</strong> mots « nanotechnologies » et<br />
« nanoscience ».<br />
Par Louis LAURENt<br />
Chef du département « Sciences et Technologies <strong>de</strong><br />
l’information » à l’Agence Nationale pour la Recherche<br />
gnétiques ou optiques et la mécanique, la fluidique qui<br />
emboîtent le pas. El<strong>les</strong> sont accompagnées par d’autres<br />
recherches qui ont pour but l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> petits objets,<br />
notamment pour comprendre, voire tirer parti <strong>de</strong>s phénomènes<br />
qui émergent à l’échelle nanométrique.<br />
- En toute rigueur, on pourrait envisager une troisième<br />
approche qui émergerait si on parvenait un jour à réaliser<br />
<strong>de</strong>s objets en trois dimensions, structurés avec précision<br />
à l’échelle nanométrique. Cela donnerait le jour<br />
à une industrie entièrement nouvelle. On évoque souvent<br />
le modèle du vivant. Celui-ci exhibe en effet une<br />
immense variété <strong>de</strong> « dispositifs » structurés à l’échelle<br />
nanométrique, parfois très complexes, qui tirent parti<br />
<strong>de</strong>s lois <strong>de</strong> la physique à cette échelle (forces d’interactions,<br />
agitation thermique) <strong>de</strong> manière bien plus efficace<br />
que <strong>les</strong> objets fabriqués par l’homme et ceci sans doute<br />
pour longtemps.<br />
La plus-value du concept « nano » est <strong>de</strong> faire partager à<br />
toutes ces activités <strong>de</strong>s concepts, <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mesure,<br />
<strong>de</strong>s procédés, voire <strong>de</strong> permettre le croisement <strong>de</strong> leurs<br />
résultats. Les promoteurs <strong>de</strong>s « nanotechnologies » mettent<br />
en avant <strong>de</strong>s retombées positives variées en termes <strong>de</strong> compétitivité<br />
économique ou, plus récemment, <strong>de</strong> réponse à <strong>de</strong>s<br />
développements durab<strong>les</strong>, au secteur <strong>de</strong> la santé.<br />
Quel<strong>les</strong> questions se posent ?<br />
Le mot « nanotechnologies » a ceci <strong>de</strong> remarquable qu’il<br />
permet d’évoquer la plupart <strong>de</strong>s questionnements traditionnels,<br />
liés à l’essor <strong>de</strong> la science, déclinés sous l’aspect<br />
« nano ».<br />
> La question du risque pour le travailleur, pour le consommateur<br />
ou le citoyen. Dans le cas <strong>de</strong>s nanotechnologies, la<br />
question qui domine est celle <strong>de</strong> la toxicité <strong>de</strong> nano particu<strong>les</strong><br />
et plus généralement <strong>de</strong> leur <strong>de</strong>venir dans l’environnement.<br />
D’un côté, nous sommes déjà entourés <strong>de</strong> tel<strong>les</strong> nano<br />
particu<strong>les</strong>, par exemple cel<strong>les</strong> produites par toute combustion<br />
(<strong>de</strong> 10 à 20 millions par litre d’air en ville), ou d’autres<br />
artificiel<strong>les</strong> comme le noir <strong>de</strong> carbone, le dioxy<strong>de</strong> <strong>de</strong> titane.<br />
D’un autre côté, rien n’exclut que <strong>de</strong>s particu<strong>les</strong> ou <strong>de</strong>s fibres<br />
issues d’un nouveau matériau se révèlent toxiques, comme<br />
cela était arrivé pour l’amiante. Les premiers travaux sur le<br />
sujet datent <strong>de</strong>s années 1990 (le sujet d’étu<strong>de</strong> était alors la
pollution <strong>de</strong> l’air) et, dans <strong>les</strong> années 2000, <strong>les</strong> recherches<br />
sur la toxicité <strong>de</strong> nano particu<strong>les</strong> artificiel<strong>les</strong> se sont développées.<br />
On observe effectivement <strong>de</strong>s effets sur le vivant<br />
induit par <strong>de</strong>s nano particu<strong>les</strong>, mais <strong>les</strong> connaissances dans<br />
ce domaine sont encore trop lacunaires, par exemple pour<br />
que l’on associe à chaque type <strong>de</strong> particu<strong>les</strong> <strong>de</strong>s valeurs limites<br />
en termes d’exposition, comme on sait le faire pour <strong>de</strong>s<br />
substances chimiques. Cette situation est peu satisfaisante à<br />
cause du décalage entre la mise sur le marché <strong>de</strong> nouveaux<br />
matériaux contenant <strong>de</strong>s nano particu<strong>les</strong> (parfois <strong>de</strong> type<br />
nouveau) et la future stabilisation <strong>de</strong>s connaissances sur <strong>les</strong><br />
risques associés.<br />
> L’évolution <strong>de</strong> la société entraînée par <strong>de</strong>s produits issus<br />
<strong>de</strong> nouvel<strong>les</strong> techniques, qu’il s’agisse <strong>de</strong> nouveaux usages<br />
ou d’un mouvement plus général comme cela s’est produit<br />
maintes fois dans le passé (impact <strong>de</strong> l’invention <strong>de</strong> l’électricité,<br />
<strong>de</strong> l’automobile…). La question n’est pas tant l’existence<br />
d’une évolution (après tout, c’est ce qu’on <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
au progrès) que <strong>de</strong> la non maîtrise <strong>de</strong> celle-ci. En ce qui<br />
concerne <strong>les</strong> nanotechnologies, la question est indirecte<br />
parce qu’el<strong>les</strong> ne sont pas associées à un produit i<strong>de</strong>ntifié.<br />
On <strong>les</strong> évoque surtout au sujet <strong>de</strong>s technologies <strong>de</strong> l’information<br />
et <strong>de</strong> la communication. Les objets incriminés (implants,<br />
objets communicants) ne sont pas nécessairement si<br />
petits que cela, mais <strong>les</strong> nanotechnologies sont pointées du<br />
doigt comme moyen d’en multiplier <strong>les</strong> possibilités.<br />
- Un <strong>de</strong>s sujets qui fait actuellement débat est l’évolution<br />
<strong>de</strong> la notion <strong>de</strong> vie privée. La multiplication <strong>de</strong>s services<br />
et loisirs faisant appel au numérique et, à terme, le déploiement<br />
d’objets communicants ne peut qu’amplifier<br />
cette question. D’un côté, l’individu perçoit la plus-value<br />
apportée par <strong>de</strong> tels services, <strong>de</strong> l’autre, il peut redouter<br />
<strong>de</strong> voir sa vie privée disparaître.<br />
- Un autre sujet, et une source d’angoisse, est la possibilité<br />
d’une dérive <strong>de</strong> la société telle que l’implantation<br />
<strong>de</strong> puces dans le corps <strong>de</strong>viendrait chose courante, à<br />
<strong>de</strong>s fins médica<strong>les</strong> mais aussi à <strong>de</strong>s fins d’i<strong>de</strong>ntification,<br />
voire <strong>de</strong> contrôle.<br />
> Les questions d’éthique. Ces questionnements apparaissent<br />
inévitablement lorsqu’une nouvelle technique agit<br />
sur le vivant ou sur l’environnement. En ce qui concerne<br />
<strong>les</strong> nanotechnologies, on s’interroge par exemple sur <strong>les</strong><br />
conséquences <strong>de</strong> nouvel<strong>les</strong> métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> mesure (prédisposition<br />
à <strong>de</strong>s maladies) ou, pour le plus long terme, sur la<br />
question <strong>de</strong> l’amélioration <strong>de</strong> l’être humain.<br />
> La possibilité qu’une recherche déclenche un phénomène<br />
irréversible qui aurait <strong>de</strong>s conséquences sur la population<br />
ou l’environnement. Le risque (jugé après coup très<br />
irréaliste) que <strong>les</strong> nanotechnologies permettent un jour<br />
<strong>de</strong> fabriquer une population <strong>de</strong> nanorobots hors contrôle<br />
avait été popularisé dans <strong>les</strong> années 80 par Eric Drexler.<br />
Quelques commentaires<br />
libres propos / LNA#49<br />
Les nanotechnologies sont une construction fructueuse<br />
pour expliciter une partie <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> recherche et<br />
évoquer <strong>de</strong>s applications. C’est <strong>de</strong>venu aussi un lieu <strong>de</strong> discussion<br />
au sujet <strong>de</strong> l’impact du progrès, <strong>de</strong> la question du<br />
chercheur face à ses responsabilités. En guise <strong>de</strong> conclusion,<br />
on peut évoquer <strong>de</strong>ux enjeux :<br />
- Mener <strong>de</strong>s recherches en prenant en compte <strong>les</strong> possib<strong>les</strong><br />
aspects négatifs <strong>de</strong> futures applications. Cette démarche<br />
s’impose <strong>de</strong> plus en plus. Tout d’abord, c’est une<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> du citoyen ou du consommateur. C’est aussi<br />
<strong>de</strong>venu un enjeu <strong>de</strong> compétitivité : celui qui innovera<br />
dans <strong>de</strong>s produits uti<strong>les</strong>, reconnus comme sans danger,<br />
respectueux <strong>de</strong> l’environnement ou <strong>de</strong> l’individu, a toutes<br />
ses chances <strong>de</strong> <strong>de</strong>venir le plus compétitif. Cette question<br />
concerne l’équilibre entre <strong>les</strong> applications visées [étu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> risque, produit avec <strong>de</strong>s effets explicitement positifs<br />
(par exemple bio dégradab<strong>les</strong>)], mais aussi la prise en<br />
compte du développement <strong>de</strong> connaissances génériques<br />
qui permettent <strong>de</strong> prendre du recul.<br />
- L’anticipation, même si c’est un exercice difficile. De<br />
nombreux films ou romans mettent en scène une découverte<br />
qui a un effet immédiat et radical. La réalité est<br />
souvent tout autre. L’impact d’un résultat <strong>de</strong> recherche,<br />
ou d’ailleurs <strong>de</strong> son absence, est souvent difficile à prévoir.<br />
En effet, le lien entre la recherche fondamentale et<br />
<strong>les</strong> objets technologiques auxquels elle donnera naissance<br />
est souvent indirect et il en est <strong>de</strong> même du lien entre<br />
ces objets et leurs usages. Par exemple, comment auraiton<br />
pu faire le lien entre <strong>les</strong> recherches en physique du<br />
début du XX ème siècle, l’invention du transistor dans <strong>les</strong><br />
années 1950, puis l’essor <strong>de</strong> l’informatique avec l’impact<br />
que l’on connaît ?<br />
33
LNA#49 / libres propos<br />
34<br />
Qu’est-ce, au juste, qu’un philosophe ?<br />
Hommage à Jean-François Lyotard<br />
Les philosophes n’ont jamais eu <strong>de</strong> <strong>de</strong>stinataires institués,<br />
affirmait Jean-François Lyotard dans Le Différend<br />
(1983) qu’il voyait comme « son » livre <strong>de</strong> philosophie.<br />
Pourtant, le chemin <strong>de</strong> pensée <strong>de</strong> Jean-François Lyotard<br />
(1924-1998) a traversé bien <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s avant et après cet<br />
ouvrage. L’hommage que nous voulons lui rendre, dix ans<br />
après sa disparition, doit tenir compte autant <strong>de</strong> la vigueur<br />
exceptionnelle <strong>de</strong> ce livre que <strong>de</strong> la riche palette esthétique,<br />
éthique, politique <strong>de</strong> l’œuvre dans son entier. Lyotard nous<br />
a appris à toujours prendre en compte simultanément le<br />
<strong>de</strong>stinateur, le <strong>de</strong>stinataire, le sens et la référence. Le sens,<br />
ou la signification, d’un énoncé philosophique est donc<br />
adressé à un <strong>de</strong>stinataire non institutionnel, ce qui peut,<br />
au moins partiellement, vouloir dire que tout lecteur <strong>de</strong> cet<br />
énoncé est son <strong>de</strong>stinataire, quand bien même celui-ci serait<br />
étranger à l’institution « philosophes » ou université, ou<br />
même « lectorat d’ouvrages <strong>de</strong> philosophie ». Le <strong>de</strong>stinataire<br />
pourrait donc être chacun d’entre nous, sans préciser<br />
<strong>les</strong> appartenances <strong>de</strong> ce « nous ». Mais inviter à lire ou relire<br />
aujourd’hui Lyotard, c’est proposer à chacun la découverte<br />
d’un itinéraire singulier, impossible à réduire à un système,<br />
mais au long duquel ont été abordées <strong>de</strong>s questions essentiel<strong>les</strong><br />
à l’humanité <strong>de</strong> la <strong>de</strong>uxième moitié du siècle <strong>de</strong>rnier.<br />
Après avoir livré quelques repères bio-bibliographiques, on<br />
s’attachera à répondre à la question « qu’est-ce qu’un philosophe<br />
? » dans son rapport à l’institution du Juste.<br />
Son premier livre publié est un exposé original <strong>de</strong> la Phénoménologie,<br />
paru sous ce titre dans la collection « Que saisje<br />
? » 1 . Il enseigne alors en Algérie et rejoint bientôt, tout au<br />
long <strong>de</strong> la guerre qui commence, la revue et le groupe Socialisme<br />
ou Barbarie. C’est une pério<strong>de</strong> militante dont il ressort<br />
in<strong>de</strong>mne, quoique désorienté, jusqu’à sa thèse (Discours, figure)<br />
et sa nomination (1971) à l’université <strong>de</strong> Vincennes.<br />
S’ouvre alors, dans l’effervescence <strong>de</strong>s années 70, la pério<strong>de</strong><br />
« libidinale » (Économie libidinale, Dérive à partir <strong>de</strong> Marx et<br />
Freud, Des dispositifs pulsionnels, Instructions païennes) où il<br />
se confondrait, faute d’attention, avec <strong>les</strong> productions désirantes<br />
d’alors. Mais son nom propre est associé, au tournant<br />
<strong>de</strong>s années 80, à l’adjectif « postmo<strong>de</strong>rne » qu’il invente et<br />
qui aura un succès qu’il n’escomptait pas et qui lui échappe,<br />
au point d’éclipser, quelques années après, la parution du<br />
Différend. Ce que Lyotard pointe, c’est la disparition par<br />
épuisement <strong>de</strong>s « grands récits » dans <strong>les</strong>quels chaque génération<br />
<strong>de</strong> la mo<strong>de</strong>rnité inscrivait le sens qu’elle prêtait à<br />
1 Éd. PUF, 1954.<br />
Par Jean-François REY<br />
Professeur <strong>de</strong> philosophie à l’IUFM <strong>de</strong> Lille<br />
l’histoire collective et singulière : Révolution, messianisme,<br />
progrès, mais aussi communisme, libéralisme. Bientôt, tout<br />
fut appréhendé sous ce jour, comme s’il s’agissait <strong>de</strong> la <strong>de</strong>rnière<br />
« nouvelle vague » <strong>de</strong> la mo<strong>de</strong>rnité qu’alimenteraient<br />
encore <strong>de</strong>s libel<strong>les</strong> rapi<strong>de</strong>s sur la « fin <strong>de</strong> l’histoire » ou « le<br />
choc <strong>de</strong>s civilisations ». Avec Au juste, dialogue serré avec<br />
Jean-Loup Thébaud 2 , se <strong>de</strong>ssine la problématique qui va<br />
occuper désormais entièrement Lyotard : la justice, le jugement,<br />
le juste délié d’avec le vrai, discours éclaté en jeux <strong>de</strong><br />
langage (concept emprunté à Wittgenstein). C’est dans ces<br />
travaux qu’il avoue sa <strong>de</strong>tte envers Levinas et qu’il amplifie<br />
la critique kantienne du jugement, mais aussi <strong>de</strong> l’imagination<br />
et <strong>de</strong> la sensation. Citons : Logique <strong>de</strong> Levinas in<br />
Collectif, Textes pour Emmanuel Levinas 3 , L’enthousiasme,<br />
la critique kantienne <strong>de</strong> l’histoire 4 , Leçons sur l’analytique<br />
du sublime 5 . Il publie également, en 1996, un Signé<br />
Malraux qui vibre <strong>de</strong> connivence et nous laisse, l’année <strong>de</strong><br />
sa mort, une Confession d’Augustin (inachevée) 6 . Ce trop<br />
rapi<strong>de</strong> et trop linéaire rappel masque la cohérence profon<strong>de</strong>,<br />
<strong>les</strong> réaménagements successifs <strong>de</strong> la pensée, <strong>les</strong> audaces et<br />
<strong>les</strong> énigmes.<br />
L’un <strong>de</strong>s portraits associés explicitement à Lyotard a été<br />
celui <strong>de</strong> « sophiste », ce qui ne doit pas être pris, malgré leur<br />
mauvaise réputation, pour un affront. Avec <strong>les</strong> sophistes,<br />
Lyotard partage un immense intérêt pour le langage, et tout<br />
autant une passion pour le « maintenant » et l’événement.<br />
Comme eux, il court le risque d’être renvoyé au-<strong>de</strong>hors <strong>de</strong><br />
la philosophie. Car, c’est à la fois du <strong>de</strong>hors et du <strong>de</strong>dans <strong>de</strong><br />
la philosophie que travaille Lyotard. À celle-ci, il reproche<br />
son « logocentrisme » et dénonce la supériorité du concept<br />
sur l’intuition ou la sensation. Mais il élargit le cercle <strong>de</strong>s<br />
philosophes.<br />
« Philosophique, c’est-à-dire n’importe qui à condition qu’il<br />
accepte <strong>de</strong> ne pas venir à bout du ‘langage’ et <strong>de</strong> ne pas<br />
‘gagner du temps’ » 7 . Mais on voit aussitôt que Lyotard,<br />
comme tout philosophe, est attaché au temps <strong>de</strong> la réflexion.<br />
2 Éd. Christian Bourgois, 1979.<br />
3 Éd. JM Place, 1980.<br />
4 Éd. Galilée, 1986.<br />
5 Éd. Galilée, 1991.<br />
6 Éd. Galilée, 1998.<br />
7 Le Différend, p. 13.
« Il n’y aura plus <strong>de</strong> livres, le siècle prochain. C’est trop long<br />
<strong>de</strong> lire, quand le succès est <strong>de</strong> gagner du temps » 8 . Du sophiste,<br />
il aurait donc la maîtrise <strong>de</strong>s jeux <strong>de</strong> langage, le parti<br />
pris du sensible et l’accueil <strong>de</strong> l’événement. Ses adversaires<br />
ou ses interlocuteurs incontournab<strong>les</strong> dans l’histoire <strong>de</strong> la<br />
philosophie seraient donc Platon ou Hegel. Philosopher,<br />
c’est toujours se situer par rapport à ces <strong>de</strong>ux-là. Sophiste, le<br />
philosophe peut être aussi avocat, voire procureur, dès lors<br />
qu’il a affaire au juste.<br />
La position classique du problème du juste est celle d’Aristote<br />
9 qui place le juste au sommet <strong>de</strong> l’ordre pratique, distinct<br />
<strong>de</strong> l’ordre théorique (la connaissance). Position reprise<br />
dans <strong>les</strong> mêmes termes par John Rawls 10 : « La justice est la<br />
première vertu <strong>de</strong>s institutions socia<strong>les</strong> comme la vérité l’est<br />
<strong>de</strong>s théories. » Autrement dit, le juste comman<strong>de</strong> l’action,<br />
le vrai comman<strong>de</strong> la connaissance. Les difficultés apparaissent<br />
lorsqu’on hypostasie le Juste et le Vrai, à côté du Beau<br />
et du Bien, en universaux. Dans ce cas, celui où nous <strong>de</strong>vons<br />
nous expliquer avec Platon, le juste est juste parce qu’il<br />
est vrai : « Platon pense que, si on a une vue ‘juste’ (c’està-dire<br />
vraie) <strong>de</strong> l’être, à ce moment-là on peut retranscrire<br />
cette vue dans l’organisation sociale, avec <strong>de</strong>s intermédiaires<br />
certes (la psyché par exemple), mais, néanmoins, le modèle<br />
reste la distribution même <strong>de</strong> l’être, il faut que la société<br />
répète pour elle-même cette distribution qui sera aussi bien<br />
distribution <strong>de</strong> capacités, <strong>de</strong> responsabilités, <strong>de</strong>s valeurs, <strong>de</strong>s<br />
biens, <strong>de</strong>s femmes et ainsi <strong>de</strong> suite » 11 . Le juste ne peut être<br />
dérivé du vrai. Le <strong>de</strong>voir-être ne dépend pas <strong>de</strong> l’être, la<br />
justice n’est pas la transcription ou la sanction d’une ontologie.<br />
L’accord avec Levinas est ici profond, explicite et<br />
revendiqué. En termes techniques, le <strong>de</strong>scriptif ne fon<strong>de</strong> pas<br />
le prescriptif. Contre Platon, Lyotard établit l’hétérogénéité<br />
<strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux ordres et dénonce le rabattement du second sur<br />
le premier. Mieux même, face au discours apophantique<br />
(ou propositionnel), Lyotard, comme Levinas, réhabilite la<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> et la prière. Non pas celle que je serais tenté <strong>de</strong><br />
faire pour qu’ « on » me ren<strong>de</strong> justice, mais celle que je<br />
suis requis d’écouter dans la rencontre d’autrui réclamant<br />
justice. Leçon adressée à la philosophie politique : « toute<br />
politique implique la prescription <strong>de</strong> faire autre chose que<br />
8 Ibid.<br />
9 Éthique à Nicomaque, livre V.<br />
10 Théorie <strong>de</strong> la justice.<br />
11 Au juste, p. 47.<br />
ce qui est » 12 . Adresse aussi à tous <strong>les</strong> philosophes, <strong>de</strong> Platon<br />
à Marx et ses discip<strong>les</strong> : on ne dérive pas le juste du vrai,<br />
la bonne société à venir <strong>de</strong> l’analyse « scientifique » <strong>de</strong> la<br />
société actuelle. Non pas qu’elle soit inutile mais, entre le<br />
régime du vrai et le régime du juste, il y a hétérogénéité.<br />
Le danger totalitaire est dans la fusion <strong>de</strong>s hétérogènes. Il<br />
n’y a pas une instance (Dieu, le Parti) qui me comman<strong>de</strong><br />
au nom <strong>de</strong> l’être. Tout ordre est à la <strong>de</strong>uxième personne : le<br />
récepteur, le <strong>de</strong>stinataire, c’est moi. Du côté <strong>de</strong> la référence, le<br />
discours théorique (« voilà comment <strong>les</strong> choses se passent, je<br />
vais vous expliquer le mécanisme d’extraction <strong>de</strong> la plus-value<br />
») reste entièrement dans le <strong>de</strong>scriptif. Un discours centré<br />
sur la référence, et non sur le <strong>de</strong>stinataire, finit toujours dans<br />
l’abstraction anonyme ou la terreur. Le projet <strong>de</strong> Lyotard<br />
était donc <strong>de</strong> penser la justice débarrassée du poids <strong>de</strong> l’être<br />
et <strong>de</strong> la vérité : « Il me semble que dans la justice, pour autant<br />
que la justice renvoie à du prescriptif, et elle y renvoie nécessairement,<br />
il y a un usage du langage qui est foncièrement<br />
différent <strong>de</strong> celui qui est son usage théorique » 13 .<br />
Le Différend se présente comme la mise à l’épreuve réciproque<br />
<strong>de</strong>s jeux <strong>de</strong> langage et du prescriptif. En avançant<br />
le concept <strong>de</strong> phrase et d’enchaînement <strong>de</strong> phrases, Lyotard<br />
franchit un pas décisif. Il réaffirme l’hétérogénéité <strong>de</strong>s régimes<br />
<strong>de</strong> phrase, <strong>de</strong> leurs règ<strong>les</strong> d’usage : dans l’enseignement,<br />
l’exercice <strong>de</strong> la justice, la pratique artistique, la relation<br />
amoureuse, etc. Rien ne peut ramener ces jeux à l’unité d’un<br />
langage. Ce qui arrive, c’est la phrase. Ce qui me manque,<br />
c’est la réponse à la question : comment enchaîner sur cette<br />
phrase ? « Le différend est l’état instable et l’instant du langage<br />
où quelque chose doit pouvoir être mis en phrases, ne<br />
peut pas l’être encore. Cet état comporte le silence qui est<br />
une phrase négative, mais il en appelle aussi à <strong>de</strong>s phrases<br />
possib<strong>les</strong> en principe » 14 . Silence, celui <strong>de</strong>s rescapés. Phrase<br />
à venir, jusqu’ici bloquée : « comment enchaîner après Auschwitz<br />
? ». « Le silence ne signale pas quelle est l’instance<br />
niée, il signale qu’une ou <strong>de</strong>s instances sont niées, et l’on<br />
peut entendre : 1) que la situation en question (le cas) n’est<br />
pas l’affaire du <strong>de</strong>stinataire (il n’a pas la compétence, ou il<br />
ne mérite pas qu’on lui en parle) ou 2) qu’elle n’a pas eu lieu<br />
(c’est ce qu’entend Faurisson) ou 3) qu’il n’y a rien à en dire<br />
(elle est insensée, inexprimable) ou 4) que ce n’est pas l’af-<br />
12 Ibid., p. 48.<br />
13 Ibid., p. 49.<br />
14 Ibid.<br />
libres propos / LNA#49<br />
35
LNA#49 / libres propos<br />
36<br />
faire <strong>de</strong>s survivants d’en parler (ils n’en sont pas dignes) ou<br />
plusieurs <strong>de</strong> ces négations ensemble » 15 . Le Différend est le<br />
premier argumentaire puissant contre le négationnisme.<br />
« J’aimerais appeler différend le cas où le plaignant est dépouillé<br />
<strong>de</strong>s moyens d’argumenter et <strong>de</strong>vient <strong>de</strong> ce fait une<br />
victime. Si le <strong>de</strong>stinateur, le <strong>de</strong>stinataire et le sens du témoignage<br />
sont neutralisés, tout est comme s’il n’y avait jamais<br />
eu <strong>de</strong> dommage. Un cas <strong>de</strong> différend entre <strong>de</strong>ux parties a<br />
lieu quand le « règlement » du conflit qui <strong>les</strong> oppose se fait<br />
dans l’idiome <strong>de</strong> l’une d’el<strong>les</strong> alors que le tort dont l’autre<br />
souffre ne se signifie pas dans cet idiome » 16 . Ici le cas,<br />
c’est le travailleur. Dans le jeu <strong>de</strong> langage le plus simple, le<br />
travailleur est dans un rapport tel avec son employeur qu’il<br />
cè<strong>de</strong> sa force <strong>de</strong> travail et son temps en échange d’un salaire.<br />
Mais il n’y a pas équivalence entre le prix <strong>de</strong> la force <strong>de</strong> travail<br />
et le salaire, ni non plus entre le temps réel <strong>de</strong> l’ouvrier<br />
dans l’atelier et le temps du calcul économique, ni entre<br />
le travail salarié et le travail « vivant ». Le problème, c’est<br />
qu’aucune instance <strong>de</strong> justice ne peut entendre ce tort. La<br />
souffrance non évaluable, le silence du sentiment restent à<br />
la porte du tribunal. Comment ne pas entendre ici l’inévaluable<br />
<strong>de</strong> nos évaluations professionnel<strong>les</strong> ? Marx, en 1843,<br />
parlait <strong>de</strong> « tort tout court » (et non particulier) fait aux travailleurs.<br />
Lyotard en 1983 : « c’est ainsi que le marxisme n’a<br />
pas fini comme sentiment du différend » 17 . Lyotard, avec<br />
le Différend, renoue avec la pensée critique, au sens kantien<br />
<strong>de</strong> ce terme, sans allégeance nouvelle, sans se donner l’illusion<br />
d’un secours. Ce qu’il doit à Kant se tient, comme<br />
pour Hannah Arendt, mais pour un usage différent, dans<br />
la Critique <strong>de</strong> la faculté <strong>de</strong> juger. Plus explicitement, dans<br />
la distinction opérée par Kant entre jugement déterminant<br />
et jugement réfléchissant. La question du juste <strong>de</strong>vient la<br />
question du jugement.<br />
À gros traits : Kant appelle « déterminant » un jugement qui<br />
subsume le particulier sous l’universel. L’universel, c’est la<br />
règle, le principe, la loi qui permet <strong>de</strong> penser le particulier.<br />
Les lois scientifiques sont <strong>de</strong> l’ordre du déterminant. Mais si<br />
seul le particulier est donné, comme dans le cas <strong>de</strong> la découverte<br />
d’une nouvelle espèce végétale, c’est à notre faculté <strong>de</strong><br />
juger <strong>de</strong> trouver l’universel. Commentaire <strong>de</strong> Lyotard : « Et<br />
15 Ibid., p. 31.<br />
16 Ibid., p. 24.<br />
17 Ibid., p. 236.<br />
alors ou bien il faut admettre une recherche régressive à l’infini<br />
<strong>de</strong>s critères <strong>de</strong> critères, qui interdit <strong>de</strong> facto le jugement<br />
ou bien il faut s’en remettre à ce ‘don <strong>de</strong> la nature’ qu’est le<br />
jugement, qui nous permet <strong>de</strong> dire : ici c’est le cas » (L’enthousiasme.<br />
La critique kantienne <strong>de</strong> l’histoire 18 ).<br />
Le jugement, c’est l’acte <strong>de</strong> l’esprit qui doit penser un « cas »<br />
imprévisible, contingent, inédit ou inouï, une phrase sans<br />
règle, sans genre sous lequel la ranger. Ce type <strong>de</strong> jugement<br />
fait défaut lorsque, armés <strong>de</strong> la toute vraie et donc toutepuissante<br />
théorie, <strong>les</strong> acteurs <strong>de</strong> l’histoire (ici, par exemple,<br />
<strong>les</strong> marxistes-léninistes <strong>de</strong> Mai 68) ne reconnaissent pas<br />
l’événement. Pour la « Théorie », <strong>les</strong> étudiants <strong>de</strong> 68 ne pouvaient<br />
que détourner l’attention <strong>de</strong>s « vraies luttes », à savoir<br />
<strong>de</strong>s luttes prolétariennes, selon le vocabulaire <strong>de</strong> cette époque.<br />
Et qu’on ne dise pas que c’était une « erreur », car nous<br />
serions encore dans le paradigme déterminant <strong>de</strong> la science<br />
politique, en l’occurrence marxiste. Le défaut <strong>de</strong> jugement<br />
par gros temps, lorsque s’agitent et s’accumulent <strong>les</strong> menaces,<br />
est tout simplement une tragédie ou un crime. Hannah<br />
Arendt : « Ils <strong>de</strong>vaient juger par eux-mêmes chaque cas à<br />
mesure qu’il se présentait, car il n’y avait pas <strong>de</strong> règ<strong>les</strong> pour<br />
ce qui est sans précé<strong>de</strong>nt » (Eichmann à Jérusalem). Cet accueil<br />
<strong>de</strong> la phrase, du « arrive-t-il ? », dit Lyotard, du cas qui<br />
se présente sans son universel, renvoie à une fondamentale<br />
« passibilité », à rapprocher <strong>de</strong> la « passivité plus passive que<br />
toute passivité » <strong>de</strong> Levinas, ou du « transpassible » d’Henri<br />
Maldiney : être en mesure d’être affecté, c’est-à-dire surpris<br />
et révélé à soi-même comme passible d’un « il m’arrive ».<br />
Antidogmatique, rétive à toute unification, la pensée <strong>de</strong> Jean-<br />
François Lyotard n’a négligé aucun domaine <strong>de</strong> la <strong>culture</strong>.<br />
Il convient <strong>de</strong> conclure, comme le Différend en 1983, par une<br />
non-conclusion, car c’est « notre cas » aujourd’hui : « Quelle<br />
assurance y a-t-il que <strong>les</strong> humains <strong>de</strong>viendront plus cultivés<br />
qu’ils ne sont ? Si la <strong>culture</strong> (<strong>de</strong> l’esprit, du moins) exige un<br />
travail et donc prend du temps, et si le genre économique<br />
impose son enjeu, gagner du temps, à la plupart <strong>de</strong>s régimes<br />
<strong>de</strong> phrases et <strong>de</strong>s genres <strong>de</strong> discours, la <strong>culture</strong> consommatrice<br />
<strong>de</strong> temps, <strong>de</strong>vrait être éliminée » 19 .<br />
Si tel <strong>de</strong>vait être le cas, philosopher serait résister.<br />
18 Éd. Galilée, 1986, p. 19.<br />
19 Le Différend, p. 259.
Mardi 7 octobre 2008<br />
18h : présentation <strong>de</strong> la saison et <strong>de</strong>s ateliers <strong>de</strong> pratiques<br />
artistiques<br />
19h : danse<br />
20h : concert<br />
La soirée sera clôturée par un cocktail.<br />
Scan<strong>de</strong>r <strong>les</strong> mouvements et <strong>les</strong> rythmes d’une saison, accor<strong>de</strong>r la diversité<br />
<strong>de</strong>s interventions intellectuel<strong>les</strong> avec <strong>les</strong> tonalités artistiques pluriel<strong>les</strong> relève<br />
d’une partition complexe, une composition orchestrale où fusionnent harmonieusement<br />
<strong>les</strong> sons, <strong>les</strong> paro<strong>les</strong> et la multiplicité <strong>de</strong>s exécutants.<br />
Le solo original La peau et <strong>les</strong> os <strong>de</strong> Lydia Fromont, nourri d’un bel esprit<br />
d’ouverture, symbolisera, entre l’énergie du hip-hop, la danse afro et la<br />
danse sar<strong>de</strong>, l’émotion et la force <strong>de</strong> vie.<br />
Puis, l’intervention <strong>de</strong> l’Orchestre Universitaire <strong>de</strong> Lille 1 sera le symbole<br />
<strong>de</strong> cette nouvelle saison, <strong>de</strong> cette ouverture à l’ensemble <strong>de</strong>s manifestations.<br />
Suivra ensuite l’émergence tellurique <strong>de</strong> l’exposition géologique Universi’terre<br />
et <strong>les</strong> incantations <strong>de</strong>s poèmes sonores, et leurs magiques volutes.<br />
L’Europe, en ses ruptures diachroniques, conjuguera le Masarat <strong>de</strong> Bruxel<strong>les</strong><br />
à tous <strong>les</strong> accents <strong>de</strong> la Pa<strong>les</strong>tine.<br />
Enfin, <strong>les</strong> pas du Butô s’accor<strong>de</strong>ront aux temps <strong>de</strong> la valse <strong>de</strong>s livres pour<br />
faire retentir <strong>les</strong> somptueuses harmonies <strong>de</strong> l’automne universitaire lillois.<br />
Ateliers, stages, workshops<br />
Inscriptions dès le 7 octobre<br />
JAZZ WORKSHOP<br />
Direction artistique : Olivier Benoit<br />
L’orchestre du workshop, dirigé par<br />
Olivier Benoit * , recherche <strong>de</strong>s musiciens<br />
d’un niveau confirmé ou très<br />
motivés, venus d’horizons divers<br />
(classique, rock, jazz) pour sa création<br />
2008-2009.<br />
Vous apportez au groupe vos propres<br />
connaissances, le bagage jazz n’est absolument<br />
pas une obligation. Impro-<br />
au programme / ouverture <strong>de</strong> saison & ateliers / LNA#49<br />
visation, rythme, écriture, travail en<br />
groupe, élaboration d’un répertoire,<br />
interprétation <strong>de</strong>s morceaux écrits par<br />
<strong>les</strong> étudiants et par Olivier Benoit,<br />
sessions d’enregistrement, vous explorerez<br />
toutes <strong>les</strong> facettes <strong>de</strong> la création.<br />
Le lundi <strong>de</strong> 17h à 21h<br />
Reprise le lundi 20 octobre<br />
* Pour plus d’informations : obenoitmusic@gmail.com<br />
http://obenoitmusic.free.fr<br />
ATELIER DE PHOTOGRAPHIE<br />
Direction artistique : Antoine<br />
Petitprez et Philippe Timmerman<br />
La photographie peut-elle être considérée<br />
comme l’autoportrait <strong>de</strong> son<br />
auteur ?<br />
Pour le photographe américain Robert<br />
Adams, l’image photographique nous<br />
en dit autant sur la personne qui tient<br />
l’appareil que sur ce qui est <strong>de</strong>vant<br />
l’objectif.<br />
Selon Serge Tisseron : « […] tout<br />
photographe est préoccupé par sa<br />
présence dans ses images 1 ». En effet,<br />
la photographie cristallise l’ensemble<br />
<strong>de</strong>s décisions qui ont poussé l’auteur<br />
à capturer une image à un moment<br />
précis.<br />
Ainsi, qu’elle soit réelle ou non, la présence<br />
<strong>de</strong> l’auteur participe <strong>de</strong> près ou<br />
<strong>de</strong> loin à l’image photographique.<br />
Dans le cadre <strong>de</strong> cet atelier, il est<br />
proposé aux participants <strong>de</strong> s’initier<br />
à la photographie (argentique et/ou<br />
numérique). Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> l’aspect purement<br />
technique, par le choix <strong>de</strong>s<br />
images réalisées, chacun s’engagera à<br />
formuler un propos artistique autour<br />
<strong>de</strong> sa propre présence dans ses images.<br />
L’atelier est ouvert à tous, débutants<br />
ou non.<br />
Le mercredi <strong>de</strong> 18h à 21h<br />
Reprise le mercredi 5 novembre<br />
ATELIER THÉÂTRE<br />
Direction artistique : Jean-Maximilien<br />
Sobocinski<br />
L’atelier sera l’occasion d’expérimenter<br />
<strong>de</strong>s situations, <strong>de</strong> proposer, <strong>de</strong> découvrir<br />
pour certains.<br />
1 Tisseron S., Le mystère <strong>de</strong> la chambre claire -<br />
photographie et inconscient, Les Bel<strong>les</strong> Lettres,<br />
Archimbaud, 1996, p. 49.<br />
37
LNA#49 / au programme / ouverture <strong>de</strong> saison & ateliers<br />
38<br />
De faire du théâtre pour avancer et<br />
comprendre.<br />
Ébaucher un montage <strong>de</strong> textes pas<br />
forcément faits pour le théâtre.<br />
Des textes, <strong>de</strong>s témoignages, <strong>de</strong>s improvisations<br />
pour construire ensemble.<br />
L’atelier à vivre comme une avancée<br />
vers l’autre, <strong>les</strong> autres, pour <strong>les</strong> autres.<br />
Pour se souvenir <strong>de</strong> l’histoire et du récit.<br />
Pour faire du théâtre sans oublier que<br />
le théâtre est un jeu…<br />
Le lundi <strong>de</strong> 19h à 21h30<br />
Reprise le lundi 3 novembre<br />
ÉCRITURE<br />
Direction artistique : François Fairon<br />
Le déroulement d’une séance d’atelier<br />
d’écriture comprend quelques invariants,<br />
dont une consigne d’écriture,<br />
un temps d’écriture, une lecture et<br />
<strong>les</strong> commentaires <strong>de</strong>s participants et<br />
<strong>de</strong> l’animateur. La consigne d’écriture<br />
est variable et multiple. Elle<br />
puise, pour une large part, dans <strong>les</strong><br />
textes d’auteurs et <strong>les</strong> joueurs d’écriture,<br />
où l’un et l’autre, chacun à sa<br />
manière, provoque et stimule l’écriture.<br />
L’atelier d’écriture s’appuie<br />
sur une dynamique individuelle et<br />
collective.<br />
Progressivement, au fil <strong>de</strong>s séances,<br />
sous l’effet <strong>de</strong> l’écriture et <strong>de</strong>s échanges<br />
provoqués lors <strong>de</strong>s lectures, un groupe<br />
se forme. Les sensibilités et <strong>les</strong> caractères<br />
<strong>de</strong>s participants s’exposent. Une<br />
complicité naît. L’atelier d’écriture<br />
poursuit tout autant une finalité : celle<br />
<strong>de</strong> sortir <strong>de</strong> son cadre en s’exposant<br />
et en se publiant.<br />
Pour cette secon<strong>de</strong> édition – après<br />
avoir travaillé sur le thème <strong>de</strong> la fron-<br />
tière – aucune thématique particulière<br />
n’est avancée. Le choix <strong>de</strong>s sujets et<br />
<strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s d’écriture se dévoilera au<br />
long <strong>de</strong>s séances, tout en cherchant à<br />
profiter et à s’inspirer <strong>de</strong> la programmation<br />
<strong>de</strong> l’<strong>Espace</strong> Culture.<br />
Le mercredi <strong>de</strong> 18h à 20h30<br />
Reprise le mercredi 5 novembre<br />
__________<br />
INSCRIPTIONS<br />
Dans la limite <strong>de</strong>s places disponib<strong>les</strong>,<br />
l’inscription <strong>de</strong> participants extérieurs<br />
à l’Université <strong>de</strong> Lille 1 sera envisagée.<br />
TARIFS<br />
Étudiants et personnels Lille 1<br />
1 atelier : 30 euros / 2 ateliers :<br />
50 euros / 3 ateliers : 70 euros<br />
Extérieurs<br />
1 atelier : 50 euros / 2 ateliers :<br />
80 euros / 3 ateliers : 100 euros<br />
Paiement uniquement par chèque<br />
à l’ordre <strong>de</strong> l’Agent Comptable <strong>de</strong><br />
l’Université <strong>de</strong> Lille 1.<br />
DANSE CONTEMPORAINE<br />
Les membres du collectif danse w2YD,<br />
en rési<strong>de</strong>nce à l’<strong>Espace</strong> Culture <strong>de</strong>puis<br />
novembre 2006, proposent, pour l’année<br />
2008-2009, <strong>de</strong>s ren<strong>de</strong>z-vous d’ateliers<br />
chorégraphiques.<br />
http://w2yd.free.fr<br />
Atelier États <strong>de</strong> corps : mené par<br />
Alice Lefranc (+ w2YD)<br />
À la croisée <strong>de</strong> ses différentes pratiques,<br />
Alice Lefranc proposera à chacun <strong>de</strong><br />
développer une mise en condition propice<br />
à la recherche chorégraphique.<br />
Chacun se familiarisera avec son propre<br />
schéma corporel, <strong>les</strong> sensations <strong>de</strong><br />
poids du corps et le contact.<br />
Aujourd’hui chorégraphe, Alice Lefranc<br />
a été interprète dans plusieurs<br />
projets (Vivat d’Armentières, Danse à<br />
Lille, <strong>Espace</strong> Culture Lille 1…). Au<br />
cours <strong>de</strong> nombreux stages, elle a abordé<br />
différentes techniques (Fel<strong>de</strong>nkrais,<br />
Alexan<strong>de</strong>r, Yoga) en parallèle d’une<br />
pratique avancée <strong>de</strong> l’Aïkido. Elle<br />
développe son langage chorégraphique<br />
à partir <strong>de</strong> ces différentes approches du<br />
mouvement.<br />
http://onlineblog.fr/alicelefranc.php<br />
Atelier gratuit et ouvert à tous<br />
(débutants - confirmés), une à <strong>de</strong>ux<br />
fois par mois <strong>les</strong> samedis <strong>de</strong> 15h à<br />
17h. Inscriptions et renseignements<br />
au 03 20 43 69 09.
Hans Vre<strong>de</strong>man <strong>de</strong> Vries, planche <strong>de</strong> la Perspectiva, édition <strong>de</strong><br />
Ley<strong>de</strong>, 1604 (éd. orig. : Anvers, 1560). Collection privée<br />
RENDEZ-VOUS D’ARCHIMÈDE<br />
u L’espace : <strong>de</strong>s axiomes réels<br />
Mardi 21 octobre à 18h30<br />
Par François Wahl, Philosophe, ancien<br />
directeur littéraire aux éditions du<br />
Seuil. Animée par Nabil El-Haggar,<br />
Vice-prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Université <strong>de</strong> Lille 1,<br />
chargé <strong>de</strong> la Culture, <strong>de</strong> la Communication<br />
et du Patrimoine Scientifique.<br />
u La genèse <strong>de</strong> l’espace chez l’enfant<br />
Mardi 18 novembre à 18h30<br />
Par Gérard Vergnaud, Directeur <strong>de</strong><br />
recherche émérite au CNRS. Animée<br />
par Jean-François Rey, Professeur <strong>de</strong><br />
philosophie à l’IUFM <strong>de</strong> Lille.<br />
u De la perspective à la construction<br />
<strong>de</strong> l’espace<br />
Mardi 9 décembre à 18h30<br />
Par Jean-Pierre Le Goff, Professeur <strong>de</strong><br />
mathématiques et historien <strong>de</strong>s sciences<br />
à l’IUFM et l’IREM <strong>de</strong> l’Université <strong>de</strong><br />
Caen (Basse-Normandie). Animée par<br />
Bernard Pourprix, Professeur émérite<br />
<strong>de</strong> physique et d’histoire <strong>de</strong>s sciences à<br />
l’Université <strong>de</strong> Lille 1.<br />
u Une histoire du ciel <strong>de</strong> Copernic<br />
à… <strong>de</strong>main<br />
Jeudi 8 janvier à 18h30<br />
Par Jean-Pierre Luminet, Directeur<br />
<strong>de</strong> recherches au CNRS, Laboratoire<br />
Univers et Théories<br />
(LUTH), Observatoire <strong>de</strong><br />
Paris-Meudon.<br />
Animée par Bernard Maitte,<br />
Professeur d’histoire et d’épistémologie<br />
<strong>de</strong>s sciences à l’Université <strong>de</strong> Lille 1.<br />
Octobre 2008 – mai 2009<br />
Cycle L’espace<br />
u La refonte du concept d’espace cosmique<br />
à la Renaissance et l’effondrement<br />
<strong>de</strong> la cosmologie traditionnelle<br />
Mardi 13 janvier à 18h30<br />
Par Jean Sei<strong>de</strong>ngart, Professeur <strong>de</strong><br />
philosophie et d’histoire <strong>de</strong>s sciences<br />
à l’Université <strong>de</strong> Paris X-Nanterre.<br />
Animée par Robert Gergon<strong>de</strong>y,<br />
Mathématicien.<br />
u <strong>Espace</strong>, territoire et ville<br />
Mardi 3 février à 18h30<br />
Par Alain Cambier, Docteur en philosophie,<br />
professeur en classes préparatoires,<br />
Lycée Faidherbe, Lille. Animée<br />
par Nabil El-Haggar.<br />
u L’homme à la recherche <strong>de</strong> nouveaux<br />
mon<strong>de</strong>s<br />
Jeudi 12 février à 18h30<br />
Par Sylvie Vauclair, Astrophysicienne,<br />
professeur à l’Université <strong>de</strong><br />
Toulouse, membre <strong>de</strong> l’Institut<br />
universitaire <strong>de</strong> France.<br />
Animée par Georges Wlodarczak,<br />
Professeur <strong>de</strong> physique<br />
à l’Université <strong>de</strong> Lille 1.<br />
u <strong>Espace</strong> et rationalité<br />
Mardi 10 mars à 18h30<br />
Par Michel Fichant, Professeur en<br />
histoire <strong>de</strong> la philosophie, directeur<br />
<strong>de</strong> l’UFR <strong>de</strong> philosophie <strong>de</strong> l’Université<br />
<strong>de</strong> Paris IV.<br />
Animée par Robert Locqueneux,<br />
Professeur émérite à l’Université <strong>de</strong><br />
Lille 1 et historien <strong>de</strong> la physique.<br />
u La planète Mars<br />
Jeudi 12 mars à 18h30<br />
Par Francis Rocard, Astrophysicien,<br />
responsable <strong>de</strong>s programmes d’explo-<br />
au programme / réflexion-débat / LNA#49<br />
ration du Système Solaire<br />
au Centre National d’Étu<strong>de</strong>s<br />
Spatia<strong>les</strong>.<br />
Animée par Hugues Leroux,<br />
Maître <strong>de</strong> conférences<br />
en physique à l’Université <strong>de</strong> Lille 1.<br />
u La formation du système solaire<br />
Jeudi 19 mars à 18h30<br />
Par Matthieu Gounelle, Professeur<br />
au Muséum National d’Histoire<br />
Naturelle, cosmochimiste.<br />
Animée par Hugues<br />
Leroux.<br />
u Les espaces à plus <strong>de</strong> trois<br />
dimensions<br />
Mardi 31 mars à 18h30<br />
Avec Michel Cassé, Directeur <strong>de</strong> recherche<br />
au Commissariat à l’Énergie<br />
Atomique, chercheur associé à l’Institut<br />
d’Astrophysique <strong>de</strong> Paris et Robert<br />
Gergon<strong>de</strong>y, Mathématicien.<br />
Animée par Robert Locqueneux.<br />
u Le cubisme : invention d’un nouvel<br />
espace plastique<br />
Mardi 14 avril à 18h30<br />
Par Nathalie Cogez, Docteur en<br />
histoire <strong>de</strong> l’art contemporain, chargée<br />
<strong>de</strong> cours à l’Université Char<strong>les</strong> <strong>de</strong><br />
Gaulle - Lille III, membre associé du<br />
Centre d’Étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Arts Contemporains<br />
(CEAC) - Lille III.<br />
Remerciements à Rudolf Bkouche, Jean-Marie<br />
Breuvart, Alain Cambier, Rémi Franckowiak, Robert<br />
Gergon<strong>de</strong>y, Hugues Leroux, Bernard Maitte, Bernard<br />
Pourprix, Alain Vienne et Georges Wlodarczak pour<br />
leur participation à l’élaboration <strong>de</strong> ce cycle.<br />
Plus d’informations : www.univ-lille1.fr/<strong>culture</strong><br />
Programme détaillé disponible à l’<strong>Espace</strong> Culture.<br />
39
LNA#49 / au programme / réflexion-débat<br />
40<br />
CONFéRENCES<br />
Octobre 2008 – mai 2009<br />
Cycle À propos <strong>de</strong> la science<br />
u Temps <strong>de</strong> la terre, temps <strong>de</strong><br />
l’homme<br />
Mardi 14 octobre à 18h30<br />
Par Patrick De Wever, Professeur au<br />
Muséum National d’Histoire Naturelle,<br />
Département Histoire <strong>de</strong> la Terre, Géologie.<br />
Animée par Nabil El-Haggar,<br />
Vice-prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Université <strong>de</strong> Lille 1,<br />
chargé <strong>de</strong> la Culture, <strong>de</strong> la Communication<br />
et du Patrimoine Scientifique.<br />
u Vidéoconférence : Les ressources<br />
énergétiques et minéra<strong>les</strong> en France,<br />
en Europe et dans le mon<strong>de</strong><br />
Mardi 25 novembre à 18h30<br />
Par Pierre Andrieux, Vice-prési<strong>de</strong>nt<br />
<strong>de</strong> l’Union Française <strong>de</strong>s Géologues,<br />
professeur émérite <strong>de</strong> géophysique appliquée<br />
<strong>de</strong> l’Université Pierre et Marie<br />
Curie (Paris VI). Animée par Francis<br />
Meilliez, Professeur en sciences <strong>de</strong> la<br />
terre à l’Université <strong>de</strong> Lille 1.<br />
u Le géosystème et la prose, vous<br />
connaissez ?<br />
Mardi 16 décembre à 18h30<br />
Par Francis Meilliez, Professeur en<br />
sciences <strong>de</strong> la terre à l’Université <strong>de</strong><br />
Lille 1. Animée par Alain Blieck,<br />
Secrétaire général du Comité National<br />
Français <strong>de</strong> Géologie (CNFG),<br />
secrétaire <strong>de</strong> la Fédération Française<br />
<strong>de</strong> Géologie (FFG).<br />
CAFéS-SCIENCES<br />
Des rencontres seront proposées au<br />
cours <strong>de</strong> la saison sur <strong>de</strong>s sujets d’actualité.<br />
Consultez régulièrement notre<br />
site web !<br />
u L’homme et l’animal : enjeux<br />
philosophiques et éthiques, <strong>de</strong>s Lumières<br />
à aujourd’hui<br />
Mardi 27 janvier à 18h30<br />
Par Jean-Luc Guichet, Philosophe,<br />
directeur <strong>de</strong> programme au Collège<br />
International <strong>de</strong> Philosophie (Paris) et<br />
membre du Centre Georges Chevrier<br />
(UMR-CNRS 5605, Dijon). Animée<br />
par Dominique Boury, Enseignant<br />
chercheur au Centre d’Éthique Médicale<br />
<strong>de</strong> l’Université Catholique <strong>de</strong> Lille.<br />
u La technique et le vivant<br />
Mardi 17 février à 18h30<br />
Par Jean-Clau<strong>de</strong> D’Halluin, Directeur<br />
<strong>de</strong> recherche au CNRS. Animée<br />
par Rémi Franckowiak, Maître <strong>de</strong><br />
conférences en histoire <strong>de</strong>s sciences et<br />
épistémologie à l’Université <strong>de</strong> Lille 1.<br />
u Évolution ? Évolution !<br />
Journée d’étu<strong>de</strong>s proposée par la<br />
Société Géologique <strong>de</strong> France<br />
Lundi 16 mars<br />
8h30 : Introduction<br />
9h : L’évolution : <strong>de</strong>s faits aux modè<strong>les</strong><br />
par André Schaaf, Université <strong>de</strong><br />
Strasbourg 1<br />
9h45 : Les fossi<strong>les</strong>, <strong>les</strong> interprétations<br />
désopilantes <strong>de</strong>s créationnistes<br />
par Clau<strong>de</strong> Babin, Université <strong>de</strong> Lyon 1<br />
10h30 : L’Intelligent Design : nature<br />
et enjeux par Jean Dubessy, Université<br />
<strong>de</strong> Nancy 1<br />
11h15 : Débat<br />
14h : L’évolution, fait, hypothèse ou<br />
théorie : le problème <strong>de</strong> l’administration<br />
<strong>de</strong> la preuve dans <strong>les</strong> sciences<br />
historiques et son retentissement pour<br />
leur enseignement par Armand <strong>de</strong><br />
Ricqlès, Collège <strong>de</strong> France<br />
14h45 : Les stratégies <strong>de</strong>s créationnismes<br />
et <strong>les</strong> contours <strong>de</strong>s sciences<br />
par Guillaume Lecointre, Muséum<br />
National d’Histoire Naturelle<br />
15h30 : Chroniques terriennes <strong>de</strong>s<br />
origines <strong>de</strong> l’Homme<br />
par Pascal Picq, Collège <strong>de</strong> France<br />
16h15 : Débat et clôture<br />
Avec la FFG (Fédération Française <strong>de</strong> Géologie), l’APF<br />
(Association Paléontologique Française), le Palais <strong>de</strong> la<br />
Découverte, l’ULP (Université Louis Pasteur, Strasbourg),<br />
l’EOST (École et Observatoire <strong>de</strong>s Sciences<br />
<strong>de</strong> la Terre), l’Académie <strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux, l’Université<br />
<strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux 1, le CAREN (Centre Armoricain<br />
<strong>de</strong> Recherches en Environnement), l’Université <strong>de</strong><br />
Rennes 1, Géosciences Rennes, l’Université Clau<strong>de</strong><br />
Bernard - Lyon 1, le PEPS (Laboratoire PaléoEnvironnements<br />
et PaléobioSphère), le Forum Départemental<br />
<strong>de</strong>s Sciences (Villeneuve d’Ascq), le BRGM (Bureau<br />
<strong>de</strong> Recherches Géologiques et Minières) et le Collège <strong>de</strong><br />
France.<br />
u Les expérimentations « in silico »<br />
Mardi 19 mai à 18h30<br />
Par Jean-Gabriel Ganascia, Professeur<br />
à l’Université Pierre et Marie Curie<br />
(Paris VI) et directeur <strong>de</strong> l’équipe<br />
ACASA (Agents Cognitifs et Apprentissage<br />
Symbolique Automatique) du LIP6<br />
(Laboratoire d’Informatique <strong>de</strong> Paris 6).<br />
Animée par Jean-Paul Delahaye, Professeur<br />
d’informatique à l’Université<br />
<strong>de</strong> Lille 1, Laboratoire d’Informatique<br />
Fondamentale <strong>de</strong> Lille.<br />
Remerciements à Rudolf Bkouche, Jean-Paul Delahaye,<br />
Gil<strong>les</strong> Denis, Hugues Leroux, Robert Locqueneux,<br />
Bernard Maitte, Bernard Pourprix, Bernard Van<strong>de</strong>nbun<strong>de</strong>r,<br />
Alain Vienne et Georges Wlodarczak pour<br />
leur participation à l’élaboration <strong>de</strong> ce cycle.<br />
Plus d’informations : www.univ-lille1.fr/<strong>culture</strong><br />
Programme détaillé disponible à l’<strong>Espace</strong> Culture.<br />
Sédiments passés à l'aci<strong>de</strong> chlorhydrique Laboratoire Géosystème<br />
Photo : Eric Bross communication Lille1
Ren<strong>de</strong>z-vous d'archimè<strong>de</strong><br />
Octobre 2008 – mai 2009<br />
Cycle La guerre<br />
RENDEZ-VOUS D’ARCHIMÈDE<br />
$<br />
u Les métamorphoses <strong>de</strong> la guerre<br />
Mardi 2 décembre à 18h30<br />
Par Pierre Hassner, Directeur <strong>de</strong> recherches<br />
émérite à l’Institut d’Étu<strong>de</strong>s<br />
Politiques <strong>de</strong> Paris, chercheur associé<br />
au CERI (Centre d’Étu<strong>de</strong>s et <strong>de</strong><br />
Recherches Internationa<strong>les</strong>).<br />
Animée par Nabil El-Haggar, Viceprési<strong>de</strong>nt<br />
<strong>de</strong> l’Université <strong>de</strong> Lille 1,<br />
chargé <strong>de</strong> la Culture, <strong>de</strong> la Communication<br />
et du Patrimoine Scientifique.<br />
u Guerre et conflits <strong>de</strong> civilisation<br />
Mardi 6 janvier à 18h30<br />
Par Sandrine Tolotti, Journaliste<br />
(sous réserve).<br />
Animée par Jean-Marie Breuvart,<br />
Philosophe.<br />
u Penser l’ennemi<br />
Mardi 20 janvier à 18h30<br />
Par Jean-Clau<strong>de</strong> Monod, Chercheur<br />
en philosophie au CNRS (UMR<br />
8547, Archives Husserl), enseignant à<br />
l’École Normale Supérieure, Paris.<br />
Animée par Alain Cambier, Docteur<br />
en philosophie, professeur en classes<br />
préparatoires, Lycée Faidherbe, Lille.<br />
u Le terrorisme aujourd’hui<br />
Mardi 10 février à 18h30<br />
Par François-Bernard Huyghe, Expert<br />
associé à l’Institut <strong>de</strong> Relations<br />
Internationa<strong>les</strong> et Stratégiques (IRIS),<br />
enseignant sur le campus virtuel <strong>de</strong><br />
l’Université <strong>de</strong> Limoges. Animée par<br />
Jean-François Rey, Professeur <strong>de</strong><br />
philosophie à l’IUFM <strong>de</strong> Lille.<br />
au programme / réflexion-débat / LNA#49<br />
u Économie et guerre<br />
Mardi 17 mars à 18h30<br />
Par Clau<strong>de</strong> Serfati, Enseignant-chercheur<br />
en économie, Centre d’Économie<br />
et d’Éthique pour l’Environnement et<br />
le Développement (C3ED), Université<br />
<strong>de</strong> Saint-Quentin-en-Yvelines.<br />
Animée par Rémi Franckowiak,<br />
Maître <strong>de</strong> conférences en histoire <strong>de</strong>s<br />
sciences et épistémologie à l’Université<br />
<strong>de</strong> Lille 1.<br />
u Prévenir et humaniser la guerre,<br />
est-ce possible ? Le cas du Vietnam<br />
Mardi 7 avril à 18h30<br />
Par Monique Chemillier-Gendreau,<br />
Professeur émérite <strong>de</strong> droit public et<br />
science politique, Université Paris<br />
Di<strong>de</strong>rot.<br />
Animée par Nabil El-Haggar.<br />
u Guerre et paix<br />
Mardi 26 mai à 18h30<br />
Par Jean-Marc Ferry, Philosophe, professeur<br />
à l’Université Libre <strong>de</strong> Bruxel<strong>les</strong><br />
en science politique et en philosophie<br />
morale, docteur honoris causa <strong>de</strong> l’Université<br />
<strong>de</strong> Lausanne, Suisse.<br />
Animée par Jean-Marie Breuvart.<br />
Remerciements à Youcef Boudjemai, Jean-Marie<br />
Breuvart, Bruno Duriez, Rémi Franckowiak, Robert<br />
Gergon<strong>de</strong>y, Jacques Lemière, Patrick Picouet, Jean-<br />
François Rey et Frédéric Worms pour leur participation<br />
à l’élaboration <strong>de</strong> ce cycle.<br />
Plus d’informations : www.univ-lille1.fr/<strong>culture</strong><br />
Programme détaillé disponible à l’<strong>Espace</strong> Culture.<br />
41
LNA#49 / au programme / réflexion-débat<br />
42<br />
Ce livre reprend, avec <strong>de</strong> nombreuses mises à jour, <strong>les</strong><br />
travaux présentés lors d’une journée d’étu<strong>de</strong>s organisée<br />
par l’<strong>Espace</strong> Culture <strong>de</strong> l’Université <strong>de</strong> Lille 1 sur le thème<br />
<strong>de</strong> la Laïcité.<br />
Notre propos n’a pas été <strong>de</strong> reprendre l’ordre chronologique<br />
<strong>de</strong>s conférences. Nous lui avons préféré une présentation<br />
que l’on pourrait qualifier <strong>de</strong> « mise au point » sur le concept<br />
<strong>de</strong> laïcité, un concept que nous considérons comme l’un<br />
<strong>de</strong>s plus beaux concepts philosophiques. Nous avons voulu<br />
insister autant sur le rappel historique <strong>de</strong> l’émergence <strong>de</strong><br />
la « laïcité à la française », et plus particulièrement sur la<br />
loi dite <strong>de</strong> 1905, que sur la dimension profondément mo<strong>de</strong>rne<br />
<strong>de</strong> notre laïcité. Dans cet esprit, cet ouvrage montre<br />
que la loi dite <strong>de</strong> séparation <strong>de</strong>s Églises et <strong>de</strong> l’État n’est pas<br />
une « loi <strong>de</strong> combat », ni une « loi <strong>de</strong> transaction », car elle<br />
n’est pas une « loi conjoncturelle », à « actualiser » et à « mo<strong>de</strong>rniser<br />
». Au contraire, c’est une loi organique.<br />
Cet ouvrage montre l’urgence <strong>de</strong> rétablir la laïcité comme<br />
pilier <strong>de</strong> la République, <strong>de</strong> la démocratie et du vivre ensemble,<br />
au centre <strong>de</strong> l’esprit républicain. La laïcité est universelle,<br />
elle est passion <strong>de</strong> l’égalité et <strong>de</strong> la lutte contre <strong>les</strong><br />
communautarismes et le confessionnalisme. Pourtant, incontestablement,<br />
la laïcité a été pour le moins délaissée.<br />
C’est pourquoi elle doit être enseignée à l’école, à l’université,<br />
dans <strong>les</strong> quartiers. Cette responsabilité n’incombe pas seulement<br />
aux enseignants et aux éducateurs. Il appartient aussi,<br />
et avant tout, aux politiques <strong>de</strong> la porter et surtout <strong>de</strong> ne<br />
pas tolérer son bafouement, d’où qu’il vienne. Enfin, nous<br />
concluons cet ouvrage en montrant que le concept <strong>de</strong> laïcité<br />
internationale est une condition <strong>de</strong> la démocratie mondiale<br />
à venir.<br />
Présentation <strong>de</strong> l’ouvrage<br />
« La laïcité, ce précieux concept »<br />
Nouvelle parution dans la collection Les Ren<strong>de</strong>z-vous d’Archimè<strong>de</strong><br />
Dirigé par Nabil El-Haggar, Vice-prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Lille 1, chargé<br />
<strong>de</strong> la Culture, <strong>de</strong> la Communication et du Patrimoine Scientifique<br />
Lundi 24 novembre à 17h<br />
<strong>Espace</strong> Rencontres du Furet <strong>de</strong> Lille<br />
Entrée libre<br />
En présence <strong>de</strong> Philippe Rollet, Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Université <strong>de</strong> Lille 1,<br />
Nabil El-Haggar, Vice-prési<strong>de</strong>nt et <strong>de</strong>s auteurs.<br />
Rudolf Bkouche, professeur émérite <strong>de</strong> mathématiques à<br />
l’Université <strong>de</strong> Lille 1<br />
Monique Chemillier-Gendreau, professeur émérite <strong>de</strong><br />
droit public et sciences politiques à l’Université Paris-Di<strong>de</strong>rot<br />
Jacqueline Costa-Lascoux, directrice <strong>de</strong> recherche au<br />
Centre <strong>de</strong> recherches politiques, CNRS – Paris, membre du<br />
Haut Conseil à l’Intégration, ancienne directrice <strong>de</strong> l’Observatoire<br />
<strong>de</strong> l’Immigration et <strong>de</strong> l’Intégration<br />
Sophie Ernst, philosophe <strong>de</strong> l’éducation, chargée d’étu<strong>de</strong>s<br />
dans le projet ECEHG (Enjeux Contemporains <strong>de</strong> l’Enseignement<br />
<strong>de</strong> l’Histoire et Géographie), INRP (Institut<br />
National <strong>de</strong> Recherche Pédagogique)<br />
Catherine Kintzler, professeur émérite à l’Université <strong>de</strong><br />
Lille 3<br />
Jean-François Rey, philosophe et enseignant à l’IUFM <strong>de</strong><br />
Lille<br />
Jean-Paul Scot, historien<br />
Bernard Stasi, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Commission <strong>de</strong> réflexion sur<br />
l’application du principe <strong>de</strong> laïcité dans la République<br />
Michèle Vianès, conseillère municipale déléguée à l’égalité<br />
hommes/femmes – Caluire, prési<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> Regards <strong>de</strong><br />
Femmes<br />
Retrouvez toutes <strong>les</strong> informations sur cet ouvrage et la<br />
collection complète sur : http://www.univ-lille1.f/<strong>culture</strong>
La suprématie <strong>de</strong> l’économie <strong>de</strong> marché entraîne <strong>de</strong>s<br />
guerres économiques. Mais un autre mon<strong>de</strong> est possible,<br />
on peut en percevoir <strong>les</strong> prémices dans nombre d’initiatives,<br />
qui ouvrent <strong>de</strong>s chemins d’humanisation, issues du tissu<br />
associatif notamment.<br />
Néanmoins, un passage à l’acte est toujours nécessaire pour<br />
être davantage humain, fraternel et solidaire, pour ne pas<br />
rester enfermé dans notre individualisme, mais se confronter à<br />
l’altérité. Une réflexion s’avère toujours nécessaire en amont<br />
ou a posteriori pour faire le point, ne pas s’égarer, avant <strong>de</strong><br />
s’engager.<br />
Ces conférences sur différentes facettes <strong>de</strong> « chemins d’humanisation<br />
», qui passent par <strong>de</strong>s approches concrètes, voudraient<br />
inviter à cette réflexion :<br />
Valeurs <strong>de</strong> résistance au niveau <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l’ homme, <strong>de</strong> réflexion<br />
aussi bien sur l’humanitaire que sur la détresse en milieu étudiant,<br />
dans la vie affective et sexuelle, qui s’exprime aujourd’hui<br />
<strong>de</strong> manière inter<strong>culture</strong>lle. Mais aussi <strong>les</strong> possibilités <strong>de</strong> dons qui<br />
sont offertes : dons d’organe, <strong>de</strong> sang… Allons-nous vers un engagement<br />
durable ?<br />
Conférences<br />
u Droits <strong>de</strong> l’homme et immigrations<br />
Jeudi 13 novembre à 18h30<br />
Par Emmanuel Terray, Membre <strong>de</strong> la Ligue <strong>de</strong>s Droits <strong>de</strong><br />
l’Homme, du Ce<strong>de</strong>tim, spécialiste <strong>de</strong>s migrations. Avec la<br />
participation du Cercle <strong>de</strong> Silence <strong>de</strong> Lille.<br />
Animée par Régis Verley, Journaliste.<br />
Des vagues successives d’immigrants font partie <strong>de</strong> notre<br />
histoire. Voulues ou forcées, économiques, politiques,<br />
environnementa<strong>les</strong>, <strong>les</strong> migrations vont <strong>de</strong>ssiner <strong>de</strong>main un<br />
nouveau mon<strong>de</strong> qu’il convient d’anticiper pour ne pas le<br />
subir.<br />
En partenariat avec le CRDTM et dans le cadre <strong>de</strong> la semaine<br />
<strong>de</strong> solidarité internationale.<br />
Question <strong>de</strong> sens 2008/09 :<br />
Chemins d’humanisation<br />
u Sexualité, terre d’aventure et <strong>de</strong> rencontre<br />
Vers <strong>de</strong> nouveaux espaces dans la santé sexuelle en<br />
milieu étudiant<br />
Jeudi 4 décembre à 18h30<br />
Avec Nadia Flicourt, Sexologue formée en anthropologie<br />
(Formation-Expertise CIRM-CRIPS) et Isabel De Penanster,<br />
Psychosociologue formée à la rencontre inter<strong>culture</strong>lle<br />
(Formation-Expertise CIRM-CRIPS).<br />
Animée par Elisabeth Fichez, Professeur émérite en sciences<br />
<strong>de</strong> l’information et <strong>de</strong> la communication.<br />
« L’existence <strong>de</strong> tabous et <strong>de</strong> mythes sexuels, la culpabilité et<br />
le secret qui en découlent et qui sont imposés par la société<br />
sur <strong>les</strong> sujets sexuels constituent <strong>de</strong>s obstac<strong>les</strong> importants à<br />
l’éducation sexuelle… Le culte du machisme, la domination<br />
masculine et la victimisation <strong>de</strong>s femmes constituent<br />
à leur tour <strong>de</strong>s obstac<strong>les</strong> à l’introduction <strong>de</strong> l’idée <strong>de</strong> plaisir<br />
sexuel pour <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux partenaires, une idée essentielle pour<br />
la réalisation <strong>de</strong> relations sexuel<strong>les</strong> saines… » (Définition<br />
OMS 1975). Que pourrait-on en dire en 2008 ?<br />
En partenariat avec le CUPS (Centre Universitaire pour la<br />
Promotion <strong>de</strong> la Santé) <strong>de</strong>s Universités <strong>de</strong> Lille 1, Lille 2 et<br />
Lille 3.<br />
Avec l’ai<strong>de</strong> du Carrefour d’Initiative et <strong>de</strong> Réflexion pour <strong>les</strong><br />
Missions relatives à la vie affective et sexuelle (CIRM) et du<br />
Centre Régional d’Information et <strong>de</strong> Prévention du SIDA<br />
(CRIPS : http://www.cirm-crips.org).<br />
À noter :<br />
au programme / réflexion-débat / LNA#49<br />
Projet enseignant proposé par Jean-Pierre Macrez et l’équipe « Question <strong>de</strong> sens » (Université <strong>de</strong> Lille 1)<br />
JOURNéE D’étUDES<br />
Valeurs et enseignement <strong>de</strong>s valeurs<br />
Vous avez dit valeurs ?<br />
Faut-il enseigner <strong>les</strong> valeurs ?<br />
Samedi 14 mars 2009<br />
En partenariat avec l’ARELC<br />
(Association Religions - Laïcité - Citoyenneté )<br />
http://www.arelc.org<br />
43
LNA#49 / au programme / exposition<br />
44<br />
Les enjeux d’une politique patrimoniale universitaire<br />
La question du patrimoine universitaire<br />
est généralement oubliée et négligée<br />
<strong>de</strong>puis trop longtemps, ce qui ne<br />
pouvait que conduire à la défiance que<br />
l’on connaît d’une bonne partie <strong>de</strong>s universités<br />
françaises en matière <strong>de</strong> conservation<br />
et <strong>de</strong> valorisation <strong>de</strong> leur patrimoine.<br />
Aujourd’hui, on note une prise<br />
<strong>de</strong> conscience croissante <strong>de</strong> l’importance<br />
du patrimoine <strong>culture</strong>l et scientifique <strong>de</strong>s<br />
universités en ce qui concerne le patrimoine<br />
hérité et, dans une moindre<br />
mesure, le patrimoine en émergence.<br />
Si cette prise <strong>de</strong> conscience est nécessaire,<br />
le patrimoine <strong>culture</strong>l et scientifique<br />
<strong>de</strong>s universités reste une question<br />
dont personne ne nie l’importance mais<br />
que l’on classe souvent comme « non<br />
prioritaire ».<br />
Le sens <strong>de</strong> l’héritage<br />
Pourtant, <strong>les</strong> universitaires ont toujours<br />
fait jouer à ce patrimoine un rôle important<br />
dans la construction <strong>de</strong>s savoirs, <strong>de</strong>s<br />
connaissances et <strong>de</strong> la recherche.<br />
La conservation et la valorisation du<br />
patrimoine, c’est avant tout un acte <strong>de</strong><br />
partage et une appropriation <strong>de</strong> l’héritage.<br />
Et l’appropriation du passé s’avère<br />
nécessaire pour nous armer contre <strong>les</strong><br />
barbaries du présent. L’écrivain italien<br />
Giuseppe Pontiggia disait : « rendre<br />
flou le passé ne peut que dilater le vi<strong>de</strong><br />
du présent ».<br />
Paul Ricœur décrit le phénomène d’usure<br />
et d’érosion que l’unique civilisation<br />
mondiale exerce sur <strong>les</strong> gran<strong>de</strong>s civilisations<br />
du passé et « qui, entre autres effets<br />
inquiétants, se traduit par la diffusion sous<br />
nos yeux d’une civilisation <strong>de</strong> pacotille qui<br />
est la contrepartie dérisoire <strong>de</strong> ce que j’appelle<br />
la <strong>culture</strong> élémentaire » 1 . Cela vaut<br />
autant pour le patrimoine artistique que<br />
1 Paul Ricœur, Civilisation universelle et <strong>culture</strong>s<br />
nationa<strong>les</strong>, in Histoire et vérité, éd. du Seuil, 1967.<br />
Par Nabil EL-HAGGAR<br />
Vice-prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Université <strong>de</strong> Lille 1,<br />
chargé <strong>de</strong> la Culture, <strong>de</strong> la Communication et du Patrimoine Scientifique<br />
En collaboration avec Antoine MAtRION, Chargé <strong>de</strong> mission Patrimoine Scientifique<br />
pour l’héritage <strong>culture</strong>l et scientifique,<br />
matériel et immatériel <strong>de</strong>s universités.<br />
Toujours selon Paul Ricœur 2 : « C’est<br />
à partir d’une analyse subtile <strong>de</strong> l’expérience<br />
individuelle d’appartenir à un<br />
groupe, et sur la base <strong>de</strong> l’enseignement<br />
reçu <strong>de</strong>s autres, que la mémoire individuelle<br />
prend possession d’elle-même…<br />
Dans ce contexte, le témoignage n’est<br />
pas considéré en tant que proféré par<br />
quelqu’un en vue d’être recueilli par un<br />
autre, mais en tant que reçu par moi<br />
d’un autre à titre d’information sur le<br />
passé. À cet égard, <strong>les</strong> premiers souvenirs<br />
rencontrés sur ce chemin sont <strong>les</strong> souvenirs<br />
partagés, <strong>les</strong> souvenirs communs. Ils<br />
nous permettent d’affirmer ‘qu’en réalité<br />
nous ne sommes jamais seuls’ ».<br />
Musées et collections universitaires<br />
Le périmètre du patrimoine <strong>de</strong> l’université<br />
englobe <strong>de</strong>s champs multip<strong>les</strong>. Le<br />
patrimoine hérité, témoin du passé et<br />
constitutif <strong>de</strong> la mémoire collective, est<br />
appelé à jouer un rôle important dans la<br />
valorisation <strong>de</strong> la <strong>culture</strong> scientifique, <strong>de</strong><br />
passeur entre l’université et la Cité. Ce<br />
rôle est pleinement assumé par <strong>les</strong> musées<br />
universitaires en Europe et en Amérique<br />
du Nord. L’université française est<br />
un cas particulier : <strong>les</strong> musées n’existent<br />
quasiment pas ! La France construit ses<br />
musées <strong>de</strong>puis quatre sièc<strong>les</strong> hors <strong>de</strong><br />
l’université. Les Français n’ont pas pour<br />
habitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> se rendre à l’université pour<br />
visiter <strong>de</strong>s collections.<br />
Le patrimoine à l’université <strong>de</strong> Lille 1<br />
Le patrimoine matériel scientifique et<br />
technique <strong>de</strong> l’enseignement et <strong>de</strong> la recherche<br />
a été oublié ou perdu. Il n’a pas<br />
pu jouer son rôle <strong>de</strong> témoin <strong>de</strong> ce qui<br />
2 Paul Ricœur, De la mémoire et <strong>de</strong> la réminiscence,<br />
in La mémoire, l’Histoire, l’oubli, éd. Points Essais,<br />
2003.<br />
a été fait, créé et inventé à l’Université<br />
<strong>de</strong> Lille. Il n’a pas pu fournir non plus<br />
un support matériel pour la mémoire<br />
collective, ce qui est indispensable à sa<br />
constitution 3 .<br />
Nous pouvons distinguer trois types<br />
d’objets. Les objets à finalité pédagogique,<br />
<strong>les</strong> objets qui sont <strong>de</strong>s outils pour la<br />
recherche et, enfin, <strong>les</strong> objets qui sont <strong>les</strong><br />
résultats appliqués <strong>de</strong> la recherche. Certains<br />
objets, plus rares donc précieux, ont<br />
été conçus et construits au sein même <strong>de</strong><br />
l’Université. À une époque où l’industrie<br />
ne répondait pas encore totalement aux<br />
besoins <strong>de</strong>s chercheurs, ceux-ci <strong>de</strong>vaient<br />
construire eux-mêmes <strong>les</strong> instruments<br />
nécessaires à leurs recherches. Le laboratoire<br />
était aussi un atelier !<br />
Grâce au travail fait par l’Association <strong>de</strong><br />
Solidarité <strong>de</strong>s Anciens <strong>de</strong> Lille 1, et notamment<br />
par le professeur Guy Séguier,<br />
environ 500 objets ont pu être inventoriés<br />
4 . Ce travail a participé à instaurer la<br />
<strong>culture</strong> du patrimoine au sein <strong>de</strong> notre<br />
communauté universitaire.<br />
Afin d’en assurer la pérennité, il faudra<br />
associer à ce travail une démarche<br />
professionnelle que l’institution <strong>de</strong>vrait<br />
prendre en charge. En attendant, une<br />
collaboration est d’ores et déjà engagée<br />
avec la mission nationale du patrimoine<br />
scientifique contemporain du Musée <strong>de</strong>s<br />
Arts et Métiers 5 , qui permet <strong>de</strong> donner<br />
une visibilité à ce patrimoine et d’y intégrer<br />
<strong>les</strong> objets <strong>de</strong> toute époque. C’est dans<br />
ce cadre que l’Université a également<br />
pu intégrer un chargé <strong>de</strong> mission pour<br />
prendre en charge l’inventaire et la mise<br />
en valeur <strong>de</strong>s objets.<br />
3 Cf. Maurice Halbwachs, La Mémoire Collective,<br />
1950, p. 84 : « Mais chaque objet rencontré, et la<br />
place qu’il occupe dans l’ensemble, nous rappellent<br />
une manière d’être commune ».<br />
4 Cf. http://phymuse.univ-lille1.fr/<br />
5 Cf. http://www.patstec.fr
Carte du Bassin Houiller du Nord par Char<strong>les</strong> Barrois - Source : Lille et la région Nord en 1909, Lille, Imprimeur L. Danel, Tome 2, p. 176.<br />
Universi’terre<br />
Du 13 octobre au 28 novembre<br />
Vernissage le lundi 13 octobre à 18h30<br />
Entrée libre<br />
Lire la terre en ses formes premières, en son alphabet<br />
millénaire, en ses métamorphoses et ses empreintes.<br />
Lire l’histoire <strong>de</strong>s hommes qui ont, <strong>les</strong> premiers, déchiffré<br />
la terre, <strong>de</strong> la première chaire <strong>de</strong> géologie <strong>de</strong> la Faculté<br />
<strong>de</strong>s Sciences <strong>de</strong> Lille en 1864 jusqu’aux travaux <strong>les</strong> plus<br />
récents. Lire une région façonnée par sa terre, la richesse<br />
inouïe <strong>de</strong> son sous-sol. Lire l’histoire <strong>de</strong> la terre, l’histoire<br />
<strong>de</strong>s hommes <strong>de</strong> science, c’est lire l’histoire d’une région,<br />
l’histoire d’une aventure commune partagée par une science<br />
et par une région.<br />
À travers cartes, photographies, fossi<strong>les</strong>, objets personnels,<br />
l’exposition illustrera ce parcours. Du temps <strong>de</strong><br />
l’exploitation industrielle <strong>de</strong> la terre à celui <strong>de</strong> la préservation<br />
<strong>de</strong> l’environnement et du développement durable<br />
<strong>de</strong> la terre mère.<br />
Elle rendra hommage au premier titulaire <strong>de</strong> la chaire <strong>de</strong><br />
géologie <strong>de</strong> Lille, Ju<strong>les</strong> Gosselet, fondateur <strong>de</strong> la Société<br />
Géologique du Nord en 1871 et du musée qui porte son<br />
nom en 1902, ainsi qu’à son successeur, Char<strong>les</strong> Barrois.<br />
Char<strong>les</strong> Barrois fut fondateur du musée houiller à Lille en<br />
1907.<br />
« Vivre pour la science et par la science, comman<strong>de</strong>r aux océans<br />
et aux montagnes, tracer comme un Dieu leurs limites aux<br />
mers du passé et leur marche aux montagnes, <strong>les</strong> faire bondir<br />
et déferler <strong>de</strong>vant ses discip<strong>les</strong> au gré <strong>de</strong> ses théories, découper<br />
<strong>les</strong> frontières <strong>de</strong>s provinces naturel<strong>les</strong> sans effusion <strong>de</strong> sang, remonter<br />
par le raisonnement dans l’immensité <strong>de</strong>s temps incommensurés,<br />
s’ élever assez haut dans son rêve pour planer<br />
au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>s misères humaines, <strong>de</strong>scendre assez bas dans son<br />
vol pour voir et déceler tout ce que la terre renferme d’utile à<br />
l’homme dans ses flancs : tel est le <strong>de</strong>stin du géologue. »<br />
Char<strong>les</strong> Barrois<br />
La Bibliothèque Universitaire <strong>de</strong> Lille 1 présentera la<br />
riche collection d’ouvrages <strong>de</strong> la Société Géologique du<br />
Nord. Ces œuvres seront exposées pour la première fois et<br />
démontreront la richesse <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> géologie lilloise.<br />
au programme / exposition / LNA#49<br />
Dans le caDre De l’année InternatIonale De la Planète terre<br />
Portrait <strong>de</strong> Ju<strong>les</strong> Gosselet<br />
Structures tectoniques dans la carrière <strong>de</strong> Bettrechies, commune <strong>de</strong> Bellignies (59) Source : O.Averbuch<br />
45
LNA#49 / au programme / poésie sonore<br />
46<br />
Serge Pey, Michel Doneda, tetsuya Nakatani<br />
Jeudi 16 octobre à 19h<br />
Entrée gratuite sur réservation<br />
En partenariat avec le Crime<br />
Dans le cadre du festival « Les Voix Magnétiques »<br />
et du réseau Les Affinités Sono-Mécaniques.<br />
Nouveau troubadour du tour du mon<strong>de</strong>, sans cesse invité<br />
dans <strong>de</strong> nombreux festivals <strong>de</strong> performances en<br />
Europe, au Japon, aux États-Unis, en Asie, au Mexique, en<br />
Amérique du Sud…, Serge Pey est l’un <strong>de</strong>s performers <strong>les</strong><br />
plus importants sur la scène poétique actuelle. Créateur<br />
<strong>de</strong> situations, il rédige ses textes sur <strong>de</strong>s piquets <strong>de</strong> tomates<br />
ou sur <strong>de</strong>s bâtons avec <strong>les</strong>quels il réalise <strong>de</strong>s installations<br />
rituel<strong>les</strong> <strong>de</strong> poèmes.<br />
Fondateur du mouvement international <strong>de</strong>s poésies contemporaines<br />
<strong>de</strong> Toulouse, théoricien <strong>de</strong> la poésie contemporaine,<br />
auteur <strong>de</strong> nouvel<strong>les</strong> et <strong>de</strong> nombreuses critiques d’art, il<br />
mène un travail singulier dans la poésie d’aujourd’hui.<br />
Saxophone soprano, Michel Doneda est un artiste majeur<br />
<strong>de</strong> la scène improvisée européenne. Une vie semée<br />
<strong>de</strong> rencontres qui, d’Elvin Jones à John Zorn, <strong>de</strong> Daunik<br />
Lazro à Keith Rowe, a façonné sa voix unique et résolument<br />
contemporaine.<br />
Son style très personnel s’est nourri <strong>de</strong>s échanges tous azimuts<br />
dans <strong>de</strong>s champs artistiques très diversifiés, aussi bien<br />
en musique (musique traditionnelle, jazz, improvisation<br />
libre, rock expérimental) que dans d’autres domaines artistiques<br />
(théâtre, cinéma, littérature, poésie...).<br />
Né au Japon et vivant régulièrement aux États-Unis, Tetsuya<br />
Nakatani est un <strong>de</strong>s percussionnistes clés <strong>de</strong> la scène <strong>de</strong>s<br />
musiques improvisées outre-atlantique. Il utilise <strong>de</strong>s tambours,<br />
gongs, cymba<strong>les</strong>, cuvettes <strong>de</strong> chant et divers bâtons. Il<br />
travaille aussi pour la télévision, la danse et participe à tous <strong>les</strong><br />
genres musicaux (free jazz, rock, improvisation).<br />
Sa musique, bien que défiant tout classement en genre ou<br />
catégorie, est cependant influencée par différentes <strong>culture</strong>s :<br />
aussi bien <strong>les</strong> musiques improvisées, la musique dite expérimentale,<br />
le jazz et le free jazz ou encore le rock. Liberté dans le<br />
développement <strong>de</strong> ses idées et précision <strong>de</strong> frappe redoutable,<br />
tel<strong>les</strong> pourraient être <strong>les</strong> caractéristiques <strong>de</strong> son approche <strong>de</strong>s<br />
percussions.<br />
Trois artistes d’envergure, marqués par une vie semée <strong>de</strong> rencontres,<br />
par une ouverture à la transversalité, à la diversité, qui<br />
offriront, sans aucun doute, au public une soirée inoubliable.
Char<strong>les</strong> Pennequin, Jean-François Pauvros<br />
Mercredi 22 octobre à 19h<br />
Entrée gratuite sur réservation<br />
En partenariat avec le Crime<br />
Dans le cadre du festival « Les Voix Magnétiques »<br />
et du réseau Les Affinités Sono-Mécaniques.<br />
Char<strong>les</strong> Pennequin découvrit simultanément l’écriture<br />
<strong>de</strong> la poésie et l’art <strong>de</strong> la pilonner. Remarquable lecteur<br />
<strong>de</strong> ses textes, il apparaît comme l’un <strong>de</strong>s meilleurs<br />
poètes <strong>de</strong> la nouvelle génération, l’un <strong>de</strong>s plus attachants<br />
en tout cas. L’un <strong>de</strong>s plus généreux également, capable d’un<br />
réel et rare intérêt pour <strong>les</strong> livres <strong>de</strong>s autres, aînés ou pairs.<br />
Il bouscule par la violence <strong>de</strong> sa poésie. Son rythme, sa rapidité,<br />
sa ponctuation rapi<strong>de</strong> et le travail <strong>de</strong> langue, en apnée,<br />
hypnotique, vont s’imposer auprès <strong>de</strong> nombreux auditeurs<br />
lors <strong>de</strong> ses lectures. Au niveau éditorial, cela le conduira à publier<br />
à partir <strong>de</strong> 2002, chez un éditeur d’envergure nationale,<br />
POL, qui, en parallèle <strong>de</strong> livres plus accessib<strong>les</strong>, a toujours<br />
défendu la littérature expérimentale ou d’avant-gar<strong>de</strong>.<br />
Depuis 2004, il a commencé à travailler l’improvisation à<br />
partir <strong>de</strong> l’usage <strong>de</strong> dictaphones, qu’il enregistre en direct,<br />
puis qu’il rediffuse. La question <strong>de</strong> l’improvisation correspond<br />
chez lui à la question même du langage, à sa donation,<br />
à son enchaînement.<br />
Ce travail d’improvisation l’a amené à faire <strong>de</strong>s lectures-performances<br />
avec le guitariste compositeur Jean-François<br />
au programme / poésie sonore / LNA#49<br />
Pauvros qui, lui, promène <strong>de</strong>puis trente ans sa silhouette<br />
dégingandée <strong>de</strong> funambule noma<strong>de</strong> sur <strong>les</strong> sentiers escarpés<br />
<strong>de</strong>s musiques <strong>de</strong> traverse. Son acharnement à extirper toutes<br />
sortes <strong>de</strong> sons inouïs <strong>de</strong> ses cor<strong>de</strong>s lui forge un instrument<br />
hybri<strong>de</strong> à mi-chemin entre le violoncelle et la cithare ethnique<br />
électrifiée, propice à toutes <strong>les</strong> aventures sonores.<br />
Jean-François Pauvros a aussi composé et interprété <strong>de</strong><br />
nombreuses musiques <strong>de</strong> films, courts-métrages, reportages,<br />
fictions.<br />
C’est aussi un amoureux <strong>de</strong>s mots et <strong>de</strong> la littérature,<br />
comme en témoignent ses morceaux basés sur <strong>de</strong>s textes <strong>de</strong><br />
Pierre Mc Orlan ou Pasolini, ou ses collaborations fréquentes<br />
avec <strong>de</strong>s poètes contemporains.<br />
Jean-François Pauvros - Char<strong>les</strong> Pennequin : un duo explosif,<br />
une rencontre majeure et atypique, une alchimie <strong>de</strong> l’improvisation<br />
en duo.<br />
Expositions, installations et concerts du 10 au 26 octobre<br />
au Tri Postal, à la Malterie et à l’<strong>Espace</strong> Culture. Jusque fin<br />
novembre dans divers lieux <strong>de</strong> la métropole.<br />
47
LNA#49 / au programme / masarat-pa<strong>les</strong>tine 2008<br />
48<br />
Saison artistique et <strong>culture</strong>lle en Communauté française wallonie-Bruxel<strong>les</strong>, à l’initiative du Commissariat Général aux<br />
Relations Internationa<strong>les</strong> et <strong>de</strong> la Délégation Générale <strong>de</strong> la Pa<strong>les</strong>tine auprès <strong>de</strong> l’union européenne, <strong>de</strong> la Belgique et<br />
du Luxembourg, sous le haut patronage <strong>de</strong> la Ministre <strong>de</strong>s Relations Internationa<strong>les</strong> <strong>de</strong> la Communauté française et <strong>de</strong><br />
Mahmoud Darwish, avec le soutien <strong>de</strong> la Ministre <strong>de</strong> la Culture.<br />
Conception et réalisation : Les Hal<strong>les</strong><br />
Terre <strong>de</strong> l’exil, territoire <strong>de</strong> la<br />
guerre, du sang et <strong>de</strong>s larmes, la<br />
Pa<strong>les</strong>tine peut-elle <strong>de</strong>venir le lieu <strong>de</strong><br />
la plus haute forme du dialogue <strong>de</strong>s<br />
<strong>culture</strong>s ? Le projet MASARAT, mis<br />
en place par la Communauté Française<br />
<strong>de</strong> Belgique, en témoigne au<br />
moment même où l’union européenne<br />
décrète 2008 l’année du dialogue<br />
inter<strong>culture</strong>l.<br />
Le désir <strong>de</strong> dialogue peut-il être plus<br />
fort que la haine et la mort ? Le désir<br />
<strong>de</strong> vivre, <strong>de</strong> surmonter <strong>les</strong> enfermements,<br />
<strong>les</strong> murail<strong>les</strong>, l’exclusion peutil<br />
être plus puissant que la violence et<br />
la loi du plus fort ? Lorsque surgissent<br />
ces images, lorsque se déplacent<br />
<strong>les</strong> paro<strong>les</strong> <strong>de</strong> théâtre et <strong>les</strong> sons <strong>de</strong><br />
la résistance d’un peuple banni, au<strong>de</strong>ssus<br />
<strong>de</strong>s villages bouclés, <strong>de</strong>s vil<strong>les</strong><br />
verrouillées, ne peut-on comprendre<br />
qu’en ces terres se noue une certaine<br />
<strong>de</strong>stinée <strong>de</strong> l’humanité, un enjeu déterminant<br />
pour le temps que nous<br />
traversons, la <strong>culture</strong> que nous partageons<br />
? Ou bien cé<strong>de</strong>r à la mortelle désolation<br />
d’une guerre <strong>de</strong> civilisation,<br />
d’une chaotique régression, où toujours,<br />
avec obstination, parcourir <strong>les</strong><br />
voies d’une appréhension plus libre et<br />
plus fraternelle, du village mon<strong>de</strong> que<br />
nous habitons très provisoirement.<br />
thÉâtRE<br />
Une mémoire pour l’oubli<br />
Lundi 20 octobre à 19h<br />
Entrée libre sur réservation préalable<br />
D’après le texte <strong>de</strong> Mahmoud Darwish<br />
Par la Compagnie El-Hakawati<br />
Mise en scène : Amer Khalil et François<br />
Abou Salem<br />
François Abou Salem - Droits Réservés<br />
Scénographie : Amir Nizar Zuabi<br />
Avec : François Abou Salem<br />
Coproduction : El-Hakawati avec le soutien<br />
du Centre Culturel Français <strong>de</strong> Jérusalem et<br />
la Fondation A. M. Quattan à Ramallah<br />
Durée : 1h<br />
Août 1982, <strong>les</strong><br />
troupes israéliennes<br />
envahissent<br />
le Liban et assiègent<br />
Beyrouth.<br />
La résistance<br />
pa<strong>les</strong>tinienne a<br />
fait <strong>de</strong> la ville<br />
son quartier général<br />
et essaie<br />
<strong>de</strong> tenir bon. Dans cette ambiance <strong>de</strong><br />
folie meurtrière, un poète, exilé <strong>de</strong><br />
la Pa<strong>les</strong>tine et habitant son huitième<br />
étage, écrit la chronique d’une ville livrée<br />
aux jeux <strong>de</strong> l’amour et <strong>de</strong> la mort.<br />
Considéré comme l’un <strong>de</strong>s chefs <strong>de</strong><br />
file <strong>de</strong> la poésie arabe contemporaine,<br />
Mahmoud Darwish révèle un aspect<br />
moins connu <strong>de</strong> son œuvre. À l’heure<br />
où s’ouvre un nouveau chapitre <strong>de</strong><br />
l’histoire pa<strong>les</strong>tinienne, le texte prend<br />
une nouvelle et singulière résonance.<br />
Interprète et metteur en scène <strong>de</strong> ce<br />
spectacle, créé en avril 2007 à Ramallah<br />
dans <strong>les</strong> territoires occupés, François<br />
Abou Salem porte en funambule<br />
un texte qui mêle <strong>les</strong> fils inextricab<strong>les</strong><br />
<strong>de</strong> l’individu, la lour<strong>de</strong>ur du quotidien<br />
et <strong>les</strong> douleurs d’une nation.<br />
François Abou Salem, <strong>de</strong> père pa<strong>les</strong>tinien<br />
et <strong>de</strong> mère française, auteur, metteur en<br />
scène, comédien, est l’un <strong>de</strong>s créateurs<br />
<strong>de</strong> la compagnie et du théâtre El-Hakawati,<br />
figure incontournable et presque<br />
solitaire du théâtre pa<strong>les</strong>tinien.<br />
MUsiQUE<br />
Groupe Watar<br />
Lundi 27 octobre à 19h<br />
Entrée libre sur réservation préalable<br />
Directeur Artistique : Wassim O<strong>de</strong>h<br />
Violon : Sroor Saliba<br />
Quanun : Mahran Mir’b<br />
Percussions : Raed Said<br />
Bouzouq : T.B.C.<br />
Le mot Watar<br />
désigne <strong>les</strong> cor<strong>de</strong>s.<br />
Un fil tendu<br />
sur une table<br />
d’harmonie d’un<br />
instrument <strong>de</strong><br />
musique. Le fil<br />
joint <strong>les</strong> musiciens<br />
<strong>de</strong> Pa<strong>les</strong>tine<br />
à ceux d’Europe,<br />
la musique classique à la musique orientale<br />
comme vibration singulière, comme<br />
tentative harmonique d’un temps et<br />
d’un espace disharmonique !<br />
Exposition<br />
Naji Al Ali<br />
Du 20 octobre au 28 novembre<br />
Entrée libre<br />
Naji Al Ali, caricaturiste pa<strong>les</strong>tinien<br />
assassiné à Londres en 1987, a produit<br />
<strong>de</strong>s milliers <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssins qui expriment<br />
la lutte et la résistance à l’occupation<br />
israélienne et critiquent <strong>les</strong> régimes<br />
arabes.<br />
Hanthala, son personnage, petit garçon<br />
<strong>de</strong> dix ans, l’âge qu’avait Naji<br />
lorsqu’il a quitté la Pa<strong>les</strong>tine, est situé<br />
dans l’espace, sans terrain d’appui car<br />
il est sans patrie. Il est témoin <strong>de</strong> la<br />
Groupe Watar - Droits Réservés
tragédie <strong>de</strong> tout un peuple, il tourne<br />
le dos au public car il se sent trahi.<br />
Naji dit <strong>de</strong> Hanthala : « Hanthala est<br />
le témoin <strong>de</strong> cette ère qui ne mourra<br />
jamais, il pénètre la vie avec une force<br />
qui ne le quitte jamais, une légen<strong>de</strong><br />
dont l’existence est un défi à l’éternité.<br />
Ce personnage que j’ai créé ne<br />
disparaîtra pas après moi. »<br />
Production : Centre Wallonie Bruxel<strong>les</strong>.<br />
Avec l’ai<strong>de</strong> du Commissariat Général aux<br />
Relations Internationa<strong>les</strong> <strong>de</strong> la Communauté<br />
française <strong>de</strong> Belgique (CGRI).<br />
ARts visUELs<br />
Mardi 21 octobre à 13h<br />
Entrée libre<br />
Pa<strong>les</strong>tine, été 2006<br />
13 courts-métrages <strong>de</strong> cinéastes pa<strong>les</strong>tiniens<br />
Vidéo, durée : 26 mn<br />
L’été <strong>de</strong> la guerre au Liban, en 2006,<br />
chaque cinéaste vivant en Pa<strong>les</strong>tine a<br />
été invité à tourner un film <strong>de</strong> 3 minutes<br />
avec pour seule contrainte : un<br />
plan-séquence, donc une seule prise<br />
effectuée dans une linéarité spatiotemporelle,<br />
sans aucune intervention<br />
<strong>de</strong> montage. Tous <strong>les</strong> films, montés<br />
bout à bout, composent une radiographie<br />
à multip<strong>les</strong> facettes <strong>de</strong> la Pa<strong>les</strong>tine<br />
vivante.<br />
Films <strong>de</strong> Akram Al Ashkar, Rowan<br />
Al Faqih, Amer Shomali, Riyad<br />
Deis, Ahmad Habash, Ismail Habbash,<br />
Annemarie Jacir, Liana Ba<strong>de</strong>r,<br />
May O<strong>de</strong>h, Mohanad Yaqubi, Enas<br />
Muthaffar, Razi Najjar, Nahed<br />
Awwad.<br />
Mercredi 22 octobre à 13h<br />
Entrée libre<br />
Une journée<br />
<strong>de</strong> Lamia Joreige<br />
(2006, 41 mn)<br />
Ce film trace le parcours <strong>de</strong> la<br />
grand-mère <strong>de</strong> l’auteur, dont<br />
la trajectoire personnelle se<br />
mêle à l’histoire collective<br />
au Proche-Orient. L’auteur<br />
amorce une réflexion sur<br />
l’histoire et <strong>les</strong> conflits <strong>de</strong><br />
cette région, sur le temps, la disparition<br />
et la perte. Elle interroge sa mère<br />
et sa grand-mère, soulevant aussi <strong>de</strong>s<br />
questions sur son propre engagement<br />
politique et révélant le lien complexe<br />
entre trois femmes <strong>de</strong> trois générations<br />
différentes.<br />
Jours tranquil<strong>les</strong> en Pa<strong>les</strong>tine<br />
<strong>de</strong> Fouad El Khoury (1998, 13 mn)<br />
De la Pa<strong>les</strong>tine, nous ne connaissons<br />
que la violence et la souffrance. Ce film<br />
nous raconte une autre histoire, celle <strong>de</strong>s<br />
habitants <strong>de</strong> la société pré-israélienne vivant<br />
paisiblement sur leur terre.<br />
Jeudi 23 octobre à 13h<br />
Entrée libre<br />
Les enfants d’Arna <strong>de</strong> Juliano Mer<br />
Khamis (2003, 84 min)<br />
Arna Mer Khamis, une femme juive<br />
qui s’était battue pour le fon<strong>de</strong>ment<br />
d’Israël, met en place une troupe <strong>de</strong><br />
théâtre dans le camp <strong>de</strong> réfugiés <strong>de</strong><br />
Jénine, dans lequel elle apprend à <strong>de</strong>s<br />
enfants pa<strong>les</strong>tiniens à s’exprimer grâce<br />
à l’art. De 1989 à 1996, le fils d’Arna,<br />
Juliano, a filmé ces enfants pendant<br />
leurs répétitions. Après l’attaque du<br />
Avec le soutien <strong>de</strong> l'association France Solidarité Pa<strong>les</strong>tine - Villeneuve d'Ascq, Roubaix.<br />
au programme / masarat-pa<strong>les</strong>tine 2008 / LNA#49<br />
camp par Israël en 2002, Juliano retourne<br />
voir ce que sont <strong>de</strong>venus ces<br />
jeunes acteurs si prometteurs que lui<br />
et sa mère avaient encadrés.<br />
Du 20 au 28 octobre<br />
Entrée libre<br />
The Road Map<br />
Installation vidéo : Collectif Multiplicity<br />
« Munis <strong>de</strong> nos passeports européens,<br />
afin <strong>de</strong> mesurer la <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong>s dispositifs<br />
frontaliers dans <strong>les</strong> environs <strong>de</strong> Jérusalem,<br />
nous avons roulé, le 13 janvier,<br />
accompagnés d’une personne titulaire<br />
d’un passeport israélien, <strong>de</strong>puis la colonie<br />
<strong>de</strong> Kiriat Arba vers la colonie <strong>de</strong><br />
Kudmin. Le jour d’après, nous avons<br />
fait le voyage <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Hébron à<br />
celle <strong>de</strong> Naplouse avec une personne<br />
détentrice d’un passeport pa<strong>les</strong>tinien.<br />
Pour relier <strong>les</strong> <strong>de</strong>ux latitu<strong>de</strong>s, il a fallu<br />
une heure au voyageur israélien, tandis<br />
que le voyageur pa<strong>les</strong>tinien a pris cinq<br />
heures et <strong>de</strong>mie. »<br />
Sandi Hilal et A<strong>les</strong>sandro Petti<br />
Multiplicity : Stefano Boeri, Maddalena<br />
Bregani, Maki Gherzi, Matteo Ghidoni,<br />
Sandi Hilal, A<strong>les</strong>sandro Petti, Salvatore<br />
Porcaro, Anniina Koivu, Francesca Recchia,<br />
Eduardo Staszowsky.<br />
Production : Festival TEMPS D’IMAGES<br />
2007/Les Hal<strong>les</strong>. Dans le cadre <strong>de</strong> MA-<br />
SARAT/Pa<strong>les</strong>tine 2008. Avec l’ai<strong>de</strong> du<br />
Commissariat Général aux Relations Internationa<strong>les</strong><br />
<strong>de</strong> la Communauté française<br />
<strong>de</strong> Belgique (CGRI).<br />
© Naji Al Ali<br />
Road Map © Collectif Multiplicity<br />
49
LNA#49 / au programme<br />
50<br />
La lunette <strong>de</strong> l’Observatoire <strong>de</strong> Lille va bientôt fêter<br />
ses 100 ans : <strong>les</strong> membres <strong>de</strong> l’Association Jonckhèere et<br />
le Laboratoire d’Astronomie <strong>de</strong> Lille vous invitent à découvrir<br />
cet instrument et son histoire en participant à une<br />
visite nocturne inédite <strong>de</strong> l’Observatoire <strong>de</strong> Lille.<br />
Au programme <strong>de</strong> la soirée (1h30 à 2h <strong>de</strong> visite) : miniconférence,<br />
visite d’exposition, découverte <strong>de</strong> la lunette<br />
et, selon <strong>les</strong> conditions météorologiques, observation<br />
du Premier Quartier <strong>de</strong> la Lune et survol visuel <strong>de</strong> ses<br />
reliefs et <strong>de</strong> ses cratères.<br />
Les mardi 7 octobre, vendredi 7 novembre, vendredi 5<br />
décembre, mardi 6 janvier, mardi 3 février, vendredi 6<br />
mars, vendredi 3 avril et vendredi 1 er mai : ren<strong>de</strong>z-vous<br />
à l’Observatoire <strong>de</strong> Lille dès 20h.<br />
Réservation obligatoire auprès <strong>de</strong> l’<strong>Espace</strong> Culture<br />
(20 personnes maximum) : 03 20 43 69 09<br />
Pour tout public à partir <strong>de</strong> 10 ans<br />
3 ème Valse <strong>de</strong>s Livres<br />
Mercredi 26 novembre <strong>de</strong> 10h à 17h<br />
Entrée libre<br />
Le jeu d’échange <strong>de</strong> livres vaut largement le déplacement. Vous donnez <strong>de</strong>s livres, désirez <strong>de</strong>s<br />
livres, vous recevez <strong>de</strong>s livres.<br />
Entre le désir d’un livre et sa possession, il n’y a qu’un mouvement du poignet, pour s’en saisir<br />
gratuitement, pas <strong>de</strong> caisse, pas <strong>de</strong> file d’attente, pas <strong>de</strong> carte bancaire.<br />
Vous n’avez qu’une seule journée pour satisfaire votre désir <strong>de</strong> lire, c’est le 26 novembre au café <strong>de</strong><br />
l’<strong>Espace</strong> Culture.<br />
Dépôt possible à partir du lundi 17 novembre.<br />
Renseignements : 03 20 43 69 09<br />
Les soirées du Premier Quartier<br />
Association Jonckhèere<br />
Les Amis <strong>de</strong> l’Observatoire <strong>de</strong> Lille<br />
Observatoire <strong>de</strong> Lille<br />
1, Impasse <strong>de</strong> l’Observatoire 59000 LILLE<br />
http://asso.jonckheere.free.fr/
Atelier Danse Butô<br />
Danser <strong>les</strong> ténèbres, sens premier <strong>de</strong> l’Ankoka Butô.<br />
Danser l’érotisme, la mort. Danser le temps. Déchirer<br />
<strong>les</strong> traditions figées, inventer ce pop-butô, ce mouvement<br />
du corps, ce mouvement <strong>de</strong> l’esprit, qui engage le regard<br />
féminin sur lui-même, qui engage son propre corps dans<br />
l’infini mouvement <strong>de</strong> l’improvisation.<br />
Dans le butô, un danseur ne dira jamais « je danse », mais<br />
« le corps danse ». Le corps à distance se métamorphose, se<br />
libère, <strong>de</strong>vient le pôle rayonnant <strong>de</strong> l’imagination, <strong>de</strong> l’énergie<br />
créatrice.<br />
Les danseuses <strong>de</strong> Hanaarashi enten<strong>de</strong>nt créer leur propre<br />
style en explorant leur propre corps. El<strong>les</strong> ne s’arrêtent pas à<br />
la danse, el<strong>les</strong> écrivent, créent <strong>de</strong>s installations, chantent…<br />
L’atelier proposé par l’<strong>Espace</strong> Culture <strong>de</strong> Lille 1 du 15<br />
au 17 décembre, vous invite, avec le groupe Hanaarashi, à<br />
pénétrer au cœur intime du mouvement, dans un parcours<br />
sensible, dont vous serez à la fois la source et le témoin <strong>de</strong> ce<br />
jaillissement créateur.<br />
Chikako Bando est née à Kyoto en 1967. Elle entame une<br />
carrière d’actrice et auteur, puis débute l’apprentissage du butô<br />
au programme / atelier / LNA#49<br />
Lundi 15, mardi 16, mercredi 17 décembre à 18h30<br />
Gratuit sur inscription à l’<strong>Espace</strong> Culture<br />
Compagnie Hanaarashi<br />
Avec<br />
Chikako Bando, chorégraphe et danseuse<br />
Yumiko Nii, chorégraphe et danseuse<br />
On Furukawa, chorégraphe et danseuse<br />
en 1993. Elle fon<strong>de</strong> Hanaarashi en 1998, On Furukawa et<br />
Yumiko Nii, œuvrant dans le groupe comme chorégraphe et<br />
danseuse. Elle crée un style unique, mêlant danse et théâtre, tel<br />
son personnage emblématique, la shaman Itako.<br />
Yumiko Nii, née à Hiroshima, est diplômée <strong>de</strong> l’Université<br />
d’Enseignement, section Beaux-Arts, d’Osaka. Sa spécialité est<br />
la sculpture et la création d’œuvres en mousse <strong>de</strong> polystyrène.<br />
Elle chante avec plusieurs formations et abor<strong>de</strong>, en 1993, le<br />
travail du corps à travers <strong>les</strong> métho<strong>de</strong>s fondamenta<strong>les</strong> <strong>de</strong> la<br />
danse mo<strong>de</strong>rne, du butô et du shintaidô. Elle intègre Hanaarashi<br />
en 1998.<br />
On Furukawa, née à Kyoto, est diplômée <strong>de</strong> sociologie. Peu<br />
intéressée par la société qui l’entoure, elle s’initie au butô. Elle<br />
pense que, si elle n’avait pas étudié la danse, elle serait <strong>de</strong>venue<br />
l’un <strong>de</strong> ces nombreux jeunes Japonais qui s’enferment dans leur<br />
chambre.<br />
Cet atelier a lieu à l’occasion du colloque <strong>de</strong> la Société française<br />
<strong>de</strong>s Étu<strong>de</strong>s Japonaises qui se tient à l’Université <strong>de</strong> Lille 3<br />
et dont la thématique porte sur la mo<strong>de</strong>rnité japonaise en<br />
perspective. Il coïnci<strong>de</strong> avec la fin <strong>de</strong>s célébrations du 150 ème<br />
anniversaire <strong>de</strong>s relations amica<strong>les</strong> franco-japonaises.<br />
51
g e n d a<br />
*Pour ce spectacle, le nombre <strong>de</strong> places étant limité, il est nécessaire <strong>de</strong> retirer préalablement vos entrées libres à l’<strong>Espace</strong> Culture (disponib<strong>les</strong> un mois avant <strong>les</strong> manifestations).<br />
Octobre, novembre, décembre 2008<br />
A<br />
Retrouvez le détail <strong>de</strong>s manifestations sur notre site : www.univ-lille1.fr/<strong>culture</strong> ou dans « l’in_edit » en pages<br />
centra<strong>les</strong>. L’ ensemble <strong>de</strong>s manifestations se déroulera à l’<strong>Espace</strong> Culture <strong>de</strong> l’université <strong>de</strong> Lille 1.<br />
Les 7, 14 et 21 octobre 14h30 Conférences <strong>de</strong> l’UTL<br />
Mardi 7 octobre 18h Ouverture <strong>de</strong> saison : Présentation <strong>de</strong>s ateliers <strong>de</strong> pratiques artistiques<br />
19h : Danse - 20h : Concert<br />
Du 13 octobre au 28 novembre Exposition « Universi’terre » dans le cadre <strong>de</strong> l’Année Internationale <strong>de</strong> la Planète Terre<br />
Vernissage le 13 octobre à 18h30<br />
Mardi 14 octobre 18h30 Ren<strong>de</strong>z-vous d’Archimè<strong>de</strong> : Cycle « À propos <strong>de</strong> la science »<br />
« Temps <strong>de</strong> la terre, temps <strong>de</strong> l’homme » par Patrick De Wever<br />
Jeudi 16 octobre 19h Poésie sonore : Serge Pey - Michel Doneda - Tetsuya Nakatani *<br />
Du 20 au 28 octobre Installation vidéo « The road map » - Collectif Multiplicity<br />
dans le cadre <strong>de</strong> Masarat-Pa<strong>les</strong>tine 2008<br />
Du 20 octobre au 28 novembre Exposition <strong>de</strong> Naji Al Ali dans le cadre <strong>de</strong> Masarat-Pa<strong>les</strong>tine 2008<br />
Lundi 20 octobre 19h Théâtre : « Une mémoire pour l’oubli » par la Cie El-Hakawati<br />
dans le cadre <strong>de</strong> Masarat-Pa<strong>les</strong>tine 2008 *<br />
Mardi 21 octobre 13h Vidéo « Pa<strong>les</strong>tine, été 2006 » dans le cadre <strong>de</strong> Masarat-Pa<strong>les</strong>tine 2008<br />
18h30 Ren<strong>de</strong>z-vous d’Archimè<strong>de</strong> : Cycle « L’espace » « L’espace : <strong>de</strong>s axiomes réels » par François Wahl<br />
Mercredi 22 octobre 13h Films « Une journée » et « Jours tranquil<strong>les</strong> en Pa<strong>les</strong>tine »<br />
dans le cadre <strong>de</strong> Masarat-Pa<strong>les</strong>tine 2008<br />
19h Poésie sonore : Char<strong>les</strong> pennequin - Jean-François Pauvros *<br />
Jeudi 23 octobre 13h Film « Les enfants d’Arna » dans le cadre <strong>de</strong> Masarat-Pa<strong>les</strong>tine 2008<br />
Lundi 27 octobre 19h Concert : Groupe Watar dans le cadre <strong>de</strong> Masarat-Pa<strong>les</strong>tine 2008 *<br />
Jeudi 13 novembre 18h30 Question <strong>de</strong> sens : Cycle « Chemins d’humanisation »<br />
« Droits <strong>de</strong> l’homme et immigrations » par Emmanuel Terray<br />
Les 18 et 25 novembre 14h30 Conférences <strong>de</strong> l’UTL<br />
Mardi 18 novembre 18h30 Ren<strong>de</strong>z-vous d’Archimè<strong>de</strong> : Cycle « L’espace »<br />
« La genèse <strong>de</strong> l’espace chez l’enfant » par Gérard Vergnaud<br />
Lundi 24 novembre 17h Présentation <strong>de</strong> l’ouvrage « La laïcité, ce précieux concept » (Furet - Lille)<br />
Collection Les Ren<strong>de</strong>z-vous d’Archimè<strong>de</strong><br />
Mardi 25 novembre 18h30 Ren<strong>de</strong>z-vous d’Archimè<strong>de</strong> / Vidéoconférence : Cycle « À propos <strong>de</strong> la science »<br />
« Les ressources énergétiques et minéra<strong>les</strong> en France, en Europe et dans le mon<strong>de</strong> »<br />
par Pierre Andrieux<br />
Mercredi 26 nov. <strong>de</strong> 10h à 17h 3 ème Valse <strong>de</strong>s livres<br />
Les 2, 9 et 16 décembre 14h30 Conférences <strong>de</strong> l’UTL<br />
Mardi 2 décembre 18h30 Ren<strong>de</strong>z-vous d’Archimè<strong>de</strong> : Cycle « La guerre »<br />
« Les métamorphoses <strong>de</strong> la guerre » par Pierre Hassner<br />
Jeudi 4 décembre 18h30 Question <strong>de</strong> sens : Cycle « Chemins d’humanisation » « Sexualité, terre<br />
d’aventure et <strong>de</strong> rencontre » avec Nadia Flicourt et Isabel De Penanster<br />
Mardi 9 décembre 18h30 Ren<strong>de</strong>z-vous d’Archimè<strong>de</strong> : Cycle « L’espace » « De la perspective à la<br />
construction <strong>de</strong> l’espace » par Jean-Pierre Le Goff<br />
Les 15, 16, 17 décembre 18h30 Atelier danse Butô - Cie Hanaarashi<br />
Mardi 16 décembre 18h30 Ren<strong>de</strong>z-vous d’Archimè<strong>de</strong> : Cycle « À propos <strong>de</strong> la science »<br />
« Le géosystème et la prose, vous connaissez ? » par Francis Meilliez<br />
<strong>Espace</strong> Culture - Cité Scientifique 59655 Villeneuve d’Ascq<br />
Du lundi au jeudi <strong>de</strong> 11h à 18h et le vendredi <strong>de</strong> 10h à 13h45<br />
Tél : 03 20 43 69 09 - Fax : 03 20 43 69 59<br />
www.univ-lille1.fr/<strong>culture</strong> - Mail : ustl-cult@univ-lille1.fr