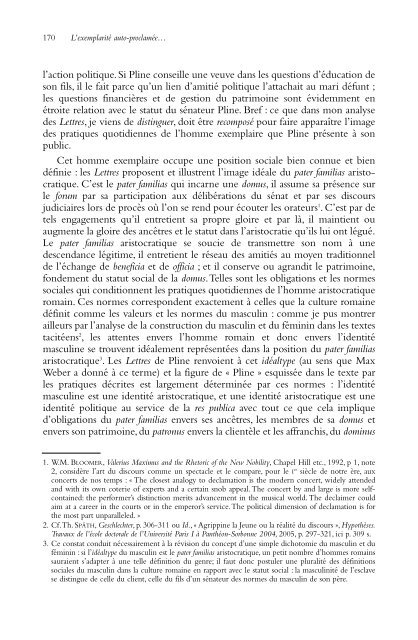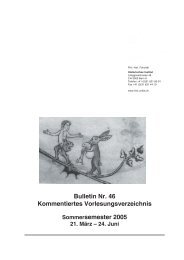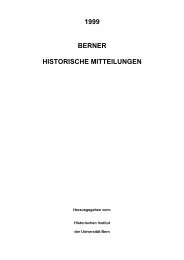p. 5 Ã p.8 - copie - Historisches Institut
p. 5 Ã p.8 - copie - Historisches Institut
p. 5 Ã p.8 - copie - Historisches Institut
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
170 L’exemplarité auto-proclamée…<br />
l’action politique. Si Pline conseille une veuve dans les questions d’éducation de<br />
son fils, il le fait parce qu’un lien d’amitié politique l’attachait au mari défunt ;<br />
les questions financières et de gestion du patrimoine sont évidemment en<br />
étroite relation avec le statut du sénateur Pline. Bref : ce que dans mon analyse<br />
des Lettres, je viens de distinguer, doit être recomposé pour faire apparaître l’image<br />
des pratiques quotidiennes de l’homme exemplaire que Pline présente à son<br />
public.<br />
Cet homme exemplaire occupe une position sociale bien connue et bien<br />
définie : les Lettres proposent et illustrent l’image idéale du pater familias aristocratique.<br />
C’est le pater familias qui incarne une domus, il assume sa présence sur<br />
le forum par sa participation aux délibérations du sénat et par ses discours<br />
judiciaires lors de procès où l’on se rend pour écouter les orateurs 1 . C’est par de<br />
tels engagements qu’il entretient sa propre gloire et par là, il maintient ou<br />
augmente la gloire des ancêtres et le statut dans l’aristocratie qu’ils lui ont légué.<br />
Le pater familias aristocratique se soucie de transmettre son nom à une<br />
descendance légitime, il entretient le réseau des amitiés au moyen traditionnel<br />
de l’échange de beneficia et de officia ; et il conserve ou agrandit le patrimoine,<br />
fondement du statut social de la domus.Telles sont les obligations et les normes<br />
sociales qui conditionnent les pratiques quotidiennes de l’homme aristocratique<br />
romain. Ces normes correspondent exactement à celles que la culture romaine<br />
définit comme les valeurs et les normes du masculin : comme je pus montrer<br />
ailleurs par l’analyse de la construction du masculin et du féminin dans les textes<br />
tacitéens 2 , les attentes envers l’homme romain et donc envers l’identité<br />
masculine se trouvent idéalement représentées dans la position du pater familias<br />
aristocratique 3 . Les Lettres de Pline renvoient à cet idéaltype (au sens que Max<br />
Weber a donné à ce terme) et la figure de « Pline » esquissée dans le texte par<br />
les pratiques décrites est largement déterminée par ces normes : l’identité<br />
masculine est une identité aristocratique, et une identité aristocratique est une<br />
identité politique au service de la res publica avec tout ce que cela implique<br />
d’obligations du pater familias envers ses ancêtres, les membres de sa domus et<br />
envers son patrimoine, du patronus envers la clientèle et les affranchis, du dominus<br />
1. W.M. BLOOMER, Valerius Maximus and the Rhetoric of the New Nobility, Chapel Hill etc., 1992, p 1, note<br />
2, considère l’art du discours comme un spectacle et le compare, pour le I er siècle de notre ère, aux<br />
concerts de nos temps : « The closest analogy to declamation is the modern concert, widely attended<br />
and with its own coterie of experts and a certain snob appeal. The concert by and large is more selfcontained:<br />
the performer’s distinction merits advancement in the musical world. The declaimer could<br />
aim at a career in the courts or in the emperor’s service.The political dimension of declamation is for<br />
the most part unparalleled. »<br />
2. Cf.Th. SPÄTH, Geschlechter, p. 306-311 ou Id., « Agrippine la Jeune ou la réalité du discours », Hypothèses.<br />
Travaux de l’école doctorale de l’Université Paris I à Panthéon-Sorbonne 2004, 2005, p. 297-321, ici p. 309 s.<br />
3. Ce constat conduit nécessairement à la révision du concept d’une simple dichotomie du masculin et du<br />
féminin : si l’idéaltype du masculin est le pater familias aristocratique, un petit nombre d’hommes romains<br />
sauraient s’adapter à une telle définition du genre; il faut donc postuler une pluralité des définitions<br />
sociales du masculin dans la culture romaine en rapport avec le statut social : la masculinité de l’esclave<br />
se distingue de celle du client, celle du fils d’un sénateur des normes du masculin de son père.