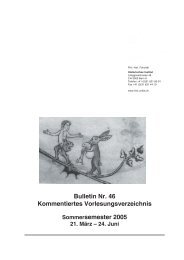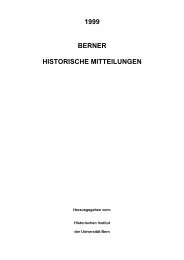p. 5 Ã p.8 - copie - Historisches Institut
p. 5 Ã p.8 - copie - Historisches Institut
p. 5 Ã p.8 - copie - Historisches Institut
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
162 L’exemplarité auto-proclamée…<br />
et qu’il aurait eu besoin de sa prudente mère pour qu’elle tempère son esprit<br />
trop ardemment attiré par l’enseignement des philosophes 1 .<br />
La remarque de Pline dans sa lettre à Attius Clemens 2 paraît d’autant plus<br />
surprenante qu’elle remet en cause l’identité de l’homme aristocratique qui, dans<br />
tous les textes dont nous disposons, se définit comme une identité politique, une<br />
vie dans et pour la res publica. Et l’auteur la présente dans un ouvrage publié en<br />
tant que monument pour assurer son image d’aristocrate exemplaire. Le recueil<br />
épistolaire est une source extraordinaire pour étudier le quotidien d’un aristocrate<br />
sous le Haut-Empire – ou plus précisément (car il ne faut pas être dupe de l’art<br />
de l’autoportrait de Pline) – une vision idéalisée de la vie aristocratique romaine 3<br />
dont les normes et les pratiques reposent largement sur le mos maiorum et donc<br />
sur cette orientation de la culture romaine déterminée par un passé toujours<br />
reconstruit, mais toujours reconstruit en tant que passé 4 . C’est la raison pour<br />
laquelle on ne constate aucune rupture entre l’aristocratie républicaine et celle de<br />
l’Empire 5 . Aucune rupture, certes, mais chez Pline, nous pouvons pourtant<br />
soupçonner des indices de transformations des valeurs aristocratiques.<br />
Pour saisir ces transformations, je propose une lecture des Lettres de Pline qui<br />
tente d’y relever les divers aspects permettant de construire l’image d’une normalité<br />
quotidienne de la vie aristocratique pendant la dernière décennie du I er<br />
et la première décennie du II e siècle de notre ère. Je précise tout de suite que<br />
j’emploie le terme d’aristocratie pour l’aristocratie sénatoriale dans un sens très<br />
général (en contournant le débat autour de la définition de la nobilitas 6 ) : le<br />
1. TACITE, Agr. 4.3.<br />
2. La remarque n’est pas du tout isolée, cf. Epist. 1.9.2-3, 2.8.2, 3.18.4, 8.9.1 ; contrairement à mon<br />
interprétation, St.E. HOFFER, The Anxieties of Pliny the Younger,Atlanta, 1999, p. 127, croit lire une « irony<br />
at Euphrates’ expense » dans la lettre 1.10 et un commentaire distant d’un « rich and powerful Roman »<br />
envers les « bizarre aspects [of] Stoic doctrine ».<br />
3. Cf., parmi bien d’autres, J.H.W.G. LIEBESCHUETZ, Continuity and Change in Roman Religion, Oxford,<br />
1979, p. 183: « The letters [scil. of Pliny] paint a picture of the life led by their author and his friends.<br />
The picture is idealized, but this only means that it shows the values by which these men sought to live<br />
rather than the extend to which they succeeded in doing so. »<br />
4. Maurizio BETTINI caractérise le rapport au temps qui domine la culture romaine avec l’heureuse<br />
expression « l’avvenire dietro le spalle », cf. M. BETTINI, Antropologia e cultura romana. Parentela, tempo,<br />
imagini dell’anima, Rome, 1986, « Parte seconda », 125-202.<br />
5. L’aristocratie sénatoriale se définit par son rapport à la tradition et donc par la continuité, elle cesserait<br />
d’exister si elle admettait une rupture avec le passé ; l’ordre sénatorial sous l’Empire, tout en étant largement<br />
composé de « nouvelles familles »,ne peut donc s’affirmer que sous le signe de la continuité.Cf.les réflexions<br />
concises de A. WINTERLING, « Die antiken Menschen in ihren Gemeinschaften : Rom », dans E.Wirbelauer<br />
(éd.), Oldenbourg Geschichte Lehrbuch: Antike, Munich, 2004, p. 194-211 (ici p. 206-210). À la différence de<br />
Christian Stein ou de Michel Humm qui affirmèrent lors de la Journée d’étude dont ce volume présente<br />
les actes, soit qu’Auguste aurait « recréé » une aristocratie, soit que la nobilitas, « nouvelle aristocratie » née au<br />
IV e siècle, aurait trouvé une fin dans l’auto-déchirement du I er siècle avant notre ère, je pense que l’on peut<br />
trouver bien plus d’éléments de persistance que de discontinuité en comparant l’aristocratie républicaine<br />
avec celle de l’époque impériale.<br />
6. Cf. la présentation des termes du débat et les commentaires de L.A. BURCKHARDT, « The Political Elite<br />
of the Roman Republic : comments on Recent Discussion of the Concepts nobilitas and homo novus »,<br />
Historia 39, 1990, p. 77-99 ; j’explicite brièvement ma position dans Th. SPÄTH, « Texte ohne Bilder:<br />
Statuen und Quellenkritik. Rez. zu : Markus Sehlmeyer, Stadtrömische Ehrenstatuen der republikanischen Zeit,<br />
Stuttgart 1999 », JRA, 13, 2000, p. 434-442, ici p. 441.