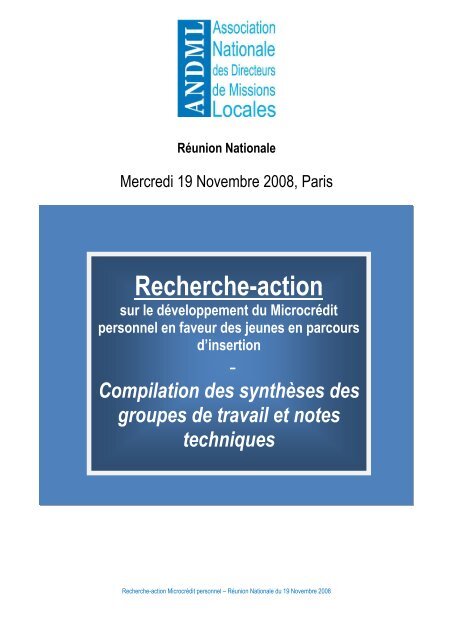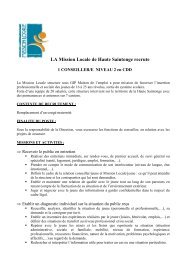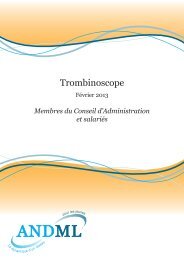Télécharger la compilation des synthèses et notes ... - ANDML
Télécharger la compilation des synthèses et notes ... - ANDML
Télécharger la compilation des synthèses et notes ... - ANDML
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Réunion Nationale<br />
Mercredi 19 Novembre 2008, Paris<br />
Recherche-action<br />
sur le développement du Microcrédit<br />
personnel en faveur <strong>des</strong> jeunes en parcours<br />
d’insertion<br />
-<br />
Compi<strong>la</strong>tion <strong>des</strong> <strong>synthèses</strong> <strong>des</strong><br />
groupes de travail <strong>et</strong> <strong>notes</strong><br />
techniques<br />
Recherche-action Microcrédit personnel – Réunion Nationale du 19 Novembre 2008
Groupe 1<br />
La typologie <strong>des</strong> publics<br />
Animateur : Jean-Michel GOUBARD, ML Alençon, Vice Président <strong>ANDML</strong><br />
Rapporteure : Emmanuelle RONDEAU, ML Le Mans<br />
Membres du groupe de travail :<br />
Sandrine BEAUCOUSIN (ML Agglo d'Elbeuf), Rachel BERTHIER (ML du pays de Fougères), Wafé CHAUVIN<br />
(ML Saint Quentin en Yvelines), Françoise DUSSERRE (ML Jeunes 05 - Gap), Philippe GARDIEN (ML du pays<br />
royannais), Thierry LOPES (ML <strong>des</strong> marches de Bourgogne- Chatillon sur Seine), Elodie MARCOCCIA (ML<br />
Vaulx en Velin), Emmanuelle RONDEAU (ML agglo mancelle), Christelle ROUSSEAU (ML Alençon), Bouchaib<br />
SENHADJI (ML Orly Choisy) <strong>et</strong> Lina VINCENT SULLY (ML Val de Reuil-Louviers-Andelle)<br />
Rappel de <strong>la</strong> note de Philippe LABBE (Cabin<strong>et</strong> Geste) :<br />
Il s’agit de concevoir à partir d’observations de terrain, les publics jeunes effectifs <strong>et</strong> potentiels qui sont ou<br />
pourraient être bénéficiaires du MCP. Si <strong>des</strong> variables traditionnelles peuvent être mobilisées (c<strong>la</strong>sses d’âge,<br />
sexe, <strong>et</strong>c.), le thème du MCP appelle une attention particulière à <strong>des</strong> variables économiques (ressources<br />
financières, exclusion du système bancaire ordinaire, end<strong>et</strong>tement…), sociales (solidarité infra-familiale,<br />
monoparentalité…) <strong>et</strong> d’emploi. A titre d’exemple pour l’emploi, si l’on se base sur l’hypothèse que le MCP<br />
intervient au centre d’un axe dont les deux pôle opposés sont occupés par une position d’exclusion <strong>et</strong> par une<br />
position d’inclusion auxquelles correspondent respectivement les secours <strong>et</strong> les revenus (dont le crédit ordinaire),<br />
<strong>la</strong> problématique est bien celle du « précariat » (R. Castel), <strong>des</strong> « travailleurs pauvres », <strong>et</strong>c.<br />
Idée de départ :<br />
Il faut trouver un équilibre entre les fonds d’aide existants (souvent conçus sous forme de dons) <strong>et</strong> les prêts de<br />
droit commun ; le MCP se situe entre les deux.<br />
C’est <strong>la</strong> première fois qu’on s’adresse à un public (jeune) non solvable dans <strong>la</strong> durée. Il va falloir aider <strong>et</strong> outiller<br />
les conseillers ML (NB : questionnements <strong>et</strong> craintes de certains par rapport au MCP)<br />
Outils de repérage du public à construire.<br />
Le thème de ce groupe de travail a fait émerger beaucoup de questionnements dont les réponses ne sont pas<br />
encore c<strong>la</strong>rifiées, même si quelques fondamentaux ont été exprimés.<br />
Voici les points qui ont été soulevés :<br />
- Il faut une approche <strong>des</strong> besoins du jeune<br />
- Celui-ci doit être demandeur <strong>et</strong> en capacité à s’engager vis-à-vis du MCP <strong>et</strong> donc jouer <strong>la</strong><br />
transparence (financière) : le suivi ML aide à <strong>la</strong> décision (notion d’antériorité)<br />
- Vis-à-vis de sa situation bancaire, il est rappelé qu’un jeune « interdit bancaire» ne peut prétendre<br />
au MCP : le sais-t-on toujours ? Comment le savoir ? (pb du secr<strong>et</strong> bancaire)<br />
- Le MCP oui, en cas de non possibilité d’autres financements (mais risque de transfert de charges)<br />
- Oui encore, quand le proj<strong>et</strong> est en cohérence avec le travail effectué dans le cadre de<br />
l’accompagnement réalisé avec <strong>la</strong> ML (proj<strong>et</strong> professionnel mais aussi proj<strong>et</strong> personnel)<br />
- La ML n’est pas <strong>et</strong> ne doit pas devenir un guich<strong>et</strong> (notion d’accompagnement) : mais si le jeune est<br />
envoyé à <strong>la</strong> ML par une banque ou d’autres structures, quel positionnement adopter ? Serait-ce là<br />
1
un début d’accompagnement (un jeune « inconnu » n’aura pas de réponse à sa demande de MCP<br />
dès <strong>la</strong> première visite)<br />
On doit reconnaître aux ML <strong>la</strong> capacité à refuser <strong>la</strong> demande<br />
- Enfin le nœud du problème : les capacités financières. Le jeune doit-il avoir <strong>des</strong> revenus ?<br />
réguliers ? sa<strong>la</strong>ires ? allocations diverses ? Le MCP doit être possible en fonction du « reste à<br />
vivre », <strong>des</strong> besoins financiers (questions <strong>des</strong> outils), de <strong>la</strong> durée <strong>des</strong> ressources ou en tous cas de<br />
<strong>la</strong> prise en compte de <strong>la</strong> non linéarité <strong>des</strong> parcours (à voir <strong>et</strong> à négocier avec les banques)<br />
- Est-ce qu’il faut tenir compte <strong>des</strong> ressources familiales ? Non, les banques ne le demandent pas<br />
Pour terminer, deux remarques ont été énoncées :<br />
- Dans le cadre du MCP, il n’y a pas de caution, <strong>et</strong> tout repose sur un taux de remboursement élevé :<br />
à qui m<strong>et</strong>-on <strong>la</strong> pression ? sur l’accompagnateur ?<br />
- Attention au transfert de <strong>la</strong> charge administrative <strong>et</strong> de <strong>la</strong> responsabilité.<br />
Note technique de Philippe Labbé<br />
Groupe 1 – Octobre 2008<br />
Du compte-rendu de <strong>la</strong> réunion du 16 juill<strong>et</strong> 2008, nous pouvons extraire deux catégories de questions <strong>et</strong>/ou<br />
propositions : une catégorie à vrai dire moins ciblée sur le thème initial de <strong>la</strong> typologie que sur celui de<br />
l’objectivation de <strong>la</strong> demande <strong>et</strong> du demandeur <strong>et</strong> une autre plus générale, c’est-à-dire recouvrant <strong>des</strong><br />
problématiques soit transversales, soit qui auraient tout aussi bien pu être <strong>des</strong> obj<strong>et</strong>s de débat dans d’autres<br />
groupes.<br />
La première catégorie sur le thème de l’objectivation de <strong>la</strong> demande <strong>et</strong> du demandeur :<br />
On y trouve de façon récurrente <strong>la</strong> préoccupation – légitime - d’être outillé pour correctement évaluer le besoin <strong>et</strong><br />
<strong>la</strong> pertinence du recours au MCP.<br />
L’évaluation ex ante s’exprime par exemple avec « Il faut une approche <strong>des</strong> besoins du jeune. » Quel pourrait<br />
être c<strong>et</strong> outil de diagnostic ? A priori, on peut imaginer qu’il recouvre trois vol<strong>et</strong>s :<br />
- un premier vol<strong>et</strong> <strong>des</strong>criptif de <strong>la</strong> situation du jeune avec les variables traditionnelles dont une <strong>la</strong>rge partie est<br />
déjà disponible via Parcours ;<br />
- un deuxième vol<strong>et</strong> centré sur <strong>la</strong> raison <strong>et</strong>/ou le proj<strong>et</strong> qui motive <strong>la</strong> demande ;<br />
- un troisième vol<strong>et</strong> purement financier (estimation du besoin financier, capacité de remboursement…) considéré<br />
comme « le nœud du problème : les capacités financières ».<br />
Des réponses ont été apportées à <strong>des</strong> questions ordinaires <strong>et</strong> discriminantes : non, les ressources familiales<br />
n’ont pas à être prises en compte ; il n’y a pas de caution…<br />
Le troisième vol<strong>et</strong> est bien celui qui génère le plus de questions : « … le nœud du problème : les capacités<br />
financières. Le jeune doit-il avoir <strong>des</strong> revenus ? Réguliers ? Sa<strong>la</strong>ires ? Allocations diverses ? » On est dans un<br />
système purement marchand : c’est <strong>la</strong> banque qui prête… avec <strong>des</strong> garanties (plus que pour les subprimes). S’il<br />
fal<strong>la</strong>it que le jeune apporte <strong>la</strong> garantie de ressources régulières, sauf à ce que celles-ci soient marginales, le<br />
MCP ne s’adresserait pas à lui. Il me semble donc que ce critère n’est pas à r<strong>et</strong>enir mais qu’il faut inverser <strong>la</strong><br />
2
perspective : c’est – entre autres - parce que le jeune est engagé dans un contrat (de prêt mais en fait plus<br />
globalement avec <strong>la</strong> société) qu’on attend de lui qu’il m<strong>et</strong>te en p<strong>la</strong>ce les moyens d’honorer ce contrat, donc de<br />
rembourser. Poser <strong>la</strong> continuité <strong>des</strong> ressources comme un préa<strong>la</strong>ble n’est pas, de mon avis, <strong>la</strong> bonne posture<br />
initiale. Poser le contrat comme facteur de stabilisation (ou de recherche de stabilisation) dans l’emploi, celui-ci<br />
étant un moyen de rembourser sa d<strong>et</strong>te, me paraît plus intéressant… a fortiori si ce<strong>la</strong> perm<strong>et</strong> de s’engager dans<br />
une démarche de proj<strong>et</strong> d’IPS (insertion professionnelle <strong>et</strong> sociale).<br />
La seconde catégorie avec <strong>des</strong> problématiques plus <strong>la</strong>rges <strong>et</strong> transversales :<br />
Les questions posées ici sont souvent d’ordre pédagogique ou déontologique. Par exemple, « Celui-ci {le jeune}<br />
doit être demandeur. » Sans avis totalement arrêté là-<strong>des</strong>sus, je m’interroge. Que le jeune soit demandeur<br />
signifierait-il qu’il soit demandeur d’une aide financière ou qu’il soit demandeur spécifiquement de ce prêt ? Et ce<br />
n’est pas une façon de couper les cheveux en quatre… En eff<strong>et</strong>, que le jeune soit demandeur d’une aide<br />
financière « générale », sans spécification, est en principe quelque chose qui intervient, soit par ce qu’il a<br />
entendu dire par ses réseaux que <strong>la</strong> mission locale pouvait débloquer <strong>des</strong> ai<strong>des</strong> (FAJ, FIPJ, <strong>et</strong>c.), soit au terme<br />
d’un diagnostic réalisé par le conseiller <strong>et</strong> qui incite celui-ci à présenter c<strong>et</strong>te opportunité : il est en fait<br />
« demandeur » parce que mis en situation de pouvoir demander. S’agissant d’un MCP, ces deux cas de figure<br />
peuvent se présenter. Cependant, en plus, lorsque les uns <strong>et</strong> les autres passons devant <strong>des</strong> vitrines de banque,<br />
nous pouvons y lire <strong>des</strong> invitations à solliciter <strong>des</strong> prêts (ça ne durera pas si <strong>la</strong> crise financière persiste <strong>et</strong><br />
s’amplifie…). Les jeunes susceptibles d’accéder au MCP n’ont pas accès aux prêts ordinaires mais ne doit-on<br />
pas garantir une « publicité » (entendez « information ») sur le MCP qui est pour eux l’équivalent du prêt ordinaire<br />
pour les autres ? Attention ! Nous ne sommes pas dans un droit (y compris conditionnel), comme par exemple les<br />
allocations feu BAE <strong>et</strong> FIPJ. Ce n’est donc pas une obligation au titre que « Nul n’est sensé ignorer <strong>la</strong> loi » mais<br />
c’est une question d’équité. Ne pas informer reviendrait à discriminer au bénéfice de celles <strong>et</strong> ceux qui sont déjà<br />
dans un parcours d’IPS ou à celui de celles <strong>et</strong> ceux qui en auraient entendu parler. On touche là un suj<strong>et</strong> sensible<br />
pour de nombreux professionnels de mission locale, le rapport à l’argent (qui était apparu avec <strong>la</strong> BAE). Il me<br />
semb<strong>la</strong>it cependant que ce<strong>la</strong> s’était atténué, que <strong>la</strong> représentation d’une re<strong>la</strong>tion gratuite avec « don/contre-don »<br />
avait quasi-disparue au bénéfice de celle du contrat, <strong>et</strong>c. A voir.<br />
Un autre suj<strong>et</strong> important est celui de l’inscription de <strong>la</strong> demande de MCP dans une logique de proj<strong>et</strong> : « … quand<br />
le proj<strong>et</strong> est en cohérence avec le travail effectué dans le cadre de l’accompagnement réalisé avec <strong>la</strong> ML (proj<strong>et</strong><br />
professionnel mais aussi proj<strong>et</strong> personnel. » Ceci me semble être également être une question à débattre. Avec<br />
trois perspectives.<br />
- Première perspective, le MCP intervient effectivement dans le cadre d’un proj<strong>et</strong> d’IPS <strong>et</strong>, dans ce cas, il ne me<br />
semble pas y avoir de grande discussion à avoir, <strong>la</strong> cohérence entre MCP <strong>et</strong> proj<strong>et</strong> d’IPS étant garantie par<br />
l’accompagnement du professionnel, par son expertise.<br />
- Deuxième perspective, <strong>la</strong> demande de MCP est déconnectée du proj<strong>et</strong> d’IPS, parce que par exemple le jeune<br />
était inconnu de <strong>la</strong> mission locale, mais il constitue une entrée pour ce dernier. Le travail à faire est de saisir<br />
l’opportunité de <strong>la</strong> demande de MCP pour engager le proj<strong>et</strong> d’IPS. C’est une variante de <strong>la</strong> notion de<br />
« dépassement » dont parle Schwartz : on dépasse <strong>la</strong> demande pour aller voir ce qui pourrait être agi plus en<br />
profondeur. A ce titre, ce travail s’inscrit dans le 1 er item du 1 er axe de <strong>la</strong> CPO, « repérage ».<br />
- Troisième perspective, <strong>la</strong> demande de MCP est déconnectée du proj<strong>et</strong> d’IPS, soit parce que ce dernier ne<br />
s’impose pas, soit parce que le jeune n’est pas preneur d’une telle démarche. On est donc dans un cas de figure<br />
purement « instrumental », le qualificatif étant choisi volontairement. Pourquoi « instrumental » ? Parce que le<br />
sentiment du conseiller va être d’être instrumentalisé : « La ML n’est pas <strong>et</strong> ne doit pas devenir un guich<strong>et</strong> (notion<br />
d’accompagnement)… » « Instrumental » également parce qu’il ne faudrait pas oublier qu’une <strong>des</strong> trois<br />
dimensions du rapport à l’environnement, avec le symbolique <strong>et</strong> le social, est l’instrumental… c’est-à-dire<br />
survivre. Ca me semble naturel <strong>et</strong> légitime <strong>et</strong> je poserais volontiers l’hypothèse que perm<strong>et</strong>tre à un jeune<br />
d’accéder au MCP, sans aller chercher plus loin que son intérêt économique, est aussi acceptable. Lorsque l’on<br />
parle de moduler l’offre de services, du plus simple - le coup de main - au plus complexe - le proj<strong>et</strong> d’IPS -, on est<br />
3
ien dans c<strong>et</strong>te acceptation que <strong>des</strong> jeunes peuvent venir nous voir sans plus d’objectif qu’obtenir une aide, en<br />
l’occurrence un prêt…<br />
Ceci devrait apporter une réponse à <strong>la</strong> question « Sur qui m<strong>et</strong>-on <strong>la</strong> pression ? L’accompagnateur ? » Il me<br />
semble que « <strong>la</strong> pression » n’existe que dans le cas où le MCP s’inscrit dans une logique d’IPS (effective ou<br />
proj<strong>et</strong>ée)… mais, pourrait-on dire, elle est « ordinaire », c’est-à-dire ni plus ni moins qu’un autre outil. Dans le cas<br />
d’une déconnection, bien évidemment, il n’y a pas de pression, juste un service.<br />
En conclusion, il me semble que l’objectif opérationnel de ce groupe devrait être de concevoir une grille<br />
d’analyse de <strong>la</strong> demande, en trois vol<strong>et</strong>s comme proposé supra, sur <strong>la</strong> base d’une question simple déclinée pour<br />
chacun de ces vol<strong>et</strong>s : qu’a-t-on besoin de savoir ?<br />
Sur le vol<strong>et</strong> 1, l’essentiel <strong>des</strong> informations servira, outre le dossier d’instruction pour <strong>la</strong> banque, à constituer une<br />
base d’informations pour l’évaluation de l’activité dans une perspective exclusivement réservée à <strong>la</strong> mission<br />
locale.<br />
Sur le vol<strong>et</strong> 2, on est dans le pur <strong>des</strong>criptif du proj<strong>et</strong> <strong>et</strong> ce qui est important <strong>et</strong> son réalisme.<br />
Le vol<strong>et</strong> 3 par contre concerne <strong>la</strong> faisabilité financière. On évalue les « produits » effectifs <strong>et</strong> probables sur une<br />
base, si le jeune est dans un parcours discontinu, incluant c<strong>et</strong>te discontinuité <strong>des</strong> revenus : quelles ont été ses<br />
ressources ces six derniers mois ? Comment, à quel rythme, ces ressources lui sont-elles parvenues ? quelles<br />
sont, au vu de l’histoire récente <strong>et</strong> du futur probable, les ressources que raisonnablement on peut attendre ? On<br />
ne peut pas en eff<strong>et</strong> raisonner sur une périodicité mensuelle mais on doit choisir une échelle plus grande<br />
(semestre, année). Toutes les ressources doivent être prises en compte : les revenus <strong>des</strong> transferts sociaux sont<br />
calculés pour mesurer le taux de pauvr<strong>et</strong>é, on ne voit pas pourquoi ils ne le seraient pas ici.<br />
Trois autres points/questions me semblent devoir être traités :<br />
- Du diagnostic, qu’est-ce qui est communiqué à <strong>la</strong> banque ? Pas tout bien sûr.<br />
- Faut-il, comme les banques mais pas uniquement celles-ci, parvenir à une logique de scoring (tant de points au<br />
total valident ou invalident <strong>la</strong> faisabilité <strong>et</strong> <strong>la</strong> recevabilité de <strong>la</strong> demande) ?<br />
- L’entrée initiale, <strong>la</strong> typologie, n’a pas été traitée. Qu’est-ce que les professionnels, qui connaissent bien les<br />
jeunes, peuvent dire là-<strong>des</strong>sus ? Quel(s) profil(s) ?<br />
4
Groupe 2<br />
La typologie <strong>des</strong> obj<strong>et</strong>s<br />
Animateur : Joseph Legrand, ML Fougères, administrateur de l’<strong>ANDML</strong><br />
Rapporteur : Régis Barbier, ML Beaune, administrateur de l’<strong>ANDML</strong><br />
Membres du groupe de travail :<br />
Régis BARBIER (ML Rurale de Beaune), Isabelle BONFY (ML Vaulx en Velin), Mé<strong>la</strong>nie BONNEVAL (ML<br />
Technowest - Mérignac), Emilie DUBOSC (ML du pays de Caux vallée de Seine – Lillebonne), Philippe<br />
GARDIEN (ML du pays royannais), Marie-Anne JOURDAN ( ML du pays de Coutances), Odile LANDEAU ( ML<br />
Rhône Sud Est - Saint Fons), Stéphanie LENOIR ( ML Agglo d'Elbeuf), Muriel MADELENAT ( ML Vesoul),<br />
Fabien MICHEL ( ML Orly Choisy)<br />
Rappel de <strong>la</strong> note de Philippe LABBE :<br />
Il s’agit à partir <strong>des</strong> observations de terrain de typologiser les MCP en mobilisant différentes variables telles que<br />
les montants, les durées de remboursement, les taux d’usure, les conditions bancaires contractuelles, les obj<strong>et</strong>s,<br />
leurs finalités (à visée professionnelle directe ou indirecte), <strong>et</strong>c.<br />
Idée de départ :<br />
Pour évoquer <strong>la</strong> typologie <strong>des</strong> obj<strong>et</strong>s <strong>des</strong> MCP, il faut partir de l’observation du terrain, or aucun représentant de<br />
Mission Locale dans le groupe n’a déjà mis en p<strong>la</strong>ce de MCP.<br />
Un constat s’impose : offrir une information c<strong>la</strong>ire sur l’offre <strong>des</strong> banques, qui ne doit pas se limiter aux taux<br />
qu’elles pratiquent mais davantage sur les services bancaires <strong>et</strong> les conditions de vente de ces services.<br />
Ex : banque qui impose une domiciliation bancaire <strong>et</strong> facture ce service 5€ par mois pour gérer le compte…<br />
Donc il importe de dresser un tableau au p<strong>la</strong>n national accessible à l’ensemble <strong>des</strong> participants, reflétant les<br />
conditions proposées par les banques <strong>et</strong> perm<strong>et</strong>tant par <strong>la</strong> suite à chaque Mission Locale de négocier avec le<br />
partenaire bancaire choisi.<br />
Les points qui ont été soulevés :<br />
-Le MCP peut-il être contracté pour financer <strong>des</strong> vacances ? Cas d’une jeune ayant un proj<strong>et</strong> de voyage au<br />
Japon. La question est de fixer <strong>la</strong> limite <strong>des</strong> obj<strong>et</strong>s pouvant être financés par le MCP.<br />
- Parcours 3 :<br />
- Est un outil d’aide à <strong>la</strong> caractérisation de l’obj<strong>et</strong> du proj<strong>et</strong><br />
- Peut faire le lien avec le jeune <strong>et</strong> le territoire : nombreuses disparités entre les territoires <strong>des</strong> Missions<br />
Locales, notamment sur l’accès au logement que certaines Missions Locales prennent en charge pour<br />
pallier à l’intervention de leur département, souvent insuffisante<br />
La typologie <strong>des</strong> obj<strong>et</strong>s peut être un outil pour faire pression au niveau local afin de faire évoluer les actions en<br />
matière de logement, santé, soin… De même au niveau <strong>des</strong> banques.<br />
La spécificité <strong>des</strong> territoires peut conduire à une segmentation <strong>des</strong> obj<strong>et</strong>s :<br />
- un territoire rural peu <strong>des</strong>servi <strong>et</strong> l’obj<strong>et</strong> mobilité<br />
- un territoire proposant une offre insuffisante en termes de logement <strong>et</strong> l’obj<strong>et</strong> accès au logement (ex :<br />
territoire de Bordeaux-Mérignac)<br />
- (…)<br />
5
Note technique de Philippe Labbé<br />
Groupe 2 – Octobre 2008<br />
A partir <strong>des</strong> observations de terrain, il s'agit de typologiser les MCP en mobilisant différentes variables telles que<br />
les montants, les durées de remboursement, les taux d’usure, les conditions bancaires contractuelles, les obj<strong>et</strong>s,<br />
leurs finalités (à visée professionnelle directe ou indirecte), <strong>et</strong>c.<br />
Le principe posé pour le MCP est que son recours par les missions locales s’inscrit dans le cadre conceptuel de<br />
celles-ci, c’est-à-dire l’approche globale. Autrement formulé, il n’y a pas d’obj<strong>et</strong>s a priori non-éligibles au MCP<br />
dès lors que celui-ci est conçu comme un moyen de progresser dans un parcours d’insertion professionnelle <strong>et</strong><br />
sociale. Par exemple, <strong>la</strong> question concernant le proj<strong>et</strong> de voyage d’un jeune au Japon obtient une réponse<br />
positive ne serait-ce qu’en termes de soutien à <strong>la</strong> mobilité… <strong>et</strong> dès lors que le « proj<strong>et</strong> de vacances » peut être<br />
relié à un objectif d’insertion, c’est-à-dire non résumé au p<strong>la</strong>isir d’un loisir. Pour aller vite, on peut considérer que<br />
les conditions de réussite de l’insertion repose sur <strong>la</strong> disposition de « capitaux » : économique (de l’argent), social<br />
(<strong>des</strong> re<strong>la</strong>tions), symbolique (de l’estime de soi), culturel (de <strong>la</strong> formation, de <strong>la</strong> qualification), de santé <strong>et</strong> de<br />
mobilité. Donc tout ce qui concourt à améliorer <strong>la</strong> situation économique du jeune, que ce dernier ne soit pas isolé,<br />
qu’il gagne en confiance en lui-même, qu’il se forme, qu’il jouisse d’une bonne santé <strong>et</strong> qu’il puisse se dép<strong>la</strong>cer<br />
entrent dans le champ du MCP. On voit donc que le champ est <strong>la</strong>rge, les seules restrictions étant de deux types :<br />
- Celles qui voudraient que le MCP soit directement fléché sur l’insertion professionnelle, logiquement tenues par<br />
<strong>la</strong> DGEFP.<br />
- Celles qui concernent les rachats de crédits, <strong>la</strong> trésorerie <strong>et</strong> le rééchelonnement de d<strong>et</strong>tes.<br />
A ces restrictions de « périmètre » peut être ajoutée une autre d’ordre pédagogique, guère étonnante dans <strong>la</strong><br />
culture <strong>des</strong> professionnels de mission locale : que le MCP s’inscrive dans une dynamique de proj<strong>et</strong>.<br />
Si le second type correspond à <strong>la</strong> prévention du surend<strong>et</strong>tement (spirale d’un crédit revolving), <strong>la</strong> première a<br />
trouvé <strong>des</strong> réponses exprimées en particulier dans le rapport de l’ANSA, Micro-crédit social. Diagnostic <strong>et</strong><br />
perspectives de développement (p. 97).<br />
S’agissant de typologiser les obj<strong>et</strong>s, on peut concevoir un tableau sur <strong>la</strong> base du c<strong>la</strong>ssement de Parcours 3<br />
(professionnel, social <strong>et</strong> vie sociale) <strong>et</strong> d’items esquissés comme suit <strong>et</strong> à compléter.<br />
Obj<strong>et</strong>s du MCP<br />
Emploi (in « Professionnel » P3)<br />
Dép<strong>la</strong>cements<br />
Achats de matériel professionnel<br />
Coûts connexes (logement, alimentation…)<br />
Formation (in « Professionnel » P3)<br />
Dép<strong>la</strong>cements<br />
Achats de matériel professionnel<br />
Coûts connexes (logement, alimentation…)<br />
Mobilité (in « Professionnel » P3)<br />
Acquisition <strong>et</strong> entr<strong>et</strong>ien d’un véhicule<br />
Permis de conduire<br />
Assurance<br />
Déménagement<br />
Logement (in « Social » P3)<br />
Loyer<br />
6
Flui<strong>des</strong><br />
Aménagement, réparations<br />
Mobilier<br />
Santé (in « Social » P3)<br />
Mutuelle<br />
Soins non remboursés<br />
Matériel orthopédique<br />
Culture, Loisirs (in Vie sociale » P3)<br />
Adhésion association<br />
Matériel sportif<br />
Dép<strong>la</strong>cements<br />
Famille (évènements familiaux : mariage, décès…)<br />
Autres<br />
Modalités du MCP<br />
Montant <strong>des</strong> prêts (entre 500 <strong>et</strong> 3 000 €)<br />
Durée <strong>des</strong> prêts (de 12 à 36 mois)<br />
Durée d’instruction <strong>et</strong> de réponse<br />
P<strong>la</strong>sticité <strong>des</strong> remboursements : capacité de suspendre temporairement ou d’augmenter les<br />
remboursements en fonction <strong>des</strong> revenus, rééchelonnement.<br />
Domiciliation bancaire<br />
Achat d’une part sociale<br />
Frais bancaires (incidents de remboursement, assurance, frais de dossier)<br />
Taux du crédit<br />
Garantie bancaire autre que 50% CDC<br />
Autres<br />
Comme indiqué par le groupe, « il importe de dresser un tableau au p<strong>la</strong>n national accessible à l’ensemble <strong>des</strong><br />
participants, reflétant les conditions proposées par les banques <strong>et</strong> perm<strong>et</strong>tant par <strong>la</strong> suite à chaque Mission<br />
Locale de négocier avec le partenaire bancaire choisi. »<br />
Un point appelle une vigi<strong>la</strong>nce particulière, l’existence d’autres ai<strong>des</strong> mobilisables à partir <strong>des</strong> institutions<br />
(collectivités territoriales, État, CPAM, CAF, ANPE, <strong>et</strong>c.). Il faudrait donc parvenir à un tableau synoptique<br />
reprenant <strong>et</strong> complétant les items proposés supra <strong>et</strong> ajoutant une colonne avec, pour chaque item, les ai<strong>des</strong> de<br />
droit commun 1 <strong>et</strong> leurs sources. Comme il est indiqué dans <strong>la</strong> contribution du 24 juill<strong>et</strong> 2008 concernant le permis<br />
de conduire, c<strong>et</strong>te juxtaposition entre le MCP <strong>et</strong> d’autres ai<strong>des</strong> peut non seulement inciter à recourir à ces<br />
dernières <strong>et</strong> subséquemment à éviter un end<strong>et</strong>tement mais intégrer <strong>la</strong> possibilité de combiner MCP avec d’autres<br />
ai<strong>des</strong> (permis à 1 € dans <strong>la</strong> contribution).<br />
Le groupe note que « <strong>la</strong> typologie <strong>des</strong> obj<strong>et</strong>s peut être un outil pour faire pression au niveau local afin de faire<br />
évoluer les actions en matière de logement, santé, soin… » Cependant, au regard du nombre limité prévisible de<br />
MCP, il n’est pas certain que le seul reporting <strong>des</strong> obj<strong>et</strong>s <strong>des</strong> MCP accordés constitue un élément robuste <strong>et</strong><br />
convaincant. Si <strong>la</strong> mission locale remplit correctement sa fonction d’observation du territoire (axe 4 de <strong>la</strong> CPO),<br />
les données spécifiques du MCP seront agrégées d’autres, l’ensemble perm<strong>et</strong>tant d’obtenir un panorama plus<br />
vaste… <strong>et</strong> plus convaincant.<br />
1 C<strong>et</strong>te notion de « droit commun » n’est toutefois pas simple, chaque institution s’employant souvent<br />
à exiger que le recours à son aide n’intervienne qu’au terme de l’épuisement du droit commun… c’està-dire<br />
<strong>des</strong> autres ai<strong>des</strong>.<br />
7
Groupe 3<br />
Accessibilité<br />
Animatrice : Annie Jeanne, ML agglomération rouennaise, présidente <strong>ANDML</strong><br />
Rapporteure : Marie-Anne JOURDAN, Mission locale du Pays de Coutances<br />
Membres du groupe de travail :<br />
Jean-Philippe CHARPENTIER (ML Agglo mancelle), Isabelle CLOT (ML du p<strong>la</strong>teau Nord Val de Saône -<br />
Fontaine sur Saône), Isabelle COUQUET (ML Antipolis - Antibes), Valérie EDOUARD (ML de <strong>la</strong> Haute Saintonge<br />
- Jonzac), Denis FORTIER ( ML Angevine), Carole JACOB ( ML Saint Quentin en Yvelines)<br />
Marie-Anne JOURDAN (ML du Pays de Coutances), Amel KOUZA (ML Orly Choisy), Jospeh LEGRAND ( ML<br />
rurale du pays de Fougères), Florence LUCET (ML <strong>des</strong> jeunes de l'arrondissement de Saint-Omer)<br />
Patricia ROGGY (ML Lure Luxeuil), Dominique TOPIN (ML pour <strong>la</strong> jeunesse <strong>et</strong> le pays reimois)<br />
Rappel de <strong>la</strong> note de Philippe LABBE – Thème 3 : Accessibilité <strong>des</strong> Microcrédits<br />
Le groupe en charge de ce thème a pour objectif de caractériser les modalités de communication du MCP en<br />
direction <strong>des</strong> bénéficiaires mais également <strong>des</strong> autres acteurs du territoire qui s’adressent à <strong>des</strong> publics adultes.<br />
Il s’agit non seulement d’identifier ce qui est fait <strong>et</strong> comment, mais d’interroger le niveau de connaissance du<br />
MCP par les uns <strong>et</strong> les autres, les freins culturels, <strong>et</strong>c.<br />
Réflexions <strong>et</strong> points soulevés :<br />
Obj<strong>et</strong> de l’accessibilité :<br />
-les pratiques de communication sur le MCP - les bonnes pratiques <strong>des</strong> autres structures du territoire<br />
- les conditions d’éligibilité<br />
- motifs de rej<strong>et</strong> de <strong>la</strong> part <strong>des</strong> acteurs : les à priori, les freins, … adossés à <strong>la</strong> question éthique, aux valeurs<br />
Recueil d’expériences en cours :<br />
Au sein <strong>des</strong> ML qui pratiquent déjà le MCP représentées dans le groupe de travail, Il est constaté <strong>des</strong> priorités<br />
données en faveur d’un champ d’intervention : MCP emploi/mobilité (pour l’aide à <strong>la</strong> création d’entreprise), MCP<br />
logement <strong>et</strong> équipement ménager, MCP famille <strong>et</strong> santé.<br />
Ces priorités semblent liées à <strong>la</strong> spécialisation du conseiller référent MCP sur le thème donné : conseiller<br />
logement, <strong>et</strong>c<br />
A Angers, chaque conseiller instruit le dossier <strong>et</strong> le référent MCP fait le point.<br />
Outre <strong>des</strong> p<strong>la</strong>ges individuelles de présentation du MCP sur RDV, <strong>des</strong> ateliers « gérer ses papiers » organisés au<br />
sein <strong>des</strong> organismes de formation sont l’occasion de proposer le MCP si besoin.<br />
La question du positionnement de <strong>la</strong> Mission Locale en terme de fonctionnement interne n’est pas anodine :<br />
référent MCP unique spécialisé, instruction MCP par l’ensemble <strong>des</strong> conseillers, commission interne de<br />
validation,...<br />
Lisibilité <strong>et</strong> accessibilité du dispositif :<br />
8
L’information <strong>des</strong> partenaires <strong>et</strong> acteurs locaux sur l’accessibilité du MCP est préconisée par le groupe de<br />
travail : <strong>la</strong> ML de Coutances constate que le MCP est peu connu <strong>des</strong> instances sociales qui ne savent pas vers<br />
qui se r<strong>et</strong>ourner.<br />
Il est proposé de s’inspirer de séances d’infos du type « info-logement <strong>des</strong> jeunes » organisées par <strong>la</strong> ML auprès<br />
<strong>des</strong> acteurs sociaux pour transm<strong>et</strong>tre l’info MCP.<br />
‣ P<strong>la</strong>n de communication :<br />
Communication éthique à l’égard <strong>des</strong> partenaires. L’appui d’outils dynamisants <strong>et</strong> facilitateurs sur power<br />
point est nécessaire – outils à créer<br />
Il est d’autre part proposé de diffuser l’info MCP aux jeunes eux-mêmes lors de séances de type « info budg<strong>et</strong> »,<br />
« p<strong>et</strong>it déjeuner de <strong>la</strong> formation », <strong>et</strong>c.<br />
Le travail sur le budg<strong>et</strong> ne doit pas pour autant s’appuyer sur le MCP comme support.<br />
Il importe de proposer une éducation aux avantages <strong>et</strong> aux dangers de <strong>la</strong> banque.<br />
‣ Promouvoir le MCP dans un cadre institutionnalisé car <strong>la</strong> démarche individuelle est difficilement<br />
mobilisable auprès <strong>des</strong> jeunes.<br />
Le groupe r<strong>et</strong>ient le principe d’une communication portant sur l’aide spécifique du MCP dans <strong>la</strong> mise en œuvre<br />
d’un proj<strong>et</strong>. Pas de communication ventant directement le MCP en tant que tel.<br />
‣ P<strong>la</strong>n de communication :<br />
P<strong>la</strong>qu<strong>et</strong>te unique + affiche <strong>des</strong>tinées au public avec un message axé sur <strong>la</strong> dimension proj<strong>et</strong> (prévoir un<br />
encart à compléter localement par chaque ML)<br />
La collecte <strong>des</strong> données est à prévoir (quantitatives <strong>et</strong> qualitatives)<br />
Le cib<strong>la</strong>ge du public auquel transm<strong>et</strong>tre <strong>des</strong> infos MCP est également envisagé par le groupe de travail ( jeunes<br />
n’ayant pas le permis, pas de véhicule, <strong>et</strong>c…).<br />
‣ Identification <strong>des</strong> cibles principales à prévoir avec l’appui de P3 (requête type)<br />
Veiller à l’articu<strong>la</strong>tion <strong>et</strong> <strong>la</strong> complémentarité avec les autres dispositifs existants (ex : le prêt Jeune Avenir octroyé<br />
par <strong>la</strong> C.A.F.). Eviter les eff<strong>et</strong>s de concurrence entre dispositif <strong>et</strong> entre partenaires instructeurs.<br />
Soutenir le conseiller dans <strong>la</strong> pertinence du choix à partir de <strong>la</strong> maîtrise <strong>des</strong> dispositifs existants quelquefois mal<br />
connus.<br />
‣ Proposition : créer un document en ligne comprenant <strong>des</strong> fiches techniques sur les ai<strong>des</strong><br />
nationales/régionales/départementales/locales (cf. catalogue <strong>des</strong> ai<strong>des</strong> sur le site du Carif Poitou<br />
Charente)<br />
Notions éthiques :<br />
- MCP : investissement pour le devenir ou aide réparatrice ?<br />
- Egalité <strong>et</strong> équité du traitement <strong>des</strong> dossiers (notion de service public)<br />
- Accessibilité aux jeunes, public en précarité<br />
- Ne pas associer le MCP au public jeune, avec le risque d’étiqu<strong>et</strong>er les Missions Locales comme unique<br />
référent instructeur du dispositif<br />
- Réconciliation avec le système bancaire<br />
- E<strong>la</strong>rgir l’information sur l’éligibilité (pas uniquement les jeunes) par le biais d’un support d’informations<br />
Les freins :<br />
- Lien entre les services instructeurs <strong>et</strong> <strong>la</strong> banque (notion de freins culturels)<br />
- Le MCP perçu comme une incitation à <strong>la</strong> consommation chez un public jeune, souvent fragile<br />
9
Note technique de Philippe Labbé<br />
Groupe 4 – Octobre 2008<br />
Là comme ailleurs, l’accessibilité au dispositif MCP est déterminée en amont par <strong>la</strong> lisibilité de ce dispositif. Les<br />
échanges dans le groupe ont permis d’identifier trois « cibles » vis-à-vis <strong>des</strong>quelles on doit communiquer : les<br />
jeunes, les partenaires <strong>et</strong> les professionnels de <strong>la</strong> mission locale. A chacune de ces cibles correspond un<br />
objectif principal.<br />
Concernant les jeunes, <strong>la</strong> communication recouvre l’opportunité d’un crédit dès lors que celui-ci est relié à un<br />
proj<strong>et</strong> : « Le groupe r<strong>et</strong>ient le principe d’une communication portant sur l’aide spécifique du MCP dans <strong>la</strong> mise en<br />
œuvre d’un proj<strong>et</strong>. Pas de communication ventant directement le MCP en tant que tel. » Au regard de c<strong>et</strong>te<br />
association entre MCP <strong>et</strong> proj<strong>et</strong>, en toute logique le MCP est adossé à <strong>des</strong> thèmes distincts : « Il est constaté <strong>des</strong><br />
priorités données en faveur d’un champ d’intervention : MCP emploi/mobilité (pour l’aide à <strong>la</strong> création<br />
d’entreprise), MCP logement <strong>et</strong> équipement ménager, MCP famille <strong>et</strong> santé. Ces priorités semblent liées à <strong>la</strong><br />
spécialisation du conseiller référent MCP sur le thème donné : conseiller logement, <strong>et</strong>c. » Deux orientations se<br />
dégagent en ce qui concerne l’accessibilité par les jeunes :<br />
- Les pratiques ordinaires d’information : « Outre <strong>des</strong> p<strong>la</strong>ges individuelles de présentation du MCP sur RDV, <strong>des</strong><br />
ateliers « gérer ses papiers » organisés au sein <strong>des</strong> organismes de formation sont l’occasion de proposer le MCP<br />
si besoin. » <strong>et</strong> « diffuser l’info MCP aux jeunes eux-mêmes lors de séances de type « info budg<strong>et</strong> », « p<strong>et</strong>it<br />
déjeuner de <strong>la</strong> formation… »<br />
- Une communication plus <strong>la</strong>rge, nationale : « P<strong>la</strong>qu<strong>et</strong>te unique + affiche <strong>des</strong>tinées au public avec un message<br />
axé sur <strong>la</strong> dimension proj<strong>et</strong> (prévoir un encart à compléter localement par chaque ML). »<br />
Enfin – on r<strong>et</strong>rouve l’importance de relier MCP <strong>et</strong> proj<strong>et</strong> – « Il importe de proposer une éducation aux avantages<br />
<strong>et</strong> aux dangers de <strong>la</strong> banque » <strong>et</strong> « Le MCP perçu comme une incitation à <strong>la</strong> consommation chez un public jeune,<br />
souvent fragilisé. »<br />
Concernant les partenaires, leur information « est préconisée par le groupe de travail : <strong>la</strong> ML de Coutances<br />
constate que le MCP est peu connu <strong>des</strong> instances sociales qui ne savent pas vers qui se r<strong>et</strong>ourner. » A c<strong>et</strong>te<br />
communication en direction <strong>des</strong> partenaires (qui pourrait s’appuyer sur un powerpoint), avec <strong>la</strong> précaution<br />
d’« éviter les eff<strong>et</strong>s de concurrence entre dispositif <strong>et</strong> entre partenaires instructeurs », s’ajoute un autre objectif,<br />
celui de <strong>la</strong> veille sur leurs pratiques dont les missions locales pourraient s’inspirer.<br />
Concernant les professionnels de <strong>la</strong> mission locale, c’est en fait de maîtrise du dispositif dont il s’agit : « La<br />
question du positionnement de <strong>la</strong> Mission Locale en termes de fonctionnement interne n’est pas anodine :<br />
référent MCP unique spécialisé, instruction MCP par l’ensemble <strong>des</strong> conseillers, commission interne de<br />
validation... » On r<strong>et</strong>rouve là <strong>des</strong> choix d’organisation simi<strong>la</strong>ires à ceux d’autres ai<strong>des</strong> (FIPJ, FAJ…). On parle<br />
ainsi de « référent MCP » ou de « spécialisation du conseiller référent MCP sur le thème donné : conseiller<br />
logement, <strong>et</strong>c. » En fait, <strong>la</strong> question posée ici est « le MCP constitue-t-il une expertise en elle-même ou fait-il<br />
partie du lot commun <strong>des</strong> outils que chaque conseiller, spécialisé ou non, doit maîtriser ? »<br />
Tout d’abord, il me semble que l’on devrait éviter l’usage de <strong>la</strong> notion de « référent » pour parler d’un domaine<br />
(mobilité, logement, <strong>et</strong>c.) 2 : c<strong>et</strong>te notion de « référent » devrait être réservée à <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion avec le jeune (référent<br />
du jeune) <strong>et</strong>, dès lors que l’on parle d’un domaine, c’est <strong>la</strong> notion d’expertise qui devrait être mobilisée. Si on<br />
s’appuie sur <strong>la</strong> littérature en GRH (<strong>et</strong>, plus particulièrement, en gestion prévisionnelle <strong>des</strong> emplois <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />
2 Même si <strong>la</strong> convention collective nationale dans l’axe « conseil en insertion » parle d’ « être référent<br />
sur un domaine spécifique » (1.4). Rien ne s’oppose au fait de faire évoluer <strong>la</strong> CCN en termes de<br />
précision…<br />
10
compétences – GPEC), l’expertise implique <strong>la</strong> maîtrise totale du domaine <strong>et</strong> sa r<strong>et</strong>ransmission aux autres<br />
professionnels : l’expert maîtrise <strong>et</strong> r<strong>et</strong>ransm<strong>et</strong>s ; il est en quelque sorte centre de ressources pour l’ensemble de<br />
l’organisation, ici mission locale. Ce<strong>la</strong> implique un travail (<strong>et</strong> du temps) de veille (pour actualiser les<br />
connaissances, pour identifier les bonnes pratiques, <strong>et</strong>c.).<br />
Ceci étant, le MCP est-il un « domaine » comme l’est <strong>la</strong> mobilité, <strong>la</strong> lutte contre les discriminations, <strong>la</strong> formation<br />
tout au long de <strong>la</strong> vie, <strong>et</strong>c ? 3 J’aurais tendance à ne pas le croire <strong>et</strong>, même si chaque mission locale peut<br />
s’organiser comme elle le souhaite, il n’est pas inutile de tenter une définition commune. Le MCP est <strong>et</strong> n’est<br />
qu’un outil ; à ce titre, il est mobilisable dans un parcours d’insertion comme le sont d’autres outils (ai<strong>des</strong>, <strong>et</strong>c.).<br />
Mais le MCP exige-t-il une technicité particulière qui le réserverait à <strong>des</strong> conseillers « spécialisés » ? Pas plus,<br />
me semble-t-il, qu’un FAJ <strong>et</strong>, si aujourd’hui ce<strong>la</strong> peut sembler plus compliqué, c’est probablement du fait de <strong>la</strong><br />
nouveauté. Chaque conseiller est en principe à même d’instruire une demande de FAj ou de FIPJ, quitte à ce<br />
que <strong>la</strong> mission locale ait installé une commission interne ou une supervision administrative pour valider <strong>la</strong><br />
recevabilité de <strong>la</strong> demande. L’instruction d’un MCP devrait ne pas poser de difficultés, le calcul du « reste à<br />
vivre » par exemple n’étant pas hors de portée. Si, de plus <strong>et</strong> avec raison, on associe systématiquement le MCP<br />
au proj<strong>et</strong>, <strong>la</strong> logique veut que ce soit le référent du jeune qui ait <strong>la</strong> maîtrise de c<strong>et</strong> outil. Reste que, par exemple<br />
pour les re<strong>la</strong>tions avec <strong>la</strong> banque, il est sans doute plus judicieux que celle-ci ait un interlocuteur unique…<br />
comme, dans bien <strong>des</strong> cas, le ou les professionnels qui participent à une commission FAJ.<br />
La question de l’accessibilité du MCP en interne renverrait donc à quatre points complémentaires :<br />
- Une compétence supplémentaire à acquérir par tous les conseillers sur <strong>la</strong> base d’un outil d’instruction, d’une<br />
formation ou d’un transfert de compétences en interne (le savoir-faire d’une conseillère ESF…). Ce qui semble ici<br />
important <strong>et</strong> noté justement par le groupe est <strong>la</strong> visibilité par les conseillers de l’ensemble <strong>des</strong> outils financiers<br />
mobilisables, leurs conditions respectives d’éligibilité, leurs complémentarités ou non, <strong>et</strong>c. : « Veiller à<br />
l’articu<strong>la</strong>tion <strong>et</strong> <strong>la</strong> complémentarité avec les autres dispositifs existants… » <strong>et</strong> « Créer un document en ligne<br />
comprenant <strong>des</strong> fiches techniques sur les ai<strong>des</strong> nationales/régionales/départementales/locales (cf. catalogue <strong>des</strong><br />
ai<strong>des</strong> sur le site du Carif Poitou Charente). »<br />
- Une organisation (procédure) interne de validation de l’instruction essentiellement sur le vol<strong>et</strong> de <strong>la</strong> conformité :<br />
contrairement au FIPJ, il n’y a pas de risque qu’un refus de MCP soit interprété par le jeune comme m<strong>et</strong>tant en<br />
cause sa re<strong>la</strong>tion avec le conseiller (puisque in fine c’est le banquier qui décide) <strong>et</strong> le « cordon sanitaire » mis en<br />
p<strong>la</strong>ce dans <strong>des</strong> missions locales entre l’instruction <strong>et</strong> <strong>la</strong> décision d’accord n’a pas lieu d’exister.<br />
- Des échanges de pratiques sur ce thème du MCP <strong>et</strong>, plus <strong>la</strong>rgement, <strong>des</strong> prêts pour <strong>des</strong> jeunes en situation<br />
économique précaire (risque de surend<strong>et</strong>tement, logique d’incitation à <strong>la</strong> consommation, <strong>et</strong>c.) : « … motifs de<br />
rej<strong>et</strong> de <strong>la</strong> part <strong>des</strong> acteurs : les à priori, les freins… adossés à <strong>la</strong> question éthique, aux valeurs… »<br />
- La désignation d’un interlocuteur unique pour les re<strong>la</strong>tions avec le banquier. C<strong>et</strong> interlocuteur unique aurait<br />
également en charge le suivi <strong>des</strong> MCP (pour le bi<strong>la</strong>n de fin d’année, <strong>et</strong>c.).<br />
3 Une vingtaine d’expertises peuvent être considérées comme « points de passage obligé » dans toute<br />
mission locale.<br />
11
Groupe 4<br />
Déontologie<br />
Animateur : Jean-Michel GOUBARD, ML Alençon, vice président <strong>ANDML</strong><br />
Secrétaire <strong>et</strong> rapporteure : Anne DUFAUD, ML Vaulx en Velin<br />
Membres du groupe de travail :<br />
Fatiha AYADI (ML Villeneuve Saint Georges Valenton), Sandrine BEAUCOUSIN (ML Agglo d'Elbeuf), Mariehélène<br />
BRUN (ML du p<strong>la</strong>teau Nord val de Saône - Fontaine sur Saône), Béatrice CERTAIN (ML Rurale de<br />
beaune) Muriel CHEVALLIER (ML Les Ulis), Anne DUFAUD (ML Vaulx en velin), Françoise DUPUY (ML du<br />
pays de Cornouaille - Quimper), America FERRAGNE (ML intercommunale <strong>des</strong> Bords de Marne - Le Perreux sur<br />
Marne), Moncef JENDOUBI (ML intercommunale <strong>des</strong> Bords de Marne - Le Perreux sur Marne), Amel KOUZA<br />
(ML Orly Choisy), Dominique LEPAGE (ML du Bergeracois), Elodie MARCOCCIA (ML Vaulx en Velin), Delphine<br />
MARTIN (ML du bassin d'emploi de Rennes) <strong>et</strong> Alexandra VIDAL (ML Les Ulis)<br />
Rappel de <strong>la</strong> note de Philippe LABBE :<br />
Quelles sont les incidences du MCP sur les pratiques d’accompagnement au regard <strong>des</strong> représentations <strong>des</strong><br />
professionnels, représentations sinon difficiles du moins sensibles, dès lors que se combinent re<strong>la</strong>tion <strong>et</strong> argent ?<br />
Si l’interaction « jeune – conseiller » constitue une problématique évidemment importante de ce thème, il faudra<br />
également s’intéresser à l’interaction « mission locale – banque » qui recouvre deux univers distincts, parfois<br />
opposés (monde de l’engagement/monde du profit). D’autres questions seront probablement étudiées telles que<br />
<strong>la</strong> différence de nature entre une allocation de type interstitielle <strong>et</strong> un prêt, l’accent mis sur le contrat plutôt que<br />
sur le mode du don/contre-don, le risque d’un objectif de socialisation qui viserait à construire de « parfaits p<strong>et</strong>its<br />
consommateurs », <strong>et</strong>c.<br />
Idées de départ <strong>et</strong> réflexions :<br />
L’obj<strong>et</strong> a été de réfléchir aux incidences de <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce du microcrédit dans <strong>la</strong> pratique d’accompagnement.<br />
Plusieurs interrogations sont apparues :<br />
- Interrogation sur <strong>la</strong> complémentarité /substitution entres les ai<strong>des</strong> gratuites ou dons <strong>et</strong> le microcrédit.<br />
Remarque : l’aide sous forme de don n’est-elle pas aussi un contrat<br />
- Interrogation sur <strong>la</strong> culture du résultat /objectifs quantitatifs à à atteindre .<br />
Remarque : <strong>la</strong> culture du résultat impacte déjà nos pratiques dans bien d’autres domaines tels<br />
(CIVIS.CPO…)<br />
- Interrogation sur <strong>la</strong> fonction nouvelle de commercialisation d’un produit bancaire. (le passage du public<br />
au privé)<br />
Remarque : en parallèle lorsque nous prescrivons une formation nous perm<strong>et</strong>tons à un organisme de<br />
formation de « vendre son action »<br />
- Interrogation sur les limites, le cadre de ce qui peut être l’obj<strong>et</strong> du prêt.<br />
12
- Interrogation sur le « risque » de ne pas être juste, équitable.<br />
Remarque : importance de définir un cadre d’intervention (ce qui peut faire l’obj<strong>et</strong> du prêt) <strong>et</strong> un cadre de<br />
fonctionnement (commission perm<strong>et</strong>tant une mise à distance)<br />
- Interrogation sur <strong>la</strong> modification de <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion entre le jeune <strong>et</strong> le conseiller (re<strong>la</strong>tion de confiance mise à<br />
mal ou dénaturée par le rapport d’argent …être en situation de refuser…)<br />
Remarques : il existe déjà l’allocation intersticielle CIVIS <strong>et</strong> les ai<strong>des</strong> diverses<br />
- Une nouvelle re<strong>la</strong>tion est initiée : celle du jeune <strong>et</strong> de son banquier<br />
- Interrogation sur l’obligation du jeune <strong>et</strong> le risque d’aggraver sa situation sociale (surend<strong>et</strong>tement…)<br />
- Interrogation sur <strong>la</strong> responsabilité du conseiller vis-à-vis de l’image de sa structure ( par rapport à sa<br />
capacité à évaluer les risques)<br />
Remarque : c<strong>et</strong>te responsabilité est aussi engagée dans d’autres actes professionnels<br />
- Interrogation sur <strong>la</strong> nature du partenariat engagé avec <strong>la</strong> banque (informations sur <strong>la</strong> situation bancaire<br />
<strong>des</strong> jeunes)<br />
- Interrogation sur le risque de « prise en otage »de <strong>la</strong> ML par <strong>la</strong> banque ou les partenaires (renvoyer sur<br />
<strong>la</strong> mission locale <strong>et</strong> le microcrédit <strong>des</strong> deman<strong>des</strong> qui auraient pu faire l’obj<strong>et</strong> d’un crédit c<strong>la</strong>ssique pour<br />
les banques ou d’autres ai<strong>des</strong> pour les partenaires)<br />
Remarque : IL SERA ESSENTIEL POUR LES MISSIONS LOCALES D ETRE GARANTES DU SENS DU<br />
MICROCREDIT<br />
Pour terminer :<br />
Le microcrédit est un outil de <strong>la</strong> « panoplie » du conseiller qui a <strong>des</strong> particu<strong>la</strong>rités en terme :<br />
- de temps (se situer sur une étape précise du parcours, complémentaire <strong>des</strong> autres dispositifs)<br />
- de sens (introduction de <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion commerciale) le microcrédit est au service du jeune (perm<strong>et</strong> l’accès à<br />
l’autonomie <strong>la</strong> prise de responsabilité…)<br />
- de déontologie : il faudra travailler à l’obj<strong>et</strong> du prêt, sa particu<strong>la</strong>rité <strong>et</strong> à l’égalité de traitement.<br />
Note technique de Philippe Labbé<br />
Groupe 4 – Octobre 2008<br />
Avec le MCP, les questions déontologiques sont c<strong>la</strong>ssiquement nombreuses puisque est en jeu une<br />
problématique d’argent dans une re<strong>la</strong>tion d’accompagnement. Ainsi <strong>la</strong> première réflexion du groupe :<br />
« Interrogation sur <strong>la</strong> complémentarité /substitution entre les ai<strong>des</strong> gratuites ou dons <strong>et</strong> le microcrédit. Remarque<br />
: l’aide sous forme de don n’est-elle pas aussi un contrat ? » On touche là un suj<strong>et</strong> (très) sensible en mission<br />
locale <strong>et</strong> sur lequel il faut préciser quelques points… en particulier l’opposition entre « aide » <strong>et</strong> « MCP ». L’aide<br />
est p<strong>la</strong>cée dans un registre qui serait celui du don alors que le MCP appartiendrait à un registre marchand qui<br />
serait celui du contrat. Il faut donc faire un détour sur les notions de don <strong>et</strong> de contrat. Détour certes un peu<br />
théorique… mais <strong>la</strong> problématique est si récurrente qu’il faut bien l’éc<strong>la</strong>ircir.<br />
13
En mission locale, nous sommes en eff<strong>et</strong>, quelles que soient les formes <strong>des</strong> ai<strong>des</strong>, c’est-à-dire <strong>des</strong> allocations,<br />
<strong>des</strong> secours ou <strong>des</strong> prêts, dans une re<strong>la</strong>tion contractuelle : une allocation ou un secours n’impliquant pas de<br />
remboursement financier n’en exige pas moins une forme de remboursement qui s’exprime par <strong>la</strong> notion de<br />
conditionnalité, par exemple démontrer une démarche de « recherche active d’emploi » ou s’engager dans un<br />
parcours d’insertion. Le don appelle le contre-don 4 <strong>et</strong> est une modalité d’échange dans <strong>des</strong> systèmes<br />
idéologiquement construits, cohérents <strong>et</strong> partagés. Ainsi, par exemple, le don est une modalité <strong>des</strong> transactions<br />
dans <strong>des</strong> « communautés » humaines. Le don appartient au registre de <strong>la</strong> « socialité primaire », celle de<br />
l’interconnaissance, de l’amour, de l’amitié, <strong>des</strong> voisins, de <strong>la</strong> communauté, alors que le contrat appartient au<br />
registre de <strong>la</strong> « socialité secondaire », celle qui appelle l’intermédiation <strong>et</strong> le professionnel – tant il est vrai qu’un<br />
proj<strong>et</strong> d’insertion n’est pas synonyme d’une conversation devant un comptoir de bistrot. La socialité secondaire<br />
est une « transaction entre deux partenaires {qui} s’établit pour arriver, en principe, à une solution de compromis<br />
qui satisfera chacun, éteindra les d<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> fera disparaître un lien interpersonnel devenu inutile. » 5 Et fort<br />
heureusement qu’une fois le proj<strong>et</strong> d’insertion abouti, ce lien interpersonnel entre le jeune <strong>et</strong> le conseiller devient<br />
inutile ! Imaginons l’inverse un instant… Il faut donc naviguer entre un re<strong>la</strong>tionnel « purifié » <strong>des</strong> scories de <strong>la</strong><br />
compassion, du sacrifice de soi, <strong>et</strong> un re<strong>la</strong>tionnel « aseptisé » réduit à sa seule dimension instrumentale. C’est<br />
évidemment complexe <strong>et</strong> l’on peut dire que l’accompagnement dans le proj<strong>et</strong> d’insertion n’exclut pas le don<br />
(qu’on préfèrera appeler « l’engagement ») mais que celui-ci est enchâssé à l’intérieur d’un modèle contractuel<br />
où <strong>la</strong> transaction subordonne le don.<br />
En mission locale <strong>et</strong> plus <strong>la</strong>rgement dans <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion de socialisation ou pédagogique professionnelle, un<br />
secours n’est pas un cadeau, ni un don mais c’est bien le contrat qui est <strong>la</strong> modalité de transaction.<br />
P<strong>la</strong>cer ce qui est un contrat dans un registre qui serait celui du don reviendrait à ne pas se situer comme<br />
professionnel mais comme acteur caritatif… ce qui n’est en principe pas le cas d’un conseiller de mission locale<br />
qui, sauf rares exceptions (jamais rencontrées), n’est pas bénévole. Autrement formulé, <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion de<br />
socialisation est déterminée en amont par le fait que le professionnel est payé pour l’effectuer… ceci n’excluant<br />
pas qu’une dimension affective (dans <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion duelle) ou idéologique (dans, par exemple, l’engagement du<br />
professionnel) soit présente. Se penser dans un système dominant de don/contre-don serait, d’une part, nier <strong>la</strong><br />
réalité de sa position de professionnel (rémunéré) <strong>et</strong>, d’autre part, p<strong>la</strong>cer le travail d’insertion dans une logique<br />
compassionnelle. Bref, tout l’inverse d’un professionnalisme qui, pour être outillé, n’en devient pas pour autant<br />
« g<strong>la</strong>cial », purement technique. 6<br />
C<strong>et</strong>te problématique de se situer comme acteur désintéressé 7 , bénévole ou caritatif, est encore présente<br />
lorsqu’on lit « Interrogation sur <strong>la</strong> fonction nouvelle de commercialisation d’un produit bancaire (le passage du<br />
public au privé). En parallèle lorsque nous prescrivons une formation nous perm<strong>et</strong>tons à un organisme de<br />
4 Et même plus pour Marcel Mauss <strong>et</strong> son célèbre ouvrage fondateur L’essai sur le don (1925 – Sociologie <strong>et</strong><br />
Anthropologie, 1968, PUF)). L’échange par le don suppose trois obligations : faire <strong>des</strong> cadeaux, les accepter <strong>et</strong><br />
les rendre. Dans un texte antérieur (« Gift, gift » Mé<strong>la</strong>nges offerts à Charles André par ses amis <strong>et</strong> ses<br />
élèves,1924, ISTRA), Marcel Mauss écrivait : « La chose reçue en don, <strong>la</strong> chose reçue en général, lie<br />
magiquement, religieusement, moralement, juridiquement le donateur <strong>et</strong> le donataire. Venant de l’un, fabriquée<br />
par lui, étant de lui (<strong>la</strong> chose donnée) confère pouvoir sur l’autre qui l’accepte. » Il n’est pas certain <strong>et</strong> il est encore<br />
moins souhaitable que les professionnels de mission locale apprécient de se r<strong>et</strong>rouver dans c<strong>et</strong>te posture…<br />
5 Paul Fustier, Le lien d’accompagnement. Entre don <strong>et</strong> contrat sa<strong>la</strong>rial, 2000, Dunod, p. 10.<br />
6 Il faut en plus se défier de ce que peut signifier ou, plus exactement, camoufler c<strong>et</strong>te idéologie du don. En<br />
particulier parce qu’elle perm<strong>et</strong> d’exiger d’un jeune un investissement qui, lui, appartient au registre de <strong>la</strong> socialité<br />
primaire : l’investissement de sa personne, parfois dans ses dimensions les plus intimes… le aussi fameux<br />
qu’indéfinissable « savoir-être ». Ce<strong>la</strong> perm<strong>et</strong> d’évacuer le système de contraintes voire de menaces (depuis le<br />
refus d’une allocation jusqu’à, pour l’ANPE ou l’Assedic, <strong>la</strong> radiation), toutes choses guère éloignées du<br />
« mensonge social » dont par<strong>la</strong>it Marcel Mauss : ce que l’on prend pour de <strong>la</strong> gratuité résulte en fait d’un<br />
caractère obligatoire, le climat psychoaffectif perm<strong>et</strong>tant d’adoucir c<strong>et</strong>te obligation. Une main de fer dans un gant<br />
de velours…<br />
7 Peut-être – à creuser – parce qu’existerait inconsciemment une culpabilité de gagner sa vie sur « <strong>la</strong> misère du<br />
monde » (Pierre Bourdieu). A creuser…<br />
14
formation de « vendre son action ». » Ici, sont opposées deux économies, l’une publique <strong>et</strong> l’autre marchande.<br />
Mais raisonner ainsi est contre-productif, parvenant en fait à conforter un discours, parfaitement rodé <strong>et</strong> répété à<br />
l’envi, dont le message central est de faire croire que seule l’économie marchande serait productive alors que<br />
l’économie publique ou associative serait par nature dépensière. Or l’économie publique comme l’économie<br />
sociale sont productrices de richesses… économiques au sens financier : éviter qu’un jeune soit désinséré, c’est<br />
éviter <strong>des</strong> coûts sociaux, c’est perm<strong>et</strong>tre qu’il devienne lui-même producteur de richesses. D’autre part, il y aurait<br />
une séparation entre le « prescripteur » (<strong>la</strong> mission locale) <strong>et</strong> l’opérateur, ici un organisme de formation, ce<br />
dernier appartenant au monde marchand ce qui déductivement signifierait que le prescripteur qui lui est opposé<br />
n’en ferait pas partie. Or, bien sur, l’un <strong>et</strong> l’autre s’inscrivent dans un système d’échanges qui sont, entre autres,<br />
financiers.<br />
Une autre précision doit être apportée lorsqu’on lit que le MCP s’inscrirait dans une « culture du résultat /objectifs<br />
quantitatifs à atteindre. {…} La culture du résultat impacte déjà nos pratiques dans bien d’autres domaines tels<br />
(CIVIS.CPO…). » On comprend bien ce qui est ici signifié mais, là encore, les mots ont leur importance…<br />
singulièrement lorsqu’il s’agit d’un débat éthique. Car il ne faut pas confondre « obligation de résultats » <strong>et</strong><br />
« culture du résultat ». Que chaque professionnel individuellement <strong>et</strong> que <strong>la</strong> mission locale collectivement aient<br />
une culture du résultat semblent être un minimum requis. Imagine-t-on un professionnel ne se souciant pas<br />
d’obtenir <strong>des</strong> résultats, voire se satisfaisant d’être inefficace ? C<strong>et</strong>te culture du résultat doit au contraire être<br />
présente de façon permanente – on travaille pour que les jeunes s’insèrent, ce qui constitue un résultat<br />
visé – <strong>et</strong> très probablement l’est d’autant plus que l’on s’adresse à <strong>des</strong> personnes rencontrant <strong>des</strong><br />
difficultés : plus en face de soi <strong>la</strong> problématique est humaine <strong>et</strong> dense, plus le professionnel doit<br />
éthiquement s’engager <strong>et</strong> ne peut pas s’en tenir à un minimum conventionnel : « La fonction<br />
d’accompagnement intervient là où il y a ruptures fractures, isolement, failles dans <strong>la</strong> socialisation. » (Mae<strong>la</strong> Paul,<br />
L’accompagnement : une posture professionnelle spécifique, 2004, L’Harmattan, p. 84). L’obligation de résultats<br />
participe d’un autre système de pensée auquel, effectivement, il faut être capable de s’opposer. Pour au moins<br />
deux raisons. D’une part, l’obligation de résultats s’inscrit dans un mode de pensée déterministe <strong>et</strong> causal : A sur<br />
B donne C… alors que, dans <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion humaine, A sur B donne C’, le ‘ étant précisément l’indication que <strong>la</strong><br />
personne n’est pas un obj<strong>et</strong> mais un suj<strong>et</strong>, donc avec sa liberté, sa capacité de ne pas aller où on veut le<br />
conduire, <strong>et</strong>c. D’autre part, l’obligation de résultats impliquerait qu’a minima le conseiller ait toutes les cartes en<br />
mains… or que le jeune s’insère professionnellement dépend bien sûr du jeune lui-même <strong>et</strong> de sa conviction (sur<br />
<strong>la</strong>quelle on attend que l’influence de l’accompagnement produise <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s) mais dans une très <strong>la</strong>rge mesure de<br />
facteurs externes sur lesquels le professionnel n’a pas de prises : une mission locale ne crée pas, sauf à <strong>la</strong><br />
marge (IAE), d’emplois. Comment donc exiger une obligation de résultats… comme si on exigeait d’un cuisinier<br />
qu’il prépare <strong>et</strong> réussisse un p<strong>la</strong>t sans avoir tous les ingrédients nécessaires à sa confection ?<br />
Autrement dit, ce n’est pas <strong>la</strong> « culture du résultat » qui impacte les pratiques mais c’est bien « l’obligation de<br />
résultats » : il faut tout au contraire revendiquer une culture du résultat ; c’est bien <strong>la</strong> moindre <strong>des</strong> choses <strong>et</strong> c’est<br />
en plus 1) être en cohérence avec le principe selon lequel tout jeune peut s’insérer 2) se relier à <strong>la</strong> généalogie<br />
<strong>des</strong> missions locales qui sont issues de l’éducation popu<strong>la</strong>ire (donc <strong>des</strong> théories de l’engagement : on s’engage<br />
dans une perspective de changement social). On doit donc viser à ce que 100% <strong>des</strong> jeunes accèdent à un<br />
emploi de qualité, <strong>et</strong> non pas 50% à un « emploi durable », mais l’évaluation de ce que l’on fait pour y parvenir<br />
doit être mobilisée sur les réalisations - comment s’y prend-t-on ? – <strong>et</strong> non exclusivement sur les résultats.<br />
Sur ce thème de l’obligation de résultats, il faut enfin noter que, concernant le MCP, il n’y a pas d’objectifs<br />
quantitatifs. La seule question que l’on peut-doit poser est : « si effectivement les jeunes vivent <strong>des</strong> situations<br />
économiques difficiles, précaires, comment se fait-il que les moyens mis à disposition soient si peu utilisés ? »<br />
Mais c’est une question qui ne se limite pas au MCP…<br />
Deux thématiques, par contre, me semblent parfaitement devoir être étudiées avec une perspective<br />
déontologique.<br />
15
« Interrogation sur <strong>la</strong> modification de <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion entre le jeune <strong>et</strong> le conseiller », non pas sur le vol<strong>et</strong> d’une<br />
« re<strong>la</strong>tion de confiance mise à mal ou dénaturée par le rapport d’argent » (pour les raisons exposées supra : on<br />
n’est pas dans un système de don/contre-don mais dans celui d’une re<strong>la</strong>tion contractuelle fondée sur une<br />
objectivation <strong>des</strong> intérêts réciproques), mais sur celui « d’être en situation de refuser ». Avec cependant une<br />
limite : le refus n’appartient pas au conseiller puisque c’est <strong>la</strong> banque qui, en dernier ressort, accepte ou refuse<br />
d’accorder le prêt. Le refus peut par contre être celui de l’instruction <strong>et</strong> de <strong>la</strong> recevabilité de <strong>la</strong> demande. La<br />
solution technique, issue d’une étude précisément conduite sur les eff<strong>et</strong>s <strong>des</strong> ai<strong>des</strong> concernant les pratiques<br />
d’accompagnement dans les missions locales de Br<strong>et</strong>agne (2007-2008), semble être de dissocier dans <strong>la</strong><br />
mission locale ce qui est du registre de l’instruction dans le cadre de l’accompagnement de <strong>la</strong> démarche<br />
d’insertion, à <strong>la</strong> charge du conseiller référent <strong>et</strong> sous sa responsabilité, <strong>et</strong> ce qui est du registre de <strong>la</strong> décision<br />
faisant suite au dossier, à <strong>la</strong> charge de <strong>la</strong> direction <strong>et</strong>/ou d’une commission ad hoc (interne pour le FIPJ ou<br />
externe pour le FAJ). Ce que le groupe a r<strong>et</strong>enu en indiquant « importance de définir un cadre d’intervention (ce<br />
qui peut faire l’obj<strong>et</strong> du prêt) <strong>et</strong> un cadre de fonctionnement (commission perm<strong>et</strong>tant une mise à distance). »<br />
« Introduction de <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion commerciale (dans <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion d’accompagnement) ». Le travail d’insertion<br />
correspond à un travail de socialisation. En mission locale, le concept-clé est celui d’approche globale <strong>et</strong>, sauf<br />
erreur, le commerce, c’est-à-dire l’échange de biens contre de l’argent, fait partie de <strong>la</strong> vie ordinaire. Chacun fait<br />
ses courses <strong>et</strong> probablement peut-on dire, voire regr<strong>et</strong>ter, qu’aujourd’hui dans <strong>la</strong> société hyper-matérialiste, ce<br />
qui fait lien est de plus en plus <strong>la</strong> possibilité de consommer. C’est ce que l’on appelle <strong>la</strong> « marchandisation » <strong>des</strong><br />
rapports sociaux. Il n’est qu’à observer <strong>la</strong> fonction sociale <strong>des</strong> super <strong>et</strong> hypermarchés : on y vient pour ach<strong>et</strong>er<br />
mais également pour rêver, pour rencontrer, <strong>et</strong>c. Lorsque l’on vise via le processus d’insertion une intégration du<br />
jeune qui repose sur l’exercice d’un emploi <strong>et</strong> sur une autonomie sociale, l’exercice de l’emploi bien sûr perm<strong>et</strong><br />
au jeune de s’inclure dans <strong>la</strong> communauté humaine via <strong>la</strong> communauté professionnelle (inclusion,<br />
reconnaissance, sentiment d’utilité, <strong>et</strong>c.) mais il perm<strong>et</strong> l’indépendance économique… donc <strong>la</strong> possibilité de<br />
consommer. La re<strong>la</strong>tion commerciale fait donc partie, très banalement, de <strong>la</strong> vie <strong>et</strong> l’on ne doit pas l’opposer à<br />
une sorte d’ineffable humain, dégagé <strong>des</strong> contingences matérielles, <strong>et</strong>c. Il en est ainsi pour le jeune dans son<br />
rapport à l’environnement ; il en est de même dans <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion entre le jeune <strong>et</strong> le conseiller : elle n’est pas<br />
commerciale mais elle est contractuelle <strong>et</strong> elle mobilise <strong>des</strong> contractants qui, chacun, ont <strong>des</strong> intérêts objectifs…<br />
sociaux, symboliques… <strong>et</strong> matériels.<br />
Une dernière interrogation évoque « le « risque » de ne pas être juste, équitable » mais c<strong>et</strong>te justice (en fait<br />
renvoyant au principe d’égalité de traitement) <strong>et</strong> c<strong>et</strong>te équité sont posées pour tout acte du professionnel dans <strong>la</strong><br />
re<strong>la</strong>tion d’accompagnement. Il ne me semble pas y avoir de particu<strong>la</strong>rité avec le MCP… sinon que, précisément,<br />
celui-ci se fonde sur un principe d’équité (faire plus pour celles <strong>et</strong> ceux qui ont moins) puisqu’il s’agit d’aider <strong>des</strong><br />
jeunes qui n’ont pas accès au prêt bancaire conventionnel. Quant au « risque d’aggraver sa situation sociale<br />
(surend<strong>et</strong>tement…) », il est à traiter sur c<strong>et</strong>te même base : c’est le jugement du professionnel, en fait son<br />
expertise <strong>et</strong> son professionnalisme, qui doit éviter ce risque <strong>et</strong> c’est plutôt un problème technique (savoir<br />
apprécier les capacités de remboursement, apprécier <strong>la</strong> pertinence du recours au MCP plutôt qu’un autre<br />
dispositif…) qu’un problème déontologique.<br />
16
Groupes 5 (A <strong>et</strong> B)<br />
Les outils du Microcrédit<br />
Groupe 5 A<br />
Animateur : Philippe Jourdan, ML Rennes, administrateur <strong>ANDML</strong><br />
Rapporteure : Muriel CHEVALLIER, ML les Ulis<br />
Secrétaire : Solenn Ravalec, <strong>ANDML</strong><br />
Membres du groupe de travail :<br />
Rachel BERTHIER (ML du pays de Fougères), Mé<strong>la</strong>nie BONNEVAL (ML Technowest - Mérignac), Béatrice<br />
CERTAIN (ML Rurale de Beaune), Wafé CHAUVIN (ML Saint Quentin en Yvelines), Muriel CHEVALLIER (ML<br />
Les Ulis), Isabelle CLOT ( ML du p<strong>la</strong>teau Nord Val de Saône - Fontaine sur Saône), Isabelle COUQUET (ML<br />
Antipolis - Antibes), Emilie DUBOSC (ML du p<strong>la</strong>teau de Caux Vallée de Seine - Lillebonne), Françoise DUPUY<br />
(ML du pays de Cornouaille), Françoise DUSSERRE (ML Jeunes 05 – Gap), Valérie EDOUARD (ML de <strong>la</strong> Haute<br />
Saintonge - Jonzac), Denis FORTIER (ML Angevine), Odile GASSER (ML du Talou - Les Gran<strong>des</strong> Ventes),<br />
Joëlle LEFRANCOIS (ML Val de Reuil-Louviers-Andelle), Stéphanie LENOIR (ML Agglo d'Elbeuf), Thierry<br />
LOPES (ML rurale <strong>des</strong> marches de Bourgogne - Chatillon sur Seine), Florence LUCET (ML de l'arrondissement<br />
de Saint-Omer), Murielle MADELENAT (ML Vesoul), Delphine MARTIN (ML du bassin d'emploi de Rennes),<br />
Fabien MICHEL (ML Orly Choisy), Solenn RAVALEC (<strong>ANDML</strong>), Emmanuelle RONDEAU (ML de l'agglo<br />
mancelle), Christelle ROUSSEAU (ML du pays d'Alençon), Lina VINCENT SULLY (ML Val de Reuil-Louviers-<br />
Andelle) <strong>et</strong> Alexandra VIDAL (ML Les Ulis)<br />
Rappel de <strong>la</strong> note de Philippe LABBE :<br />
Ce groupe s’intéressera aux différents outils tels que l’évaluation sociale de l’opportunité du MCP <strong>et</strong> l’évaluation<br />
de <strong>la</strong> situation budgétaire du demandeur (le « reste à vivre », par exemple), le suivi sur l’utilisation du MCP, les<br />
conventions… L’objectif est à terme de proposer <strong>des</strong> outils d’instruction <strong>et</strong> de suivi simples d’utilisation,<br />
harmonisés à l’échelle du réseau de telle façon à perm<strong>et</strong>tre <strong>des</strong> traitements agrégés.<br />
Idées de départ :<br />
Dans un premier temps, il importe de recenser les outils préexistants en matière d’ai<strong>des</strong> aux jeunes. La Mission<br />
Locale de Vesoul réalise actuellement un tableau récapitu<strong>la</strong>tif de ces outils, qui sera transmis, via le blog, à <strong>la</strong> fin<br />
du mois d’Août. Il existe en eff<strong>et</strong> <strong>des</strong> prêts dans le cadre du Fonds d’Ai<strong>des</strong> aux Jeunes <strong>et</strong> les Missions Locales ne<br />
doivent pas empiéter sur le champ du caritatif qui propose déjà du Microcrédit personnel.<br />
Il est proposé de créer plusieurs outils pour encadrer le dispositif du Microcrédit :<br />
- une fiche technique à <strong>des</strong>tination <strong>des</strong> conseillers, qui serait réalisée par l’<strong>ANDML</strong> <strong>et</strong> qui poserait le cadre<br />
global du Microcrédit, en rappe<strong>la</strong>nt les objectifs de <strong>la</strong> convention signée avec <strong>la</strong> Caisse <strong>des</strong> Dépôts notamment<br />
(cf : module 1 de formation MCP)<br />
- une fiche interne de prescription (ou fiche de liaison), en amont du dossier d’instruction, qui perm<strong>et</strong>trait une<br />
première expertise sur l’éligibilité du proj<strong>et</strong> du jeune à un dossier de microcrédit personnel<br />
- Une fiche à <strong>des</strong>tination <strong>des</strong> partenaires <strong>des</strong> Missions Locales qui reprendrait en partie le contenu de <strong>la</strong> fiche<br />
technique <strong>et</strong> indiquerait le nom du référent à contacter. C<strong>et</strong>te fiche est également le moyen de communiquer<br />
auprès <strong>des</strong> partenaires sur les nouveaux dispositifs<br />
17
- Le dossier d’instruction, dont <strong>la</strong> réalisation pourrait s’appuyer sur l’outil de Finances <strong>et</strong> Pédagogie. Ce dernier<br />
devra être adapté au public <strong>des</strong> Missions locales <strong>et</strong> simplifié. Le conseiller <strong>et</strong> le jeune pourraient compléter<br />
ensemble ce dossier. L’<strong>ANDML</strong> diffusera prochainement c<strong>et</strong> outil aux membres du groupe qui pourront en r<strong>et</strong>our<br />
proposer leurs modifications en vue de l’adapter<br />
- Un outil de suivi ou tableau de bord sera mis en p<strong>la</strong>ce perm<strong>et</strong>tant ainsi au référent d’avoir un accès rapide à<br />
un dossier de microcrédit, pouvant vérifier <strong>la</strong> situation du jeune <strong>et</strong> les remboursements de ses échéances, <strong>et</strong><br />
décider de rééchelonner, si nécessaire <strong>et</strong> en lien avec le partenaire bancaire, les microcrédits personnels qui ne<br />
seraient pas honorés pour <strong>des</strong> raisons liées à un changement de revenu…<br />
C<strong>et</strong> outil devra renseigner les caractéristiques du jeune (un lien microcrédit avec P3 est à réfléchir).<br />
Il devra également indiquer:<br />
- Si le dossier à été présenté / validé / honoré / avec quel taux / sur quelle durée / pour quel montant / quelle<br />
procédure de rééchelonnement a été mise en p<strong>la</strong>ce (si problème)….,<br />
- le niveau de ressources du jeune<br />
- son proj<strong>et</strong> de vie<br />
- <strong>la</strong> valeur ajoutée offerte par le MCP<br />
- une partie re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion avec le partenaire bancaire sur <strong>la</strong> durée <strong>des</strong> prêts sera à compléter<br />
- les raisons <strong>des</strong> refus d’octroi <strong>et</strong> les modalités de réorientation par les conseillers<br />
C<strong>et</strong> outil devra respecter <strong>la</strong> loi Informatique <strong>et</strong> Libertés <strong>et</strong> se plier aux conditions garanties par <strong>la</strong> CNIL pour ce<br />
qui concerne les questions que soulèvent les conseillers auprès de jeunes.<br />
Plusieurs questions sont soulevées :<br />
1. En ce qui concerne le dossier d’instruction, il est impératif de travailler en lien avec les groupes de travail<br />
« Typologie <strong>des</strong> publics » <strong>et</strong> « Typologie <strong>des</strong> obj<strong>et</strong>s » <strong>et</strong> « Accessibilité » pour ce qui concerne les outils<br />
de communication.<br />
Ce dossier doit éviter à tous prix de faire scoring en excluant, quitte à ce que celui-ci soit conçu à l’envers, les<br />
conditions habituelles d’inéligibilité devenant <strong>des</strong> conditions d’éligibilité…. Il doit au contraire perm<strong>et</strong>tre de déceler<br />
les informations qui pointent <strong>la</strong> précarité <strong>et</strong> <strong>la</strong> pauvr<strong>et</strong>é.<br />
2. Le dossier de suivi ou tableau de bord pose <strong>la</strong> question <strong>des</strong> jeunes qui contractent un prêt à 25 ans sur<br />
3 ans : comment organiser le suivi d’un jeune qui a quitté <strong>la</strong> ML (question de l’allongement de <strong>la</strong><br />
jeunesse <strong>et</strong> de sa prise en compte dans le dispositif de suivi du MCP) ?<br />
Ce<strong>la</strong> ouvre deux hypothèses. Ou un conventionnement spécifique perm<strong>et</strong>tant d’aller au-delà <strong>des</strong> « 25 ans<br />
révolus » pour les jeunes concernés… mais il y en aura probablement peu à l’échelle d’une mission locale. Ou,<br />
plus judicieux, un accord de partenariat avec l’organisme ad hoc<br />
Groupe 5 B<br />
Animatrice : Annie Jeanne, ML Rouen, Présidente <strong>ANDML</strong><br />
Rapporteure : Wafé Chauvin, ML St Quentin en Yvelines<br />
Membres du groupe de travail :<br />
Rachel BERTHIER (ML du pays de Fougères), Mé<strong>la</strong>nie BONNEVAL (ML Technowest - Mérignac), Béatrice<br />
CERTAIN (ML Rurale de Beaune), Wafé CHAUVIN (ML Saint Quentin en Yvelines), Muriel CHEVALLIER (ML<br />
Les Ulis), Isabelle CLOT ( ML du p<strong>la</strong>teau Nord Val de Saône - Fontaine sur Saône), Isabelle COUQUET (ML<br />
18
Antipolis - Antibes), Emilie DUBOSC (ML du p<strong>la</strong>teau de Caux Vallée de Seine - Lillebonne), Françoise DUPUY<br />
(ML du pays de Cornouaille), Françoise DUSSERRE (ML Jeunes 05 – Gap), Valérie EDOUARD (ML de <strong>la</strong> Haute<br />
Saintonge - Jonzac), Denis FORTIER (ML Angevine), Odile GASSER (ML du Talou - Les Gran<strong>des</strong> Ventes),<br />
Joëlle LEFRANCOIS (ML Val de Reuil-Louviers-Andelle), Stéphanie LENOIR (ML Agglo d'Elbeuf), Thierry<br />
LOPES (ML rurale <strong>des</strong> marches de Bourgogne - Chatillon sur Seine), Florence LUCET (ML de l'arrondissement<br />
de Saint-Omer), Murielle MADELENAT (ML Vesoul), Delphine MARTIN (ML du bassin d'emploi de Rennes),<br />
Fabien MICHEL (ML Orly Choisy), Solenn RAVALEC (<strong>ANDML</strong>), Emmanuelle RONDEAU (ML de l'agglo<br />
mancelle), Christelle ROUSSEAU (ML du pays d'Alençon), Lina VINCENT SULLY (ML Val de Reuil-Louviers-<br />
Andelle) <strong>et</strong> Alexandra VIDAL (ML Les Ulis)<br />
Les propositions suivantes ont été dégagées :<br />
1) Rechercher <strong>des</strong> documents déjà produits sur le MCP <strong>et</strong> expérimentés tel que les outils pédagogiques<br />
de Finances <strong>et</strong> Pédagogie<br />
‣ documents à amender <strong>et</strong> adapter à notre contexte <strong>et</strong> public<br />
2) Les conventions, documents à signer entre d’une part le partenaire bancaire <strong>et</strong> <strong>la</strong> Mission Locale <strong>et</strong><br />
d’autre part <strong>la</strong> Caisse de Dépôt <strong>et</strong> <strong>la</strong> Mission Locale.<br />
‣ Un formu<strong>la</strong>ire type sera mis en ligne sur le blog.<br />
Certaines banques proposent <strong>des</strong> chartes.<br />
‣ Il serait judicieux de rédiger une charte commune <strong>des</strong> accompagnants ML. Elle prendrait en<br />
compte toutes les spécificités de notre public caractérisé par <strong>la</strong> discontinuité <strong>des</strong> situations sur<br />
le p<strong>la</strong>n professionnel. Alençon <strong>et</strong> Angers ont déjà signé <strong>des</strong> chartes puisque ces Missions<br />
locales ont déjà mis en p<strong>la</strong>ce <strong>des</strong> microcrédits.<br />
Le groupe a souligné l’importance d’avoir un interlocuteur physique repérable au niveau de <strong>la</strong> banque <strong>et</strong><br />
joignable en cas de difficulté de parcours d’un jeune par exemple.<br />
3) M<strong>et</strong>tre en p<strong>la</strong>ce un document d’engagement avec présentation succincte par le jeune de son proj<strong>et</strong><br />
(document signé par le jeune)<br />
4) M<strong>et</strong>tre en p<strong>la</strong>ce un outil de co-évaluation avec le bénéficiaire. C<strong>et</strong>te formalisation aurait l’avantage<br />
d’encourager le jeune à s’approprier davantage son proj<strong>et</strong> au fur <strong>et</strong> à mesure qu’on avancera. Les collègues<br />
ayant déjà mis en p<strong>la</strong>ce <strong>des</strong> microcrédits ont constaté qu’ils réussissaient à accrocher le jeune pour travailler<br />
sur son budg<strong>et</strong>.<br />
5) M<strong>et</strong>tre en p<strong>la</strong>ce un outil d’évaluation : outil qui doit perm<strong>et</strong>tre de suivre en interne le proj<strong>et</strong> depuis son<br />
amorce jusqu’au bi<strong>la</strong>n final en passant par les différentes étapes du déroulement.<br />
‣ Veiller à ne pas faire une trame trop fermée.<br />
‣ Identification dans Parcours 3 : le suj<strong>et</strong> va être confié à un groupe de réflexion (Jean-François<br />
Rebiffé référent P3 <strong>et</strong> directeur ML Gap, ML Anger déjà engagée dans le MCP, Eric Augade ML<br />
Tarbes pionnière P3 …) afin de proposer <strong>des</strong> items en rapport avec le Microcrédit à tout le réseau<br />
!<br />
Il n’existe pas de note technique pour le groupe 5<br />
19
Groupe 6<br />
Organisation interne de <strong>la</strong> Mission<br />
Locale<br />
Animateur : Joseph Legrand<br />
Rapporteur : Régis Barbier<br />
Membres du groupe de travail :<br />
Fatiha AYADI ( ML Villeneuve Saint Georges Valenton), Régis BARBIER (ML rurale de Beaune), Isabelle<br />
BONFY ( ML Vaulx en Velin), Marie-Hélène BRUN ( ML du p<strong>la</strong>teau Nord val de Saône - Fontaine sur Saône),<br />
Anne DUFAUD (ML Vaulx en Velin), Julie GILBERT D'HALLUIN ( ML du pays de Caux vallée de Seine -<br />
Lillebonne), Moncef JENDOUBI (ML intercommunale <strong>des</strong> Bords de Marne - Le Perreux sur Marne), Odile<br />
LANDEAU (ML Rhône Sud Est - Saint Fons), Joseph LEGRAND (ML du pays de Fougères),<strong>et</strong> Dominique<br />
LEPAGE (ML du bergeracois)<br />
Rappel de <strong>la</strong> note de Philippe LABBE :<br />
Organisation interne avec les tâches <strong>et</strong> compétences <strong>des</strong> référents MCP, leur formation, leur responsabilité, les<br />
conditions d’information de l’équipe, les procédures en particulier en ce qui concerne l’articu<strong>la</strong>tion du MCP <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />
autres ai<strong>des</strong> (FIPJ, FAJ…). Organisation externe avec le système bancaire, le réseau d’acteurs (orientation <strong>et</strong><br />
prescription), les collectivités territoriales susceptibles d’intervenir dans le dispositif (garanties complémentaire à<br />
celle de <strong>la</strong> Caisse <strong>des</strong> Dépôts <strong>et</strong> Consignation)…<br />
Idée de départ <strong>et</strong> réflexions concernant l’organisation interne:<br />
Les participants ont souligné :<br />
- que l’organisation r<strong>et</strong>enue était avant tout dictée par celle existante ;<br />
- que <strong>la</strong> montée en charge conduirait certainement à une évolution de l’organisation car, faute de<br />
pratique, il est aujourd’hui impossible de définir le temps qui sera consacré aux dossiers de<br />
microcrédit ;<br />
- que, si une vigi<strong>la</strong>nce s’impose pour éviter toute dérive de l’aide vers le prêt, le passage d’une<br />
« logique d’aide » à une logique complémentaire de facilitation dans l’octroi de prêts bancaires<br />
nécessite aussi une action volontariste au sein <strong>des</strong> équipes<br />
- que <strong>la</strong> recherche-action <strong>et</strong> le travail au niveau <strong>des</strong> sites perm<strong>et</strong>traient de partager les<br />
expériences <strong>et</strong> de développer ce nouvel outil dans les meilleures conditions.<br />
Propositions :<br />
Deux grands types d’organisation se <strong>des</strong>sinent :<br />
- une centralisation avec deux référents en charge du montage <strong>des</strong> dossiers <strong>et</strong> de leurs suivis, <strong>des</strong><br />
re<strong>la</strong>tions avec les partenaires, notamment les banques, <strong>et</strong> de l’animation interne :<br />
o commission interne « tournante »<br />
o journée d’équipe pour échanger <strong>et</strong> définir le rôle de chacun<br />
o communication sur l’exemp<strong>la</strong>rité d’un dossier en réponse au besoin « particulier » d’un<br />
jeune<br />
20
Les référents actuels du MCP dans les ML ont une « orientation sociale » <strong>et</strong> sont très souvent en<br />
charge du suivi logement ou vie sociale. Ce peut être <strong>des</strong> CESF qui assurent déjà <strong>la</strong> pédagogie<br />
autour de <strong>la</strong> gestion budgétaire.<br />
- un outil mis en œuvre par chaque conseiller avec une coordination centralisée (vérification <strong>des</strong><br />
dossiers, re<strong>la</strong>tions avec les banques <strong>et</strong> les partenaires). Ce modèle correspond plus aux missions<br />
locales « éc<strong>la</strong>tées » autour de plusieurs antennes <strong>et</strong> d’un grand territoire. Un effort de formation plus<br />
important apparaît nécessaire, de même en matière de communication entre les conseillers <strong>et</strong> le ou<br />
les coordonnateurs.<br />
Concernant l’organisation externe :<br />
La réflexion initiale peut être organisée autour de trois questions :<br />
1- un ou plusieurs partenaires bancaires :<br />
- banque de <strong>la</strong> ML ou autres<br />
- « gestion » de l’écart de taux <strong>et</strong> de conditions<br />
- implication du partenaire bancaire dans le montage <strong>des</strong> dossiers<br />
- gestion <strong>des</strong> difficultés rencontrées par le jeune pour le remboursement du prêt<br />
- orientation par <strong>la</strong> banque de jeunes pour une demande de prêt ;<br />
- orientation par <strong>la</strong> banque de jeunes ayant <strong>des</strong> soucis avec leurs comptes bancaires<br />
2- implication <strong>des</strong> collectivités<br />
- garanties complémentaires dans <strong>la</strong> perspective de r<strong>et</strong>rait du Fonds de cohésion sociale<br />
- financement du rôle de suivi <strong>des</strong> jeunes<br />
- prise en charge du coût <strong>des</strong> intérêts<br />
- articu<strong>la</strong>tion aide – prêts<br />
3- re<strong>la</strong>tion avec <strong>des</strong> partenaires<br />
- montage de dossiers pour <strong>des</strong> partenaires<br />
- gestion <strong>des</strong> orientations de jeunes non connus par <strong>la</strong> ML<br />
Note technique de Philippe Labbé<br />
Groupe 6 – Octobre 2008<br />
Parmi les réflexions concernant l’organisation interne, on peut noter…<br />
- « La montée en charge conduirait certainement à une évolution de l’organisation car, faute de pratique, il est<br />
aujourd’hui impossible de définir le temps qui sera consacré aux dossiers de microcrédit. » Effectivement, il faut<br />
être prudent. Si, actuellement, le thème du MCP peut prendre une importance particulière, celle-ci est<br />
conjoncturelle avec un eff<strong>et</strong>-loupe de <strong>la</strong> novation (<strong>et</strong> de c<strong>et</strong>te recherche-action) <strong>et</strong> il est probable que le MCP sera<br />
<strong>et</strong> ne sera qu’un outil parmi d’autres… Ce qui, au moins dans l’immédiat, exclut que l’on construise le MCP<br />
21
comme une expertise « point de passage obligé » d’une mission locale. L’intérêt du MCP me paraît plus se situer<br />
dans une c<strong>la</strong>rification opportune de <strong>la</strong> problématique « accompagnement/argent » (va<strong>la</strong>ble pour toutes les ai<strong>des</strong><br />
financières) <strong>et</strong> dans <strong>la</strong> possibilité de transférabilité de certaines compétences (typiquement celles <strong>des</strong><br />
conseillères ESF).<br />
- « Si une vigi<strong>la</strong>nce s’impose pour éviter toute dérive de l’aide vers le prêt, le passage d’une « logique d’aide » à<br />
une logique complémentaire de facilitation dans l’octroi de prêts bancaires nécessite aussi une action volontariste<br />
au sein <strong>des</strong> équipes. » On ne peut qu’être d’accord avec <strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nce concernant <strong>la</strong> dérive de l’aide vers le prêt.<br />
Pour une raison objective : les jeunes qui fréquentent les missions locales sont rarement <strong>des</strong> héritiers ou rentiers.<br />
Il importe donc de faire jouer prioritairement <strong>la</strong> solidarité nationale (redistribution) via les ai<strong>des</strong> dont certaines sont<br />
<strong>des</strong> droits <strong>et</strong> appartiennent au droit commun. Il faut donc, en termes de posture professionnelle, garantir que <strong>la</strong><br />
connaissance du droit commun soit garantie pour tous les conseillers <strong>et</strong> que celui-ci soit épuisé avant le recours<br />
au prêt. Une seule situation, de nature pédagogique, peut constituer une exception : que le conseiller soit<br />
confronté à un jeune qui manifestement cherche à profiter du système <strong>et</strong> qui, se situant dans une position<br />
assistancielle, ne se m<strong>et</strong> pas dans une re<strong>la</strong>tion contractuelle. Dans ce cas, le fait que le MCP soit un prêt<br />
contraint à une contractualisation.<br />
Deux modèles organisationnels sont dégagés :<br />
- Le premier est de type dédié avec un ou <strong>des</strong> « référents » 8 « en charge du montage <strong>des</strong> dossiers <strong>et</strong><br />
de leurs suivis, <strong>des</strong> re<strong>la</strong>tions avec les partenaires, notamment les banques, <strong>et</strong> de l’animation<br />
interne… une commission interne « tournante »… une journée d’équipe pour échanger <strong>et</strong> définir le<br />
rôle de chacun … une communication sur l’exemp<strong>la</strong>rité d’un dossier en réponse au besoin «<br />
particulier » d’un jeune. » Notons que ce dernier item devrait en théorie ne pas être spécifique,<br />
correspondant au travail monographique à partir duquel <strong>des</strong> enseignements sont généralisables à<br />
<strong>des</strong> jeunes présentant <strong>des</strong> caractéristiques comparables.<br />
- Le second est de type non-dédié, « un outil mis en œuvre par chaque conseiller avec une<br />
coordination centralisée (vérification <strong>des</strong> dossiers, re<strong>la</strong>tions avec les banques <strong>et</strong> les partenaires) »<br />
qui correspondrait plus « aux missions locales « éc<strong>la</strong>tées » autour de plusieurs antennes <strong>et</strong> d’un<br />
grand territoire. »<br />
Je pose l’hypothèse que, une fois le travail fait concernant l’outil<strong>la</strong>ge, le MCP devrait être un outil intégré dans les<br />
pratiques professionnelles de tous les conseillers, ne constituerait pas un domaine d’expertise spécifique <strong>et</strong><br />
n’exigerait qu’une procédure interne avec, effectivement, un contrôle de conformité sur le montage du dossier <strong>et</strong><br />
un interface dédié pour les re<strong>la</strong>tions bancaires. Si effectivement « Un effort de formation plus important apparaît<br />
nécessaire » dans le modèle non-dédié, c<strong>et</strong>te formation ne recouvre pas un haut niveau de technicité mais, par<br />
contre, son bénéfice est <strong>la</strong>rge puisqu’il concerne techniquement toutes les situations où est posée une<br />
problématique économique (savoir calculer les ressources d’un jeune)… que savent généralement traiter les<br />
conseillères ESF, ce qui explique leur rôle privilégié actuel dans le MCP. Dans plusieurs missions locales, c<strong>et</strong>te<br />
formation pourrait être auto-administrée.<br />
Les réflexions concernant l’organisation externe (banques, collectivités <strong>et</strong> partenaires) n’appellent pas à ce stade<br />
d’observations particulières mais <strong>des</strong> réponses à partir <strong>des</strong> pratiques de terrain, comme par exemple le choix<br />
d’un ou de plusieurs partenaires bancaires…<br />
8 Dans une autre note, j’ai proposé que <strong>la</strong> notion de « référent » soit être réservée à <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion avec le jeune <strong>et</strong><br />
que, dès lors qu’il s’agit d’un domaine, lui soit préférée <strong>la</strong> notion d’ « expert ».<br />
22
Groupe 7<br />
Évaluation<br />
Animateur : Philippe Jourdan, ML Rennes<br />
Secrétaire <strong>et</strong> rapporteure : Solenn Ravalec, <strong>ANDML</strong><br />
Membres du groupe de travail :<br />
Jean-Philippe CHARPENTIER (ML Agglo mancelle), Julie GILBERT D'HALLUIN (ML du pays de Caux vallée de<br />
Seine-Lillebonne), Odile GASSER (ML du Talou - Les Gran<strong>des</strong> Ventes), Philippe JOURDAN (ML du bassin<br />
d'emploi de Rennes) -Florence KARSENTI ( ML Rhône Sud Est - Saint Fons), Joëlle LEFRANCOIS (ML Val de<br />
Reuil-Louviers-Andelle), Solenn RAVALEC (<strong>ANDML</strong>), Patricia ROGGY (ML Lure-Luxeuil), Bouchaib SENHADJI<br />
(ML Orly Choisy) <strong>et</strong> Dominique TOPIN (ML pour <strong>la</strong> jeunesse <strong>et</strong> le pays reimois)<br />
Rappel de <strong>la</strong> note de Philippe LABBE :<br />
On entend par « eff<strong>et</strong>s » les conséquences immédiates du MCP <strong>et</strong> par « impacts » les conséquences différées à<br />
plus ou moins long terme. La question – éminemment importante – est celle de l’évaluation du MCP que l’on<br />
pourra estimer sur <strong>la</strong> base de trois catégories de valeurs ajoutées : <strong>des</strong> valeurs ajoutées directes individuelles<br />
pour le demandeur <strong>et</strong> bénéficiaire ; <strong>des</strong> valeurs ajoutées directes collectives pour <strong>la</strong> mission locale en termes de<br />
densification du partenariat ; <strong>des</strong> valeurs ajoutées indirectes organisationnelles en termes de professionnalisation<br />
de <strong>la</strong> structure, d’assurance qualité <strong>et</strong> d’amélioration de l’image.<br />
Idées de départ :<br />
- Evaluation de <strong>la</strong> valeur ajoutée directe pour les jeunes (concrétisation de leur proj<strong>et</strong>…)<br />
- Evaluation de <strong>la</strong> valeur ajoutée collective pour <strong>la</strong> ML en termes d’ouverture à de nouveaux partenaires<br />
- Evaluation de <strong>la</strong> valeur ajoutée indirecte professionnelle vis à vis <strong>des</strong> équipes, dans leur organisation<br />
interne <strong>et</strong> dans l’enrichissement de leur professionnalisme<br />
Quelques réflexions / interrogations :<br />
- L’évaluation peut nécessiter de former <strong>des</strong> personnes au préa<strong>la</strong>ble<br />
- Le MCP peut être un outil facilitant l’émergence de proj<strong>et</strong>s dans d’autres domaines que l’emploi-formation<br />
- Evoquer avec les jeunes le microcrédit personnel peut faire émerger <strong>des</strong> proj<strong>et</strong>s jusqu’alors in- envisagés<br />
- Le MCP doit-il être en lien avec le parcours d’insertion?<br />
Rappel :<br />
- Aucun objectif quantitatif fixé<br />
- Seul ¼ de l’enveloppe du Fonds de Cohésion Sociale a été utilisé à ce jour<br />
- Le MCP, dans ses évaluations, justifie un excellent taux de recouvrement du fait de l’accompagnement<br />
- Le MCP constitue un enjeu stratégique pour le réseau, notamment sur <strong>la</strong> crédibilité <strong>des</strong> Missions Locales : il<br />
s’agit de démontrer qu’un obj<strong>et</strong> social peut interférer sur un obj<strong>et</strong> professionnel. C<strong>et</strong> outil est une façon de<br />
faire <strong>la</strong> démonstration de l’évaluation systémique <strong>et</strong> globale : sociale <strong>et</strong> professionnelle<br />
Les points soulevés :<br />
Que cherche-t-on à évaluer ?<br />
Le MCP est-il adapté aux jeunes ?<br />
Les Missions Locales sont-elles le bon acteur du MCP ?<br />
Sommes-nous tous convaincus de son bien fondé, à priori ?<br />
En quoi le MCP rend-il les jeunes plus autonomes ? (réfléchir à <strong>la</strong> définition de l’autonomie)<br />
23
Lors de l’évaluation, 4 critères sont à prendre en compte :<br />
- le critère d’efficacité (Le MCP a t-il répondu à son besoin ?)<br />
- le critère d’effectivité (Est-ce <strong>la</strong> bonne méthode ?)<br />
- le critère d’efficience (Proportionnalité entre le bénéfice <strong>et</strong> le résultat)<br />
- le critère de conformité<br />
Axe 1 : Évaluation en direction <strong>des</strong> jeunes<br />
Le jeune a-t-il acquis ce pourquoi il a contracté un MCP ?<br />
Faut-il évaluer l’obj<strong>et</strong> du MCP ou le MCP en lui-même, quelque soit l’obj<strong>et</strong> de <strong>la</strong> demande ?<br />
Le MCP est-il un droit ?<br />
S’il s’agit d’un droit, comment faut-il communiquer <strong>des</strong>sus?<br />
Quelle différence entre les prêts dans le cadre du FAJ <strong>et</strong> le MCP ?<br />
Les objectifs du MCP :<br />
- Lutter contre l’exclusion bancaire<br />
- Atteindre l’autonomie<br />
- Prévenir le surend<strong>et</strong>tement<br />
- Responsabiliser les bénéficiaires<br />
- Insérer socialement <strong>et</strong> professionnellement<br />
Dans l’évaluation, il importe de prendre en compte <strong>la</strong> typologie <strong>des</strong> jeunes bénéficiaires.<br />
Le MCP va-t-il atteindre de nouveaux jeunes, jusqu’alors non inscrits à <strong>la</strong> Mission Locale ?<br />
La re<strong>la</strong>tion avec le système bancaire est à évaluer, à travers notamment le conseil transmis par le banquier au<br />
jeune afin de lui faire faire <strong>des</strong> choix responsables.<br />
Quels risques le conseiller est-il prêt à prendre dans son choix d’orienter un jeune vers un MCP ?<br />
Axe 2 : Évaluation en direction <strong>des</strong> partenaires<br />
En quoi le MCP peut-il donner une autre image de <strong>la</strong> ML, à travers <strong>la</strong> valeur ajoutée de<br />
l’accompagnement ?<br />
En quoi le MCP peut-t-il donner à voir sur <strong>la</strong> situation <strong>des</strong> jeunes (en précarité) aux élus ?<br />
Evaluer <strong>la</strong> réactivité <strong>des</strong> banques :<br />
En cas de problème de paiement, quelle est leur souplesse ? Quelle est leur réactivité ? Comment<br />
donnent-elles l’alerte ? Ont-elles évolué dans leurs pratiques au fil du temps ?<br />
Le MCP a-t-il permis de développer de nouveaux partenariats ?<br />
En quoi le MCP perm<strong>et</strong>-il à <strong>la</strong> ML de réaliser de nouvelles col<strong>la</strong>borations ou un meilleur travail en<br />
commun avec ses partenaires du champ social ?<br />
Ex : négociation avec <strong>des</strong> collectivités locales pour <strong>des</strong> prêts à taux zéro (Conseil Régional de Poitou<br />
Charente : microcrédit social régional universel)<br />
Le MCP perm<strong>et</strong>-il de développer <strong>des</strong> partenariats avec les associations caritatives ?<br />
Comment communiquer avec les réseaux <strong>des</strong> associations qui ont déjà mis en p<strong>la</strong>ce le MCP sur leur<br />
territoire, afin d’éviter toute concurrence ?<br />
Comment communiquer avec les auto-écoles <strong>et</strong> les bailleurs sociaux ? Ce<strong>la</strong> génère-t-il de nouveaux<br />
liens <strong>et</strong> de nouveaux partenariats?<br />
Axe 3 : évaluation en direction de l’interne<br />
Le MCP va-t-il constituer une nouvelle compétence dans le champ d’intervention <strong>des</strong> Missions<br />
Locales en termes de gestion de budg<strong>et</strong> avec les jeunes ?<br />
24
C<strong>et</strong>te compétence du MCP est-elle spécifique du métier de conseiller-ère en économie sociale <strong>et</strong><br />
familiale? Faut-il un profil type de référent ?<br />
Est-ce dans nos missions habituelles ?<br />
Comment sont abordées <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion à l’argent <strong>et</strong> <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion d’aide dans les équipes ?<br />
Le MCP est-il un outil d’accompagnement comme les autres ?<br />
Le MCP est-il accepté dans les pratiques ? Le MCP change-t-il ces pratiques ?<br />
Quel temps est consacré à un dossier de MCP par le référent ?<br />
Le MCP aide-t-il le conseiller à travailler davantage dans <strong>la</strong> globalité ?<br />
Comment ce nouveau dispositif prend-il sa p<strong>la</strong>ce <strong>et</strong> s’intègre-t-il dans le reste <strong>des</strong> ai<strong>des</strong> ?<br />
Note technique de Philippe Labbé<br />
Groupe 7 – Octobre 2008<br />
Tout d’abord, on se situe dans le thème de l’évaluation, considérant que celle-ci concerne ce qui est produit, les<br />
bénéfices obtenus par le recours au MCP. On pourrait en eff<strong>et</strong> concevoir l’évaluation de façon extensive, par<br />
exemple en « ex ante », c’est-à-dire avant l’action étudié dans le champ du diagnostic avec les outils (groupe 5).<br />
C<strong>la</strong>ssiquement, trois catégories de valeurs ajoutées (VA) peuvent structurer le travail évaluatif :<br />
- Les VA directes individuelles : ce sont les bénéfices que chaque jeune tire de l’action ;<br />
- Les VA directes collectives pour le milieu : c’est par exemple les bénéfices qu’un territoire tire de l’action d’une<br />
mission locale (amélioration de <strong>la</strong> situation de l’emploi <strong>des</strong> jeunes, développement économique <strong>et</strong> social,<br />
innovation, <strong>et</strong>c.).<br />
- Les VA indirectes professionnelles pour <strong>la</strong> mission locale : c’est globalement <strong>la</strong> démonstration qu’il y a un gain<br />
de professionnalisme, une meilleure façon de s’organiser <strong>et</strong> de travailler, un partenariat é<strong>la</strong>rgi, <strong>et</strong>c. Ces VA<br />
indirectes professionnelles constituent ce que l’on appelle une « assurance de <strong>la</strong> qualité » : <strong>la</strong> mission locale<br />
démontre sa capacité d’être bien organisée <strong>et</strong>, déductivement, on peut s’attendre à ce qu’il y ait plus de VA<br />
directes (à l’inverse, on poserait l’hypothèse que, si <strong>la</strong> mission locale est mal organisée, on obtiendrait moins de<br />
VA directes). Une illustration de ces VA indirectes professionnelles est fournie par le groupe lorsqu’il pose<br />
l’hypothèse que « Le MCP peut être un outil facilitant l’émergence de proj<strong>et</strong>s dans d’autres domaines que<br />
l’emploi-formation. » Oui, l’émergence de proj<strong>et</strong>s nouveaux est déterminée par tout un ensemble, un terrain<br />
favorable, <strong>et</strong> le MCP peut être un vecteur de c<strong>et</strong>te émergence.<br />
Il me semble qu’ici on peut se centrer principalement <strong>et</strong> dans un premier temps sur <strong>la</strong> première catégorie, les VA<br />
directes individuelles.<br />
« L’évaluation peut nécessiter de former <strong>des</strong> personnes au préa<strong>la</strong>ble », est-il indiqué dans <strong>la</strong> synthèse du groupe<br />
de travail. Oui, sans aucun doute, <strong>et</strong> pour au moins deux raisons :<br />
- Parce que l’évaluation est un enjeu majeur pour les missions locales, qu’il s’agisse du MCP ou d’autres choses.<br />
Il faut donc qu’à l’échelle <strong>des</strong> missions locales on dispose d’un référentiel d’évaluation connu <strong>et</strong> partagé, dont <strong>la</strong><br />
proposition <strong>des</strong> trois catégories de VA n’est qu’une partie. Il faut s’entendre sur les critères évaluatifs, qui<br />
déterminent les questions de l’évaluation, <strong>et</strong> ce<strong>la</strong> est nécessaire pour le MCP comme pour le reste.<br />
- Parce que l’occasion est donnée ou, plus exactement, est à saisir, de faire une évaluation intelligente, globale,<br />
systémique… <strong>et</strong>, donc, de ne pas se limiter à l’évaluation quantitative. L’exercice d’une évaluation systémique<br />
peut constituer un entraînement transférable, applicable pour d’autres actions.<br />
C<strong>et</strong>te porosité entre l’évaluation du MCP <strong>et</strong> l’évaluation en général (qui s’impose aussi au regard de <strong>la</strong> cohérence<br />
interne) est quelque chose d’important <strong>et</strong>, sans doute, essentiel. Lorsque le groupe pose <strong>la</strong> question « Evoquer<br />
25
avec les jeunes le microcrédit personnel peut faire émerger <strong>des</strong> proj<strong>et</strong>s jusqu’alors non-envisagés », il raisonne<br />
de façon systémique : une action produit <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s directement liés à son obj<strong>et</strong> mais également, par capil<strong>la</strong>rité<br />
ou porosité, <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s que l’on va r<strong>et</strong>rouver ailleurs : si un MCP va perm<strong>et</strong>tre par exemple d’acquérir un moyen<br />
de locomotion, celui-ci ne servira pas qu’à se dép<strong>la</strong>cer mais peut constituer un eff<strong>et</strong> levier sur toute une stratégie<br />
d’insertion. L’émergence de proj<strong>et</strong>s non-envisagés appartient à l’aléatoire, l’imprévisible, c’est-à-dire à <strong>la</strong><br />
complexité. C’est une façon intelligente de concevoir l’évaluation (plus <strong>la</strong>rgement l’action). Edgar Morin écrit fort<br />
justement que « Le hasard n’est pas seulement le facteur négatif à réduire dans le domaine de <strong>la</strong> stratégie. C’est<br />
aussi <strong>la</strong> chance à saisir. » (Introduction à <strong>la</strong> pensée complexe, 1990, ESF Éditeur).<br />
S’agissant de VA ajoutées directes, celles dont le jeune, chaque jeune, va profiter, <strong>la</strong> première question à<br />
<strong>la</strong>quelle il faut répondre est celle que le groupe a formulé en disant « En quoi le MCP rend-il les jeunes plus<br />
autonomes ? (réfléchir à <strong>la</strong> définition de l’autonomie). » Et ce<strong>la</strong> renvoie à l’objectif finalisé de l’insertion :<br />
l’intégration. Celle-ci repose sur deux piliers, l’indépendance économique via un emploi <strong>et</strong> l’autonomie sociale.<br />
Ces deux grands vol<strong>et</strong>s sont évidemment articulés entre eux, ils interfèrent mutuellement <strong>et</strong> c’est le concept-clé<br />
<strong>des</strong> missions locales : l’approche globale. Si l’indépendance économique ne pose pas de problèmes majeurs<br />
dans sa compréhension avoir un travail, donc <strong>des</strong> ressources, <strong>et</strong> pouvoir s’assumer financièrement), l’autonomie<br />
sociale est un peu plus compliquée à comprendre.<br />
On peut s’appuyer sur le schéma ci-<strong>des</strong>sous :<br />
Visées Indépendance économique Autonomie sociale<br />
Objectifs opérationnels<br />
Insertion professionnelle<br />
Insertion sociale<br />
Objectif finalisé<br />
Intégration<br />
Correspondant à Exercer un emploi Vivre soi-même <strong>et</strong> avec les<br />
autres de façon équilibrée<br />
Sphère de<br />
l’économie : avoir<br />
un emploi stable,<br />
pouvoir être mobile,<br />
acquérir <strong>des</strong><br />
compétences, <strong>et</strong>c.<br />
Sphère de<br />
l’individuation :<br />
re<strong>la</strong>tions du jeune<br />
avec soi-même<br />
(santé, équilibre<br />
psychologique) <strong>et</strong><br />
avec ses proches<br />
(famille,<br />
logement…)<br />
Sphère de <strong>la</strong><br />
sociabilité :<br />
re<strong>la</strong>tions du<br />
jeune avec son<br />
environnement<br />
de proximité<br />
(quartier,<br />
voisinage,<br />
associations…)<br />
Sphère du<br />
sociétal :<br />
re<strong>la</strong>tions du<br />
jeune avec <strong>la</strong><br />
société, ses<br />
institutions<br />
(citoyenn<strong>et</strong>é,<br />
droits <strong>et</strong> devoirs,<br />
respects <strong>des</strong><br />
normes <strong>et</strong><br />
conventions…)<br />
Notions-clés Indépendance Accomplissement Lien Citoyenn<strong>et</strong>é<br />
Évaluation<br />
(VA directes)<br />
Le MCP a-t-il permis<br />
d’accéder à un emploi,<br />
a-t-il favorisé l’insertion<br />
professionnelle ?<br />
D’accéder aux services<br />
bancaires ? De<br />
prévenir un<br />
surend<strong>et</strong>tement ?<br />
Le MCP a-t-il permis<br />
d’améliorer <strong>la</strong><br />
situation personnelle<br />
du jeune :<br />
équipement de <strong>la</strong><br />
maison, soins<br />
dentaires, <strong>et</strong>c. ?<br />
Le MCP a-t-il<br />
permis au jeune<br />
de mieux<br />
s’intégrer dans<br />
<strong>des</strong> réseaux<br />
locaux, de<br />
participer à <strong>des</strong><br />
activités, <strong>et</strong>c ?<br />
Le MCP a-t-il<br />
permis au jeune<br />
d’être en règle visà-vis<br />
de <strong>la</strong> société<br />
(par ex. circuler<br />
avec le permis,<br />
une assurance) ?<br />
26
On comprend donc qu’à <strong>la</strong> question posée dans le groupe « Le MCP doit-il être en lien avec le parcours<br />
d’insertion ? », <strong>la</strong> réponse soit positive… sans toutefois qu’elle soit, à mon sens, systématique. Le schéma<br />
évaluatif posé ci-<strong>des</strong>sus s’applique pour un jeune inscrit dans un parcours d’insertion mais on doit être capable<br />
de moduler l’offre de services <strong>et</strong> un jeune peut avoir besoin d’un simple coup de main, que le MCP perm<strong>et</strong>tra,<br />
sans que l’on déploie toute une batterie évaluative <strong>et</strong>, en amont, diagnostique. Le risque, évidemment, serait une<br />
instrumentalisation, c’est-à-dire le conseiller réduit à une fonction d’instruction ou pré-instruction d’aire mais, là<br />
comme ailleurs, c’est une question d’équilibre.<br />
Autres questions posées dans le groupe auxquelles on peut tenter d’apporter <strong>des</strong> réponses… à discuter :<br />
- « Le MCP est-il adapté aux jeunes ? » Il l’est certainement dans certains cas, pas dans d’autres. Au même titre<br />
que chacun d’entre nous a eu recours au crédit <strong>et</strong> que, si celui-ci n’a pas un taux d’usure prohibitif, ce<strong>la</strong><br />
correspond à un règlement en n fois donc à un allègement <strong>des</strong> charges sur une période donnée.<br />
- « Sommes-nous tous convaincus de son bien-fondé, a priori ? » Ce n’est évidemment pas une question à<br />
négliger mais son traitement appartient au domaine de <strong>la</strong> déontologie (autre groupe).<br />
- « Les Missions Locales sont-elles le bon acteur du MCP ? » Elles le sont pour les jeunes dès lors que l’on<br />
considère 1) que <strong>la</strong> loi de programmation pour <strong>la</strong> cohésion sociale a créé un nouveau droit créance ouvert à tous<br />
les jeunes rencontrant <strong>des</strong> difficultés d’insertion professionnelle ; 2) que <strong>la</strong> mise en œuvre de ce droit a été confié<br />
aux missions locales ; 3) que <strong>la</strong> situation économique <strong>des</strong> jeunes est sans conteste difficile <strong>et</strong> que le MCP peut<br />
être un moyen, parmi d’autres, de pondérer ces difficultés.<br />
- « Le MCP est-il un droit ? S’il s’agit d’un droit, comment faut-il communiquer <strong>des</strong>sus ? » Non, le MCP n’est pas<br />
un droit comme par exemple feu <strong>la</strong> BAE ou l’actuel FIPJ qui sont <strong>des</strong> droits conditionnels. Le MCP est un produit,<br />
un outil <strong>et</strong> une opportunité… ce qui n’obère en rien <strong>la</strong> nécessité de communiquer son existence.<br />
Qui dit évaluation, dit critères, c’est-à-dire référentiel d’évaluation, une partie de celui-ci étant constituée par ce<br />
qui précède (les différentes catégories de VA).<br />
Plusieurs critères peuvent être pris en compte. Il me semble qu’on peut à ce stade se limiter à trois critères, quitte<br />
à ce qu’ultérieurement d’autres critères apparaissent <strong>et</strong> soient mobilisés :<br />
- le critère d’efficacité : Le MCP a t-il répondu à son besoin ?<br />
- le critère d’effectivité : Le recours au MCP a-t-il été <strong>la</strong> bonne solution (par rapport à d’autres outils) ?<br />
- le critère d’efficience : Le résultat obtenu a-t-il été proportionné à l’effort consenti pour le montage du dossier ?<br />
Ceci signifie concrètement que, pour chaque dossier, on doit à minima poser ces trois questions <strong>et</strong> y apporter<br />
<strong>des</strong> réponses.<br />
A présent, <strong>la</strong> catégorie <strong>des</strong> VA directes collectives <strong>et</strong> indirectes professionnelles qui grosso modo repose sur <strong>la</strong><br />
question « En quoi l’usage du MCP contribue-t-il à <strong>la</strong> professionnalisation de <strong>la</strong> mission locale <strong>et</strong> à son impact sur<br />
le territoire ? »<br />
On peut ainsi s’interroger principalement à partir <strong>des</strong> questions du groupe, reprises <strong>et</strong> complétées, ventilées en<br />
deux catégories : l’impact sur le territoire puis <strong>la</strong> professionnalisation.<br />
27
Impact sur le territoire : valeurs ajoutées directes collectives<br />
Jeunes<br />
« Le MCP a-t-il permis d’atteindre de nouveaux jeunes, jusqu’alors non inscrits à <strong>la</strong> Mission<br />
Locale ? »<br />
« Le MCP a-t-il eu pour <strong>des</strong> jeunes un eff<strong>et</strong>-levier, partant du MCP pour s’inscrire dans un<br />
véritable parcours d’insertion ? »<br />
Banques « La re<strong>la</strong>tion avec le système bancaire est-elle satisfaisante ? A-t-elle permis d’é<strong>la</strong>rgir le<br />
partenariat <strong>et</strong> d’apporter <strong>des</strong> solutions à d’autres problèmes que le seul MCP ? »<br />
« La re<strong>la</strong>tion avec le système bancaire fait-elle évoluer ces dernières en termes d’une<br />
meilleure souplesse vis-à-vis <strong>des</strong> jeunes (interdiction <strong>et</strong> exclusion bancaires…) ? »<br />
Partenaires « En quoi le MCP perm<strong>et</strong>-il à <strong>la</strong> ML de réaliser de nouvelles col<strong>la</strong>borations ou un meilleur<br />
travail en commun avec ses partenaires du champ social ? »<br />
« Les conditions de communication <strong>et</strong> de coopération avec les réseaux <strong>des</strong> associations qui<br />
ont déjà mis en p<strong>la</strong>ce le MCP sur leur territoire ont-elles permis d’éviter une logique de<br />
concurrence ? »<br />
Élus<br />
« Le MCP constitue-t-il un élément perm<strong>et</strong>tant aux élus de mieux connaître <strong>et</strong> prendre en<br />
compte <strong>la</strong> précarité <strong>des</strong> jeunes ? »<br />
« Le MCP a-t-il suscité <strong>des</strong> réflexions <strong>et</strong> <strong>des</strong> propositions pour de nouvelles ai<strong>des</strong> (prêts à<br />
taux zéro…) ? »<br />
Professionnalisation de <strong>la</strong> mission locale : valeurs ajoutées indirectes professionnelles<br />
Organisation « Le MCP a-t-il été organisé c<strong>la</strong>irement dans <strong>la</strong> mission locale avec <strong>des</strong> procédures (fiche<br />
pratique, recours au MCP <strong>et</strong> autres ai<strong>des</strong>, <strong>et</strong>c…)? »<br />
« Le MCP est-il régulièrement l’obj<strong>et</strong> d’échanges de pratiques ? »<br />
Expertise « Le MCP est-il inscrit comme une expertise spécifique (professionnels dédiés) ou fait-il<br />
partie du « fonds commun » de <strong>la</strong> polyvalence ? »<br />
« Un transfert de compétences a-t-il té organisé à partir <strong>des</strong> professionnels disposant <strong>des</strong><br />
compétences (type CESF) ? »<br />
Déontologie « Le MCP est-il saisi comme thème pour aborder <strong>et</strong> c<strong>la</strong>rifier <strong>la</strong> problématique du rapport à<br />
l’argent dans l’accompagnement ? »<br />
28