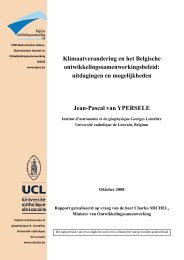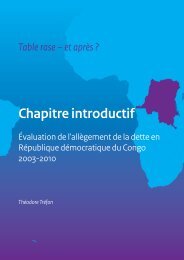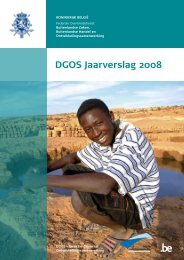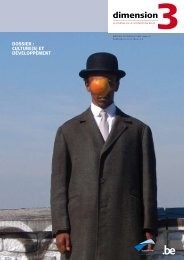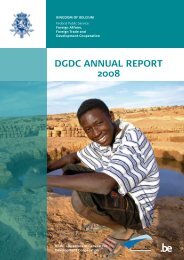L'accès et le contrôle des ressources par les femmes - Belgium
L'accès et le contrôle des ressources par les femmes - Belgium
L'accès et le contrôle des ressources par les femmes - Belgium
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L’ACCèS ET LE CONTRÔLE<br />
DES RESSOURCES PAR LES FEMMES<br />
Un défi pour la sécurité alimentaire<br />
Groupe Genre, Empowerment <strong>et</strong> Sécurité Alimentaire<br />
de la Commission Femmes <strong>et</strong> Développement
L’ACCèS ET LE CONTRÔLE<br />
DES RESSOURCES PAR LES FEMMES<br />
Un défi pour la sécurité alimentaire<br />
© Auteures de c<strong>et</strong>te publication:<br />
• Catherine BELEMSIGRI, Consultante Indépendante en Genre au Niger.<br />
• Lis<strong>et</strong>te CAUBERGS, ATOL (vzw), lid van de Werkgroep Gender, Empowerment en Voedselzekerheid (GEV)<br />
van de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling (CVO).<br />
• Carmelina CARACCILLO, Entraide <strong>et</strong> Fraternité, lid van de Werkgroep Gender, Empowerment en<br />
Voedselzekerheid van de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling.<br />
• Sophie CHARLIER, Le Monde selon <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong>, Présidente du groupe Genre Empowerment<br />
<strong>et</strong> Sécurité Alimentaire (GESA) de la Commission Femmes <strong>et</strong> Développement (CFD).<br />
• Lea CLAES, Agricultrice belge.<br />
• Mara COPPENS, Conseillère à la Cellu<strong>le</strong> stratégique du Ministre de la Coopération au Développement,<br />
M. Char<strong>le</strong>s Michel.<br />
• Virginie DATTLER, titulaire d’un Master en développement, UCL.<br />
• Djènèbou DEMBELE, Association Malienne pour la Promotion <strong>des</strong> Entreprises Féminines (AMAPEF).<br />
• Isabel<strong>le</strong> DENIS, Chargée de liaison, Bureau de liaison de la FAO avec l’Union Européenne <strong>et</strong> la Belgique.<br />
• Martje HOUBRECHTS, Dimitra (FAO), lid van de Werkgroep Gender, Empowerment en Voedselzekerheid<br />
van de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling.<br />
• Françoise KAT KAMBOL, Doctorante en Sociologie à l’Université de Lubumbashi /ISES<br />
<strong>et</strong> Coordinatrice de l’ONG «Action pour <strong>le</strong> Développement Intégré de la Femme» (ADIF).<br />
• Thierry KESTELOOT, Chercheur en souverain<strong>et</strong>é alimentaire à Oxfam-Solidarité<br />
<strong>et</strong> membre de la Coalition belge contre la faim.<br />
• Angè<strong>le</strong> MBOMBO KATCHIUNGA, Secrétaire exécutive du REFD Casaï Oriental RDCongo<br />
<strong>et</strong> Coordinatrice du CEDI (Centre D’encadrement pour <strong>le</strong> Développement Intégré DIKOLELA).<br />
• Eliane NAJROS, Dimitra (FAO), Lid van de Werkgroep Gender, Empowerment<br />
en Voedselzekerheid van de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling.<br />
• Fatou NDOYE, Chargée du programme genre à ENDA GRAF <strong>et</strong> coordinatrice de la plate-forme alimentaire<br />
« Geewo Agro » à Dakar, Sénégal.<br />
• Tiné NDOYE, Présidente du Réseau National <strong>des</strong> Femmes Rura<strong>le</strong>s du Sénégal.<br />
• Marie-Thérèse NDUMBA, genderexperte, lid van de Werkgroep Gender, Empowerment en Voedselzekerheid<br />
van de Commissie Vrouwen en Ontwikkeling.<br />
• Annick SEZIBERA, Confédérations <strong>des</strong> Associations <strong>des</strong> Producteurs Agrico<strong>le</strong>s<br />
pour <strong>le</strong> Développement (CAPAD), Burundi.<br />
LECTRICES :<br />
• Poup<strong>et</strong>te CHOQUE<br />
• Virginie DELATTRE ESCUDIE<br />
• Sylvie GROLET<br />
• Ashling HOARE<br />
TRADUCTRICE :<br />
Delphine ROSSINI<br />
Mise en page de : www.immediaprint.be<br />
Dépôt légal : 0218/2011/07<br />
Commission Femmes <strong>et</strong> Développement<br />
DGD, Direction Généra<strong>le</strong> de la Coopération au Développement<br />
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur <strong>et</strong> Coopération au développement<br />
rue <strong>des</strong> P<strong>et</strong>its Carmes 15 (Na 59 – B305) - 1000 Brussel<br />
+32 2 501.44.43 - +32 2 501.45.44<br />
cvo-cfd@diplobel.fed.be<br />
http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/CFD/<br />
© Illustrations de Lis<strong>et</strong>te CAUBERGS
L’ACCèS ET LE CONTRÔLE<br />
DES RESSOURCES PAR LES FEMMES<br />
Un défi pour la sécurité alimentaire<br />
Groupe Genre, Empowerment <strong>et</strong> Sécurité Alimentaire<br />
de la Commission Femmes <strong>et</strong> Développement
TABLE DES MATIERES
TABLE DES MATIèRES<br />
ACRONYMES 6<br />
1. INTRODUCTION GLOBALE 8<br />
1.1. IntroductIon<br />
Sophie Charlier 9<br />
1.2. IntroductIon à la problématIque<br />
de l’accès <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> de<br />
<strong>le</strong>urs contrô<strong>le</strong>s <strong>par</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
en lIen avec <strong>le</strong>s enjeux de<br />
la sécurIté alImentaIre 13<br />
2. LES POSITIONS DES INSTITUTIONS<br />
DE DEVELOPPEMENT 32<br />
2.1. l’Importance de l’agrIculture <strong>et</strong><br />
du genre au seIn de la coopératIon<br />
belge au développement<br />
Mara Coppens 33<br />
2.2. l’accès aux <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong>ur<br />
contrô<strong>le</strong> - poInt de vue de la fao<br />
Isabel<strong>le</strong> Denis 36<br />
2.3. la souveraIn<strong>et</strong>é alImentaIre ne se<br />
fera pas sans justIce de genre<br />
Thierry Kesteloot 40<br />
3. ANALYSE DES FACTEURS<br />
D’INSECURITE ALIMENTAIRE ET<br />
DES STRATEGIES DES FEMMES POUR<br />
UNE SECURITE ALIMENTAIRE 44<br />
3.1. au sénégal, l’accès <strong>et</strong> <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>ressources</strong> <strong>par</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> :<br />
défIs pour la sécurIté alImentaIre<br />
Fatou Ndoye & Virginie Datt<strong>le</strong>r 45<br />
3.2. au nIger, l’accès <strong>et</strong> <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>ressources</strong> <strong>par</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> :<br />
un défI pour la sécurIté<br />
alImentaIre<br />
Catherine Bé<strong>le</strong>msigri 56<br />
3.3. <strong>le</strong>s InterdIts alImentaIres en<br />
républIque démocratIque du congo<br />
Françoise Kat Kambol 66<br />
4. EXEMPLES DE PRATIQUES ET<br />
STRATEGIES A LA BASE 72<br />
4.1. l’accès <strong>et</strong> <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong><br />
<strong>des</strong> <strong>ressources</strong> <strong>par</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> :<br />
un défI pour la sécurIté alImentaIre<br />
Tiné Ndoye 73<br />
4.2. <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> sécurIté alImentaIre<br />
au malI<br />
Djénébou Dembélé 78<br />
4.3. expérIence en genre de la capad<br />
Annick Sezibera 86<br />
4.4. voedselteams<br />
Lea Claes 89<br />
4.5. rdc : l’accès <strong>et</strong> <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> de<br />
<strong>ressources</strong> <strong>par</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong>, un<br />
défI pour la sécurIté alImentaIre<br />
Angè<strong>le</strong> Mbombo 92<br />
5. CONCLUSION ET<br />
RECOMMANDATIONS 94<br />
vers une sécurIté alImentaIre :<br />
<strong>des</strong> InégalItés à combattre 95<br />
5
ACRONYMES
ACRONYMES<br />
ADPIC Accords Internationaux sur la<br />
Protection <strong>des</strong> Droits Intel<strong>le</strong>ctuels<br />
AG<br />
AGR<br />
Assemblée Généra<strong>le</strong><br />
Activités Génératrices de<br />
Revenus<br />
ALISA Alimentation, Innovation <strong>et</strong><br />
Savoir faire Agroalimentaire en<br />
Afrique de l’Ouest<br />
AOPP<br />
BC<br />
Association d’Organisations<br />
Professionnel<strong>le</strong>s Paysannes<br />
Banque de Céréa<strong>le</strong>s<br />
CAPAD Confédération <strong>des</strong> Associations<br />
<strong>des</strong> Producteurs Agrico<strong>le</strong>s pour<br />
<strong>le</strong> Développement<br />
GIE<br />
IFPRI<br />
ISDL<br />
MGF<br />
MUSO<br />
NTIC<br />
OMC<br />
Groupement d’Intérêt<br />
Economique<br />
Institut International de<br />
Recherche sur <strong>le</strong>s Politiques<br />
Alimentaires<br />
Institut Supérieur pour <strong>le</strong><br />
Développement Local<br />
Mutilation Génita<strong>le</strong>s Féminines<br />
Mutuel<strong>le</strong> de Solidarité<br />
Nouvel<strong>le</strong>s Technologies<br />
de l’Information <strong>et</strong><br />
de la Communication<br />
Organisation Mondia<strong>le</strong> du<br />
Commerce<br />
CEDI<br />
Centre d’Encadrement pour<br />
<strong>le</strong> Développement Intégré<br />
OMD<br />
Objectifs du Millénaire pour <strong>le</strong><br />
Développement<br />
CFD<br />
Commission Femmes<br />
<strong>et</strong> Développement<br />
ONG<br />
Organisation<br />
Non-Gouvernementa<strong>le</strong><br />
CTB<br />
Coopération Technique Belge<br />
PIB<br />
Produit Intérieur Brut<br />
DGCD<br />
DQ<br />
FAO<br />
FMI<br />
Direction Généra<strong>le</strong> de<br />
la Coopération au Développement<br />
Dépenses Quotidiennes<br />
Organisation <strong>des</strong> Nations Unies<br />
pour l’Alimentation <strong>et</strong> l’Agriculture<br />
Fonds Monétaire International<br />
SDRP<br />
RDC<br />
RGAC<br />
Stratégie de Développement<br />
accéléré <strong>et</strong> de Réduction de<br />
la Pauvr<strong>et</strong>é<br />
République Démocratique<br />
du Congo<br />
Recensement Général de<br />
l’Agriculture <strong>et</strong> du Cheptel<br />
GESA<br />
Genre Empowerment <strong>et</strong> Sécurité<br />
Alimentaire<br />
UPI<br />
Unité de Production Informel<strong>le</strong><br />
7
1. INTRODUCTION<br />
GLOBALE
1.1. INTRODUCTION<br />
Depuis deux ans, <strong>le</strong> groupe de travail<br />
« Genre <strong>et</strong> Sécurité Alimentaire» de la<br />
Commission Femmes <strong>et</strong> Développement<br />
(CFD) travail<strong>le</strong> sur <strong>le</strong> thème de l’accès<br />
aux <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> de <strong>le</strong>ur contrô<strong>le</strong> <strong>par</strong> <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong>, en lien avec la sécurité alimentaire.<br />
Les derniers chiffres publiés <strong>par</strong> la FAO<br />
confirment qu’il est nécessaire d’attacher<br />
une importance toute <strong>par</strong>ticulière à la<br />
sécurité alimentaire. Le nombre de gens<br />
souffrant de la faim dans <strong>le</strong> monde est,<br />
aujourd’hui encore, de 925 millions de<br />
personnes! Même si ce chiffre montre une<br />
relative amélioration de la situation, il reste<br />
cependant «supérieur au niveau d’avant<br />
<strong>le</strong>s crises alimentaire <strong>et</strong> économique de<br />
2008», qui était alors de 850 millions.<br />
Paradoxa<strong>le</strong>ment, c’est surtout en milieu<br />
rural que <strong>le</strong>s personnes souffrent <strong>le</strong> plus<br />
de la faim, touchant majoritairement <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong>s enfants. Et pourtant, de<br />
<strong>par</strong> <strong>le</strong>ur rô<strong>le</strong> socioculturel, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
sont responsab<strong>le</strong>s de l’agriculture de<br />
consommation familia<strong>le</strong>, <strong>des</strong> plantes<br />
médicina<strong>le</strong>s, ainsi que de la pré<strong>par</strong>ation<br />
<strong>des</strong> plats consommés chaque jour. En<br />
milieu urbain, on <strong>le</strong>s r<strong>et</strong>rouve dans<br />
<strong>des</strong> activités génératrices de revenus<br />
<strong>et</strong> ces revenus sont investis en grande<br />
<strong>par</strong>tie dans l’achat de biens alimentaires<br />
<strong>des</strong>tinés à la famil<strong>le</strong>.<br />
Ces différentes réalités ont interpellé<br />
<strong>le</strong> groupe de travail qui, dans un<br />
premier temps, s’est penché sur <strong>le</strong> lien<br />
entre <strong>le</strong> développement du processus<br />
d’empowerment <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> la sécurité<br />
alimentaire <strong>des</strong> famil<strong>le</strong>s. Le groupe de<br />
travail a voulu se questionner sur <strong>des</strong><br />
réalités comme la faim dans <strong>le</strong> monde<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong>s stratégies développées <strong>par</strong> <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> pour assurer l’alimentation de<br />
la famil<strong>le</strong>. Nous avons voulu m<strong>et</strong>tre en<br />
lumière <strong>le</strong>s pratiques de terrain, grâce aux<br />
témoignages de différentes intervenantes<br />
qui ont présenté une analyse critique de<br />
<strong>le</strong>ur expérience de terrain ainsi que <strong>le</strong>urs<br />
résultats. C’est ainsi qu’un séminaire<br />
international intitulé «l’accès <strong>et</strong> <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong><br />
<strong>des</strong> <strong>ressources</strong> <strong>par</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> : un défi<br />
pour la sécurité alimentaire» a été organisé<br />
<strong>le</strong> 15 décembre 2009. C<strong>et</strong>te journée nous<br />
a permis de discuter l’approche du thème<br />
avec d’autres <strong>par</strong>tenaires, dans un premier<br />
temps avec <strong>des</strong> <strong>par</strong>tenaires africains puis<br />
avec <strong>des</strong> acteurs de la coopération au<br />
développement. Nous avons ainsi écouté<br />
<strong>des</strong> exposés théoriques, reprenant <strong>le</strong>s<br />
résultats de recherches <strong>et</strong>/ou analyses de<br />
terrain. Nous avons éga<strong>le</strong>ment reçu <strong>le</strong>s<br />
témoignages de <strong>femmes</strong> <strong>le</strong>aders dans <strong>des</strong><br />
organisations paysannes <strong>et</strong> <strong>par</strong>tagé <strong>le</strong>urs<br />
expériences. Au total, 170 personnes, tous<br />
acteurs ou actrices dans la coopération au<br />
développement en Belgique ou dans <strong>le</strong>s<br />
pays du Sud, ont <strong>par</strong>ticipé à ce séminaire.<br />
C<strong>et</strong>te publication s’ouvre sur <strong>le</strong> document<br />
de base de notre discussion, réalisé <strong>par</strong> <strong>le</strong><br />
groupe de travail de la Commission Femmes<br />
<strong>et</strong> Développement (introduction).<br />
ll s’agit d’un bref rappel de l’analyse<br />
sur <strong>le</strong> développement du processus<br />
d’empowerment <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>, de <strong>le</strong>ur<br />
accès aux <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong>ur contrô<strong>le</strong> pour<br />
la sécurité alimentaire de la famil<strong>le</strong>.<br />
Un second chapitre intitulé la position<br />
<strong>des</strong> institutions de développement<br />
reprend d’une <strong>par</strong>t <strong>le</strong>s priorités du Ministre<br />
belge de la Coopération au Développement<br />
face aux enjeux du genre <strong>et</strong> de la<br />
sécurité alimentaire <strong>et</strong>, d’autre <strong>par</strong>t, <strong>le</strong>s<br />
recommandations de la FAO sur <strong>le</strong> suj<strong>et</strong>.<br />
Les thèmes du genre <strong>et</strong> de l’agriculture<br />
sont deux thèmes prioritaires pour la<br />
9
1. INTRODUCTION GLOBALE<br />
coopération belge. Lors de son intervention,<br />
Mara Coppens, conseillère à la Cellu<strong>le</strong><br />
stratégique du Ministre de la Coopération,<br />
Char<strong>le</strong>s Michel, rappel<strong>le</strong> que <strong>le</strong> genre est<br />
<strong>par</strong>tie intégrante de la politique de sécurité<br />
alimentaire du Ministre. El<strong>le</strong> précise que <strong>le</strong><br />
Ministre de la Coopération s’est engagé à<br />
accroître l’investissement dans <strong>le</strong> secteur<br />
agrico<strong>le</strong> <strong>et</strong> dans la sécurité alimentaire<br />
ainsi que dans la prise en compte du genre<br />
dans ce secteur.<br />
Isabel<strong>le</strong> Denis, chargée de liaison au<br />
bureau de liaison de la FAO avec l’Union<br />
Européenne <strong>et</strong> la Belgique, fait <strong>le</strong> tour de la<br />
question «<strong>femmes</strong> <strong>et</strong> sécurité alimentaire»<br />
<strong>et</strong> présente <strong>le</strong>s actions de la FAO sur <strong>le</strong> suj<strong>et</strong>.<br />
El<strong>le</strong> souligne que <strong>le</strong>s inégalités socia<strong>le</strong>s <strong>et</strong><br />
économiques entre hommes <strong>et</strong> <strong>femmes</strong><br />
comprom<strong>et</strong>tent la sécurité alimentaire <strong>et</strong><br />
freinent la croissance économique <strong>et</strong> <strong>le</strong>s<br />
progrès du secteur agrico<strong>le</strong>.<br />
Enfin, Thierry Kesteloot, chercheur sur la<br />
souverain<strong>et</strong>é alimentaire à Oxfam solidarité<br />
<strong>et</strong> membre de la Coalition belge contre la<br />
faim, présente <strong>le</strong>s actions de la coalition,<br />
<strong>par</strong><strong>le</strong> du désir de c<strong>et</strong>te dernière d’intégrer<br />
la dimension genre à son programme <strong>et</strong> de<br />
faire pour cela <strong>des</strong> liens avec <strong>le</strong>s différents<br />
acteurs de la lutte contre la faim, pour une<br />
vue plus globa<strong>le</strong>.<br />
Les résultats du séminaire ont démontré <strong>le</strong><br />
rô<strong>le</strong> essentiel <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> dans la sécurité<br />
alimentaire <strong>des</strong> famil<strong>le</strong>s. Cependant, dans<br />
la pratique, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> bénéficient de<br />
moins de droits que <strong>le</strong>s hommes en termes<br />
d’accès aux <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> de <strong>le</strong>ur contrô<strong>le</strong>.<br />
De plus, peu de moyens financiers sont<br />
dédiés à l’agriculture vivrière.<br />
Le troisième chapitre de notre publication<br />
concerne l’analyse <strong>des</strong> facteurs d’insécurité<br />
alimentaire <strong>et</strong> <strong>des</strong> stratégies<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> pour une sécurité alimentaire.<br />
Il reprend <strong>le</strong>s résultats d’étu<strong>des</strong> sur<br />
<strong>le</strong> thème réalisées au Sénégal, au Niger <strong>et</strong><br />
en RDC.<br />
Fatou Ndoye, chargée du programme genre<br />
à ENDA GRAF <strong>et</strong> coordinatrice de la plateforme<br />
alimentaire «Geewo Agro» à Dakar,<br />
Sénégal <strong>et</strong> Virginie Datt<strong>le</strong>r, titulaire d’un<br />
master en développement, présentent <strong>le</strong>s<br />
résultats d’une recherche sur <strong>le</strong>s stratégies<br />
développées <strong>par</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> du Sénégal<br />
pour nourrir <strong>le</strong>urs famil<strong>le</strong>s. Les situations<br />
de crise obligent <strong>le</strong>s famil<strong>le</strong>s à revoir <strong>le</strong>ur<br />
manière de consommer ainsi qu’à redéfinir<br />
<strong>le</strong>s priorités lors de l’investissement <strong>des</strong><br />
revenus. Différentes stratégies existent pour<br />
faire face à la crise <strong>et</strong> la difficulté de nourrir<br />
la famil<strong>le</strong> pousse <strong>par</strong>fois <strong>le</strong>s foyers à avoir<br />
recours à la restauration de rue, pratique<br />
de consommation de moindre qualité <strong>et</strong><br />
affectant <strong>par</strong> ail<strong>le</strong>urs la cohésion familia<strong>le</strong>. Les<br />
famil<strong>le</strong>s sont déstructurées <strong>et</strong> <strong>le</strong>s enfants de<br />
plus en plus livrés à eux-mêmes. Et pourtant,<br />
malgré ces difficultés, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> cherchent<br />
<strong>des</strong> solutions col<strong>le</strong>ctives à travers la création<br />
de restaurants populaires contrôlés ou de<br />
p<strong>et</strong>ites entreprises de transformation de<br />
produits agrico<strong>le</strong>s (fruits, farines, <strong>et</strong>c.). Le<br />
développement de ces pratiques d’économie<br />
solidaire perm<strong>et</strong> de répondre <strong>par</strong>tiel<strong>le</strong>ment<br />
au problème de l’insécurité alimentaire. De<br />
plus, el<strong>le</strong>s contribuent au renforcement de<br />
l’estime de soi <strong>et</strong> de la solidarité entre <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong>.<br />
Au Niger, Catherine Bé<strong>le</strong>msigri, consultante<br />
indépendante en genre, nous <strong>par</strong><strong>le</strong> de la<br />
<strong>par</strong>ticipation <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> à l’agriculture.<br />
El<strong>le</strong> nous propose un regard genre dans<br />
l’agriculture du Niger. Même si cela ne<br />
trans<strong>par</strong>aît pas dans <strong>le</strong>s données officiel<strong>le</strong>s,<br />
<strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> <strong>par</strong>ticipent clairement à la<br />
sécurité alimentaire, que ce soit à travers<br />
l’é<strong>le</strong>vage ou la production agrico<strong>le</strong> (mil,<br />
10
sorgho, maïs, haricot <strong>et</strong> légumineuses). De<br />
plus, el<strong>le</strong>s constituent une <strong>par</strong>t importante<br />
de la main d’œuvre utilisée dans <strong>le</strong>s<br />
champs familiaux. Le problème de l’accès<br />
à la terre reste une contrainte importante<br />
pour <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong>. En eff<strong>et</strong>, <strong>le</strong>ur accès à la<br />
terre <strong>et</strong> surtout <strong>le</strong>ur contrô<strong>le</strong> est limité en<br />
raison du système foncier au Niger (droit<br />
coutumier, religieux <strong>et</strong> moderne). En outre,<br />
l’acca<strong>par</strong>ement <strong>des</strong> terres rach<strong>et</strong>ées <strong>par</strong><br />
<strong>des</strong> nantis qui proposent une agriculture<br />
moderne intensive constitue une nouvel<strong>le</strong><br />
limite pour <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong>.<br />
Enfin, une étude réalisée <strong>par</strong> Françoise<br />
Kat, doctorante en RDC, présente une<br />
approche de l’insécurité alimentaire <strong>des</strong><br />
<strong>femmes</strong> enceintes à <strong>par</strong>tir <strong>des</strong> interdits<br />
alimentaires. Il en existe de nombreux dans<br />
la tradition africaine, qui, dans certains cas,<br />
peuvent avoir <strong>des</strong> conséquences néfastes<br />
sur la santé <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>. En eff<strong>et</strong>, si la<br />
situation économique se détériore, cel<strong>le</strong>sci<br />
ne trouvent pas toujours <strong>le</strong>s aliments de<br />
substitution à <strong>des</strong> prix abordab<strong>le</strong>s <strong>et</strong> font<br />
face à <strong>des</strong> carences alimentaires.<br />
Un quatrième chapitre intitulé «exemp<strong>le</strong>s<br />
de pratiques <strong>et</strong> stratégies à la base»,<br />
présente quatre témoignages d’organisations<br />
socia<strong>le</strong>s de développement. Chaque<br />
témoignage décrit <strong>le</strong>s stratégies mises en<br />
place <strong>par</strong> <strong>le</strong>s famil<strong>le</strong>s ainsi que <strong>le</strong>s changements<br />
<strong>des</strong> pratiques alimentaires liés aux<br />
crises. Il souligne éga<strong>le</strong>ment l’importance<br />
de l’accès aux <strong>ressources</strong> naturel<strong>le</strong>s - <strong>et</strong><br />
<strong>le</strong>ur contrô<strong>le</strong> - financières <strong>et</strong> humaines,<br />
pour assurer une alimentation de qualité<br />
au sein de la famil<strong>le</strong>.<br />
Tiné Ndoye, présidente du RNFRS «Réseau<br />
National <strong>des</strong> Femmes Rura<strong>le</strong>s du Sénégal»,<br />
<strong>par</strong>tage son expérience politique <strong>et</strong> agrico<strong>le</strong><br />
<strong>et</strong> décrit <strong>le</strong>s contraintes rencontrées <strong>par</strong> <strong>le</strong>s<br />
agricultrices.<br />
Djénébou Dembélé, coordinatrice de programmes<br />
d’AMAPEF «Association Malienne<br />
pour la Promotion <strong>des</strong> Entreprises Féminines»,<br />
fait <strong>le</strong> point sur <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
dans la gestion de la production agrico<strong>le</strong>.<br />
El<strong>le</strong> illustre <strong>par</strong> ail<strong>le</strong>urs l’expérience de son<br />
association.<br />
Annick Sezibera, présidente de la CAPAD<br />
«Confédération <strong>des</strong> Associations <strong>des</strong> Producteurs<br />
Agrico<strong>le</strong>s pour <strong>le</strong> Développement» au<br />
Burundi, nous introduit à la mission <strong>et</strong> aux<br />
activités de son organisation sur ce thème.<br />
Lea Claes, agricultrice belge, présente <strong>le</strong><br />
concept <strong>des</strong> «Voedselteams», groupes<br />
d’achat, qui se fournissent en fruits <strong>et</strong> légumes<br />
directement chez <strong>le</strong> cultivateur.<br />
En guise de conclusion, <strong>le</strong> groupe de<br />
travail présente une série de recommandations<br />
formulées en concertation avec <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> du Sud <strong>par</strong>ticipant au colloque.<br />
Ces recommandations, exprimées selon<br />
<strong>le</strong>s quatre principes de l’empowerment<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> - Avoir, Savoir, Vouloir, Pouvoir<br />
- sont <strong>des</strong>tinées à m<strong>et</strong>tre en lumière <strong>le</strong>s<br />
progrès à faire en matière de genre <strong>et</strong> sécurité<br />
alimentaire. El<strong>le</strong>s s’adressent à tous<br />
<strong>le</strong>s acteurs du développement que ce soit<br />
la Coopération internationa<strong>le</strong>, bi- <strong>et</strong> multilatéra<strong>le</strong>,<br />
ou <strong>le</strong>s acteurs de la coopération<br />
non-gouvernementa<strong>le</strong> au Nord <strong>et</strong> au Sud.<br />
Ces recommandations m<strong>et</strong>tent l’accent sur<br />
l’importance d’appuyer <strong>le</strong>s politiques de<br />
développement qui soutiennent <strong>et</strong> m<strong>et</strong>tent<br />
en place une agriculture paysanne pour une<br />
souverain<strong>et</strong>é alimentaire (droit <strong>des</strong> peup<strong>le</strong>s<br />
à choisir la manière de se nourrir). Et, de<br />
plus, que ces politiques de coopération<br />
puissent prendre en compte <strong>le</strong>s questions<br />
de genre. Cela signifie encourager <strong>des</strong><br />
recherches-actions qui tiennent compte<br />
<strong>des</strong> rô<strong>le</strong>s <strong>et</strong> <strong>des</strong> spécificités <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
<strong>et</strong> <strong>des</strong> hommes dans l’agriculture. Cela<br />
11
1. INTRODUCTION GLOBALE<br />
implique aussi <strong>le</strong> développement de<br />
recherches qui perm<strong>et</strong>tent d’améliorer<br />
<strong>le</strong>s conditions de production <strong>des</strong> produits<br />
vivriers en se basant sur <strong>le</strong>s savoirs <strong>et</strong><br />
en développant <strong>le</strong>s stratégies mises au<br />
point <strong>par</strong> <strong>le</strong>s paysannes. Les recherches<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong>s col<strong>le</strong>ctes de données devraient être<br />
différenciées <strong>par</strong> sexe.<br />
Un autre point important est l’accès <strong>des</strong><br />
hommes <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> à la terre <strong>et</strong> son<br />
contrô<strong>le</strong> (sécurité d’accès). L’acca<strong>par</strong>ement<br />
<strong>des</strong> terres que certains appel<strong>le</strong>nt <strong>le</strong> «nouveau<br />
colonialisme agraire» a <strong>des</strong> conséquences<br />
directes sur la vie <strong>des</strong> paysans-nes. Ces<br />
derniers-ières revendent <strong>le</strong>urs terres dans<br />
l’espoir d’une vie meil<strong>le</strong>ure en vil<strong>le</strong> <strong>et</strong> se<br />
r<strong>et</strong>rouvent fina<strong>le</strong>ment sans moyens <strong>et</strong> sans<br />
outils de production. L’accès à la terre <strong>et</strong> son<br />
contrô<strong>le</strong> sont aussi une question de droits.<br />
Or, à ce jour, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> ont moins de<br />
droits que <strong>le</strong>s hommes en matière d’accès<br />
aux <strong>ressources</strong>, qu’il s’agisse de la terre,<br />
<strong>des</strong> intrants, du crédit ou de la formation.<br />
Il est urgent de soutenir <strong>le</strong>s gouvernements<br />
du Sud qui sont prêts à revoir <strong>le</strong>s lois <strong>et</strong>/ou<br />
à m<strong>et</strong>tre en place <strong>des</strong> dispositifs pour<br />
<strong>le</strong>s faire appliquer de manière à garantir<br />
un accès équitab<strong>le</strong> aux <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> aux<br />
hommes aux <strong>ressources</strong> naturel<strong>le</strong>s <strong>et</strong><br />
financières. Des indicateurs de genre sont<br />
nécessaires pour mesurer c<strong>et</strong>te évolution.<br />
Il faut éga<strong>le</strong>ment s’assurer que <strong>le</strong>s lois<br />
relatives aux droits <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> à la terre<br />
soient votées <strong>et</strong> appliquées.<br />
Les recommandations insistent éga<strong>le</strong>ment<br />
sur <strong>le</strong> lien entre la sécurité alimentaire<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong> besoin d’un climat de paix. En eff<strong>et</strong>,<br />
dans bien <strong>des</strong> régions, <strong>le</strong>s hommes <strong>et</strong><br />
<strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> n’osent plus al<strong>le</strong>r dans <strong>le</strong>s<br />
champs de peur d’être attaqués, torturés<br />
ou violés. La vio<strong>le</strong>nce n’est pas un<br />
élément pris en compte comme tel dans<br />
<strong>le</strong>s politiques agrico<strong>le</strong>s ni même dans <strong>le</strong>s<br />
indicateurs <strong>des</strong> Objectifs du Millénaire pour<br />
<strong>le</strong> Développement (OMD). Et pourtant,<br />
on sait que <strong>le</strong>s vio<strong>le</strong>nces ont un eff<strong>et</strong><br />
dévastateur sur la santé <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>, <strong>le</strong>ur<br />
accès aux <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong>ur estime de soi<br />
(empowerment).<br />
Grâce à c<strong>et</strong>te publication, la CFD espère<br />
attirer l’attention <strong>des</strong> acteurs de la sécurité<br />
alimentaire sur la nécessité de donner<br />
plus de droits aux <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> de veil<strong>le</strong>r à<br />
l’application de droits déjà existants, pour<br />
une meil<strong>le</strong>ure sécurité alimentaire.<br />
Sophie Charlier,<br />
Présidente du groupe GESA<br />
Juin 2011<br />
12
1.2. INTRODUCTION à LA PROBLéMATIQUE DE L’ACCèS DES<br />
RESSOURCES ET DE LEURS CONTRÔLES PAR LES FEMMES<br />
EN LIEN AVEC LES ENjEUX DE LA SéCURITé ALIMENTAIRE<br />
GESA*<br />
Avoir à manger chaque jour pour ses<br />
enfants <strong>et</strong> pour soi-même est la plus grande<br />
préoccupation d’un très grand nombre<br />
d’hommes <strong>et</strong> de <strong>femmes</strong> dans <strong>le</strong> monde.<br />
Pourtant, la qualité de la nourriture ou <strong>le</strong>s<br />
conditions (directes ou indirectes) dans<br />
<strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s c<strong>et</strong>te nourriture a été produite<br />
ou la manière dont on se l’est procurée<br />
posent encore question. En eff<strong>et</strong>, bien <strong>des</strong><br />
<strong>femmes</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> hommes n’arrivent pas à<br />
subvenir à <strong>le</strong>urs besoins de base, c’est-àdire,<br />
avoir à manger <strong>et</strong> à boire en suffisance<br />
<strong>et</strong> en qualité, même si ceci devrait être un<br />
droit pour toutes <strong>et</strong> tous.<br />
En 2009, <strong>le</strong> nombre de personnes ayant<br />
faim dans <strong>le</strong> monde avait augmenté<br />
jusqu’à 1,02 milliard, <strong>le</strong> chiffre <strong>le</strong> plus<br />
é<strong>le</strong>vé depuis 1970.<br />
En 2010, une amélioration a été constatée<br />
<strong>et</strong> en septembre, la FAO a annoncé 1 que <strong>le</strong><br />
nombre de gens souffrant de la faim a chuté<br />
de 98 millions en 1 an mais il reste encore<br />
925 millions de personnes qui souffrent de<br />
la faim. La baisse s’expliquerait en grande<br />
<strong>par</strong>tie <strong>par</strong> une conjoncture économique plus<br />
favorab<strong>le</strong> en 2010 <strong>et</strong> <strong>par</strong> la baisse <strong>des</strong> prix<br />
alimentaires depuis 2008, aussi bien sur<br />
<strong>le</strong>s marchés internationaux que nationaux.<br />
925 millions de personnes souffrant de<br />
la faim, cela reste «supérieur au niveau<br />
d’avant <strong>le</strong>s crises alimentaire <strong>et</strong> économique<br />
de 2008», qui était de 850 millions.<br />
La baisse du nombre d’affamés s’est ressentie<br />
dans toutes <strong>le</strong>s régions du monde. L’Asie-<br />
Pacifique est la plus massivement touchée,<br />
avec 578 millions de personnes affamées,<br />
mais c’est aussi cel<strong>le</strong> où la faim a <strong>le</strong> plus reculé,<br />
avec une baisse de 12% <strong>par</strong> rapport à<br />
2009. La proportion d’affamés reste la plus<br />
forte en Afrique sub-saharienne, avec 30%<br />
de la population qui souffre de la faim. De<br />
plus, soixante dix pour cent de ceux qui ont<br />
faim vivent en zones rura<strong>le</strong>s.<br />
Les récentes crises régiona<strong>le</strong>s ou mondia<strong>le</strong>s<br />
(alimentaires – énergétiques – financières -<br />
environnementa<strong>le</strong>s) ainsi que <strong>le</strong>s situations<br />
de guerre <strong>et</strong> d’insécurité politique ont (eu)<br />
sans doute une influence sur l’insécurité<br />
alimentaire mais <strong>le</strong> fait que près d’un milliard<br />
de personnes continuent d’être victimes<br />
de la faim, même après la conclusion <strong>des</strong><br />
récentes crises alimentaire <strong>et</strong> financière,<br />
traduit un problème structurel plus profond<br />
conclut la FAO.<br />
C<strong>et</strong>te situation préoccupante mérite<br />
une attention <strong>par</strong>ticulière, raison pour<br />
laquel<strong>le</strong> la sécurité alimentaire est au<br />
cœur de beaucoup de programmes de<br />
développement, aussi bien <strong>des</strong> ONG que<br />
<strong>des</strong> Coopérations bi- <strong>et</strong> multilatéra<strong>le</strong>s.<br />
Par <strong>le</strong>ur rô<strong>le</strong> socioculturel, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> sont<br />
généra<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s premières responsab<strong>le</strong>s<br />
de l’approvisionnement en eau <strong>et</strong> de<br />
la transformation <strong>et</strong> pré<strong>par</strong>ation de la<br />
nourriture. Mais <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> économique <strong>des</strong><br />
<strong>femmes</strong> ne se limite pas à c<strong>et</strong> aspect de la<br />
sécurité alimentaire. Leurs responsabilités<br />
dans l’agriculture <strong>et</strong> l’é<strong>le</strong>vage ont souvent<br />
été sous-estimées <strong>et</strong> <strong>le</strong>ur travail dans ces<br />
domaines reste encore trop peu visib<strong>le</strong>. En<br />
milieu urbain, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> – suite à <strong>le</strong>urs<br />
activités multip<strong>le</strong>s génératrices de revenus<br />
- contribuent considérab<strong>le</strong>ment au budg<strong>et</strong><br />
du ménage pour l’achat <strong>et</strong> la transformation<br />
<strong>des</strong> aliments. C<strong>et</strong>te situation est d’autant<br />
plus <strong>par</strong>lante pour <strong>le</strong>s ménages ayant une<br />
femme comme chef de ménage - à cause<br />
de la migration, du divorce ou du veuvage -<br />
1<br />
www.france24.com/fr/20100914-fao-onu-faim-monde-recu<strong>le</strong>-crise-alimentaire-prixbaisse<br />
* Document de travail du groupe GESA élaboré sous la coordination de Lis<strong>et</strong>te Caubergs, Carmelina Caraccillo,<br />
Sophie Charlier, Maartje Houbrechts, Eliane Najros, Marie-Thérèse Ndumba.<br />
13
1. INTRODUCTION GLOBALE<br />
<strong>et</strong> qui figurent souvent <strong>par</strong>mi <strong>le</strong>s ménages<br />
<strong>le</strong>s plus pauvres. En Afrique subsaharienne,<br />
31% <strong>des</strong> ménages ruraux sont dirigés <strong>par</strong><br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong>, alors qu’en Amérique latine,<br />
aux Caraïbes <strong>et</strong> en Asie, <strong>le</strong>s chiffres sont<br />
respectivement de 17 <strong>et</strong> 14%.<br />
D’autre <strong>par</strong>t, <strong>le</strong>s contraintes économiques,<br />
socia<strong>le</strong>s <strong>et</strong> culturel<strong>le</strong>s auxquel<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
doivent faire face <strong>le</strong>s empêchent d’assurer<br />
<strong>le</strong>urs responsabilités <strong>et</strong>/ou de trouver un<br />
juste équilibre avec <strong>le</strong>s hommes dans l’accomplissement<br />
de ces responsabilités.<br />
Ces réalités - la faim dans <strong>le</strong> monde <strong>et</strong> <strong>le</strong>s<br />
responsabilités <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> dans la sécurité<br />
alimentaire - nous interpel<strong>le</strong>nt en tant que<br />
groupe de travail de la Commission «Femmes<br />
<strong>et</strong> Développement». Aussi, <strong>le</strong> groupe de travail<br />
sur l’empowerment <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> a décidé<br />
de continuer son engagement <strong>et</strong> de focaliser<br />
ses efforts sur <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> dans la<br />
sécurité alimentaire.<br />
Ce document veut servir de cadre de référence<br />
pour guider <strong>le</strong>s recherches-action en<br />
cours dans <strong>le</strong> Sud, <strong>et</strong> pour formu<strong>le</strong>r <strong>des</strong><br />
recommandations vis-à-vis de la Coopération<br />
internationa<strong>le</strong>, bi- multilatéra<strong>le</strong> <strong>et</strong><br />
non-gouvernementa<strong>le</strong>.<br />
• Les crises <strong>et</strong> La sécurité<br />
ALImENTAIRE<br />
Ces dernières années, <strong>le</strong> monde a subi<br />
trois crises importantes qui ont <strong>des</strong> impacts<br />
sur la sécurité alimentaire : la crise<br />
<strong>des</strong> prix <strong>des</strong> matières premières (produits<br />
agrico<strong>le</strong>s <strong>et</strong> pétro<strong>le</strong>), la crise financière,<br />
ainsi que la crise environnementa<strong>le</strong> (changement<br />
climatique). El<strong>le</strong>s ont <strong>des</strong> origines<br />
communes, liées notamment au manque<br />
d’engagement vis-à-vis <strong>des</strong> rég<strong>le</strong>mentations<br />
internationa<strong>le</strong>s, de la faib<strong>le</strong>sse <strong>des</strong><br />
états ainsi que de la libéralisation du commerce<br />
international. Le système mondial a<br />
dérapé dans l’exercice de la gouvernance<br />
de la mondialisation (CSI, 2009).<br />
Premièrement, la crise <strong>des</strong> prix <strong>des</strong> matières<br />
premières est au dé<strong>par</strong>t due à une<br />
chute constante <strong>des</strong> prix <strong>des</strong> produits agrico<strong>le</strong>s<br />
sur <strong>le</strong> marché international <strong>et</strong> <strong>par</strong><br />
conséquent, une diminution <strong>des</strong> stocks.<br />
Ces produits agrico<strong>le</strong>s ont dès lors fait l’obj<strong>et</strong><br />
de spéculation <strong>et</strong> ont atteint en 2008,<br />
un niveau de prix très bas sur <strong>le</strong> marché<br />
international (en <strong>des</strong>sous <strong>des</strong> coûts de<br />
production). A cela s’ajoutent l’augmentation<br />
du prix du pétro<strong>le</strong>, <strong>et</strong> cel<strong>le</strong> <strong>des</strong> coûts<br />
de production (engrais, pesticide, carburant,<br />
transport, <strong>et</strong>c.).<br />
La chute <strong>des</strong> prix <strong>des</strong> produits agrico<strong>le</strong>s<br />
rem<strong>et</strong> éga<strong>le</strong>ment en question <strong>le</strong>s modifications<br />
de taxes aux frontières, effectuées<br />
en 2008 dans un contexte de hausse <strong>des</strong><br />
prix pour <strong>le</strong>s autres produits <strong>et</strong> de crise<br />
alimentaire. Ces changements sont causes<br />
de tensions entre l’État (ressource budgétaire),<br />
<strong>le</strong>s consommateurs (prix <strong>des</strong> denrées)<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong>s producteurs (débouchés).<br />
Depuis quelques années, l’agriculture fait<br />
<strong>par</strong>tie <strong>des</strong> négociations internationa<strong>le</strong>s<br />
(à l’OMC); <strong>le</strong>s politiques agrico<strong>le</strong>s qui<br />
en décou<strong>le</strong>nt ont éga<strong>le</strong>ment un impact<br />
important sur la situation précaire de<br />
l’agriculture dans <strong>le</strong>s pays pauvres. Les<br />
échanges commerciaux internationaux<br />
affectent autant <strong>le</strong>s marchés orientés vers<br />
l’exportation que <strong>le</strong>s marchés locaux. Leur<br />
influence sur <strong>le</strong>s ménages peut être tantôt<br />
positive (<strong>par</strong> l’amélioration <strong>des</strong> revenus <strong>et</strong><br />
la disponibilité de biens à moindre prix),<br />
tantôt négative (<strong>par</strong> la réduction <strong>des</strong><br />
14
terres disponib<strong>le</strong>s ou la perte de revenus<br />
qu’occasionne <strong>le</strong> dumping de produits<br />
importés face auquel la production<br />
familia<strong>le</strong> est impuissante). Ainsi <strong>par</strong><br />
exemp<strong>le</strong>, <strong>des</strong> politiques qui soutiennent<br />
prioritairement <strong>le</strong>s marchés d’exportation<br />
auront tendance à bénéficier surtout à<br />
ceux qui font de la culture de rente au<br />
détriment de la culture vivrière. De plus,<br />
la non protection de l’agriculture loca<strong>le</strong><br />
a pour conséquence la <strong>des</strong>truction <strong>des</strong><br />
p<strong>et</strong>ites exploitations familia<strong>le</strong>s. Par ail<strong>le</strong>urs,<br />
l’importation de produits alimentaires<br />
menace <strong>le</strong>s marchés locaux, car outre<br />
la baisse <strong>des</strong> prix à la consommation,<br />
notamment la consommation alimentaire<br />
familia<strong>le</strong> (surtout dans <strong>le</strong>s zones<br />
urbaines), el<strong>le</strong> fait baisser <strong>le</strong>s rentrées<br />
d’argent issues de la vente de produits<br />
sur <strong>le</strong>s marchés locaux. Ce deuxième eff<strong>et</strong><br />
pénalise davantage <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> qui sont<br />
<strong>le</strong>s principa<strong>le</strong>s productrices agrico<strong>le</strong>s <strong>des</strong><br />
produits vivriers. Le risque est moindre<br />
en revanche si <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> se spécialisent<br />
dans une production loca<strong>le</strong> qui n’est pas<br />
concurrencée <strong>par</strong> <strong>le</strong>s importations. En Inde,<br />
<strong>par</strong> exemp<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> Dalits apportent<br />
<strong>le</strong>ur récolte traditionnel<strong>le</strong> de mill<strong>et</strong> sur<br />
<strong>le</strong>s marchés locaux, el<strong>le</strong>s y trouvent ainsi<br />
un avantage com<strong>par</strong>atif <strong>par</strong> rapport aux<br />
grands exploitants rizico<strong>le</strong>s, étant donné<br />
que <strong>le</strong> gouvernement considère <strong>le</strong> riz<br />
comme une denrée alimentaire <strong>des</strong>tinée à<br />
l’exportation. D’autres règ<strong>le</strong>s commercia<strong>le</strong>s<br />
actuel<strong>le</strong>ment discutées à l’OMC ont<br />
éga<strong>le</strong>ment <strong>des</strong> conséquences désastreuses<br />
sur <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> la souverain<strong>et</strong>é<br />
alimentaire. Ainsi <strong>par</strong> exemp<strong>le</strong> <strong>le</strong>s accords<br />
internationaux sur la protection <strong>des</strong> droits<br />
intel<strong>le</strong>ctuels (ADPIC) sont défavorab<strong>le</strong>s<br />
aux paysans <strong>et</strong> <strong>par</strong>ticulièrement aux<br />
paysannes gardiennes de la biodiversité<br />
(S. Charlier, 2006).<br />
Deuxièmement, différents mécanismes de<br />
contagion de la crise financière aux pays<br />
du Sud sont reconnus. Suite à la crise financière,<br />
<strong>le</strong>s eff<strong>et</strong>s suivants sont à noter :<br />
chute de 33% <strong>des</strong> investissements directs,<br />
diminution de 20% <strong>des</strong> transferts <strong>des</strong><br />
migrants, diminution de 33% à 40% <strong>des</strong><br />
prêts bancaires internationaux. Ces impacts<br />
touchent l’agriculture tant en termes<br />
de croissance que d’emploi <strong>et</strong> de ré<strong>par</strong>tition<br />
<strong>des</strong> revenus. Le resserrement de<br />
l’offre de crédit devrait jouer directement<br />
sur <strong>le</strong>s capacités à financer l’importation<br />
de produits alimentaires, l’achat d’intrants<br />
<strong>et</strong> l’investissement dans la production<br />
agrico<strong>le</strong>. En outre, la baisse du prix <strong>des</strong><br />
matières premières agrico<strong>le</strong>s affecte fortement<br />
<strong>le</strong>s producteurs <strong>et</strong> l’économie généra<strong>le</strong><br />
de ces pays.<br />
Il faut souligner éga<strong>le</strong>ment l’impact en<br />
milieu rural de la dégradation de la situation<br />
économique <strong>des</strong> populations urbaines<br />
issues de l’exode rural. Ayant perdu <strong>le</strong>ur<br />
emploi, <strong>le</strong>s populations sont en train de<br />
r<strong>et</strong>ourner vers <strong>le</strong>urs pays d’origine <strong>et</strong>/ou<br />
vers <strong>le</strong>s campagnes. Or, beaucoup de ménages<br />
ruraux dépendent <strong>des</strong> transferts financiers<br />
de membres de <strong>le</strong>ur famil<strong>le</strong> <strong>par</strong>tis<br />
travail<strong>le</strong>r en vil<strong>le</strong> <strong>et</strong> perdent donc un<br />
fil<strong>et</strong> de sécurité important. De plus, ces<br />
r<strong>et</strong>ours vers <strong>le</strong>s campagnes accentuent la<br />
pression sur la terre <strong>et</strong> peuvent aboutir<br />
à <strong>des</strong> conflits fonciers. Au niveau local,<br />
la crise alimentaire a <strong>des</strong> conséquences<br />
importantes. Non seu<strong>le</strong>ment on assiste à<br />
une diminution <strong>des</strong> denrées alimentaires<br />
disponib<strong>le</strong>s dans la famil<strong>le</strong>, mais éga<strong>le</strong>ment<br />
à un changement dans <strong>le</strong>s habitu<strong>des</strong><br />
alimentaires : <strong>le</strong>s dis<strong>par</strong>ités dans la<br />
distribution de l’alimentation au sein de<br />
la famil<strong>le</strong> ont augmenté en défaveur <strong>des</strong><br />
<strong>femmes</strong>.<br />
15
1. INTRODUCTION GLOBALE<br />
À ces difficultés s’ajoutent <strong>des</strong> facteurs de<br />
déstabilisation supplémentaire comme <strong>le</strong>s<br />
risques climatiques. L’impact <strong>des</strong> changements<br />
climatiques sur l’insécurité alimentaire<br />
vis-à-vis <strong>des</strong> personnes <strong>le</strong>s plus pauvres<br />
est certainement un grand défi pour demain.<br />
Le changement climatique <strong>et</strong> <strong>le</strong>s<br />
défaillances du système alimentaire soulèvent<br />
d’importantes questions en termes<br />
de droits (d’accès <strong>et</strong> de contrô<strong>le</strong> <strong>des</strong> <strong>ressources</strong><br />
naturel<strong>le</strong>s) <strong>et</strong> de justice socia<strong>le</strong>.<br />
Ils doivent être considérés en termes de<br />
genre, c’est-à-dire en fonction <strong>des</strong> besoins<br />
<strong>et</strong> <strong>des</strong> stratégies différentes <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
<strong>et</strong> <strong>des</strong> hommes.<br />
Les crises économiques mondia<strong>le</strong>s<br />
ainsi que la mise sur <strong>le</strong> marché <strong>des</strong><br />
négociations internationa<strong>le</strong>s <strong>des</strong> produits<br />
agrico<strong>le</strong>s ont un fort impact sur <strong>le</strong>s pays<br />
du Sud en général, <strong>et</strong> sur <strong>le</strong>ur agriculture<br />
en <strong>par</strong>ticulier, avec la menace réel<strong>le</strong> de<br />
nouvel<strong>le</strong>s crises alimentaires. Ceci nous<br />
rappel<strong>le</strong> <strong>le</strong> caractère géostratégique de<br />
l’agriculture, insuffisamment pris en<br />
compte, <strong>et</strong> <strong>le</strong> potentiel déstabilisateur<br />
de tel<strong>le</strong>s crises sur <strong>le</strong>s États (émeutes,<br />
terrorisme, narcotrafic). Les pays jugés<br />
<strong>le</strong>s plus vulnérab<strong>le</strong>s <strong>par</strong> <strong>le</strong> FMI sont<br />
souvent déjà fragi<strong>le</strong>s (Libéria, Angola,<br />
République démocratique du Congo,<br />
Soudan, Centrafrique, <strong>et</strong>c.) <strong>et</strong> <strong>le</strong>s<br />
risques d’instabilité politique <strong>et</strong> socia<strong>le</strong><br />
voire de conflits sont réels.<br />
Pour faire face à ces menaces, <strong>le</strong>s pays <strong>le</strong>s<br />
plus pauvres ont peu de réserve monétaire<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong>ur situation budgétaire s’aggrave.<br />
Les 1.100 milliards de dollars de<br />
fonds supplémentaires pour <strong>le</strong> FMI <strong>et</strong> la<br />
Banque mondia<strong>le</strong> votés <strong>par</strong> <strong>le</strong> G20 se traduiront<br />
majoritairement <strong>par</strong> <strong>des</strong> prêts,<br />
peu accessib<strong>le</strong>s aux pays <strong>le</strong>s moins avancés,<br />
plutôt engagés dans <strong>des</strong> processus<br />
d’apurement de d<strong>et</strong>tes passées que<br />
de contraction de nouvel<strong>le</strong>s. «A titre de<br />
com<strong>par</strong>aison, <strong>le</strong>s 44 milliards de dollars<br />
d’aide publique au développement qui<br />
sont consacrés au développement agrico<strong>le</strong><br />
représentent un montant très faib<strong>le</strong><br />
com<strong>par</strong>é aux 365 milliards de dollars dépensés<br />
en 2007 <strong>par</strong> <strong>le</strong>s pays riches pour<br />
soutenir <strong>le</strong>urs agricultures ou aux 1.340<br />
milliards de dollars dépensés chaque année<br />
dans <strong>le</strong> monde sur <strong>le</strong>s armements,<br />
sans compter <strong>le</strong>s sommes inimaginab<strong>le</strong>s<br />
qui ont été mobilisées très rapidement en<br />
2008-2009 pour soutenir <strong>le</strong> secteur financier»<br />
(Discours de M. Jacques Diouf, FAO,<br />
JMA, 16 Octobre 2009).<br />
• La sécurité aLimentaire –<br />
LES TROIS pILIERS 2<br />
«La sécurité alimentaire existe lorsque<br />
tous <strong>le</strong>s êtres humains ont, à tout moment,<br />
un accès physique <strong>et</strong> économique à<br />
une nourriture suffisante, saine <strong>et</strong><br />
nutritive <strong>le</strong>ur perm<strong>et</strong>tant de satisfaire<br />
<strong>le</strong>urs besoins énergétiques <strong>et</strong> <strong>le</strong>urs<br />
préférences alimentaires pour mener une<br />
vie saine <strong>et</strong> active» (Somm<strong>et</strong> mondial de<br />
l’alimentation, 1996).<br />
C<strong>et</strong>te définition présente trois dimensions<br />
principa<strong>le</strong>s de la sécurité alimentaire<br />
à savoir la disponibilité physique,<br />
l’accès économique <strong>et</strong> physique <strong>des</strong><br />
aliments <strong>et</strong> l’utilisation <strong>des</strong> aliments ou<br />
la sécurité nutritionnel<strong>le</strong>. Les <strong>femmes</strong><br />
ont <strong>des</strong> responsabilités importantes<br />
dans l’apport de ces trois éléments,<br />
indispensab<strong>le</strong>s pour atteindre la sécurité<br />
alimentaire. Mais el<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s remplissent<br />
en se heurtant à d’énormes contraintes<br />
socioculturel<strong>le</strong>s <strong>et</strong> économiques. Dans la<br />
2<br />
FAO-focus : http://www.fao.org/focus/f/women/Sustin-f.htm<br />
16
production, <strong>le</strong> stockage, <strong>le</strong> commerce <strong>et</strong> la<br />
transformation <strong>des</strong> aliments, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong>s hommes n’ont pas <strong>le</strong>s mêmes tâches<br />
ni <strong>le</strong>s mêmes possibilités d’avoir accès<br />
aux moyens de production (terre, temps,<br />
crédit, technologie, information,…) <strong>et</strong><br />
de <strong>le</strong>s contrô<strong>le</strong>r. Il en va de même pour<br />
<strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> <strong>des</strong> bénéfices <strong>des</strong> activités<br />
agrico<strong>le</strong>s <strong>et</strong> commercia<strong>le</strong>s.<br />
Depuis quelques années, <strong>le</strong>s mouvements<br />
sociaux se positionnent au-delà de la sécurité<br />
alimentaire en y ajoutant une dimension<br />
politique. Ils <strong>par</strong><strong>le</strong>nt de la souverain<strong>et</strong>é<br />
alimentaire ce qui désigne «<strong>le</strong> droit <strong>des</strong><br />
peup<strong>le</strong>s, <strong>des</strong> pays <strong>et</strong>/ou <strong>des</strong> Etat à définir<br />
<strong>le</strong>ur politique agrico<strong>le</strong> <strong>et</strong> alimentaire». El<strong>le</strong><br />
est certainement un enjeu qui touche de<br />
près <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong>, non seu<strong>le</strong>ment dans <strong>le</strong>ur<br />
rô<strong>le</strong> de citoyennes, mais éga<strong>le</strong>ment dans<br />
<strong>le</strong>ur lutte pour plus d’autonomie, pour<br />
un empowerment. Les groupements de<br />
<strong>femmes</strong> se positionnent non seu<strong>le</strong>ment <strong>par</strong><br />
rapport aux politiques en matière d’alimentation<br />
mais éga<strong>le</strong>ment en incluant la reconnaissance<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong>s droits <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> - ainsi<br />
que de tout être humain - à une vie digne.<br />
La Marche <strong>des</strong> Femmes au sein du mouvement<br />
Via Campesina a déclaré, lors du<br />
Forum sur la Souverain<strong>et</strong>é alimentaire<br />
(Nyéléni, 2007):<br />
«La garantie du droit à l’alimentation<br />
passe <strong>par</strong> la priorité de la production loca<strong>le</strong><br />
pour nourrir <strong>le</strong>s populations <strong>et</strong> <strong>par</strong> l’accès<br />
<strong>des</strong> agricultrices <strong>et</strong> agriculteurs ainsi que<br />
<strong>des</strong> sans-terre, à la terre, à l’eau, aux<br />
semences <strong>et</strong> aux crédits. El<strong>le</strong> passe aussi<br />
<strong>par</strong> la prise en compte du travail invisib<strong>le</strong><br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> qui pré<strong>par</strong>ent <strong>et</strong> distribuent<br />
la nourriture, mais pas dans <strong>le</strong> sens que<br />
lui donnent <strong>le</strong>s organisations comme la<br />
Banque mondia<strong>le</strong>, c’est-à-dire en m<strong>et</strong>tant<br />
sur la femme <strong>le</strong> fardeau <strong>et</strong> la responsabilité<br />
de la santé <strong>et</strong> du bien-être familial dans<br />
un contexte de réduction, de la <strong>par</strong>t <strong>des</strong><br />
Etats <strong>et</strong> <strong>des</strong> entreprises, <strong>des</strong> salaires <strong>et</strong><br />
<strong>des</strong> droits <strong>des</strong> travail<strong>le</strong>uses <strong>et</strong> travail<strong>le</strong>urs.<br />
Notre voie est cel<strong>le</strong> de la reconnaissance<br />
du fait que la durabilité de la vie humaine,<br />
pour laquel<strong>le</strong> l’alimentation constitue une<br />
<strong>par</strong>tie fondamenta<strong>le</strong>, doit être au cœur de<br />
l’économie <strong>et</strong> de l’organisation socia<strong>le</strong>.»<br />
D’autres encore se battent pour que <strong>le</strong><br />
respect du droit à l’alimentation puisse<br />
être garanti <strong>par</strong> <strong>le</strong>s pouvoirs publics.<br />
- La disponibiLité <strong>des</strong> aLiments<br />
La disponibilité <strong>des</strong> aliments fait référence,<br />
au «côté de l’offre» de la sécurité alimentaire<br />
<strong>et</strong> est déterminée <strong>par</strong> la production<br />
agrico<strong>le</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong>s niveaux de provisions.<br />
Quant à la production agrico<strong>le</strong>, la division<br />
<strong>des</strong> responsabilités entre <strong>le</strong>s hommes <strong>et</strong><br />
<strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> varie selon <strong>le</strong>s pays <strong>et</strong> est en<br />
évolution constante. En règ<strong>le</strong> généra<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s<br />
hommes sont chargés <strong>des</strong> cultures commercia<strong>le</strong>s<br />
de grande envergure, notamment<br />
lorsqu’el<strong>le</strong>s sont très mécanisées,<br />
tandis que <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> cultivent <strong>des</strong> <strong>par</strong>cel<strong>le</strong>s<br />
plus p<strong>et</strong>ites à l’aide de techniques<br />
<strong>et</strong> d’outils traditionnels, dont la production<br />
est <strong>des</strong>tinée à la consommation familia<strong>le</strong> <strong>et</strong><br />
au marché local. Les <strong>femmes</strong> représentent<br />
éga<strong>le</strong>ment une <strong>par</strong>tie de la main-d’œuvre<br />
agrico<strong>le</strong> dans <strong>le</strong>s plantations.<br />
«En Afrique sub-saharienne, <strong>le</strong>s paysannes<br />
représentent 60 à 80% de la main-d’œuvre<br />
employée dans la production agrico<strong>le</strong> alimentaire<br />
<strong>et</strong> de rente. En Asie, el<strong>le</strong>s sont<br />
responsab<strong>le</strong>s d’environ 50% de la production<br />
alimentaire globa<strong>le</strong> de la région, avec<br />
<strong>des</strong> variations considérab<strong>le</strong>s, selon <strong>le</strong>s<br />
17
1. INTRODUCTION GLOBALE<br />
pays. En Amérique latine <strong>et</strong> aux Caraïbes,<br />
aux cours <strong>des</strong> dernières décennies, la population<br />
rura<strong>le</strong> a diminué ainsi que la proportion<br />
de la main d’œuvre agrico<strong>le</strong>. Alors<br />
qu’en 1950, 55% de la population ap<strong>par</strong>tenait<br />
au secteur agrico<strong>le</strong>, il n’en restait que<br />
25%en 1990. Les <strong>femmes</strong> s’y occupent<br />
principa<strong>le</strong>ment de l’agriculture de subsistance,<br />
<strong>par</strong>ticulièrement de l’horticulture <strong>et</strong><br />
de l’é<strong>le</strong>vage <strong>des</strong> volail<strong>le</strong>s <strong>et</strong> du p<strong>et</strong>it bétail<br />
pour la consommation domestique.» 3<br />
Un aspect souvent sous-estimé est <strong>le</strong> fait<br />
que <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> contribuent largement<br />
à la préservation de la biodiversité, un<br />
élément essentiel en matière de sécurité<br />
alimentaire. Grâce à <strong>le</strong>urs responsabilités<br />
dans <strong>le</strong>s domaines de l’alimentation <strong>et</strong><br />
<strong>des</strong> soins de <strong>le</strong>urs famil<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
possèdent souvent une connaissance<br />
spécia<strong>le</strong> <strong>des</strong> vertus <strong>et</strong> modalités<br />
d’utilisation <strong>des</strong> plantes en matière de<br />
nutrition, de santé ou pour la vente. Par<br />
conséquent, el<strong>le</strong>s sont fréquemment <strong>le</strong>s<br />
conservatrices du savoir traditionnel relatif<br />
aux plantes indigènes.<br />
Pour tous ces aspects, la contribution <strong>des</strong><br />
<strong>femmes</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> fil<strong>le</strong>s est souvent sous-estimée<br />
car la plu<strong>par</strong>t <strong>des</strong> enquêtes <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />
recensements ne comptabilisent que <strong>le</strong><br />
travail rémunéré. De plus, <strong>le</strong>s données de<br />
production proviennent <strong>des</strong> archives foncières<br />
où <strong>le</strong>s terres ap<strong>par</strong>tiennent officiel<strong>le</strong>ment<br />
aux hommes.<br />
- L’accès économique <strong>et</strong><br />
physique <strong>des</strong> aLiments<br />
«L’accès économique <strong>et</strong> physique focalise<br />
sur <strong>le</strong> revenu, <strong>le</strong>s dépenses, <strong>le</strong> marché<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong> prix <strong>des</strong> aliments pour atteindre<br />
<strong>le</strong>s objectifs de sécurité alimentaire. Ce<br />
point est important <strong>par</strong>ce que de bonnes<br />
provisions alimentaires au niveau national<br />
ou international ne garantissent pas en<br />
soi la sécurité alimentaire <strong>des</strong> ménages. A<br />
titre d’exemp<strong>le</strong>, une région peut disposer<br />
de stocks alimentaires mais un village<br />
de c<strong>et</strong>te région peut être marqué <strong>par</strong><br />
une insécurité alimentaire en période de<br />
soudure du fait de son iso<strong>le</strong>ment. Dans un<br />
autre cas, même si <strong>le</strong> marché du village<br />
est bien fourni, une famil<strong>le</strong> peut se trouver<br />
en insécurité alimentaire si el<strong>le</strong> a connu <strong>le</strong><br />
chômage <strong>et</strong> si <strong>le</strong>s prix du marché sont trop<br />
é<strong>le</strong>vés pour son pouvoir d’achat. Quant à<br />
l’accessibilité, il s’agit <strong>le</strong> plus souvent d’une<br />
combinaison entre production, échanges<br />
<strong>et</strong> mécanismes sociaux. En zone rura<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s<br />
populations vont s’appuyer principa<strong>le</strong>ment<br />
sur <strong>le</strong>ur production, complétée <strong>par</strong><br />
<strong>des</strong> échanges de denrées alimentaires<br />
sur <strong>le</strong> marché. En milieu urbain, <strong>le</strong>s<br />
denrées alimentaires nécessaires aux<br />
populations proviennent principa<strong>le</strong>ment<br />
du marché. Dans ce cas, <strong>des</strong> mécanismes<br />
sociaux (entraide, soutien familial, aide<br />
alimentaire, crédits…) vont intervenir pour<br />
préserver l’accès aux disponibilités <strong>et</strong> la<br />
sécurité alimentaire <strong>des</strong> populations». 4<br />
Des éléments probants re<strong>le</strong>vés en Afrique,<br />
en Asie <strong>et</strong> en Amérique Latine indiquent<br />
que <strong>le</strong>s revenus <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> ont une plus<br />
grande incidence que <strong>le</strong>s revenus <strong>des</strong><br />
hommes sur la sécurité alimentaire <strong>des</strong><br />
ménages <strong>et</strong> sur la nutrition <strong>des</strong> enfants.<br />
Ceci s’explique <strong>par</strong> <strong>le</strong> fait que <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
ont traditionnel<strong>le</strong>ment la charge du<br />
ménage, <strong>et</strong> notamment la responsabilité<br />
d’assurer que tous <strong>le</strong>s membres du<br />
ménage reçoivent une <strong>par</strong>t adéquate <strong>des</strong><br />
aliments disponib<strong>le</strong>s. Les observations<br />
montrent aussi que <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> passent<br />
plus de temps avec <strong>le</strong>s enfants.<br />
3<br />
www.fao.org/docrep/x0233f/x0233f02.htm<br />
4<br />
FAO, Les concepts de sécurité alimentaire <strong>et</strong> <strong>le</strong>ur aptitude à répondre aux défis posés <strong>par</strong> la croissance urbaine.<br />
18
Par ail<strong>le</strong>urs, <strong>le</strong>s hommes <strong>et</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> ont<br />
<strong>des</strong> flux de revenu différents. Puisque <strong>le</strong>s<br />
revenus <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> sont plus fréquents<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong>s montants moins importants, ils sont<br />
davantage consacrés aux besoins de subsistance<br />
quotidiens du ménage <strong>par</strong> rapport aux<br />
revenus saisonniers globaux perçus <strong>par</strong> <strong>le</strong>s<br />
hommes. Au Niger, <strong>par</strong> exemp<strong>le</strong>, une étude<br />
a démontré que la périodicité <strong>des</strong> flux de<br />
revenus féminins a une incidence profonde<br />
sur <strong>le</strong> total <strong>des</strong> dépenses <strong>des</strong> ménages <strong>et</strong> <strong>le</strong>s<br />
dépenses alimentaires selon la saison, alors<br />
que la périodicité <strong>des</strong> revenus masculins n’a<br />
aucune incidence. Ce qui indiquerait que <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> ont moins accès que <strong>le</strong>s hommes<br />
aux <strong>ressources</strong> perm<strong>et</strong>tant d’égaliser la<br />
consommation, comme <strong>par</strong> exemp<strong>le</strong> <strong>le</strong> crédit<br />
<strong>et</strong> l’é<strong>par</strong>gne (IFPRI, 1995).<br />
Dans <strong>le</strong> cadre de la lutte contre l’insécurité<br />
alimentaire, il convient donc de souligner<br />
l’importance du «contrô<strong>le</strong>» <strong>des</strong> revenus<br />
<strong>par</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong>. En eff<strong>et</strong>, cel<strong>le</strong>s-ci ont<br />
tendance à <strong>le</strong>s consacrer au bien-être de<br />
la famil<strong>le</strong>, notamment à l’amélioration du<br />
niveau nutritionnel <strong>des</strong> membres <strong>le</strong>s plus<br />
vulnérab<strong>le</strong>s.<br />
- La sécurité nutritionneLLe<br />
L’utilisation <strong>des</strong> aliments comprend la<br />
façon dont <strong>le</strong> corps optimise <strong>le</strong>s différents<br />
nutriments présents dans <strong>le</strong>s aliments. De<br />
bonnes pratiques de soins <strong>et</strong> d’alimentation,<br />
de pré<strong>par</strong>ation <strong>des</strong> aliments, de diversité<br />
du régime alimentaire, <strong>et</strong> de distribution<br />
<strong>des</strong> aliments à l’intérieur du ménage<br />
ont pour résultat un apport adéquat<br />
d’énergie <strong>et</strong> de nutriments. Ceci s’ajoute<br />
à une bonne utilisation biologique <strong>des</strong><br />
aliments consommés, <strong>et</strong> détermine l’état<br />
nutritionnel <strong>des</strong> individus. Les <strong>femmes</strong>,<br />
<strong>par</strong> <strong>le</strong>urs tâches de transformation <strong>des</strong><br />
denrées, contribuent à ce troisième aspect<br />
de la sécurité alimentaire en perm<strong>et</strong>tant<br />
de réduire <strong>le</strong>s pertes, de diversifier <strong>le</strong>s<br />
régimes alimentaires <strong>et</strong> d’assurer un apport<br />
en vitamines <strong>et</strong> minéraux important.<br />
Par ail<strong>le</strong>urs, l’accès aux aliments dans un<br />
ménage demande éga<strong>le</strong>ment une approche<br />
«genre sensib<strong>le</strong>». En eff<strong>et</strong>, la disponibilité de<br />
la nourriture ne garantit pas nécessairement<br />
une ré<strong>par</strong>tition équitab<strong>le</strong> de cel<strong>le</strong>-ci entre<br />
tous <strong>le</strong>s membres de la famil<strong>le</strong>. Ainsi, <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong>s fil<strong>le</strong>s sont <strong>par</strong>fois défavorisées<br />
quant à la qualité ou la quantité d’aliments<br />
qu’el<strong>le</strong>s peuvent consommer. La plu<strong>par</strong>t<br />
<strong>des</strong> éléments probants relatifs au préjudice<br />
dans l’affectation <strong>des</strong> aliments au sein <strong>des</strong><br />
ménages vient de l’Asie du Sud, <strong>et</strong> indique<br />
fortement qu’il existe un préjugé marqué en<br />
faveur <strong>des</strong> hommes <strong>et</strong> <strong>des</strong> adultes en ce qui<br />
concerne l’apport alimentaire dans c<strong>et</strong>te région.<br />
Une <strong>par</strong>tie de ce préjudice s’expliquerait<br />
<strong>par</strong> la spécialisation <strong>des</strong> hommes dans<br />
<strong>le</strong>s tâches à forte intensité énergétique. Toutefois,<br />
<strong>le</strong>s garçons sont éga<strong>le</strong>ment favorisés<br />
dans la distribution alimentaire, notamment<br />
durant la saison maigre.<br />
D’autres aspects comme <strong>par</strong> exemp<strong>le</strong><br />
<strong>le</strong>s soins infanti<strong>le</strong>s ainsi que l’accès à<br />
l’eau <strong>et</strong> à un assainissement de qualité<br />
constituent éga<strong>le</strong>ment <strong>des</strong> éléments clés.<br />
L’une <strong>des</strong> questions essentiel<strong>le</strong>s reste <strong>le</strong><br />
temps. Dans de nombreuses régions du<br />
monde, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong>s fil<strong>le</strong>s consacrent<br />
un temps quotidien considérab<strong>le</strong> au<br />
ramassage du bois <strong>et</strong> au puisage de l’eau<br />
ainsi qu’à la pré<strong>par</strong>ation <strong>des</strong> aliments. Les<br />
soins ont une incidence sur la sécurité<br />
nutritionnel<strong>le</strong> à deux égards : tout d’abord<br />
<strong>par</strong> <strong>le</strong> biais de pratiques alimentaires,<br />
notamment l’allaitement maternel <strong>et</strong> la<br />
pré<strong>par</strong>ation d’aliments nutritifs pour <strong>le</strong>s<br />
enfants sevrés <strong>et</strong> <strong>le</strong>s autres membres du<br />
ménage, <strong>et</strong> ensuite grâce à <strong>des</strong> pratiques<br />
d’hygiène <strong>et</strong> de santé tel<strong>le</strong>s que <strong>le</strong> bain<br />
19
1. INTRODUCTION GLOBALE<br />
<strong>des</strong> enfants <strong>et</strong> <strong>le</strong> lavage <strong>des</strong> mains avant<br />
la pré<strong>par</strong>ation d’aliments <strong>et</strong> <strong>le</strong>s repas.<br />
Il est à noter aussi que <strong>le</strong> rythme rapide de<br />
l’urbanisation dans de nombreux pays <strong>et</strong><br />
la <strong>par</strong>ticipation accrue de la main-d’œuvre<br />
féminine entraînent une surcharge <strong>des</strong><br />
tâches révolues aux <strong>femmes</strong>.<br />
• Les contraintes pour Les<br />
fEmmES<br />
Toute activité économique nécessite <strong>des</strong><br />
moyens de production. Pour l’agriculture<br />
<strong>et</strong> l’é<strong>le</strong>vage, l’accès à la terre <strong>et</strong> à l’eau<br />
est indispensab<strong>le</strong>. Ensuite, il faut <strong>des</strong><br />
semences, <strong>des</strong> engrais, <strong>des</strong> insectici<strong>des</strong> ou<br />
<strong>des</strong> produits vétérinaires pour soutenir ou<br />
pour augmenter la productivité. Les accès<br />
à l’information <strong>et</strong> à la technologie sont<br />
éga<strong>le</strong>ment <strong>des</strong> facteurs qui soutiennent<br />
<strong>le</strong> développement <strong>des</strong> activités agrico<strong>le</strong>s<br />
<strong>et</strong> d’é<strong>le</strong>vage. Et un facteur souvent oublié<br />
mais déterminant - surtout pour <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
déjà surchargées - est <strong>le</strong> facteur «temps».<br />
- ACCèS ET CONTRôLE DE LA TERRE<br />
ET DE L’EAU<br />
«En Afrique, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> triment toute <strong>le</strong>ur<br />
vie sur une terre qu’el<strong>le</strong>s ne possèdent pas,<br />
pour produire ce qu’el<strong>le</strong>s ne contrô<strong>le</strong>nt<br />
pas, <strong>et</strong> si <strong>le</strong>ur mariage finit <strong>par</strong> un divorce<br />
où la mort de <strong>le</strong>ur mari, el<strong>le</strong>s peuvent être<br />
renvoyées, <strong>le</strong>s mains vi<strong>des</strong>.»<br />
Mzee Mwalimu Julius Nyerere 5<br />
La possibilité d’accès à la terre, <strong>et</strong> <strong>le</strong><br />
contrô<strong>le</strong> de cel<strong>le</strong>-ci, préoccupent tant <strong>le</strong>s<br />
agricultrices que <strong>le</strong>s agriculteurs, bien<br />
que <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> soient <strong>par</strong>ticulièrement<br />
défavorisées. Même si el<strong>le</strong>s jouent un rô<strong>le</strong><br />
crucial dans <strong>le</strong>s économies rura<strong>le</strong>s <strong>des</strong><br />
pays en développement, <strong>par</strong>ticulièrement<br />
dans l’agriculture de subsistance, souvent,<br />
el<strong>le</strong>s ne possèdent pas la terre, moyen de<br />
production numéro un s’agissant de la<br />
production de la nourriture. De plus, si<br />
<strong>le</strong>s droits fonciers ne sont pas garantis,<br />
<strong>le</strong>s accès aux crédits, aux organisations<br />
rura<strong>le</strong>s <strong>et</strong> aux autres intrants <strong>et</strong> services<br />
agrico<strong>le</strong>s risquent d’être compromis. Et <strong>le</strong>s<br />
exploitants sont moins enclins à garantir la<br />
qualité du sol <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>ressources</strong>.<br />
Les programmes de réforme agraire<br />
conjugués au morcel<strong>le</strong>ment <strong>des</strong> terres<br />
communa<strong>le</strong>s ont déterminé <strong>le</strong> transfert<br />
<strong>des</strong> droits fonciers aux seuls hommes en<br />
tant que chefs de famil<strong>le</strong>, ignorant ainsi<br />
à la fois l’existence de ménages dirigés<br />
<strong>par</strong> une femme <strong>et</strong> <strong>le</strong>s droits <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
mariées à la copropriété. Par ail<strong>le</strong>urs, <strong>le</strong><br />
nombre de ménages ayant une femme à<br />
<strong>le</strong>ur tête est croissant. La première cause<br />
de ce phénomène est l’exode masculin <strong>des</strong><br />
zones rura<strong>le</strong>s vers <strong>le</strong>s vil<strong>le</strong>s ou à l’étranger<br />
<strong>et</strong>/ou l’abandon <strong>par</strong> <strong>le</strong>s hommes <strong>des</strong><br />
activités agrico<strong>le</strong>s au profit d’activités plus<br />
lucratives.<br />
La plu<strong>par</strong>t <strong>des</strong> surfaces cultivab<strong>le</strong>s sont<br />
donc la propriété <strong>des</strong> hommes. Dans de<br />
nombreux pays, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> ne possèdent<br />
qu’un très faib<strong>le</strong> pourcentage <strong>des</strong> terres<br />
arab<strong>le</strong>s. A titre d’exemp<strong>le</strong>, au Cameroun,<br />
el<strong>le</strong>s sont en charge de plus de 75% de<br />
tout <strong>le</strong> travail agrico<strong>le</strong>, mais el<strong>le</strong>s ont<br />
moins de 10% <strong>des</strong> titres fonciers. Les<br />
droits fonciers sont souvent détenus <strong>par</strong><br />
<strong>des</strong> hommes ou <strong>des</strong> groupes de <strong>par</strong>enté<br />
contrôlés <strong>par</strong> <strong>des</strong> hommes, <strong>et</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
n’ont généra<strong>le</strong>ment accès à la terre que<br />
<strong>par</strong> l’intermédiaire d’un <strong>par</strong>ent de sexe<br />
masculin, habituel<strong>le</strong>ment un père ou un<br />
mari. C<strong>et</strong> accès restreint est, en outre,<br />
très précaire (Eliane Najros, 2009).<br />
5<br />
Mzee Mwalimu Julius Nyerere, Premier Président de la République unie de Tanzanie (voir Bull<strong>et</strong>in Dimitra N° 8,<br />
octobre 2003).<br />
20
Les lois régissant <strong>le</strong>s droits de propriété<br />
foncière pour <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> varient sensib<strong>le</strong>ment<br />
selon <strong>le</strong>s régions. Lorsque <strong>le</strong> droit civil accorde<br />
aux <strong>femmes</strong> <strong>le</strong> droit d’héritage foncier, <strong>le</strong>s<br />
coutumes loca<strong>le</strong>s l’interdisent en eff<strong>et</strong> bien<br />
souvent <strong>et</strong> <strong>le</strong> droit statutaire va l’encontre<br />
du droit coutumier (Dimitra, juill<strong>et</strong> 2008).<br />
En Afrique subsaharienne, où la production<br />
alimentaire incombe principa<strong>le</strong>ment aux<br />
<strong>femmes</strong>, <strong>le</strong>urs droits se restreignent<br />
souvent aux droits d’utilisation (ou usufruit)<br />
<strong>et</strong> uniquement avec <strong>le</strong> consentement<br />
d’un <strong>par</strong>ent masculin. C<strong>et</strong>te déficience de<br />
contrô<strong>le</strong> <strong>et</strong> de droit de propriété <strong>des</strong> terres<br />
<strong>par</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> fait qu’el<strong>le</strong>s se r<strong>et</strong>rouvent<br />
souvent avec <strong>des</strong> lopins de terre de tail<strong>le</strong><br />
restreinte <strong>et</strong> aux sols <strong>le</strong>s plus pauvres. Ce<br />
manque de contrô<strong>le</strong> <strong>des</strong> terres a éga<strong>le</strong>ment<br />
pour conséquence que <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> ne sont<br />
pas encouragées à investir dans la mise<br />
en va<strong>le</strong>ur <strong>des</strong> sols en termes de fertilité<br />
ou de plantation <strong>des</strong> arbres. Dans <strong>le</strong> cadre<br />
<strong>des</strong> programmes de réforme foncière, <strong>le</strong><br />
constat est que, souvent, <strong>le</strong>s chefs de<br />
famil<strong>le</strong> masculins reçoivent <strong>des</strong> superficies<br />
beaucoup plus importantes que <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
chefs de famil<strong>le</strong>. Pour ce qui concerne <strong>des</strong><br />
proj<strong>et</strong>s de revalorisation <strong>des</strong> terrains <strong>et</strong><br />
d’irrigation, comme <strong>le</strong>s titres officiels de<br />
propriété sont remis exclusivement aux<br />
hommes, la possibilité pour <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> de<br />
contrô<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s terres se réduit. Quant aux<br />
systèmes publics d’irrigation <strong>le</strong>s hommes en<br />
ont <strong>le</strong> plus souvent <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> : <strong>le</strong>s décisions<br />
concernant l’utilisation de l’eau d’irrigation<br />
sont donc prises sans tenir compte <strong>des</strong><br />
besoins <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> pour <strong>le</strong>ur propre<br />
production (FAO-focus consulté en 2009).<br />
On constate, <strong>par</strong>ticulièrement en Afrique<br />
austra<strong>le</strong> <strong>et</strong> de l’est, que <strong>le</strong> VIH-SIDA a encore<br />
fragilisé la situation <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />
orphelins qui, sauf cas de testament écrit<br />
encore très rares, verront <strong>le</strong>urs terres prises<br />
<strong>par</strong> <strong>le</strong>s <strong>par</strong>ents de <strong>le</strong>ur défunt mari. Les enfants<br />
se r<strong>et</strong>rouvent à la rue avec <strong>le</strong>ur mère ou livrés<br />
à eux-mêmes si <strong>le</strong>urs deux <strong>par</strong>ents meurent,<br />
en dépit de la loi qui protège <strong>le</strong>ur patrimoine.<br />
Au Kenya, <strong>des</strong> comités de surveillance<br />
(«Watchdog Committees» Bull<strong>et</strong>in Dimitra<br />
N° 13, septembre 2007) se sont mis en<br />
place dans <strong>le</strong>s quartiers pour faire respecter<br />
<strong>le</strong>s droits <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> enfants, <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />
services juridiques sont mis à <strong>le</strong>ur disposition<br />
pour faire valoir ces droits. Cependant, <strong>le</strong>s<br />
procédures sont longues <strong>et</strong> pesantes.<br />
- ACCèS ET CONTRôLE DES REvENUS<br />
ET DES mOyENS fINANCIERS<br />
Les activités développées <strong>par</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> <strong>et</strong><br />
<strong>le</strong>s hommes ne se limitent pas à l’agriculture<br />
de subsistance, el<strong>le</strong>s se combinent souvent<br />
avec d’autres activités <strong>des</strong>tinées à procurer<br />
<strong>des</strong> revenus complémentaires. Les activités<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> se développent à <strong>par</strong>tir de la<br />
production agrico<strong>le</strong>, en transformant <strong>le</strong>s<br />
produits agrico<strong>le</strong>s issus de la cueill<strong>et</strong>te (hui<strong>le</strong><br />
de palme, farines,…), de la pêche <strong>et</strong> de<br />
l’é<strong>le</strong>vage. Le secteur de la pêche, <strong>par</strong> exemp<strong>le</strong>,<br />
est assez significatif quant à la manière dont<br />
sont ré<strong>par</strong>tis <strong>le</strong>s rô<strong>le</strong>s entre <strong>le</strong>s hommes<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong>. Ce sont généra<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s<br />
hommes qui pêchent en mer, sur de gros<br />
bateaux. Les <strong>femmes</strong> ont <strong>le</strong> plus souvent<br />
un travail à terre, de transformation du<br />
poisson, de commercialisation ou encore<br />
d’artisanat (ré<strong>par</strong>ation <strong>des</strong> fil<strong>et</strong>s, fabrication<br />
d’obj<strong>et</strong>s à <strong>par</strong>tir <strong>des</strong> déch<strong>et</strong>s de poisson,<br />
<strong>et</strong>c.). Dans bien <strong>des</strong> cas, on remarque que<br />
ce sont aussi <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> qui développent<br />
<strong>le</strong>s proj<strong>et</strong>s d’é<strong>le</strong>vage de poisson dans <strong>le</strong>s<br />
eaux continenta<strong>le</strong>s. La pêche est encore<br />
aujourd’hui un secteur qui perm<strong>et</strong> à 120<br />
millions de personnes dans <strong>le</strong> monde de vivre<br />
<strong>et</strong> de se nourrir (FAO, 6 consulté en 2007).<br />
6<br />
http://www.fao.org/gender/fr/nutr-f/NU2doc-f.asp<br />
21
1. INTRODUCTION GLOBALE<br />
Souvent, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> combinent <strong>le</strong>urs activités<br />
agrico<strong>le</strong>s à d’autres activités comme la<br />
couture, l’artisanat, la production du savon,<br />
la coiffure, <strong>et</strong>c. C<strong>et</strong>te diversification répond<br />
à une logique de sécurisation <strong>des</strong> revenus<br />
<strong>et</strong> s’adapte généra<strong>le</strong>ment au temps morcelé<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong>. Parfois, c<strong>et</strong>te diversification<br />
peut être liée au développement d’une<br />
agriculture industriel<strong>le</strong> d’exportation. Ainsi,<br />
dans plusieurs pays d’Amérique latine, la<br />
floriculture ou l’horticulture, orientées vers<br />
l’exportation <strong>et</strong> souvent <strong>des</strong>tructrices de<br />
l’environnement, se sont développées dans<br />
<strong>des</strong> zones précédemment <strong>des</strong>tinées principa<strong>le</strong>ment<br />
à la production vivrière.<br />
On ne peut s’empêcher d’analyser la<br />
manière dont <strong>le</strong>s revenus sont utilisés <strong>par</strong><br />
<strong>le</strong>s hommes <strong>et</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong>, notamment<br />
<strong>par</strong> rapport aux besoins de la famil<strong>le</strong>.<br />
Plusieurs étu<strong>des</strong> montrent que <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
investissent prioritairement <strong>le</strong>urs revenus<br />
dans l’achat d’aliments <strong>et</strong> d’instruments liés<br />
au ménage. L’eff<strong>et</strong> du revenu de la femme<br />
sur la santé <strong>et</strong> la sécurité alimentaire de la<br />
famil<strong>le</strong> est 4 à 8 fois plus grand que l’eff<strong>et</strong><br />
du revenu de l’homme. Pour la survie de<br />
l’enfant, il est presque 20 fois plus é<strong>le</strong>vé<br />
(Christiaensen L. <strong>et</strong> Tol<strong>le</strong>ns E., 1995). Ainsi<br />
à Bukavu, Birindwa B. <strong>et</strong> Katunga Musa<strong>le</strong><br />
D. (2007) ont étudié la manière dont <strong>le</strong>s<br />
hommes <strong>et</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> investissent l’argent<br />
<strong>des</strong> microcrédits dans <strong>le</strong>s besoins familiaux.<br />
Les <strong>femmes</strong> investissent 30,51% <strong>des</strong><br />
microcrédits reçus à l’achat de nourriture<br />
contre 23,33% pour <strong>le</strong>s hommes.<br />
Même si <strong>le</strong> crédit n’est pas la solution «mirac<strong>le</strong>»<br />
pour remédier aux problèmes d’insécurité<br />
alimentaire, son accès - à <strong>des</strong> moments<br />
bien précis – peut constituer un facteur<br />
déterminant. Prenons <strong>par</strong> exemp<strong>le</strong> la<br />
problématique de la vente de céréa<strong>le</strong>s au<br />
moment de la récolte à <strong>des</strong> prix très réduits<br />
à cause de l’afflux au marché. Souvent,<br />
<strong>le</strong>s paysans – hommes <strong>et</strong> <strong>femmes</strong> - n’ont<br />
pas <strong>le</strong> choix car ils ont besoin de l’argent.<br />
L’accès au crédit à ce moment perm<strong>et</strong>tra<br />
aux paysans de conserver <strong>le</strong>urs stocks afin<br />
d’en tirer <strong>des</strong> bénéfices plus importants<br />
ultérieurement grâce à un meil<strong>le</strong>ur prix<br />
de vente de <strong>le</strong>ur production agrico<strong>le</strong>.<br />
De façon généra<strong>le</strong>, l’accès au crédit est<br />
un problème pour tous <strong>le</strong>s paysans,<br />
étant donné que <strong>le</strong>s possibilités sont très<br />
limitées <strong>et</strong> <strong>le</strong>s taux d’intérêt très é<strong>le</strong>vés.<br />
Les <strong>femmes</strong> ont encore moins accès aux<br />
crédits que <strong>le</strong>s hommes. Pour <strong>le</strong>s pays<br />
où <strong>le</strong>s informations sont disponib<strong>le</strong>s,<br />
seuls 10% <strong>des</strong> crédits sont octroyés aux<br />
<strong>femmes</strong>, principa<strong>le</strong>ment du fait que la<br />
législation nationa<strong>le</strong> <strong>et</strong> la loi coutumière ne<br />
<strong>le</strong>ur perm<strong>et</strong>tent pas de <strong>par</strong>tager <strong>des</strong> droits<br />
de propriété foncière avec <strong>le</strong>urs maris,<br />
ou <strong>par</strong>ce que <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> chefs de famil<strong>le</strong><br />
sont exclues <strong>des</strong> systèmes de tenure <strong>et</strong> ne<br />
peuvent donc fournir <strong>le</strong>s garanties exigées<br />
<strong>par</strong> <strong>le</strong>s institutions de crédit.<br />
- ACCèS ET CONTRôLE DES<br />
intrants agricoLes –<br />
pRODUITS ET OUTILS<br />
L’accès <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> aux intrants techniques<br />
tels que <strong>le</strong>s semences améliorées, <strong>le</strong>s<br />
engrais <strong>et</strong> <strong>le</strong>s pestici<strong>des</strong> est limité car,<br />
dans bien <strong>des</strong> cas, el<strong>le</strong>s ne bénéficient<br />
pas <strong>des</strong> services de vulgarisation. Pour<br />
<strong>des</strong> raisons socioculturel<strong>le</strong>s, el<strong>le</strong>s sont<br />
moins engagées dans <strong>le</strong>s coopératives,<br />
<strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s distribuent souvent <strong>des</strong> intrants<br />
subventionnés. En outre, el<strong>le</strong>s n’ont<br />
pas <strong>le</strong>s moyens suffisants pour ach<strong>et</strong>er<br />
ces intrants même subventionnés. Au<br />
Bénin <strong>par</strong> exemp<strong>le</strong>, dans <strong>le</strong> cadre d’une<br />
recherche-action <strong>des</strong> ONG Vre<strong>des</strong>eilanden<br />
<strong>et</strong> ATOL sur <strong>le</strong> thème «Genre <strong>et</strong> gestion<br />
<strong>des</strong> connaissances» 7 , il a été constaté que<br />
7<br />
«Genre <strong>et</strong> Gestion <strong>des</strong> connaissances» L. Caubergs, R. Kestier, Programme DGCD 2003-2007<br />
22
<strong>le</strong>s problèmes de fertilisation du sol étaient<br />
plus préoccupants chez <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong>. Etant<br />
donné qu’el<strong>le</strong>s ne pouvaient pas se procurer<br />
<strong>des</strong> engrais promus <strong>par</strong> <strong>le</strong>s services de<br />
vulgarisation, un accent <strong>par</strong>ticulier a été<br />
mis sur <strong>le</strong> niébé, un fertilisant organique<br />
faci<strong>le</strong>ment accepté <strong>et</strong> pratiqué <strong>par</strong> tous <strong>et</strong><br />
en <strong>par</strong>ticulier <strong>par</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong>.<br />
Les agricultrices possédant d’ordinaire<br />
moins d’outils <strong>et</strong> d’intrants que <strong>le</strong>s hommes,<br />
<strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> obtiennent généra<strong>le</strong>ment <strong>des</strong><br />
rendements inférieurs à ceux <strong>des</strong> hommes.<br />
De plus, il a été démontré que <strong>le</strong>s ménages<br />
dirigés <strong>par</strong> une femme utilisent <strong>le</strong> moindre<br />
crédit disponib<strong>le</strong> pour se procurer de la<br />
main-d’œuvre ou <strong>des</strong> semences, ce qui est<br />
susceptib<strong>le</strong> d’accroître la production, mais pas<br />
nécessairement la productivité. Les hommes,<br />
en revanche, sont plus enclins à ach<strong>et</strong>er<br />
<strong>des</strong> engrais ou <strong>des</strong> produits agrochimiques,<br />
servant à accroître la productivité 8 .<br />
Lorsque de nouvel<strong>le</strong>s technologies sont<br />
introduites comme <strong>le</strong> matériel d’ensemencement,<br />
<strong>des</strong> transplanteurs ou <strong>des</strong> batteuses,<br />
<strong>le</strong>s eff<strong>et</strong>s sur la situation <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> varient.<br />
Les <strong>femmes</strong> qui cultivent <strong>le</strong>urs propres<br />
<strong>par</strong>cel<strong>le</strong>s <strong>et</strong> qui ont la possibilité de se<br />
procurer de nouvel<strong>le</strong>s technologies voient<br />
<strong>le</strong>ur travail allégé <strong>et</strong> <strong>le</strong>ur productivité augmentée.<br />
En revanche, pour <strong>le</strong>s ouvrières<br />
agrico<strong>le</strong>s, l’adoption de ces machines pourrait<br />
entraîner <strong>des</strong> pertes de revenus <strong>et</strong> d’emploi<br />
(FAO-focus, consulté en 2009).<br />
- ACCèS AUx INfORmATIONS ET<br />
AUx INNOvATIONS<br />
L’accès <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> aux informations se<br />
restreint du fait de <strong>le</strong>ur accès limité aux<br />
services d’éducation, de formation <strong>et</strong> de<br />
vulgarisation. Les deux tiers du milliard<br />
d’analphabètes dans <strong>le</strong> monde sont <strong>des</strong><br />
<strong>femmes</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> fil<strong>le</strong>s. C<strong>et</strong>te réalité a non<br />
seu<strong>le</strong>ment de graves incidences sur la productivité<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong>s revenus agrico<strong>le</strong>s mais aussi<br />
sur l’état nutritionnel <strong>des</strong> enfants <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />
adultes. Les agriculteurs plus instruits sont<br />
plus à même d’adopter de nouvel<strong>le</strong>s<br />
métho<strong>des</strong> <strong>et</strong> technologies <strong>et</strong> d’avoir accès<br />
aux services de vulgarisation agrico<strong>le</strong>s <strong>et</strong><br />
d’é<strong>le</strong>vage. Les chiffres disponib<strong>le</strong>s montrent<br />
que seuls 5% <strong>des</strong> services de vulgarisation<br />
visent <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> rura<strong>le</strong>s <strong>et</strong> seu<strong>le</strong>ment<br />
15% <strong>des</strong> vulgarisateurs sont du sexe féminin.<br />
C<strong>et</strong>te réalité a surtout un impact dans<br />
<strong>le</strong>s pays où la culture n’est pas favorab<strong>le</strong><br />
aux contacts entre <strong>le</strong>s agents de vulgarisation<br />
masculins <strong>et</strong> <strong>le</strong>s agricultrices. En<br />
outre, la plu<strong>par</strong>t <strong>des</strong> services de vulgarisation<br />
concernent davantage la production de<br />
cultures de rente au détriment <strong>des</strong> cultures<br />
vivrières <strong>et</strong> de subsistance, qui sont cependant<br />
<strong>le</strong> principal souci <strong>des</strong> agricultrices <strong>et</strong> la<br />
clé de la sécurité alimentaire. Par ail<strong>le</strong>urs,<br />
<strong>le</strong>s tâches multip<strong>le</strong>s <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> entravent<br />
<strong>par</strong>fois <strong>le</strong>ur mobilité <strong>et</strong> <strong>par</strong> conséquent, <strong>le</strong>ur<br />
<strong>par</strong>ticipation aux réunions <strong>et</strong> aux formations<br />
organisées loin de chez el<strong>le</strong>s. Un autre obstac<strong>le</strong><br />
est <strong>le</strong> fait que, la plu<strong>par</strong>t du temps, <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> ne maîtrisent pas la langue utilisée<br />
lors <strong>des</strong> formations. De plus, <strong>le</strong>s informations<br />
sont fournies à 80% <strong>par</strong> <strong>des</strong> experts<br />
contre 20% <strong>par</strong> <strong>le</strong>s paysannes/paysans<br />
ayant une expertise de terrain.<br />
Les <strong>femmes</strong> n’ont guère accès aux<br />
avantages de la recherche <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />
innovations, notamment dans <strong>le</strong> domaine<br />
<strong>des</strong> cultures vivrières, qui, malgré <strong>le</strong>ur<br />
importance dans la sécurité alimentaire<br />
familia<strong>le</strong> <strong>et</strong> communautaire, ne jouissent<br />
que d’une faib<strong>le</strong> priorité dans la recherche<br />
sur l’amélioration <strong>des</strong> cultures. Les<br />
technologies d’allègement de tâches<br />
prennent généra<strong>le</strong>ment peu en compte<br />
<strong>le</strong>s rô<strong>le</strong>s <strong>et</strong> <strong>le</strong>s besoins <strong>des</strong> agricultrices<br />
(FAO-focus, consulté en 2009).<br />
8<br />
www.fao.org/news/story/fr/item/41208/icode/<br />
23
1. INTRODUCTION GLOBALE<br />
Les recherches agrico<strong>le</strong>s peuvent même avoir<br />
<strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s négatifs. Si <strong>le</strong> désherbage <strong>et</strong> la<br />
récolte <strong>des</strong> cultures sont considérés comme<br />
<strong>des</strong> «tâches féminines», un programme<br />
visant à accroître la production de cultures<br />
de rente peut alourdir <strong>le</strong> fardeau <strong>des</strong><br />
<strong>femmes</strong> <strong>et</strong> ne pas <strong>le</strong>ur fournir d’avantages.<br />
Effectivement, financièrement el<strong>le</strong>s n’en<br />
profitent pas <strong>par</strong>ce que souvent, <strong>le</strong>s cultures<br />
de rente ap<strong>par</strong>tiennent aux hommes.<br />
- ACCèS ET CONTRôLE DU TEmpS ET<br />
DE LA mAIN D’œUvRE<br />
Suite à la combinaison <strong>des</strong> rô<strong>le</strong>s de<br />
reproduction (tâches ménagères), de<br />
production <strong>et</strong> communautaires, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
– de façon presque généralisée – ont<br />
relativement moins de temps que <strong>le</strong>s hommes.<br />
Le <strong>par</strong>tage inégal <strong>des</strong> responsabilités entre<br />
<strong>le</strong>s hommes/garçons <strong>et</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong>/fil<strong>le</strong>s<br />
d’une <strong>par</strong>t <strong>et</strong> <strong>le</strong>s difficultés d’avoir accès aux<br />
techniques <strong>et</strong> équipements d’allègement du<br />
travail d’autre <strong>par</strong>t, en sont <strong>le</strong>s principa<strong>le</strong>s<br />
raisons. Il faut noter éga<strong>le</strong>ment que, dans<br />
de nombreux cas, <strong>le</strong>s ménages comptent<br />
un nombre d’enfants é<strong>le</strong>vé en raison <strong>des</strong><br />
difficultés d’accès à la contraception, ou de<br />
la pauvr<strong>et</strong>é. Dans certains endroits, <strong>le</strong> temps<br />
consacré aux occupations quotidiennes<br />
comme la recherche du bois <strong>et</strong> de l’eau<br />
reste considérab<strong>le</strong>. Les phénomènes du<br />
déboisement, de la désertification - <strong>et</strong> à plus<br />
long terme du réchauffement climatique -<br />
aggravent la situation.<br />
Dans <strong>le</strong>s pays où <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> <strong>par</strong>ticipent<br />
aux activités agrico<strong>le</strong>s - semis, sarclage,<br />
récolte -, <strong>le</strong>s saisons d’hivernage sont<br />
<strong>des</strong> pério<strong>des</strong> durant <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> sont réel<strong>le</strong>ment surchargées. Les<br />
responsabilités de <strong>le</strong>urs champs familiaux<br />
combinées avec cel<strong>le</strong>s de <strong>le</strong>urs propres<br />
champs <strong>le</strong>s privent de temps suffisant<br />
pour <strong>le</strong>s cultures vivrières. Le manque de<br />
moyens pour payer de la main d’œuvre<br />
sur <strong>le</strong>urs propres <strong>par</strong>cel<strong>le</strong>s entraîne <strong>des</strong><br />
rendements inférieurs aux potentialités.<br />
Dans <strong>le</strong>s pério<strong>des</strong> de difficultés économiques,<br />
<strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> endossent souvent la charge<br />
de l’ajustement comme, <strong>par</strong> exemp<strong>le</strong>,<br />
<strong>le</strong>s soins <strong>des</strong> mala<strong>des</strong>. El<strong>le</strong>s absorbent <strong>le</strong>s<br />
chocs subis <strong>par</strong> <strong>le</strong> niveau de vie du ménage<br />
en allongeant <strong>le</strong>ur journée de travail, déjà<br />
très longue, souvent au détriment de <strong>le</strong>ur<br />
propre santé <strong>et</strong> de <strong>le</strong>ur nutrition (Dimitra,<br />
septembre 2008).<br />
Les problèmes auxquels se heurtent <strong>le</strong>s<br />
ménages ruraux ayant pour chef une<br />
femme varient selon <strong>le</strong>ur niveau d’accès<br />
aux <strong>ressources</strong> productives. Selon la FAO,<br />
l’absence de main-d’œuvre masculine<br />
se traduit d’une <strong>par</strong>t <strong>par</strong> la baisse <strong>des</strong><br />
rendements <strong>et</strong> de la production ou la<br />
tendance à adopter <strong>des</strong> cultures moins<br />
nourrissantes mais moins exigeantes en<br />
main-d’œuvre. D’autre <strong>par</strong>t, on constate<br />
l’accroissement de la main-d’œuvre infanti<strong>le</strong><br />
laquel<strong>le</strong> a, à son tour, <strong>des</strong> répercussions<br />
sur la famil<strong>le</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong> capital humain du pays.<br />
Dans ces cas, l’accès <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> à <strong>des</strong><br />
techniques nécessitant moins de maind’œuvre<br />
revêt une importance capita<strong>le</strong><br />
(FAO-focus, consulté en 2009).<br />
Aussi, dans <strong>le</strong>s régions d’insécurité politique<br />
<strong>et</strong> de guerre, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> n’ont pas toujours<br />
la possibilité de rejoindre <strong>le</strong>urs champs<br />
à cause <strong>des</strong> militaires ou <strong>des</strong> milices<br />
qui rendent l’environnement insécurisé.<br />
Au Kivu (RDC) <strong>par</strong> exemp<strong>le</strong>, <strong>des</strong> milliers de<br />
<strong>femmes</strong> sont terrorisées <strong>par</strong> <strong>le</strong>s militaires<br />
<strong>et</strong> sont attaquées <strong>et</strong> violées en allant ou en<br />
revenant de <strong>le</strong>urs champs. Aux souffrances<br />
physiques <strong>et</strong> psychologiques <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
s’ajoute l’insécurité alimentaire <strong>des</strong> ménages<br />
(cel<strong>le</strong> <strong>des</strong> enfants en <strong>par</strong>ticulier).<br />
24
- ACCèS ET CONTRôLE DE LA pRISE<br />
de décision<br />
Traditionnel<strong>le</strong>ment, dans la plu<strong>par</strong>t <strong>des</strong><br />
cultures, <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> est limité<br />
dans <strong>le</strong>s processus de prise de décision<br />
au niveau du ménage, du village <strong>et</strong> du<br />
pays. Par conséquent, <strong>le</strong>urs besoins, <strong>le</strong>urs<br />
intérêts <strong>et</strong> <strong>le</strong>urs problèmes sont rarement<br />
pris en compte dans l’élaboration <strong>des</strong><br />
politiques <strong>et</strong> <strong>des</strong> lois. Cel<strong>le</strong>s-ci jouent<br />
cependant un rô<strong>le</strong> important dans<br />
l’élimination de la pauvr<strong>et</strong>é, la sécurité<br />
alimentaire <strong>et</strong> la durabilité écologique.<br />
Seul un nombre restreint de <strong>femmes</strong><br />
accède à <strong>des</strong> postes supérieurs dans <strong>le</strong>s<br />
institutions publiques <strong>et</strong> indépendantes<br />
de recherche <strong>et</strong> de formation, <strong>le</strong>s<br />
ministères responsab<strong>le</strong>s de l’agriculture<br />
<strong>et</strong> de l’environnement, ainsi que <strong>le</strong>s<br />
organisations non gouvernementa<strong>le</strong>s<br />
chargées de l’environnement <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />
programmes agrico<strong>le</strong>s. Les causes de<br />
l’exclusion <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> <strong>des</strong> processus de<br />
prise de décision sont étroitement liées aux<br />
perceptions <strong>des</strong> rô<strong>le</strong>s <strong>et</strong> responsabilités<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> <strong>par</strong> <strong>le</strong>s hommes <strong>et</strong> <strong>par</strong> <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong>, à <strong>le</strong>ur niveau d’instruction, à <strong>le</strong>ur<br />
trip<strong>le</strong> rô<strong>le</strong> de production, reproduction <strong>et</strong><br />
communautaires qui absorbent une <strong>par</strong>tie<br />
importante de <strong>le</strong>ur temps (IFPRI, 1995).<br />
Encore trop peu de <strong>femmes</strong> ont pu se<br />
positionner en tant que <strong>le</strong>ader au niveau<br />
<strong>des</strong> communautés <strong>et</strong> au niveau politique<br />
local. Leur faib<strong>le</strong> représentation au sein de<br />
la classe politique limite <strong>le</strong>ur <strong>par</strong>ticipation<br />
au développement économique local <strong>et</strong><br />
plus précisément à l’élaboration <strong>des</strong> plans<br />
de développement local. Cependant, c’est à<br />
ce niveau que <strong>le</strong>s stratégies décentralisées<br />
du renforcement <strong>des</strong> producteurs/trices<br />
sont élaborées <strong>et</strong> que l’allocation <strong>des</strong><br />
moyens se décide.<br />
• d es stratégies pour une<br />
sécurité aLimentaire<br />
- d es stratégies au moment <strong>des</strong><br />
CRISES ALImENTAIRES<br />
La vulnérabilité de la population d’une<br />
région soumise à <strong>des</strong> crises dépend à<br />
la fois <strong>des</strong> mesures qui peuvent être<br />
mises en œuvre dans un contexte donné<br />
<strong>et</strong> de la capacité <strong>des</strong> famil<strong>le</strong>s, <strong>et</strong> plus<br />
<strong>par</strong>ticulièrement <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>, à répondre<br />
à ces événements. La vulnérabilité d’une<br />
population peut être estimée <strong>par</strong> l’analyse<br />
<strong>des</strong> mécanismes d’adaptation <strong>et</strong> de<br />
réaction mis en œuvre en réponse à une<br />
situation diffici<strong>le</strong>. Lorsque <strong>le</strong>s mécanismes<br />
ne sont pas efficaces, <strong>le</strong> foyer entre dans<br />
une situation de vulnérabilité chronique.<br />
La notion de risques <strong>et</strong> de mécanismes<br />
d’adaptation est au centre de la sécurité<br />
alimentaire. Le niveau de risque pour un<br />
foyer ou une communauté est fonction <strong>des</strong><br />
mo<strong>des</strong> d’accès aux <strong>ressources</strong> alimentaires<br />
<strong>et</strong> du capital disponib<strong>le</strong>. Pour minimiser<br />
<strong>le</strong>s risques, <strong>le</strong>s populations adoptent <strong>des</strong><br />
mécanismes d’adaptation ou de réaction à<br />
trois niveaux:<br />
• la production (diversification, échelonnement,<br />
stockage) pour <strong>le</strong>s ruraux,<br />
la modification de la structure de la<br />
ration alimentaire pour <strong>le</strong>s urbains<br />
(achats de produits peu chers);<br />
• <strong>le</strong>s activités économiques: augmentation<br />
<strong>des</strong> revenus <strong>par</strong> <strong>le</strong> recours<br />
à <strong>des</strong> activités du secteur formel <strong>et</strong><br />
surtout informel, investissement dans<br />
<strong>des</strong> va<strong>le</strong>urs non-productives (bijoux,<br />
vêtements, animaux, argent liquide),<br />
échange <strong>des</strong> produits de l’aide humanitaire<br />
contre <strong>des</strong> liquidités ou autres<br />
va<strong>le</strong>urs;<br />
25
1. INTRODUCTION GLOBALE<br />
• <strong>le</strong>s mécanismes sociaux: appel aux crédits<br />
en argent ou en nature, entraide<br />
<strong>et</strong> soutiens, enregistrement multip<strong>le</strong><br />
d’une famil<strong>le</strong> auprès <strong>des</strong> organisations<br />
humanitaires.<br />
Lorsque ces mécanismes d’adaptation<br />
sont insuffisants <strong>et</strong> menacent la sécurité<br />
alimentaire du foyer, <strong>des</strong> activités vont se<br />
déployer en réponse à la situation défavorab<strong>le</strong>,<br />
en trois étapes:<br />
• stratégie de risques minimisés: activités<br />
informel<strong>le</strong>s <strong>des</strong> enfants, modification <strong>des</strong><br />
habitu<strong>des</strong> alimentaires (jardins urbains,<br />
réduction <strong>des</strong> rations alimentaires, réduction<br />
du groupe de commensalité,<br />
repas hors foyer moins coûteux), demande<br />
d’appuis en argent ou en nature<br />
(famil<strong>le</strong>, relations, communauté), vente<br />
<strong>des</strong> va<strong>le</strong>urs non productives (bijoux,<br />
ustensi<strong>le</strong>s,); vente de main d’œuvre; la<br />
vente <strong>des</strong> produits en <strong>des</strong>sous du prix<br />
du marché afin d‘obtenir rapidement<br />
<strong>des</strong> liquidités; de p<strong>et</strong>ites AGR (Activités<br />
Génératrices de Revenus) temporaires<br />
comme la col<strong>le</strong>cte <strong>et</strong> <strong>le</strong> vente du bois;<br />
• vente <strong>des</strong> va<strong>le</strong>urs productives du capital:<br />
outils, animaux ou terre pour<br />
<strong>le</strong>s ruraux, ventes <strong>des</strong> réserves <strong>et</strong><br />
location ou vente de maison pour <strong>le</strong>s<br />
urbains;<br />
• migration temporaire de certains<br />
membres de la famil<strong>le</strong>, puis migration<br />
permanente du foyer» (FAO, 1995).<br />
Les <strong>femmes</strong> combinent <strong>des</strong> logiques<br />
économiques <strong>et</strong> socia<strong>le</strong>s. Ainsi <strong>par</strong> exemp<strong>le</strong>,<br />
en Bolivie, el<strong>le</strong>s vendent prioritairement<br />
<strong>le</strong>urs produits agrico<strong>le</strong>s à <strong>des</strong> organisations<br />
de commerce équitab<strong>le</strong> à un prix supérieur<br />
à celui du marché (Charlier S., Yépez I.,<br />
Andia E., 2000). Pourtant, el<strong>le</strong>s continuent<br />
à vendre une <strong>par</strong>tie de <strong>le</strong>urs produits aux<br />
commerçants, même si d’autres voies<br />
<strong>le</strong>ur offrent un prix plus avantageux. El<strong>le</strong>s<br />
combinent ainsi une logique de réseau,<br />
«de sécurité socia<strong>le</strong>» <strong>et</strong> une logique<br />
économique. C<strong>et</strong>te réalité se r<strong>et</strong>rouve<br />
chez <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> africaines. «Saisies <strong>par</strong><br />
l’urgence du quotidien <strong>et</strong> inscrites dans la<br />
logique de survie, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> privilégient<br />
quant à el<strong>le</strong>s une articulation entre logique<br />
économique <strong>et</strong> logique socia<strong>le</strong>. C’est-àdire<br />
la réalisation de profits économiques<br />
autant que de profits sociaux, politiques<br />
<strong>et</strong> même symboliques» (Ryckmans H.,<br />
1998 :189).<br />
Les <strong>femmes</strong> sont aussi <strong>le</strong>s premières<br />
à développer <strong>des</strong> stratégies pour faire<br />
face à l’insécurité alimentaire, <strong>par</strong>fois<br />
au détriment de <strong>le</strong>ur propre santé, <strong>par</strong><br />
exemp<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> cas de la réduction <strong>des</strong><br />
rations alimentaires. Dans <strong>le</strong>s pério<strong>des</strong><br />
diffici<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> limitent <strong>le</strong> nombre de<br />
repas chaud à un <strong>par</strong> jour afin de réduire<br />
l’utilisation du bois <strong>et</strong> d’avoir plus de<br />
temps pour <strong>le</strong>s p<strong>et</strong>ites AGR. Afin de faire<br />
face aux gran<strong>des</strong> crises alimentaires ou<br />
aux problèmes de vulnérabilité chronique,<br />
la migration <strong>des</strong> hommes <strong>et</strong> <strong>par</strong>fois <strong>des</strong><br />
<strong>femmes</strong> se généralise. Les programmes<br />
«Food for Work» sont <strong>des</strong> stratégies mises<br />
en œuvre <strong>par</strong> l’Etat <strong>et</strong>/ou <strong>le</strong>s ONG pour<br />
r<strong>et</strong>enir <strong>le</strong>s populations sur place.<br />
Dans <strong>le</strong>s régions touchées <strong>par</strong> l’insécurité<br />
alimentaire, hommes <strong>et</strong> <strong>femmes</strong> s’engagent<br />
de plus en plus souvent dans <strong>le</strong>s systèmes<br />
de banques céréalières afin de vendre une<br />
<strong>par</strong>tie de <strong>le</strong>ur récolte préservée au moment<br />
où <strong>le</strong>s prix <strong>des</strong> céréa<strong>le</strong>s sont avantageux.<br />
L’appui en crédit d’une IMF (Institution<br />
de Micro Finance) est nécessaire car au<br />
moment <strong>des</strong> récoltes, <strong>le</strong>s paysans ont<br />
besoin de l’argent pour subvenir aux frais<br />
quotidiens. «Garantir <strong>le</strong> prêt en m<strong>et</strong>tant <strong>le</strong><br />
26
stock dans <strong>le</strong> grenier fermé avec plusieurs<br />
clés est un type de crédit qui a fait ses<br />
preuves. Il porte même un nom savant :<br />
<strong>le</strong> warrantage !» (Oud<strong>et</strong>, 2008).<br />
En milieu urbain, c’est surtout autour d’une<br />
pluralité d’activités d’économie solidaire<br />
que <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> répondent au besoin de<br />
sécurité alimentaire de la famil<strong>le</strong>. Outre<br />
<strong>le</strong> développement <strong>des</strong> AGR, el<strong>le</strong>s réalisent<br />
de p<strong>et</strong>its potagers urbains (dans <strong>des</strong><br />
espaces réduits <strong>et</strong> <strong>par</strong>fois même dans <strong>des</strong><br />
bacs autour de chez el<strong>le</strong>s). Les produits<br />
de ces activités servent généra<strong>le</strong>ment à<br />
la consommation domestique <strong>et</strong>, dans<br />
certains cas, si un surplus existe, il peut<br />
être commercialisé.<br />
- L’EmpOwERmENT DES fEmmES<br />
comme stratégie durabLe<br />
pour La sécurité aLimentaire<br />
Le concept de sécurité alimentaire<br />
a évolué au fil <strong>des</strong> années, grâce à<br />
l’attention de plus en plus grande aux<br />
dimensions socia<strong>le</strong>s, sexuel<strong>le</strong>s, écologiques,<br />
techniques <strong>et</strong> économiques du problème.<br />
La reconnaissance du rô<strong>le</strong> <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> a<br />
éga<strong>le</strong>ment évolué. Il a été mis en évidence<br />
que <strong>des</strong> mesures spécifiques s’imposent<br />
pour faire face aux contraintes auxquel<strong>le</strong>s<br />
el<strong>le</strong>s se heurtent aussi bien en vil<strong>le</strong> qu’en<br />
milieu rural <strong>et</strong> spécifiquement en tant que<br />
chefs de famil<strong>le</strong>.<br />
Le défi à re<strong>le</strong>ver à l’avenir consistera à<br />
poursuivre la démarche d’empowerment<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> - aussi bien au niveau<br />
individuel que col<strong>le</strong>ctif - prenant en<br />
compte <strong>le</strong>s quatre composantes : l’avoir<br />
(<strong>le</strong> pouvoir économique), <strong>le</strong> savoir (<strong>le</strong><br />
pouvoir <strong>des</strong> connaissances), <strong>le</strong> vouloir (<strong>le</strong><br />
pouvoir interne) <strong>et</strong> <strong>le</strong> pouvoir (<strong>le</strong> pouvoir<br />
social <strong>et</strong> politique) (Caubergs & Charlier,<br />
2007).<br />
Un plus grand «avoir» fait référence au<br />
renforcement de l’accès <strong>et</strong> du contrô<strong>le</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>ressources</strong> <strong>par</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> <strong>le</strong>ur perm<strong>et</strong>tant<br />
de produire <strong>des</strong> aliments, <strong>et</strong> dans <strong>le</strong>urs<br />
possibilités d’ach<strong>et</strong>er <strong>le</strong>s vivres qui n’ont pu<br />
être produits sur place. L’accès aux services<br />
de base (l’eau, la santé, l’éducation) sont<br />
éga<strong>le</strong>ment <strong>des</strong> facteurs déterminants du<br />
pouvoir économique. L’accès au marché<br />
constitue éga<strong>le</strong>ment un élément essentiel<br />
aussi bien pour la vente <strong>des</strong> produits<br />
agrico<strong>le</strong>s que pour l’achat <strong>des</strong> vivres.<br />
Le «savoir» comprend la valorisation <strong>des</strong><br />
connaissances <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> <strong>des</strong> systèmes<br />
agrico<strong>le</strong>s dont el<strong>le</strong>s ont la charge. Il<br />
s’agit éga<strong>le</strong>ment d’apprendre à lire, à<br />
écrire <strong>et</strong> à calcu<strong>le</strong>r, <strong>et</strong> à comprendre<br />
son environnement économique. Sont à<br />
considérer éga<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> développement<br />
de nouvel<strong>le</strong>s connaissances agrico<strong>le</strong>s<br />
dans <strong>le</strong> cadre <strong>des</strong> recherches-action <strong>et</strong> la<br />
<strong>par</strong>ticipation <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> aux processus<br />
d’innovation <strong>et</strong> de création en vue d’une<br />
meil<strong>le</strong>ure sécurité alimentaire.<br />
Le «vouloir» porte sur <strong>le</strong> pouvoir interne<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong>, la confiance en soi, l’image de<br />
soi ainsi que <strong>le</strong>s va<strong>le</strong>urs. La reconnaissance<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong> respect pour <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> en tant que<br />
coresponsab<strong>le</strong> avec <strong>le</strong>s hommes du bienêtre<br />
de la famil<strong>le</strong> a un lien direct avec <strong>le</strong>urs<br />
responsabilités pour nourrir <strong>et</strong> soigner <strong>le</strong>s<br />
enfants <strong>et</strong> tous <strong>le</strong>s membres de la famil<strong>le</strong>.<br />
Au niveau communautaire, il s’agit de<br />
<strong>le</strong>urs contributions au développement<br />
local <strong>et</strong> national <strong>par</strong> la «reproduction» <strong>des</strong><br />
personnes qui sont en bonne santé <strong>et</strong> en<br />
forme pour étudier <strong>et</strong>/ou travail<strong>le</strong>r.<br />
Le «pouvoir» englobe toutes <strong>le</strong>s mesures<br />
qui visent à assurer une meil<strong>le</strong>ure<br />
<strong>par</strong>ticipation <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> aux prises<br />
de décision au sein <strong>des</strong> ménages, dans<br />
<strong>le</strong>s organisations <strong>et</strong> col<strong>le</strong>ctivités, dans<br />
<strong>le</strong>s politiques loca<strong>le</strong>s <strong>et</strong> nationa<strong>le</strong>s. En<br />
27
1. INTRODUCTION GLOBALE<br />
lien avec la sécurité <strong>et</strong> la souverain<strong>et</strong>é<br />
alimentaire, il s’agit donc pour <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> de pouvoir utiliser <strong>le</strong>ur pouvoir<br />
économique, <strong>le</strong>ur pouvoir de connaissance<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong>ur pouvoir interne pour renforcer <strong>le</strong>s<br />
trois aspects de la sécurité alimentaire :<br />
une production appropriée <strong>et</strong> suffisante,<br />
un accès physique <strong>et</strong> économique <strong>et</strong><br />
une utilisation adaptée aux exigences<br />
nutritionnel<strong>le</strong>s.<br />
AVOIR<br />
• Garantir que <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> aient <strong>le</strong>s<br />
mêmes chances que <strong>le</strong>s hommes de<br />
posséder <strong>des</strong> terres<br />
• Encourager la production de cultures<br />
vivrières grâce à <strong>des</strong> mesures d’incitations<br />
• Promouvoir l’adoption d’intrants <strong>et</strong> de<br />
techniques appropriées pour accroître<br />
<strong>le</strong> temps que <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> peuvent<br />
consacrer à <strong>des</strong> activités rémunératrices;<br />
encourager <strong>le</strong> développement<br />
<strong>des</strong> techniques d’allègement <strong>des</strong><br />
tâches<br />
• Favoriser l’accès au crédit pour <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> afin de <strong>le</strong>ur perm<strong>et</strong>tre d’avoir<br />
<strong>des</strong> moyens de production, de stockage<br />
(warrantage), de transformation,<br />
d’allégement <strong>des</strong> tâches, de commercialisation<br />
• Favoriser l’accès aux marchés d’une<br />
<strong>par</strong>t pour vendre <strong>le</strong>s excès de <strong>le</strong>ur<br />
production agrico<strong>le</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> produits<br />
transformés; d’autre <strong>par</strong>t pour se<br />
procurer <strong>des</strong> vivres au besoin<br />
• Améliorer l’état nutritionnel <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
<strong>et</strong> <strong>des</strong> enfants à travers l’accès aux soins<br />
de santé <strong>et</strong> de nutrition<br />
• Fournir de meil<strong>le</strong>ures occasions<br />
d’emploi <strong>et</strong> de création de revenus.<br />
SAVOIR<br />
• Faciliter, pour <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong>, l’accès aux<br />
services agrico<strong>le</strong>s <strong>et</strong> aux services de<br />
santé (nutrition) <strong>et</strong> adapter ces services<br />
à <strong>le</strong>urs besoins<br />
• Encourager l’alphabétisation <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
à travers <strong>des</strong> programmes adaptés<br />
(alphabétisation fonctionnel<strong>le</strong>)<br />
• Elaborer <strong>des</strong> programmes d’alphabétisation<br />
économique perm<strong>et</strong>tant<br />
aux <strong>femmes</strong> de mieux comprendre<br />
<strong>le</strong>ur environnement économique : <strong>le</strong>s<br />
mécanismes de formation de prix <strong>des</strong><br />
aliments, <strong>le</strong>s mécanismes de marché,<br />
<strong>le</strong> rô<strong>le</strong> de l’importation <strong>et</strong> de l’exportation<br />
de produits alimentaires, <strong>et</strong>c.<br />
• Valoriser <strong>le</strong>s connaissances <strong>des</strong><br />
<strong>femmes</strong> à propos <strong>des</strong> cultures <strong>et</strong><br />
écosystèmes dont el<strong>le</strong>s ont la charge<br />
• Stimu<strong>le</strong>r la <strong>par</strong>ticipation <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
aux recherches, innovations <strong>et</strong> création<br />
de nouvel<strong>le</strong>s connaissances <strong>par</strong> rapport<br />
à la production <strong>et</strong> la transformation <strong>des</strong><br />
produits vivriers<br />
• Stimu<strong>le</strong>r la col<strong>le</strong>cte <strong>et</strong> l’analyse <strong>des</strong><br />
données <strong>par</strong> sexe, <strong>par</strong> rapport aux<br />
trois piliers de la sécurité alimentaire;<br />
rendre accessib<strong>le</strong> ces données ventilées<br />
<strong>par</strong> sexe aux techniciens, aux<br />
planificateurs <strong>et</strong> aux décideurs.<br />
VOULOIR<br />
• Rendre visib<strong>le</strong>s <strong>et</strong> valoriser <strong>le</strong>s rô<strong>le</strong>s<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> dans toutes <strong>le</strong>s instances:<br />
la famil<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s organisations paysannes,<br />
artisanes (comités de gestion, de<br />
commercialisation, <strong>et</strong>c.), tant dans <strong>le</strong>s<br />
politiques loca<strong>le</strong>s qu’internationa<strong>le</strong>s…<br />
• Garder une attention spécifique aux<br />
priorités <strong>et</strong> aux va<strong>le</strong>urs <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>:<br />
28
<strong>le</strong> bien-être <strong>des</strong> enfants <strong>et</strong> de la<br />
famil<strong>le</strong>…<br />
• Assurer un environnement de sécurité<br />
physique qui perm<strong>et</strong>te aux <strong>femmes</strong><br />
d’assurer <strong>le</strong>urs fonctions en tant que<br />
productrices, gestionnaires, transformatrices,<br />
commerçantes <strong>des</strong> aliments.<br />
POUVOIR<br />
• M<strong>et</strong>tre en place <strong>des</strong> modalités assurant<br />
une plus grande <strong>par</strong>ticipation <strong>des</strong><br />
<strong>femmes</strong> au sein <strong>des</strong> ménages quant<br />
aux investissements <strong>et</strong> aux dépenses<br />
• Promouvoir <strong>le</strong>s organisations de<br />
<strong>femmes</strong><br />
• Favoriser la mise en réseau, l’échange<br />
d’informations <strong>et</strong> la communication<br />
<strong>par</strong>ticipative. La mise en réseau <strong>et</strong><br />
l’échange d’expériences <strong>et</strong> d’informations<br />
perm<strong>et</strong>tent de briser l’iso<strong>le</strong>ment<br />
<strong>des</strong> populations rura<strong>le</strong>s, surtout celui<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong>. L’accès à l’information <strong>et</strong><br />
la possibilité de communiquer, via <strong>le</strong>s<br />
radios communautaires <strong>par</strong> exemp<strong>le</strong>,<br />
renforcent la confiance en soi <strong>et</strong> <strong>le</strong><br />
pouvoir <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> en tant que productrices<br />
agrico<strong>le</strong>s <strong>et</strong> citoyennes<br />
(Dimitra, septembre 2008)<br />
• Veil<strong>le</strong>r à l’intégration <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> dans<br />
l’organisation <strong>et</strong> la gestion financière<br />
de la production, du stockage <strong>et</strong> de la<br />
commercialisation <strong>des</strong> produits agrico<strong>le</strong>s<br />
au sein <strong>des</strong> coopératives ou <strong>des</strong><br />
organisations mixtes<br />
• Appuyer l’intégration de la femme<br />
dans <strong>le</strong>s structures de pouvoir <strong>et</strong> sa<br />
<strong>par</strong>ticipation p<strong>le</strong>ine <strong>et</strong> entière au<br />
développement rural <strong>et</strong> aux stratégies<br />
de sécurité alimentaire<br />
• Examiner <strong>et</strong> réorienter <strong>le</strong>s politiques<br />
nationa<strong>le</strong>s de manière à éradiquer<br />
<strong>le</strong>s problèmes qui limitent <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>femmes</strong> dans la sécurité alimentaire.<br />
29
1. INTRODUCTION GLOBALE<br />
BIBLIOGRAPhIE<br />
Caubergs Lis<strong>et</strong>te, Charlier Sophie (2007)<br />
« L’approche de l’empowerment <strong>des</strong><br />
<strong>femmes</strong>. Un guide méthodologique »<br />
http://diplomatie.belgium.be/fr/binaries/<br />
approche_empowerment_<strong>femmes</strong>_fr_<br />
tcm313-65184.pdf<br />
Charlier Sophie (2007), « Les <strong>femmes</strong><br />
contribuent à la souverain<strong>et</strong>é alimentaire »,<br />
in S. Charlier <strong>et</strong> G. Warnotte (éd.), La<br />
souverain<strong>et</strong>é alimentaire. Regards croisés.<br />
UCL/Presses Universitaires de Louvain <strong>et</strong><br />
Entraide <strong>et</strong> Fraternité.<br />
Charlier Sophie, Yepez del Castillo Isabel,<br />
Andia Elisab<strong>et</strong>h, (2000), « Payer un<br />
juste prix aux cultivatrices de quinoa. Un<br />
éclairage ‘genre <strong>et</strong> développement’ sur<br />
<strong>le</strong>s défis du commerce équitab<strong>le</strong> dans<br />
<strong>le</strong>s An<strong>des</strong> boliviennes », Luc Pire, GRIAL,<br />
Presses Universitaires de Louvain<br />
Confédération Syndica<strong>le</strong> International<br />
(CSI), 1 st World Women’s Conférence<br />
consulté en 2009, « Un travail décent,<br />
une vie décente pour <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong>. Guide<br />
de discussion »,<br />
Even Marie-Aude (consulté en 2009)<br />
« Crise financière <strong>et</strong> crise alimentaire :<br />
<strong>des</strong> interconnexions inquiétantes » ; -<br />
Chargée de mission Agricultures du monde<br />
- Ministère de l’Agriculture <strong>et</strong> de la Pêche<br />
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr<br />
FAO :<br />
- « Les <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> la sécurité alimentaire »<br />
(consulté en 2009)<br />
http://www.fao.org/focus/f/women/<br />
Sustin-f.htm<br />
- La contribution <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> à la production<br />
agrico<strong>le</strong> <strong>et</strong> a la sécurité alimentaire:<br />
situation actuel<strong>le</strong> <strong>et</strong> perspectives ;<br />
www.fao.org/docrep/x0233f/x0233f02.htm<br />
(consulté en 2010)<br />
- La <strong>par</strong>ité homme-femme dans l’agriculture<br />
mieux ciblée ; www.fao.org/news/story/fr/<br />
item/41208/icode/ (consulté en 2010)<br />
- http://www.la-croix.com/La-FAOenregistre-un-recul-de-la-faim-dans-<strong>le</strong>monde-en-2010/artic<strong>le</strong>/2439331/4077<br />
(consulté en 2010)<br />
- http://www.fao.org/gender/fr/nutr-f/<br />
NU2doc-f.asp (consulté en 2007)<br />
IFAD, South Asia - How Women and their<br />
Households Cope with Food Insecurity<br />
(consulté en 2009)<br />
http://www.ifad.org/hfs/<strong>le</strong>arning/11.htm<br />
IFPRI (1995) A. R. Quisumbing, L.R.<br />
Brown, H.S.Feldstein, L. Haddad, C. Pena,<br />
« Les <strong>femmes</strong> ou la c<strong>le</strong>f de la sécurité<br />
alimentaire », Washington<br />
ITUC, CSI, IGB.<br />
http://www.ituc-si.org/IMG/pdf/FINAL_<br />
GUIDE.pdf (20/10/09)<br />
Najros Eliane, Lil<strong>le</strong>, 13 novembre 2009 :<br />
« L’accès <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> à la terre: un moyen<br />
pour lutter contre l’insécurité alimentaire<br />
<strong>et</strong> la pauvr<strong>et</strong>é en Afrique »<br />
Oud<strong>et</strong> Maurice (2008) « Crise alimentaire<br />
<strong>et</strong> crise financière : deux poids, deux<br />
mesures » Koudougou,<br />
Président du SEDELAN<br />
http://www.abcburkina.n<strong>et</strong>/content/<br />
view/668/45/lang,fr/<br />
30
Oxfam-Solidarité : Agriculture familia<strong>le</strong><br />
<strong>et</strong> sécurité alimentaire - Un dossier de<br />
la Coalition contre la faim rédigé <strong>par</strong><br />
Jan Vannoppen, Vre<strong>des</strong>eilanden, <strong>et</strong><br />
Thierry Kesteloot, 2005.<br />
Padilla Martine (1997), « Les concepts de<br />
sécurité alimentaire <strong>et</strong> <strong>le</strong>ur aptitude à répondre<br />
aux défis posés <strong>par</strong> la croissance<br />
urbain » : dans Sécurité Alimentaire <strong>des</strong><br />
Vil<strong>le</strong>s Africaines: <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> <strong>des</strong> SADA, FAO,<br />
Col<strong>le</strong>ction «Aliments dans <strong>le</strong>s vil<strong>le</strong>s»<br />
Publication Dimitra, « L’accès <strong>des</strong><br />
<strong>femmes</strong> à la terre en Afrique de l’Ouest :<br />
problématique <strong>et</strong> pistes de solution au<br />
Sénégal <strong>et</strong> au Burkina-Faso », Tab<strong>le</strong><br />
Ronde, Mbour, Sénégal, juill<strong>et</strong> 2008,<br />
http://www.fao.org/dimitra/publicationsdimitra/brochures-dateliers/fr/<br />
Ryckmans Hélène (janvier 1998), « De<br />
la précarité à la logique économique :<br />
logiques économiques ou socia<strong>le</strong>s <strong>des</strong><br />
<strong>femmes</strong> africaines », Cahiers marxistes,<br />
n°208, pp. 173-198<br />
SEAGA Socio-Economic and Gender<br />
Analysis for Emergency and Rehabilitation<br />
- Coping Strategy Indicators<br />
(consulté en 2009)<br />
http://www.fao.org/docrep/008/y5702e/<br />
y5702e05.htm<br />
« Plus d’un milliard de personnes vont<br />
connaître la famine en 2009 »<br />
http://www.wsws.org/<br />
« Quel prix plancher pour <strong>le</strong> riz paddy ? »<br />
(consulté en 2009)<br />
http://www.abcburkina.n<strong>et</strong>/content/<br />
view/667/1/lang,fr/<br />
Bull<strong>et</strong>ins Dimitra,<br />
n° 8 (octobre 2003),<br />
n° 13 (septembre 2007),<br />
n° 14 (mars 2008),<br />
n° 15 (novembre 2008),<br />
n° 16 (mai 2009)<br />
http://www.fao.org/dimitra/publicationsdimitra/bull<strong>et</strong>in/fr/<br />
31
2. LES POSITIONS DES<br />
INSTITUTIONS DE<br />
DéVELOPPEMENT
2.1. L’IMPORTANCE DE L’AGRICULTURE ET DU GENRE AU SEIN<br />
DE LA COOPéRATION BELGE AU DéVELOPPEMENT<br />
mara Coppens<br />
Madame la Présidente de la Commission<br />
Femmes <strong>et</strong> Développement,<br />
Mesdames, Messieurs,<br />
Chacun <strong>et</strong> chacune en vos titres <strong>et</strong> qualités,<br />
C’est pour moi un grand honneur <strong>et</strong> un<br />
grand plaisir de représenter <strong>le</strong> Ministre de<br />
la Coopération au Développement, Char<strong>le</strong>s<br />
MICHEL, à l’occasion de l’ouverture de<br />
ce séminaire international consacré à<br />
«l’accès <strong>et</strong> au contrô<strong>le</strong> <strong>des</strong> <strong>ressources</strong><br />
<strong>par</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> : un défi pour la sécurité<br />
alimentaire».<br />
R<strong>et</strong>enu <strong>par</strong> d’autres engagements, M. <strong>le</strong><br />
Ministre m’a chargée de vous adresser<br />
ce message de bienvenue à Bruxel<strong>le</strong>s, de<br />
félicitation pour la dynamique <strong>et</strong> l’expertise<br />
que vous développez <strong>et</strong> d’encouragement<br />
pour la poursuite <strong>des</strong> travaux que vous<br />
menez au sein de la Commission Femmes<br />
<strong>et</strong> Développement.<br />
Vos discussions de ce jour seront riches<br />
en enseignements, en témoignages,<br />
en échanges d’expériences <strong>et</strong> bonnes<br />
pratiques de terrain tant <strong>le</strong> panel d’invitées<br />
<strong>et</strong> d’oratrices présentes est de qualité <strong>et</strong><br />
d’expériences variées.<br />
Vous abordez aujourd’hui <strong>des</strong> thématiques<br />
transversa<strong>le</strong>s <strong>et</strong> sectoriel<strong>le</strong>s qui constituent<br />
<strong>des</strong> domaines prioritaires d’actions du<br />
Ministre Char<strong>le</strong>s Michel : <strong>le</strong> genre <strong>et</strong> la<br />
sécurité alimentaire.<br />
En eff<strong>et</strong>, <strong>le</strong> caractère prioritaire de l’égalité<br />
hommes-<strong>femmes</strong> a été réaffirmé <strong>par</strong> <strong>le</strong><br />
Ministre de la Coopération au Développement<br />
dans ses notes de politique généra<strong>le</strong><br />
successives.<br />
Il y rappel<strong>le</strong> que l’égalité entre <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong>s hommes est un droit humain<br />
fondamental <strong>et</strong> une question de justice<br />
socia<strong>le</strong>; que l’égalité entre <strong>le</strong>s hommes<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong> renforcement de<br />
<strong>le</strong>urs capacités humaines, économiques,<br />
politiques, socioculturel<strong>le</strong>s <strong>et</strong> défensives<br />
constituent <strong>des</strong> éléments essentiels pour<br />
perm<strong>et</strong>tre un développement juste <strong>et</strong><br />
durab<strong>le</strong>.<br />
Mesdames, Messieurs,<br />
En 2010, la Belgique entend intensifier<br />
ses efforts pour renforcer l’attention<br />
transversa<strong>le</strong> pour <strong>le</strong> genre <strong>et</strong> accélérer <strong>le</strong>s<br />
progrès dans <strong>le</strong> domaine de l’égalité entre<br />
<strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong>s hommes en soutenant<br />
<strong>le</strong>s efforts de ses <strong>par</strong>tenaires.<br />
Dans ce contexte, de nouvel<strong>le</strong>s instructions<br />
ministériel<strong>le</strong>s ont été rédigées m<strong>et</strong>tant<br />
l’accent sur la prise en compte effective de<br />
l’égalité <strong>des</strong> genres <strong>et</strong> de l’autonomisation<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> dans l’analyse <strong>et</strong> la formulation<br />
de stratégies menant à la conclusion<br />
d’accord de coopération. Certains résultats<br />
prom<strong>et</strong>teurs s’annoncent, comme <strong>par</strong><br />
exemp<strong>le</strong> pour <strong>le</strong> Programme indicatif de<br />
coopération 2010-2014 avec la RDC, j’y<br />
reviendrai.<br />
Quant au niveau politique, quatre domaines<br />
d’actions prioritaires sont r<strong>et</strong>enus. Ils<br />
seront relayés sur <strong>le</strong> plan international<br />
ainsi que de manière opérationnel<strong>le</strong> sur <strong>le</strong><br />
terrain. Ces priorités sont :<br />
• La santé <strong>et</strong> <strong>le</strong>s droits sexuels <strong>et</strong><br />
reproductifs dans <strong>le</strong> cadre de notre<br />
appui au secteur de la santé;<br />
• L’éducation <strong>des</strong> fil<strong>le</strong>s <strong>et</strong> la formation<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong>;<br />
• Le rô<strong>le</strong> <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> dans la résolution<br />
33
2. Les positions <strong>des</strong> institutions de déVeLoppement<br />
<strong>des</strong> conflits <strong>et</strong> la lutte contre <strong>le</strong>s<br />
vio<strong>le</strong>nces sexuel<strong>le</strong>s;<br />
• La promotion économique <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>,<br />
en <strong>par</strong>ticulier dans <strong>le</strong> secteur agrico<strong>le</strong>,<br />
secteur économique majeur dans la<br />
plu<strong>par</strong>t <strong>des</strong> pays en développement.<br />
C’est ce dernier point qui r<strong>et</strong>iendra votre<br />
attention aujourd’hui.<br />
Ce thème est effectivement essentiel dans<br />
<strong>le</strong> cadre <strong>des</strong> débats concernant la réponse<br />
globa<strong>le</strong> à apporter à la crise alimentaire.<br />
En étant responsab<strong>le</strong> de 60 à 80% de la<br />
production <strong>des</strong> aliments dans la plu<strong>par</strong>t<br />
<strong>des</strong> pays en développement, <strong>et</strong> de la moitié<br />
de la production alimentaire mondia<strong>le</strong>,<br />
<strong>le</strong> rô<strong>le</strong> clé <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> mais surtout<br />
<strong>le</strong>urs difficultés d’accès aux facteurs de<br />
production <strong>et</strong> de transformation agrico<strong>le</strong>,<br />
doivent être rappelés avec force.<br />
Malgré <strong>le</strong>s efforts entrepris depuis <strong>le</strong>s<br />
émeutes de la faim en 2008, l’insécurité<br />
alimentaire demeure une réalité <strong>et</strong> une<br />
problématique qui doit r<strong>et</strong>enir toute notre<br />
attention. Nous venons de dépasser <strong>le</strong> cap<br />
du milliard de personnes souffrant de la<br />
faim dans <strong>le</strong> monde. C’est une situation<br />
inacceptab<strong>le</strong>. Le premier Objectif du<br />
Millénaire pour <strong>le</strong> Développement visant à<br />
réduire de moitié <strong>le</strong>s personnes souffrant<br />
de la faim en 2015 reste hors de portée, en<br />
<strong>par</strong>ticulier en ce qui concerne <strong>le</strong> continent<br />
africain.<br />
Dans ce contexte, une approche basée<br />
sur <strong>le</strong>s droits humains est essentiel<strong>le</strong> <strong>et</strong><br />
l’égalité d’accès <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> <strong>par</strong> rapport<br />
aux hommes à l’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> <strong>ressources</strong><br />
<strong>et</strong> facteurs de production constituent <strong>des</strong><br />
éléments-clés de réponse.<br />
Pour ce faire, il est indispensab<strong>le</strong> de<br />
disposer de données exactes sur l’accès<br />
relatif <strong>des</strong> hommes <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> aux<br />
<strong>ressources</strong> <strong>et</strong> sur <strong>le</strong>ur contrô<strong>le</strong>. La méthode<br />
de recherche-action perm<strong>et</strong>tant de<br />
faire remonter <strong>des</strong> expériences du terrain<br />
<strong>et</strong> de <strong>le</strong>s confronter entre el<strong>le</strong>s est <strong>par</strong>ticulièrement<br />
intéressante à c<strong>et</strong> égard.<br />
Ce séminaire perm<strong>et</strong>tra de capitaliser<br />
<strong>le</strong>s bonnes <strong>le</strong>çons pour ainsi alimenter <strong>le</strong><br />
débat stratégique <strong>et</strong> politique <strong>et</strong> rendre<br />
opérationnel<strong>le</strong> notre vision.<br />
Mesdames, Messieurs,<br />
Si la Belgique s’est engagée, dès 2008,<br />
à porter à 10% en 2010 <strong>et</strong> 15% en<br />
2015, la <strong>par</strong>t de son aide publique au<br />
développement consacrée au secteur<br />
agrico<strong>le</strong> <strong>et</strong> à proposer c<strong>et</strong> objectif à tous <strong>le</strong>s<br />
pays donateurs, il faut bien entendu veil<strong>le</strong>r<br />
à ce que c<strong>et</strong>te aide soit opportune, efficace<br />
<strong>et</strong> investie dans <strong>des</strong> domaines vecteurs de<br />
croissance <strong>et</strong> contribuant effectivement<br />
à réduire l’insécurité alimentaire. Il faut<br />
réinvestir dans <strong>le</strong>s capacités de production<br />
loca<strong>le</strong>, en valorisant l’approche filière,<br />
pour une agriculture durab<strong>le</strong> <strong>et</strong> axée sur<br />
<strong>le</strong>s cultures vivrières dans <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> jouent un rô<strong>le</strong> capital.<br />
Dans sa politique en faveur de la sécurité<br />
alimentaire, <strong>le</strong> Ministre plaide éga<strong>le</strong>ment<br />
pour une augmentation graduel<strong>le</strong> <strong>des</strong><br />
achats locaux de produits alimentaires <strong>par</strong><br />
<strong>le</strong> PAM <strong>et</strong> <strong>le</strong>s autres institutions nationa<strong>le</strong>s,<br />
régiona<strong>le</strong>s <strong>et</strong> internationa<strong>le</strong>s. La Belgique<br />
s’engage donc de façon résolue à œuvrer<br />
en faveur de l’autosuffisance <strong>et</strong> de la<br />
sécurité alimentaire en Afrique, continent<br />
<strong>le</strong> plus touché <strong>par</strong> la crise alimentaire <strong>et</strong><br />
qui souffrira sans doute <strong>le</strong> plus <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s<br />
<strong>des</strong> changements climatiques. La mise en<br />
œuvre de c<strong>et</strong> engagement nécessite non<br />
seu<strong>le</strong>ment de définir une piste de croissance<br />
34
quantitative mais surtout qualitative<br />
où l’égalité de genre, l’autonomisation<br />
économique <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> doivent occuper<br />
une place prépondérante si l’on veut<br />
atteindre <strong>le</strong>s résultats escomptés.<br />
De façon opérationnel<strong>le</strong>, l’agriculture a été<br />
r<strong>et</strong>enue comme secteur de concentration<br />
de notre aide bilatéra<strong>le</strong> pour 11 de nos<br />
18 <strong>par</strong>tenaires (Bénin, Bolivie, Burundi,<br />
RD Congo, Equateur, Mali, Maroc,<br />
Mozambique, Niger, Rwanda, Tanzanie).<br />
Je vous citerai l’exemp<strong>le</strong> de la pré<strong>par</strong>ation<br />
du prochain Programme Indicatif de<br />
Coopération (2010-2013) avec la RDC où<br />
l’agriculture est r<strong>et</strong>enue comme secteur<br />
d’intervention <strong>et</strong> dans <strong>le</strong>quel <strong>le</strong> Ministre<br />
Char<strong>le</strong>s Michel a décidé de faire appel<br />
à une expertise genre conjointe belgocongolaise<br />
pour définir clairement <strong>le</strong>s<br />
processus <strong>et</strong> <strong>le</strong>s modalités d’intégration<br />
du genre dans <strong>le</strong>s secteurs <strong>et</strong> zones<br />
de concentration de l’aide en vue de la<br />
promotion de l’égalité, de l’équité de<br />
genre <strong>et</strong> de l’empowerment de la femme<br />
congolaise <strong>et</strong> ainsi contribuer à la mise<br />
en œuvre de la politique nationa<strong>le</strong> dans<br />
ce domaine.<br />
Au nom du Ministre, je vous souhaite une<br />
journée d’échanges riches <strong>et</strong> fructueux <strong>et</strong><br />
vous invite à lui communiquer <strong>le</strong>s principaux<br />
enseignements de c<strong>et</strong>te journée.<br />
Je puis vous assurer que ceux-ci seront<br />
pris en compte <strong>par</strong> M. <strong>le</strong> Ministre à <strong>le</strong>ur<br />
juste va<strong>le</strong>ur.<br />
Je vous remercie pour votre attention.<br />
Mesdames <strong>et</strong> Messieurs,<br />
Il reste donc beaucoup de travail si nous<br />
voulons que <strong>le</strong> 21ème sièc<strong>le</strong> soit celui au<br />
cours duquel la sécurisation alimentaire <strong>des</strong><br />
populations du Sud <strong>et</strong> la reconnaissance<br />
du rô<strong>le</strong> <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> comme véritab<strong>le</strong>s<br />
actrices privilégiées du développement<br />
rural soit une réalité.<br />
C’est avec c<strong>et</strong>te vision que la Coopération<br />
belge continuera à placer l’égalité <strong>des</strong><br />
genres, l’empowerment <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong><br />
soutien au développement de l’agriculture<br />
au cœur de son action.<br />
35
2. Les positions <strong>des</strong> institutions de déVeLoppement<br />
2.2. L’ACCèS AUX RESSOURCES ET LEUR CONTRÔLE - POINT<br />
DE VUE DE LA FAO<br />
Isabel<strong>le</strong> Denis<br />
Les <strong>femmes</strong> jouent un rô<strong>le</strong> clé dans la<br />
production de denrées alimentaires. El<strong>le</strong>s<br />
produisent près de 80% <strong>des</strong> aliments<br />
dans <strong>le</strong>s pays en développement <strong>et</strong> sont<br />
responsab<strong>le</strong>s de la moitié de la production<br />
alimentaire mondia<strong>le</strong>. Ce sont <strong>des</strong> acteurs<br />
majeurs dans la production vivrière, la<br />
transformation <strong>des</strong> produits, <strong>et</strong> <strong>le</strong> stockage.<br />
En plus d’assurer l’alimentation de <strong>le</strong>ur<br />
propre foyer, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> contribuent à la<br />
sécurité alimentaire urbaine <strong>par</strong> <strong>le</strong> biais de<br />
l’horticulture urbaine <strong>et</strong> périurbaine qui<br />
perm<strong>et</strong> un apport en légumes frais au<br />
niveau <strong>des</strong> vil<strong>le</strong>s, <strong>et</strong> contribue à la qualité<br />
nutritionnel<strong>le</strong> <strong>des</strong> populations urbaines.<br />
Grâce au soutien du Gouvernement belge,<br />
<strong>le</strong>s cultures maraîchères se sont développées<br />
autour de certaines gran<strong>des</strong> vil<strong>le</strong>s d’Afrique,<br />
notamment au Congo <strong>et</strong> au Burundi.<br />
El<strong>le</strong>s s’occupent de l’é<strong>le</strong>vage <strong>des</strong> volail<strong>le</strong>s<br />
<strong>et</strong> <strong>des</strong> p<strong>et</strong>its ruminants. El<strong>le</strong>s jouent un<br />
rô<strong>le</strong> prépondérant dans la transformation<br />
<strong>et</strong> la commercialisation du poisson. En<br />
gestion forestière, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> s’occupent<br />
de la récolte de plantes sauvages qui sont<br />
employées dans l’alimentation. La forêt<br />
constitue une source importante pour la<br />
subsistance <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>, lorsqu’el<strong>le</strong>s ont<br />
moins de temps à consacrer à la production<br />
agrico<strong>le</strong> <strong>et</strong> sont dès lors beaucoup plus<br />
tributaires pour <strong>le</strong>ur alimentation <strong>des</strong><br />
produits alimentaires récoltés en forêt.<br />
Les <strong>femmes</strong> jouent un rô<strong>le</strong> non négligeab<strong>le</strong><br />
dans la biodiversité agrico<strong>le</strong>. Tandis que<br />
<strong>le</strong>s systèmes commerciaux dominés <strong>par</strong><br />
<strong>le</strong>s hommes utilisent habituel<strong>le</strong>ment <strong>des</strong><br />
variétés standard, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> gèrent <strong>des</strong><br />
systèmes de production de plantes traditionnel<strong>le</strong>s<br />
riches en espèces, <strong>et</strong> qui constituent<br />
un réservoir en matériel génétique.<br />
• a ccès réduit aux <strong>ressources</strong><br />
Malgré la reconnaissance du rô<strong>le</strong> fondamental<br />
que joue la femme dans la gestion<br />
<strong>des</strong> activités agrico<strong>le</strong>s, el<strong>le</strong> ne dispose<br />
pas d’une garantie de droit d’accès <strong>et</strong> de<br />
contrô<strong>le</strong> <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> productives, ce<br />
facteur influençant négativement <strong>le</strong> développement<br />
agrico<strong>le</strong>. Il a <strong>des</strong> répercussions<br />
sur l’accès aux <strong>ressources</strong> complémentaires<br />
de la production agrico<strong>le</strong>, tel<br />
que <strong>le</strong> crédit.<br />
Dans bon nombre de pays d’Afrique<br />
sub-saharienne, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> ne sont<br />
généra<strong>le</strong>ment pas autorisées à posséder<br />
la terre. L’accès à la terre s’obtient <strong>par</strong><br />
<strong>le</strong> biais du mariage. Si celui-ci est rompu<br />
<strong>par</strong> mort du mari, la veuve devra épouser<br />
soit un frère soit un <strong>par</strong>ent du défunt,<br />
pour conserver c<strong>et</strong> accès. El<strong>le</strong> peut en<br />
outre perdre l’accès aux animaux à la<br />
mort du conjoint <strong>et</strong> l’accès à la terre<br />
suite à une répudiation. Il existe dans<br />
certains pays <strong>des</strong> lois qui accordent <strong>des</strong><br />
droits égaux de propriété aux hommes <strong>et</strong><br />
aux <strong>femmes</strong>, mais ces lois ne sont bien<br />
souvent pas appliquées; <strong>le</strong>s systèmes<br />
coutumiers préva<strong>le</strong>nt sur <strong>le</strong> droit civil,<br />
<strong>et</strong> octroient <strong>le</strong> droit de propriété aux<br />
hommes.<br />
Les terres attribuées aux <strong>femmes</strong> sont<br />
généra<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s terres <strong>le</strong>s plus margina<strong>le</strong>s,<br />
de superficie réduite qui ne perm<strong>et</strong>tent<br />
pas de mener <strong>des</strong> activités productives<br />
à hauts rendements. Suite aux risques<br />
d’expropriation, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> évitent de<br />
réaliser <strong>des</strong> investissements tendant à la<br />
bonne conservation <strong>et</strong> à l’amélioration de<br />
la fertilité <strong>des</strong> sols, avec pour conséquence<br />
une productivité plus faib<strong>le</strong> <strong>et</strong> <strong>par</strong> là<br />
même, <strong>des</strong> répercussions sur la sécurité<br />
alimentaire. C’est généra<strong>le</strong>ment l’homme<br />
36
qui assure la gestion de la terre dont il est<br />
propriétaire, la femme étant un acteur de<br />
la production agrico<strong>le</strong>.<br />
L’accès à l’eau constitue éga<strong>le</strong>ment un<br />
facteur limitant à une production agrico<strong>le</strong><br />
soutenue. La femme doit fournir l’eau pour<br />
la famil<strong>le</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong>s cultures <strong>et</strong> doit souvent<br />
<strong>par</strong>courir de longues distances avant de<br />
trouver un puits ou un ruisseau. Les jeunes<br />
fil<strong>le</strong>s sont souvent obligées d’abandonner<br />
<strong>le</strong>ur scolarité pour al<strong>le</strong>r puiser l’eau dans<br />
<strong>le</strong>s sources éloignées. Quand el<strong>le</strong>s ont <strong>des</strong><br />
pompes manuel<strong>le</strong>s, el<strong>le</strong>s ne peuvent pas<br />
toujours <strong>le</strong>s actionner, <strong>par</strong> manque de force.<br />
El<strong>le</strong>s ne peuvent bien souvent pas <strong>le</strong>s ré<strong>par</strong>er,<br />
n’ayant pas reçu la formation adéquate.<br />
L’accès au crédit, qui fait généra<strong>le</strong>ment<br />
défaut, perm<strong>et</strong>trait aux <strong>femmes</strong> d’accéder<br />
aux moyens de production nécessaires<br />
pour accroitre <strong>le</strong> niveau de production <strong>et</strong><br />
la productivité agrico<strong>le</strong>. L’autofinancement<br />
n’est souvent pas suffisant pour acquérir<br />
<strong>le</strong>s intrants en quantités requises.<br />
• q ue fait La fao ?<br />
Les inégalités hommes-<strong>femmes</strong> exacerbent<br />
l’insécurité alimentaire. L’équité hommes<strong>femmes</strong><br />
est une condition essentiel<strong>le</strong> vers<br />
laquel<strong>le</strong> il faut tendre pour m<strong>et</strong>tre en<br />
œuvre <strong>le</strong>s décisions adoptées au somm<strong>et</strong><br />
mondial sur la sécurité alimentaire qui<br />
s’est tenu à Rome en novembre 2009.<br />
Depuis <strong>des</strong> années, la FAO mène <strong>le</strong> combat<br />
pour la reconnaissance de la contribution<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> à la production vivrière <strong>et</strong> à la<br />
sécurité alimentaire <strong>par</strong> <strong>le</strong> biais de divers<br />
programmes dont notamment la formation<br />
à l’analyse socioéconomique selon <strong>le</strong><br />
genre, en envoyant <strong>des</strong> messages c<strong>le</strong>fs <strong>par</strong><br />
<strong>le</strong> biais de son site intern<strong>et</strong>. El<strong>le</strong> compte,<br />
depuis 2007, au sein du dé<strong>par</strong>tement du<br />
développement économique <strong>et</strong> social,<br />
une division de la <strong>par</strong>ité, de l’équité <strong>et</strong> de<br />
l’emploi rural en charge de ce suj<strong>et</strong>.<br />
La FAO a placé l’intégration <strong>des</strong> considérations<br />
de <strong>par</strong>ité au cœur de ses politiques<br />
<strong>et</strong> programmes de développement. Dans<br />
son nouveau cadre stratégique, el<strong>le</strong> a fixé<br />
<strong>par</strong>mi ses principaux objectifs pour <strong>le</strong>s dix<br />
prochaines années, l’équité entre <strong>le</strong>s sexes<br />
dans la prise de décisions <strong>et</strong> dans l’accès<br />
aux biens <strong>et</strong> aux services en zones rura<strong>le</strong>s.<br />
Grâce au travail de la FAO sur la <strong>par</strong>ité, de<br />
nombreux pays ont adopté <strong>des</strong> politiques<br />
<strong>et</strong> <strong>des</strong> programmes de développement<br />
intégrant davantage <strong>le</strong>s dimensions de<br />
genre. Cependant, <strong>des</strong> lacunes importantes<br />
restent à comb<strong>le</strong>r : <strong>le</strong>s préjugés culturels <strong>et</strong><br />
<strong>le</strong> manque de volonté politique ont eu pour<br />
eff<strong>et</strong> que <strong>le</strong>s politiques <strong>et</strong> <strong>le</strong>s conventions<br />
approuvées au niveau international<br />
sur la <strong>par</strong>ité hommes-<strong>femmes</strong>, ont été<br />
très inéga<strong>le</strong>ment adoptées <strong>et</strong> mises en<br />
œuvre. Même lorsque <strong>des</strong> progrès ont été<br />
accomplis, la capacité à m<strong>et</strong>tre en œuvre<br />
<strong>des</strong> politiques <strong>et</strong> à évaluer l’impact qu’el<strong>le</strong>s<br />
ont, est souvent inadapté. La stratégie de<br />
la FAO concernant la dimension de genre<br />
vise à comb<strong>le</strong>r ces lacunes <strong>et</strong> à re<strong>le</strong>ver <strong>le</strong><br />
niveau d’égalité entre hommes <strong>et</strong> <strong>femmes</strong><br />
dans <strong>le</strong>s zones rura<strong>le</strong>s.<br />
• c oncLusions<br />
En conclusion, nous notons que la<br />
population pauvre de notre planète est<br />
en majorité composée de <strong>femmes</strong> vivant<br />
en milieu rural. Les <strong>femmes</strong> sont loin de<br />
bénéficier <strong>des</strong> mêmes facilités que <strong>le</strong>s<br />
hommes en ce qui concerne l’accès à la<br />
propriété foncière, aux services financiers,<br />
37
2. Les positions <strong>des</strong> institutions de déVeLoppement<br />
à la formation <strong>et</strong> aux autres moyens<br />
qui perm<strong>et</strong>tent d’accroître la production<br />
agrico<strong>le</strong> <strong>et</strong> d’améliorer <strong>le</strong>s revenus. Une<br />
étude sur <strong>le</strong>s systèmes de crédits agrico<strong>le</strong>s<br />
en Afrique a montré que <strong>le</strong>s emprunts<br />
accordés aux <strong>femmes</strong> ne dépassaient<br />
pas 10 pour cent. Il existe rarement <strong>des</strong><br />
statistiques sur <strong>le</strong>s rendements <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>,<br />
<strong>le</strong>ur taux d’adoption <strong>des</strong> technologies <strong>et</strong><br />
<strong>le</strong>ur utilisation <strong>des</strong> intrants. L’absence de<br />
<strong>par</strong>ticipation <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> à la production<br />
agrico<strong>le</strong> commercia<strong>le</strong> est rarement un<br />
choix, mais plutôt la conséquence d’un<br />
accès limité aux intrants <strong>et</strong> aux marchés.<br />
El<strong>le</strong>s sont bien plus durement touchées<br />
<strong>par</strong> la récession économique <strong>et</strong> l’envolée<br />
<strong>des</strong> prix <strong>des</strong> denrées alimentaires. Les<br />
inégalités socia<strong>le</strong>s <strong>et</strong> économiques entre<br />
hommes <strong>et</strong> <strong>femmes</strong> comprom<strong>et</strong>tent<br />
la sécurité alimentaire <strong>et</strong> freinent la<br />
croissance économique <strong>et</strong> <strong>le</strong>s progrès<br />
du secteur agrico<strong>le</strong>. Pourtant, une étude<br />
a permis de calcu<strong>le</strong>r qu’en Afrique<br />
subsaharienne la productivité agrico<strong>le</strong><br />
pourrait augmenter de 20 pour cent si <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> bénéficiaient d’un accès égal à la<br />
terre, aux semences <strong>et</strong> aux engrais.<br />
• r ecommandations<br />
Le spectre de la faim subsiste dans bon<br />
nombre de pays en développement.<br />
La sous-alimentation touche plus d’un<br />
milliard de personnes, soit un sixième de<br />
l’humanité. La communauté internationa<strong>le</strong><br />
est en outre confrontée à d’autres défis<br />
que sont <strong>le</strong> ra<strong>le</strong>ntissement de l’économie<br />
mondia<strong>le</strong>, l’effondrement <strong>des</strong> échanges<br />
<strong>et</strong> <strong>des</strong> investissements, la raréfaction<br />
<strong>des</strong> <strong>ressources</strong> naturel<strong>le</strong>s <strong>et</strong> l’impact du<br />
changement climatique. Le renforcement<br />
de la productivité agrico<strong>le</strong> est indispensab<strong>le</strong><br />
à la sécurité alimentaire. Pour nourrir une<br />
population estimée à plus de 9 milliards<br />
en 2050, l’agriculture devra doub<strong>le</strong>r sa<br />
production alimentaire malgré la diminution<br />
de la quantité de terre arab<strong>le</strong> <strong>par</strong> habitant,<br />
la baisse <strong>des</strong> gains de rendements agrico<strong>le</strong>s,<br />
<strong>le</strong>s eff<strong>et</strong>s du changement climatique. La FAO<br />
appel<strong>le</strong> à augmenter la productivité agrico<strong>le</strong><br />
<strong>et</strong> sa contribution à la sécurité alimentaire,<br />
grâce à <strong>des</strong> pratiques agrico<strong>le</strong>s durab<strong>le</strong>s<br />
tel<strong>le</strong>s que la protection intégrée contre <strong>le</strong>s<br />
ravageurs <strong>et</strong> l’agriculture de conservation.<br />
Rappelons que <strong>le</strong> troisième Objectif du<br />
Millénaire pour <strong>le</strong> Développement <strong>des</strong><br />
Nations-Unies est de promouvoir l’égalité<br />
<strong>des</strong> sexes <strong>et</strong> l’autonomisation <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>.<br />
Il vise à éliminer <strong>le</strong>s dis<strong>par</strong>ités entre<br />
<strong>le</strong>s sexes à tous <strong>le</strong>s niveaux d’ici 2015.<br />
L’égalité <strong>des</strong> sexes peut éga<strong>le</strong>ment aider<br />
la communauté internationa<strong>le</strong> à atteindre<br />
d’autres Objectifs du Millénaire pour <strong>le</strong><br />
Développement, tel qu’éradiquer l’extrême<br />
pauvr<strong>et</strong>é <strong>et</strong> la faim, lutter contre la mortalité<br />
infanti<strong>le</strong> <strong>et</strong> améliorer la santé maternel<strong>le</strong>.<br />
Les inégalités entre <strong>le</strong>s hommes <strong>et</strong> <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> constituent dans bon nombre<br />
de sociétés un frein à la croissance<br />
économique <strong>et</strong> au développement durab<strong>le</strong>.<br />
Des objectifs de développement durab<strong>le</strong><br />
impliquent qu’ils <strong>par</strong>ticipent de façon éga<strong>le</strong><br />
aux différentes étapes qui conduisent à la<br />
création <strong>et</strong> à la redistribution de richesses.<br />
Ces défis pour nourrir la planète ne<br />
pourront être re<strong>le</strong>vés tant que persisteront<br />
<strong>le</strong>s préjugés ancestraux sur <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> respectif<br />
<strong>des</strong> hommes <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>, qui interdisent<br />
à cel<strong>le</strong>s-ci de <strong>par</strong>ticiper p<strong>le</strong>inement aux<br />
décisions <strong>et</strong> au développement économique<br />
<strong>et</strong> social. Nous devons être conscients que<br />
l’agriculture durab<strong>le</strong>, <strong>le</strong> développement<br />
rural <strong>et</strong> la sécurité alimentaire ne peuvent<br />
être atteint si on exclut plus de la moitié<br />
de la population rura<strong>le</strong>.<br />
38
Pour instaurer l’équilibre entre <strong>le</strong>s sexes<br />
dans <strong>le</strong> secteur de l’agriculture <strong>et</strong> du<br />
développement rural, l’action <strong>des</strong> communautés<br />
rura<strong>le</strong>s, <strong>des</strong> gouvernements <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />
institutions internationa<strong>le</strong>s de développement<br />
est nécessaire. Les dirigeants politiques du<br />
monde commencent à prendre conscience<br />
de l’importance d’adopter <strong>des</strong> mesures qui<br />
visent à garantir <strong>le</strong> travail <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> rura<strong>le</strong>s,<br />
à renforcer <strong>le</strong>ur sécurité économique,<br />
<strong>et</strong> à favoriser <strong>le</strong>ur accès aux <strong>ressources</strong> <strong>et</strong><br />
aux services.<br />
Il est important que <strong>le</strong>s ministères responsab<strong>le</strong>s<br />
du développement rural améliorent<br />
l’équilibre entre <strong>le</strong>s sexes, encouragent<br />
plus de <strong>femmes</strong> pour <strong>le</strong>s activités de<br />
vulgarisation. Au niveau local, il faut que<br />
<strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong>s hommes jouent un rô<strong>le</strong><br />
actif dans <strong>le</strong>s organes de décision pour<br />
<strong>le</strong>s infrastructures communautaires.<br />
Il est important d’organiser <strong>des</strong> campagnes<br />
de sensibilisation, <strong>des</strong> radios communautaires<br />
pour que <strong>le</strong>s communautés rura<strong>le</strong>s<br />
puissent échanger <strong>le</strong>urs expériences, pour<br />
que <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> soient sensibilisées à <strong>le</strong>urs<br />
droits, notamment en matière d’accès aux<br />
<strong>ressources</strong>. La communication, <strong>par</strong> exemp<strong>le</strong><br />
au travers <strong>des</strong> radios solaires ou à manivel<strong>le</strong>,<br />
est un élément essentiel pour la sensibilisation<br />
<strong>et</strong> la mobilisation <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>,<br />
la connaissance <strong>et</strong> la reconnaissance de<br />
<strong>le</strong>urs droits, pour qu’el<strong>le</strong>s puissent prendre<br />
mieux conscience de <strong>le</strong>ur rô<strong>le</strong> au sein de<br />
la société, pour qu’el<strong>le</strong>s puissent <strong>par</strong>tager<br />
<strong>des</strong> idées <strong>et</strong> <strong>des</strong> pratiques avec d’autres.<br />
Il est important éga<strong>le</strong>ment de développer<br />
<strong>des</strong> initiatives d’information <strong>et</strong> de communication<br />
touchant <strong>le</strong>s chefs communautaires,<br />
<strong>le</strong>s chefs coutumiers, <strong>et</strong> <strong>le</strong>s sensibiliser au<br />
respect de l’accès <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> à la terre.<br />
L’alphabétisation doit être promue si on<br />
veut que <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> puissent avoir un<br />
meil<strong>le</strong>ur accès à l’information, <strong>et</strong> qu’el<strong>le</strong>s<br />
puissent se défendre <strong>et</strong> revendiquer <strong>le</strong>urs<br />
droits. La p<strong>le</strong>ine <strong>par</strong>ticipation de la femme,<br />
l’accès aux <strong>ressources</strong> est une condition<br />
sine qua non pour <strong>le</strong> développement de<br />
la société. Il est important de garantir<br />
l’accès <strong>des</strong> productrices aux facteurs de<br />
production, qu’el<strong>le</strong>s utilisent <strong>le</strong>urs propres<br />
outils pour cultiver, <strong>et</strong> non ceux de <strong>le</strong>urs<br />
maris, qu’el<strong>le</strong>s disposent si possib<strong>le</strong> pour<br />
l’irrigation <strong>des</strong> techniques modernes<br />
comme la motopompe, la pompe à<br />
péda<strong>le</strong>s au lieu de l’arrosoir, qu’el<strong>le</strong>s soient<br />
mieux informées sur <strong>le</strong>s techniques de<br />
production, d’irrigation <strong>et</strong> de protection<br />
intégrée. Il faut favoriser, dans <strong>le</strong>s éco<strong>le</strong>s,<br />
la formation <strong>des</strong> productrices aux champs.<br />
Il faut qu’el<strong>le</strong>s aient accès aux semences<br />
améliorées.<br />
Notre objectif est de tendre vers une<br />
éradication de la faim dans <strong>le</strong> monde,<br />
pour avoir un monde plus prospère, plus<br />
juste, plus équitab<strong>le</strong>. Nous venons de<br />
faire un point rapide sur la situation de la<br />
femme quant à l’accès aux <strong>ressources</strong>, <strong>et</strong><br />
l’importance <strong>des</strong> objectifs que se fixe la<br />
FAO pour réduire <strong>le</strong>s inégalités hommes<strong>femmes</strong>.<br />
Nous remercions cel<strong>le</strong>s <strong>et</strong> ceux<br />
qui au cours de c<strong>et</strong> atelier voudront bien<br />
enrichir c<strong>et</strong>te réf<strong>le</strong>xion <strong>par</strong> <strong>le</strong> fruit de<br />
<strong>le</strong>ur expérience <strong>et</strong> connaissance, <strong>et</strong> qui<br />
œuvrent chaque jour pour que <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
deviennent actrices d’un développement<br />
concerté <strong>et</strong> qui contrecarre <strong>le</strong>ur<br />
marginalisation.<br />
39
2. Les positions <strong>des</strong> institutions de déVeLoppement<br />
2.3. LA SOUVERAINETé ALIMENTAIRE NE SE FERA PAS SANS<br />
jUSTICE DE GENRE<br />
Thierry Kesteloot<br />
Au sein de la Coalition contre la Faim,<br />
diverses ONG travail<strong>le</strong>nt pour défendre<br />
la souverain<strong>et</strong>é alimentaire. A l’occasion<br />
de la Journée Mondia<strong>le</strong> de l’Alimentation<br />
el<strong>le</strong>s ont, avec l’appui de <strong>par</strong>tenaires <strong>et</strong><br />
d’organisations de producteurs d’Europe<br />
<strong>et</strong> du Sud présenté <strong>des</strong> propositions<br />
pour une politique belge face à la crise<br />
alimentaire. La reconnaissance <strong>et</strong> <strong>le</strong><br />
renforcement <strong>des</strong> droits <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>, y<br />
compris dans l’accès aux <strong>ressources</strong>, en<br />
fait <strong>par</strong>tie.<br />
• La coaLition contre La faim<br />
Une coalition d’ONG belges (francophones<br />
<strong>et</strong> néerlandophones) s’est mise en place<br />
en 2002 pour contribuer aux politiques de<br />
coopération belges liées au problème de la<br />
faim dans <strong>le</strong> monde. La Coalition est avant<br />
tout une plate-forme qui doit faciliter<br />
la réf<strong>le</strong>xion commune entre différents<br />
acteurs de coopération impliqués dans la<br />
politique contre la faim. Ces acteurs sont<br />
la Direction Généra<strong>le</strong> de la Coopération au<br />
Développement (DGCD), la Coopération<br />
Technique Belge (CTB), <strong>le</strong>s chercheurs, la<br />
Commission Femmes <strong>et</strong> Développement,<br />
<strong>le</strong>s ONG <strong>et</strong> <strong>le</strong>s organisations de producteurs<br />
du Nord <strong>et</strong> du Sud. Eradiquer la faim<br />
dans <strong>le</strong> monde est possib<strong>le</strong>. Toutefois, <strong>le</strong>s<br />
réponses pour y arriver sont comp<strong>le</strong>xes,<br />
<strong>le</strong>s enjeux de pouvoirs importants, <strong>le</strong>s<br />
solutions souvent inadéquates. Par ail<strong>le</strong>urs,<br />
<strong>le</strong>s crises climatiques, économiques,<br />
financières ou énergétiques ont eu un<br />
impact direct sur une crise alimentaire<br />
plus structurel<strong>le</strong>. La réf<strong>le</strong>xion commune<br />
nous perm<strong>et</strong> de mieux appréhender <strong>le</strong>s<br />
interventions de différents acteurs de la<br />
coopération belge.<br />
D’autre <strong>par</strong>t, la Coalition estime important<br />
de pouvoir informer l’opinion publique<br />
sur <strong>le</strong>s politiques contre la faim, en y<br />
associant <strong>des</strong> <strong>par</strong>tenaires <strong>des</strong> pays en<br />
développement. El<strong>le</strong> vise non seu<strong>le</strong>ment<br />
l’opinion publique <strong>par</strong> <strong>le</strong> biais d’un<br />
travail avec <strong>le</strong>s médias, mais veut en<br />
<strong>par</strong>ticulier pouvoir éga<strong>le</strong>ment informer <strong>le</strong>s<br />
<strong>par</strong><strong>le</strong>mentaires belges intéressés sur <strong>le</strong>s<br />
enjeux généraux. Avec <strong>des</strong> propositions<br />
concrètes développées <strong>par</strong> la Coalition, <strong>le</strong>s<br />
<strong>par</strong><strong>le</strong>mentaires, ainsi que <strong>le</strong> gouvernement<br />
belge sont invités à renforcer <strong>le</strong>s politiques<br />
contre la faim.<br />
En termes de contenu, il y a trois axes<br />
de travail sur <strong>le</strong>squels la Coalition se<br />
concentre.<br />
Le premier axe est la défense de<br />
l’agriculture familia<strong>le</strong> durab<strong>le</strong>. Le deuxième<br />
axe est la cohérence <strong>des</strong> politiques. La<br />
faim dans <strong>le</strong> monde n’est pas uniquement<br />
une affaire de production agrico<strong>le</strong> <strong>et</strong> une<br />
affaire d’un modè<strong>le</strong> d’agriculture familia<strong>le</strong>,<br />
el<strong>le</strong> est éga<strong>le</strong>ment influencée <strong>par</strong> de<br />
nombreuses autres politiques, que ce<br />
soit la politique agrico<strong>le</strong> européenne, la<br />
politique commercia<strong>le</strong> ou <strong>le</strong> changement<br />
climatique.<br />
Le troisième axe est la nécessité de reconnaître<br />
<strong>et</strong> de renforcer <strong>le</strong>s organisations de<br />
paysannes <strong>et</strong> de paysans comme acteurs<br />
de changement.<br />
• Le genre comme axe transVersaL<br />
Ces trois axes de travail ont un lien évident<br />
avec la thématique du genre. Concernant<br />
<strong>le</strong> premier axe «agriculture familia<strong>le</strong><br />
durab<strong>le</strong>», la famil<strong>le</strong> est forcément <strong>le</strong><br />
pilier de ce modè<strong>le</strong> agrico<strong>le</strong> <strong>et</strong> la femme<br />
en est souvent <strong>le</strong> pilier central au niveau<br />
40
du ménage. Ceci implique la nécessité<br />
d’aborder la ré<strong>par</strong>tition de travail inéga<strong>le</strong><br />
<strong>et</strong> l’accès aux moyens de production<br />
inégal entre hommes <strong>et</strong> <strong>femmes</strong>.<br />
Ces inégalités constituent un frein au<br />
développement de l’agriculture familia<strong>le</strong><br />
durab<strong>le</strong>. Ainsi, <strong>par</strong> une meil<strong>le</strong>ure prise<br />
en compte du genre, on pourrait produire<br />
plus <strong>et</strong> répondre mieux aux fonctions<br />
multip<strong>le</strong>s qu’a l’agriculture familia<strong>le</strong><br />
au niveau <strong>des</strong> communautés loca<strong>le</strong>s,<br />
du développement rural, <strong>des</strong> marchés<br />
locaux <strong>et</strong> régionaux, <strong>et</strong>c. Prendre en<br />
compte l’inégalité de genre <strong>et</strong> l’accès<br />
aux <strong>ressources</strong> ne pourra que renforcer<br />
l’urgence de m<strong>et</strong>tre l’agriculture familia<strong>le</strong><br />
durab<strong>le</strong> au cœur <strong>des</strong> politiques agrico<strong>le</strong>s.<br />
La libéralisation <strong>des</strong> marchés agrico<strong>le</strong>s,<br />
<strong>le</strong>s politiques d’investissements privés,<br />
<strong>le</strong> recul significatif du rô<strong>le</strong> régalien <strong>des</strong><br />
Etats sur <strong>le</strong> développement agrico<strong>le</strong><br />
ne sont que quelques éléments qui<br />
ont favorisé l’agriculture industriel<strong>le</strong><br />
au détriment de l’agriculture familia<strong>le</strong>,<br />
avec <strong>des</strong> conséquences souvent plus<br />
dramatiques encore pour <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong>.<br />
Concernant <strong>le</strong> deuxième axe, la cohérence<br />
<strong>des</strong> politiques se fait <strong>par</strong> rapport à une<br />
certaine vision de l’agriculture : cel<strong>le</strong> de la<br />
souverain<strong>et</strong>é alimentaire.<br />
La souverain<strong>et</strong>é alimentaire est <strong>le</strong> droit <strong>des</strong><br />
peup<strong>le</strong>s à une alimentation saine, dans <strong>le</strong><br />
respect <strong>des</strong> cultures, produite à l’aide de<br />
métho<strong>des</strong> durab<strong>le</strong>s <strong>et</strong> respectueuses de<br />
l’environnement, ainsi que <strong>le</strong>ur droit à<br />
définir <strong>le</strong>urs propres systèmes alimentaires<br />
<strong>et</strong> agrico<strong>le</strong>s. El<strong>le</strong> place <strong>le</strong>s producteurs,<br />
distributeurs <strong>et</strong> consommateurs <strong>des</strong><br />
aliments au cœur <strong>des</strong> systèmes <strong>et</strong> politiques<br />
alimentaires en lieu <strong>et</strong> place <strong>des</strong> exigences<br />
<strong>des</strong> marchés <strong>et</strong> <strong>des</strong> transnationa<strong>le</strong>s. (…)<br />
El<strong>le</strong> garantit que <strong>le</strong>s droits d’utiliser <strong>et</strong><br />
de gérer nos terres, territoires, eaux,<br />
semences, bétail <strong>et</strong> biodiversité soient<br />
aux mains de ceux <strong>et</strong> cel<strong>le</strong>s qui produisent<br />
<strong>le</strong>s aliments. La souverain<strong>et</strong>é alimentaire<br />
implique de nouvel<strong>le</strong>s relations socia<strong>le</strong>s,<br />
sans oppression <strong>et</strong> inégalités entres <strong>le</strong>s<br />
hommes <strong>et</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong>, <strong>le</strong>s peup<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s<br />
groupes raciaux, <strong>le</strong>s classes socia<strong>le</strong>s <strong>et</strong> <strong>le</strong>s<br />
générations. 9<br />
C<strong>et</strong>te vision de souverain<strong>et</strong>é alimentaire<br />
est indispensab<strong>le</strong> pour faire face aux<br />
enjeux <strong>et</strong> aux crises multip<strong>le</strong>s, mais el<strong>le</strong><br />
reste confrontée à un modè<strong>le</strong> dominant,<br />
à <strong>des</strong> réponses de repli sur soi face aux<br />
crises, aux inégalités de pouvoir. Plutôt<br />
que de renforcer l’intérêt général, la<br />
solidarité ou la justice socia<strong>le</strong>, nous restons<br />
confrontés à un système d’exclusions avec<br />
pour premières victimes <strong>le</strong>s sans voix qui<br />
travail<strong>le</strong>nt la terre, <strong>et</strong> en <strong>par</strong>ticulier <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong>.<br />
Il est important de reconnaître, qu’audelà<br />
du nécessaire accès <strong>et</strong> contrô<strong>le</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>ressources</strong> <strong>par</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong>, d’autres<br />
politiques sont tout autant exclusives,<br />
tant pour <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> que pour l’ensemb<strong>le</strong><br />
<strong>des</strong> p<strong>et</strong>its producteurs. Les politiques<br />
agrico<strong>le</strong>s, commercia<strong>le</strong>s, énergétiques,<br />
de coopération ou d’investissements ne<br />
sont que quelques enjeux politiques qui<br />
déterminent <strong>le</strong> sort <strong>des</strong> paysans <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />
paysannes, sans <strong>par</strong><strong>le</strong>r <strong>des</strong> inégalités<br />
de pouvoir dans <strong>le</strong>s filières de marchés.<br />
Par ail<strong>le</strong>urs, l’agriculture paysanne reste<br />
considérée comme archaïque <strong>et</strong> sa<br />
contribution à répondre aux enjeux est<br />
insuffisamment reconnue. La cohérence<br />
nous appel<strong>le</strong> à joindre <strong>le</strong>s luttes d’équité de<br />
genre, y compris en termes d’accès <strong>et</strong> de<br />
contrô<strong>le</strong> <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> naturel<strong>le</strong>s, à cel<strong>le</strong>s<br />
plus larges qui sont menées de manière<br />
9<br />
Déclaration de Nyéléni, Forum pour la Souverain<strong>et</strong>é Alimentaire, 27 février 2007, www.nye<strong>le</strong>ni.org<br />
41
2. Les positions <strong>des</strong> institutions de déVeLoppement<br />
conjointe pour la souverain<strong>et</strong>é alimentaire,<br />
qu’el<strong>le</strong>s soient menées au Sud, au Nord ou<br />
au niveau international. La Coalition contre<br />
la Faim vise en premier lieu à travail<strong>le</strong>r sur<br />
ces politiques du Nord qui ont un eff<strong>et</strong> sur<br />
<strong>le</strong> droit à la souverain<strong>et</strong>é alimentaire. Ceci<br />
se traduit <strong>par</strong> un travail sur l’acca<strong>par</strong>ement<br />
<strong>des</strong> terres, <strong>le</strong>s agro carburants, <strong>le</strong>s APE,<br />
<strong>le</strong>s mo<strong>des</strong> agrico<strong>le</strong>s ém<strong>et</strong>teurs de gaz à<br />
eff<strong>et</strong>s de serre, <strong>le</strong>s pratiques de dumping,<br />
<strong>le</strong>s pratiques de coopération. Relier ces<br />
dossiers avec celui du genre est sûrement<br />
un travail qui mérite d’être renforcé.<br />
Le troisième axe est la reconnaissance<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong> renforcement <strong>des</strong> organisations de<br />
paysannes <strong>et</strong> paysans. Trop longtemps<br />
ignorées, el<strong>le</strong>s sont <strong>par</strong>ties intégrantes<br />
pour répondre aux crises alimentaires<br />
ou climatiques. Plutôt que d’être <strong>le</strong>s<br />
seu<strong>le</strong>s victimes du système dominant, ou<br />
principa<strong>le</strong>s bénéficiaires de politiques de<br />
coopération, el<strong>le</strong>s doivent être reconnues<br />
comme actrices de changement. Le<br />
renforcement de ces organisations doit<br />
nécessairement aborder <strong>le</strong>s iniquités de<br />
genre en termes d’ «avoir», de «savoir»,<br />
de «vouloir», <strong>et</strong> surtout de «pouvoir».<br />
L’empowerment <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> <strong>le</strong>ur perm<strong>et</strong><br />
d’avoir <strong>le</strong>ur place légitime au sein de<br />
<strong>le</strong>urs organisations <strong>et</strong> conduit l’ensemb<strong>le</strong><br />
<strong>des</strong> organisations paysannes à avoir une<br />
légitimité beaucoup plus forte tant visà-vis<br />
de l’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong> producteurs <strong>et</strong><br />
productrices que vis-à-vis de l’extérieur.<br />
L’empowerment <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong><br />
renforcement <strong>des</strong> organisations vont<br />
de pair <strong>et</strong> doivent perm<strong>et</strong>tre d’aborder<br />
l’iniquité de genre, mais sont aussi la<br />
clé pour résister aux injustices, pour<br />
renforcer <strong>le</strong>s capacités de proposition,<br />
pour construire <strong>des</strong> alliances <strong>et</strong> pour peser<br />
sur <strong>le</strong>s politiques.<br />
• t raduire Les intentions en<br />
ACTES<br />
Avec l’appui de la Coalition contre la<br />
Faim, un consensus s’est construit au<br />
sein <strong>des</strong> acteurs de la coopération belge<br />
autour <strong>des</strong> axes de travail décrits ci<strong>des</strong>sus,<br />
que ce soit la reconnaissance<br />
<strong>des</strong> organisations paysannes, la priorité<br />
à donner à l’agriculture familia<strong>le</strong> durab<strong>le</strong>,<br />
la cohérence <strong>des</strong> politiques ou même<br />
l’égalité de genre. Un consensus très<br />
large se dégage mais cela ne se traduit<br />
pas nécessairement en pratiques ni en<br />
changements concr<strong>et</strong>s pour <strong>le</strong>s populations<br />
dans <strong>le</strong>s pays en développement. Bien sûr<br />
la politique de coopération peut être mise<br />
à mal <strong>par</strong> d’autres politiques. Mais il est<br />
indispensab<strong>le</strong> de rechercher <strong>le</strong>s meil<strong>le</strong>ures<br />
pratiques, d’essayer de voir ce qui fait la<br />
différence dans la mise en pratique <strong>des</strong><br />
politiques.<br />
En ce qui concerne l’exemp<strong>le</strong> <strong>des</strong> inégalités<br />
de genre, même si dans <strong>le</strong> discours <strong>le</strong>s droits<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> sont largement reconnus,<br />
il reste <strong>des</strong> résistances très fortes, que<br />
ce soit au niveau <strong>des</strong> ménages ou <strong>des</strong><br />
communautés ou encore <strong>des</strong> pouvoirs<br />
publics <strong>et</strong> acteurs non gouvernementaux.<br />
A chaque niveau, chacun <strong>des</strong> acteurs<br />
se doit de voir comment surmonter ces<br />
obstac<strong>le</strong>s, ces conflits d’intérêts. La<br />
Coalition contre la Faim veut mener une<br />
réf<strong>le</strong>xion beaucoup plus approfondie sur<br />
<strong>le</strong> genre <strong>et</strong> <strong>le</strong> développement, <strong>et</strong> pouvoir<br />
appuyer ses recommandations sur <strong>des</strong><br />
pratiques concrètes.<br />
Une pratique intéressante à souligner<br />
dans <strong>le</strong> domaine de la sécurité alimentaire<br />
est l’organisation de la société civi<strong>le</strong> au<br />
niveau international. En novembre 2009,<br />
un forum de la société civi<strong>le</strong> a eu lieu<br />
42
lors du somm<strong>et</strong> mondial sur la sécurité<br />
alimentaire à Rome. Ce forum, ainsi que <strong>le</strong><br />
mécanisme de représentation de la société<br />
civi<strong>le</strong> qui en décou<strong>le</strong> 10 , tente de traduire en<br />
pratique l’égalité de genre. Non seu<strong>le</strong>ment<br />
la <strong>par</strong>ticipation <strong>des</strong> représentants <strong>des</strong><br />
différents groupes d’acteurs (paysans,<br />
pêcheurs, pasteurs, peup<strong>le</strong>s autochtones,<br />
pauvres urbains,…) doit respecter la <strong>par</strong>ité<br />
de genre, résultant en une <strong>par</strong>ticipation<br />
de 60% de déléguées. De plus, au cours<br />
<strong>des</strong> trois jours de ce forum qui pré<strong>par</strong>ait la<br />
contribution de la société civi<strong>le</strong> au somm<strong>et</strong>,<br />
un lieu spécifique, une assise, a été organisé<br />
pour <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> qui <strong>le</strong>ur a permis, avec<br />
<strong>le</strong>s jeunes <strong>et</strong> <strong>le</strong>s peup<strong>le</strong>s autochtones, de<br />
réfléchir à <strong>le</strong>ur contribution. Ce n’est pas<br />
nouveau, car depuis plusieurs années <strong>le</strong>s<br />
forums sur la souverain<strong>et</strong>é alimentaire<br />
reconnaissent <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> central <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
dans la sécurité alimentaire, <strong>et</strong> cela se<br />
traduit <strong>par</strong> <strong>des</strong> mécanismes concr<strong>et</strong>s <strong>le</strong>ur<br />
perm<strong>et</strong>tant d’y <strong>par</strong>ticiper p<strong>le</strong>inement.<br />
10<br />
Voir www.cso4cfs.org<br />
43
3. ANALYSE ...<br />
DES FACTEURS D’INSECURITE ALIMENTAIRE<br />
ET DES STRATEGIES DES FEMMES POUR UNE<br />
SECURITE ALIMENTAIRE
3.1. AU SéNéGAL, L’ACCèS ET LE CONTRÔLE DES RESSOURCES<br />
PAR LES FEMMES : DéFIS POUR LA SéCURITé ALIMENTAIRE<br />
fatou Ndoye <strong>et</strong> virginie Datt<strong>le</strong>r<br />
La crise économique <strong>et</strong> financière qui frappe<br />
<strong>le</strong> monde est encore plus ressentie <strong>par</strong> <strong>le</strong>s<br />
pays africains, notamment ceux qui dépendent<br />
très fortement <strong>des</strong> importations<br />
pour satisfaire <strong>le</strong>urs besoins de consommation.<br />
Le Sénégal est un pays qui a une<br />
consommation très extravertie car l’essentiel<br />
de ses produits alimentaires vient de l’extérieur.<br />
Le riz qui constitue l’aliment de base<br />
<strong>des</strong> populations est principa<strong>le</strong>ment importé<br />
<strong>des</strong> pays asiatiques. De 300 000 tonnes en<br />
1980, <strong>le</strong>s importations de riz sont passées<br />
à 900 000 tonnes, voire 1 million de tonnes<br />
en 2009, soit une va<strong>le</strong>ur moyenne estimée à<br />
plus de 100 milliards de francs CFA 11 .<br />
La consommation alimentaire ap<strong>par</strong>aît<br />
comme l’un <strong>des</strong> postes de dépenses<br />
<strong>le</strong>s plus importants dans <strong>le</strong> budg<strong>et</strong> de<br />
consommation <strong>des</strong> ménages. Les dépenses<br />
alimentaires représentent près de 52% au<br />
plan national <strong>et</strong> 46% au niveau de la région<br />
de Dakar. Ce qui signifie que l’essentiel<br />
<strong>des</strong> revenus <strong>des</strong> populations est <strong>des</strong>tiné à<br />
couvrir <strong>des</strong> besoins en alimentation.<br />
Face à c<strong>et</strong>te situation déjà alarmante, la<br />
crise économique <strong>et</strong> financière de 2008<br />
ne vient qu’approfondir <strong>et</strong> accentuer la<br />
pauvr<strong>et</strong>é, en créant de nouvel<strong>le</strong>s ruptures<br />
<strong>et</strong> de nouvel<strong>le</strong>s formes de vulnérabilités <strong>par</strong><br />
l’aggravation de l’insécurité alimentaire.<br />
El<strong>le</strong> a engendré de nouvel<strong>le</strong>s modifications<br />
qui se traduisent <strong>par</strong> un changement <strong>des</strong><br />
habitu<strong>des</strong> alimentaires <strong>et</strong> surtout <strong>des</strong><br />
mo<strong>des</strong> de consommation <strong>des</strong> populations,<br />
notamment la prolifération <strong>des</strong> restaurants<br />
de rue. La crise économique <strong>et</strong> financière<br />
de 2008 provoque de nouvel<strong>le</strong>s stratégies<br />
pour survivre <strong>et</strong> répondre aux besoins de<br />
la famil<strong>le</strong>.<br />
Après un bref rappel de la démarche<br />
méthodologique, nous aborderons dans un<br />
second chapitre <strong>le</strong>s différentes stratégies<br />
déployées <strong>par</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> pour faire face<br />
à la crise. Dans une troisième <strong>par</strong>tie nous<br />
ferons un zoom sur la restauration de rue<br />
<strong>et</strong> ses caractéristiques <strong>et</strong> enfin, dans la<br />
quatrième <strong>par</strong>tie nous ferons une <strong>le</strong>cture<br />
<strong>des</strong> activités économiques <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> au<br />
travers du concept d’Empowerment.<br />
• p résentation de La démarche<br />
méthodoLogique<br />
Le travail présenté ici est issu de différentes<br />
étu<strong>des</strong> réalisées <strong>par</strong> Enda Graf. Il s’agit<br />
d’enquêtes quantitatives menées auprès<br />
<strong>des</strong> ménages dakarois <strong>et</strong> <strong>des</strong> restauratrices<br />
de rue <strong>et</strong> une enquête qualitative réalisée<br />
<strong>par</strong> Enda Graf en collaboration avec une<br />
stagiaire du Monde selon <strong>le</strong>s Femmes,<br />
Virginie Datt<strong>le</strong>r.<br />
- Les enquêtes quantitatiVes<br />
Différentes enquêtes quantitatives ont été<br />
réalisées en 2001, 2008 <strong>et</strong> 2009. El<strong>le</strong>s<br />
ont toutes porté sur <strong>le</strong>s modifications <strong>des</strong><br />
habitu<strong>des</strong> alimentaires <strong>des</strong> populations en<br />
milieu urbain dakarois.<br />
En 2001, l’Etude ALISA (Alimentation, Innovation<br />
<strong>et</strong> Savoir faire Agroalimentaire en<br />
Afrique de l’Ouest) 12 a été menée à Dakar<br />
auprès de 500 ménages. Dans c<strong>et</strong>te enquête<br />
il s’agissait d’identifier <strong>le</strong>s pratiques d’approvisionnement,<br />
de pré<strong>par</strong>ation <strong>et</strong> de consommation<br />
<strong>des</strong> ménages <strong>par</strong> une analyse portant<br />
sur <strong>le</strong>s facteurs qui influencent <strong>le</strong>s habitu<strong>des</strong><br />
alimentaires.<br />
En 2008, c<strong>et</strong>te même étude a été reconduite<br />
dans <strong>le</strong> but de faire une com<strong>par</strong>aison<br />
11<br />
Dieye P. Noyine : «Etude Sectoriel<strong>le</strong> sur l’Agroalimentaire», Enda Graf, 2008<br />
12<br />
ALISA était un programme de recherches sur <strong>le</strong>s sty<strong>le</strong>s alimentaires, il était financé <strong>par</strong><br />
l’Union Européenne <strong>et</strong> Coordonné <strong>par</strong> <strong>le</strong> CIRAD. Ce programme de recherche a été réalisé<br />
dans 3 pays de la sous région : Burkina Faso, Bénin <strong>et</strong> Sénégal.<br />
45
3. ANALySE DES fACTEURS D’INSECURITE ALImENTAIRE ET DES STRATEGIES DES fEmmES<br />
pOUR UNE SECURITE ALImENTAIRE<br />
avec <strong>le</strong>s résultats de 2001. Au cours c<strong>et</strong>te<br />
enquête, la restauration de rue s’est révélée<br />
comme un phénomène très important<br />
dans <strong>le</strong>s stratégies de sécurité alimentaire,<br />
ce qui nous a conduit à mener une étude<br />
spécifique auprès <strong>des</strong> acteurs en 2009.<br />
L’enquête dans <strong>le</strong> secteur de la restauration<br />
de rue a été réalisée en collaboration avec<br />
l’Institut Supérieur pour <strong>le</strong> Développement<br />
Local (ISDL), el<strong>le</strong> portait sur 600 vendeuses<br />
ré<strong>par</strong>ties dans <strong>le</strong>s différents dé<strong>par</strong>tements<br />
que compte la région de Dakar (Dakar,<br />
Pikine, Guédiawaye <strong>et</strong> Rufisque).<br />
Dé<strong>par</strong>tement Nb. Vendeuses %<br />
Guédiawaye 201 33,5%<br />
Dakar 193 32,2%<br />
Pikine 102 17%<br />
Rufisque 104 17,3%<br />
TOTAL CIT. 600 100%<br />
Source : Enquête Restauration de Rue Enda Graf/<br />
ISDL, mai 2009<br />
- L’étude quaLitatiVe<br />
L’étude qualitative a été menée en collaboration<br />
avec <strong>des</strong> stagiaires du Monde Selon<br />
<strong>le</strong>s Femmes, Virginie Datt<strong>le</strong>r <strong>et</strong> Maïmouna<br />
Ka. Le suj<strong>et</strong> de la recherche portait sur <strong>le</strong>s<br />
stratégies développées <strong>par</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
pour assurer la sécurité alimentaire de<br />
<strong>le</strong>ur famil<strong>le</strong> suite à la crise.<br />
El<strong>le</strong> a été réalisée auprès de 90 <strong>femmes</strong><br />
vivant dans <strong>le</strong>s différents quartiers de la<br />
banlieue (Pikine, Rufisque), <strong>le</strong>s quartiers<br />
populaires de Dakar (Grand Dakar, Ñari<br />
Tally, Grand Yoff, Parcel<strong>le</strong>s Assainies<br />
<strong>et</strong>c.) <strong>et</strong> en milieu rural au niveau de<br />
Pointe Sarène.<br />
Des entr<strong>et</strong>iens semi-directifs ont été menés<br />
au plan individuel <strong>et</strong> col<strong>le</strong>ctif à travers <strong>le</strong>s<br />
organisations de <strong>femmes</strong> notamment,<br />
<strong>le</strong>s Groupements d’Intérêts Economiques<br />
(GIE) <strong>et</strong> <strong>le</strong>s associations.<br />
• Les différentes stratégies<br />
déVeLoppées <strong>par</strong> Les <strong>femmes</strong><br />
pOUR fAIRE fACE à LA CRISE<br />
Comme nous l’avons révélé en introduction,<br />
la consommation alimentaire occupe<br />
un poste important dans <strong>le</strong> budg<strong>et</strong> <strong>des</strong><br />
ménages, près de 50% du budg<strong>et</strong> familial<br />
est consenti pour assurer <strong>des</strong> besoins<br />
alimentaires. En période de crise, <strong>des</strong><br />
ajustements sont nécessairement effectués<br />
pour maintenir ce poste important <strong>et</strong><br />
répondre aux besoins familiaux.<br />
A) STRATEGIE N°1 :<br />
Le changement de l’organisation <strong>et</strong><br />
de la pré<strong>par</strong>ation <strong>des</strong> repas<br />
Depuis quelques années, un changement<br />
profond est ap<strong>par</strong>u dans <strong>le</strong>s pratiques<br />
alimentaires <strong>des</strong> ménages. Ces modifications<br />
peuvent porter sur la composition<br />
<strong>des</strong> plats <strong>et</strong> produits consommés au sein<br />
<strong>des</strong> ménages.<br />
Rappelons que de tout temps, au Sénégal,<br />
la consommation était structurée en<br />
3 temps: p<strong>et</strong>it-déjeuner, déjeuner <strong>et</strong><br />
dîner au sein de toutes <strong>le</strong>s famil<strong>le</strong>s.<br />
En milieu urbain dakarois, où nous avons<br />
porté l’essentiel de nos étu<strong>des</strong>, <strong>le</strong> p<strong>et</strong>it<br />
déjeuner était composé de pain, café au<br />
lait, thé <strong>et</strong>c.; <strong>le</strong> sty<strong>le</strong> européen.<br />
A midi, <strong>le</strong>s plats de riz dominaient dans<br />
tous <strong>le</strong>s ménages. Il s’agissait du «riz au<br />
poisson» (<strong>le</strong> plat national) ou de plats à<br />
sauce.<br />
46
Au dîner, on observait une plus grande<br />
diversité ré<strong>par</strong>tie en 3 catégories :<br />
- <strong>des</strong> plats à base de pain<br />
(ragoût, beefsteak, poul<strong>et</strong>)<br />
- <strong>des</strong> plats à base de riz<br />
(mbaxal, dakhine, ou <strong>le</strong> prélèvement<br />
sur <strong>le</strong> repas de midi <strong>et</strong>c.)<br />
- <strong>des</strong> plats à base de céréa<strong>le</strong>s loca<strong>le</strong>s<br />
(bouillies, couscous, <strong>et</strong>c.)<br />
Avec la crise de 2008, on peut observer<br />
l’abandon de la consommation du lait<br />
(généra<strong>le</strong>ment consommé au p<strong>et</strong>it<br />
déjeuner <strong>par</strong> <strong>le</strong>s famil<strong>le</strong>s). Les tisanes<br />
loca<strong>le</strong>s comme <strong>le</strong> Kinkéliba pour <strong>le</strong>s<br />
enfants <strong>et</strong> <strong>le</strong> café touba pour <strong>le</strong>s adultes<br />
sont consommés dans la grande majorité<br />
<strong>des</strong> famil<strong>le</strong>s dakaroises <strong>et</strong> ont pris la place<br />
du café classique.<br />
A midi, la consommation du riz n’a pas<br />
changé <strong>par</strong> contre, la composition <strong>des</strong><br />
plats a connu quelques modifications avec<br />
la suppression <strong>des</strong> espèces nob<strong>le</strong>s de<br />
poissons, au profit <strong>des</strong> pélagiques comme<br />
<strong>le</strong>s sardinel<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s chinchards, <strong>et</strong>c.<br />
Au dîner, on observe <strong>des</strong> modifications<br />
liées surtout à la suppression de la viande<br />
<strong>et</strong> du pain qui l’accompagne. Les famil<strong>le</strong>s<br />
ont plutôt tendance à consommer <strong>des</strong><br />
plats à base de céréa<strong>le</strong>s loca<strong>le</strong>s comme <strong>le</strong><br />
couscous, la bouillie de mil ou <strong>des</strong> pâtes<br />
alimentaires, plats assez bourratifs au<br />
détriment de la qualité nutritionnel<strong>le</strong>.<br />
D’autres modifications sont aussi visib<strong>le</strong>s<br />
dans l’organisation <strong>des</strong> repas, cela se<br />
traduit <strong>par</strong> la réduction du nombre de<br />
repas <strong>et</strong>/ou <strong>le</strong> changement <strong>des</strong> horaires<br />
auxquels ils sont pris.<br />
Enfin, toujours dans c<strong>et</strong>te catégorie de<br />
stratégie, on peut considérer <strong>le</strong> recours<br />
à la restauration de rue, autrefois tabou<br />
dans la société sénégalaise car mal<br />
considérée. En eff<strong>et</strong> au Sénégal, <strong>le</strong> repas est<br />
traditionnel<strong>le</strong>ment consommé en famil<strong>le</strong>.<br />
C’est autour du plat commun que <strong>le</strong>s<br />
membres de la famil<strong>le</strong> <strong>par</strong>tagent <strong>le</strong> repas.<br />
Le recours à la restauration de rue est<br />
ap<strong>par</strong>u véritab<strong>le</strong>ment avec l’instauration<br />
de la journée continue <strong>et</strong> la dévaluation<br />
du franc CFA en 1994. Le phénomène s’est<br />
accentué en 2008 avec <strong>le</strong>s famil<strong>le</strong>s qui ont<br />
abandonné <strong>le</strong>s pré<strong>par</strong>ations à domici<strong>le</strong> au<br />
profit de la restauration de rue. C’est au<br />
dîner que l’on observe plus ce phénomène.<br />
En eff<strong>et</strong>, <strong>le</strong>s chefs de famil<strong>le</strong> se sentent<br />
de moins en moins engagés pour ce type<br />
de repas. Aujourd’hui, près de 50% <strong>des</strong><br />
famil<strong>le</strong>s ne pré<strong>par</strong>ent plus de repas du<br />
soir <strong>et</strong> s’approvisionnent dans la rue<br />
auprès de vendeuses, alors qu’en 2001 ce<br />
phénomène ne concernait que 25% <strong>des</strong><br />
ménages dakarois.<br />
B) STRATEGIE N°2 :<br />
Trouver <strong>des</strong> Activités Génératrices de<br />
Revenus (AGR)<br />
On assiste à une réel<strong>le</strong> mutualisation de<br />
l’allocation <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> du ménage.<br />
Le chef de famil<strong>le</strong> n’est plus <strong>le</strong> seul à se<br />
soucier du budg<strong>et</strong> familial <strong>et</strong> à y contribuer.<br />
La femme a un nouveau rô<strong>le</strong> en tant que<br />
contributrice à la dépense quotidienne<br />
(DQ). On note l’émergence de nouveaux<br />
acteurs avec, comme évoqué à l’instant, la<br />
femme contributrice mais aussi <strong>le</strong>s jeunes<br />
fil<strong>le</strong>s qui s’investissent dans l’économie<br />
domestique.<br />
Parmi <strong>le</strong>s multip<strong>le</strong>s activités économiques<br />
développées <strong>par</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong>, <strong>le</strong>s plus<br />
courantes sont la transformation de<br />
produits locaux <strong>et</strong> la restauration de rue.<br />
47
3. ANALySE DES fACTEURS D’INSECURITE ALImENTAIRE ET DES STRATEGIES DES fEmmES<br />
pOUR UNE SECURITE ALImENTAIRE<br />
C<strong>et</strong>te dernière est devenue un véritab<strong>le</strong><br />
phénomène depuis <strong>le</strong> tournant de la<br />
dévaluation de 1994. Il s’est accentué en<br />
2008 avec <strong>le</strong>s famil<strong>le</strong>s qui ont abandonné<br />
<strong>le</strong>s pré<strong>par</strong>ations à domici<strong>le</strong>.<br />
On reviendra plus en détail sur la<br />
restauration de rue <strong>et</strong> ses caractéristiques.<br />
C) STRATEGIE N°3 :<br />
Le recours au crédit, à l’achat au<br />
détail <strong>et</strong> à l’utilisation <strong>des</strong> é<strong>par</strong>gnes<br />
En période diffici<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s stratégies développées<br />
<strong>par</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> vont crescendo selon<br />
<strong>le</strong> degré d’urgence <strong>et</strong> de désespoir face<br />
aux besoins.<br />
L’un <strong>des</strong> mécanismes souvent observé<br />
<strong>et</strong> relaté est celui du recours aux crédits<br />
usuriers. A court terme, ils peuvent aider<br />
mais, dans certains cas, ils peuvent<br />
aussi enc<strong>le</strong>ncher une spira<strong>le</strong> inferna<strong>le</strong><br />
d’end<strong>et</strong>tement.<br />
Une autre manière de réagir que <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> ont pu m<strong>et</strong>tre en application<br />
en période de crise est cel<strong>le</strong> de revoir la<br />
méthode de ravitail<strong>le</strong>ment. Lorsque <strong>le</strong>s<br />
temps sont durs, on peut observer la<br />
dis<strong>par</strong>ition <strong>des</strong> stocks alimentaires au<br />
sein <strong>des</strong> foyers. En eff<strong>et</strong>, au<strong>par</strong>avant, <strong>le</strong><br />
ravitail<strong>le</strong>ment se faisait mensuel<strong>le</strong>ment<br />
avec un achat en gros du riz <strong>et</strong> autres<br />
denrées non périssab<strong>le</strong>s (hui<strong>le</strong>, sucre,<br />
<strong>et</strong>c.). Les <strong>femmes</strong> achètent désormais au<br />
détail, avec <strong>des</strong> quantités de plus en plus<br />
revues à la baisse.<br />
Enfin, el<strong>le</strong>s en arrivent, souvent en dernier<br />
recours, à l’utilisation <strong>des</strong> é<strong>par</strong>gnes. Cela<br />
signifie qu’el<strong>le</strong>s n’ont plus de réserve<br />
de sécurité en cas d’imprévu (maladie,<br />
accident, décès d’un proche, <strong>et</strong>c.). El<strong>le</strong>s<br />
se r<strong>et</strong>rouvent plus vulnérab<strong>le</strong>s face aux<br />
événements.<br />
D) STRATEGIE N°4 :<br />
Réduire <strong>le</strong>s dépenses concernant<br />
certains secteurs<br />
Les <strong>femmes</strong> interrogées dans <strong>le</strong> cadre de<br />
l’étude qualitative évoquent, <strong>par</strong>mi <strong>le</strong>s<br />
stratégies pour faire face à la crise, la<br />
réduction <strong>des</strong> autres postes de dépense<br />
tels que l’habil<strong>le</strong>ment (pour el<strong>le</strong>s-mêmes<br />
mais aussi pour <strong>le</strong>s enfants), la baisse<br />
<strong>des</strong> contributions accordées lors <strong>des</strong><br />
cérémonies (<strong>le</strong>s cérémonies représentent<br />
d’ordinaire une <strong>par</strong>t conséquente du<br />
budg<strong>et</strong> car el<strong>le</strong>s perm<strong>et</strong>tent d’entr<strong>et</strong>enir<br />
<strong>le</strong> réseau social qui est très important), la<br />
diminution <strong>des</strong> frais liés à la scolarisation<br />
(ce qui peut générer <strong>des</strong> inquiétu<strong>des</strong><br />
quant à l’accès <strong>des</strong> enfants à l’éducation)<br />
<strong>et</strong> enfin, la réduction <strong>des</strong> dépenses liées à<br />
la santé.<br />
E) STRATEGIE N°5:<br />
La vente de certains biens personnels<br />
Les <strong>femmes</strong> peuvent être amenées à<br />
vendre certains de <strong>le</strong>urs biens personnels.<br />
Il peut s’agir de bijoux, vêtements ou<br />
meub<strong>le</strong>s, de terrains voire de <strong>le</strong>urs outils<br />
de production (matériel, bétail, <strong>et</strong>c.).<br />
Dans ce cas, cela revient à hypothéquer<br />
<strong>le</strong>ur avenir <strong>et</strong> à rendre <strong>le</strong>ur condition<br />
<strong>et</strong> cel<strong>le</strong> du foyer concerné encore plus<br />
vulnérab<strong>le</strong>s.<br />
• Zoom sur La restauration de<br />
rue <strong>et</strong> ses caractéristiques<br />
La restauration de rue joue un rô<strong>le</strong><br />
important dans la sécurité alimentaire<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong>s stratégies de survie <strong>des</strong> ménages.<br />
48
El<strong>le</strong> perm<strong>et</strong> à de nombreuses <strong>femmes</strong><br />
<strong>et</strong> hommes de disposer de revenus. Son<br />
développement en milieu urbain est assez<br />
récent contrairement aux autres centres<br />
urbains <strong>des</strong> pays de la sous région (Abidjan,<br />
Cotonou, Lomé <strong>et</strong>c.). La restauration<br />
de rue s’est réel<strong>le</strong>ment développée au<br />
Sénégal avec l’instauration de la journée<br />
continue en 1992 <strong>et</strong> la dévaluation du<br />
franc CFA en 1994.<br />
Déjà en 1996, l’étude menée dans ce<br />
secteur nous a permis de faire une<br />
typologie : <strong>le</strong>s restaurants modernes, <strong>le</strong>s<br />
gargotes, <strong>le</strong>s maisons aménagées <strong>et</strong> <strong>le</strong>s<br />
restaurants de fortune (abris de fortune,<br />
tab<strong>le</strong>s installées en p<strong>le</strong>ine rue <strong>et</strong>c.) 13 .<br />
L’enquête quantitative réalisée en mai<br />
2009 a concerné <strong>le</strong>s gargotes <strong>et</strong> <strong>le</strong>s<br />
restaurants de fortune.<br />
L’accès à ces restaurants peut être :<br />
• De type individuel : c<strong>et</strong>te restauration<br />
de type individuel est plutôt une pratique<br />
<strong>des</strong> hommes. Le soir, ils fréquentent<br />
certains espaces comme <strong>le</strong>s «dibiteries»<br />
(espaces <strong>des</strong>tinés à la vente de viande<br />
grillée), <strong>le</strong>s «tangana», <strong>et</strong>c.<br />
• De type col<strong>le</strong>ctif : il s’agit d’achat de<br />
plats comme <strong>le</strong>s bouillies, <strong>le</strong>s couscous<br />
<strong>des</strong>tinés aux membres de la famil<strong>le</strong>. La<br />
ménagère achète son plat de bouillie, de<br />
couscous ou de soupe, qu’el<strong>le</strong> <strong>par</strong>tage<br />
avec <strong>le</strong>s membres de la famil<strong>le</strong>. Un<br />
phénomène que l’on observe plus dans<br />
<strong>le</strong>s quartiers populaires <strong>et</strong> qui concerne<br />
plutôt <strong>le</strong> dîner.<br />
Quelques caractéristiques <strong>des</strong> actrices<br />
de restauration de rue :<br />
L’étude sur <strong>le</strong> secteur de la restauration<br />
de rue montre que près de 95% <strong>des</strong><br />
personnes interrogées sont <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
d’âge moyen, se situant entre 36 <strong>et</strong> 38 ans.<br />
69% <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> sont mariées contre<br />
20% de célibataires, 5% de divorcées <strong>et</strong><br />
5% de veuves.<br />
Ces restauratrices font fonctionner <strong>des</strong><br />
ménages dont la tail<strong>le</strong> varie entre 1 <strong>et</strong><br />
30 personnes avec une moyenne de 8<br />
personnes. L’activité de restauration<br />
constitue la principa<strong>le</strong> source de revenus<br />
de <strong>le</strong>ur famil<strong>le</strong>.<br />
Ce secteur est pourvoyeur d’emplois, 95%<br />
<strong>des</strong> restauratrices emploient en moyenne<br />
2 personnes au sein de <strong>le</strong>ur activité, pour<br />
la plu<strong>par</strong>t, <strong>des</strong> enfants ou <strong>des</strong> membres de<br />
<strong>le</strong>urs famil<strong>le</strong>s.<br />
Ces restauratrices sont généra<strong>le</strong>ment<br />
dans <strong>des</strong> situations assez précaires, 51%<br />
d’entre el<strong>le</strong>s utilisent en général <strong>des</strong> abris<br />
de fortune (sans abris 15%, cantine de<br />
récupération 16%, abri en dur 15%) <strong>et</strong><br />
<strong>le</strong> surplus <strong>des</strong> acteurs sont installés de<br />
manière libre.<br />
Mode d’occupation<br />
du lieu de vente<br />
Nb.<br />
cit.<br />
Fréq.<br />
propriété 80 13,9%<br />
Location 184 31,9%<br />
installation libre 300 52,1%<br />
autre (préciser) 12 2,1%<br />
TOTAL CIT. 576 100%<br />
Source : Enquête Restauration de Rue Enda Graf/<br />
ISDL, mai 2009<br />
L’essentiel <strong>des</strong> plats vendus dans la rue<br />
sont pré<strong>par</strong>és à domici<strong>le</strong> <strong>par</strong> 63% <strong>des</strong><br />
restauratrices (35% pré<strong>par</strong>ent <strong>le</strong>s plats<br />
aux abords <strong>des</strong> trottoirs).<br />
Par contre, il existe un déficit criant en<br />
matière de formation. L’enquête révè<strong>le</strong><br />
que seu<strong>le</strong>s 10% <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> interrogées<br />
13<br />
Ndoye F. : «Dévaluation <strong>et</strong> Restauration de rue à Dakar», 1996<br />
49
3. ANALySE DES fACTEURS D’INSECURITE ALImENTAIRE ET DES STRATEGIES DES fEmmES<br />
pOUR UNE SECURITE ALImENTAIRE<br />
ont déjà suivi <strong>des</strong> formations dans<br />
<strong>le</strong>s domaines suivants : gastronomie,<br />
pâtisserie, nutrition. Pour l’hygiène, 5%<br />
de notre échantillon seu<strong>le</strong>ment déclarent<br />
avoir reçu <strong>des</strong> formations dans ce domaine,<br />
ce qui pose <strong>des</strong> inquiétu<strong>des</strong> <strong>par</strong> rapport à<br />
la santé <strong>des</strong> populations.<br />
Une marginalisation <strong>des</strong> acteurs malgré<br />
<strong>le</strong>ur forte contribution à la sécurité<br />
alimentaire<br />
La restauration de rue est, comme<br />
nous l’a révélé l’enquête, un secteur<br />
pourvoyeur d’emplois surtout pour <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> qui jouent <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> de chef de<br />
famil<strong>le</strong> <strong>et</strong> qui sont marginalisées <strong>par</strong> <strong>le</strong><br />
système formel.<br />
Sur <strong>le</strong> plan économique, la restauration<br />
de rue apporte une large contribution<br />
à l’économie nationa<strong>le</strong>. En eff<strong>et</strong>, c<strong>et</strong>te<br />
étude portant sur un échantillon de 600<br />
personnes montre que l’activité draine<br />
près de 3 300 000 000 F CFA (5 030 818 €)<br />
de chiffre d’affaire.<br />
Le développement du secteur de<br />
la restauration de rue, témoin du<br />
dynamisme <strong>des</strong> populations, de <strong>le</strong>urs<br />
capacités à inventer en permanence <strong>des</strong><br />
réponses face aux contraintes nouvel<strong>le</strong>s<br />
que la vil<strong>le</strong> impose aux citadins, soulève<br />
cependant de nombreuses interrogations.<br />
Et malgré son rô<strong>le</strong> important dans<br />
la sécurité alimentaire, la création<br />
d‘emplois <strong>et</strong> de revenus surtout pour<br />
<strong>le</strong>s <strong>femmes</strong>, force est de constater que<br />
<strong>le</strong> secteur est faib<strong>le</strong>ment pris en compte<br />
dans <strong>le</strong>s politiques publiques nationa<strong>le</strong>s<br />
<strong>et</strong> loca<strong>le</strong>s. En eff<strong>et</strong>, ce secteur est ignoré<br />
voire marginalisé <strong>par</strong> <strong>le</strong>s politiques<br />
publiques, il n’existe aucune statistique<br />
fiab<strong>le</strong> perm<strong>et</strong>tant d’avoir <strong>le</strong> nombre exact<br />
d’acteurs évoluant dans <strong>le</strong> domaine. Par<br />
ail<strong>le</strong>urs, <strong>le</strong> secteur n’a pas de ministère<br />
de tutel<strong>le</strong> ce qui empêche <strong>le</strong>s acteurs<br />
d’avoir <strong>des</strong> interlocuteurs directs en cas<br />
de besoin.<br />
Sur <strong>le</strong> plan local, <strong>le</strong>s restauratrices sont<br />
confrontées à un manque flagrant de<br />
dialogue avec <strong>le</strong>s col<strong>le</strong>ctivités loca<strong>le</strong>s. El<strong>le</strong>s<br />
sont victimes car souvent chassées de<br />
<strong>le</strong>urs emplacements (déguerpissement).<br />
C<strong>et</strong>te situation s’explique <strong>par</strong> <strong>le</strong><br />
manque de reconnaissance <strong>par</strong> <strong>le</strong>s<br />
autorités loca<strong>le</strong>s de la légitimité de ces<br />
acteurs. Les <strong>femmes</strong> ne développent<br />
aucune capacité de négociation avec<br />
<strong>le</strong>s col<strong>le</strong>ctivités loca<strong>le</strong>s, ce qui ne <strong>le</strong>ur<br />
perm<strong>et</strong> pas d’être prises en compte dans<br />
la gestion de l’espace urbain. Ceci se<br />
traduit <strong>par</strong> <strong>des</strong> actions de répression <strong>et</strong><br />
de poursuites souvent perpétrées <strong>par</strong> <strong>le</strong>s<br />
autorités loca<strong>le</strong>s <strong>et</strong> dictées <strong>par</strong> un souci<br />
de préservation de l’environnement <strong>et</strong> de<br />
valorisation <strong>des</strong> espaces pour la création<br />
de sources de revenus municipaux<br />
(construction de cantines payantes pour<br />
<strong>le</strong>s commerçants).<br />
C’est dans c<strong>et</strong>te perspective que s’inscrivent<br />
<strong>le</strong>s actions d’Enda Graf pour accompagner<br />
<strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> afin qu’el<strong>le</strong>s puissent bénéficier<br />
de :<br />
• une meil<strong>le</strong>ure maîtrise <strong>des</strong> enjeux de<br />
<strong>le</strong>ur secteur;<br />
• une sensibilisation <strong>des</strong> autorités loca<strong>le</strong>s<br />
à <strong>le</strong>ur contribution aux économies;<br />
• l’ap<strong>par</strong>tenance à un ministère de<br />
tutel<strong>le</strong>;<br />
• l’existence de données statistiques;<br />
• la formation <strong>des</strong> restauratrices (hygiène,<br />
nutrition, gestion <strong>et</strong>c.);<br />
• l’amélioration <strong>des</strong> espaces de vente;<br />
• la structuration <strong>des</strong> acteurs.<br />
50
• Lecture <strong>des</strong> actiVités<br />
génératrices de reVenus (agr)<br />
AU TRAvERS DU CONCEpT DE<br />
«L’EmpOwERmENT»<br />
On peut définir la notion d’Empowerment<br />
comme <strong>le</strong> pouvoir que peuvent acquérir<br />
<strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> sur <strong>le</strong>ur propre vie <strong>et</strong> sur<br />
la société. Ce concept comprend trois<br />
notions de pouvoir, dans <strong>le</strong>urs dimensions<br />
individuel<strong>le</strong>s <strong>et</strong> col<strong>le</strong>ctives :<br />
- <strong>le</strong> «pouVoir intérieur»:<br />
fait référence à l’estime que <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
ont pour el<strong>le</strong>s-mêmes <strong>et</strong> l’impression<br />
qu’el<strong>le</strong>s peuvent avoir d’être quelqu’un<br />
ou non. [VOULOIR]<br />
- <strong>le</strong> «pOUvOIR DE»:<br />
désigne <strong>le</strong>s capacités <strong>et</strong> compétences (<strong>le</strong><br />
savoir-faire), la capacité de développer<br />
une conscience critique (<strong>le</strong> savoir<br />
critique) <strong>et</strong> la capacité d’influencer, de<br />
changer, de se positionner vis-à-vis de<br />
ses proches (<strong>le</strong> savoir être) <strong>et</strong> enfin<br />
«l’avoir» avec la notion de propriété<br />
<strong>et</strong> de revenus financiers. [SAVOIR;<br />
AVOIR]<br />
- <strong>le</strong> «pOUvOIR AvEC»:<br />
vise la capacité de conscience critique<br />
col<strong>le</strong>ctive, la capacité de s’organiser<br />
pour un changement socioéconomique<br />
<strong>et</strong> l’impact que <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> peuvent<br />
avoir sur <strong>le</strong> développement local <strong>et</strong><br />
national pour un changement politique.<br />
[POUVOIR]<br />
Dans <strong>le</strong> cadre de l’étude qualitative, nous<br />
avons analysé <strong>le</strong>s Groupements d’Intérêts<br />
Economiques (GIE) rencontrés au travers<br />
de la gril<strong>le</strong> de <strong>le</strong>cture de ce concept. Il<br />
s’agit principa<strong>le</strong>ment <strong>des</strong> GIE membres<br />
du réseau APROVAL qui regroupe <strong>des</strong><br />
<strong>femmes</strong> qui s’activent dans <strong>le</strong> domaine<br />
de la transformation <strong>des</strong> produits locaux<br />
comme <strong>le</strong>s céréa<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s fruits <strong>et</strong> légumes.<br />
Une analyse a été menée aussi au<br />
niveau <strong>des</strong> organisations <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
transformatrices <strong>des</strong> produits halieutiques.<br />
- LE «pOUvOIR INTERIEUR»<br />
Les <strong>femmes</strong> sont fières de pouvoir améliorer<br />
la situation de <strong>le</strong>ur famil<strong>le</strong> aux niveaux<br />
financier <strong>et</strong> alimentaire <strong>et</strong> de m<strong>et</strong>tre fin<br />
à la souffrance de voir <strong>le</strong>urs enfants avoir<br />
faim. Les <strong>femmes</strong> interrogées expriment<br />
aussi <strong>le</strong>ur fierté d’exister autrement qu’en<br />
tant que mère ou épouse. El<strong>le</strong>s ont <strong>le</strong><br />
sentiment de compter en tant qu’individu<br />
<strong>et</strong> non au travers de <strong>le</strong>ur famil<strong>le</strong>.<br />
Les <strong>femmes</strong> se sentent valorisées en<br />
réalisant qu’el<strong>le</strong>s sont capab<strong>le</strong>s de<br />
travail<strong>le</strong>r en dehors du domici<strong>le</strong> conjugal.<br />
El<strong>le</strong>s (re)prennent confiance en el<strong>le</strong>s <strong>et</strong><br />
reconnaissent <strong>le</strong>urs propres aptitu<strong>des</strong>.<br />
Etre membre actif d’un GIE procure un<br />
nouveau statut <strong>et</strong> un réel changement<br />
du regard <strong>des</strong> autres (dont la famil<strong>le</strong>,<br />
<strong>le</strong>s voisins, l’entourage). Cela peut être<br />
exprimé sous la forme de valorisation/<br />
admiration ou <strong>par</strong>fois de jalousie. (Les<br />
coépouses notamment peuvent être<br />
jalouses de voir se m<strong>et</strong>tre en place ce<br />
nouveau statut).<br />
Les <strong>femmes</strong> <strong>des</strong> GIE ne sont plus<br />
r<strong>et</strong>ranchées seu<strong>le</strong>s dans <strong>le</strong>urs problèmes.<br />
El<strong>le</strong>s n’ont plus à porter seu<strong>le</strong>s <strong>le</strong> souci<br />
de subvenir aux besoins de <strong>le</strong>ur famil<strong>le</strong>.<br />
El<strong>le</strong>s peuvent en discuter <strong>et</strong> <strong>par</strong>tager <strong>le</strong>urs<br />
expériences avec <strong>le</strong>s autres <strong>femmes</strong> de <strong>le</strong>ur<br />
groupe, ce qui <strong>le</strong>ur perm<strong>et</strong> de se libérer<br />
l’esprit <strong>et</strong> d’envisager <strong>des</strong> proj<strong>et</strong>s, de voir<br />
plus loin. Les <strong>femmes</strong> r<strong>et</strong>rouvent une<br />
certaine dignité du fait d’être considérée<br />
51
3. ANALySE DES fACTEURS D’INSECURITE ALImENTAIRE ET DES STRATEGIES DES fEmmES<br />
pOUR UNE SECURITE ALImENTAIRE<br />
comme une personne compétente,<br />
<strong>par</strong>ticipant à un proj<strong>et</strong> col<strong>le</strong>ctif. Dans<br />
<strong>le</strong> cas où l’activité du GIE est rentab<strong>le</strong><br />
<strong>et</strong> qu’el<strong>le</strong>s en tirent <strong>des</strong> bénéfices, cela<br />
perm<strong>et</strong> d’améliorer concrètement <strong>le</strong>s<br />
conditions de vie du foyer en assurant la<br />
sécurité alimentaire familia<strong>le</strong>. Cela peut<br />
ainsi perm<strong>et</strong>tre à la mère de r<strong>et</strong>rouver sa<br />
dignité, el<strong>le</strong> est soulagée <strong>par</strong>ce que ses<br />
enfants ne souffrent plus de la faim.<br />
«Avant, je n’avais pas la même estime de<br />
moi-même. Je ne me considère plus de<br />
la même manière. J’ai même changé de<br />
démarche !»<br />
«Avant, on restait à la maison en tant que<br />
<strong>femmes</strong> un peu effacées. Maintenant, on<br />
quitte la maison, avec <strong>des</strong> sacs à main,<br />
en tant que <strong>femmes</strong> actives, de vraies<br />
entrepreneuses !»<br />
- LE «pOUvOIR DE»<br />
Les <strong>femmes</strong> sont actrices de changements<br />
en s’impliquant dans de nouvel<strong>le</strong>s<br />
Activités Génératrices de Revenus (AGR)<br />
au plan individuel ou au sein d’un GIE.<br />
Leur stratégie est d’obtenir <strong>des</strong> revenus<br />
supplémentaires pour contribuer au budg<strong>et</strong><br />
familial, <strong>le</strong> stabiliser <strong>et</strong> ainsi assurer la<br />
sécurité alimentaire de la famil<strong>le</strong>.<br />
El<strong>le</strong>s ont aussi une autre stratégie, à eff<strong>et</strong><br />
direct c<strong>et</strong>te fois-ci : <strong>le</strong>s changements<br />
<strong>des</strong> habitu<strong>des</strong> alimentaires. En tant que<br />
«maitresse d’orchestre» de l’alimentation<br />
à la maison, la femme conjugue <strong>le</strong>s menus<br />
en fonction <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> dont el<strong>le</strong><br />
dispose. Pour ajuster c<strong>et</strong> équilibre, el<strong>le</strong><br />
peut supprimer certains aliments devenus<br />
trop chers comme la viande, <strong>le</strong> poisson <strong>et</strong><br />
<strong>le</strong> lait. El<strong>le</strong> peut aussi réduire <strong>le</strong> nombre de<br />
repas pré<strong>par</strong>és à la maison <strong>par</strong> jour.<br />
Les <strong>femmes</strong> membres <strong>des</strong> GIE ont un rô<strong>le</strong><br />
à jouer que ce soit en tant que simp<strong>le</strong><br />
membre ou dans un poste à responsabilités.<br />
El<strong>le</strong>s développent <strong>des</strong> compétences tel<strong>le</strong>s<br />
que l’alphabétisation, la prise de <strong>par</strong>o<strong>le</strong><br />
en public, <strong>le</strong>s bases de calcul simp<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s<br />
notions de base de gestion.<br />
Les <strong>femmes</strong> <strong>des</strong> GIE acquièrent non<br />
seu<strong>le</strong>ment <strong>des</strong> rudiments de gestion pour<br />
<strong>le</strong>urs activités, mais accèdent aussi à <strong>des</strong><br />
formations plus poussées en gestion,<br />
en règ<strong>le</strong>s d’hygiène, en techniques<br />
d’emballage, en mark<strong>et</strong>ing, en techniques<br />
de transformation <strong>des</strong> produits locaux <strong>et</strong>/<br />
ou en techniques de restauration. El<strong>le</strong>s<br />
apprennent à utiliser un nouveau matériel<br />
de transformation (moulins, tamis,<br />
centrifugeuses, <strong>et</strong>c.) qui <strong>le</strong>ur perm<strong>et</strong> d’être<br />
plus efficaces dans <strong>le</strong>ur activité.<br />
Du moment que <strong>le</strong> mari donne son accord<br />
pour que la femme travail<strong>le</strong> au sein d’un<br />
GIE, il lui accorde une certaine liberté de<br />
mouvement (plus ou moins cadrée selon<br />
<strong>le</strong>s cas) <strong>et</strong> <strong>le</strong> droit de décider (de manière<br />
plus ou moins autonome) pour ce qui<br />
concerne son activité.<br />
Les GIE sont ainsi <strong>des</strong> espaces ferti<strong>le</strong>s pour<br />
l’émergence d’idées <strong>et</strong> d’opinions. Les<br />
<strong>femmes</strong> peuvent s’organiser pour défendre<br />
une opinion ou un proj<strong>et</strong> commun au sein<br />
de <strong>le</strong>ur GIE ou plus largement au niveau<br />
du réseau APROVAL.<br />
«Les <strong>femmes</strong> ont plus de dignité, plus de<br />
courage. Les <strong>femmes</strong> veu<strong>le</strong>nt désormais<br />
être associées aux hommes pour prendre <strong>le</strong>s<br />
décisions. El<strong>le</strong>s veu<strong>le</strong>nt vraiment s’engager,<br />
<strong>par</strong>ticiper. El<strong>le</strong>s se sont affirmées.»<br />
Les activités de l’AGR poussent <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> à anticiper, el<strong>le</strong>s sont obligées de<br />
se proj<strong>et</strong>er au travers de <strong>le</strong>ur commerce.<br />
El<strong>le</strong>s gagnent donc une meil<strong>le</strong>ure vision du<br />
futur <strong>et</strong> cela peut avoir un impact sur la<br />
manière dont el<strong>le</strong>s appréhendent <strong>le</strong> futur<br />
de <strong>le</strong>ur vie personnel<strong>le</strong>.<br />
La mère doit quitter <strong>le</strong> foyer pour al<strong>le</strong>r<br />
52
travail<strong>le</strong>r à l’unité de production du GIE. Cela<br />
implique une réorganisation <strong>des</strong> activités<br />
domestiques durant son absence. Soit un<br />
de ses enfants (<strong>le</strong>s fil<strong>le</strong>s <strong>le</strong> plus souvent)<br />
prend la relève, soit il y a une coépouse qui<br />
joue ce rô<strong>le</strong> (sous conditions que <strong>le</strong>s deux<br />
<strong>femmes</strong> s’entendent bien), soit encore la<br />
mère anticipe ses tâches domestiques en<br />
<strong>le</strong>s faisant avant de quitter <strong>le</strong> domici<strong>le</strong> !<br />
Dans la majorité <strong>des</strong> cas, la femme gagne<br />
plus de respect auprès de son conjoint,<br />
el<strong>le</strong> gagne de l’importance du fait de<br />
contribuer au budg<strong>et</strong> familial. Aussi,<br />
comme évoqué à l’instant, <strong>le</strong> mari est<br />
amené à lui laisser plus de liberté d’action<br />
<strong>et</strong> à lui faire plus confiance dans la gestion<br />
de la vie quotidienne.<br />
L’entraide entre <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> <strong>des</strong> GIE est<br />
une va<strong>le</strong>ur essentiel<strong>le</strong>, défendue dans tous<br />
<strong>le</strong>s groupes que nous avons rencontrés.<br />
Les membres <strong>des</strong> GIE se soutiennent<br />
mutuel<strong>le</strong>ment.<br />
Dans <strong>le</strong> cas où l’AGR est rentab<strong>le</strong>, la<br />
perception de revenus supplémentaires<br />
provenant de l’activité développée,<br />
perm<strong>et</strong> à la femme de sécuriser <strong>le</strong> budg<strong>et</strong><br />
familial <strong>et</strong> d’assurer l’achat <strong>des</strong> denrées<br />
alimentaires nécessaires, ce qui perm<strong>et</strong><br />
d’améliorer <strong>le</strong> régime alimentaire du<br />
ménage <strong>et</strong> contribuer ainsi au maintien<br />
de la sécurité alimentaire de la famil<strong>le</strong>. On<br />
notera que la femme a plus de chances<br />
de contrô<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s revenus supplémentaires<br />
qu’el<strong>le</strong> apporte <strong>et</strong> ainsi de <strong>le</strong>s allouer aux<br />
dépenses de nourriture. Comme on a pu <strong>le</strong><br />
voir dans <strong>le</strong> chapitre II, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> sont<br />
plus à même d’accorder la priorité aux<br />
dépenses de nourriture que <strong>le</strong>s hommes.<br />
Indirectement, la femme améliore <strong>le</strong>s<br />
conditions de vie de l’ensemb<strong>le</strong> de la<br />
famil<strong>le</strong> (y compris cel<strong>le</strong>s de ses coépouses)<br />
en allégeant <strong>le</strong>s frais à charge du mari chef<br />
de famil<strong>le</strong>.<br />
Dans certains cas, <strong>et</strong> cela devient de plus<br />
en plus courant, la femme a son mot à<br />
dire concernant la gestion <strong>des</strong> <strong>ressources</strong><br />
depuis qu’el<strong>le</strong> contribue au budg<strong>et</strong> familial.<br />
Aussi, pour <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> membres <strong>des</strong> GIE,<br />
<strong>le</strong>s formations qu’el<strong>le</strong>s ont suivies pour<br />
l’activité génératrice de revenus du groupe<br />
influencent positivement <strong>le</strong>ur manière<br />
de gérer <strong>le</strong> budg<strong>et</strong> familial. El<strong>le</strong>s ont pu<br />
acquérir un savoir-faire en gestion qui <strong>le</strong>ur<br />
est potentiel<strong>le</strong>ment uti<strong>le</strong>.<br />
Le sentiment d’apaisement de savoir ses<br />
enfants <strong>et</strong> sa famil<strong>le</strong> nourris à <strong>le</strong>ur faim n’a<br />
pas de prix. On sort dès lors de la notion de<br />
survie, on considère possib<strong>le</strong> de faire <strong>des</strong><br />
proj<strong>et</strong>s à court, moyen voire, long terme.<br />
On redevient acteur de sa propre vie.<br />
- LE «pOUvOIR AvEC»<br />
Lorsqu’el<strong>le</strong>s se r<strong>et</strong>rouvent ensemb<strong>le</strong><br />
au sein <strong>des</strong> GIE, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> discutent,<br />
échangent autour <strong>des</strong> préoccupations<br />
de chacune… C’est dans ces moments<br />
de dialogue <strong>et</strong> d’échanges qu’el<strong>le</strong>s ont<br />
l’occasion de prendre conscience que<br />
<strong>le</strong>s problèmes d’insécurité alimentaire<br />
<strong>et</strong> d’inégalités de genre ne sont pas<br />
individuels mais bien sociétaux, culturels<br />
<strong>et</strong> politiques.<br />
Au sein <strong>des</strong> GIE, une dynamique de<br />
groupe se m<strong>et</strong> en place. Les <strong>femmes</strong><br />
membres ressentent un fort sentiment<br />
d’ap<strong>par</strong>tenance au groupe. El<strong>le</strong>s travail<strong>le</strong>nt<br />
pour une cause commune. Il est de<br />
l’intérêt de chacune que <strong>le</strong> GIE vende<br />
bien <strong>le</strong>urs produits. Le groupe <strong>le</strong>ur perm<strong>et</strong><br />
aussi de tisser de nouveaux contacts, qui<br />
sortent éventuel<strong>le</strong>ment <strong>des</strong> cerc<strong>le</strong>s de<br />
voisinage <strong>et</strong>/ou familiaux, ce qui élargit<br />
<strong>le</strong>urs horizons.<br />
Pour m<strong>et</strong>tre en lumière la notion<br />
d’empowerment dans <strong>le</strong> cadre <strong>des</strong> GIE,<br />
53
3. ANALySE DES fACTEURS D’INSECURITE ALImENTAIRE ET DES STRATEGIES DES fEmmES<br />
pOUR UNE SECURITE ALImENTAIRE<br />
il est intéressant de se pencher sur ce<br />
qui motive <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> ap<strong>par</strong>tenant<br />
à <strong>des</strong> GIE qui ne dégagent aucun<br />
profit à continuer. Ce cas de figure<br />
illustre bien <strong>le</strong> fait que l’apport de<br />
revenus supplémentaires est une <strong>des</strong><br />
motivations mais n’est pas la seu<strong>le</strong>.<br />
Participer à ce forum de décision,<br />
se sentir ‘femme active’, gagner en<br />
autonomie, en liberté de mouvement…<br />
tous ces éléments construisent la<br />
volonté <strong>et</strong> la persévérance de ces<br />
<strong>femmes</strong>.<br />
Le fait d’être membre actif d’un GIE<br />
implique un engagement considérab<strong>le</strong><br />
<strong>et</strong> régulier. Cela signifie assister aux<br />
réunions, venir travail<strong>le</strong>r de manière<br />
régulière, travail<strong>le</strong>r dans une démarche de<br />
qualité pour faire perdurer l’activité. C’est<br />
un grand pas pour beaucoup de <strong>femmes</strong>.<br />
Le GIE devient presque une deuxième<br />
famil<strong>le</strong> pour <strong>le</strong>s plus engagées.<br />
«Le groupe a apporté une consolidation<br />
de nos liens. Actuel<strong>le</strong>ment, nous sommes<br />
comme une famil<strong>le</strong>. La cohésion de notre<br />
groupe est forte».<br />
Les <strong>femmes</strong> du réseau APROVAL<br />
commencent à se faire entendre mais<br />
manquent encore de moyens pour<br />
vraiment influencer <strong>le</strong>s décisions au niveau<br />
politique. N’ayant pas de reconnaissance<br />
juridique, <strong>le</strong> réseau APROVAL ne peut<br />
pas être représenté officiel<strong>le</strong>ment dans<br />
<strong>le</strong>s instances de décisions, malgré la<br />
motivation <strong>et</strong> l’engagement de ses<br />
membres. L’absence de reconnaissance<br />
juridique va de pair avec l’absence de siège<br />
fonctionnel, de support de communication<br />
<strong>et</strong> de promotion pour faire évoluer la<br />
structure.<br />
Impact sur <strong>le</strong> développement (local,<br />
national) vers un changement politique<br />
Les bénéfices tirés <strong>des</strong> nouvel<strong>le</strong>s AGR<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> perm<strong>et</strong>tent la sécurisation<br />
du budg<strong>et</strong> du ménage. Dans <strong>le</strong>s meil<strong>le</strong>urs<br />
<strong>des</strong> cas, en apportant <strong>le</strong>ur contribution,<br />
<strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> fournissent <strong>le</strong> pouvoir d’achat<br />
qui manquait pour pouvoir assurer <strong>et</strong><br />
améliorer la sécurité alimentaire de la<br />
famil<strong>le</strong>. Les restauratrices de rue, quant<br />
à el<strong>le</strong>s, améliorent la sécurité alimentaire<br />
via deux facteurs : en facilitant l’accès<br />
physique <strong>et</strong> financier à la nourriture pour<br />
<strong>le</strong>ur famil<strong>le</strong>.<br />
Loca<strong>le</strong>ment, <strong>le</strong> travail <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> devient<br />
de plus en plus reconnu. Les maris<br />
l’acceptent dans <strong>le</strong>ur grande majorité <strong>et</strong><br />
l’encouragent même, une fois qu’ils se<br />
rendent compte de l’apport précieux que<br />
cela peut représenter pour <strong>le</strong> foyer. Nous<br />
préciserons toutefois qu’il est diffici<strong>le</strong> pour<br />
nous d’estimer la <strong>par</strong>t de ménages dont <strong>le</strong><br />
mari refuse que l’épouse soit membre d’un<br />
GIE. En eff<strong>et</strong>, nous n’avons approché lors<br />
de notre étude que <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> autorisées<br />
à travail<strong>le</strong>r en dehors du domici<strong>le</strong> familial.<br />
Mais généra<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s maris qui refusent<br />
à <strong>le</strong>ur épouse l’accès à <strong>des</strong> activités<br />
économiques sont pour la plu<strong>par</strong>t en<br />
mesure de couvrir l’essentiel <strong>des</strong> besoins<br />
<strong>et</strong> <strong>par</strong> conséquent, ne trouvent pas uti<strong>le</strong><br />
pour <strong>le</strong>ur épouse de chercher <strong>des</strong> revenus<br />
supplémentaires.<br />
Les représentantes de certains GIE<br />
ont acquis une certaine expérience de<br />
l’expression en public. Certaines ont même<br />
pris goût à la politique <strong>et</strong> s’investissent<br />
dans la vie politique de <strong>le</strong>ur communauté<br />
(vil<strong>le</strong>, communes d’arrondissement, <strong>et</strong>c.)<br />
en tant qu’actrices de la société civi<strong>le</strong>.<br />
El<strong>le</strong>s ont la capacité de faire évoluer <strong>le</strong>s<br />
habitu<strong>des</strong> alimentaires <strong>et</strong> d’encourager<br />
la consommation de produits locaux en<br />
véhiculant la valorisation <strong>des</strong> produits<br />
locaux auprès de <strong>le</strong>ur clientè<strong>le</strong> <strong>et</strong><br />
54
de <strong>le</strong>ur communauté, <strong>et</strong> surtout de<br />
développer <strong>des</strong> initiatives de lutte contre<br />
la malnutrition dans <strong>le</strong>s quartiers <strong>et</strong> <strong>le</strong>s<br />
éco<strong>le</strong>s.<br />
CONCLUSIONS<br />
Les différentes étu<strong>des</strong> menées montrent<br />
<strong>le</strong> rô<strong>le</strong> incontournab<strong>le</strong> <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> pour<br />
<strong>le</strong> maintien de la sécurité alimentaire. La<br />
transformation <strong>des</strong> produits locaux <strong>et</strong> la<br />
restauration constituent principa<strong>le</strong>ment<br />
<strong>le</strong>ur domaine de prédi<strong>le</strong>ction. Cela pourrait<br />
s’expliquer <strong>par</strong> <strong>le</strong>s faib<strong>le</strong>s barrières à<br />
l’entrée.<br />
Les activités qu’el<strong>le</strong>s développent perm<strong>et</strong>tent<br />
d’acquérir <strong>des</strong> revenus supplémentaires<br />
<strong>et</strong> de <strong>par</strong>ticiper p<strong>le</strong>inement au bon<br />
fonctionnement de <strong>le</strong>ur ménage.<br />
En intégrant <strong>des</strong> structures comme <strong>le</strong>s<br />
Groupements d’Intérêts Economiques<br />
(GIE), <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> acquièrent plus de<br />
pouvoir <strong>et</strong> d’autonomie. En tant que forum<br />
d’appui à la décision, <strong>le</strong> GIE offre à cel<strong>le</strong>s-ci<br />
la possibilité de s’épanouir <strong>et</strong> de s’engager<br />
ensemb<strong>le</strong> de manière solidaire.<br />
Malgré <strong>le</strong>ur rô<strong>le</strong> important <strong>et</strong> <strong>le</strong>ur contribution<br />
pour maintenir la sécurité alimentaire,<br />
<strong>le</strong>s activités qu’el<strong>le</strong>s développent<br />
sont pour la plu<strong>par</strong>t ignorées voire marginalisées<br />
<strong>par</strong> <strong>le</strong>s décideurs politiques. Ces<br />
<strong>femmes</strong> contribuent largement à l’économie<br />
à travers la création d’emplois <strong>et</strong><br />
la création de richesse. Par conséquent,<br />
el<strong>le</strong>s doivent <strong>par</strong>ticiper p<strong>le</strong>inement à l’élaboration<br />
<strong>des</strong> politiques publiques. El<strong>le</strong>s<br />
doivent construire <strong>des</strong> argumentaires<br />
pour avoir une meil<strong>le</strong>ure visibilité de <strong>le</strong>ur<br />
contribution.<br />
Cela nécessite au préalab<strong>le</strong> un renforcement<br />
<strong>des</strong> capacités dans <strong>le</strong> domaine<br />
du plaidoyer, <strong>le</strong> lobbying <strong>et</strong> <strong>le</strong> dialogue<br />
politique.<br />
BIBLIOGRAPhIE<br />
Charlier S. & Warnotte G. (2007),<br />
«La souverain<strong>et</strong>é alimentaire, regards<br />
croisés», PUL.<br />
Dièye Pape N. (2008), «Etude sectoriel<strong>le</strong> sur<br />
l’Agroalimentaire au Sénégal», Enda Graf.<br />
Gueye, O. (2009), «Le Secteur de la transformation<br />
<strong>des</strong> céréa<strong>le</strong>s loca<strong>le</strong>s au Sénégal,<br />
enjeux, défis <strong>et</strong> stratégies <strong>des</strong> acteurs»,<br />
Enda Graf.<br />
Ndoye F. (1996), «Dévaluation <strong>et</strong> Restauration<br />
de Rue à Dakar», IEDES.<br />
Ndoye F. (2001), «Evolution <strong>des</strong> sty<strong>le</strong>s<br />
alimentaire à Dakar», Enda Graf CIRAD.<br />
Sy M. (2009), «Etude sur l’Etat <strong>des</strong> lieux<br />
de la restauration de rue dans la région de<br />
Dakar», Enda Graf ISDL.<br />
55
3. ANALySE DES fACTEURS D’INSECURITE ALImENTAIRE ET DES STRATEGIES DES fEmmES<br />
pOUR UNE SECURITE ALImENTAIRE<br />
3.2. AU NIGER, L’ACCèS ET LE CONTRÔLE DES RESSOURCES PAR<br />
LES FEMMES : UN DéFI POUR LA SéCURITé ALIMENTAIRE<br />
Catherine Bé<strong>le</strong>msigri<br />
• contexte généraL<br />
- SITUATION AU pLAN<br />
géographique, démographique<br />
<strong>et</strong> poLitique du niger<br />
Le Niger est un pays enclavé de l’Afrique<br />
de l’Ouest dont la superficie est de<br />
1 267 000 km². Il est entouré <strong>par</strong> <strong>le</strong> Mali, <strong>le</strong><br />
Burkina Faso, <strong>le</strong> Bénin, <strong>le</strong> Nigeria, <strong>le</strong> Tchad,<br />
la Libye <strong>et</strong> l’Algérie. Les deux tiers du territoire<br />
sont situés en zone saharienne <strong>et</strong><br />
sont donc désertiques. Il est traversé <strong>par</strong><br />
<strong>le</strong> f<strong>le</strong>uve Niger qui est son seul cours d’eau<br />
permanent sur une longueur de 550 km.<br />
Du fait <strong>des</strong> difficultés de mobilisation <strong>des</strong><br />
<strong>ressources</strong> en eau <strong>et</strong> <strong>des</strong> problèmes importants<br />
de maintenance <strong>des</strong> ouvrages mis en<br />
place, <strong>le</strong>s besoins (domestiques, agrico<strong>le</strong>s<br />
<strong>et</strong> industriels) sont loin d’être couverts. La<br />
proportion de la population en milieu rural<br />
ayant accès à l’eau potab<strong>le</strong> est passée de<br />
22,3% en 1992 à 36,1% en 2000, pour se<br />
situer à 60,3% en 2005.<br />
Le Niger a une population estimée à<br />
13,4 millions d’habitants en 2007, dont<br />
48,6% a moins de 15 ans. Environ 4 nigériens<br />
sur 5 vivent dans <strong>le</strong>s zones rura<strong>le</strong>s.<br />
Le Niger est classé <strong>par</strong>mi <strong>le</strong>s pays <strong>le</strong>s plus<br />
pauvres du monde.<br />
Au-delà de son taux d’accroissement moyen<br />
annuel de 3,3% <strong>par</strong> rapport au recensement<br />
précédent (1988), la population nigérienne<br />
se caractérise aussi <strong>par</strong>:<br />
• sa faib<strong>le</strong> densité de peup<strong>le</strong>ment<br />
(10,3h/km²) <strong>et</strong> sa concentration dans<br />
la bande sud du pays;<br />
• une distribution presque équilibrée<br />
de la population <strong>par</strong> sexe, (50,1% de<br />
<strong>femmes</strong> contre 49,9% d’hommes) <strong>et</strong><br />
une urbanisation relativement faib<strong>le</strong><br />
(16,6%) mais en forte progression;<br />
• sa jeunesse, car près de la moitié de la<br />
population est âgée de moins de 15 ans.<br />
Dans <strong>le</strong> domaine de l’éducation, l’on note<br />
selon <strong>le</strong> rapport annuel 2008 du Ministère<br />
en charge, une amélioration du taux brut<br />
de scolarisation; il est de 53,5% pour<br />
<strong>le</strong>s fil<strong>le</strong>s <strong>et</strong> de 71,7% pour <strong>le</strong>s garçons.<br />
Cependant, <strong>le</strong>s problèmes persistent au<br />
niveau du maintien, surtout <strong>des</strong> fil<strong>le</strong>s,<br />
dans <strong>le</strong> cursus scolaire.<br />
Le territoire est divisé en huit (8) régions,<br />
trente six (36) dé<strong>par</strong>tements <strong>et</strong> deux cent<br />
soixante cinq (265) communes re<strong>par</strong>ties en<br />
cinquante deux (52) communes urbaines<br />
<strong>et</strong> deux cent treize (213) communes<br />
rura<strong>le</strong>s.<br />
- situation économique<br />
L’économie nigérienne est peu diversifiée<br />
<strong>et</strong> se caractérise <strong>par</strong> sa forte dépendance<br />
de l’agriculture <strong>et</strong> sa grande vulnérabilité<br />
aux aléas climatiques. Le taux de croissance<br />
du PIB est de 3,9% en moyenne au<br />
cours de la période 2001-2006, à peine<br />
supérieur au croît démographique de<br />
3,3% 14 . L’activité économique est largement<br />
dominée <strong>par</strong> <strong>le</strong> secteur informel qui<br />
contribue pour 70% au Produit Intérieur<br />
Brut. Le Niger est fortement tributaire de<br />
l’aide extérieure, qui reste cependant très<br />
faib<strong>le</strong> <strong>par</strong> rapport aux besoins de financement<br />
<strong>des</strong> OMD. Notre communication<br />
porte sur <strong>le</strong> secteur agrico<strong>le</strong>.<br />
Dimension agrico<strong>le</strong> de l’économie<br />
nigérienne<br />
Malgré ses contraintes naturel<strong>le</strong>s, <strong>le</strong> secteur<br />
rural domine l’économie nigérienne.<br />
14<br />
Recensement Général de la Population <strong>et</strong> de l’Habitat, 2001<br />
56
En eff<strong>et</strong>, <strong>le</strong> secteur rural a contribué, pendant<br />
<strong>le</strong>s dix dernières années, à hauteur<br />
de 40% en moyenne à la formation du PIB<br />
<strong>et</strong> de 31% aux rec<strong>et</strong>tes d’exportation en<br />
2004. Il est éga<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> premier pourvoyeur<br />
d’emploi, car il occupe actuel<strong>le</strong>ment<br />
84% de la population active, organisée<br />
autour <strong>des</strong> activités liées à l’agriculture,<br />
l’é<strong>le</strong>vage <strong>et</strong> l’exploitation <strong>des</strong> <strong>ressources</strong><br />
forestières, fauniques <strong>et</strong> halieutiques.<br />
Les systèmes de production sont pour<br />
l’essentiel de type traditionnel. A l’exception<br />
de quelques cultures de rente, tel<strong>le</strong>s que<br />
cel<strong>le</strong> de l’oignon, du souch<strong>et</strong> <strong>et</strong> de la<br />
gomme arabique, il s’agit d’une agriculture<br />
de subsistance essentiel<strong>le</strong>ment basée sur<br />
l’agriculture pluvia<strong>le</strong> (principa<strong>le</strong>ment <strong>le</strong><br />
mil, <strong>le</strong> sorgho <strong>et</strong> <strong>le</strong> niébé) <strong>et</strong> sur un é<strong>le</strong>vage<br />
extensif, extrêmement sensib<strong>le</strong>s aux aléas<br />
climatiques. Des cultures irriguées sont<br />
éga<strong>le</strong>ment pratiquées (<strong>par</strong>cel<strong>le</strong>s familia<strong>le</strong>s<br />
de 0,25 à 0,5 ha) mais el<strong>le</strong>s ne concernent<br />
que moins de 30% du potentiel irrigab<strong>le</strong><br />
du pays, estimé à 270 000 ha.<br />
Quant à l’é<strong>le</strong>vage, il perm<strong>et</strong> de substantiel<strong>le</strong>s<br />
exportations vers <strong>le</strong>s pays voisins (surtout<br />
<strong>le</strong> Nigeria) <strong>et</strong> constitue la principa<strong>le</strong> source<br />
de revenu pour une <strong>par</strong>tie importante<br />
de la population <strong>par</strong> l’intermédiaire de la<br />
production de viande, de la vente de bétail<br />
sur pied <strong>et</strong> de produits secondaires (lait,<br />
fromage, cuirs, <strong>et</strong>c.).<br />
Malgré une croissance de la production<br />
agrico<strong>le</strong> de base estimée en moyenne<br />
à 2,5% <strong>par</strong> an, <strong>le</strong> pays n’arrive pas à<br />
satisfaire <strong>le</strong>s besoins alimentaires de sa<br />
population sans cesse croissante. C<strong>et</strong>te<br />
situation rend <strong>le</strong> Niger tributaire de ses<br />
voisins, en <strong>par</strong>ticulier du Nigeria, principal<br />
fournisseur potentiel de céréa<strong>le</strong>s. La<br />
crise de 2005 a en eff<strong>et</strong> mis en évidence<br />
c<strong>et</strong>te dépendance, car <strong>le</strong> déficit céréalier,<br />
habituel<strong>le</strong>ment résorbé <strong>par</strong> <strong>le</strong>s flux<br />
transfrontaliers avec <strong>le</strong> Nigeria, <strong>le</strong> Burkina<br />
Faso <strong>et</strong> <strong>le</strong> Mali, n’ont pas fonctionné pour<br />
<strong>le</strong>s mêmes raisons dans ces pays.<br />
De toute évidence, compte tenu <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s<br />
de la crise 2005, la recherche de la sécurité<br />
alimentaire passe <strong>par</strong> la maîtrise de la<br />
production agrico<strong>le</strong> céréalière.<br />
- La situation généraLe de La<br />
fEmmE AU NIGER<br />
La société nigérienne se caractérise <strong>par</strong><br />
une riche diversité culturel<strong>le</strong>, matérialisée<br />
<strong>par</strong> la coexistence de plusieurs groupes<br />
<strong>et</strong>hniques dont <strong>le</strong>s Haussa, <strong>le</strong>s Zarma,<br />
<strong>le</strong>s Songhaï, <strong>le</strong>s Peulh, <strong>le</strong>s Touareg, <strong>le</strong>s<br />
Kanouri, <strong>le</strong>s Buduma, <strong>le</strong>s Arabe, <strong>le</strong>s<br />
Toubou <strong>et</strong> <strong>le</strong>s Gourmantché. Ré<strong>par</strong>tis<br />
sur l’ensemb<strong>le</strong> du territoire, ces groupes<br />
<strong>et</strong>hniques <strong>par</strong>tagent pour l’essentiel<br />
<strong>le</strong>s mêmes va<strong>le</strong>urs culturel<strong>le</strong>s fondées<br />
sur <strong>le</strong>s us <strong>et</strong> coutumes spécifiques à<br />
chaque groupe; ceux-ci sont renforcés<br />
<strong>par</strong> l’islam, religion dominante au Niger.<br />
L’organisation socia<strong>le</strong> traditionnel<strong>le</strong> de la<br />
société nigérienne est de type patriarcal<br />
dans la majorité <strong>des</strong> communautés.<br />
Ainsi, <strong>le</strong>s relations familia<strong>le</strong>s entre <strong>le</strong>s<br />
hommes <strong>et</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> sont édifiées à<br />
<strong>par</strong>tir d’une inégalité fondamenta<strong>le</strong> entre<br />
l’homme, chef de famil<strong>le</strong>, <strong>et</strong> la femme,<br />
mère <strong>et</strong> épouse. Il est à noter l’exception,<br />
notamment chez <strong>le</strong>s Touareg <strong>et</strong> <strong>le</strong>s Peulh<br />
Bororo, qui sont <strong>des</strong> communautés de<br />
type matriarcal. Dans <strong>le</strong> processus de<br />
socialisation, <strong>le</strong>s rô<strong>le</strong>s sociaux sont traduits<br />
à travers <strong>des</strong> stéréotypes qui en font <strong>le</strong>s<br />
portraits imagés faci<strong>le</strong>ment intériorisés<br />
comme étant dévolus aux hommes <strong>et</strong> aux<br />
<strong>femmes</strong>. L’homme est présenté comme<br />
57
3. ANALySE DES fACTEURS D’INSECURITE ALImENTAIRE ET DES STRATEGIES DES fEmmES<br />
pOUR UNE SECURITE ALImENTAIRE<br />
celui qui pourvoit aux frais d’entr<strong>et</strong>ien <strong>et</strong><br />
d’alimentation de la famil<strong>le</strong>, <strong>et</strong> la femme,<br />
el<strong>le</strong>, s’occupe de la maison. En réalité,<br />
c<strong>et</strong>te image est aujourd’hui trompeuse,<br />
révolue, car dans la grande majorité <strong>des</strong><br />
cas, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> <strong>par</strong>ticipent aux dépenses<br />
du ménage, si el<strong>le</strong>s ne <strong>le</strong>s prennent pas<br />
tota<strong>le</strong>ment en charge grâce aux bénéfices<br />
qu’el<strong>le</strong>s tirent de <strong>le</strong>urs activités agrico<strong>le</strong>s<br />
<strong>et</strong> aux activités génératrices de revenus,<br />
qu’el<strong>le</strong>s initient de plus en plus.<br />
En 2000, <strong>le</strong> Par<strong>le</strong>ment nigérien a adopté<br />
une loi instituant <strong>le</strong> système de quota dans<br />
<strong>le</strong>s fonctions é<strong>le</strong>ctives, au gouvernement<br />
<strong>et</strong> à l’administration de l’Etat. L’artic<strong>le</strong> 3<br />
de ladite loi stipu<strong>le</strong> «lors <strong>des</strong> é<strong>le</strong>ctions législatives<br />
ou loca<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s listes présentées<br />
<strong>par</strong> <strong>par</strong>ti politique, groupement de <strong>par</strong>tis<br />
politiques ou regroupement de candidats<br />
indépendants, doivent comporter <strong>des</strong> candidats<br />
de l’un ou l’autre sexe. Lors de la<br />
proclamation <strong>des</strong> résultats définitifs, la<br />
proportion <strong>des</strong> candidats élus de l’un ou<br />
de l’autre sexe, ne doit pas être inférieure<br />
à 10%». L’artic<strong>le</strong> 4 quant à lui, élève la<br />
proportion à 25% lors de la nomination<br />
<strong>des</strong> membres du gouvernement <strong>et</strong> de la<br />
promotion aux emplois supérieurs.<br />
C’est que la mobilisation <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> à<br />
travers la société civi<strong>le</strong> a permis l’application<br />
de la loi qui a donné <strong>le</strong>s résultats suivants:<br />
670 <strong>femmes</strong> ont été élues sur 3747<br />
conseil<strong>le</strong>rs communaux soit 17%. En outre<br />
14 <strong>femmes</strong> sur 113 députés, soit 12%,<br />
au <strong>par</strong><strong>le</strong>ment <strong>des</strong> é<strong>le</strong>ctions municipa<strong>le</strong>s<br />
<strong>et</strong> législatives de 2004. Mais c<strong>et</strong>te loi est<br />
considérée comme une mesure transitoire<br />
sur laquel<strong>le</strong> il faut s’appuyer pour élargir<br />
la <strong>par</strong>ticipation <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> sur la base du<br />
mérite. Une Politique Nationa<strong>le</strong> de Genre a<br />
été adoptée en juill<strong>et</strong> 2008.<br />
A ce jour, <strong>le</strong> Niger ne dispose pas encore<br />
d’un code de statut <strong>des</strong> personnes <strong>et</strong> de<br />
la famil<strong>le</strong> (Code de la famil<strong>le</strong>). Ainsi, la<br />
situation juridique de la femme continue à<br />
être tiraillée entre <strong>le</strong> droit civil, <strong>le</strong>s coutumes<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong> religieux. Mais grâce à la volonté du<br />
Ministère de la Promotion de la Femme <strong>et</strong><br />
à la mobilisation <strong>des</strong> Associations <strong>et</strong> ONG<br />
féminines, renforcées <strong>par</strong> <strong>le</strong>s Associations<br />
de Défense <strong>des</strong> droits de la personne, on<br />
note certaines avancées sur <strong>le</strong> plan juridique<br />
comme, l’adoption d’une loi pénalisant <strong>le</strong>s<br />
Mutilation Génita<strong>le</strong>s Féminines (MGF), la<br />
prise en compte <strong>des</strong> intérêts <strong>des</strong> enfants<br />
en cas de répudiation/divorce entre <strong>le</strong>s<br />
deux <strong>par</strong>ents, une proposition sur l’âge<br />
du mariage <strong>des</strong> fil<strong>le</strong>s à 18 ans. Cependant<br />
l’insuffisance d’information <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
<strong>et</strong> <strong>des</strong> hommes perm<strong>et</strong> de mobiliser<br />
<strong>des</strong> groupes se réclamant membres<br />
de certaines associations islamiques à<br />
contester <strong>le</strong>s prochains pas nécessaires<br />
pour faire avancer <strong>le</strong> cadre légal de<br />
l’égalité <strong>des</strong> chances entre <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong>s hommes. Il faut souligner que <strong>le</strong><br />
Niger a ratifié la CEDEF en 1999, avec <strong>des</strong><br />
réserves sur certains artic<strong>le</strong>s ayant trait<br />
au statut de la femme <strong>et</strong> aux rapports<br />
familiaux.<br />
Aujourd’hui, même si <strong>le</strong> genre est utilisé<br />
dans <strong>le</strong>s discours <strong>et</strong> documents-cadres<br />
nationaux, il y a une insuffisance dans la<br />
compréhension <strong>des</strong> questions de genre<br />
dans <strong>le</strong> pays qui se traduit <strong>par</strong> l’implication<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> seu<strong>le</strong>ment. L’insuffisance <strong>des</strong><br />
compétences nationa<strong>le</strong>s dans <strong>le</strong> domaine<br />
limite la traduction concrète de la prise en<br />
compte <strong>des</strong> dimensions <strong>et</strong> de l’approche<br />
genre à tous <strong>le</strong>s niveaux. Néanmoins, <strong>le</strong>s<br />
actions spécifiques connaissent une avancée<br />
positive (scolarisation <strong>des</strong> fil<strong>le</strong>s, lutte<br />
contre <strong>le</strong>s vio<strong>le</strong>nces faites aux <strong>femmes</strong> <strong>et</strong><br />
aux enfants, <strong>le</strong> développement du <strong>le</strong>adership<br />
féminin, <strong>le</strong> crédit féminin).<br />
58
• Le regard genre dans L’agri-<br />
CULTURE AU NIGER<br />
Même si <strong>le</strong> genre a été inscrit thème<br />
transversal de la Stratégie de Développement<br />
accéléré <strong>et</strong> de Réduction de la Pauvr<strong>et</strong>é<br />
(SDRP), il demeure diffici<strong>le</strong> d’avoir une<br />
situation différenciée de l’apport <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
<strong>et</strong> <strong>des</strong> hommes au cours d’une campagne<br />
agrico<strong>le</strong>. Le rapport d’évaluation de la<br />
campagne, élaboré chaque année <strong>par</strong> <strong>le</strong><br />
Ministère en charge du secteur, présente <strong>des</strong><br />
insuffisances à ce niveau.<br />
- pLACE DES fEmmES ET DES hOmmES<br />
dans Les actiVités agricoLes<br />
C<strong>et</strong>te situation connait un début de solution<br />
avec <strong>le</strong>s résultats d’un Recensement<br />
Général de l’Agriculture <strong>et</strong> du Cheptel<br />
au Niger (RGAC 2005-2008), initié <strong>par</strong><br />
<strong>le</strong>s Ministères du Développement de<br />
l’Agriculture <strong>et</strong> <strong>des</strong> Ressources Anima<strong>le</strong>s,<br />
avec l’appui de l’Institut National <strong>des</strong><br />
Statistiques, de la FAO, de la Banque<br />
Mondia<strong>le</strong> <strong>et</strong> de l’Union Européenne.<br />
Ce proj<strong>et</strong> vise à m<strong>et</strong>tre à jour <strong>le</strong>s<br />
connaissances sur l’agriculture <strong>et</strong> l’é<strong>le</strong>vage<br />
afin de <strong>le</strong>s moderniser. L’utilisation de<br />
l’approche différenciée homme/femme<br />
est à saluer car el<strong>le</strong> a permis d’obtenir<br />
<strong>des</strong> données désagrégées <strong>par</strong> sexe,<br />
nécessaires dans <strong>le</strong>s prises de décisions<br />
pour une planification conséquente à la<br />
recherche d’un développement équitab<strong>le</strong><br />
<strong>et</strong> durab<strong>le</strong>. Quelques données pertinentes<br />
de ce recensement :<br />
• Sur une population agrico<strong>le</strong> de<br />
10.108.795 individus, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> en<br />
constituent 49,4% soit 4.997.034. Il faut<br />
noter que 53,4% de l’effectif a moins<br />
de 20 ans d’âge.<br />
• Chefs de ménage agrico<strong>le</strong> <strong>par</strong> sexe :<br />
1.627.294 dont 6,6% sont <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>;<br />
<strong>le</strong> taux de dépendance moyen est plus<br />
é<strong>le</strong>vé pour <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> cheffes de<br />
ménage (1,03) que pour <strong>le</strong>s chefs de<br />
ménage hommes (0,86). Ce qui indique<br />
que <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> cheffes de ménage ont<br />
plus de personnes à <strong>le</strong>ur charge.<br />
• La superficie agrico<strong>le</strong> connait deux<br />
mo<strong>des</strong> de gestion : gestion col<strong>le</strong>ctive<br />
avec une superficie de 4.813.167 ha<br />
dont 40% sont entre <strong>le</strong>s mains <strong>des</strong><br />
<strong>femmes</strong>; <strong>et</strong> en gestion individuel<strong>le</strong>,<br />
el<strong>le</strong>s se r<strong>et</strong>rouvent avec 24% <strong>des</strong><br />
1.721.485 ha.<br />
• L’é<strong>le</strong>vage constituant la deuxième<br />
activité économique du pays occupe<br />
une place importante dans la vie <strong>des</strong><br />
hommes <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> en milieu rural;<br />
c’est ainsi que <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> représentent<br />
49,5% <strong>des</strong> ménages agrico<strong>le</strong>s pratiquant<br />
l’é<strong>le</strong>vage sédentaire.<br />
• Ainsi la ré<strong>par</strong>tition <strong>des</strong> chefs de ménage<br />
<strong>par</strong> activité principa<strong>le</strong>s nous donnent <strong>le</strong><br />
tab<strong>le</strong>au ci-<strong>des</strong>sous :<br />
Sexe Agriculture E<strong>le</strong>vage Agriculture<br />
<strong>et</strong> E<strong>le</strong>vage<br />
Femmes 8.434<br />
(8%)<br />
Hommes 172.172<br />
(11%)<br />
27.966<br />
(26%)<br />
151.203<br />
(10%)<br />
71.749<br />
(66%)<br />
1.195.729<br />
(79%)<br />
- CONTRIBUTION DES fEmmES à LA<br />
sécurité aLimentaire<br />
Les résultats statistiques du recensement<br />
général de l’agriculture <strong>et</strong> du cheptel (RGAC),<br />
montrent que <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> pratiquent <strong>des</strong><br />
activités agrico<strong>le</strong>s <strong>et</strong> <strong>par</strong>ticulièrement cel<strong>le</strong>s<br />
59
3. ANALySE DES fACTEURS D’INSECURITE ALImENTAIRE ET DES STRATEGIES DES fEmmES<br />
pOUR UNE SECURITE ALImENTAIRE<br />
en milieu rural. La pratique de l’agriculture<br />
<strong>et</strong> de l’é<strong>le</strong>vage tant <strong>par</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> que <strong>le</strong>s<br />
hommes, constitue traditionnel<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s<br />
sources de richesse <strong>et</strong> de célébrité. Même<br />
si <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> se présentent différemment<br />
selon <strong>le</strong>s régions, selon <strong>le</strong>s communautés,<br />
el<strong>le</strong>s cherchent toujours à produire soit <strong>des</strong><br />
céréa<strong>le</strong>s, soit <strong>des</strong> légumineuses pendant<br />
la saison <strong>des</strong> pluies, selon <strong>le</strong>s opportunités<br />
<strong>et</strong> en dépit <strong>des</strong> aléas climatiques.<br />
En agriculture, el<strong>le</strong>s pratiquent <strong>le</strong>s cultures<br />
suivantes : du mil, du sorgho, du maïs,<br />
du haricot <strong>et</strong> <strong>des</strong> légumineuses comme<br />
l’arachide <strong>et</strong> <strong>le</strong> voandzou. Les <strong>femmes</strong> sont<br />
dans la production de légumes pluviaux <strong>et</strong><br />
en saison de décrue, avec <strong>le</strong> maraîchage.<br />
Le RGAC a fait ressortir la situation<br />
suivante en termes de superficie exploitée<br />
<strong>par</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong>s hommes (cas du mil,<br />
du gombo, du maïs, du voandzou) : <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> exploitent 51% de la superficie<br />
sous voandzou, 44% de cel<strong>le</strong> du gombo<br />
<strong>et</strong> 22% de cel<strong>le</strong> du maïs. Il faut noter que<br />
ces résultats renferment <strong>des</strong> dis<strong>par</strong>ités<br />
régiona<strong>le</strong>s.<br />
Les <strong>femmes</strong> constituent une <strong>par</strong>t<br />
importante de la main-d’œuvre utilisée<br />
dans <strong>le</strong> champ familial qui est prioritaire<br />
<strong>par</strong> rapport à ses cultures. Les récoltes<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> servent en grande <strong>par</strong>tie à<br />
l’alimentation de la famil<strong>le</strong>. La production<br />
agrico<strong>le</strong> <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> a longtemps servi<br />
d’é<strong>par</strong>gne <strong>et</strong> a été utilisée directement<br />
comme cadeaux lors <strong>des</strong> cérémonies;<br />
<strong>le</strong>s surplus <strong>des</strong> cultures dites de rente<br />
(niébé, oseil<strong>le</strong>, gombo, sésame, <strong>et</strong>c.)<br />
étaient vendus sur <strong>le</strong>s marchés afin<br />
d’acquérir du numéraire pour subvenir<br />
à <strong>le</strong>urs besoins spécifiques ainsi qu’à<br />
ceux <strong>des</strong> enfants (habil<strong>le</strong>ment, santé,<br />
scolarisation, mariage, capital bétail…).<br />
En milieu rural, la richesse de la femme<br />
vient du champ.<br />
Les <strong>femmes</strong> sédentaires pratiquaient aussi<br />
l’é<strong>le</strong>vage <strong>des</strong> bovins, ovins <strong>et</strong> caprins, <strong>et</strong><br />
s’étaient spécialisées dans l’embouche<br />
ovine <strong>et</strong> caprine. L’é<strong>le</strong>vage joue un rô<strong>le</strong><br />
important dans <strong>le</strong>s activités économiques<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> : il constitue un capital<br />
aisément mobilisab<strong>le</strong> en cas de crise <strong>et</strong><br />
une é<strong>par</strong>gne sur pied en cas d’abondance<br />
(avec intérêt puisque <strong>le</strong>s animaux se<br />
reproduisent). Son importance socia<strong>le</strong><br />
influe de façon déterminante sur <strong>le</strong> statut<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> en milieu sédentaire <strong>et</strong> en<br />
milieu pastoral <strong>et</strong> il contribue fortement<br />
à réduire la vulnérabilité <strong>des</strong> ménages.<br />
En milieu pastoral, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> possèdent<br />
<strong>des</strong> animaux (gros <strong>et</strong> p<strong>et</strong>its ruminants)<br />
qui évoluent au sein du troupeau familial.<br />
Là aussi, <strong>le</strong>s crises répétées ont vu<br />
diminuer <strong>et</strong> même dis<strong>par</strong>aître <strong>le</strong> troupeau<br />
familial, contraignant <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> hommes<br />
à chercher d’autres <strong>ressources</strong>, voire à<br />
changer de mode de vie.<br />
Bovins Ovins Caprins<br />
Fem. Hom. Fem. Hom. Fem. Hom.<br />
22,3% 77,7% 39,7% 60,3% 54,5% 45,5%<br />
Propriétés <strong>des</strong> animaux RGAC 2005-2008 :<br />
ré<strong>par</strong>tition <strong>des</strong> animaux sédentaires<br />
- Les contraintes Liées à La<br />
pRODUCTION AGRICOLE DES<br />
fEmmES<br />
Les aléas climatiques <strong>et</strong> sociaux<br />
Le Niger, à l’instar <strong>des</strong> autres régions ari<strong>des</strong><br />
<strong>et</strong> semi-ari<strong>des</strong>, connaît <strong>des</strong> difficultés<br />
croissantes. Des sécheresses répétées,<br />
une agriculture trop gourmande en<br />
<strong>ressources</strong> <strong>et</strong> une démographie galopante<br />
60
ont entraîné une forte pression foncière<br />
sur <strong>le</strong>s terres de culture pluvia<strong>le</strong>, réduisant<br />
ainsi la tail<strong>le</strong> <strong>des</strong> exploitations agrico<strong>le</strong>s à<br />
5 ha puis à 4 ha en moyenne <strong>par</strong> ménage<br />
en 2005.<br />
- u n accès Limité aux <strong>ressources</strong><br />
- L’accès à la terre<br />
L’agriculture étant la première source de<br />
revenus pour <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> rura<strong>le</strong>s, el<strong>le</strong>s se<br />
battent pour disposer d’un lopin de terre.<br />
Mais <strong>le</strong> chiffre de 6,6% de <strong>femmes</strong> chefs<br />
de ménage agrico<strong>le</strong> montre <strong>le</strong>s inégalités<br />
d’accès entre <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong>s hommes.<br />
C<strong>et</strong>te situation est due à la cohabitation<br />
de plusieurs systèmes fonciers au Niger<br />
(systèmes basés sur <strong>le</strong> droit coutumier,<br />
droit coranique <strong>et</strong> droit civil). Le RGAC a<br />
re<strong>le</strong>vé <strong>le</strong>s mo<strong>des</strong> suivants d’acquisition<br />
de la terre : l’héritage est <strong>le</strong> premier<br />
mode d’accès, 69% contre 83% pour<br />
<strong>le</strong>s hommes; 11% sont prêtés (5% pour<br />
<strong>le</strong>s hommes); 9% sous forme de don<br />
(1% pour homme); 6% sont ach<strong>et</strong>és<br />
(7% pour <strong>le</strong>s hommes); 0% en fermage<br />
ou métayage (1% pour <strong>le</strong>s hommes);<br />
autres mo<strong>des</strong> d’acquisition : 5% pour <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong>, contre 3% pour <strong>le</strong>s hommes. Les<br />
superficies étant limitées, <strong>le</strong>s cultivatrices<br />
ne peuvent pas pratiquer <strong>le</strong>s cultures<br />
de rentes pérennes qui sont d’un grand<br />
apport financier pour l’exploitant. El<strong>le</strong>s se<br />
consacrent essentiel<strong>le</strong>ment aux cultures<br />
vivrières. Les terres irriguées restent<br />
encore la chasse gardée <strong>des</strong> hommes.<br />
L’arrivée <strong>des</strong> nantis pour la pratique d’une<br />
production intégrée moderne, constitue<br />
aujourd’hui dans <strong>le</strong> pays une grande<br />
menace foncière cultivab<strong>le</strong>, car ces<br />
derniers achètent <strong>le</strong>s champs mais aussi<br />
menacent certaines réserves du pays.<br />
- Conditions de travail peu gratifiantes<br />
Les productrices agrico<strong>le</strong>s déploient une<br />
intense activité tout au long de l’année.<br />
Toutes ces activités sont accomplies<br />
selon <strong>le</strong>s métho<strong>des</strong> traditionnel<strong>le</strong>s peu<br />
performantes. El<strong>le</strong>s n’utilisent pas d’outils<br />
ou machines modernes. El<strong>le</strong>s se servent de<br />
peu d’intrants dont <strong>le</strong>s coûts sont hors de<br />
<strong>le</strong>ur portée. El<strong>le</strong>s ne bénéficient que d’une<br />
très faib<strong>le</strong> proportion d’encadrement, de<br />
formations <strong>et</strong> d’informations. Par rapport<br />
à l’amélioration <strong>des</strong> terres, <strong>le</strong> RGAC relève<br />
que 55,4% <strong>des</strong> productrices ne font<br />
aucune amélioration; 5,6% seu<strong>le</strong>ment <strong>des</strong><br />
<strong>femmes</strong> font <strong>le</strong> labour avec enfouissement<br />
de matière organique (13,3% chez <strong>le</strong>s<br />
hommes); 20,7% améliorent avec la<br />
fumure de fonds.<br />
- Une division socia<strong>le</strong> inéga<strong>le</strong> du travail<br />
Pendant la période <strong>des</strong> cultures la femme<br />
est tenue de travail<strong>le</strong>r quatre à cinq jours<br />
sur <strong>le</strong> champ familial, ne travaillant sa<br />
<strong>par</strong>cel<strong>le</strong> que deux ou trois jours <strong>par</strong> semaine<br />
<strong>par</strong>ticulièrement chez <strong>le</strong>s Haussa; mais<br />
el<strong>le</strong> a la possibilité de se faire aider <strong>par</strong> ses<br />
enfants. D’autre <strong>par</strong>t, ayant la charge <strong>des</strong><br />
tâches domestiques, el<strong>le</strong> ne peut pas avoir<br />
<strong>le</strong> même temps de travail sur <strong>le</strong>s champs<br />
que <strong>le</strong>s hommes. Parfois <strong>le</strong>s corvées d’eau<br />
de longues distance ou longues attentes<br />
sont imposées aux <strong>femmes</strong>. Le bois de<br />
chauffe devient de plus en plus rare à cause<br />
de la déforestation. Ainsi, la ressource<br />
temps est précieuse pour <strong>le</strong>s productrices.<br />
- Aide financière aléatoire <strong>et</strong> peu consistante<br />
Les revenus tirés de <strong>le</strong>ur travail sont si<br />
minimes que <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> qui s’adonnent au<br />
travail de la terre ont besoin d’appoints si<br />
61
3. ANALySE DES fACTEURS D’INSECURITE ALImENTAIRE ET DES STRATEGIES DES fEmmES<br />
pOUR UNE SECURITE ALImENTAIRE<br />
el<strong>le</strong>s désirent émerger <strong>et</strong> évoluer. Or ceuxci<br />
ne peuvent provenir que <strong>des</strong> emprunts.<br />
Les structures financières classiques<br />
n’offrent pas de services aux opérateurs<br />
économiques dépourvus d’é<strong>par</strong>gne ou de<br />
garanties. Les dossiers de prêt <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
qui travail<strong>le</strong>nt la terre, pour c<strong>et</strong>te raison,<br />
ne sont pas bancab<strong>le</strong>s dans <strong>le</strong>ur grande<br />
majorité. Il y a eu <strong>des</strong> actions d’appui<br />
aux producteurs/productrices, mais<br />
malheureusement, à cause de la mauvaise<br />
gouvernance, el<strong>le</strong>s n’étaient pas adaptées<br />
aux capacités <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> en général<br />
aux pauvres. L’offre reste limitée du coté<br />
<strong>des</strong> Institutions de la Micro-Finance. Les<br />
chefs de ménage <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> hommes sont<br />
dans <strong>le</strong> cerc<strong>le</strong> vicieux <strong>des</strong> usuriers créant<br />
ainsi une dépendance, un end<strong>et</strong>tement<br />
chronique.<br />
- Analphabétisme<br />
Avec un taux d’analphabétisme de 88%<br />
chez <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong>, cel<strong>le</strong>s-ci sont limitées<br />
<strong>par</strong> rapport à l’accès aux informations pour<br />
renforcer <strong>et</strong>/ou améliorer <strong>le</strong>urs pratiques.<br />
Il existe aujourd’hui <strong>des</strong> plateformes<br />
paysannes, <strong>des</strong> cadres de prise de décision<br />
sur <strong>le</strong> secteur, mais où la <strong>par</strong>ticipation <strong>des</strong><br />
<strong>femmes</strong> rura<strong>le</strong>s reste limitée.<br />
- Non valorisation <strong>des</strong> capacités <strong>et</strong><br />
responsabilités <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
Les encadreurs de proj<strong>et</strong>s ne considèrent<br />
pas <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> comme <strong>des</strong> productrices<br />
au même titre que <strong>le</strong>s hommes. El<strong>le</strong>s sont<br />
<strong>par</strong>fois exclues <strong>des</strong> formations <strong>et</strong> <strong>le</strong>urs<br />
préoccupations ne sont pas prises en<br />
compte, en se disant qu’el<strong>le</strong>s vont trouver<br />
la solution auprès <strong>des</strong> hommes. C<strong>et</strong>te<br />
situation suscite <strong>des</strong> questionnements sur<br />
<strong>le</strong> rô<strong>le</strong> <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> dans <strong>le</strong>s différentes<br />
organisations paysannes ainsi que dans<br />
<strong>des</strong> cadres d’orientation comme <strong>le</strong>s<br />
plateformes paysannes <strong>et</strong> <strong>le</strong>s commissions<br />
foncières à tous <strong>le</strong>s niveaux. El<strong>le</strong>s sont<br />
présentes <strong>par</strong>ce que <strong>le</strong>s bail<strong>le</strong>urs l’ont<br />
exigé ou <strong>par</strong>ce que c’est un eff<strong>et</strong> de mode<br />
mais pas <strong>par</strong>ce que <strong>le</strong>s encadreurs <strong>et</strong><br />
<strong>le</strong>s hommes reconnaissent l’apport <strong>des</strong><br />
<strong>femmes</strong> dans la production.<br />
Les <strong>femmes</strong> sont peu présentes sur <strong>le</strong><br />
circuit du marché, ce qui limite <strong>le</strong>urs<br />
capacités en matière de commercialisation<br />
<strong>des</strong> produits.<br />
• Les muLtipLes conséquences de<br />
ces inégaLités<br />
Les caprices de la nature <strong>et</strong> <strong>le</strong>s inégalités<br />
de genre influencent fortement la situation<br />
socio-économique du Niger. A cela<br />
s’ajoutent aussi <strong>le</strong>s grands changements<br />
mondiaux car <strong>le</strong> pays est importateur sur<br />
<strong>le</strong> plan alimentaire.<br />
Une déféminisation de l’agriculture<br />
en cours<br />
Les terres cultivab<strong>le</strong>s se faisant de plus<br />
en plus rares, <strong>le</strong>s hommes utilisent tous<br />
<strong>le</strong>s prétextes, surtout religieux, pour<br />
ne pas prêter de lopins aux <strong>femmes</strong>.<br />
L’argumentaire tourne autour du «repos»,<br />
traduisant la claustration <strong>des</strong> jeunes<br />
<strong>femmes</strong>. Même cel<strong>le</strong>s qui sont cheffes<br />
de ménage <strong>par</strong> veuvage sont obligées de<br />
lutter pour ne pas être expulsées. «Sans<br />
<strong>le</strong>s activités agrico<strong>le</strong>s, nous croulons<br />
sous l’extrême pauvr<strong>et</strong>é» répètent<br />
régulièrement <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong>. Les <strong>femmes</strong><br />
vont à la recherche <strong>des</strong> terres lointaines,<br />
ce qui accroît <strong>le</strong>urs charges, <strong>et</strong> <strong>par</strong>fois<br />
<strong>le</strong>s place dans <strong>des</strong> situations de risques<br />
(vio<strong>le</strong>nces, infraction à la loi <strong>par</strong> manque<br />
62
d’information lorsqu’el<strong>le</strong>s tombent sur<br />
<strong>des</strong> aires de pâturages). C<strong>et</strong>te violation<br />
<strong>des</strong> droits <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>, constitue une <strong>des</strong><br />
principa<strong>le</strong>s causes d’insécurité alimentaire<br />
que connaissent la majorité <strong>des</strong> ménages<br />
ruraux. Comment assurer la survie <strong>des</strong><br />
membres du ménage dont el<strong>le</strong>s ont la<br />
charge pendant <strong>le</strong>s huit ou neuf mois de<br />
l’année ?<br />
Les crises alimentaires<br />
Le Somm<strong>et</strong> mondial de l’alimentation<br />
(Rome, 1996) a défini que la sécurité<br />
alimentaire existe lorsque tous <strong>le</strong>s êtres<br />
humains ont, à tout moment, un accès<br />
physique <strong>et</strong> économique à une nourriture<br />
suffisante, saine <strong>et</strong> nutritive <strong>le</strong>ur perm<strong>et</strong>tant<br />
de satisfaire <strong>le</strong>urs besoins énergétiques <strong>et</strong><br />
<strong>le</strong>urs préférences alimentaires pour mener<br />
une vie saine <strong>et</strong> active. La faim est un état<br />
immédiat, l’insécurité alimentaire est une<br />
expérience <strong>et</strong> un processus comportant<br />
une suite d’évènements.<br />
Le Niger a connu plusieurs crises<br />
alimentaires, mais limitons-nous à cel<strong>le</strong>s<br />
de 2005, une crise qui a été fortement<br />
médiatisée malgré <strong>le</strong> refus <strong>des</strong> autorités<br />
du pays. La crise alimentaire de 2005<br />
a aggravé la pauvr<strong>et</strong>é dans toutes ses<br />
dimensions. Les conditions de vie <strong>des</strong><br />
populations se sont n<strong>et</strong>tement détériorées<br />
en milieu rural comme urbain. Depuis<br />
la situation empire avec <strong>le</strong>s déficits<br />
alimentaires annoncés pour l’année 2009,<br />
causant <strong>le</strong>s évènements suivants :<br />
• La rar<strong>et</strong>é <strong>des</strong> aliments de base incite à<br />
la spéculation.<br />
• La hausse <strong>des</strong> prix : <strong>le</strong>s prix <strong>des</strong> différentes<br />
céréa<strong>le</strong>s constituant l’alimentation de<br />
base <strong>des</strong> Nigériens, ne cessent d’augmenter.<br />
La hausse <strong>des</strong> prix <strong>des</strong> aliments<br />
de base se répercute vite sur toutes <strong>le</strong>s<br />
denrées alimentaires, vestimentaires<br />
<strong>et</strong> autres, c’est la cherté de la vie,<br />
conduisant plusieurs ménages à ne pas<br />
pouvoir disposer <strong>des</strong> trois repas de la<br />
journée (cas d’un repas dans la journée<br />
mais d’autres jours, sans poser <strong>le</strong>ur<br />
propre marmite).<br />
• L’accès aux aliments de base devient<br />
diffici<strong>le</strong>, pas de disponibilité sur <strong>le</strong>s<br />
marchés.<br />
• L’insécurité alimentaire gagnant<br />
de plus en plus de ménages engendre<br />
plusieurs évènements : instabilité dans<br />
<strong>le</strong> ménage avec <strong>le</strong> dé<strong>par</strong>t en exode du<br />
mari <strong>et</strong> qui revient avec <strong>le</strong> VIH/SIDA.<br />
Ce sont surtout <strong>le</strong>s jeunes <strong>femmes</strong><br />
qui en <strong>par</strong><strong>le</strong>nt; avec <strong>le</strong>s risques de<br />
contamination, <strong>le</strong> dé<strong>par</strong>t du mari<br />
n’est plus un engouement pour el<strong>le</strong>s.<br />
En l’absence du mari, la femme se fragilise<br />
<strong>et</strong> s’adonne à la recherche de nourriture<br />
pour ses enfants, encourant <strong>le</strong> risque<br />
du VIH (<strong>par</strong>fois exode temporaire).<br />
L’incapacité de la mère à nourrir ses<br />
enfants fait surgir la malnutrition, ce<br />
qui contribue à l’accroissement du taux<br />
de mortalité infanti<strong>le</strong> (81% en 2006).<br />
L’accroissement du taux de mortalité<br />
maternel<strong>le</strong>, la non scolarisation ou<br />
déscolarisation <strong>des</strong> enfants, <strong>le</strong> mariage<br />
forcé <strong>et</strong> précoce, l’exploitation <strong>des</strong><br />
enfants (cas de mise en place auprès<br />
d’un marabout pour la connaissance<br />
<strong>et</strong> l’apprentissage religieux) entrainent<br />
la mendicité dans <strong>le</strong>s gran<strong>des</strong> vil<strong>le</strong>s<br />
du pays. Les conflits entre é<strong>le</strong>veurs <strong>et</strong><br />
agriculteurs ne sont pas é<strong>par</strong>gnés.<br />
• La vie chère peut entrainer l’instabilité<br />
politique : la crise de 2005 a créé un<br />
mouvement citoyen nigérien. Suite à<br />
l’adoption de la loi de finances 2005 <strong>par</strong><br />
<strong>le</strong> <strong>par</strong><strong>le</strong>ment, <strong>le</strong>s ONG de défense <strong>des</strong><br />
63
3. ANALySE DES fACTEURS D’INSECURITE ALImENTAIRE ET DES STRATEGIES DES fEmmES<br />
pOUR UNE SECURITE ALImENTAIRE<br />
droits <strong>des</strong> consommateurs se sont organisées<br />
pour créer une coalition Equité/<br />
qualité contre la vie chère au Niger, qui<br />
a vu l’adhésion de toutes <strong>le</strong>s centra<strong>le</strong>s<br />
syndica<strong>le</strong>s du pays. Le lancement <strong>des</strong><br />
activités de c<strong>et</strong>te coalition a été fait <strong>le</strong><br />
15 mars 2005, accompagné d’une forte<br />
mobilisation nationa<strong>le</strong> autour de la lutte<br />
contre la vie chère. La coalition est active<br />
dans <strong>le</strong> pays, malgré ses faib<strong>le</strong>s<br />
moyens; el<strong>le</strong> joue son rô<strong>le</strong> d’interface<br />
entre <strong>le</strong>s consommatrices/consommateurs<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong> gouvernement. C<strong>et</strong>te prise de<br />
conscience a lancé <strong>le</strong>s débats sur <strong>le</strong> droit<br />
à l’alimentation, qui n’a pas de loi dans<br />
la Constitution. Un consortium d’ONG<br />
est né, comprenant <strong>des</strong> organisations<br />
de défense <strong>des</strong> droits de l’homme <strong>et</strong><br />
<strong>des</strong> organisations de producteurs/productrices<br />
(ANDDH, Alternatives, AREN,<br />
MOORIBEN <strong>et</strong> TIMIDRIA), il organise<br />
<strong>des</strong> actions de sensibilisation auprès <strong>des</strong><br />
communautés, <strong>des</strong> plaidoyers, car il a<br />
déjà réalisé ne proposition de loi à intégrer<br />
dans la Constitution du pays.<br />
• Le Gouvernement, avec l’appui <strong>des</strong><br />
<strong>par</strong>tenaires, a mis en place un dispositif<br />
de coordination <strong>et</strong> de suivi de la situation<br />
alimentaire du pays, qui a été renforcé<br />
avec la crise de 2005. C<strong>et</strong>te situation<br />
a favorisé l’installation d’une véritab<strong>le</strong><br />
économie de l’aide d’urgence, annulant<br />
souvent <strong>le</strong>s acquis de développement<br />
de longue ha<strong>le</strong>ine.<br />
La flambée <strong>des</strong> prix <strong>des</strong> aliments de base<br />
pénalise toute la population défavorisée<br />
avec pour conséquence, un end<strong>et</strong>tement<br />
majeur <strong>des</strong> ménages, <strong>par</strong>ticulièrement<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> qui ont la charge de la survie<br />
quotidienne du ménage. La crise a aussi<br />
rendu l’accès <strong>des</strong> pauvres aux services<br />
de santé diffici<strong>le</strong> voire impossib<strong>le</strong>. Les<br />
conditions de vie <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> se sont<br />
<strong>par</strong>ticulièrement dégradées du fait de<br />
<strong>le</strong>ur faib<strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> <strong>des</strong><br />
ménages avec <strong>des</strong> conséquences néfastes<br />
sur la santé <strong>des</strong> enfants.<br />
• p ropositions de pistes<br />
D’ACTIONS<br />
• Réaliser <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> <strong>et</strong> analyses <strong>des</strong><br />
coutumes du pays afin de <strong>le</strong>s adapter<br />
aux besoins actuels <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>. Ce<br />
travail pourrait aussi aider <strong>le</strong> processus<br />
d’élaboration du code de statut de la<br />
famil<strong>le</strong>.<br />
• Disposer de données de base fiab<strong>le</strong>s <strong>et</strong><br />
désagrégées, ceci constitue un point de<br />
dé<strong>par</strong>t essentiel pour une gouvernance<br />
équitab<strong>le</strong> du secteur développement<br />
rural. Le gouvernement vient de faire<br />
un pas avec <strong>le</strong> Recensement Général de<br />
l’Agriculture <strong>et</strong> du Cheptel. Il faudrait<br />
penser à <strong>le</strong> renforcer <strong>par</strong> <strong>des</strong> analyses<br />
qualitatives de genre pour aborder <strong>le</strong>s<br />
différentes dimensions au niveau d’une<br />
exploitation familia<strong>le</strong>. La constitution de<br />
c<strong>et</strong>te base de données doit être conjuguée<br />
avec un monitoring régulier.<br />
• Echanger <strong>le</strong>s expériences <strong>et</strong> <strong>le</strong> savoir<br />
pour soutenir <strong>et</strong> valoriser la contribution<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> en matière de sécurité<br />
alimentaire. Ce qui nécessite la prise<br />
en compte de la capitalisation dès la<br />
conception d’un proj<strong>et</strong>/programme.<br />
Utiliser <strong>le</strong>s moyens modernes de<br />
communication comme <strong>le</strong>s radios<br />
communautaires, car ils perm<strong>et</strong>tent<br />
d’échanger un savoir-faire local avec<br />
d’autres réseaux <strong>et</strong> sont aussi une<br />
possibilité de donner l’occasion aux<br />
«sans voix», c’est-à-dire en <strong>par</strong>ticulier<br />
<strong>le</strong>s <strong>femmes</strong>, de s’exprimer.<br />
• Soutenir <strong>des</strong> actions de création <strong>et</strong> de<br />
64
enforcement <strong>des</strong> compétences féminines<br />
<strong>et</strong> masculines en genre, pour multiplier<br />
la sensibilité dans l’encadrement, la<br />
formation <strong>et</strong> <strong>le</strong> suivi <strong>des</strong> producteurs/<br />
productrices. Pour plus d’efficacité,<br />
conjuguer avec un accompagnement<br />
pratique <strong>des</strong> <strong>par</strong>tenaires (services<br />
étatiques, société civi<strong>le</strong>). La prise en<br />
compte de la dimension genre exige <strong>des</strong><br />
compétences, <strong>des</strong> outils <strong>et</strong> <strong>des</strong> moyens<br />
financiers.<br />
• Appliquer <strong>le</strong>s quotas sur <strong>le</strong>s surfaces<br />
irriguées pour en faciliter l’accès aux<br />
<strong>femmes</strong>.<br />
• Développer d’avantage d’actions d’appui<br />
financier adaptées aux capacités <strong>et</strong><br />
conditions <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> (ex: système de<br />
warrantage).<br />
• Soutenir <strong>le</strong>s productrices sur toute la<br />
chaîne de production (exploitation,<br />
transformation/conservation <strong>et</strong> commercialisation)<br />
sur <strong>le</strong>s deux secteurs,<br />
agriculture <strong>et</strong> é<strong>le</strong>vage.<br />
• Renforcer <strong>le</strong>s capacités <strong>des</strong> productrices<br />
au sein <strong>des</strong> différentes organisations<br />
paysannes <strong>et</strong> à tous <strong>le</strong>s niveaux, en vue<br />
de <strong>le</strong>ur autonomisation.<br />
• Soutenir <strong>le</strong>s actions <strong>des</strong> organisations<br />
pour la défense du droit à l’alimentation<br />
<strong>et</strong> la lutte contre la vie chère.<br />
BIBLIOGRAPhIE<br />
Diarra M. <strong>et</strong> Monimart M. (2006), «Femmes<br />
sans terre, <strong>femmes</strong> sans repères ? Genre,<br />
foncier <strong>et</strong> décentralisation au Niger», IIED,<br />
dossier n° 143.<br />
Kadi Oumarou M., Président du Col<strong>le</strong>ctif<br />
pour la défense du droit à l’Energie,<br />
membre coalition Equité/Qualité au Niger,<br />
«Les raisons de la colère, rapport de la<br />
mobilisation de lutte sur la vie chère au<br />
Niger».<br />
Institut National de la Statistique (INS)<br />
(2007), «Rapport national sur <strong>le</strong>s progrès<br />
vers l’atteinte <strong>des</strong> OMD au Niger».<br />
Institut National de la Statistique (INS)<br />
(2008), «Recensement Général de<br />
l’Agriculture <strong>et</strong> du Cheptel au Niger».<br />
Ministère du Développement de l’Agriculture<br />
(2009), «Rapport d’évaluation de la campagne<br />
2008-2009 <strong>et</strong> résultats définitifs».<br />
Ministère de la Promotion de la Femme<br />
<strong>et</strong> de la Protection de l’Enfant (2008),<br />
«Politique Nationa<strong>le</strong> de Genre».<br />
Rapport d’atelier FAO-Dimitra (2008),<br />
«Accès à la terre en milieu rural en Afrique:<br />
stratégies de lutte contre <strong>le</strong>s inégalités de<br />
genre».<br />
65
3. ANALySE DES fACTEURS D’INSECURITE ALImENTAIRE ET DES STRATEGIES DES fEmmES<br />
pOUR UNE SECURITE ALImENTAIRE<br />
3.3 LES INTERDITS ALIMENTAIRES EN RéPUBLIQUE<br />
DéMOCRATIQUE DU CONGO<br />
françoise KAT KAmBOL<br />
Qu’il nous soit de prime abord permis<br />
de remercier la CFD qui nous a invités à<br />
venir <strong>par</strong>tager <strong>le</strong>s premiers résultats de<br />
l’enquête que nous avons menée sur <strong>le</strong>s<br />
interdits alimentaires chez la femme enceinte<br />
dans trois institutions hospitalières<br />
(Cliniques Universitaires, Centre de Santé<br />
Bongonga, Hôpital Général de Référence<br />
de la Katuba) fonctionnant dans la vil<strong>le</strong> de<br />
Lubumbashi, province du Katanga.<br />
Notre contribution à ce séminaire axé sur<br />
la sécurité alimentaire s’articu<strong>le</strong> autour de<br />
la thématique «Interdits alimentaires chez<br />
la femme enceinte <strong>et</strong> sécurité alimentaire».<br />
Outre l’introduction <strong>et</strong> la conclusion, notre<br />
communication est subdivisée en quatre<br />
<strong>par</strong>ties, <strong>le</strong>s unes <strong>et</strong> <strong>le</strong>s autres s’articulant<br />
comme suit :<br />
- la première <strong>par</strong>tie planchera sur l’aperçu<br />
géographique de la province du Katanga;<br />
- la deuxième, quant à el<strong>le</strong>, sera axée sur<br />
<strong>le</strong>s interdits alimentaires;<br />
- la présentation <strong>des</strong> premiers résultats de<br />
l’enquête menée sur <strong>le</strong>s interdits alimentaires<br />
chez la femme enceinte bouc<strong>le</strong>ra<br />
la troisième <strong>par</strong>tie;<br />
- <strong>et</strong> enfin, la quatrième est inhérente à<br />
l’examen de la thématique «femme enceinte,<br />
sécurité alimentaire, interdits alimentaires<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong>urs conséquences sur la<br />
santé.<br />
• a perçu géographique de La<br />
pROvINCE DU KATANGA<br />
Le Katanga est l’une <strong>des</strong> onze provinces<br />
de la République Démocratique du Congo.<br />
El<strong>le</strong> a une superficie de 496.877 km². Sa<br />
population est estimée à 105.228.338 hab.<br />
El<strong>le</strong> est limitée <strong>par</strong> :<br />
- à l’Est : la rivière Luapula, <strong>le</strong> lac Moero<br />
qui nous sé<strong>par</strong>e de la République de la<br />
Zambie;<br />
- au Sud -Est : la République de la Zambie;<br />
- au Sud- Ouest : la République d’Angola;<br />
- au Nord –Ouest : la rivière Lulua, la<br />
rivière Lubilanji <strong>et</strong> <strong>le</strong>s deux Kasaï;<br />
- au Nord –Est : <strong>le</strong> lac Tanganyika qui<br />
nous sé<strong>par</strong>e de la République de la<br />
Zambie, un peu plus au nord;<br />
- au Nord : <strong>le</strong>s provinces du Sud Kivu <strong>et</strong><br />
<strong>le</strong> Maniema.<br />
Sur <strong>le</strong> plan administratif, la province<br />
compte quatre districts, vingt-deux territoires,<br />
trois vil<strong>le</strong>s <strong>et</strong> trente <strong>et</strong> une cités.<br />
Nous signalons en passant que Lubumbashi<br />
est la deuxième vil<strong>le</strong> de la RDC en<br />
termes d’importance, la première étant<br />
bien entendu Kinshasa.<br />
• Les interdits aLimentaires<br />
La tradition africaine reconnaît l’existence<br />
de nombreux interdits imposés à tous <strong>le</strong>s<br />
membres de la communauté. Ces interdits<br />
accompagnent l’homme de la naissance à<br />
la mort, déterminent toute la vie humaine,<br />
<strong>et</strong> risqueraient même de la prendre en<br />
otage.<br />
En eff<strong>et</strong>, ces restrictions règ<strong>le</strong>nt la vie<br />
quotidienne. Et dans la plu<strong>par</strong>t <strong>des</strong> cas, <strong>le</strong>s<br />
individus s’y conforment malgré eux. Ceci<br />
se vérifie aussi bien dans <strong>le</strong>urs relations<br />
avec <strong>le</strong>s autres hommes qu’avec <strong>le</strong>ur<br />
milieu ambiant (Bolakang, 1989).<br />
Ces interdits sont une réponse aux exigences<br />
d’un environnement socioculturel<br />
bien déterminé. Celui-ci se transm<strong>et</strong> de<br />
père en fils, de mère en fil<strong>le</strong>, bref de génération<br />
en génération. La transgression<br />
<strong>par</strong> un individu <strong>des</strong> interdits alimentaires<br />
66
entrainerait <strong>des</strong> conséquences non seu<strong>le</strong>ment<br />
pour lui, mais aussi pour toute la<br />
communauté.<br />
Ainsi, <strong>le</strong>s interdits alimentaires frappent<br />
<strong>par</strong>ticulièrement <strong>le</strong>s enfants, <strong>le</strong>s jeunes<br />
fil<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong>, <strong>par</strong>ticulièrement <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> enceintes <strong>et</strong> allaitantes, <strong>le</strong>s chasseurs,<br />
<strong>le</strong>s pêcheurs, <strong>le</strong>s guerriers, <strong>le</strong>s chefs<br />
coutumiers <strong>et</strong>c. Les interdits alimentaires<br />
chez <strong>le</strong>s hommes sont liés à <strong>le</strong>ur profession,<br />
à <strong>le</strong>ur pouvoir, <strong>et</strong>c., tandis que ceux<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> sont liés à <strong>le</strong>ur état physiologique<br />
(biologique) (Kapend, 2010).<br />
Dans la présente communication, nous<br />
n’avons nul<strong>le</strong>ment la prétention de <strong>par</strong><strong>le</strong>r<br />
de tous <strong>le</strong>s interdits alimentaires existant<br />
dans la société africaine en général <strong>et</strong> en<br />
République Démocratique du Congo. Notre<br />
attention sera focalisée sur <strong>le</strong>s interdits<br />
alimentaires que <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> enceintes<br />
issues <strong>des</strong> différents groupes <strong>et</strong>hniques<br />
de la RDC <strong>et</strong> vivant au Katanga observent<br />
dans la vil<strong>le</strong> de Lubumbashi.<br />
Présentation <strong>des</strong> résultats de l’enquête<br />
Les interdits alimentaires que nous présentons<br />
ici comme illustrations proviennent de<br />
l’enquête que nous avons menée auprès<br />
<strong>des</strong> 168 <strong>femmes</strong> enceintes qui venaient<br />
en consultation prénata<strong>le</strong> dans trois formations<br />
hospitalières citées ci-<strong>des</strong>sus.<br />
A la question de savoir quels sont <strong>le</strong>s aliments<br />
à éviter pendant la période de <strong>le</strong>ur<br />
grossesse, <strong>le</strong>s réponses se sont articulées<br />
comme suit : <strong>le</strong>s unes confirment <strong>le</strong> fait<br />
qu’el<strong>le</strong>s agissent conformément à la coutume,<br />
tandis que <strong>le</strong>s autres sont influencées<br />
<strong>par</strong> <strong>le</strong> qu’en-dira-t-on véhiculé <strong>par</strong> <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> d’une <strong>par</strong>t, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> enceintes<br />
d’autre <strong>par</strong>t, dans <strong>le</strong>ur milieu ambiant <strong>et</strong><br />
au dispensaire lors <strong>des</strong> séances de consultation<br />
prénata<strong>le</strong>.<br />
Les tab<strong>le</strong>aux 1 <strong>et</strong> 2 présentent <strong>le</strong>s différents<br />
aliments interdits à la femme enceinte au<br />
Katanga, <strong>le</strong>urs noms scientifiques, <strong>le</strong>urs noms<br />
vernaculaires <strong>et</strong> l’explication de l’interdiction.<br />
TABLEAU 1. Aliments végétaux interdits à la femme enceinte<br />
N° Nom Aliment Nom vernaculaire Explication<br />
1 Oseil<strong>le</strong> Ngai ngai La femme va tremb<strong>le</strong>r lors de l’accouchement<br />
<strong>et</strong> aura <strong>des</strong> convulsions<br />
2 Piment Pili-pili L’enfant aura <strong>des</strong> problèmes d’yeux<br />
3 Cucurbitacée Bibwaba L’enfant va commencer à trop <strong>par</strong><strong>le</strong>r<br />
4 Aubergine Nyanya Hémorroï<strong>des</strong><br />
5 Manioc Moko Beaucoup de sécrétions vagina<strong>le</strong>s <strong>et</strong><br />
possibilité d’un avortement<br />
6 Arachide Kalanga Beaucoup de sécrétions vagina<strong>le</strong>s<br />
7 Soja Soya Poids exagéré de l’enfant<br />
8 Patate douce Bilashi Poids exagéré de l’enfant<br />
67
3. ANALySE DES fACTEURS D’INSECURITE ALImENTAIRE ET DES STRATEGIES DES fEmmES<br />
pOUR UNE SECURITE ALImENTAIRE<br />
TABLEAU 1 (suite). Aliments végétaux interdits à la femme enceinte<br />
N° Nom Aliment Nom vernaculaire Explication<br />
9 Feuil<strong>le</strong> de manioc Sombe L’enfant aura un mauvais esprit<br />
10 Feuil<strong>le</strong> de patate<br />
douce<br />
Matembe<strong>le</strong><br />
L’enfant aura <strong>des</strong> dou<strong>le</strong>urs au ventre<br />
11 Canne à sucre Muwa Eruption cutanée<br />
12 Maïs gril<strong>le</strong> Mihindi ya ku kalanga L’enfant aura tendance à trop p<strong>le</strong>urer<br />
13 Basilic sauvage La femme aura <strong>des</strong> maux de ventre à<br />
l’accouchement<br />
14 Tshilibwalwenyi Peut entrainer la folie chez la femme<br />
15 Légumes verts Bilombolombo, Koni<br />
mutenyela, Tshikota<br />
Provoque l’avortement. L’enfant peut<br />
naître prématuré<br />
16 Igname Kihama R<strong>et</strong>arde l’accouchement<br />
TABLEAU 2. Aliments animaux interdits à la femme enceinte<br />
N° Nom Aliment Nom vernaculaire Explication<br />
1 Viande de Chien Nyama ya imbwa Apporte de la malchance<br />
2 Viande de Chat Nyama ya Punchi Apporte de la malchance<br />
3 Viande du Chacal Nyama ya imbwa ya pori Apporte de la malchance<br />
4 Œuf Mayayi L’enfant naitra sans cheveux<br />
5 Viande de singe Nyama ya ya Makaka Grimaces <strong>et</strong> turbu<strong>le</strong>nce chez l’enfant<br />
6 Viande de porc Nyama ya Ngulube La femme n’aura pas faci<strong>le</strong>ment de<br />
contractions (contractions <strong>le</strong>ntes)<br />
7 Crocodi<strong>le</strong> Mamba L’enfant naîtra avec <strong>des</strong> écail<strong>le</strong>s sur<br />
tout son corps<br />
8 Hippopotame Kiboko Respiration diffici<strong>le</strong><br />
9 Civ<strong>et</strong>te La femme enceinte peut avoir ses<br />
règ<strong>le</strong>s<br />
10 Hibou Nfuifi L’enfant aura <strong>des</strong> mauvais rêves<br />
11 Goril<strong>le</strong> Makaka Animal sacré qu’il ne faut manger. C’est<br />
un animal pour <strong>le</strong>s rituels<br />
68
TABLEAU 2 (suite). Aliments animaux interdits à la femme enceinte<br />
N° Nom Aliment Nom vernaculaire Explication<br />
12 Escargot (mou<strong>le</strong>) Kikolokofyo Raison culturel<strong>le</strong><br />
13 Chenil<strong>le</strong> Bilulu L’enfant aura un caractère caché<br />
14 Lapin Kalulu L’enfant naîtra avec <strong>des</strong> gran<strong>des</strong><br />
oreil<strong>le</strong>s<br />
15 Agneau Nkondolo L’enfant aura <strong>des</strong> lèvres rouges<br />
16 Tortue Bandakwe L’enfant sera hypocrite<br />
17 Antilope Kasha L’enfant aura <strong>des</strong> démangeaisons<br />
18 Sanglier Phacochère L’enfant sera mendiant ou vo<strong>le</strong>ur<br />
19 Pintade Kanga L’enfant sera un grand <strong>par</strong><strong>le</strong>ur<br />
20 Vache Ngombe P<strong>et</strong>its boutons rougeâtres sur <strong>le</strong> corps<br />
de l’enfant<br />
21 Varan Samba L’enfant aura tendance à gratter ses<br />
amis<br />
22 Gué<strong>par</strong>d Pas de dents chez l’enfant<br />
23 Rat de Gambie Pombofuko La femme aura <strong>des</strong> difficultés lors de<br />
l’accouchement<br />
24 Boa Moma Ressemblance avec un serpent<br />
25 Silure Kabamba<strong>le</strong> Fragilité <strong>des</strong> os de l’enfant<br />
26 Canard Mbata L’enfant ne sera pas malin<br />
27 Écureuil Maigreur de l’enfant<br />
Il se dégage à travers ces interdits<br />
alimentaires, <strong>le</strong> souci vital qui anime <strong>le</strong>s<br />
africains de donner à l’être à venir une vie<br />
saine, garante d’une longévité largement<br />
souhaitée.<br />
D’après certaines croyances <strong>et</strong> coutumes,<br />
<strong>le</strong>s africains refusent toute ressemblance<br />
négative entre l’enfant attendu <strong>et</strong> tout<br />
autre animal ou végétal, c’est–à-dire qu’ils<br />
souhaitent voir chez l’enfant à venir un<br />
état de pur<strong>et</strong>é <strong>et</strong> presque de perfection.<br />
C’est là une preuve supplémentaire de<br />
la va<strong>le</strong>ur suprême qu’ils accordent à<br />
la <strong>des</strong>cendance <strong>et</strong> à la vie el<strong>le</strong>-même.<br />
Les interdits alimentaires relèvent de<br />
l’expression symbolique <strong>et</strong> sont souvent<br />
liés à la pensée religieuse. Ils sont<br />
l’expression de la représentation de<br />
l’ordre cosmique <strong>et</strong> doivent être compris<br />
comme <strong>des</strong> facteurs garantissant l’ordre<br />
social <strong>et</strong> celui de l’univers. (Tshise<strong>le</strong>ke<br />
Fehla Ndjinda T., 1986)<br />
69
3. ANALySE DES fACTEURS D’INSECURITE ALImENTAIRE ET DES STRATEGIES DES fEmmES<br />
pOUR UNE SECURITE ALImENTAIRE<br />
• f emme enceinte, sécurité<br />
aLimentaire, interdits<br />
ALImENTAIRES ET LEURS<br />
conséquences sur La santé.<br />
La FAO définit la sécurité alimentaire<br />
comme étant une situation tel<strong>le</strong> que chacun<br />
peut à tout moment avoir matériel<strong>le</strong>ment<br />
<strong>et</strong> économiquement accès à une<br />
alimentation sûre, nutritive <strong>et</strong> suffisante<br />
pour satisfaire ses préférences <strong>et</strong> besoins<br />
alimentaires <strong>et</strong> ainsi mener une vie active<br />
<strong>et</strong> saine.<br />
Malheureusement, il existe certaines<br />
croyances <strong>et</strong> coutumes qui empêchent la<br />
femme enceinte de consommer tel ou tel<br />
aliment nécessaire à sa santé <strong>et</strong> à cel<strong>le</strong> de<br />
l’enfant qu’el<strong>le</strong> porte en son sein.<br />
Femme enceinte <strong>par</strong> rapport à<br />
La sécurité<br />
alimentaire<br />
• A <strong>des</strong> besoins<br />
alimentaires très<br />
croissants surtout<br />
en qualité<br />
Interdits<br />
alimentaires<br />
• Distribution<br />
alimentaire<br />
inéga<strong>le</strong> au sein de<br />
la famil<strong>le</strong><br />
• Refus d’accès aux<br />
aliments de qualité<br />
<strong>et</strong> en quantité<br />
suffisantes<br />
répondant à ses<br />
besoins.<br />
Conséquences<br />
• Malnutrition<br />
• Affaiblissement<br />
• Mauvaise croissance du fœtus<br />
• Faib<strong>le</strong> ou manque d’immunité aux<br />
infections <strong>et</strong> maladies<br />
• Accouchement prématuré<br />
• Faib<strong>le</strong> poids de la mère <strong>et</strong> de l’enfant<br />
• Mortalité maternel<strong>le</strong> <strong>et</strong> infanti<strong>le</strong><br />
• A <strong>des</strong> préférences<br />
alimentaires instab<strong>le</strong>s<br />
<strong>et</strong> compliquées<br />
• Non respect<br />
<strong>des</strong> préférences<br />
alimentaires<br />
liées à son état<br />
physiologique<br />
• Malnutrition<br />
• Affaiblissement<br />
• Etc.<br />
70
CONCLUSION<br />
En conclusion, nous pouvons dire que<br />
tout interdit alimentaire quel que soit sa<br />
nature, son explication, est une violation<br />
du droit à l’alimentation tel que stipulé<br />
dans la Déclaration Universel<strong>le</strong> <strong>des</strong> Droits<br />
Humains en son artic<strong>le</strong> 25 «Toute personne<br />
a droit à un niveau de vie suffisant<br />
pour assurer sa santé <strong>et</strong> son bien-être<br />
ainsi que ceux de sa famil<strong>le</strong>…».<br />
C<strong>et</strong>te situation est encore plus grave pour<br />
la femme enceinte à cause de ses besoins<br />
<strong>et</strong> de ses préférences physiologiques. Les<br />
interdits alimentaires imposés à la femme<br />
enceinte posent un sérieux problème de<br />
santé dans la mesure où la plu<strong>par</strong>t <strong>des</strong><br />
aliments interdits sont riches en protéines,<br />
en fer <strong>et</strong> en vitamines. Bien plus, ils<br />
sont <strong>par</strong>mi <strong>le</strong>s plus disponib<strong>le</strong>s dans<br />
l’environnement physique <strong>et</strong> s’achètent<br />
<strong>par</strong>fois à bas prix.<br />
Il sied aussi de re<strong>le</strong>ver <strong>le</strong> fait que <strong>le</strong> taux<br />
d’analphabétisme étant é<strong>le</strong>vé <strong>par</strong>mi <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> enceintes qui sont victimes de<br />
ces interdits alimentaires, il <strong>le</strong>ur arrive<br />
de «gober» sans discernement toute<br />
information alimentaire relative à <strong>le</strong>ur<br />
état physiologique. Même certaines<br />
intel<strong>le</strong>ctuel<strong>le</strong>s observent scrupu<strong>le</strong>usement<br />
ces interdits au nom de la coutume.<br />
Eu égard à ce qui précède, il est<br />
impérieux d’organiser <strong>des</strong> campagnes de<br />
sensibilisation auprès <strong>des</strong> fil<strong>le</strong>s, <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>,<br />
<strong>des</strong> <strong>le</strong>aders traditionnels d’opinion pour un<br />
changement de comportement. Il importe<br />
aussi que <strong>le</strong>s infirmiers <strong>et</strong> infirmières qui<br />
assurent <strong>le</strong>s consultations prénata<strong>le</strong>s <strong>et</strong><br />
qui s’occupent de l’éducation nutritionnel<strong>le</strong><br />
puissent s’engager à aider <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
enceintes à opérer <strong>des</strong> changements dans<br />
<strong>le</strong>s habitu<strong>des</strong> alimentaires.<br />
BIBLIOGRAPhIE<br />
Bolakang, B. (1989), «Les tabous<br />
alimentaires chez <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> Sakata», in<br />
Anna<strong>le</strong>s Aequatori No 10, pp 25-35.<br />
Déclaration Universel<strong>le</strong> <strong>des</strong> droits humains<br />
Kapend M.B. (2010), «Communication sur<br />
Genre <strong>et</strong> Sécurité Alimentaire»,<br />
Tshise<strong>le</strong>ke fehla ndjinda T. (1986), «Les<br />
interdits relatifs à la femme chez <strong>le</strong>s Chokwe»,<br />
Zaïre-Afrique, no 2001, pp 149-257.<br />
www.france.org!spip.php%3F artic<strong>le</strong> 7479+<br />
71
4. EXEMPLES<br />
DE PRATIQUES ET<br />
STRATEGIES A LA BASE
4.1. L’ACCèS ET LE CONTRÔLE DES RESSOURCES PAR LES<br />
FEMMES : UN DéFI POUR LA SéCURITé ALIMENTAIRE<br />
Tiné Ndoye<br />
Vous me perm<strong>et</strong>trez d’abord de vous<br />
présenter <strong>le</strong> Réseau National <strong>des</strong> Femmes<br />
Rura<strong>le</strong>s du Sénégal que j’ai eu l’honneur<br />
de diriger. Ce réseau a été fondé en 2001<br />
dans <strong>le</strong> but de contribuer à la promotion<br />
du dialogue <strong>et</strong> de l’échange d’information<br />
entre <strong>le</strong>s organisations féminines de base,<br />
<strong>le</strong>s organisations d’appui, <strong>le</strong>s institutions<br />
de recherche <strong>et</strong> tous <strong>le</strong>s acteurs du<br />
développement en général, suite à la 1ère<br />
phase du proj<strong>et</strong> FAO-Dimitra.<br />
Le réseau comporte actuel<strong>le</strong>ment 130 organisations<br />
de base composées d’associations<br />
d’environ <strong>et</strong> chaque association comporte<br />
50 à 80 membres.<br />
L’atelier sous-régional donnera suite<br />
à l’atelier organisé <strong>par</strong> <strong>le</strong> Réseau <strong>des</strong><br />
Femmes Rura<strong>le</strong>s en février 2003 sur <strong>le</strong><br />
foncier, renforcé <strong>par</strong> un film documentaire<br />
«Accès <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> rura<strong>le</strong>s au foncier :<br />
entre lois <strong>et</strong> réalités».<br />
Entre autres recommandations, il fallait<br />
développer <strong>le</strong>s stratégies d’intégration <strong>des</strong><br />
<strong>femmes</strong> dans <strong>le</strong>s instances de décisions<br />
afin de pouvoir défendre <strong>le</strong>ur cause. Aussi,<br />
l’un <strong>des</strong> objectifs de l’atelier organisé <strong>par</strong><br />
<strong>le</strong>s radios communautaires <strong>et</strong> <strong>le</strong>s NTIC<br />
en avril 2005 sur <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> rura<strong>le</strong>s, a<br />
été de renforcer <strong>le</strong>s recommandations<br />
en ces termes : recueillir <strong>le</strong>s propositions<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> pour une meil<strong>le</strong>ure utilisation<br />
<strong>des</strong> radios qui favoriserait <strong>le</strong>ur accès<br />
à l’information <strong>et</strong> qui <strong>le</strong>ur offrirait une<br />
tribune d’expression <strong>et</strong> de communication.<br />
L’analyse de la place de la femme africaine<br />
dans la vie socio-économique de nos pays<br />
présente un intérêt majeur <strong>et</strong> stratégique.<br />
En eff<strong>et</strong>, malgré l’importance considérab<strong>le</strong><br />
de <strong>le</strong>ur nombre au sein de la population <strong>et</strong><br />
<strong>le</strong> rô<strong>le</strong> prépondérant qu’el<strong>le</strong>s jouent dans<br />
l’économie de notre pays, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
rura<strong>le</strong>s restent encore très insuffisamment<br />
impliquées dans <strong>le</strong>s politiques de<br />
développement <strong>et</strong> surtout, sont sousinformées.<br />
Le thème de la journée mondia<strong>le</strong> de<br />
l’alimentation de 1998 «<strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
nourrissent <strong>le</strong> monde» exprime toute<br />
l’importance de la contribution pluridimensionnel<strong>le</strong><br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> à l’agriculture<br />
<strong>et</strong> à la sécurité alimentaire. La production<br />
alimentaire est largement dans <strong>le</strong>s mains<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> (<strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> paysannes <strong>et</strong><br />
ouvrières sont responsab<strong>le</strong>s de 70% de<br />
c<strong>et</strong>te production. Dans <strong>le</strong>s régions <strong>le</strong>s<br />
plus pauvres <strong>des</strong> pays touchés <strong>par</strong> la<br />
faim, sept producteurs agrico<strong>le</strong>s sur dix<br />
sont <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>).<br />
• p robLèmes rencontrés <strong>par</strong> Les<br />
<strong>femmes</strong> en généraL<br />
Notre principal rô<strong>le</strong> est de défendre <strong>le</strong>s<br />
intérêts <strong>et</strong> l’amélioration <strong>des</strong> conditions<br />
d’existence <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> rura<strong>le</strong>s, non<br />
seu<strong>le</strong>ment au niveau de la localité, mais<br />
aussi à travers tout <strong>le</strong> territoire national,<br />
ce qui n’est pas du tout un travail aisé<br />
car <strong>le</strong> monde rural souffre de plusieurs<br />
manquements dans presque tous <strong>le</strong>s<br />
domaines.<br />
Accès à la terre <strong>et</strong> à la bonne terre<br />
L’absence de droit <strong>et</strong> de sécurité pour <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> concernant la terre est un <strong>des</strong><br />
obstac<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s plus sérieux à l’accroissement<br />
de la production ouvrière <strong>et</strong> <strong>des</strong> revenus<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> rura<strong>le</strong>s. De plus, l’accès inégal<br />
73
4. exempLes de pratiques <strong>et</strong> strategies a La base<br />
aux facteurs de production - dont la terre<br />
- est aussi un obstac<strong>le</strong> à l’accroissement<br />
de la production vivrière <strong>et</strong> <strong>des</strong> revenus de<br />
<strong>femmes</strong> rura<strong>le</strong>s.<br />
Le problème est encore plus diffici<strong>le</strong><br />
pour <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> veuves. Dans la plu<strong>par</strong>t<br />
<strong>des</strong> pays, selon <strong>le</strong>s systèmes fonciers<br />
traditionnels <strong>et</strong> <strong>le</strong>s lois coutumières, qui<br />
restent en vigueur malgré l’existence d’un<br />
droit moderne, la femme n’a pas <strong>le</strong> droit<br />
d’hériter <strong>des</strong> terres de son mari ou de<br />
son père. Les veuves sont donc exclues<br />
<strong>des</strong> systèmes de propriété de terres <strong>et</strong> ne<br />
peuvent pas fournir <strong>le</strong>s garanties exigées<br />
pour un prêt.<br />
Les <strong>femmes</strong> ont un droit d’usage régi<br />
<strong>par</strong> l’homme. El<strong>le</strong>s doivent compter sur<br />
<strong>le</strong>ur mari, frère(s) ou bel<strong>le</strong>-famil<strong>le</strong> pour<br />
obtenir une terre à cultiver. Les terres<br />
attribuées aux <strong>femmes</strong> <strong>par</strong> <strong>le</strong>s famil<strong>le</strong>s<br />
ou <strong>par</strong> la communauté sont généra<strong>le</strong>ment<br />
de piètre qualité, de surface réduite <strong>et</strong><br />
souvent éloignées <strong>des</strong> villages. Il faut<br />
noter qu’el<strong>le</strong>s n’ont souvent pas <strong>le</strong> droit,<br />
<strong>le</strong> temps ni <strong>le</strong>s moyens nécessaires d’y<br />
pratiquer <strong>des</strong> cultures commercia<strong>le</strong>s, ce<br />
qui limite sérieusement <strong>le</strong>urs revenus. Sur<br />
ces lopins de terres, el<strong>le</strong>s font pousser<br />
<strong>des</strong> cultures vivrières, nécessaires pour<br />
l’alimentation de la famil<strong>le</strong> <strong>et</strong> travail<strong>le</strong>nt<br />
aussi sans rémunération dans <strong>le</strong> champ de<br />
<strong>le</strong>ur mari.<br />
Dans bien <strong>des</strong> cas, <strong>le</strong> respect de ce droit<br />
dépend <strong>des</strong> disponibilités foncières <strong>et</strong> est<br />
soumis à la règ<strong>le</strong> fondamenta<strong>le</strong> d’affecter<br />
<strong>le</strong>s meil<strong>le</strong>ures terres aux chefs de famil<strong>le</strong>s<br />
en priorité.<br />
Quand la famil<strong>le</strong> s’agrandit <strong>et</strong> que <strong>le</strong>s<br />
terres doivent être redistribuées, <strong>le</strong> chef<br />
de famil<strong>le</strong> commence d’abord <strong>par</strong> amputer<br />
la <strong>par</strong>t <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>.<br />
Le droit d’usage de la terre est très<br />
précaire pour beaucoup de <strong>femmes</strong>.<br />
Traditionnel<strong>le</strong>ment, la femme occupe une<br />
place prépondérante dans l’agriculture<br />
sénégalaise. C’est el<strong>le</strong> qui s’occupe de la<br />
préservation <strong>des</strong> semences, <strong>des</strong> semis,<br />
de la récolte, qui pratique ses cultures<br />
de case (niébé, bissap, <strong>et</strong>c. jouant<br />
ainsi un rô<strong>le</strong> important dans la sécurité<br />
alimentaire de la famil<strong>le</strong>). En réalité, en<br />
milieu rural, c’est el<strong>le</strong> qui s’occupe de la<br />
chaîne alimentaire (de la production à la<br />
consommation) <strong>et</strong> qui pratique en plus<br />
<strong>des</strong> cultures vivrières.<br />
Force est donc est de constater qu’il y<br />
a une relation étroite entre la femme,<br />
l’agriculture <strong>et</strong> la sécurité alimentaire.<br />
Malgré c<strong>et</strong>te contribution à toutes <strong>le</strong>s<br />
activités de productions agrico<strong>le</strong>s <strong>et</strong> la<br />
sécurité alimentaire mondia<strong>le</strong>, <strong>des</strong> millions<br />
de <strong>femmes</strong> rura<strong>le</strong>s dans <strong>le</strong> monde n’ont<br />
pas de droits d’occupation, de contrô<strong>le</strong> <strong>et</strong><br />
d’utilisation sur <strong>le</strong>s <strong>ressources</strong> foncières<br />
très limitées; cela provient <strong>des</strong> traditions<br />
loca<strong>le</strong>s <strong>et</strong> de la religion musulmane.<br />
Au<strong>par</strong>avant, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> ne jouissaient<br />
pas de tous <strong>le</strong>urs droits, surtout en ce<br />
qui concernait l’accès à la terre alors<br />
qu’el<strong>le</strong>s l’exploitaient effectivement mais<br />
de manière informel<strong>le</strong>. El<strong>le</strong>s devaient alors<br />
soit emprunter de l’argent soit louer, tout<br />
en sachant qu’el<strong>le</strong>s ne pouvaient engager<br />
aucun investissement, même si el<strong>le</strong>s en<br />
avaient <strong>le</strong>s moyens.<br />
La notion d’accès à la terre fait allusion<br />
aux mécanismes institutionnels publics<br />
<strong>et</strong> privés qui perm<strong>et</strong>tent aux individus<br />
74
d’acquérir <strong>le</strong> droit de posséder, d’utiliser<br />
<strong>et</strong> de transférer la terre. Leur manque<br />
de contrô<strong>le</strong> <strong>et</strong> d’accès découragent <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> à faire <strong>des</strong> investissements à<br />
long terme sur <strong>des</strong> terrains. Dès lors,<br />
el<strong>le</strong>s préfèrent s’engager dans <strong>des</strong> proj<strong>et</strong>s<br />
plus prom<strong>et</strong>teurs. De plus, pendant la<br />
saison de culture, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> travail<strong>le</strong>nt<br />
plus de 16 heures <strong>par</strong> jour, dont la moitié<br />
est consacrée aux cultures agrico<strong>le</strong>s. Les<br />
étu<strong>des</strong> d’utilisation du temps montrent<br />
que <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> travail<strong>le</strong>nt 1 à 3 heures de<br />
plus que <strong>le</strong>s hommes.<br />
• s tratégies déVeLoppées pour<br />
une sécurité aLimentaire<br />
A <strong>par</strong>tir de 1976, l’année de la sécheresse,<br />
nous autres productrices ne pratiquions<br />
plus de cultures de rente. Depuis l’année<br />
dernière, avec l’insécurité alimentaire qui<br />
a touché <strong>le</strong> monde entier, nous sommes<br />
r<strong>et</strong>ournées aux cultures de niébé, de<br />
manioc, d’arachide de bouche <strong>et</strong> de bissap<br />
pour assurer notre nourriture.<br />
Suite à la hausse <strong>des</strong> prix de denrées<br />
alimentaires, notre p<strong>et</strong>it déjeuner se<br />
compose principa<strong>le</strong>ment de couscous,<br />
pré<strong>par</strong>é avec du mil. Nous utilisons l’hui<strong>le</strong><br />
d’arachide <strong>et</strong> <strong>le</strong> riz local qui est moins cher<br />
que <strong>le</strong> riz importé.<br />
Mon expérience<br />
Quand je suis arrivée dans <strong>le</strong> Diender en<br />
1982 avec pour ambition de défendre <strong>le</strong>s<br />
intérêts <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>, je suis entrée en<br />
contact avec <strong>le</strong> responsab<strong>le</strong> politique de<br />
la zone, feu Sel<strong>le</strong> Ndoye. La communauté<br />
rura<strong>le</strong> de Diender était la zone test du<br />
Sénégal, où est né <strong>le</strong> premier groupement<br />
féminin du Sénégal.<br />
Plusieurs raisons justifient mon entrée en<br />
politique :<br />
Premièrement, il y a <strong>le</strong> développement de<br />
ma localité qui est un sacerdoce pour moi.<br />
J’ai compris que la décentralisation, qui<br />
a comme finalité la gestion de proximité<br />
<strong>des</strong> affaires publiques, est <strong>le</strong> meil<strong>le</strong>ur<br />
cadre pour apprécier la <strong>par</strong>ticipation du<br />
citoyen sans distinction de sexe. El<strong>le</strong> est<br />
instituée <strong>par</strong> l’artic<strong>le</strong> 102 de la constitution<br />
qui dispose que «<strong>le</strong>s col<strong>le</strong>ctivités loca<strong>le</strong>s<br />
constituent <strong>le</strong> cadre institutionnel de la<br />
<strong>par</strong>ticipation <strong>des</strong> citoyens à la gestion<br />
<strong>des</strong> affaires publiques. El<strong>le</strong> s’administrent<br />
librement <strong>par</strong> <strong>des</strong> assemblées élues».<br />
C’est ainsi que j’ai milité activement dans<br />
un <strong>par</strong>ti jusqu’à devenir la deuxième<br />
conseillère rura<strong>le</strong> de la communauté<br />
rura<strong>le</strong> de Diender, <strong>et</strong> j’ai siégé durant trois<br />
mandats.<br />
Même depuis que Cayar est devenu<br />
commune rura<strong>le</strong> j’ai continué <strong>le</strong> combat,<br />
<strong>et</strong> présentement je suis conseillère<br />
municipa<strong>le</strong> <strong>et</strong> j’étais la deuxième mairesse<br />
adjointe du Maire sortant.<br />
La deuxième raison justifiant mon<br />
entrée en politique est la défense de la<br />
cause <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>. En eff<strong>et</strong>, el<strong>le</strong>s sont<br />
sous-représentées dans <strong>le</strong>s instances<br />
décisionnel<strong>le</strong>s <strong>et</strong> c<strong>et</strong>te inégalité au pouvoir<br />
politique est inadmissib<strong>le</strong>. Car <strong>le</strong> véritab<strong>le</strong><br />
pouvoir est politique : c’est <strong>le</strong> pouvoir<br />
de légiférer, de décider, de délibérer <strong>et</strong><br />
d’exécuter. Il est alors inconcevab<strong>le</strong> de<br />
laisser aux hommes la prérogative de<br />
mener à <strong>le</strong>ur guise <strong>le</strong> <strong>des</strong>tin <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>.<br />
Avec Enda-PRONAT qui est notre principal<br />
<strong>par</strong>tenaire, nous avons organisé plusieurs<br />
activités d’information sur la gestion <strong>des</strong><br />
terres au Sénégal <strong>et</strong> <strong>par</strong>ticulièrement<br />
dans la zone <strong>des</strong> Niayes, où se trouve la<br />
75
4. exempLes de pratiques <strong>et</strong> strategies a La base<br />
fédération <strong>des</strong> agro pasteurs de Diender.<br />
Nos principa<strong>le</strong>s activités sont <strong>le</strong>s cultures<br />
pluvia<strong>le</strong>s <strong>et</strong> <strong>le</strong> maraîchage.<br />
Diversification de la production<br />
Pour diversifier ma production, c<strong>et</strong>te année<br />
j’ai cultivé de l’arachide contre saison <strong>et</strong><br />
pluvia<strong>le</strong>, du niébé <strong>et</strong> du manioc en plus de<br />
mes cultures maraichères : chou, tomate,<br />
gombo, aubergine, <strong>et</strong>c. J’étais très fière<br />
en voyant que mes voisines avaient semé<br />
<strong>et</strong> récolté (bénéficié de ces récoltes) en<br />
améliorant <strong>le</strong>s besoins nutritifs de <strong>le</strong>ur<br />
famil<strong>le</strong>.<br />
Accès à l’eau<br />
Le problème <strong>le</strong> plus récurent pour <strong>le</strong>s pays<br />
en voie de développement est en général<br />
celui de l’eau. Les <strong>femmes</strong> rura<strong>le</strong>s sont<br />
<strong>le</strong>s plus exposées à ce phénomène <strong>et</strong> en<br />
souffrent énormément.<br />
Au Sénégal, la mise en place de nouveaux<br />
programmes d’aménagement hydro<br />
agrico<strong>le</strong> est encore vivace. En eff<strong>et</strong>, aussi<br />
bien dans la vallée du f<strong>le</strong>uve Sénégal que<br />
dans cel<strong>le</strong> dans l’Anambé, région de Kolda,<br />
ce sont uniquement <strong>le</strong>s chefs de ménage<br />
masculins qui bénéficient <strong>des</strong> périmètres<br />
aménagés <strong>et</strong> sont chargés de <strong>le</strong>s distribuer<br />
aux membres <strong>des</strong> deux sexes de <strong>le</strong>ur<br />
famil<strong>le</strong>.<br />
Problème de commercialisation<br />
Il se pose un véritab<strong>le</strong> problème de commercialisation<br />
pour <strong>le</strong>s productions agrico<strong>le</strong>s<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> qui peuvent <strong>par</strong>fois être très<br />
prom<strong>et</strong>teuses. Notamment <strong>des</strong> problèmes<br />
liés aux transports <strong>des</strong> produits mais aussi<br />
<strong>des</strong> problèmes pour trouver un marché pour<br />
écou<strong>le</strong>r tous <strong>le</strong>s produits cultivés.<br />
Problème de conservation<br />
A ces problèmes de commercialisation<br />
s’ajoute celui de la conservation <strong>des</strong><br />
produits en pério<strong>des</strong> de fortes productions.<br />
Si la conservation se révè<strong>le</strong> impossib<strong>le</strong>,<br />
cela entraîne une grande perte causant<br />
une baisse de revenus pour <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong>.<br />
Manque de matériel<br />
Dans <strong>le</strong>s zones rura<strong>le</strong>s, <strong>le</strong> manque de<br />
services de base comme la fourniture d’eau,<br />
<strong>le</strong>s centres de santé, <strong>le</strong>s transports <strong>et</strong> <strong>le</strong>s<br />
moulins, augmente considérab<strong>le</strong>ment <strong>le</strong><br />
temps que <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> doivent consacrer<br />
aux travaux domestiques. L’insuffisance de<br />
temps réduit l’attention qu’el<strong>le</strong>s peuvent<br />
porter aux activités productives <strong>et</strong> <strong>le</strong>s<br />
visites aux centres de santé.<br />
Il incombe aux <strong>femmes</strong> de travail<strong>le</strong>r sur<br />
<strong>le</strong>s <strong>par</strong>cel<strong>le</strong>s de terres du mari <strong>et</strong> de la<br />
famil<strong>le</strong> <strong>et</strong> de s’occuper <strong>des</strong> enfants, ce qui<br />
limite <strong>le</strong>ur capacité à établir <strong>des</strong> priorités<br />
dans <strong>le</strong>ur emploi du temps.<br />
Conservation <strong>et</strong> commercialisation<br />
Par manque d’unité de conservation, j’ai<br />
procédé au séchage de mon surplus de<br />
récolte de tomates, que je transforme en<br />
poudre pour l’utilisation ultérieure dans<br />
l’alimentation. Une <strong>par</strong>tie de ce produit<br />
a fait l’obj<strong>et</strong> de troc avec <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> de<br />
la Fédération sœur -Yaakar Niani Wulide<br />
Koussanar, qui el<strong>le</strong>s, possédaient un<br />
surplus de maïs.<br />
Les acquis<br />
Au niveau de notre organisation, la<br />
fédération <strong>des</strong> agro pasteurs de Diender, <strong>et</strong><br />
au niveau du Réseau National <strong>des</strong> Femmes<br />
76
Rura<strong>le</strong>s du Sénégal que je préside, nous<br />
avons vécu <strong>des</strong> expériences sur l’accès<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> à la terre <strong>et</strong> sur l’information<br />
<strong>et</strong> la communication qui nous ont apporté<br />
un changement positif.<br />
Les <strong>femmes</strong> rura<strong>le</strong>s jouent un rô<strong>le</strong><br />
important dans l’agriculture : el<strong>le</strong>s assurent<br />
la moitié de la production alimentaire<br />
mondia<strong>le</strong> <strong>et</strong> dans beaucoup de pays en<br />
voie de développement <strong>le</strong>ur contribution<br />
va de 60 à 80%.<br />
Aujourd’hui, nous connaissons <strong>des</strong> avancées<br />
très fortes. Dans la zone de Diender, y<br />
compris la commune de Cayar, <strong>et</strong> même la<br />
communauté rura<strong>le</strong> de Keur Moussa avec<br />
qui nous faisons <strong>le</strong> même travail, nous<br />
avons réussi à ce que l’héritage <strong>des</strong> terres<br />
soit appliqué après <strong>le</strong> décès d’un propriétaire<br />
foncier (mari, père, mère, <strong>et</strong>c.). La<br />
ré<strong>par</strong>tition de ses biens est faite selon <strong>le</strong>s<br />
conditions de la religion musulmane. Ce<br />
n’est pas entièrement gagné mais c’est<br />
une avancée importante pour nous. Certaines<br />
<strong>femmes</strong> font <strong>des</strong> économies <strong>et</strong> <strong>par</strong>viennent<br />
à ach<strong>et</strong>er <strong>le</strong>urs propres terres.<br />
Toujours avec l’appui du proj<strong>et</strong> Dimitra-<br />
FAO, <strong>le</strong> Réseau National <strong>des</strong> Femmes Rura<strong>le</strong>s<br />
a pu organiser un atelier sous-régional<br />
à Mbour, Sénégal du 3 au 5 juill<strong>et</strong> 2007,<br />
sur <strong>le</strong> thème : «Quel<strong>le</strong>s stratégies pour<br />
améliorer l’accès au pouvoir <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
rura<strong>le</strong>s pour une pratique <strong>des</strong> politiques de<br />
développement de <strong>le</strong>ur terroir ?».<br />
Nous avons aussi organisé avec Enda-Pronat<br />
<strong>et</strong> Dimitra-FAO un atelier sous-régional<br />
sur <strong>le</strong> thème «Femmes <strong>et</strong> droit foncier».<br />
Ainsi, nous avons fait beaucoup de<br />
rencontres avec <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong>s<br />
hommes, notamment avec la fédération<br />
<strong>des</strong> agro-pasteurs de Diender dont je suis<br />
membre, sur la gestion foncière <strong>et</strong> l’intérêt<br />
d’une culture saine <strong>et</strong> durab<strong>le</strong>.<br />
Je reviens à c<strong>et</strong>te courte phrase p<strong>le</strong>ine de<br />
sens de la FAO «<strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> nourrissent <strong>le</strong><br />
monde», car el<strong>le</strong> souligne <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> fondamental<br />
que joue la femme dans la production<br />
agrico<strong>le</strong>, dans <strong>le</strong> secteur de la pêche mais<br />
aussi dans la sylviculture à travers <strong>le</strong> monde.<br />
Il convient de rappe<strong>le</strong>r qu’au Sénégal,<br />
c’est au début <strong>des</strong> années 80 grâce à<br />
plusieurs conférences <strong>et</strong> à la «Décennie<br />
de la femme» décrétée <strong>par</strong> <strong>le</strong>s Nations<br />
Unies, mais aussi grâce aux injonctions<br />
<strong>des</strong> bail<strong>le</strong>urs de fonds quant à la nécessité<br />
d’intégrer la dimension genre dans <strong>le</strong>s<br />
politiques de développement, que <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> ont commencé à devenir de<br />
véritab<strong>le</strong>s actrices du jeu économique.<br />
C’est-à-dire que <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> ont commencé<br />
à être mieux encadrées <strong>et</strong> qu’el<strong>le</strong>s<br />
jouent aujourd’hui un rô<strong>le</strong> de premier plan<br />
dans <strong>le</strong> développement <strong>des</strong> activités économiques.<br />
La force due à <strong>le</strong>ur nombre <strong>et</strong><br />
<strong>le</strong>ur dynamisme économique ont favorisé<br />
l’émergence de quelques <strong>femmes</strong> <strong>le</strong>aders.<br />
Les <strong>femmes</strong> ont encore plus de difficultés<br />
à accéder, <strong>et</strong> moins de temps à consacrer,<br />
aux technologies que <strong>le</strong>s hommes, à la<br />
formation, à l’information, au savoir-faire<br />
<strong>et</strong> aux intrants agrico<strong>le</strong>s.<br />
Je lance un appel en faveur d’une mondialisation<br />
<strong>des</strong> efforts <strong>et</strong> <strong>des</strong> initiatives pour un<br />
changement social <strong>et</strong> économique durab<strong>le</strong>.<br />
Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes<br />
<strong>par</strong>tantes pour un entreprenariat, pour une<br />
solidarité Nord-Sud en vue d’un changement<br />
durab<strong>le</strong> en faveur du monde rural.<br />
77
4. exempLes de pratiques <strong>et</strong> strategies a La base<br />
4.2. FEMMES ET SéCURITé ALIMENTAIRE AU MALI<br />
Djénébou Dembélé<br />
L’agriculture qui nourrit plus de 80% de<br />
la population malienne est confrontée<br />
à <strong>des</strong> problèmes de crise liée soit aux<br />
conditions climatiques, soit aux systèmes<br />
de production, soit à l’organisation de la<br />
commercialisation <strong>des</strong> produits.<br />
El<strong>le</strong> se manifeste <strong>par</strong> une baisse <strong>des</strong><br />
rendements dans <strong>le</strong>s zones de production<br />
qui entraîne du coup la paupérisation<br />
<strong>des</strong> agriculteurs qui non seu<strong>le</strong>ment<br />
ne produisent pas suffisamment pour<br />
satisfaire <strong>le</strong>s besoins alimentaires <strong>des</strong><br />
famil<strong>le</strong>s, mais aussi ne disposent pas de<br />
<strong>ressources</strong> financières suffisantes pour<br />
payer <strong>le</strong>s céréa<strong>le</strong>s disponib<strong>le</strong>s sur <strong>le</strong>s<br />
marchés avec <strong>le</strong>s commerçants.<br />
El<strong>le</strong> se fait surtout ressentir dans <strong>le</strong>s zones<br />
rura<strong>le</strong>s <strong>et</strong> touche <strong>par</strong>ticulièrement <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong>s enfants. La <strong>par</strong>ticipation <strong>des</strong><br />
<strong>femmes</strong> dans la recherche de la sécurité<br />
alimentaire, bien qu’invisib<strong>le</strong>, n’est pas<br />
négligeab<strong>le</strong>. C<strong>et</strong>te <strong>par</strong>ticipation se faisait<br />
surtout dans l’exploitation familia<strong>le</strong> dans<br />
<strong>le</strong> seul but de satisfaire <strong>le</strong>s besoins de<br />
consommation du ménage.<br />
Aujourd’hui <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> sont devenues<br />
de véritab<strong>le</strong>s actrices du secteur agrico<strong>le</strong><br />
rural. El<strong>le</strong>s sont présentes tout <strong>le</strong> long<br />
de la chaîne agrico<strong>le</strong>, du labour à la<br />
transformation <strong>et</strong> à la commercialisation.<br />
El<strong>le</strong>s travail<strong>le</strong>nt aussi bien dans <strong>le</strong> champ<br />
commun de la famil<strong>le</strong> que sur <strong>le</strong>s <strong>par</strong>cel<strong>le</strong>s<br />
de <strong>le</strong>urs ménages <strong>et</strong> <strong>le</strong>urs propres <strong>par</strong>cel<strong>le</strong>s<br />
de terre.<br />
Ainsi l’état Malien à travers une loi dénommée<br />
«La Loi d’Orientation Agrico<strong>le</strong><br />
au Mali» donne une place de choix à la<br />
femme pour l’accès aux terres aménagées.<br />
L’artic<strong>le</strong> 83 de c<strong>et</strong>te loi stipu<strong>le</strong><br />
que «L’Etat veil<strong>le</strong> à assurer un accès<br />
équitab<strong>le</strong> aux <strong>ressources</strong> foncières<br />
agrico<strong>le</strong>s, aux différentes catégories<br />
d’exploitants agrico<strong>le</strong>s <strong>et</strong> promoteurs<br />
d’exploitation agrico<strong>le</strong>s. Toutefois,<br />
<strong>des</strong> préférences sont accordées aux<br />
<strong>femmes</strong>, aux jeunes <strong>et</strong> aux groupes<br />
déclarés vulnérab<strong>le</strong>s dans l’attribution<br />
<strong>des</strong> <strong>par</strong>cel<strong>le</strong>s au niveau <strong>des</strong> zones aménagées<br />
sur <strong>des</strong> fonds publics». Il est à<br />
souligner que l’application de c<strong>et</strong>te loi<br />
s’avère diffici<strong>le</strong> car <strong>le</strong>s <strong>par</strong>cel<strong>le</strong>s sont<br />
données la plu<strong>par</strong>t du temps aux chefs<br />
de ménage qui sont généra<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s<br />
hommes.<br />
Malgré <strong>le</strong>ur forte implication dans <strong>le</strong>s<br />
activités agrico<strong>le</strong>s <strong>et</strong> dans <strong>le</strong> souci<br />
d’assurer la sécurité alimentaire de <strong>le</strong>urs<br />
famil<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> rencontrent beaucoup<br />
de contraintes qui ne <strong>le</strong>ur perm<strong>et</strong>tent<br />
pas d’accroitre <strong>le</strong>ur production <strong>et</strong> <strong>le</strong>ur<br />
productivité.<br />
• présentation généraLe du maLi<br />
- La géographie <strong>et</strong><br />
Le découpage administratif<br />
Le Mali, vaste pays continental d’environ<br />
1 241 238 km 2 , est situé en Afrique de<br />
l’Ouest. Le Mali est découpé en régions administratives,<br />
en cerc<strong>le</strong>s <strong>et</strong> en communes.<br />
La structure administrative du pays est la<br />
suivante :<br />
- 8 régions administratives <strong>et</strong> <strong>le</strong> District de<br />
Bamako la capita<strong>le</strong>;<br />
- 49 cerc<strong>le</strong>s;<br />
- 703 communes composées de villages <strong>et</strong><br />
de quartiers.<br />
78
Le Mali est un pays de plaines <strong>et</strong> de bas<br />
plateaux. Son relief est peu é<strong>le</strong>vé <strong>et</strong> peu<br />
accidenté. Du Nord au Sud, <strong>le</strong> pays se<br />
caractérise <strong>par</strong> sa diversité climatique:<br />
désertique au Nord, sahélienne <strong>et</strong><br />
soudanienne au centre, <strong>et</strong> pré guinéenne<br />
au Sud <strong>et</strong> à l’Ouest.<br />
- LA pOpULATION<br />
La population du Mali est estimée à<br />
12 051 020 habitants en 2006. El<strong>le</strong> est<br />
inéga<strong>le</strong>ment ré<strong>par</strong>tie sur <strong>le</strong> territoire<br />
national <strong>et</strong> est d’une faib<strong>le</strong> densité<br />
(10 habitants au km²). Son taux<br />
d’accroissement moyen est de 2,2% <strong>par</strong><br />
an. 67,6% de c<strong>et</strong>te population est rura<strong>le</strong>,<br />
50,5% est féminine, 49% a moins de<br />
15 ans, soit une population très jeune. Les<br />
religions <strong>le</strong>s plus pratiquées sont l’islam, <strong>le</strong><br />
christianisme <strong>et</strong> l’animisme.<br />
- L’économie<br />
C<strong>et</strong>te économie, qui reste dominée <strong>par</strong> <strong>le</strong><br />
secteur primaire (environ 40% du PIB),<br />
est tributaire <strong>des</strong> aléas climatiques <strong>et</strong><br />
<strong>des</strong> prix <strong>des</strong> matières premières sur <strong>le</strong><br />
marché international. Ainsi, la crise dans<br />
<strong>le</strong> secteur du coton en 2000 a fortement<br />
ra<strong>le</strong>nti l’activité économique en 2001.<br />
De ce fait, la croissance économique a<br />
évolué en dents de scie entre 2002 <strong>et</strong><br />
2006 <strong>et</strong> reste dépendante du climat <strong>et</strong><br />
<strong>des</strong> prix <strong>des</strong> matières premières sur <strong>le</strong><br />
marché international. Le taux <strong>le</strong> plus<br />
faib<strong>le</strong> enregistré sur c<strong>et</strong>te période, 2,2%<br />
en 2004, résulte donc, d’une <strong>par</strong>t, <strong>des</strong><br />
mauvaises performances de la campagne<br />
agrico<strong>le</strong> 2004-2005 liées à un déficit<br />
pluviométrique <strong>et</strong> à l’invasion acridienne<br />
(criqu<strong>et</strong>s pè<strong>le</strong>rins) <strong>et</strong>, d’autre <strong>par</strong>t, de la<br />
baisse de la production d’or, de l’évolution<br />
défavorab<strong>le</strong> <strong>des</strong> cours du coton, de la<br />
hausse de ceux du pétro<strong>le</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s de<br />
la crise ivoirienne.<br />
• f emme <strong>et</strong> production<br />
ALImENTAIRE<br />
Les actions de développement de<br />
l’agriculture avaient principa<strong>le</strong>ment comme<br />
cib<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s gran<strong>des</strong> <strong>par</strong>cel<strong>le</strong>s cultivées <strong>par</strong><br />
<strong>le</strong>s hommes <strong>et</strong> non <strong>le</strong>s lopins de terre <strong>des</strong><br />
<strong>femmes</strong>. Les programmes de formation,<br />
de crédit, de production <strong>et</strong> de coopération<br />
n’ont pas toujours atteint <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong>.<br />
Au Mali, il ressort qu’en 2006 <strong>le</strong>s branches<br />
agrico<strong>le</strong>s ont enregistré la <strong>par</strong>ticipation de<br />
63,7% <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> actives âgées de 15 ans<br />
<strong>et</strong> plus (ELIM 2006).<br />
Ainsi c<strong>et</strong>te marginalisation se caractérise<br />
<strong>par</strong> l’accès diffici<strong>le</strong> <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> aux<br />
facteurs de production.<br />
- L’ACCèS DES fEmmES à LA TERRE<br />
La terre cultivée est généra<strong>le</strong>ment une exploitation<br />
familia<strong>le</strong> dont l’homme, en tant<br />
que chef de ménage, est <strong>le</strong> chef d’exploitation<br />
<strong>et</strong> détient <strong>le</strong> titre de propriété.<br />
Le tab<strong>le</strong>au ci-après montre clairement que<br />
plus la tail<strong>le</strong> de l’exploitation augmente,<br />
moins on trouve de <strong>femmes</strong> propriétaires<br />
d’exploitations (seu<strong>le</strong>s 6% <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
exploitantes ont plus de 5ha).<br />
79
4. exempLes de pratiques <strong>et</strong> strategies a La base<br />
Ré<strong>par</strong>tition du nombre d’exploitations selon la tail<strong>le</strong> en superficie <strong>et</strong> <strong>le</strong> sexe du<br />
chef d’exploitation<br />
Classe<br />
tail<strong>le</strong><br />
sans<br />
<strong>par</strong>cel<strong>le</strong><br />
moins<br />
de 1 ha<br />
1 à<br />
2 ha<br />
2 à<br />
3 ha<br />
3 à<br />
5 ha<br />
5 à<br />
10 ha<br />
10 à<br />
20 ha<br />
20 ha<br />
<strong>et</strong> plus<br />
Masculin Féminin Total<br />
Nombre<br />
d'exploitations<br />
%<br />
Nombre<br />
d'exploitations<br />
%<br />
Nombre<br />
d'exploitations<br />
108 348 14 2 287 9 110 635 13,7<br />
131 646 17 13 315 54 144 961 18,0<br />
105 063 13 3 935 16 108 998 13,5<br />
77 488 10 1 388 6 78 876 9,8<br />
108 604 14 2 157 9 110 761 13,8<br />
141 710 18 1 221 5 142 932 17,8<br />
78 733 10 332 1 79 065 9,8<br />
28 967 4 28 967 3,6<br />
Total 780 559 100 24 635 100 805 195 100,0<br />
%<br />
Source: Recensement Général de l’Agriculture 2004<br />
- L’ACCèS AUx INSTRUmENTS<br />
mODERNES DE pRODUCTION :<br />
intrants, équipements<br />
L’accès aux intrants constitue un aspect<br />
très important dans l’activité <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
exploitantes agrico<strong>le</strong>s car il influence<br />
<strong>le</strong>urs interventions dans la production <strong>et</strong><br />
détermine <strong>le</strong>ur poids.<br />
Les intrants qui intéressent <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
sont surtout ceux utilisés dans <strong>le</strong>s activités<br />
d’exploitations agrico<strong>le</strong>s. Il s’agit <strong>des</strong> semences,<br />
<strong>des</strong> engrais chimiques, <strong>des</strong> insectici<strong>des</strong>,<br />
<strong>des</strong> herbici<strong>des</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> fongici<strong>des</strong>.<br />
Selon <strong>le</strong>s résultats du RGA 2004, la ré<strong>par</strong>tition<br />
se fait plus au bénéfice <strong>des</strong> hommes<br />
exploitants agrico<strong>le</strong>s que <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> exploitantes<br />
agrico<strong>le</strong>s :<br />
- Semences améliorées : 28% d’exploitants<br />
bénéficiaires dont 7% de <strong>femmes</strong><br />
contre 21% d’hommes;<br />
- Engrais : 45% de bénéficiaires dont<br />
14% de <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> 31% d’hommes;<br />
- Insectici<strong>des</strong> : 27% de bénéficiaires<br />
dont 6,7% de <strong>femmes</strong>;<br />
- Fongici<strong>des</strong> : 5,0% de bénéficiaires dont<br />
3% de <strong>femmes</strong>;<br />
- Herbici<strong>des</strong> : 20,2% de bénéficiaires<br />
dont 4% de <strong>femmes</strong>.<br />
80
L’accès aux équipements <strong>des</strong> exploitants<br />
agrico<strong>le</strong>s selon <strong>le</strong> sexe est aussi inégalitaire<br />
que celui <strong>des</strong> intrants. Dans <strong>le</strong>s différentes<br />
localités d’enquêtes, il a été constaté que<br />
<strong>le</strong>s instruments de production modernes<br />
ap<strong>par</strong>tiennent à la famil<strong>le</strong>, pas à un individu.<br />
Mais <strong>le</strong> problème qui se pose aux <strong>femmes</strong><br />
est l’accès aux dits instruments, notamment<br />
<strong>le</strong>s charrues <strong>et</strong> multicultures. Ne sachant<br />
pas <strong>le</strong>s utiliser, el<strong>le</strong>s n’y accèdent que quand<br />
<strong>le</strong>s hommes n’en ont plus besoin ou el<strong>le</strong>s<br />
ont recours à <strong>des</strong> prestataires en dehors<br />
de la famil<strong>le</strong>, moyennant une rémunération<br />
journalière de 5000 à 7500 francs CFA.<br />
L’accès <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> aux <strong>ressources</strong> définit<br />
<strong>le</strong>ur degré d’autonomie financière <strong>et</strong> de<br />
vulnérabilité.<br />
- L’accès <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> au crédit<br />
AGRICOLE<br />
L’accès au crédit a toujours été un<br />
problème crucial pour <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong>. Les<br />
conditions <strong>des</strong> banques, notamment la<br />
garantie <strong>et</strong> <strong>le</strong> taux d’escompte é<strong>le</strong>vé, ne<br />
favorisent pas <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> du milieu rural<br />
<strong>et</strong> cel<strong>le</strong>s évoluant dans <strong>le</strong> secteur informel.<br />
• En milieu rural, la femme ne dispose<br />
d’aucune <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> (terre, maison,<br />
équipements agrico<strong>le</strong>s) pouvant lui servir<br />
de garantie auprès <strong>des</strong> banques <strong>et</strong>/ou <strong>des</strong><br />
établissements de crédits.<br />
• Les banques <strong>et</strong> établissements de crédits<br />
sont très éloignés de la population cib<strong>le</strong>,<br />
surtout de cel<strong>le</strong> du milieu rural.<br />
• Le manque de comptabilité caractéristique<br />
du secteur informel, pose <strong>le</strong> problème<br />
de base d’évaluation de la bonne<br />
santé <strong>des</strong> activités pour l’obtention du<br />
crédit.<br />
Il existe une forme de crédit dont<br />
bénéficient uniquement <strong>le</strong>s exploitants<br />
agrico<strong>le</strong>s appelé <strong>le</strong> crédit agrico<strong>le</strong>. Ces<br />
crédits sont soit en nature soit en espèces.<br />
Il s’agit de crédit d’équipement ou de<br />
campagne. Ainsi, suivant <strong>le</strong>s données du<br />
RGA 2004, seu<strong>le</strong>ment 8% <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
exploitantes agrico<strong>le</strong>s avaient bénéficié de<br />
ce crédit contre 22% <strong>des</strong> hommes.<br />
• f emmes <strong>et</strong> gestion de La<br />
pRODUCTION AGRICOLE<br />
Outre <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> prépondérant qu’el<strong>le</strong>s<br />
jouent dans la production alimentaire, <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> apportent d’autres contributions<br />
importantes à la sécurité alimentaire:<br />
- f emmes <strong>et</strong> gestion <strong>des</strong> banques<br />
de céréaLes (bc) au maLi<br />
Pour faire face aux situations de crise,<br />
l‘Etat malien, avec l’aide <strong>des</strong> organismes<br />
internationaux <strong>et</strong> de tous <strong>le</strong>s acteurs<br />
au développement, a entrepris depuis<br />
plusieurs années <strong>des</strong> actions en faveur de<br />
la sécurité alimentaire.<br />
Ainsi, en 2007, <strong>le</strong>s autorités maliennes<br />
ont installé une banque de céréa<strong>le</strong>s dans<br />
chacune <strong>des</strong> 703 communes que compte <strong>le</strong><br />
pays. Le décr<strong>et</strong> d’application de l’installation<br />
de ces banques de céréa<strong>le</strong>s a prévu la<br />
<strong>par</strong>ticipation d’au moins une femme pour<br />
<strong>le</strong> comité de gestion de cinq membres.<br />
De plus, <strong>le</strong>s ONG ont aussi installé <strong>des</strong><br />
BC dans <strong>le</strong>s zones <strong>le</strong>s plus déficitaires.<br />
L’installation de ces banques de céréa<strong>le</strong>s<br />
est généra<strong>le</strong>ment inscrite dans <strong>des</strong> proj<strong>et</strong>s/<br />
programmes <strong>et</strong> est <strong>par</strong>ticulièrement <strong>des</strong>tiné<br />
aux <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> aux enfants. Dans <strong>le</strong>s<br />
différentes stratégies d’intervention, il est<br />
81
4. exempLes de pratiques <strong>et</strong> strategies a La base<br />
<strong>le</strong> plus souvent défini que ces BC installées<br />
doivent être gérées <strong>par</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> qui en<br />
sont <strong>le</strong>s principa<strong>le</strong>s bénéficiaires.<br />
Selon <strong>le</strong>s initiateurs, cela est fondé sur<br />
<strong>le</strong> fait que <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> sont <strong>le</strong>s premières<br />
concernées dès que <strong>le</strong> ménage vient à<br />
manquer de vivres. El<strong>le</strong>s se battent corps<br />
<strong>et</strong> âme pour trouver de la nourriture pour<br />
<strong>le</strong>s enfants qui ont faim.<br />
Le réseau YIRIBA SUMA, un col<strong>le</strong>ctif<br />
d’associations <strong>et</strong> d’ONG féminines au Mali, a<br />
entrepris avec l’appui financier de GECOZA<br />
NORVEGE, une étude sur la <strong>par</strong>ticipation<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> à la gestion <strong>des</strong> BC. Au vu<br />
de quelques constats dans <strong>le</strong>s différentes<br />
régions du Mali, <strong>le</strong> réseau Yiriba Suma, à<br />
travers ses ONG membres, s’est aperçu<br />
que la gestion de ces BC est assurée dans<br />
la plu<strong>par</strong>t <strong>des</strong> cas <strong>par</strong> <strong>des</strong> hommes.<br />
C<strong>et</strong>te pratique a favorisé une discrimination<br />
dans <strong>le</strong>s conditions d’accès <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
aux céréa<strong>le</strong>s, car la plu<strong>par</strong>t du temps, el<strong>le</strong>s<br />
ne disposent pas de <strong>ressources</strong> financières<br />
nécessaires pour s’ach<strong>et</strong>er <strong>le</strong> minimum<br />
de quantité imposé <strong>par</strong> <strong>le</strong>s hommes (50<br />
à 100 kg). El<strong>le</strong>s sont peu satisfaites aussi<br />
<strong>par</strong> la qualité <strong>des</strong> céréa<strong>le</strong>s vendues dans<br />
<strong>le</strong>s banques.<br />
A ceci s’ajoute une gestion malsaine de ces<br />
infrastructures qui a conduit à <strong>le</strong>ur ferm<strong>et</strong>ure<br />
progressive dans plusieurs zones de la<br />
deuxième région. La ferm<strong>et</strong>ure <strong>des</strong> banques<br />
de céréa<strong>le</strong>s se fait plus sentir chez <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
car el<strong>le</strong>s sont plus vulnérab<strong>le</strong>s quand <strong>le</strong>s<br />
céréa<strong>le</strong>s manquent dans <strong>le</strong>s ménages. 15<br />
L’expérience d’AMAPEF<br />
Dans la mise en œuvre de son programme<br />
financé <strong>par</strong> <strong>le</strong> <strong>par</strong>tenaire Al<strong>le</strong>mand « Pain<br />
pour <strong>le</strong> Monde », AMAPEF a accompagné<br />
<strong>des</strong> groupements de <strong>femmes</strong> pour la<br />
gestion <strong>des</strong> banques céréalières dans la<br />
commune de Dombila.<br />
Dans <strong>le</strong> cadre de la recherche-action<br />
sur l’Economie socia<strong>le</strong> <strong>et</strong> solidaire initié<br />
<strong>par</strong> l’ONG ATOL, nous avons développé<br />
<strong>des</strong> métho<strong>des</strong> <strong>et</strong> outils pour améliorer<br />
notre accompagnement, pour renforcer<br />
la <strong>par</strong>ticipation <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> à la gestion<br />
<strong>des</strong> BC, <strong>et</strong> pour <strong>le</strong>s gérer comme une<br />
entreprise <strong>et</strong> pas seu<strong>le</strong>ment comme une<br />
activité socia<strong>le</strong> <strong>et</strong> communautaire.<br />
Au début de la recherche, <strong>le</strong>s constats<br />
étaient <strong>le</strong>s suivants :<br />
- <strong>le</strong> contrat de financement est<br />
signé <strong>par</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> (donc <strong>le</strong>s BC<br />
ap<strong>par</strong>tiennent aux <strong>femmes</strong>);<br />
- <strong>le</strong> comité mis en place pour la gestion<br />
comprend 13 personnes dont<br />
3 <strong>femmes</strong>;<br />
- la nature <strong>des</strong> céréa<strong>le</strong>s à ach<strong>et</strong>er est<br />
choisie <strong>par</strong> <strong>le</strong>s hommes qui assurent<br />
l’approvisionnement;<br />
- la gérance est assurée <strong>par</strong> un homme;<br />
- la décision de fixer la période de vente<br />
<strong>des</strong> céréa<strong>le</strong>s vient <strong>des</strong> hommes, en<br />
l’occurrence <strong>le</strong> chef de village;<br />
- la non prise en compte <strong>des</strong> aspects<br />
d’amortissement dans <strong>le</strong> calcul du<br />
prix de vente;<br />
- <strong>le</strong>s céréa<strong>le</strong>s sont ach<strong>et</strong>ées sans tenir<br />
compte <strong>des</strong> pério<strong>des</strong> d’abondance;<br />
- <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> ne cherchent pas<br />
d’informations auprès de différents<br />
fournisseurs pour faire <strong>le</strong> bon choix.<br />
Les actions entreprises afin de favoriser<br />
la <strong>par</strong>ticipation <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> la démarche<br />
dans un esprit d’entreprise :<br />
- recyclage <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> sur la gestion<br />
<strong>des</strong> BC;<br />
15<br />
Rapport d’étude sur la <strong>par</strong>ticipation de la femme à la gestion <strong>des</strong> banques de céréa<strong>le</strong>s 2009.<br />
82
- changement <strong>des</strong> heures d’ouverture de<br />
la BC;<br />
- vulgarisation <strong>des</strong> statuts <strong>et</strong> règ<strong>le</strong>ment<br />
intérieurs;<br />
- <strong>des</strong> réunions d’information sur la nécessité<br />
de faire <strong>par</strong>ticiper <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
aux activités de la BC;<br />
- fixation du prix de vente en tenant<br />
compte du prix d’achat <strong>et</strong> de l’amortissement<br />
du matériel <strong>et</strong> équipement;<br />
- achat <strong>des</strong> céréa<strong>le</strong>s au moment <strong>des</strong> récoltes.<br />
Résultats obtenus :<br />
- amélioration du niveau de connaissance<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> sur la gestion <strong>des</strong> BC;<br />
- une femme est gérante suppléante;<br />
- <strong>le</strong>s décisions sont prises en réunion<br />
du comité de gestion ou en AG avec la<br />
<strong>par</strong>ticipation <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>;<br />
- une meil<strong>le</strong>ure responsabilisation <strong>des</strong><br />
<strong>femmes</strong>;<br />
- la prise en compte de l’amortissement<br />
du bâtiment.<br />
Malgré ces efforts, il faut encore souligner<br />
que la <strong>par</strong>ticipation <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> pose<br />
toujours <strong>des</strong> problèmes :<br />
- difficultés pour <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> d’assurer la<br />
gérance pour <strong>des</strong> raisons de disponibilités<br />
(travaux domestiques);<br />
- refus pour certains hommes d’accepter<br />
<strong>le</strong> déplacement de <strong>le</strong>urs épouses pour<br />
l’approvisionnement <strong>des</strong> banques;<br />
- une sous information <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
membres du comité à cause de <strong>le</strong>ur<br />
faib<strong>le</strong> niveau d’instruction.<br />
- fEmmES ET TRANSfORmATION -<br />
COmmERCIALISATION DES<br />
denrées aLimentaires<br />
Les <strong>femmes</strong> sont aussi attirées <strong>par</strong> la<br />
transformation agroalimentaire. Il s’agit<br />
de p<strong>et</strong>ites unités de production informel<strong>le</strong><br />
(UPI) dont la tail<strong>le</strong> moyenne ne dépasse<br />
pas en général 1,4 emploi <strong>par</strong> unité. L’auto<br />
emploi est la règ<strong>le</strong> dans près de quatre<br />
établissements sur cinq. Ces activités<br />
agroalimentaires couvrent tout <strong>le</strong> territoire<br />
national <strong>et</strong> portent sur :<br />
- la transformation <strong>des</strong> produits locaux<br />
en jus de fruits ou confitures;<br />
- <strong>le</strong> conditionnement <strong>des</strong> condiments (pâte<br />
d’arachide, l’échalote)<br />
En plus, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> occupent une place<br />
prépondérante dans la commercialisation<br />
<strong>des</strong> denrées alimentaires.<br />
Expérience de GAAS Mali<br />
Dans <strong>le</strong> cadre de notre recherche-action,<br />
nous pouvons citer l’exemp<strong>le</strong> d’une<br />
autre ONG malienne, GAAS Mali du Pays<br />
Dogon, qui a pu contribuer au renforcement<br />
de la <strong>par</strong>ticipation <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
dans l’organisation du travail de la transformation<br />
<strong>et</strong> la commercialisation de<br />
l’échalote, ainsi que dans <strong>le</strong>s prises de<br />
décisions <strong>et</strong> <strong>le</strong> <strong>par</strong>tage <strong>des</strong> bénéfices de<br />
ce produit. Ceci nous amène à présenter<br />
la situation d’un groupe mixte de producteurs<br />
d’échalotes.<br />
Anciennes pratiques :<br />
- pas d’alternance (pas de renouvel<strong>le</strong>ment<br />
du bureau);<br />
- déficit de communication (l’information<br />
est détenue <strong>par</strong> quelques <strong>le</strong>aders);<br />
- décisions prises <strong>par</strong> <strong>le</strong>s <strong>le</strong>aders (en<br />
majorité <strong>le</strong>s hommes);<br />
- faib<strong>le</strong> prise en compte de la dimension<br />
genre dû au poids de la tradition <strong>et</strong> à la<br />
mauvaise compréhension du concept;<br />
- absence de pouvoir de décision <strong>et</strong> de<br />
contrô<strong>le</strong> <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> au sein <strong>des</strong> comités;<br />
- <strong>le</strong>s produits <strong>des</strong> unités de transformation<br />
sont pesés <strong>et</strong> vendus <strong>par</strong> <strong>le</strong>s hommes;<br />
83
4. exempLes de pratiques <strong>et</strong> strategies a La base<br />
- seuls <strong>le</strong>s hommes savent lire <strong>et</strong> écrire;<br />
- seuls <strong>le</strong>s hommes bénéficient <strong>des</strong><br />
formations relatives à la gestion <strong>des</strong><br />
unités de transformation du fait de<br />
l’analphabétisme.<br />
Actions entreprises :<br />
- suivi de l’application <strong>des</strong> règ<strong>le</strong>ments<br />
intérieurs;<br />
- renforcement <strong>des</strong> capacités <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> :<br />
ouvertures de centres d’alphabétisation;<br />
- assistance technique <strong>et</strong> financière envers<br />
<strong>le</strong>s <strong>femmes</strong>.<br />
Pratiques actuel<strong>le</strong>s :<br />
- une meil<strong>le</strong>ure <strong>par</strong>ticipation <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
dans <strong>le</strong>s prises de décisions en assemblée<br />
généra<strong>le</strong> : choix <strong>des</strong> activités,<br />
choix <strong>des</strong> <strong>le</strong>aders…;<br />
- Grâce aux différentes sensibilisations,<br />
<strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> occupent <strong>des</strong> postes de<br />
responsabilité au sein <strong>des</strong> comités :<br />
présidente, vice présidente, trésorière,<br />
commissaire aux comptes;<br />
- l’exécution <strong>des</strong> tâches <strong>et</strong> la ré<strong>par</strong>tition<br />
<strong>des</strong> rô<strong>le</strong>s <strong>et</strong> responsabilités sont faites<br />
sans distinction de sexe, d’<strong>et</strong>hnie, de<br />
classe socia<strong>le</strong> de religion <strong>et</strong> d’âge;<br />
- égalité de chances dans la <strong>par</strong>ticipation<br />
aux ateliers de formation entre hommes<br />
<strong>et</strong> <strong>femmes</strong> grâce à l’ouverture de centres<br />
d’alphabétisation pour <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> au niveau<br />
<strong>des</strong> villages abritant <strong>le</strong>s unités;<br />
- une ré<strong>par</strong>tition équitab<strong>le</strong> <strong>des</strong> bénéfices<br />
tirés de l’entreprise entre <strong>le</strong>s différents<br />
membres.<br />
Expérience d’AOPP<br />
AOPP est l’Association d’Organisations<br />
Professionnel<strong>le</strong>s Paysannes. Dans <strong>le</strong><br />
cadre de l’accompagnement du vol<strong>et</strong> maraîchage<br />
du proj<strong>et</strong> d’appui aux initiatives<br />
féminines, la mise en relation entre <strong>le</strong>s<br />
productrices (offre) <strong>et</strong> <strong>le</strong>s commerçants<br />
(demande) de légumes de Bamako fut<br />
entamée <strong>par</strong> l’animatrice <strong>et</strong> 2 responsab<strong>le</strong>s<br />
de la coopérative.<br />
Lors d’une première action de mise<br />
en relation ayant pour objectif la prise<br />
de contact avec <strong>le</strong>s commerçants en<br />
vue d’échanger sur <strong>le</strong>s possibilités de<br />
<strong>par</strong>tenariat d’affaire, il a été constaté que<br />
<strong>le</strong>s commerçants <strong>et</strong> <strong>le</strong>s consommateurs<br />
n’apprécient pas la qualité <strong>des</strong> produits<br />
maraîchers. En eff<strong>et</strong>, ces produits en<br />
provenance <strong>des</strong> localités de production se<br />
situant dans un rayon de 60 km autour<br />
de Bamako ont une mauvaise réputation<br />
à cause de l’utilisation d’eaux usées <strong>par</strong><br />
certains maraîchers. Les maladies issues<br />
de c<strong>et</strong>te pratique (fièvre typhoïde <strong>par</strong><br />
exemp<strong>le</strong>) sont connues de tous.<br />
Pour remédier à ce problème, un atelier de<br />
concertation regroupant <strong>le</strong>s maraîchères<br />
de la coopérative, <strong>le</strong>s commerçants, <strong>et</strong><br />
quelques consommateurs de légumes<br />
de Bamako, a été organisé. L’objectif<br />
était d’amener <strong>le</strong>s commerçants <strong>et</strong> <strong>le</strong>s<br />
consommateurs à s’enquérir <strong>des</strong> conditions<br />
de production maraîchère de la coopérative,<br />
en vue d’établir un climat de confiance<br />
entre eux.<br />
Le résultat de c<strong>et</strong>te action est <strong>le</strong> début d’instauration<br />
d’un climat de confiance entre<br />
maraîchères, commerçants <strong>et</strong> consommateurs-trices,<br />
<strong>et</strong> qui a même conduit à un<br />
<strong>par</strong>tenariat d’affaire. La mise en œuvre de<br />
la démarche a été facilitée <strong>par</strong> la volonté<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong> dynamisme <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> à trouver un<br />
marché pour <strong>le</strong>urs produits, <strong>et</strong> aussi <strong>par</strong><br />
l’adhésion <strong>des</strong> <strong>le</strong>aders dans la démarche<br />
de l’économie socia<strong>le</strong> <strong>et</strong> solidaire.<br />
84
Conclusion<br />
Les <strong>femmes</strong> se r<strong>et</strong>rouvent principa<strong>le</strong>ment<br />
dans <strong>le</strong>s activités agrico<strong>le</strong>s de façon informel<strong>le</strong>.<br />
Les dis<strong>par</strong>ités enregistrées entre <strong>le</strong>s hommes<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> dans <strong>le</strong>urs occupations agrico<strong>le</strong>s<br />
ne sont que la conséquence logique<br />
de la division sexuel<strong>le</strong> du travail, née de<br />
l’organisation patriarca<strong>le</strong> qui maintient <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> dans <strong>des</strong> fonctions de reproduction<br />
dans la société. C<strong>et</strong>te organisation confère<br />
éga<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> de chef de ménage, de<br />
chef d’exploitation, à l’homme qui gère <strong>et</strong><br />
contrô<strong>le</strong>, de ce fait, <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> productives<br />
(terres, équipements <strong>et</strong> intrants) <strong>et</strong><br />
<strong>des</strong> revenus issus de l’activité.<br />
La sous-estimation <strong>des</strong> activités féminines<br />
dans <strong>le</strong>s statistiques actuel<strong>le</strong>s constitue<br />
éga<strong>le</strong>ment une contrainte à laquel<strong>le</strong> <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> sont confrontées car el<strong>le</strong> ne<br />
perm<strong>et</strong> pas de valoriser <strong>le</strong>ur contribution<br />
réel<strong>le</strong> dans la sécurité alimentaire.<br />
Les expériences <strong>des</strong> ONG <strong>par</strong>tenaires de<br />
la recherche-action en collaboration avec<br />
ATOL prouvent qu’avec une tel<strong>le</strong> démarche<br />
d’analyse, de <strong>par</strong>tage de métho<strong>des</strong> <strong>et</strong><br />
d’outils, un travail d’expérimentation <strong>et</strong><br />
de <strong>par</strong>tage d’expériences, il est possib<strong>le</strong><br />
d’améliorer la <strong>par</strong>ticipation <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> à<br />
la sécurité alimentaire.<br />
Des contraintes demeurent éga<strong>le</strong>ment <strong>par</strong><br />
rapport à l’accessibilité <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> au<br />
crédit <strong>et</strong> ne favorisent pas la promotion de<br />
<strong>le</strong>urs activités : exigences fortes sur <strong>le</strong> dépôt<br />
initial, taux d’intérêts é<strong>le</strong>vés, délai de<br />
remboursement trop court, faib<strong>le</strong> niveau<br />
<strong>des</strong> montants prêtés.<br />
85
4. exempLes de pratiques <strong>et</strong> strategies a La base<br />
4.3. EXPéRIENCE EN GENRE DE LA CAPAD<br />
Annick Sezibera<br />
La Confédération <strong>des</strong> Associations <strong>des</strong><br />
Producteurs Agrico<strong>le</strong>s pour <strong>le</strong> Développement,<br />
«CAPAD» en sig<strong>le</strong>, a été créée en<br />
2000 <strong>par</strong> <strong>des</strong> groupements <strong>des</strong> productrices<br />
<strong>et</strong> producteurs agrico<strong>le</strong>s qui voulaient<br />
créer un espace de défense de <strong>le</strong>urs<br />
intérêts socio-économiques.<br />
La CAPAD est structurée de la base au niveau<br />
national <strong>et</strong> regroupe 21.130 ménages<br />
de paysannes <strong>et</strong> paysans.<br />
C’est depuis 2005 que la CAPAD a commencé<br />
à intégrer <strong>le</strong> genre dans ses structures<br />
mais éga<strong>le</strong>ment dans ses interventions.<br />
• s ituation aVant L’intégration<br />
DU GENRE<br />
La CAPAD, devenue une organisation majoritairement<br />
de <strong>femmes</strong> (environ 70% <strong>des</strong> membres<br />
sont <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>), s’est rendu compte en 2005<br />
que <strong>le</strong>s organes de décision, <strong>le</strong>s comités exécutifs<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong>s comités de surveillances de la base au<br />
niveau national, étaient dirigés à plus de 85%<br />
<strong>par</strong> <strong>le</strong>s hommes, <strong>et</strong> que <strong>le</strong> nombre de <strong>femmes</strong><br />
faisant <strong>par</strong>tie de ces comités était très réduit,<br />
environ 15%.<br />
Des séances d’auto analyse selon <strong>le</strong><br />
genre ont été organisées dans toutes<br />
<strong>le</strong>s coopératives membres de la CAPAD.<br />
Les causes identifiées de ce déséquilibre<br />
entre <strong>le</strong>s hommes <strong>et</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> sont <strong>le</strong>s<br />
suivantes :<br />
- La culture qui pèse lourdement sur<br />
<strong>le</strong>s rapports entre <strong>le</strong>s hommes <strong>et</strong> <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong>.<br />
- Le <strong>par</strong>tage <strong>des</strong> activités au sein du<br />
ménage qui laisse plus de temps libre à<br />
l’homme qu’à la femme.<br />
- L’éducation <strong>des</strong> fil<strong>le</strong>s : au sein de la<br />
CAPAD, 48% <strong>des</strong> membres sont analphabètes<br />
<strong>et</strong> 68% d’entre eux sont <strong>des</strong><br />
<strong>femmes</strong>.<br />
- La discrimination mais aussi l’auto<br />
discrimination <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>.<br />
- Le non accès aux <strong>ressources</strong> pour <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong>, qui crée <strong>le</strong>ur dépendance<br />
financière envers l’homme, <strong>et</strong> <strong>le</strong>ur non<br />
<strong>par</strong>ticipation dans la prise de décision au<br />
sein du ménage <strong>et</strong> <strong>des</strong> communautés.<br />
Ici nous signa<strong>le</strong>rons que la succession<br />
de la terre se fait de père en fils <strong>et</strong> que<br />
la fil<strong>le</strong> n’hérite pas de la terre <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />
biens de ses <strong>par</strong>ents.<br />
• c hangement opérés pour<br />
intégrer Le genre<br />
Après ce diagnostic, la CAPAD a développé<br />
<strong>des</strong> actions visant à améliorer <strong>et</strong> à changer<br />
la situation. Ces actions <strong>et</strong> ces changements<br />
sont <strong>le</strong>s suivants :<br />
- Mise en place d’une politique de genre<br />
adaptée à l’organisation paysanne.<br />
- Les textes législatifs <strong>des</strong> coopératives<br />
membres <strong>et</strong> ceux de la CAPAD ont été<br />
modifiés en vue d’y ajouter <strong>le</strong>s closes<br />
relatives à la <strong>par</strong>ticipation équitab<strong>le</strong><br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> hommes dans <strong>le</strong>s<br />
organes de décisions. Ainsi depuis<br />
2006, au sein <strong>des</strong> coopératives <strong>et</strong> au<br />
sein de la CAPAD, dans <strong>le</strong>s organes de<br />
prise de décision de la base au niveau<br />
national, on a 50% de <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> 50%<br />
d’hommes.<br />
- Les réunions s’organisent pendant <strong>le</strong>s<br />
moments qui conviennent aux <strong>femmes</strong>,<br />
86
el<strong>le</strong>s <strong>par</strong>ticipent au choix <strong>des</strong> moments<br />
<strong>et</strong> <strong>des</strong> lieux de réunions.<br />
- Création <strong>des</strong> associations à caractère<br />
social <strong>et</strong> économique au sein <strong>des</strong> coopératives<br />
pour perm<strong>et</strong>tre aux <strong>femmes</strong><br />
d’accéder aux p<strong>et</strong>its crédits, réaliser<br />
<strong>le</strong>urs micros proj<strong>et</strong>s <strong>et</strong> p<strong>et</strong>it à p<strong>et</strong>it,<br />
devenir autonomes financièrement : <strong>le</strong><br />
programme de MUSO (Mutuel<strong>le</strong> de Solidarité),<br />
est un programme d’é<strong>par</strong>gne<br />
<strong>et</strong> de crédit, il perm<strong>et</strong> aux hommes <strong>et</strong><br />
<strong>femmes</strong> membres de réaliser <strong>des</strong> activités<br />
génératrices de revenus.<br />
C’est à travers ce programme que <strong>le</strong>s<br />
<strong>femmes</strong> peuvent disposer d’argent propre<br />
dont el<strong>le</strong>s assument la libre gestion.<br />
Le Burundi étant un pays ou <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
n’ont pas accès à la terre, il est diffici<strong>le</strong><br />
pour une femme rura<strong>le</strong> d’accéder à un<br />
crédit sans l’aval de son mari, la femme<br />
manque de garantie pour ce crédit. Dans<br />
une société patriarca<strong>le</strong> comme la nôtre,<br />
c’est souvent l’homme qui dirige <strong>et</strong> qui<br />
décide de tout.<br />
- La sé<strong>par</strong>ation <strong>des</strong> mutuel<strong>le</strong>s de<br />
solidarité pour <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> pour <strong>le</strong>s<br />
hommes, perm<strong>et</strong> aux <strong>femmes</strong> d’avoir<br />
beaucoup plus d’espace de décision,<br />
mais aussi ces MUSO constituent <strong>des</strong><br />
éco<strong>le</strong>s de <strong>le</strong>adership féminin, <strong>des</strong><br />
espaces d’échange, de discussion <strong>et</strong> de<br />
traitement <strong>des</strong> questions concernant<br />
<strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> ainsi que <strong>le</strong>s questions<br />
socia<strong>le</strong>s <strong>et</strong> de développement.<br />
- L’introduction d’un programme d’alphabétisation<br />
<strong>et</strong> de renforcement <strong>des</strong> capacités<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> à travers <strong>le</strong>s Mutuel<strong>le</strong>s de<br />
Solidarité, perm<strong>et</strong> aux <strong>femmes</strong> d’acquérir<br />
<strong>des</strong> connaissances en gestion <strong>des</strong> associations<br />
<strong>et</strong> en gestion d’activités génératrices<br />
de revenus.<br />
- Les Coopératives constituent actuel<strong>le</strong>ment<br />
<strong>des</strong> assemblées où <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> <strong>et</strong><br />
<strong>le</strong>s hommes se rencontrent pour échanger,<br />
planifier <strong>et</strong> évaluer <strong>le</strong>s saisons<br />
cultura<strong>le</strong>s.<br />
- Tous <strong>le</strong>s proj<strong>et</strong>s <strong>et</strong> <strong>le</strong>s programmes<br />
développés <strong>par</strong> <strong>le</strong>s coopératives ou<br />
la CAPAD sont élaborés, exécutés <strong>et</strong><br />
suivis <strong>par</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong>s hommes<br />
membres.<br />
- La CAPAD a mis en place un règ<strong>le</strong>ment<br />
de recrutement du personnel qui donne<br />
<strong>le</strong>s mêmes chances aux <strong>femmes</strong> <strong>et</strong><br />
hommes, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong>s hommes<br />
ont donc <strong>le</strong>s mêmes droits <strong>et</strong> <strong>le</strong>s mêmes<br />
avantages.<br />
• i mpact de c<strong>et</strong>te intégration<br />
- AU NIvEAU DE LA GESTION INTERNE :<br />
- Au sein du secrétariat exécutif, sur<br />
<strong>le</strong>s 7 Cadres du bureau élargi de prise<br />
de décision, 3 sont <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>.<br />
- Au sein <strong>des</strong> organes nationaux de<br />
prise de décision, sur 10 membres,<br />
5 sont <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>.<br />
- Au sein <strong>des</strong> organes de prise de<br />
décision dans <strong>le</strong>s coopératives, sur<br />
362 membres, 174 sont <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>.<br />
- AU NIvEAU DES pROGRAmmES :<br />
- Les interventions sont <strong>des</strong>tinées équitab<strong>le</strong>ment<br />
aux <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> aux hommes.<br />
- Les hommes <strong>et</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> <strong>par</strong>ticipent<br />
à l’élaboration, l’exécution, <strong>le</strong><br />
87
4. exempLes de pratiques <strong>et</strong> strategies a La base<br />
suivi <strong>et</strong> l’évaluation <strong>des</strong> proj<strong>et</strong>s <strong>et</strong><br />
programmes développés <strong>par</strong> <strong>le</strong>s coopératives<br />
<strong>et</strong> la CAPAD.<br />
- a u niVeau <strong>des</strong> ménages :<br />
- Les <strong>femmes</strong> membres <strong>des</strong> Mutuel<strong>le</strong>s<br />
de Solidarité affirment qu’el<strong>le</strong>s<br />
possèdent <strong>le</strong>ur argent avec <strong>le</strong>quel el<strong>le</strong><br />
peuvent s’ach<strong>et</strong>er ce qu’el<strong>le</strong>s veu<strong>le</strong>nt<br />
sans demander à <strong>le</strong>ur mari.<br />
- Ces mêmes <strong>femmes</strong> assurent <strong>des</strong><br />
activités qui génèrent <strong>des</strong> revenus<br />
dont el<strong>le</strong>s sont <strong>le</strong>s gestionnaires sans<br />
que <strong>le</strong>ur époux dictent comment el<strong>le</strong>s<br />
doivent faire.<br />
- Les rapports au sein du ménage s’améliorent<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> sont de mieux<br />
en mieux considérées <strong>et</strong> consultées<br />
<strong>par</strong> <strong>le</strong>ur époux pour l’une ou l’autre<br />
question.<br />
- L’analphabétisme <strong>des</strong> adultes en milieu<br />
rural, en <strong>par</strong>ticulier <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>,<br />
limitent l’accès à l’information <strong>et</strong> à la<br />
communication.<br />
- Le non accès <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> à la terre <strong>et</strong><br />
autres <strong>ressources</strong> est en lien avec la<br />
pauvr<strong>et</strong>é.<br />
• Les perspectiVes<br />
Pour faire face à ces défis, en c<strong>et</strong>te année<br />
2010, la CAPAD vient de réactualiser sa<br />
politique genre <strong>et</strong> de nouvel<strong>le</strong>s actions<br />
sont proposées pour que l’intégration du<br />
genre au sein de la confédération soit<br />
effective. La CAPAD travail<strong>le</strong> aussi en<br />
synergie avec d’autres organisations pour<br />
faire du lobbying pour que la femme rura<strong>le</strong><br />
accède aux <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> en <strong>par</strong>ticulier, ait<br />
<strong>le</strong> droit d’hériter de la terre.<br />
- a u niVeau <strong>des</strong> communautés :<br />
- Dans <strong>le</strong>s coopératives, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
n’ont plus peur de prendre la <strong>par</strong>o<strong>le</strong><br />
<strong>et</strong> d’exprimer <strong>le</strong>urs opinions ou suggestions.<br />
- Les hommes membres <strong>des</strong> Coopératives<br />
reconnaissent <strong>le</strong> rô<strong>le</strong><br />
incontournab<strong>le</strong> <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> dans<br />
<strong>le</strong> développement.<br />
• Les défis<br />
- La culture <strong>et</strong> <strong>le</strong>s coutumes ne favorisent<br />
pas l’émergence <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>.<br />
- Le manque d’accès à la santé de la<br />
reproduction, <strong>le</strong> planning familial,<br />
constituent un frein à la promotion de<br />
la femme rura<strong>le</strong>.<br />
88
4.4. VOEDSELTEAMS<br />
Lea Claes<br />
(texte publié sur <strong>le</strong> site de Voedselteams) 16<br />
En 1995, Lea Claes <strong>et</strong> son conjoint, Marcel<br />
Stas, ont repris l’entreprise fruitière du père<br />
de Marcel. Sur une superficie de 5,5 ha, ils<br />
cultivent surtout <strong>des</strong> pommes (biologiques)<br />
<strong>et</strong> <strong>des</strong> poires (de culture intégrée), mais aussi<br />
<strong>des</strong> prunes <strong>et</strong> <strong>des</strong> cerises. Ils ont choisi<br />
de planter p<strong>et</strong>it à p<strong>et</strong>it différentes variétés<br />
de pommes en <strong>le</strong>s mélangeant <strong>le</strong>s unes aux<br />
autres, ce qui favorise la pollinisation <strong>et</strong> garantit<br />
en même temps une offre variée. Ils<br />
y vendent <strong>des</strong> pommes <strong>et</strong> <strong>des</strong> poires, mais<br />
éga<strong>le</strong>ment <strong>des</strong> jus de fruits <strong>et</strong> du sirop. Afin<br />
que la p<strong>et</strong>ite entreprise continue d’être rentab<strong>le</strong>,<br />
ils essaient de vendre un maximum de<br />
fruits directement au consommateur, que ce<br />
soit via l’asbl Voedselteams, via la vente à<br />
domici<strong>le</strong> ou encore sur <strong>le</strong> marché.<br />
L’asbl Voedselteams<br />
Un «voedselteam» est un groupe de personnes<br />
provenant d’un même quartier qui achètent<br />
en commun <strong>des</strong> légumes frais, <strong>des</strong> fruits, de<br />
la viande, du pain, <strong>des</strong> produits laitiers, <strong>des</strong><br />
produits Fair Trade <strong>des</strong> magasins du monde,…<br />
chez <strong>des</strong> producteurs de la région. Tout <strong>le</strong><br />
monde peut devenir membre après avoir reçu<br />
d’un responsab<strong>le</strong> local un mot d’introduction<br />
sur <strong>le</strong>s principes <strong>et</strong> l’approche. En tant que<br />
membre, vous pouvez commander toutes <strong>le</strong>s<br />
semaines via la boutique en ligne, vous al<strong>le</strong>z<br />
récupérer vos comman<strong>des</strong> au dépôt situé pas<br />
loin de chez vous <strong>et</strong> payez la facture mensuel<strong>le</strong><br />
au moyen d’un virement à la banque. L’adhésion<br />
à l’asbl coûte 10€ <strong>par</strong> an, <strong>par</strong> famil<strong>le</strong>.<br />
En groupe, vous déterminez ce que vous<br />
al<strong>le</strong>z ach<strong>et</strong>er, chez qui vous al<strong>le</strong>z l’ach<strong>et</strong>er<br />
<strong>et</strong> quels sont <strong>le</strong>s critères importants. Vous<br />
vous réunissez au moins une fois <strong>par</strong> an<br />
pour discuter du fonctionnement <strong>et</strong> visitez<br />
ou recevez la visite de producteurs qui approvisionnent<br />
votre groupe. Vous collaborez<br />
pour cela avec <strong>le</strong> responsab<strong>le</strong> régional. Tous<br />
<strong>le</strong>s groupes d’achats sont différents <strong>et</strong> <strong>le</strong>s<br />
régions <strong>et</strong> provinces flaman<strong>des</strong> connaissent<br />
el<strong>le</strong>s aussi <strong>des</strong> dynamiques distinctes. Nous<br />
veillons toutefois à avoir une administration<br />
uniforme <strong>des</strong> groupes.<br />
historique<br />
L’asbl Voedselteams organise <strong>des</strong> groupes<br />
d’achats locaux en Flandre depuis 1996: il<br />
s’agit de groupes de personnes issues d’un<br />
même quartier qui, ensemb<strong>le</strong>, achètent de la<br />
nourriture, directement auprès d’agriculteurs<br />
<strong>et</strong> de producteurs locaux ou régionaux. Ces<br />
groupes d’achats ont été créés en réponse à la<br />
méfiance de bon nombre de consommateurs<br />
quant à la qualité de notre nourriture. Or, <strong>le</strong><br />
contact direct avec <strong>le</strong>s producteurs d’aliments<br />
locaux restaure c<strong>et</strong>te confiance. Ces groupes<br />
d’achats cherchent en outre à promouvoir<br />
l’économie régiona<strong>le</strong>. Une manière pour nous<br />
de contribuer à une agriculture durab<strong>le</strong>.<br />
En collaboration avec Vre<strong>des</strong>eilanden, une<br />
organisation du tiers monde organisation<br />
du tiers monde, <strong>et</strong> avec Wervel, une<br />
organisation pour une agriculture juste <strong>et</strong><br />
durab<strong>le</strong>, <strong>le</strong> centre Elcker-ik s’est basé sur<br />
<strong>le</strong> modè<strong>le</strong> japonais du Seikatsu Club (une<br />
coopérative de consommateurs japonaise)<br />
pour lancer <strong>le</strong>s Voedselteams. Ce modè<strong>le</strong><br />
offrait en eff<strong>et</strong> une alternative d’action<br />
concrète dans laquel<strong>le</strong> tous <strong>le</strong>s aspects du<br />
développement durab<strong>le</strong> étaient abordés.<br />
Prudents <strong>et</strong> armés d’une bonne dose de<br />
courage, une poignée de consommateurs<br />
<strong>et</strong> quelques producteurs ont lancé ce<br />
nouveau système dans <strong>le</strong> Brabant flamand<br />
en 1996. Entre-temps, ce p<strong>et</strong>it mouvement<br />
16<br />
http://www.voedselteams.be/ (novembre 2010)<br />
89
4. exempLes de pratiques <strong>et</strong> strategies a La base<br />
<strong>des</strong> Voedselteams a grandi jusqu’à compter<br />
aujourd’hui une nonantaine de groupes <strong>et</strong><br />
une septantaine de producteurs ré<strong>par</strong>tis à<br />
travers toute la Flandre.<br />
Encouragé pour ce vif succès, ce mouvement<br />
a re<strong>le</strong>vé <strong>le</strong> défi en 2001 de devenir<br />
une organisation indépendante. Maintenant<br />
dotés d’une structure d’asbl démocratique,<br />
producteurs <strong>et</strong> consommateurs<br />
déterminent désormais ensemb<strong>le</strong> la manière<br />
dont Voedselteams va continuer de<br />
se développer.<br />
En plus de ses objectifs écologiques, économiques<br />
<strong>et</strong> sociaux, l’asbl Voedselteams<br />
a l’ambition d’éga<strong>le</strong>ment exercer une pression<br />
au niveau politique concernant divers<br />
aspects de la production alimentaire. L’asbl<br />
offre un emploi stab<strong>le</strong> à 2 ETP.<br />
Le concept<br />
Il existe une différence entre <strong>le</strong> supermarché<br />
en tant que machine hyper bien huilée <strong>et</strong><br />
un groupe d’achats. En faisant <strong>par</strong>tie d’un<br />
groupe, de nombreuses occasions vous<br />
sont offertes de connaître l’origine de vos<br />
aliments d’une manière vivante <strong>et</strong> c’est en<br />
tant que personne que vous agissez <strong>et</strong> non<br />
plus en tant que simp<strong>le</strong> consommateur.<br />
Dans <strong>le</strong> cas d’un groupe d’achats, il peut<br />
aussi arriver qu’un problème se produise<br />
lors de la commande ou de la livraison. Cela<br />
dit, <strong>le</strong>s membres ne râ<strong>le</strong>nt pas à propos de<br />
ces p<strong>et</strong>ites imperfections mais essaient au<br />
contraire d’améliorer <strong>le</strong> système en en <strong>par</strong>lant.<br />
Les membres d’un groupe d’achats peuvent<br />
se faire une meil<strong>le</strong>ure idée du processus<br />
de production grâce au contact qu’ils ont<br />
avec <strong>le</strong>s producteurs. Ce contact se fait <strong>par</strong><br />
<strong>le</strong> biais de courriels, de communications<br />
jointes dans <strong>le</strong>s paniers de légumes, de<br />
visites mutuel<strong>le</strong>s, de nouvel<strong>le</strong>s publiées sur<br />
<strong>le</strong> site Intern<strong>et</strong>. Via <strong>le</strong>ur mot de passe, <strong>le</strong>s<br />
membres ont en outre accès aux résultats<br />
d’une évaluation <strong>des</strong> producteurs en matière<br />
de durabilité. C<strong>et</strong>te évaluation est faite <strong>par</strong><br />
<strong>le</strong>s responsab<strong>le</strong>s régionaux <strong>et</strong> porte sur<br />
l’application de métho<strong>des</strong> agrico<strong>le</strong>s durab<strong>le</strong>s<br />
ainsi que sur <strong>le</strong>s intentions d’entreprendre à<br />
l’avenir d’autres mesures dans ce domaine.<br />
Grâce à ce contact, <strong>le</strong>s membres voient à<br />
quel point l’agriculture, à l’heure actuel<strong>le</strong>, n’a<br />
rien d’évident. Ils acceptent <strong>par</strong> ail<strong>le</strong>urs <strong>le</strong>s<br />
éventuel<strong>le</strong>s p<strong>et</strong>ites imperfections résultant de<br />
mauvaises conditions climatiques ou autres.<br />
L’engagement<br />
Un groupe d’achats achète sur base de ses<br />
besoins <strong>et</strong> de l’appréciation qu’il a <strong>des</strong> producteurs<br />
<strong>et</strong> de <strong>le</strong>ur produit. Personne n’est obligé<br />
d’ach<strong>et</strong>er toutes <strong>le</strong>s semaines, une chose<br />
dont nous ne voulons pas non plus nous mê<strong>le</strong>r.<br />
Nous demandons toutefois aux membres<br />
d’ach<strong>et</strong>er régulièrement car <strong>le</strong>s producteurs<br />
adaptent <strong>le</strong>urs perspectives de ventes (<strong>et</strong> intentions<br />
de semis) au nombre de membres.<br />
Il arrive <strong>par</strong>fois qu’un producteur demande<br />
à un groupe d’ach<strong>et</strong>er pour un montant<br />
minimum. Sans un chiffre d’affaires<br />
minimum, ce n’est en eff<strong>et</strong> pas rentab<strong>le</strong> pour<br />
<strong>le</strong>s producteurs, sans <strong>par</strong><strong>le</strong>r <strong>des</strong> kilomètres<br />
<strong>par</strong>courus inuti<strong>le</strong>ment pour transporter <strong>le</strong>s<br />
produits alimentaires. Il n’est toutefois pas<br />
rare que <strong>le</strong>s producteurs s’organisent pour<br />
assurer ensemb<strong>le</strong> <strong>le</strong> transport <strong>et</strong> ainsi limiter<br />
encore davantage <strong>le</strong> nombre de kilomètres<br />
<strong>par</strong>courus <strong>par</strong> <strong>le</strong>s aliments.<br />
Vous <strong>le</strong> constatez vous-même: opter<br />
délibérément pour <strong>des</strong> groupes d’achats<br />
demande un effort, ne fût-ce que minime.<br />
Mais la récompense, c’est que vous<br />
ach<strong>et</strong>ez une alimentation saine qui, en<br />
90
plus d’apporter un soutien à l’agriculture<br />
à p<strong>et</strong>ite échel<strong>le</strong> de votre région, offre la<br />
possibilité aux agriculteurs du Sud de<br />
développer <strong>le</strong>ur propre agriculture.<br />
Les raisons pour <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s nous <strong>le</strong><br />
faisons<br />
Nous optons pour <strong>le</strong> panier de légumes:<br />
une grande variété de légumes sains<br />
<strong>et</strong> appétissants aux noms <strong>et</strong> aux goûts<br />
<strong>par</strong>fois surprenants, cultivés de manière<br />
biologique, avec la possibilité de choisir<br />
entre un mini, un p<strong>et</strong>it ou un grand panier.<br />
Nous savons d’où viennent nos aliments.<br />
Nous avons un lien avec nos agriculteurs.<br />
Nous optons pour une qualité saine : pas de<br />
pestici<strong>des</strong>, d’hormones ni d’agents conservateurs<br />
dans notre assi<strong>et</strong>te. Nous optons<br />
pour <strong>le</strong> respect <strong>des</strong> plantes <strong>et</strong> <strong>des</strong> animaux.<br />
Nous mangeons <strong>des</strong> produits de saison.<br />
Nous savons ce que nous payons : un prix<br />
honnête, sans <strong>le</strong>s coûts <strong>des</strong> nombreux<br />
emballages ou du commerce intermédiaire<br />
<strong>et</strong> sans perte en cours de route. Nous optons<br />
pour <strong>le</strong>s agriculteurs locaux <strong>et</strong> ach<strong>et</strong>ons<br />
<strong>des</strong> produits de notre propre région.<br />
Le fonctionnement<br />
Notre structure est basée sur différents<br />
principes de la <strong>par</strong>ticipation démocratique.<br />
Au niveau local, il y a <strong>le</strong>s groupes d’achats<br />
qui s’organisent de manière autonome. Pour<br />
cela, nous faisons un <strong>par</strong>tage <strong>des</strong> différentes<br />
tâches bénévo<strong>le</strong>s, désignons une personne de<br />
contact ainsi que d’autres responsab<strong>le</strong>s pour<br />
se charger <strong>des</strong> finances, <strong>des</strong> comman<strong>des</strong>,<br />
du dépôt,... Ces groupes dressent ensemb<strong>le</strong><br />
<strong>le</strong>ur propre liste de commande sur base d’une<br />
sé<strong>le</strong>ction d’agriculteurs <strong>et</strong> de producteurs de<br />
<strong>le</strong>ur région <strong>et</strong> de <strong>le</strong>ur offre de produits.<br />
Au niveau régional, on trouve <strong>le</strong>s noyaux qui<br />
sont constitués de membres <strong>des</strong> groupes, de<br />
producteurs <strong>et</strong> de collaborateurs. Les régions<br />
n’ont pas toutes <strong>des</strong> noyaux actifs; il est tout à<br />
fait courant de se réunir à l’initiative d’une <strong>des</strong><br />
<strong>par</strong>ties concernées <strong>et</strong> pour une raison concrète.<br />
En Flandre, nous avons <strong>le</strong> Conseil d’Administration<br />
<strong>et</strong> l’Assemblée généra<strong>le</strong>. Les<br />
deux sont constitués de représentants <strong>des</strong><br />
régions, de producteurs <strong>et</strong> de membres.<br />
Le fonctionnement journalier est assuré<br />
grâce à une collaboration entre <strong>le</strong> coordinateur<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong>s responsab<strong>le</strong>s régionaux. À côté<br />
de ces fonctions rémunérées, il y a <strong>le</strong>s bénévo<strong>le</strong>s<br />
supra locaux. Ces derniers contribuent<br />
au système de commande via Intern<strong>et</strong>, à la<br />
rédaction <strong>et</strong> à l’entr<strong>et</strong>ien du site Intern<strong>et</strong>, à<br />
la gestion administrative <strong>et</strong> veil<strong>le</strong>nt en outre<br />
à assurer une permanence aux stands ou<br />
lors d’autres activités publiques.<br />
L’asbl Voedselteams est établie à Louvain.<br />
Nous ne visons aucun but commercial, mais<br />
sommes plutôt <strong>le</strong> lien entre <strong>le</strong>s groupes<br />
d’achats communs (<strong>le</strong>s Voedselteams) <strong>et</strong><br />
<strong>le</strong>s producteurs.<br />
Le financement se fait en <strong>par</strong>tie sur fonds<br />
propres, grâce à la cotisation annuel<strong>le</strong> de tous<br />
<strong>le</strong>s membres <strong>et</strong> la contribution <strong>des</strong> producteurs,<br />
à savoir 3% de <strong>le</strong>ur chiffre d’affaires.<br />
À côté de cela, ce travail est rendu possib<strong>le</strong><br />
grâce aux subsi<strong>des</strong> octroyés <strong>par</strong> <strong>le</strong><br />
Ministère de la Culture qui a reconnu l’asbl<br />
comme un mouvement. Chaque année,<br />
nous <strong>le</strong>ur présentons un rapport sur notre<br />
travail dans trois domaines: la sensibilisation,<br />
l’éducation <strong>et</strong> l’activation socia<strong>le</strong>.<br />
Bouger, c’est ensemb<strong>le</strong> que nous <strong>le</strong> faisons<br />
: <strong>le</strong>s membres <strong>des</strong> groupes d’achats,<br />
<strong>le</strong>s producteurs <strong>et</strong> l’asbl Voedselteams.<br />
L’agriculture (bio) durab<strong>le</strong> est un point primordial,<br />
mais nous accordons tout autant<br />
d’importance aux groupes en tant que fait<br />
social.<br />
91
4. exempLes de pratiques <strong>et</strong> strategies a La base<br />
4.5. RDC : L’ACCèS ET LE CONTRÔLE DE RESSOURCES PAR<br />
LES FEMMES, UN DéFI POUR LA SéCURITé ALIMENTAIRE<br />
Résumé de l’intervention d’Angè<strong>le</strong> mBOmBO<br />
KATChIUNGA du 10 octobre 2010<br />
La sécurité alimentaire est un défi que<br />
la RDC peine à re<strong>le</strong>ver. La population<br />
congolaise est en train de traverser un <strong>des</strong><br />
moments <strong>le</strong>s plus durs de son histoire <strong>et</strong> la<br />
situation est accentuée <strong>par</strong> <strong>des</strong> décennies<br />
de conflit. En dépit de quelques progrès<br />
enregistrés sur la période 2006-2009,<br />
résultant de la campagne de sensibilisation<br />
de la population « Agriculture priorité <strong>des</strong><br />
priorités » menée <strong>par</strong> <strong>le</strong> Gouvernement de<br />
la République <strong>et</strong> <strong>par</strong> <strong>le</strong>s gouvernements<br />
provinciaux, la situation demeure précaire.<br />
On observe, notamment chez <strong>le</strong>s enfants<br />
de moins de cinq ans <strong>et</strong> chez <strong>le</strong>s mères,<br />
<strong>des</strong> taux é<strong>le</strong>vés de malnutrition chronique<br />
<strong>et</strong> aigüe. Prise dans <strong>le</strong> cerc<strong>le</strong> vicieux de la<br />
pauvr<strong>et</strong>é, la population congolaise n’a pas<br />
la possibilité d’investir dans l’avenir car <strong>le</strong>s<br />
patrimoines <strong>des</strong> famil<strong>le</strong>s sont revendus<br />
pour assurer la survie du foyer. La sécurité<br />
alimentaire en RDC est, à ce jour, loin<br />
d’être garantie !<br />
A c<strong>et</strong> égard, il est indispensab<strong>le</strong> de m<strong>et</strong>tre<br />
en lumière <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> de la femme dans la<br />
sécurité alimentaire. Les <strong>femmes</strong> travail<strong>le</strong>nt<br />
toute la journée dans <strong>le</strong>s champs, vont<br />
puiser de l’eau, pré<strong>par</strong>ent <strong>le</strong>s repas : el<strong>le</strong>s<br />
sont un pilier de la sécurité alimentaire.<br />
Cependant, el<strong>le</strong>s agissent avec peu de<br />
moyens. Dans la pratique, l’égalité <strong>des</strong><br />
sexes est l’un <strong>des</strong> objectifs <strong>le</strong>s plus diffici<strong>le</strong>s<br />
à atteindre pour diverses raisons. L’accès<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> aux <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> aux terres<br />
est limité. Dans la culture traditionnel<strong>le</strong>,<br />
<strong>le</strong>s terres se transm<strong>et</strong>tent de père en fils,<br />
privant ainsi <strong>le</strong>s fil<strong>le</strong>s <strong>et</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> d’un<br />
héritage précieux. Subissant l’héritage<br />
de traditions patriarca<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
congolaises ont peu de chance de pouvoir<br />
s’émanciper, notamment en milieu rural.<br />
A ceci s’ajoutent l’insécurité au sein de<br />
<strong>le</strong>ur foyer <strong>et</strong> sur <strong>le</strong>ur lieu de travail qui<br />
contribue à <strong>le</strong>s fragiliser <strong>et</strong> empêche <strong>le</strong>ur<br />
développement personnel. Par ail<strong>le</strong>urs, <strong>le</strong><br />
faib<strong>le</strong> taux d’alphabétisation <strong>des</strong> fil<strong>le</strong>s <strong>et</strong><br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> aggrave la situation car il limite<br />
<strong>le</strong>ur action <strong>et</strong> <strong>le</strong>s prive de responsabilités<br />
quant au contrô<strong>le</strong> <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />
terres.<br />
L’intégration du genre en milieu rural est<br />
nécessaire pour atteindre l’objectif de<br />
sécurité alimentaire. Depuis sa création en<br />
2001, notre organisation, <strong>le</strong> CEDI (Centre<br />
d’Encadrement pour <strong>le</strong> Développement<br />
Intégré) DIKOLELA s’intéresse à ce suj<strong>et</strong>.<br />
Notre expérience confirme qu’il est possib<strong>le</strong><br />
de changer <strong>et</strong> de défier <strong>le</strong>s traditions.<br />
Plaidant la cause <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> auprès <strong>des</strong><br />
chefs traditionnels, notre organisation<br />
a réussi à obtenir une concession de<br />
3000 ha. Les chefs traditionnels ont ainsi<br />
transmis l’autorisation aux autorités<br />
politico-administratives qui ont émis un<br />
procès-verbal de vacance de terre. Ce<br />
procès verbal a ensuite servi à effectuer<br />
<strong>le</strong>s démarches nécessaires d’obtention <strong>des</strong><br />
documents officiels délivrés <strong>par</strong> <strong>le</strong>s titres<br />
fonciers après bornage <strong>par</strong> <strong>le</strong>s services de<br />
cadastre. Chaque femme s’est ensuite vue<br />
délivrer une <strong>par</strong>cel<strong>le</strong> de 100m x 100m.<br />
Les bénéficiaires de notre proj<strong>et</strong> ont ainsi<br />
pu cultiver (maraîchage) <strong>et</strong> disposer <strong>des</strong><br />
revenus de <strong>le</strong>ur récolte. Ainsi, grâce à une<br />
production plus conséquente, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
ont dégagé <strong>des</strong> revenus qui <strong>le</strong>ur ont permis<br />
de produire plus <strong>et</strong> d’augmenter <strong>le</strong>ur<br />
revenu. En conséquence, el<strong>le</strong>s peuvent<br />
contribuer à couvrir une <strong>par</strong>tie <strong>des</strong><br />
dépenses de <strong>le</strong>ur foyer. Notre expérience<br />
nous montre, une fois de plus, que l’accès<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> aux terres <strong>et</strong> aux <strong>ressources</strong><br />
92
est crucial pour atteindre l’objectif de<br />
sécurité alimentaire. Il faut cependant<br />
noter que dans l’exemp<strong>le</strong> de CEDI, nous<br />
restons sur <strong>des</strong> surfaces agrico<strong>le</strong>s très<br />
réduites, l’augmentation du revenu est<br />
donc assez relative.<br />
L’objectif 1b <strong>des</strong> OMD vise à « réduire de<br />
moitié la faim d’ici 2015 ». A ce jour, la RDC<br />
compte environ 60 millions d’habitants<br />
<strong>et</strong> seuls 10% de la population mangent<br />
deux repas <strong>par</strong> jour. Face à ce constat<br />
alarmant, il convient de souligner que <strong>le</strong>s<br />
droits civils, politiques <strong>et</strong> économiques<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong>, tels que décrits dans <strong>le</strong>s<br />
différents instruments juridiques tant<br />
nationaux qu’internationaux, sont loin<br />
d’être garantis.<br />
Une meil<strong>le</strong>ure synergie au niveau national<br />
est nécessaire pour promouvoir un<br />
développement basé sur <strong>le</strong>s droits humains<br />
<strong>des</strong> enfants, <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> hommes.<br />
Atteindre la sécurité alimentaire en RDC<br />
nécessite de mobiliser <strong>le</strong>s <strong>ressources</strong><br />
<strong>et</strong> de promouvoir <strong>le</strong>s proj<strong>et</strong>s efficaces<br />
qui intègrent la dimension genre. Une<br />
attention toute <strong>par</strong>ticulière doit éga<strong>le</strong>ment<br />
être placée sur l’appui à l’agriculture<br />
informel<strong>le</strong>, familia<strong>le</strong> qui constitue 54,3%<br />
<strong>des</strong> agriculteurs. Appuyer l’agriculture<br />
familia<strong>le</strong>, en aidant <strong>par</strong> exemp<strong>le</strong> <strong>le</strong>s<br />
agriculteurs-trices à adopter un outillage<br />
plus performant, à avoir accès à <strong>des</strong><br />
semences de qualités, <strong>et</strong>c. contribuerait<br />
à accroître la production <strong>et</strong> donc, à<br />
contribuer à la sécurité alimentaire.<br />
93
5. CONCLUSION ET<br />
RECOMMANDATIONS
VERS UNE SéCURITé ALIMENTAIRE : DES INéGALITéS à<br />
COMBATTRE<br />
• Le rôLe <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> dans La<br />
sécurité aLimentaire<br />
Ces dernières années, que ce soit la<br />
crise <strong>des</strong> matières premières (produits<br />
agrico<strong>le</strong>s, pétro<strong>le</strong>…), la crise financière ou<br />
la crise environnementa<strong>le</strong> (changements<br />
climatiques), ces crises ont eu <strong>des</strong> impacts<br />
sur la sécurité alimentaire mondia<strong>le</strong>. En 2009,<br />
<strong>le</strong> nombre de personnes ayant faim dans<br />
<strong>le</strong> monde a augmenté jusqu’à 1,02 milliard,<br />
<strong>le</strong> chiffre <strong>le</strong> plus é<strong>le</strong>vé depuis 1970. Depuis<br />
l’année passée, plus de 100 millions de<br />
personnes ayant faim se sont ajoutées.<br />
Le plus grand <strong>par</strong>adoxe est que 70 % de<br />
ceux qui ont faim vivent en zones rura<strong>le</strong>s.<br />
Et <strong>le</strong>s plus touchés sont <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong>s<br />
enfants.<br />
Pourtant, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> produisent 60 à 80 %<br />
<strong>des</strong> aliments dans <strong>le</strong>s pays du Sud <strong>et</strong> sont<br />
responsab<strong>le</strong>s de la moitié de la production<br />
alimentaire mondia<strong>le</strong> (FAO, 2009).<br />
Par <strong>le</strong>ur rô<strong>le</strong> socioculturel, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
sont responsab<strong>le</strong>s <strong>des</strong> cultures vivrières<br />
(<strong>le</strong>s produits que l’on r<strong>et</strong>rouve chaque jour<br />
sur la tab<strong>le</strong>), de l’approvisionnement en<br />
eau <strong>et</strong> de la col<strong>le</strong>cte <strong>et</strong>/ou production <strong>des</strong><br />
plantes médicina<strong>le</strong>s. Ce sont éga<strong>le</strong>ment<br />
el<strong>le</strong>s qui pré<strong>par</strong>ent <strong>le</strong>s repas <strong>et</strong> cherchent à<br />
équilibrer la diète alimentaire de la famil<strong>le</strong>.<br />
En outre, en milieu urbain, el<strong>le</strong>s contribuent<br />
considérab<strong>le</strong>ment au budg<strong>et</strong> alimentaire<br />
du ménage grâce à <strong>le</strong>urs activités<br />
rémunératrices. Malgré cela, un peu <strong>par</strong>tout<br />
dans <strong>le</strong> monde <strong>et</strong> notamment en Afrique,<br />
ces <strong>femmes</strong> jouissent généra<strong>le</strong>ment de<br />
moins de droits que <strong>le</strong>s hommes : comme<br />
<strong>par</strong> exemp<strong>le</strong> l’accès <strong>et</strong> <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> de la<br />
terre (ou encore la sécurité de garder c<strong>et</strong>te<br />
terre), l’accès aux moyens financiers, aux<br />
moyens de productions, <strong>et</strong>c.<br />
Aussi <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> sont acculées à chercher<br />
<strong>des</strong> terres lointaines, ce qui accroît <strong>le</strong>urs<br />
charges, <strong>et</strong> <strong>par</strong>fois <strong>le</strong>s place dans <strong>des</strong><br />
situations de risques (vio<strong>le</strong>nces, victimes<br />
d’infractions <strong>par</strong> manque d’information<br />
lorsqu’el<strong>le</strong>s tombent sur <strong>des</strong> aires de<br />
pâturages,…).<br />
L’accès <strong>et</strong> <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> <strong>des</strong> moyens<br />
financiers sont restreints : pour <strong>le</strong>s pays<br />
africains, seuls 10 % <strong>des</strong> crédits agrico<strong>le</strong>s<br />
sont octroyés aux <strong>femmes</strong>. El<strong>le</strong>s ont peu<br />
d’accès aux intrants agrico<strong>le</strong>s, que ce<br />
soit aux produits (semences améliorées,<br />
pestici<strong>des</strong>, <strong>et</strong>c.) ou aux outils car el<strong>le</strong>s ne<br />
bénéficient pas de services de vulgarisation<br />
ou manquent de moyens.<br />
De plus, l’accès <strong>et</strong> <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> du temps <strong>et</strong> de<br />
la main d’œuvre sont aussi problématiques.<br />
Les <strong>femmes</strong> doivent combiner <strong>le</strong>s charges<br />
liées à la reproduction de la famil<strong>le</strong> <strong>et</strong><br />
<strong>le</strong> travail productif, ce qui fait que <strong>le</strong>urs<br />
journées sont souvent surchargées.<br />
Enfin, <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> ont peu d’accès à<br />
l’information, à la formation <strong>et</strong> à la prise<br />
de décision <strong>et</strong> souvent, <strong>le</strong>urs besoins<br />
pratiques <strong>et</strong> <strong>le</strong>urs intérêts ne sont pas pris<br />
en cause car el<strong>le</strong>s sont trop peu ou pas<br />
assez représentées dans <strong>le</strong>s instances de<br />
prise de décision.<br />
Le défi à re<strong>le</strong>ver consiste à atteindre<br />
l’égalité entre <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong>s hommes<br />
dans l’accès <strong>et</strong> <strong>le</strong> maintien <strong>des</strong> <strong>ressources</strong><br />
<strong>le</strong>ur perm<strong>et</strong>tant ainsi de contribuer<br />
ensemb<strong>le</strong> à la sécurité alimentaire, dont<br />
<strong>le</strong>s trois éléments centraux sont : la<br />
disponibilité <strong>des</strong> aliments, c’est-à-dire une<br />
production alimentaire suffisante, l’accès<br />
économique <strong>et</strong> physique aux denrées<br />
alimentaires exploitab<strong>le</strong>s <strong>et</strong> enfin la sécurité<br />
95
5. CONCLUSION ET RECOmmANDATIONS<br />
nutritionnel<strong>le</strong>. Les <strong>femmes</strong> remplissent<br />
<strong>des</strong> fonctions importantes dans l’apport<br />
de ces trois éléments indispensab<strong>le</strong>s à la<br />
sécurité alimentaire.<br />
• L’empowerment <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
comme stratégie durabLe<br />
Durant c<strong>et</strong>te dernière décennie, <strong>le</strong> thème<br />
de la sécurité alimentaire a reçu de plus<br />
en plus d’attention <strong>et</strong> <strong>le</strong>s stratégies pour<br />
re<strong>le</strong>ver ce défi ont de fait évolué. La démarche<br />
d’empowerment <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
s’inscrit donc logiquement comme piste<br />
de solution, au niveau individuel <strong>et</strong> au<br />
niveau <strong>des</strong> organisations. Quatre composantes<br />
sont prises en compte: AVOIR (<strong>le</strong><br />
pouvoir économique) – SAVOIR (<strong>le</strong> pouvoir<br />
<strong>des</strong> connaissances) – VOULOIR (<strong>le</strong><br />
pouvoir interne) – POUVOIR (<strong>le</strong> pouvoir<br />
social <strong>et</strong> politique).<br />
C’est pourquoi la Commission Femmes <strong>et</strong><br />
Développement recommande à tous <strong>le</strong>s<br />
niveaux d’acteurs* de m<strong>et</strong>tre en priorité<br />
ces quatre composantes dans <strong>le</strong>s politiques<br />
de développement.<br />
AVOIR<br />
L’objectif de l’avoir suppose l’égalité<br />
dans l’accès <strong>et</strong> <strong>le</strong> contrô<strong>le</strong> <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
aux <strong>ressources</strong>, à la terre, au temps,<br />
aux crédits, aux marchés <strong>et</strong> aux<br />
technologies <strong>le</strong>ur perm<strong>et</strong>tant de<br />
produire <strong>le</strong>s aliments.<br />
Promulguer <strong>et</strong> appliquer <strong>le</strong>s lois qui<br />
accordent <strong>des</strong> droits égaux de propriété<br />
aux <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> aux hommes<br />
– notamment <strong>le</strong>s lois relatives à<br />
l’héritage <strong>des</strong> terres -; sensibiliser<br />
<strong>le</strong>s chefs traditionnels ainsi que <strong>le</strong>s<br />
populations à la base pour que ces<br />
lois soient appliquées.<br />
Encourager la production <strong>et</strong> la<br />
diversification <strong>des</strong> cultures vivrières<br />
grâce à plus d’informations, à <strong>des</strong><br />
recherches-actions <strong>et</strong> à d’autres<br />
activités de vulgarisation.<br />
Encourager <strong>le</strong> développement <strong>des</strong><br />
techniques d’allègement <strong>des</strong> tâches,<br />
encourager la ré<strong>par</strong>tition éga<strong>le</strong> <strong>des</strong><br />
tâches entre hommes <strong>et</strong> <strong>femmes</strong> <strong>et</strong><br />
entre garçons <strong>et</strong> fil<strong>le</strong>s.<br />
M<strong>et</strong>tre en place <strong>des</strong> services sociaux<br />
(garderies d’enfants, <strong>et</strong>c.)<br />
Assurer l’approvisionnement en eau<br />
potab<strong>le</strong>, en é<strong>le</strong>ctricité <strong>et</strong> en énergies<br />
renouvelab<strong>le</strong>s.<br />
Améliorer l’accès aux soins de santé<br />
<strong>et</strong> de nutrition.<br />
Favoriser la création de mutuel<strong>le</strong>s<br />
d’é<strong>par</strong>gne <strong>et</strong> de crédit à <strong>des</strong> conditions<br />
accessib<strong>le</strong>s à toutes <strong>et</strong> à tous.<br />
Encourager <strong>et</strong> accompagner <strong>le</strong>s<br />
activités génératrices de revenus<br />
comme la transformation de produits<br />
agrico<strong>le</strong>s vivriers <strong>et</strong> la création de<br />
micro-entreprises rura<strong>le</strong>s.<br />
Impliquer <strong>le</strong>s hommes <strong>et</strong> <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
dans la gestion <strong>et</strong> l’organisation <strong>des</strong><br />
travaux aux champs ainsi que <strong>des</strong><br />
greniers en Afrique de l’Ouest.<br />
Améliorer <strong>le</strong>s infrastructures de<br />
transport.<br />
Améliorer l’accessibilité <strong>et</strong> la qualité<br />
<strong>des</strong> marchés <strong>par</strong> une meil<strong>le</strong>ure<br />
mobilité (en termes d’accès,<br />
temps, moyens <strong>et</strong> permission) <strong>et</strong><br />
<strong>par</strong> une promotion du commerce<br />
équitab<strong>le</strong>.<br />
96
Améliorer <strong>le</strong>s infrastructures de<br />
stockage <strong>et</strong> <strong>le</strong>s techniques de<br />
conservation.<br />
Promouvoir la certification <strong>des</strong> produits<br />
biologiques.<br />
SAVOIR<br />
L’objectif du savoir est la création, la diffusion<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong> <strong>par</strong>tage <strong>des</strong> connaissances ainsi<br />
que l’élaboration de données statistiques<br />
sur l’agriculture qui prennent en considération<br />
<strong>le</strong>s inégalités <strong>femmes</strong>/hommes.<br />
S’assurer que dans <strong>le</strong>s recherches,<br />
diagnostics <strong>et</strong> col<strong>le</strong>ctes de données,<br />
toutes <strong>le</strong>s informations soient<br />
différenciées <strong>par</strong> sexe.<br />
S’assurer que <strong>le</strong>s recherches tiennent<br />
compte <strong>des</strong> questions spécifiques au<br />
genre (vio<strong>le</strong>nce, accès <strong>et</strong> contrô<strong>le</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>ressources</strong>, accès aux aliments, identification<br />
<strong>des</strong> discriminations alimentaires,<br />
ré<strong>par</strong>tition de la diète alimentaire<br />
au sein de la famil<strong>le</strong>, identification<br />
<strong>des</strong> pratiques coutumières favorab<strong>le</strong>s<br />
<strong>et</strong> défavorab<strong>le</strong>s aux <strong>femmes</strong>).<br />
Développer <strong>des</strong> recherches-actions<br />
qui tiennent compte <strong>des</strong> spécificités<br />
<strong>des</strong> hommes <strong>et</strong> <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> notamment<br />
sur <strong>des</strong> thèmes comme:<br />
> Les rô<strong>le</strong>s <strong>des</strong> hommes <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>femmes</strong> dans l’agriculture<br />
> La production <strong>et</strong> la conservation<br />
de semences<br />
> L’impact <strong>des</strong> changements climatiques<br />
sur la sécurité alimentaire<br />
> L’impact <strong>des</strong> politiques de coopération<br />
sur la sécurité <strong>et</strong> la souverain<strong>et</strong>é<br />
alimentaire.<br />
Impliquer hommes <strong>et</strong> <strong>femmes</strong> dans<br />
la formation <strong>et</strong> <strong>le</strong>s campagnes de<br />
sensibilisation sur : <strong>le</strong> genre, <strong>le</strong>s lois<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong>s droits, la nutrition, <strong>le</strong> fonctionnement<br />
<strong>des</strong> services techniques,<br />
<strong>le</strong>s cultures vivrières <strong>et</strong> durab<strong>le</strong>s,<br />
l’alphabétisation fonctionnel<strong>le</strong>, économique<br />
<strong>et</strong> politique.<br />
Renforcer <strong>le</strong>s capacités <strong>des</strong> services<br />
techniques au niveau national <strong>et</strong><br />
décentralisé en matière de sécurité<br />
alimentaire.<br />
Développer <strong>et</strong> soutenir <strong>des</strong> systèmes<br />
de communication accessib<strong>le</strong>s aux<br />
populations rura<strong>le</strong>s, périurbaines<br />
<strong>et</strong> urbaines prenant en compte <strong>le</strong>s<br />
thématiques ayant trait aux accès <strong>et</strong><br />
contrô<strong>le</strong> <strong>des</strong> <strong>ressources</strong>, à la nutrition,<br />
aux discriminations alimentaires <strong>et</strong><br />
aux droits <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>.<br />
Organiser <strong>des</strong> visites d’échanges d’expériences<br />
pour <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> hommes<br />
afin de valoriser <strong>des</strong> approches innovatrices<br />
sur <strong>le</strong> plan technique <strong>et</strong> sur<br />
<strong>le</strong> plan social (changement <strong>des</strong> rô<strong>le</strong>s<br />
hommes/<strong>femmes</strong>).<br />
Encourager la valorisation <strong>et</strong> la<br />
capitalisation <strong>des</strong> connaissances<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> <strong>des</strong> hommes sur <strong>le</strong>s<br />
écosystèmes <strong>et</strong> <strong>le</strong>s cultures traditionnel<strong>le</strong>s.<br />
Col<strong>le</strong>cter <strong>des</strong> données différenciées<br />
<strong>par</strong> sexe sur l’agriculture <strong>et</strong> sur<br />
<strong>le</strong>s trois piliers de la sécurité<br />
alimentaire:<br />
> Disponibilité/Production<br />
> Accessibilité/Marchés<br />
> Utilisation/Nutrition<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong>s m<strong>et</strong>tre au service <strong>des</strong> planificateurs,<br />
techniciens <strong>et</strong> décideurs.<br />
97
5. CONCLUSION ET RECOmmANDATIONS<br />
VOULOIR<br />
L’objectif du vouloir c’est <strong>le</strong> changement<br />
<strong>des</strong> mentalités vers <strong>des</strong> normes <strong>et</strong> coutumes<br />
favorab<strong>le</strong>s à tous <strong>le</strong>s membres de<br />
la famil<strong>le</strong>, ainsi que l’appui au <strong>le</strong>adership<br />
féminin.<br />
Appuyer la sensibilisation de tous<br />
<strong>le</strong>s acteurs concernés (autorités<br />
loca<strong>le</strong>s, religieuses <strong>et</strong> coutumières,<br />
hommes, <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> enfants) au<br />
respect <strong>des</strong> droits <strong>des</strong> <strong>femmes</strong>.<br />
Assurer un environnement de sécurité<br />
physique pour perm<strong>et</strong>tre<br />
aux <strong>femmes</strong> d’assumer <strong>le</strong>urs fonctions<br />
en tant que productrices,<br />
gestionnaires, transformatrices,<br />
commerçantes…<br />
Travail<strong>le</strong>r sur l’estime de soi <strong>des</strong><br />
<strong>femmes</strong> <strong>et</strong> appuyer l’émergence de<br />
<strong>femmes</strong> <strong>le</strong>aders.<br />
M<strong>et</strong>tre en œuvre <strong>le</strong>s rég<strong>le</strong>mentations<br />
visant à lutter contre toute forme de<br />
discrimination envers <strong>le</strong>s <strong>femmes</strong><br />
pour ce qui concerne l’accès <strong>et</strong> <strong>le</strong><br />
contrô<strong>le</strong> <strong>des</strong> <strong>ressources</strong> (la terre <strong>et</strong><br />
<strong>le</strong>s moyens de production), la ré<strong>par</strong>tition<br />
de la diète alimentaire au sein<br />
de la famil<strong>le</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong>s tabous alimentaires.<br />
M<strong>et</strong>tre en place <strong>des</strong> réseaux d’organisations<br />
de <strong>femmes</strong>.<br />
Former <strong>le</strong>s hommes <strong>et</strong> <strong>le</strong>s jeunes au<br />
respect <strong>des</strong> <strong>femmes</strong> <strong>et</strong> aux bonnes<br />
règ<strong>le</strong>s de vie (santé, alimentation,<br />
<strong>et</strong>c.).<br />
POUVOIR<br />
L’objectif du pouvoir est que la société civi<strong>le</strong><br />
-notamment <strong>le</strong>s groupements de <strong>femmes</strong><strong>par</strong>ticipe<br />
à l’élaboration <strong>des</strong> politiques en<br />
matière de sécurité alimentaire. C’est-à-dire<br />
soutenir une autonomie <strong>des</strong> Etats pour qu’ils<br />
assurent une sécurité alimentaire <strong>et</strong> qu’ils<br />
soutiennent une agriculture familia<strong>le</strong> durab<strong>le</strong>.<br />
Reconnaître <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> fondamental <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
dans la sécurité alimentaire <strong>et</strong> rendre <strong>le</strong>s lois<br />
en matière de genre effectives.<br />
Examiner <strong>et</strong> réorienter <strong>le</strong>s politiques<br />
agrico<strong>le</strong>s <strong>et</strong> alimentaires afin qu’el<strong>le</strong>s<br />
défendent une agriculture familia<strong>le</strong><br />
durab<strong>le</strong> <strong>et</strong> prennent en compte <strong>le</strong>s<br />
intérêts <strong>par</strong>ticuliers <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
dans l’exploitation familia<strong>le</strong>, qui<br />
n’est pas un tout homogène.<br />
Régu<strong>le</strong>r la filière agroalimentaire<br />
afin de protéger une agriculture<br />
loca<strong>le</strong> dans <strong>le</strong>s pays où la sécurité<br />
alimentaire n’est pas assurée.<br />
Renforcer <strong>le</strong> pouvoir politique <strong>des</strong><br />
Etats pour régu<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s marchés afin<br />
de garantir <strong>le</strong> droit à l’alimentation<br />
<strong>et</strong> <strong>des</strong> prix rémunérateurs <strong>et</strong> stab<strong>le</strong>s<br />
pour <strong>le</strong>s producteurs <strong>et</strong> productrices<br />
dans un contexte de forte volatilité<br />
<strong>et</strong> de défis climatiques.<br />
Appuyer l’intégration <strong>des</strong> <strong>femmes</strong><br />
dans <strong>le</strong>s structures de pouvoir ainsi<br />
que <strong>le</strong>ur <strong>par</strong>ticipation effective au<br />
développement rural <strong>et</strong> aux stratégies<br />
de sécurité alimentaire.<br />
Veil<strong>le</strong>r à la prise en compte de la dimension<br />
du genre lors de l’élaboration<br />
<strong>des</strong> budg<strong>et</strong>s (genderbudg<strong>et</strong>ing)<br />
98
<strong>des</strong> ministères techniques concernés<br />
(agriculture, économie/finances, développement<br />
rural, environnement) <strong>et</strong><br />
<strong>le</strong>ur attribuer un budg<strong>et</strong> adéquat.<br />
Impliquer <strong>le</strong> ministère en charge<br />
de la promotion de la femme dans<br />
l’analyse <strong>et</strong> l’élaboration <strong>des</strong> politiques<br />
nationa<strong>le</strong>s agrico<strong>le</strong>s <strong>et</strong> de sécurité<br />
alimentaire. Faire <strong>des</strong> liens entre <strong>le</strong>s<br />
ministères tels que l’agriculture, <strong>le</strong><br />
développement rural, l’environnement<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong> ministère de la femme notamment<br />
à travers <strong>des</strong> espaces interministériels<br />
réservés à une analyse de genre.<br />
Elaborer <strong>des</strong> lois qui garantissent<br />
un accès équitab<strong>le</strong> aux <strong>ressources</strong><br />
naturel<strong>le</strong>s, productives <strong>et</strong> à l’alimentation<br />
(droit à l’alimentation).<br />
Revoir <strong>le</strong>s textes fondamentaux en<br />
vigueur (Constitution), vérifier <strong>le</strong>ur<br />
application afin de garantir un accès<br />
<strong>et</strong> un contrô<strong>le</strong> équitab<strong>le</strong>s aux <strong>ressources</strong><br />
naturel<strong>le</strong>s (eau, terre, biodiversité,<br />
<strong>et</strong>c.), à la connaissance, aux<br />
crédits <strong>et</strong> aux infrastructures.<br />
Promouvoir <strong>le</strong>s organisations de<br />
<strong>femmes</strong> (organisations agrico<strong>le</strong>s <strong>et</strong><br />
d’économie solidaire liées à l’agroalimentaire).<br />
Renforcer la <strong>par</strong>ticipation effective<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> dans l’organisation <strong>et</strong> la<br />
gestion financière de la production,<br />
du stockage <strong>et</strong> de la commercialisation<br />
<strong>des</strong> produits agrico<strong>le</strong>s au sein<br />
<strong>des</strong> organisations agrico<strong>le</strong>s <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />
organisations faitières.<br />
Encourager une plus grande <strong>par</strong>ticipation<br />
<strong>des</strong> <strong>femmes</strong> quant à la prise<br />
de décisions au sein <strong>des</strong> ménages.<br />
* acteurs à qui sont adressées<br />
<strong>le</strong>s recommandations<br />
= Etat :<br />
gouvernements nationaux, locaux,<br />
services techniques, ministères de<br />
l’Agriculture <strong>et</strong> ministères en charge<br />
de la promotion féminine,<br />
institutions internationa<strong>le</strong>s.<br />
= Autorités coutumières :<br />
autorités coutumières, religieuses <strong>et</strong><br />
traditionnel<strong>le</strong>s.<br />
= Organismes de recherche :<br />
universités, instituts nationaux<br />
statistiques, éco<strong>le</strong>s agrico<strong>le</strong>s.<br />
= Société civi<strong>le</strong> :<br />
organisations paysannes, ONG,<br />
groupements de <strong>femmes</strong>, famil<strong>le</strong>s,<br />
médias.<br />
99
Commission Femmes <strong>et</strong> Développement<br />
DGD, Direction Généra<strong>le</strong> de la Coopération au Développement<br />
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur <strong>et</strong> Coopération au développement<br />
Rue <strong>des</strong> P<strong>et</strong>its Carmes 15 (Na 59 – B305) - 1000 Brussel<br />
Tel. +32 2 501.44.43 - Fax +32 2 501.45.44<br />
cvo-cfd@diplobel.fed.be<br />
http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/CFD/