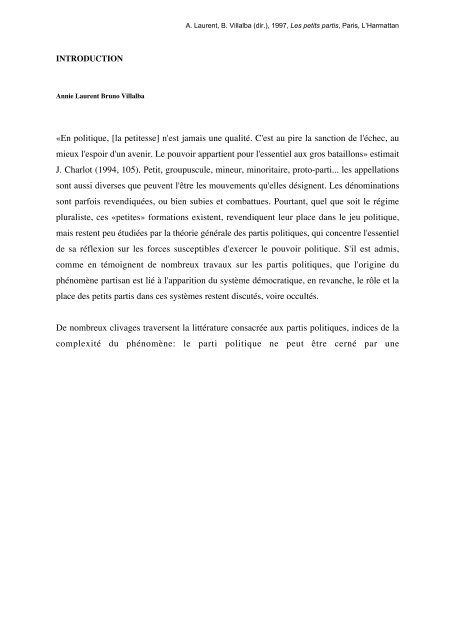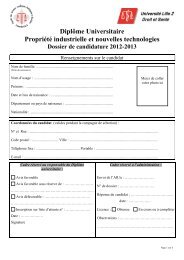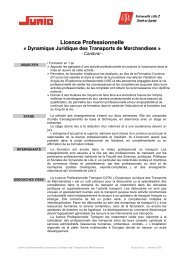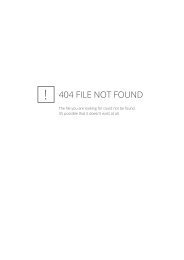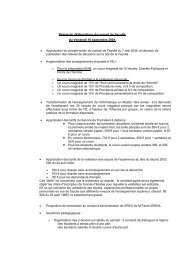Télécharger l'introduction - Université Lille 2 Droit et Santé
Télécharger l'introduction - Université Lille 2 Droit et Santé
Télécharger l'introduction - Université Lille 2 Droit et Santé
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
A. Laurent, B. Villalba (dir.), 1997, Les p<strong>et</strong>its partis, Paris, L’Harmattan<br />
INTRODUCTION<br />
Annie Laurent Bruno Villalba<br />
«En politique, [la p<strong>et</strong>itesse] n'est jamais une qualité. C'est au pire la sanction de l'échec, au<br />
mieux l'espoir d'un avenir. Le pouvoir appartient pour l'essentiel aux gros bataillons» estimait<br />
J. Charlot (1994, 105). P<strong>et</strong>it, groupuscule, mineur, minoritaire, proto-parti... les appellations<br />
sont aussi diverses que peuvent l'être les mouvements qu'elles désignent. Les dénominations<br />
sont parfois revendiquées, ou bien subies <strong>et</strong> combattues. Pourtant, quel que soit le régime<br />
pluraliste, ces «p<strong>et</strong>ites» formations existent, revendiquent leur place dans le jeu politique,<br />
mais restent peu étudiées par la théorie générale des partis politiques, qui concentre l'essentiel<br />
de sa réflexion sur les forces susceptibles d'exercer le pouvoir politique. S'il est admis,<br />
comme en témoignent de nombreux travaux sur les partis politiques, que l'origine du<br />
phénomène partisan est lié à l'apparition du système démocratique, en revanche, le rôle <strong>et</strong> la<br />
place des p<strong>et</strong>its partis dans ces systèmes restent discutés, voire occultés.<br />
De nombreux clivages traversent la littérature consacrée aux partis politiques, indices de la<br />
complexité du phénomène: le parti politique ne peut être cerné par une
A. Laurent, B. Villalba (dir.), 1997, Les p<strong>et</strong>its partis, Paris, L’Harmattan<br />
seule approche, pas plus qu'appréhendé par une seule définition. De multiples entrées ont tour<br />
à tour été sollicitées, oubliées, revisitées. Dès le début du XXe siècle, Moisei Ostrogorski,<br />
Roberto Michels <strong>et</strong> Max Weber ont pensé les partis comme des formes organisationnelles<br />
capables de concilier l'émancipation des masses avec le principe représentatif Ces analyses<br />
accordent une place centrale à la question de l'organisation. C<strong>et</strong>te notion marque durablement<br />
la recherche sur les partis politiques. En 1951, la construction typologique présentée par<br />
Maurice Duverger complète des connaissances jusqu'alors acquises pour systématiser<br />
l'importance centrale de l'organisation, au niveau interne, mais aussi au niveau du système de<br />
partis (DUVERGER, 1951). Depuis lors, les partis politiques n'ont cessé d'occuper une place<br />
prédominante dans les travaux de science politique menés tant en France qu'à l'étranger. Mais<br />
les recherches ont depuis diversifié les angles d'approche. L'unidimensionnalité, fondée sur<br />
l'analyse privilégiée d'une dimension particulière du parti, en l'occurrence la question<br />
organisationnelle, a été quelque peu remise en question (LAVAU, 1953).<br />
La division typologique de M. Duverger (parti de cadres, parti de masses) s'est tout d'abord<br />
vu complétée, amendée <strong>et</strong> nuancée par les notions de parti "stratarchique" (Samuel<br />
Eldersveld), de parti "attrape-tout" (Otto Kirchheimer) ou bien encore de parti "d'électeurs"<br />
(Jean Charlot).<br />
Ensuite, l'essai typologique a été en partie abandonné, laissant la place à une approche plus<br />
fonctionnelle de l'activité des partis politiques. Ces analyses insistent sur l'ancrage social des<br />
partis politiques. Ils sont étudiés comme des éléments légitimant la démocratie (KEY, 1964)<br />
ou comme des facteurs d'intégration sociale (LAVAU, 1953). Ils ont aussi une fonction de<br />
mobilisation<br />
10
A. Laurent, B. Villalba (dir.), 1997, Les p<strong>et</strong>its partis, Paris, L’Harmattan<br />
(OBERSCHALL, 1973) ou de connexion (LAWSON, 1976 <strong>et</strong> 1980). D'autres auteurs<br />
insistent davantage sur leur dimension idéologique (ARON, 1955; KRIEGEL, 1969)...<br />
Cependant, les symptômes d'une crise actuelle des partis, comme l'affaiblissement du lien<br />
avec les électeurs (KATZ, MAIR, 1995) ou l'accroissement de la volatilité électorale<br />
(BARTOLINI, MAIR, 1990), renforcent la difficulté d'une vision unidimensionnelle, qu'elle<br />
soit organisationnelle ou fonctionnelle, de la forme-parti.<br />
L'essai typologique, sur la base d'une seule dimension, est lui-même remis en cause. Des<br />
analyses multidimensionnelles ont été proposées, prenant en compte simultanément plusieurs<br />
axes, offrant ainsi une vision plus dynamique de l'étude du phénomène partisan. Elles ont<br />
permis de mieux comprendre l'évolution du système partisan (SARTORI, 1976), <strong>et</strong> la<br />
question du parti. Ainsi, S. Rokkan <strong>et</strong> M. Lips<strong>et</strong> (1967) classent les forces politiques selon le<br />
système des clivages socio-historiques. C<strong>et</strong>te classification a été complétée par Jean <strong>et</strong><br />
Monica Charlot, qui ont introduit un nouveau clivage concernant l'EtatlSociété (CHARLOT,<br />
CHARLOT, 1985). Elle a aussi été approfondie, notamment sur le cas français, par D.-L.<br />
Seiler; la grande majorité des partis, du moins occidentaux, peuvent désormais être ventilés<br />
selon des taxinomies plus ou moins complexes qui autorisent leur classement au sein de<br />
«familles» politiques (SElLER, 1986, 1993). De fait, l'approche comparative a largement<br />
contribué à bousculer les repères contextualisés de l'étude des partis politiques (ainsi en est-il<br />
de l'axe gauche/droite, BLONDEL, 1978). C'est aussi une conception multidimensionnelle<br />
qu'ont r<strong>et</strong>enue Rose <strong>et</strong> Urwin pour établir une classification des partis politiques fondée, c<strong>et</strong>te<br />
fois, sur la cohésion sociale (ROSE, URWIN, 1971).<br />
Enfin, on a aussi vu apparaître progressivement un<br />
11
A. Laurent, B. Villalba (dir.), 1997, Les p<strong>et</strong>its partis, Paris, L’Harmattan<br />
cadre d'analyse plus sociologique de l'étude des partis, qui tente d'éviter toute approche<br />
normative. C<strong>et</strong>te théorie s'inspire des réflexions générales de M. Weber, de Pierre Bourdieu,<br />
<strong>et</strong> va, à la suite de M. Ostrogorski, étudier les partis comme des entreprises politiques, dont le<br />
but est le pouvoir, <strong>et</strong> dont l'un des moteurs est la rétribution (GAXIE; 1973). En outre, les<br />
partis sont perçus comme des espaces de concurrence objectivée entre les agents luttant pour<br />
le contrôle des ressources collectives (OFFERLE, 1987; SAWICKI, 1997). Signalons aussi<br />
des travaux novateurs en sociologie historique ou en anthropologie politique, qui tentent de<br />
saisir les permanences de l'ancrage partisan (HUARD, 1996), les mécanismes de sa<br />
perpétuation ou les formes de sa sociabilité (HASTINGS, 1991).<br />
Qu'elles soient unidimensionnelles ou multidimensionnelles, ces démarches ont renoncé à<br />
saisir le parti dans sa globalité. Néanmoins, au regard de c<strong>et</strong>te littérature, on constate que la<br />
recherche se concentre autour de la forme-parti en mesure de peser sur la décision politique<br />
(telle la notion de parti de gouvernement, CHARLOT, 1994). Pourtant, même si les<br />
modalités d'organisation <strong>et</strong> de fonctionnement dans la sphère politique se sont modifiées<br />
depuis les origines de la démocratie représentative (AVRIL, 1990; POMBENI, 1992), on<br />
r<strong>et</strong>rouve des formes-partis minoritaires qui, à l'image des formes-partis dominants, participent<br />
au jeu démocratique. Malgré c<strong>et</strong>te présence régulière, les taxinomies leur offrent une place<br />
subalterne dans le système partisan (CHARLOT, 1994), ou une fonction perturbatrice<br />
(PATRIAT, 1992), antisystème (CHARLOT, 1971 ; YSMAL, 1992), voire hors système<br />
(PERRINEAU, 1993).<br />
Le présent ouvrage, issu d'un colloque organisé par le Centre de Recherches Administratives,<br />
Politiques <strong>et</strong><br />
12
A. Laurent, B. Villalba (dir.), 1997, Les p<strong>et</strong>its partis, Paris, L’Harmattan<br />
Sociales (CRAPS) à <strong>Lille</strong> en 1996, contribue au débat sur la notion de p<strong>et</strong>it parti,<br />
communément utilisée par les acteurs eux-mêmes (appellation politique qu'ils acceptent,<br />
qu'ils rej<strong>et</strong>tent ou tentent de nier), par l'électeur (qui évalue son vote), par l'observateur.<br />
Huit contributions sont ici présentées. Elles s'appuient pour l'essentiel sur le cas français, <strong>et</strong><br />
proposent une démarche pluridisciplinaire <strong>et</strong> comparative. Les différents auteurs n'ont pas eu<br />
pour objectif prioritaire de proposer une nouvelle classification schématique du p<strong>et</strong>it parti,<br />
ni de construire un nouveau modèle dans lequel on tenterait d'insérer les différents p<strong>et</strong>its<br />
partis. Ils se sont davantage interrogés sur l'apport <strong>et</strong> les limites des usages les plus fréquents<br />
de la notion de p<strong>et</strong>it parti, qui, généralement, soit désigne une catégorie particulière<br />
s'opposant à une autre (les "grands"), soit qualifie une force politique donnée (Ligue<br />
communiste révolutionnaire (LCR), Parti des forces nouvelles (PFN), Les Verts...).<br />
Deux modes de lecture de la p<strong>et</strong>itesse peuvent être avancés à partir de ces contributions.<br />
Le premier concerne la construction du parti autour du vocable p<strong>et</strong>it. Ainsi, Annie Laurent<br />
montre qu'il n'existe ni une définition, ni un critère d'analyse unique, mais une pluralité, liée à<br />
chaque étape du processus électoral. C'est ainsi qu'à la veille du scrutin, le p<strong>et</strong>it parti peut être<br />
défini à partir de l'offre électorale ou de la capacité à négocier des alliances; au lendemain de<br />
l'élection, le score, le nombre d'élus ou les alliances « gouvernementales» perm<strong>et</strong>tent d'arrêter<br />
d'autres définitions, d'autres critères du p<strong>et</strong>it parti (Définir les p<strong>et</strong>its partis: le regard de<br />
l'électoraliste). Daniel Boy propose de définir un p<strong>et</strong>it parti à partir de sa structure<br />
d'implantation territoriale, établie sur la base d'un indicateur statistique (le coefficient de<br />
corrélation) construit sur les résultats obtenus par les partis à plusieurs scrutins<br />
13
A. Laurent, B. Villalba (dir.), 1997, Les p<strong>et</strong>its partis, Paris, L’Harmattan<br />
(Les p<strong>et</strong>its partis . niveau, structure <strong>et</strong> sens). Dans ces deux chapitres, il apparaît que le<br />
concept de p<strong>et</strong>it, couramment utilisé, est relatif, même sur courte période, <strong>et</strong> qu'il ne fait sens<br />
que pour une hypothèse donnée <strong>et</strong> dans un système de partis précis.<br />
L'étude des p<strong>et</strong>its partis en tant que catégorie n'est pas spécifique aux électoralistes ; d'autres<br />
regards peuvent éclairer les débats que suscitent ces partis parfois qualifiés de perturbateurs.<br />
Ainsi, Bruno Villalba a étudié la relation qu'entr<strong>et</strong>iennent les p<strong>et</strong>its partis avec l'idéologie, ce<br />
qui les conduit à une attitude différente vis-à-vis de la logique représentative; certains<br />
privilégient la différenciation idéologique au détriment d'une insertion dynamique au jeu<br />
politique, d'autres préfèrent développer une logique d'intégration (Les p<strong>et</strong>its partis face à<br />
l'idéologie: le paradoxe de la différenciation). Bernard Dolez s'est interrogé sur la question<br />
du financement des partis politiques. L'analyse des lois sur le financement montre que le<br />
souci du législateur est moins de distinguer les p<strong>et</strong>its des grands que d'isoler les faux partis<br />
des autres, ou de perm<strong>et</strong>tre l'émergence de nouveaux partis (Les «p<strong>et</strong>its » partis au regard de<br />
la réglementation du financement de la vie politique). En étudiant le traitement journalistique<br />
que la presse écrite réserve aux p<strong>et</strong>its partis, Eric Dupin montre que l'accès aux médias reste<br />
le privilège des grands, de ceux qui sont au pouvoir, qui y ont été ou risquent d'y revenir. Les<br />
p<strong>et</strong>its partis ne font guère rec<strong>et</strong>te. L'attitude des médias à leur égard oscille entre le mépris <strong>et</strong><br />
l'indifférence (Médias <strong>et</strong> p<strong>et</strong>its partis : entre le mépris <strong>et</strong> l'indifférence).<br />
Le second mode de lecture prend en considération le rôle joué par ces p<strong>et</strong>ites formations au<br />
regard de la relation qu'ils entr<strong>et</strong>iennent avec leur propre organisation, ou avec le système<br />
électoral. C'est la question de l'autonomie qui est ici sous-jacente, par rapport. au système<br />
partisan. Trois<br />
14
A. Laurent, B. Villalba (dir.), 1997, Les p<strong>et</strong>its partis, Paris, L’Harmattan<br />
contributions s'appuyant sur l'étude précise d'une ou plusieurs forces politiques données,<br />
considérées par les auteurs comme p<strong>et</strong>ites, perm<strong>et</strong>tent de rendre compte de c<strong>et</strong>te notion. La<br />
première est de nature comparative. Ferdinand Müller-Rommel étudie l'implantation, le<br />
succès ou l'échec des écologistes <strong>et</strong> des mouvements d'extrême droite dans une recherche<br />
menée au sein de seize pays de l'Europe de l'Ouest. Les différences observées font d'autant<br />
plus sens que l'auteur inscrit son étude dans la durée (19851994) qui, seule, traduit le<br />
mouvement (The New Challengers: Explaining the Electoral Success of Green and<br />
Right-Wing Populist Parties in Western Europe). C'est aussi la prise en compte du temps qui<br />
perm<strong>et</strong> à JeanPhilippe Roy, dans son étude sur le Front national, de montrer comment une<br />
force politique, perçue comme p<strong>et</strong>ite au début des années quatre-vingts peut être considérée<br />
comme grande, au moins au regard des scores (Grandir<br />
le Front national). Enfin, une troisième contribution atteste que l'espace en jeu n'est pas<br />
seulement géographique, il est aussi politique. Alexis Massart montre que l'UDF,<br />
apparemment grand, n'a de sens que si l'on considère au préalable le fait que chacune de ses<br />
composantes avait intériorisé sa p<strong>et</strong>itesse politique (L'Union pour la démocratie française:<br />
entre grand parti <strong>et</strong> p<strong>et</strong>ites composantes).<br />
Questionner la hiérarchie des résultats électoraux ou les fondements de l'engagement,<br />
analyser les modes de représentation de la p<strong>et</strong>itesse, réévaluer les perspectives de la grandeur<br />
en politique en tenant compte du rythme de vie des partis, c'est en définitive s'interroger sur<br />
la forme-parti.<br />
15
A. Laurent, B. Villalba (dir.), 1997, Les p<strong>et</strong>its partis, Paris, L’Harmattan<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
ARON R. (1955), L'opium des intellectuels, Paris, Calmann-Lévy.<br />
AVRIL P. (1990), Essais sur les partis politiques, Paris, Payot (p<strong>et</strong>ite bibliothèque), (1 éd.<br />
1985).<br />
BARTOLINI S., MAIR P. (1990), Identity, Comp<strong>et</strong>ition and Electoral Availability: The<br />
Stabilization of European Electorates, 1885-1985, Cambridge, CUP.<br />
BLONDEL J. (1978), Political Parties: A Genuine Case for Discontent, London Wildwood<br />
House.<br />
CHARLOT J. (1971), Les partis politiques, Paris, A. Colin.<br />
CHARLOT J. (1994), La politique en France, Paris, Le Livre de Poche, coil. «références »<br />
n°509.<br />
DU VERGER M. (1 éd., 1951), Les Partis Politiques, Paris, A. Colin, Coll. Points Po. 114,<br />
rééd. 1976.<br />
GAXIE D. (1973), Les professionnels de la politique, Paris, PUF.<br />
HASTINGS M. (1991), Halluin la Rouge . 1919-1939. Aspects d'un communisme identitaire.<br />
singularités écologiques <strong>et</strong> singularités d'implantation, <strong>Lille</strong>, Presses universitaires de <strong>Lille</strong>.<br />
HUARD R. (1996), La naissance du parti politique en France, Paris, Presses de Sciences Po.<br />
KATZ R., MAIR P. (1995), Political Parties and Party Systems, Oxford, OUP.<br />
16
A. Laurent, B. Villalba (dir.), 1997, Les p<strong>et</strong>its partis, Paris, L’Harmattan<br />
KEY V. 0. (1964), Politics, Parties and Pressure Groups, New York, Groweil.<br />
KRIEGEL A. (1969), Aux origines du communisme français, Paris, Fiammanon.<br />
LAVAU G. (1953), Partis politiques <strong>et</strong> réalités sociales. Contribution à une étude réaliste<br />
des partis politiques, Paris, A. Colin, coll. «Cahiers de la FNSP ».<br />
LAWSON K. (1976), The Comparative Study of Political Parties, New York, Saint Martin<br />
Press.<br />
LAWSON K. (1980), Political Parties and Linkage. A Comparative Perspective, New York,<br />
Yale University Press.<br />
OFFERLE M. (1987), Les partis politiques, Paris, PUF, coll. Que sais-je ? n°2376.<br />
OBERSCHALL A. (1973), Social Conflict and Social Movements, Enlewood Cliffs, Prentice<br />
Hall.<br />
PATRIAT Cl. (1992), «Pouvoirs régionaux en chantier. Le réglage régional des majorités<br />
nationales? », in PERRINEAU P., YSMAL C. (dir.), Le vote éclaté, Paris, Presses FNSP,<br />
307-326.<br />
PERRINEAU P., YSMAL C. (dir.), Le vote éclaté, Paris, Presses FNSP.<br />
POMBENI P. (1992), Introduction à l'histoire des partis politiques, Paris, PUF, coil. «<br />
Recherches politiques ».<br />
ROKKAN S., UPSET M. (1967), Party Systems And Voters Alignements. Cross National<br />
Perspectives, New York, Free Press.<br />
ROSE R., URWIN D. (1971), «Social Cohesion, Political Parties and Strains in Regimes »,<br />
in DOGAN M., ROSE S. (Eds), European Politics, London Macmillan.<br />
17
A. Laurent, B. Villalba (dir.), 1997, Les p<strong>et</strong>its partis, Paris, L’Harmattan<br />
SARTORI G. (1976), Parties and Party Systems, New York, Harper & Row.<br />
SAWICKI F. (1997), Les réseaux du Parti socialiste. Sociologie d'un milieu partisan, Paris,<br />
Belin.<br />
SElLER D.-L. (1986), De la comparaison des partis politiques, Paris, Economica.<br />
SElLER D.-L. (1993), Les partis politiques, Paris, Armand Colin.<br />
SORAUF F. (1964), Political parties in the American System, Boston Little and Brown.<br />
YSMAL C. (1993), «La diversité des forces anti-système », in PERRINEAU P., YSMAL C.<br />
(dir.), Le vote éclaté, Paris, Presses FNSP.<br />
18