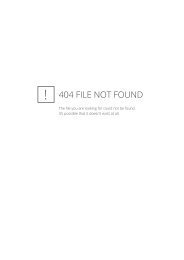Infection à parvovirus B19 et transplantation rénale
Infection à parvovirus B19 et transplantation rénale
Infection à parvovirus B19 et transplantation rénale
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
articles originaux<br />
une copie d’ADN simple brin linéaire de 5,4 kb de long, de polarité<br />
positive ou négative. Le génome du <strong>B19</strong> a des extrémités 3’<br />
<strong>et</strong> 5’ qui s’autohybrident sur elles-mêmes en raison de l’existence<br />
de séquences complémentaires palindromiques. 8 La région<br />
gauche du génome (nucléotides 427 <strong>à</strong> 2449) code pour une protéine<br />
régulatrice de 671 acides aminés, la NS1, indispensable <strong>à</strong> la<br />
réplication virale. 9 La région droite du génome (nucléotides 2897<br />
<strong>à</strong> 3749) code pour deux protéines structurales VP1 (viral protein)<br />
<strong>et</strong> VP2 représentant respectivement les composants mineur (4%)<br />
<strong>et</strong> majeur (96%) de la capside virale. 9<br />
●<br />
Tropisme cellulaire<br />
A partir de sa porte d’entrée, le virus diffuse dans l’organisme<br />
en direction de ses cellules cibles. Récemment, le récepteur<br />
cellulaire du PV<strong>B19</strong> a été identifié. Il s’agit d’un glycosphingolipide<br />
neutre membranaire appelé globoside (Gb4) 10 connu<br />
comme étant un antigène du système de groupe érythrocytaire<br />
P. Sur des cultures de moelle osseuse in vitro, l’utilisation d’anticorps<br />
monoclonaux anti-Gb4 <strong>et</strong> de leurre Gb4 exogène confère<br />
une résistance <strong>à</strong> l’infection par le PV<strong>B19</strong>. 10,11 Un eff<strong>et</strong> identique<br />
est obtenu par l’utilisation de moelle osseuse provenant de suj<strong>et</strong>s<br />
phénotypiquement négatifs pour le Gb4. 10,11<br />
Le Gb4 est présent chez l’homme non seulement sur les érythrocytes<br />
<strong>et</strong> leurs précurseurs médullaires mais aussi sur les cellules<br />
de la lignée mégacaryocytaire, les cellules endothéliales, les<br />
fibroblastes <strong>et</strong> de nombreux tissus d’origine mésodermique (rein,<br />
cœur, poumon, cartilage). 12 C<strong>et</strong>te distribution tissulaire se calque<br />
strictement sur le spectre clinique <strong>et</strong> biologique des infections<br />
par le PV<strong>B19</strong>.<br />
La pénétration virale est donc possible dans un grand nombre<br />
de cellules, cependant, seuls les précurseurs érythroïdes sont permissifs<br />
<strong>et</strong> perm<strong>et</strong>tent la réplication virale. 13 C<strong>et</strong>te spécificité pourrait<br />
être due au fait que la réplication virale nécessite des facteurs<br />
de transcription spécifiques de la lignée érythrocytaire.<br />
La mort cellulaire induite par l’infection virale se fait par deux<br />
voies distinctes: une lyse cellulaire par toxicité directe de certaines<br />
protéines virales, <strong>et</strong> une induction de l’apoptose par interaction<br />
de la protéine NS1 avec la voie de signalisation du récepteur<br />
au TNF alpha. 14<br />
■ <strong>Infection</strong> chez le suj<strong>et</strong><br />
immunocompétent<br />
●<br />
Epidémiologie<br />
Le PV<strong>B19</strong> est un virus ubiquitaire. Les infections <strong>à</strong> PV<strong>B19</strong>, fréquentes,<br />
évoluent le plus souvent sous forme d’épidémie<br />
hiverno-printanière. La séroprévalence du virus augmente avec<br />
l’âge: de 10% entre un <strong>et</strong> cinq ans, elle augmente rapidement <strong>à</strong><br />
60% durant la période scolaire pour atteindre 90% chez les<br />
suj<strong>et</strong>s âgés. 15<br />
Le virus est présent dans les sécrétions respiratoires des suj<strong>et</strong>s<br />
infectés <strong>et</strong> la transmission se fait par contact direct. Une transmission<br />
verticale entre la mère <strong>et</strong> le fœtus est aussi possible. 16<br />
Enfin, une contamination par transfusion sanguine a été décrite<br />
avec un risque estimé <strong>à</strong> 1/3300. 17 En eff<strong>et</strong>, le PV<strong>B19</strong> étant thermostable<br />
<strong>et</strong> dépourvu d’enveloppe lipidique, il ne peut être<br />
308<br />
détruit par les procédés physicochimiques utilisés aujourd’hui<br />
pour l’inactivation du VIH <strong>et</strong> des virus des hépatites.<br />
●<br />
Clinique<br />
Des infections expérimentales chez des volontaires sains non<br />
immuns ont permis d’étudier le déroulement des infections <strong>à</strong><br />
PV<strong>B19</strong> in vivo. 18 La symptomatologie évolue en deux phases:<br />
une fébricule, une sensation de malaise <strong>et</strong> des courbatures marquant<br />
la phase virémique autour du huitième jour, puis au cours<br />
de la troisième semaine, certains patients présentent un rash<br />
cutané <strong>et</strong>/ou des douleurs articulaires. 18<br />
A côté de c<strong>et</strong>te primo-infection d’allure banale, le PV<strong>B19</strong><br />
peut aussi être <strong>à</strong> l’origine de manifestations cliniques plus spécifiques.<br />
Chez l’enfant, il est responsable du mégalérythème épidémique,<br />
ou cinquième maladie, caractérisé par un rash maculopapuleux<br />
débutant au niveau du visage <strong>et</strong> s’étendant au tronc <strong>et</strong><br />
aux extrémités avant de disparaître après cinq <strong>à</strong> neuf jours. Chez<br />
l’adulte, l’atteinte cutanée est moins fréquente <strong>et</strong> la symptomatologie<br />
articulaire prédomine, surtout chez la femme jeune, sous<br />
la forme de polyarthralgies symétriques, régressant habituellement<br />
en deux <strong>à</strong> trois semaines mais qui peuvent se chroniciser<br />
dans 10% des cas. 19<br />
Chez les suj<strong>et</strong>s ayant une érythropoïèse normale, l’infection <strong>à</strong><br />
PV<strong>B19</strong> entraîne une érythroblastopénie qui reste cliniquement<br />
inapparente car de durée brève. En revanche, chez les suj<strong>et</strong>s<br />
ayant une destruction globulaire accélérée (anémies hémolytiques<br />
chroniques), l’infection peut aboutir <strong>à</strong> une érythroblastopénie<br />
aiguë <strong>et</strong> profonde s’exprimant par une anémie sévère. 20,21<br />
D’autres manifestations cliniques ont aussi été rattachées au<br />
PV<strong>B19</strong>: augmentation du risque de mort fœtale <strong>et</strong> d’anasarque<br />
fœto-placentaire en cas d’infection chez la femme enceinte, 22<br />
manifestations rhumatologiques multiples, 23 vascularites, 24,25<br />
myocardites, 26 <strong>et</strong>c.<br />
Enfin, en <strong>transplantation</strong> d’organe des infections <strong>à</strong> PV<strong>B19</strong><br />
ont été décrites après tout type d’organe transplanté. En dehors<br />
des manifestations généralement liées au PV<strong>B19</strong> telles que l’anémie<br />
ou la pancytopénie, des cas de pneumonies, de myocardites<br />
<strong>et</strong> d’hépatites ont été rapportés. 27<br />
■ <strong>Infection</strong> <strong>à</strong> PV<strong>B19</strong> en <strong>transplantation</strong><br />
<strong>rénale</strong><br />
Si l’infection <strong>à</strong> PV<strong>B19</strong> est le plus souvent <strong>à</strong> l’origine d’une<br />
symptomatologie bénigne <strong>et</strong> brève chez le suj<strong>et</strong> immunocompétent<br />
du fait d’une élimination rapide du virus, le problème est<br />
tout autre chez les suj<strong>et</strong>s immunodéprimés. Ainsi, des cas d’infections<br />
chroniques ont été décrits chez des patients porteurs du<br />
VIH, 28 présentant un déficit immunitaire congénital, 29 atteints de<br />
leucémie ou de lymphome 30 <strong>et</strong> enfin chez des patients ayant<br />
bénéficié d’une <strong>transplantation</strong> d’organe en particulier d’une<br />
<strong>transplantation</strong> <strong>rénale</strong>. 6<br />
●<br />
Epidémiologie<br />
La prévalence des infections <strong>à</strong> PV<strong>B19</strong> en <strong>transplantation</strong><br />
<strong>rénale</strong> est difficile <strong>à</strong> estimer car l’ensemble des cas rapportés l’est<br />
sous forme de « case report » ou de très p<strong>et</strong>ites séries. Par<br />
Néphrologie Vol. 24 n° 6 2003