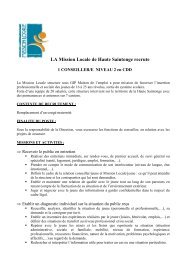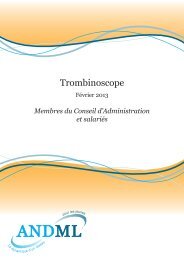Le paradoxe de l'urgence sociale Pierre A. Vidal-Naquet ... - ANDML
Le paradoxe de l'urgence sociale Pierre A. Vidal-Naquet ... - ANDML
Le paradoxe de l'urgence sociale Pierre A. Vidal-Naquet ... - ANDML
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Pierre</strong> A. <strong>Vidal</strong>-<strong>Naquet</strong><br />
Janvier 2005<br />
<strong>Le</strong> <strong>paradoxe</strong> <strong>de</strong> l’urgence <strong>sociale</strong><br />
Restos du cœur, épiceries <strong>sociale</strong>s, foyers d’accueil, hôtels sociaux… <strong>Le</strong> champ <strong>de</strong><br />
l’urgence est illimité. Mais cette réponse sans conditions ne peut être seulement <strong>de</strong><br />
compassion.<br />
L’approche humanitaire <strong>de</strong> l’exclusion semble avoir acquis un certain droit <strong>de</strong> cité au cours <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux<br />
<strong>de</strong>rnières décennies. C’est, en effet, durant cette pério<strong>de</strong> que se <strong>de</strong>ssinent les contours d’un nouveau<br />
secteur dans le champ <strong>de</strong>s politiques <strong>sociale</strong>s. Pour répondre aux besoins <strong>de</strong> personnes délaissées,<br />
entièrement ou en partie, par les dispositifs « normalisés », les structures d’urgence se spécialisent<br />
peu à peu dans l’accueil <strong>de</strong>s publics a priori indéfinissables, dans l’accueil <strong>de</strong> tous les « sans » : sans<br />
abri, sans emploi, sans revenu, sans famille, sans droits… Elles adoptent ainsi <strong>de</strong>s principes qui<br />
tranchent par rapport à ceux qui orientent classiquement les politiques <strong>sociale</strong>s.<br />
L’accueil inconditionnel<br />
En général, en effet, c’est sous certaines conditions que l’ai<strong>de</strong> <strong>sociale</strong> est distribuée aux ayants droit.<br />
Or, dans le secteur <strong>de</strong> l’urgence, la notion d’inconditionnalité apparaît comme une autre modalité<br />
d’accueil et <strong>de</strong> soutien <strong>de</strong>s personnes, repoussant les limites d’accès aux services <strong>de</strong> protection.<br />
Quand la conditionnalité maintient assez élevés <strong>de</strong>s seuils d’accès et peut <strong>de</strong>venir un facteur<br />
d’exclusion, l’inconditionnalité élargit les portes d’entrée dans <strong>de</strong>s dispositifs ouverts à tous.<br />
L’accueil et le service rendu ne sont pas, ici, la contrepartie d’un quelconque engagement <strong>de</strong> l’usager.<br />
<strong>Le</strong>s rapports entre accueillants et accueillis ne sont pas contractuels.<br />
Pratiquement, l’inconditionnalité se décline <strong>de</strong> plusieurs façons. Elle est d’abord « temporelle », la<br />
détresse <strong>sociale</strong> justifiant <strong>de</strong>s interventions qui ne peuvent être différées et ne relèvent pas <strong>de</strong> la<br />
logique du ren<strong>de</strong>z-vous. L’inconditionnalité est ensuite « spatiale », la détresse <strong>sociale</strong> étant traitée<br />
là où elle s’exprime par <strong>de</strong>s équipes mobiles qui ont pour mission d’aller au-<strong>de</strong>vant <strong>de</strong>s personnes en<br />
difficulté, afin <strong>de</strong> les prendre en charge, le cas échéant, là où elles sont. L’inconditionnalité est aussi<br />
biographique : les secours sont donnés quels que soient les parcours <strong>de</strong>s personnes, leur histoire, les<br />
raisons pour lesquelles elles vivent leur situation d’exclusion. De même que les Samu médicaux ne<br />
s’intéressent pas aux responsabilités <strong>de</strong>s victimes d’acci<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> la route, les acteurs <strong>de</strong> l’urgence<br />
<strong>sociale</strong> ne subordonnent pas leur action à l’analyse du passé <strong>de</strong>s bénéficiaires. L’anonymat <strong>de</strong><br />
l’accueil symbolise bien ce principe qui, en général, n’est pas appliqué dans le cadre <strong>de</strong>s<br />
interventions <strong>sociale</strong>s traditionnelles. L’impasse sur l’itinéraire <strong>de</strong> l’usager permet <strong>de</strong> prendre en<br />
charge <strong>de</strong>s personnes inscrites dans une dynamique durable d’échec et qui renouvellent, <strong>de</strong> façon<br />
répétée, les mêmes <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s.<br />
Enfin, l’inconditionnalité est aussi <strong>sociale</strong>, l’appartenance à une catégorie d’ayants droit n’étant pas<br />
non plus exigée comme condition <strong>de</strong> prise en charge par les structures d’urgence.<br />
L’inconditionnalité répond à la configuration prise aujourd’hui par le phénomène d’exclusion dans<br />
un contexte <strong>de</strong> fragmentation <strong>sociale</strong>. L’accueil et le service rendu, enfin, ne sont pas la contrepartie<br />
d’un quelconque engagement <strong>de</strong> l’usager. <strong>Le</strong>s rapports entre accueillants et accueillis ne sont pas<br />
contractuels. A la différence du RMI par exemple, perçu à condition que le bénéficiaire remplisse<br />
son contrat en prouvant son engagement dans la voie <strong>de</strong> l’insertion, le service d’urgence peut être<br />
reçu sans que l’usager ne propose quoi que ce soit en retour.<br />
Dans le secteur <strong>de</strong> l’urgence, l’ai<strong>de</strong> n’est pas seulement régie par le principe <strong>de</strong> l’inconditionnalité ;<br />
elle est aussi focalisée sur la personne. Cet intérêt porté à la personne s’explique par la place prise<br />
par <strong>de</strong>s organisations confessionnelles et caritatives d’inspiration humaniste. Mais il résulte surtout<br />
du mo<strong>de</strong> contemporain <strong>de</strong> socialisation <strong>de</strong>s individus. Dans une société hyperdifférenciée, il existe<br />
toujours un risque <strong>de</strong> décalage entre <strong>de</strong>s dispositifs « formatés » pour répondre à <strong>de</strong>s problèmes<br />
collectifs et les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s personnes qui ne s’y réduisent pas toujours, surtout quand elles sont
atypiques. D’où cette tendance à prendre en compte l’individu dans sa globalité. Ainsi les acteurs <strong>de</strong><br />
l’urgence s’efforcent <strong>de</strong> ne pas prendre en charge les personnes <strong>de</strong> façon fragmentée dans <strong>de</strong>s<br />
dispositifs éclatés. L’approche globale est censée permettre à l’individu <strong>de</strong> relier les segments d’une<br />
vie « en pointillés », faite <strong>de</strong> ruptures successives, <strong>de</strong> recouvrer une i<strong>de</strong>ntité corrodée par l’exclusion.<br />
Mais ce recentrage <strong>de</strong> l’action <strong>sociale</strong> modifie profondément la métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’intervention <strong>sociale</strong>.<br />
Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s compétences légales, d’une connaissance <strong>de</strong>s dispositifs et <strong>de</strong>s procédures, elle<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> aussi une attention soutenue à chacun, à ses <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s, à sa singularité.<br />
L’accompagnement<br />
Dans ce contexte, la qualité <strong>de</strong> l’accueil et <strong>de</strong> l’écoute <strong>de</strong>vient un enjeu majeur car elle doit permettre<br />
à l’usager <strong>de</strong> s’exprimer, d’explorer, sans crainte d’un jugement normatif, les ressources<br />
personnelles dont il dispose afin <strong>de</strong> les mobiliser. Selon ce schéma, l’accompagnement apparaît<br />
comme une nécessité, complétant le premier accueil. Quand la seule redistribution <strong>de</strong> droits ne<br />
suffit pas à stabiliser les individus dans les filières d’insertion, le « suivi » <strong>de</strong>s personnes s’impose<br />
afin que celles-ci ne se per<strong>de</strong>nt pas dans le labyrinthe <strong>de</strong>s services sociaux et ne s’exposent pas au<br />
risque <strong>de</strong> nouveaux décrochages.<br />
Mais l’accompagnement va au-<strong>de</strong>là. Il ne suffit pas seulement d’ouvrir l’accès <strong>de</strong>s familles au<br />
logement, il est nécessaire d’accompagner les familles pour qu’elles puissent effectivement habiter<br />
leur logement et leur quartier. Il ne suffit pas non plus d’ouvrir aux exclus la porte <strong>de</strong>s entreprises,<br />
mais d’offrir un accompagnement à l’intérieur <strong>de</strong> l’entreprise, sinon un tutorat, dans les parcours<br />
emploi-formation, et parfois dans le maintien au poste <strong>de</strong> travail lui-même. Mais où sont alors les<br />
limites A partir <strong>de</strong> quand peut-on être sûr que la personne qui a retrouvé un emploi ou un<br />
logement n’a plus besoin d’être soutenue <br />
Ce centrage sur la personne oblige à réviser le profil même <strong>de</strong>s agents qui s’investissent dans ce<br />
champ. Quand on reçoit un usager dont on attend qu’il parle <strong>de</strong> lui-même, <strong>de</strong> ses ressources<br />
personnelles, <strong>de</strong> ses angoisses et <strong>de</strong> ses désirs, peut-on renvoyer simplement l’image <strong>de</strong> l’institution<br />
(<strong>de</strong> ses règles et <strong>de</strong> ses normes) Dans la relation <strong>de</strong> face à face, c’est un visage qui se présente à un<br />
autre visage. Alors que l’institution ne peut « regar<strong>de</strong>r » chez l’autre que les expressions<br />
normalisées, adéquates aux réponses disponibles, la personne peut – sous certaines conditions –<br />
voir l’autre dans toute sa complexité. La démarche n’est plus anatomique et partielle. Elle passe par<br />
un engagement personnel, avec ses affects et ses singularités, par une relation <strong>de</strong> confiance.<br />
Un secteur en crise chronique<br />
Mais, en raison même <strong>de</strong>s principes sur lesquels elles s’appuient, les structures d’urgence sont<br />
soumises en permanence à <strong>de</strong>s risques <strong>de</strong> déstabilisation. Placées en première ligne, elles<br />
enregistrent en temps réel toutes les variations <strong>de</strong>s processus <strong>de</strong> précarisation. Car c’est vers elles<br />
que se tournent finalement tous ceux qui, à un moment donné <strong>de</strong> leur parcours, sont mis à l’écart du<br />
jeu social.<br />
La sur-occupation chronique <strong>de</strong>s dispositifs affaiblit le principe <strong>de</strong> l’inconditionnalité. Afin d’éviter<br />
les phénomènes <strong>de</strong> saturation, les gestionnaires sont en effet amenés à réglementer les flux d’entrée,<br />
à refuser les accès répétés aux structures ainsi que les sé<strong>de</strong>ntarisations prolongées. Dans certains<br />
cas, ils ont tacitement réintroduit le système <strong>de</strong>s quotas, en fonction <strong>de</strong>s pays d’origine.<br />
L’hétérogénéité <strong>de</strong>s publics est une autre source <strong>de</strong> fragilité. Coexistent dans les dispositifs<br />
d’urgence <strong>de</strong>s populations qui, souvent, n’ont pas ni la même histoire, ni les mêmes projets, ni les<br />
mêmes attentes et, notamment <strong>de</strong>puis l’arrivée en force d’étrangers <strong>de</strong> toutes nationalités, ne<br />
partagent ni la même culture, ni la même langue. Cette cohabitation peut s’avérer très<br />
problématique, aiguisant la concurrence entre usagers [1].
Entre fonction relais et fonction asilaire<br />
L’urgence <strong>sociale</strong> est aussi mise en difficulté pour une autre raison. En effet, les structures d’urgence<br />
se sont développées sur le modèle <strong>de</strong> l’urgence médicale. <strong>Le</strong>s services d’urgence <strong>de</strong>s hôpitaux ou les<br />
Samu médicaux sont <strong>de</strong>stinés à prendre en charge sans délai <strong>de</strong>s personnes en danger pour leur<br />
permettre d’accé<strong>de</strong>r aux soins. Il s’agit d’espaces « intermédiaires » dans lesquels <strong>de</strong>s premiers soins<br />
peuvent être dispensés, avant d’orienter les personnes vers d’autres services ou vers leur domicile.<br />
Dans tous les cas, ce sont <strong>de</strong>s « sas » <strong>de</strong> stationnement, le temps d’un diagnostic et d’une<br />
orientation.<br />
En théorie, les dispositifs d’urgence <strong>sociale</strong> fonctionnent <strong>de</strong> la même manière. Ils tirent leur<br />
légitimité <strong>de</strong> leur adossement à l’insertion. Un premier contact est établi avec <strong>de</strong>s usagers qui<br />
rencontrent <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s difficultés et qui sont <strong>de</strong>stinés à être réorientés vers les services<br />
administratifs, sociaux ou médicaux. Dans la pratique, les choses sont bien différentes. Certes pour<br />
quelques-uns, l’urgence est un relais. Par exemple, <strong>de</strong>s femmes, victimes <strong>de</strong> violences conjugales,<br />
peuvent être dépannées par les services d’urgence dans l’attente d’une autre modalité d’assistance.<br />
Mais la plupart du temps, beaucoup utilisent les structures d’urgence comme <strong>de</strong>s réseaux <strong>de</strong> survie<br />
qu’ils fréquentent très régulièrement. Ainsi, selon une enquête <strong>de</strong> l’Insee, 60 % <strong>de</strong>s personnes sans<br />
domicile qui ont recours aux services d’ai<strong>de</strong> (hébergement, restauration) le font tous les jours, et 20<br />
% les sollicitent cinq ou six jours par semaine. Nombreux sont ceux qui vivent ainsi une situation<br />
« flottante », développant une économie <strong>de</strong> l’exclusion, mobilisant et combinant toutes sortes <strong>de</strong><br />
ressources : ressources légales, illégales, assistance <strong>sociale</strong> classique, réseaux d’urgence [2].<br />
Pour d’autres, l’insertion est vraiment hors d’atteinte : étrangers en situation irrégulière, déficients<br />
mentaux dans la rue <strong>de</strong>puis longtemps, « clochards » <strong>de</strong> longue date… Ils sont plus ou moins (mal)<br />
installés durablement dans les réseaux d’urgence. Or une telle « fidélisation » ruine <strong>de</strong> fait la notion<br />
même d’urgence, surtout quand, en raison <strong>de</strong> la saturation, les dispositifs se transforment en relais<br />
entre la rue et la rue… Ce qui est le cas, lorsque les personnes hébergées le soir doivent quitter<br />
l’établissement le len<strong>de</strong>main matin, parfois très tôt, sans être assurées <strong>de</strong> retrouver une place la nuit<br />
suivante.<br />
Cette absence <strong>de</strong> perspective d’insertion ne peut qu’interroger un mo<strong>de</strong> d’intervention <strong>sociale</strong><br />
normalement transitoire. Tel est le cas lorsque les services d’urgence <strong>de</strong>viennent <strong>de</strong>s « terminaux »<br />
où aboutissent <strong>de</strong>s gens très précarisés et développent ainsi, à « bas bruit », une fonction asilaire. Or<br />
cette fonction n’est ni reconnue ni admise dans la mesure où elle s’écarte trop <strong>de</strong>s logiques d’égalité,<br />
<strong>de</strong> justice et <strong>de</strong> progrès social qui sont au cœur <strong>de</strong> l’Etat provi<strong>de</strong>nce. Notre société répugne, à juste<br />
titre, à concevoir et à admettre <strong>de</strong>s espaces <strong>de</strong> relégation qui rappellent le « grand enfermement ».<br />
La fonction asilaire qui existe <strong>de</strong> fait n’est, par conséquent, assumée par personne. Cet « asile au<br />
noir » ou « sans nom » [3] provoque un grand malaise chez les intervenants et un ressentiment<br />
croissant chez les usagers.<br />
L’enjeu <strong>de</strong>s réseaux<br />
Face à cette situation, la tentation du repli est assez forte. <strong>Le</strong>s gestionnaires cherchent à « protéger »<br />
les espaces et donc les usagers dont ils ont la charge, limitant les flux d’entrée, « fluidifiant » les flux<br />
<strong>de</strong> sortie. Pour préserver leur fonctionnement, on doit encore d’urgence exclure. Une mise en réseau<br />
offre sans doute une alternative. Sur le terrain, elle suppose une « mutualisation » <strong>de</strong>s ressources<br />
disponibles. Des réseaux « horizontaux » se forment, qui rassemblent <strong>de</strong>s structures proches les<br />
unes <strong>de</strong>s autres, quant au contenu <strong>de</strong> leur action. Plus rares, les réseaux « verticaux » croisent <strong>de</strong>s<br />
dispositifs d’urgence et <strong>de</strong>s dispositifs <strong>de</strong> droit commun. Plus difficiles à constituer, <strong>de</strong> tels réseaux,<br />
thématiques, ambitionnent <strong>de</strong> rendre effectives les trajectoires d’insertion dans un domaine<br />
particulier. S’ils ne garantissent pas, bien entendu, le succès <strong>de</strong>s itinéraires, ils permettent au moins<br />
<strong>de</strong> repérer les dysfonctionnements éventuels et dans certains cas <strong>de</strong> les corriger.
La coopération <strong>de</strong>s intervenants sociaux dans <strong>de</strong>s réseaux « primaires » (horizontaux ou verticaux)<br />
ne résout pas tous les problèmes. Mais elle fait sortir le risque d’une fonction asilaire <strong>de</strong> sa quasiclan<strong>de</strong>stinité<br />
et rend publics, sur un territoire donné, les débats concernant cette difficile question.<br />
Ces réseaux pratiques règlent surtout <strong>de</strong>s questions individuelles, à une échelle spatiale restreinte –<br />
ville, agglomération, bassin <strong>de</strong> vie. A cette échelle, ce type d’action ne bouscule pas véritablement les<br />
principes du fonctionnement social. En revanche, sa généralisation fait entrer l’humanitaire dans le<br />
champ du politique. L’articulation <strong>de</strong> l’urgence humanitaire et <strong>de</strong> l’action politique est alors un<br />
enjeu <strong>de</strong> la réflexion à mener dans un cadre qui dépasse les contraintes du terrain. La détresse<br />
<strong>sociale</strong> requiert <strong>de</strong>s interventions dispensées <strong>de</strong> toute médiation, notamment <strong>de</strong> celle du temps, <strong>de</strong><br />
la réflexion, du débat, <strong>de</strong> la norme et du droit. Porté dans <strong>de</strong>s « réseaux secondaires », le débat<br />
permettrait peut-être <strong>de</strong> réintroduire le temps <strong>de</strong> la médiation dans le secteur <strong>de</strong> l’urgence <strong>sociale</strong>, et<br />
<strong>de</strong> maintenir en état les interrogations sur les pratiques qui s’y développent et sur les nouveaux<br />
principes qui s’y <strong>de</strong>ssinent.<br />
Une telle réflexion « distanciée » autour <strong>de</strong> l’urgence <strong>sociale</strong> paraît d’autant plus nécessaire que<br />
cette catégorie <strong>de</strong> l’action est porteuse d’un <strong>paradoxe</strong> irréductible. D’un côté, les interventions<br />
d’urgence paraissent incontournables dès lors que <strong>de</strong>s personnes sont exposées à <strong>de</strong>s menaces<br />
vitales, sont touchées dans leur intégrité et leur dignité et sont victimes d’un système qui les<br />
marginalise. D’un autre côté, on voit bien les limites d’un mo<strong>de</strong> d’intervention qui dépend pour<br />
beaucoup <strong>de</strong> l’existence <strong>de</strong> sentiments compassionnels. De surcroît, il ne garantit en rien<br />
l’amélioration <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> vie qui dépen<strong>de</strong>nt moins <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s prestations proposées que<br />
<strong>de</strong> la place accordée dans la société aux personnes en gran<strong>de</strong> difficulté. Il <strong>de</strong>vient pervers quand, au<br />
lieu <strong>de</strong> servir <strong>de</strong> passerelle vers l’insertion, il oriente vers <strong>de</strong>s espaces <strong>de</strong> relégation.<br />
Face à ce <strong>paradoxe</strong>, plusieurs positions sont possibles. On peut le masquer et faire comme s’il<br />
n’existait pas en compartimentant les <strong>de</strong>ux termes. On peut aussi tenter <strong>de</strong> le résoudre à tout prix,<br />
en ne privilégiant que l’un <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux termes : soit valoriser l’intervention d’urgence sans en voir les<br />
limites, soit y renoncer sous le prétexte <strong>de</strong> ses limites.<br />
Mais on peut aussi exploiter ce <strong>paradoxe</strong> pour le rendre dynamique et productif. A force d’être<br />
rappelé, le risque <strong>de</strong> relégation peut engendrer <strong>de</strong>s réactions positives. A savoir, interroger en<br />
permanence les facteurs <strong>de</strong> paupérisation, rappeler que la seule action « sur les marges » ne suffit<br />
pas à résoudre les problèmes liés à l’exclusion, interroger sans relâche les politiques <strong>de</strong> l’emploi, <strong>de</strong><br />
la formation, du logement, <strong>de</strong> la santé et <strong>de</strong> l’immigration, en bref continuer à maintenir dans le<br />
débat public cette difficile question <strong>sociale</strong>.<br />
<strong>Pierre</strong> A. <strong>Vidal</strong>-<strong>Naquet</strong>,<br />
<strong>Pierre</strong> A. <strong>Vidal</strong>-<strong>Naquet</strong> est sociologue au Cerpe, (Lyon)<br />
1 Selon l’enquête <strong>de</strong> l’Insee, 50% <strong>de</strong>s personnes dormant dans la rue en janvier 2001<br />
ne souhaitaient pas se rendre dans <strong>de</strong>s centres d’hébergement. La première raison<br />
invoquée était le refus <strong>de</strong> fréquenter les autres hébergés.<br />
2 Parmi les sans-domicile enquêtés par l’Insee, 50% n’ont pas effectué <strong>de</strong> démarches<br />
pour trouver un logement dans l’année précédant l’enquête, 14% ne souhaitant pas<br />
changer <strong>de</strong> mo<strong>de</strong> d’hébergement.<br />
3 Nous empruntons ces termes à Olivier Brachet : « L’impossible organigramme <strong>de</strong><br />
l’asile en France. <strong>Le</strong> développement <strong>de</strong> l’asile noir », Revue européenne <strong>de</strong>s migrations<br />
internationales, 1997.<br />
<strong>Pierre</strong> A. <strong>Vidal</strong>-<strong>Naquet</strong>, « <strong>Le</strong> <strong>paradoxe</strong> <strong>de</strong> l’urgence <strong>sociale</strong> », Ceras - revue Projet<br />
n°284, Janvier 2005. URL : http://www.ceras-projet.com/in<strong>de</strong>x.phpid=1023.