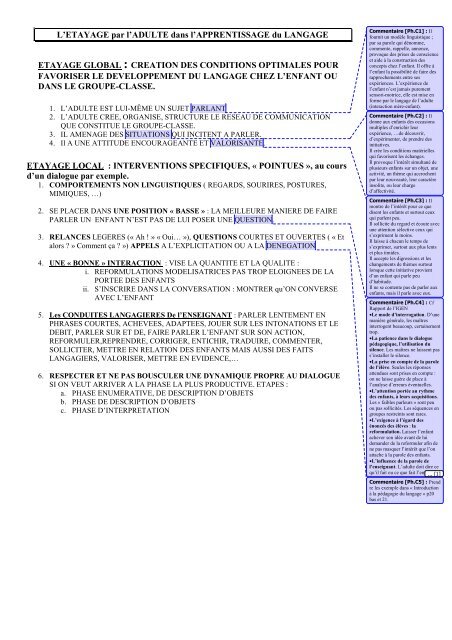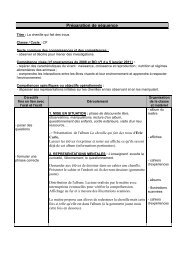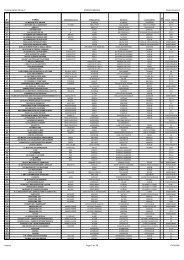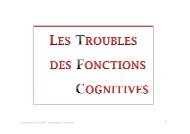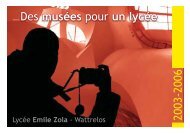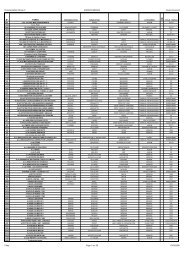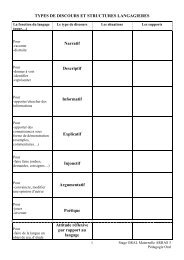L'ETAYAGE par l'ADULTE dans l ... - Www5.ac-lille.fr
L'ETAYAGE par l'ADULTE dans l ... - Www5.ac-lille.fr
L'ETAYAGE par l'ADULTE dans l ... - Www5.ac-lille.fr
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L’ETAYAGE <strong>par</strong> l’ADULTE <strong>dans</strong> l’APPRENTISSAGE du LANGAGE<br />
ETAYAGE GLOBAL : CREATION DES CONDITIONS OPTIMALES POUR<br />
FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DU LANGAGE CHEZ L’ENFANT OU<br />
DANS LE GROUPE-CLASSE.<br />
1. L’ADULTE EST LUI-MÊME UN SUJET PARLANT<br />
2. L’ADULTE CREE, ORGANISE, STRUCTURE LE RESEAU DE COMMUNICATION<br />
QUE CONSTITUE LE GROUPE-CLASSE.<br />
3. IL AMENAGE DES SITUATIONS QUI INCITENT A PARLER.<br />
4. Il A UNE ATTITUDE ENCOURAGEANTE ET VALORISANTE.<br />
ETAYAGE LOCAL : INTERVENTIONS SPECIFIQUES, « POINTUES », au cours<br />
d’un dialogue <strong>par</strong> exemple.<br />
1. COMPORTEMENTS NON LINGUISTIQUES ( REGARDS, SOURIRES, POSTURES,<br />
MIMIQUES, …)<br />
2. SE PLACER DANS UNE POSITION « BASSE » : LA MEILLEURE MANIERE DE FAIRE<br />
PARLER UN ENFANT N’EST PAS DE LUI POSER UNE QUESTION.<br />
3. RELANCES LEGERES (« Ah ! » « Oui… »), QUESTIONS COURTES ET OUVERTES ( « Et<br />
alors » Comment ça ») APPELS A L’EXPLICITATION OU A LA DENEGATION<br />
4. UNE « BONNE » INTERACTION : VISE LA QUANTITE ET LA QUALITE :<br />
i. REFORMULATIONS MODELISATRICES PAS TROP ELOIGNEES DE LA<br />
PORTEE DES ENFANTS<br />
ii. S’INSCRIRE DANS LA CONVERSATION : MONTRER qu’ON CONVERSE<br />
AVEC L’ENFANT<br />
5. Les CONDUITES LANGAGIERES De l’ENSEIGNANT : PARLER LENTEMENT EN<br />
PHRASES COURTES, ACHEVEES, ADAPTEES, JOUER SUR LES INTONATIONS ET LE<br />
DEBIT, PARLER SUR ET DE, FAIRE PARLER L’ENFANT SUR SON ACTION,<br />
REFORMULER,REPRENDRE, CORRIGER, ENTICHIR, TRADUIRE, COMMENTER,<br />
SOLLICITER, METTRE EN RELATION DES ENFANTS MAIS AUSSI DES FAITS<br />
LANGAGIERS, VALORISER, METTRE EN EVIDENCE,…<br />
6. RESPECTER ET NE PAS BOUSCULER UNE DYNAMIQUE PROPRE AU DIALOGUE<br />
SI ON VEUT ARRIVER A LA PHASE LA PLUS PRODUCTIVE. ETAPES :<br />
a. PHASE ENUMERATIVE, DE DESCRIPTION D’OBJETS<br />
b. PHASE DE DESCRIPTION D’OBJETS<br />
c. PHASE D’INTERPRETATION<br />
Commentaire [Ph.C1] : Il<br />
fournit un modèle linguistique ;<br />
<strong>par</strong> sa <strong>par</strong>ole qui dénomme,<br />
commente, rappelle, annonce,<br />
provoque des prises de conscience<br />
et aide à la construction des<br />
concepts chez l’enfant. Il of<strong>fr</strong>e à<br />
l’enfant la possibilité de faire des<br />
rapprochements entre ses<br />
expériences. L’expérience de<br />
l’enfant n’est jamais purement<br />
sensori-motrice, elle est mise en<br />
forme <strong>par</strong> le langage de l’adulte<br />
(interaction mère-enfant).<br />
Commentaire [Ph.C2] : Il<br />
donne aux enfants des occasions<br />
multiples d’enrichir leur<br />
expérience, …de découvrir,<br />
d’expérimenter, de prendre des<br />
initiatives.<br />
Il crée les conditions matérielles<br />
qui favorisent les échanges.<br />
Il provoque l’intérêt simultané de<br />
plusieurs enfants sur un objet, une<br />
activité, un thème qui accrochent<br />
<strong>par</strong> leur nouveauté, leur caractère<br />
insolite, ou leur charge<br />
d’affectivité.<br />
Commentaire [Ph.C3] : Il<br />
montre de l’intérêt pour ce que<br />
disent les enfants et surtout ceux<br />
qui <strong>par</strong>lent peu.<br />
Il sollicite du regard et écoute avec<br />
une attention sélective ceux qui<br />
s’expriment le moins.<br />
Il laisse à chacun le temps de<br />
s’exprimer, surtout aux plus lents<br />
et plus timides.<br />
Il accepte les digressions et les<br />
changements de thèmes surtout<br />
lorsque cette initiative provient<br />
d’un enfant qui <strong>par</strong>le peu<br />
d’habitude.<br />
Il ne se contente pas de <strong>par</strong>ler aux<br />
enfants, mais il <strong>par</strong>le avec eux.<br />
Commentaire [Ph.C4] : Cf<br />
Rapport de l’IGEN<br />
•Le mode d’interrogation. D’une<br />
manière générale, les maîtres<br />
interrogent beaucoup, certainement<br />
trop.<br />
•La patience <strong>dans</strong> le dialogue<br />
pédagogique, l’utilisation du<br />
silence. Les maîtres ne laissent pas<br />
s’installer le silence.<br />
•La prise en compte de la <strong>par</strong>ole<br />
de l’élève. Seules les réponses<br />
attendues sont prises en compte :<br />
on ne laisse guère de place à<br />
l’analyse d’erreurs éventuelles.<br />
•L’attention portée au rythme<br />
des enfants, à leurs acquisitions.<br />
Les « faibles <strong>par</strong>leurs » sont peu<br />
ou pas sollicités. Les séquences en<br />
groupes restreints sont rares.<br />
•L’exigence à l’égard des<br />
énoncés des élèves : la<br />
reformulation. Laisser l’enfant<br />
achever son idée avant de lui<br />
demander de la reformuler afin de<br />
ne pas masquer l’intérêt que l’on<br />
attache à la <strong>par</strong>ole des enfants.<br />
•L’influence de la <strong>par</strong>ole de<br />
l’enseignant. L’adulte doit dire ce<br />
qu’il fait ou ce que fait l’enfant. ... [1]<br />
Commentaire [Ph.C5] : Prend<br />
re les exemple <strong>dans</strong> « Introduction<br />
à la pédagogie du langage » p20<br />
bas et 21.
Page 1: [1] Commentaire [Ph.C4]<br />
Philippe Courbois<br />
Cf Rapport de l’IGEN<br />
• Le mode d’interrogation. D’une manière générale, les maîtres interrogent<br />
beaucoup, certainement trop.<br />
• La patience <strong>dans</strong> le dialogue pédagogique, l’utilisation du silence. Les<br />
maîtres ne laissent pas s’installer le silence.<br />
• La prise en compte de la <strong>par</strong>ole de l’élève. Seules les réponses attendues sont<br />
prises en compte : on ne laisse guère de place à l’analyse d’erreurs éventuelles.<br />
• L’attention portée au rythme des enfants, à leurs acquisitions. Les « faibles<br />
<strong>par</strong>leurs » sont peu ou pas sollicités. Les séquences en groupes restreints sont<br />
rares.<br />
• L’exigence à l’égard des énoncés des élèves : la reformulation. Laisser<br />
l’enfant achever son idée avant de lui demander de la reformuler afin de ne pas<br />
masquer l’intérêt que l’on attache à la <strong>par</strong>ole des enfants.<br />
• L’influence de la <strong>par</strong>ole de l’enseignant. L’adulte doit dire ce qu’il fait ou ce<br />
que fait l’enfant. Les maîtres n’of<strong>fr</strong>ent pas toujours un langage suffisamment<br />
explicite et élaboré. Rôle modélisant de la langue du maître.