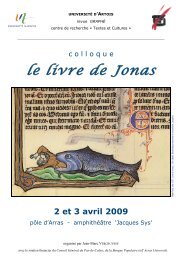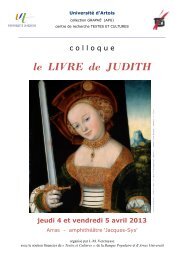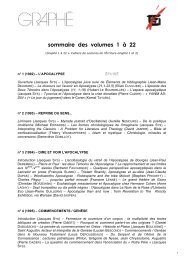Choisir le français pour exprimer l'indicible. Elie Wiesel
Choisir le français pour exprimer l'indicible. Elie Wiesel
Choisir le français pour exprimer l'indicible. Elie Wiesel
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Choisir</strong> <strong>le</strong> français <strong>pour</strong> <strong>exprimer</strong> l'indicib<strong>le</strong>. <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong><br />
Extrait du Institut d'Etude des Faits Religieux<br />
http://iefr.univ-artois.fr/spip.php?artic<strong>le</strong>46<br />
<strong>Choisir</strong> <strong>le</strong> français <strong>pour</strong><br />
<strong>exprimer</strong> l'indicib<strong>le</strong>. <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong><br />
- Ressources - Artic<strong>le</strong>s -<br />
Date de mise en ligne : vendredi 7 janvier 2011<br />
Institut d'Etude des Faits Religieux<br />
Copyright © Institut d'Etude des Faits Religieux Page 1/8
<strong>Choisir</strong> <strong>le</strong> français <strong>pour</strong> <strong>exprimer</strong> l'indicib<strong>le</strong>. <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong><br />
Pour citer cet artic<strong>le</strong> : Olivier Rota, « <strong>Choisir</strong> <strong>le</strong> français <strong>pour</strong> <strong>exprimer</strong> l'indicib<strong>le</strong>. <strong>Elie</strong><br />
<strong>Wiesel</strong> », paru dans Mythe et mondialisation. L'exil dans <strong>le</strong>s littératures francophones, Actes<br />
du colloque organisé dans <strong>le</strong> cadre du projet bilatéral franco-roumain « Mythes et stratégies<br />
de la francophonie en Europe, en Roumanie et dans <strong>le</strong>s Balkans », programme Brâcu_i des<br />
8-9 septembre 2005, Editura Universitcii Suceava, Suceava, 2006, pp.47-55.<br />
<strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong> est né <strong>le</strong> 30 septembre 1928 à Sighet, dans <strong>le</strong>s Carpates. Jeune élève talmudiste baigné dans <strong>le</strong><br />
mysticisme, rien ne destinait <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong> à la carrière d'écrivain. Rien n'était alors plus déconsidéré dans sa<br />
communauté que <strong>le</strong> métier des <strong>le</strong>ttres. Mais l'histoire devait en décider autrement.<br />
Alors que la population juive de Sighet avait pu échapper pendant <strong>le</strong>s cinq premières années de guerre à la<br />
déportation et aux « marches de la faim » organisées par <strong>le</strong> régime d'Antonescu [1], Sighet est bruta<strong>le</strong>ment détachée<br />
de la Roumanie <strong>pour</strong> être incorporée à la Hongrie en mai 1944. La vil<strong>le</strong>, qui ne comporte pas moins de 15.000 Juifs,<br />
subit alors <strong>le</strong> même sort que <strong>le</strong>s autres shtetls (villages) de Hongrie. Sa communauté juive est rassemblée dans<br />
deux ghettos et déportée en quelques jours. Quatre-vingt dix <strong>pour</strong> cent de la population est directement envoyée aux<br />
chambres à gaz d'Auschwitz. Les dix <strong>pour</strong> cent restants sont enrôlés <strong>pour</strong> des travaux forcés. Peu reviendront.<br />
Déporté à Birkenau puis à Buchenwald, <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong> fait partie de ces trop rares survivants. Refusant de retourner à<br />
Sighet, il rejoint après la libération de son camp un convoi de quatre cents enfants. Ce convoi, après une errance<br />
incertaine, est fina<strong>le</strong>ment accueilli par la France. Pourtant, <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong> ne reçoit pas la nationalité française. A la<br />
question d'un commissaire de police, qui demande aux enfants <strong>le</strong>squels d'entre eux veu<strong>le</strong>nt obtenir la nationalité<br />
française, il répond par <strong>le</strong> si<strong>le</strong>nce. <strong>Wiesel</strong>, qui ne comprend pas <strong>le</strong> français, ne se manifeste pas. Dans son dossier<br />
figure : « a refusé la nationalité française ».<br />
Hébergé dans un foyer avec d'autres enfants survivants, <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong> reprend ses études de la Torah et du Talmud.<br />
Le français, il <strong>le</strong> néglige. Seu<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s études religieuses importent. Et la concordance des temps l'agace<br />
prodigieusement.<br />
Pourtant, il faut bien apprendre la langue française. L'organisme qui gère <strong>le</strong> foyer s'arrange alors <strong>pour</strong> attribuer au<br />
jeune <strong>Wiesel</strong> un professeur particulier. François Wahl, « excel<strong>le</strong>nt professeur, intuitif autant qu'érudit, doté d'une<br />
imagination effervescente », il initie <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong> au français. Sa méthode ? L'explication de texte. « Grâce à lui, nous<br />
dit <strong>Wiesel</strong>, j'apprends à savourer la puissance suggestive du vers racinien et <strong>le</strong>s subtilités de la pensée chez Pascal.<br />
Il m'emmène à la Comédie-Française, aux concerts, me fait découvrir <strong>le</strong> Quartier latin. Ma passion <strong>pour</strong> la littérature<br />
classique et la culture française, c'est à lui que je la dois » [2].<br />
Devenu pigiste <strong>pour</strong> <strong>le</strong> journal israélien Yedioth Ahronot, il parcourt <strong>le</strong> monde à la recherche de scoops. L'hébreu<br />
moderne, <strong>Wiesel</strong> <strong>le</strong> par<strong>le</strong> couramment, grâce à la ténacité de son père. Rationaliste invétéré, ce dernier avait<br />
persuadé son fils d'associer à ses études du Talmud, un apprentissage de l'hébreu moderne. Pour <strong>Wiesel</strong>, l'hébreu<br />
s'apprend à travers la <strong>le</strong>cture de ses poètes nationaux <strong>le</strong>s plus illustres : Chaïm Nahman Bialik, Saul Tchernikowski,<br />
et d'autres.<br />
Devenu correspondant <strong>pour</strong> son journal aux Etats-Unis, <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong> obtient la nationalité américaine en 1963. Les<br />
tracasseries administratives que sa situation d'apatride occasionnait n'ont pu trouver que cette échappatoire<br />
heureuse. De fait, résidant aux Etats-Unis depuis la deuxième moitié des années cinquante, <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong> passe sa vie<br />
entre New York, Paris et Jérusa<strong>le</strong>m. <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong> a un don indéniab<strong>le</strong> <strong>pour</strong> <strong>le</strong>s langues. Yiddish, hongrois, hébreu,<br />
Copyright © Institut d'Etude des Faits Religieux Page 2/8
<strong>Choisir</strong> <strong>le</strong> français <strong>pour</strong> <strong>exprimer</strong> l'indicib<strong>le</strong>. <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong><br />
al<strong>le</strong>mand, français et anglais sont autant de langues qui ont traversé sa vie. Chacun d'entre-el<strong>le</strong>s aurait pu être sa<br />
langue d'écriture. Pourtant, son choix se porte sur <strong>le</strong> français. Sur <strong>le</strong>s quelques cinquante romans, pièces de théâtre,<br />
contes et essais, une douzaine d'entre eux ont été écrits en yiddish, et seu<strong>le</strong>ment quatre en anglais.<br />
L'adoption de la nationalité américaine n'y change rien. Prix d'Universalité de la langue française en 1963, Prix Nobel<br />
de la Paix en 1986 (nous passons sous si<strong>le</strong>nce la liste impressionnante de Prix que l'auteur a reçu tout au long de sa<br />
carrière), <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong> reste et demeure un écrivain francophone.<br />
Le choix d'écrire en français<br />
Né dans un shtetl, <strong>le</strong> yiddish reste <strong>pour</strong> <strong>Wiesel</strong> la langue où il se reconnaît. « J'aime <strong>le</strong> yiddish, dit-il, car il<br />
m'accompagne depuis <strong>le</strong> berceau. C'est en yiddish que j'ai prononcé mes premiers mots, exprimé mes premières<br />
craintes : il constitue <strong>pour</strong> moi un pont vers mes années d'enfance. C'est un royaume à lui tout seul, où vivent amitié<br />
et envie, grandeur et bassesse, savoir et ignorance, joies et deuil » [3].<br />
« Il est des chants que je ne peux chanter qu'en yiddish. Il est des prières, que seu<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s grands-mères juives<br />
avaient coutume de chuchoter dans la pénombre du crépuscu<strong>le</strong>. Il est des bons mots qui ne sonnent juste qu'en<br />
yiddish. Il est des contes que seu<strong>le</strong> la langue yiddish, inondée de tristesse et de nostalgie, peut rendre la magie et <strong>le</strong><br />
mystère » [4].<br />
De fait, c'est en yiddish qu'<strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong> écrit son premier livre. A l'age de 28 ans, il compose <strong>le</strong> volumineux récit<br />
autobiographique de son expérience concentrationnaire : Und die velt hot geshviegen (« Et <strong>le</strong> Monde était si<strong>le</strong>ncieux<br />
»). Traduit en français avec <strong>le</strong>s encouragements de François Mauriac, il est publié en forme condensée aux Editions<br />
de Minuit en 1958, sous <strong>le</strong> titre La Nuit [5]. Ce sera son seul livre autobiographique. Les autres ouvrages littéraires<br />
de <strong>Wiesel</strong> seront des explorations à connotation biographique [6].<br />
Pourquoi cette première écriture en yiddish ? Et <strong>pour</strong>quoi cette traduction en français ? <strong>Wiesel</strong> se confie dans ses<br />
mémoires : « J'ai besoin du yiddish <strong>pour</strong> rire et p<strong>le</strong>urer, célébrer et regretter. Et <strong>pour</strong> me plonger dans mes<br />
souvenirs. Existe-t-il une meil<strong>le</strong>ure langue <strong>pour</strong> évoquer <strong>le</strong> passé avec son poids d'horreurs ? Sans <strong>le</strong> yiddish, la<br />
littérature de l'Holocauste n'aurait pas d'âme. [...] Si je n'avais pas écrit mon premier récit en yiddish, <strong>le</strong>s livres qui lui<br />
succédèrent seraient restés muets » [7]. Puisque <strong>Wiesel</strong> devait se libérer par la plume de son expérience<br />
concentrationnaire, il lui fallait une langue intime, qui puisse refléter ses états d'âme d'alors. Le yiddish, la<br />
mame-loshn, la « langue maternel<strong>le</strong> », c'est la langue du shtetl. C'est aussi la langue des survivants, avec <strong>le</strong>squels<br />
<strong>Wiesel</strong> peut partager un même univers de dou<strong>le</strong>ur.<br />
Mais <strong>le</strong> yiddish est aussi une langue qui meurt, une langue dont la portée ne va que s'amoindrissant [8]. C'est une<br />
langue qui a besoin d'être traduite, si el<strong>le</strong> veut être lue. Comment ne pas lire ce déchirement du Cinquième Fils<br />
comme celui de son auteur : « Tout ce qui me reste, ce sont des mots, des mots démodés, inuti<strong>le</strong>s sous <strong>le</strong>urs fards<br />
multip<strong>le</strong>s, lâchés au-dessus des cimetières d'exilés. Je me laisse guider par eux afin de cerner <strong>le</strong>s choses à<br />
l'intérieur des choses, l'Etre au-delà des êtres » [9] ?<br />
Qu'en est-il des autres langues ? A un journaliste venu l'interrogé, <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong> déclare : « Mon anglais n'est pas si<br />
bon. J'écris mes livres en français parce que c'est <strong>le</strong> langage que j'ai acquis immédiatement après la guerre, en<br />
protestation. Je connais <strong>le</strong> hongrois, mais je <strong>le</strong> détestais et j'ai fait un effort physique <strong>pour</strong> l'oublier, <strong>pour</strong> l'éradiquer<br />
de mon cerveau. Je n'ai jamais bien connu l'al<strong>le</strong>mand, et <strong>le</strong> peu que je <strong>le</strong> connaissais, je ne l'aimais pas. Le yiddish<br />
était <strong>pour</strong> moi connecté à mes études du Talmud et de tout cela. [...] J'ai choisi <strong>le</strong> français comme un refuge, et ce<br />
que j'ai lu plus tard en littérature et philosophie a été en français » [10].<br />
Copyright © Institut d'Etude des Faits Religieux Page 3/8
<strong>Choisir</strong> <strong>le</strong> français <strong>pour</strong> <strong>exprimer</strong> l'indicib<strong>le</strong>. <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong><br />
Le français comme langue de refuge. Le français comme langue d'accueil [11]. La langue française offre à <strong>Wiesel</strong> «<br />
un nouveau commencement, une nouvel<strong>le</strong> possibilité, un nouveau monde », une nouvel<strong>le</strong> vie qui permet de prendre<br />
de la distance avec <strong>le</strong>s événements de la Seconde Guerre mondia<strong>le</strong>.<br />
Rencontre fortuite entre <strong>Wiesel</strong> et la langue française ? Rencontre fortuite entre <strong>Wiesel</strong> et <strong>le</strong>s <strong>le</strong>ttres françaises ?<br />
<strong>Wiesel</strong> déclarait récemment : « Je cherchais une langue. Cette langue me cherchait aussi. Il y a eu une sorte de<br />
fusion, de mariage entre cette langue et moi » [12]. Et comme <strong>pour</strong> tous <strong>le</strong>s mariages heureux, il n'existe aucune<br />
raison de <strong>le</strong>s défaire.<br />
Mais <strong>le</strong> français offre aussi une manière commode de prendre des distances avec une expérience que l'on ne peut<br />
quotidiennement assumer autrement. De son séjour à Birkenau et à Buchenwald, <strong>le</strong> jeune <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong> est sorti<br />
vivant, mais à jamais changé. « J'étais devenu un tout autre homme, moi aussi. L'étudiant talmudiste, l'enfant que<br />
j'étais s'étaient consumés dans <strong>le</strong>s flammes. Il ne restait plus qu'une forme qui me ressemblait. Une flamme noire<br />
s'était introduite dans mon âme et l'avait dévorée » [13] , déclare-t-il dans La nuit.<br />
Pour se réapproprier un passé, <strong>Wiesel</strong> doit passer par une langue étrangère. Comme <strong>le</strong> remarque pertinemment<br />
Robert Jouanny, « l'interrogation sur l'identité est, souvent, la source ou du moins <strong>le</strong> corollaire d'un changement de<br />
langue, qui n'a pas <strong>pour</strong> seu<strong>le</strong> vocation d'<strong>exprimer</strong> un refus, mais bien de répondre à un désir de reconstruction » [14<br />
]. Cette reconstruction passe notamment par une rationalisation de l'événement. Dans L'aube, roman de fiction qui<br />
suit immédiatement La nuit, <strong>le</strong> personnage principal déclare : « La philosophie m'attirait : je voulais comprendre <strong>le</strong><br />
sens des événements dont j'étais la victime. Ce cri de dou<strong>le</strong>ur, de colère, que j'avais poussé au camp contre Dieu et<br />
contre l'homme qui ne lui ressemb<strong>le</strong> que dans la cruauté, je voulais <strong>le</strong> réentendre dans <strong>le</strong>s termes du présent,<br />
l'analyser dans un climat de détachement » [15]. Ce cheminement est certainement celui de <strong>Wiesel</strong>, qui rencontre<br />
après guerre <strong>le</strong>s oeuvres d'Albert Camus.<br />
<strong>Wiesel</strong> se reconnaît dans l'état mental et physique d'emprisonnement tel que <strong>le</strong>s deux premiers chapitres de La<br />
peste <strong>le</strong> décrivent. Il se reconnaît aussi dans l'éthique du témoin que développe son auteur [16]. Pour Camus comme<br />
<strong>pour</strong> <strong>Wiesel</strong> (mais ce sera valab<strong>le</strong> <strong>pour</strong> tous ceux qui prendront part à l'existentialisme), la littérature est une force<br />
politique qui peut oeuvrer en faveur d'un changement social. Pour <strong>Wiesel</strong>, l'art <strong>pour</strong> l'art n'a plus de sens. La Shoah a<br />
mit fin à l'innocence littéraire.<br />
Exprimer l'indicib<strong>le</strong> à travers <strong>le</strong> français ?<br />
Certains survivants ont choisi <strong>le</strong> si<strong>le</strong>nce afin de commémorer <strong>le</strong>ur perte, d'autres ont choisi de prendre la paro<strong>le</strong>. <strong>Elie</strong><br />
<strong>Wiesel</strong> considère sa tache comme étant cel<strong>le</strong> du témoin -que la tradition juive assimi<strong>le</strong> au messager. Le messager<br />
d'un univers qui n'existe plus.<br />
Lorsqu'il décide, poussé par François Mauriac, de traduire en français Und die velt hot geshviegen, <strong>Wiesel</strong> a<br />
conscience de l'impérieuse nécessité de par<strong>le</strong>r, de faire connaître aux hommes l'étendue du mal qui <strong>le</strong>s habite. Il lui<br />
faut une langue <strong>pour</strong> véhicu<strong>le</strong>r cela. Il lui faut utiliser une autre langue, qui ne soit pas associée à un monde mort,<br />
une autre langue où <strong>le</strong> poids des mots ne se serait pas colorié du traumatisme de la Shoah. Son choix, qui ne se<br />
démentira pas, se porte sur <strong>le</strong> français.<br />
Le français a alors <strong>le</strong> crédit d'être une langue logique et claire. Chacun a en mémoire <strong>le</strong>s fameux arguments du «<br />
discours sur l'universalité de la langue française » qu'Antoine de Rivarol a délivré à l'Académie de Berlin (1783) : «<br />
Ce qui distingue notre langue [française] des langues anciennes et modernes, c'est l'ordre et la construction de la<br />
phrase. Cet ordre doit toujours être direct et nécessairement clair. Le français nomme d'abord <strong>le</strong> sujet du discours,<br />
Copyright © Institut d'Etude des Faits Religieux Page 4/8
<strong>Choisir</strong> <strong>le</strong> français <strong>pour</strong> <strong>exprimer</strong> l'indicib<strong>le</strong>. <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong><br />
ensuite <strong>le</strong> verbe qui est l'action, et enfin l'objet de cette action : voilà la logique naturel<strong>le</strong> à tous <strong>le</strong>s hommes ; voilà ce<br />
qui constitue <strong>le</strong> sens commun. Or cet ordre, si favorab<strong>le</strong>, si nécessaire au raisonnement, est presque toujours<br />
contraire aux sensations, qui nomment <strong>le</strong> premier l'objet qui frappe <strong>le</strong> premier » [17].<br />
On peut mettre en doute <strong>le</strong>s propos de Rivarol. On peut mettre en cause <strong>le</strong>ur actualité, au vu des tentatives de<br />
libération esthétique que la langue française a connu au XXème sièc<strong>le</strong>. Pour autant, <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong> n'échappe pas à<br />
cette réputation de clarté de la langue française, que Rivarol a largement contribué à créer. <strong>Wiesel</strong> aussi certifie : «<br />
Le français est une langue cartésienne, logique. Or ce que j'ai vécu dans mon enfance, mon ado<strong>le</strong>scence, toutes<br />
mes aventures intérieures, c'était juste <strong>le</strong> contraire : je baignais dans <strong>le</strong> mysticisme. S'il y a une langue qui rejette <strong>le</strong><br />
mysticisme, qui s'y oppose, c'est <strong>le</strong> français. Transformer, retraduire en français <strong>le</strong>s notions, <strong>le</strong>s concepts, <strong>le</strong>s<br />
découvertes, <strong>le</strong>s secrets du monde mystique, c'était une gageure, un pari, donc ça m'a tenté. Je peux écrire un<br />
artic<strong>le</strong> en hébreu, pas un livre. Je peux écrire un artic<strong>le</strong> en anglais, pas un livre. Le livre vient d'une zone à part » [18<br />
]. Une zone que <strong>le</strong>s qualités prêtées au français permettent de faire émerger.<br />
L'étrangéité d'une expérience indicib<strong>le</strong><br />
Qu'en est-il fina<strong>le</strong>ment de l'étrangéité dans l'oeuvre d'<strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong> ? <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong> se définit avant tout dans la sphère du<br />
judaïsme. « Si je dois me définir, je me pense d'abord comme un Juif, et ensuite comme un écrivain : et en tant<br />
qu'écrivant, j'appartiens à tout lieu. [...] Je n'appartiens ni à la France, ni à l'Amérique, ni à aucun autre lieu, mais à<br />
un monde qui n'est pas là » [19]. L'identité d'<strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong> n'est pas en péril : el<strong>le</strong> reste et demeure juive. Mais son<br />
expérience française permet au jeune <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong> de prendre conscience de l'universalité de l'éthique juive. Comme<br />
il <strong>le</strong> dira plus tard : <strong>le</strong>s mots « juif » et « humain » sont interchangeab<strong>le</strong>s dans ses romans.<br />
Si l'étrangéité s'exprime dans l'oeuvre de <strong>Wiesel</strong>, ce n'est pas du fait de l'exil géographique. Si ses personnages<br />
s'interrogent, ce n'est pas par rapport à <strong>le</strong>ur passé ou à <strong>le</strong>ur nouvel environnement. Le sentiment d'étrangéité est<br />
provoqué par la rupture qu'occasionne la Shoah entre <strong>le</strong>s êtres. Les mots mêmes font-il encore sens après la Shoah<br />
? <strong>Wiesel</strong> déplore une « rupture entre <strong>le</strong>s êtres, <strong>le</strong>s mots, <strong>le</strong>s instants » [20].<br />
La question est alors : comment frapper l'imagination du <strong>le</strong>cteur, si <strong>le</strong>s mots sont insuffisants à décrire l'abomination<br />
des camps ? Dans Un Juif, aujourd'hui, <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong> résume toute la difficulté de prendre la paro<strong>le</strong>. « Que <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> du<br />
survivant soit de témoigner, j'en étais conscient. Seu<strong>le</strong>ment j'ignorais comment m'y prendre. Je manquais<br />
d'expérience, de repères. Je me méfiais des outils, des procédés. Fallait-il tout dire ou tout taire ? Hur<strong>le</strong>r ou<br />
murmurer. Mettre l'accent sur <strong>le</strong>s absents ou sur <strong>le</strong>urs héritiers ? Comment décrit-on l'indicib<strong>le</strong> ? Comment faire <strong>pour</strong><br />
revivre, avec pudeur, la chute des hommes et l'éclipse des dieux ? Et puis, comment être sûr que <strong>le</strong>s mots, une fois<br />
lâchés, ne vont pas trahir, déformer <strong>le</strong> message dont ils étaient porteurs ? » [21].<br />
Les mots ont une histoire, <strong>le</strong>s mots sont chargés d'histoire et de va<strong>le</strong>ur, ils évoquent un imaginaire au <strong>le</strong>cteur, par<br />
<strong>le</strong>ur sonorité ou <strong>le</strong>ur champ <strong>le</strong>xical. Mais « l'imaginaire des camps » est encore absent dans <strong>le</strong>s années 1950. C'est<br />
un imaginaire à construire. Le langage n'a pas encore intégré l'héritage douloureux de l'Holocauste. Il ne s'est pas<br />
alourdi du poids sémantique de six millions de morts.<br />
L'étrangéité est ici avant tout cel<strong>le</strong> de l'expérience concentrationnaire. Non pas une étrangéité de l'écrivain à<br />
l'expérience, mais une étrangéité de son <strong>le</strong>ctorat à l'expérience. Comment <strong>exprimer</strong> toute la dou<strong>le</strong>ur de la mémoire ?<br />
Comment <strong>exprimer</strong> <strong>le</strong> drame même de la mémoire ? Contrairement à d'autres auteurs qui ont écrit sur la Shoah, <strong>Elie</strong><br />
<strong>Wiesel</strong> décide de garder <strong>le</strong> si<strong>le</strong>nce sur son expérience. Pendant dix ans, il interroge son vécu, il interroge <strong>le</strong> vécu des<br />
six millions de victimes -condition préalab<strong>le</strong> à toute prise de paro<strong>le</strong> en tant que témoin. « Car <strong>le</strong> temps <strong>pour</strong><br />
comprendre est aussi <strong>le</strong> temps <strong>pour</strong> ne pas comprendre » [22], nous dit <strong>le</strong> philosophe Jean-Claude Milner. Comment<br />
Copyright © Institut d'Etude des Faits Religieux Page 5/8
<strong>Choisir</strong> <strong>le</strong> français <strong>pour</strong> <strong>exprimer</strong> l'indicib<strong>le</strong>. <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong><br />
ne pas rapprocher la décision de <strong>Wiesel</strong> de garder <strong>le</strong> si<strong>le</strong>nce du cri de détresse de Robert Antelme : « Comment<br />
nous résigner à ne pas tenter d'expliquer comment nous en étions venus là ? Nous y étions encore. Et cependant<br />
c'était impossib<strong>le</strong>. A peine commencions-nous à raconter, que nous suffoquions. A nous-mêmes, ce que nous avions<br />
à dire commençait alors à nous paraître inimaginab<strong>le</strong> » [23]. C'est une expérience au-delà des mots, une expérience<br />
sans imaginaire, une expérience qu'on ne peut imaginer, qu'on ne peut communiquer.<br />
Aussi, en toi<strong>le</strong> de fond à chacun de ses romans, <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong> exprime-t-il l'impossibilité de communiquer l'expérience<br />
concentrationnaire tout aussi bien que son impérieuse nécessité. Comme il <strong>le</strong> dit si bien à Jorge Semprun : « Se taire<br />
est interdit, par<strong>le</strong>r est impossib<strong>le</strong>. [...] Pauvrement, mais il faut par<strong>le</strong>r. On n'a pas <strong>le</strong>s moyens, on n'a pas <strong>le</strong><br />
vocabulaire, mais il faut par<strong>le</strong>r » [24].<br />
Le poids de l'expérience concentrationnaire parcourt toute l'oeuvre d'<strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong>, renfermant ses personnages<br />
survivants dans un mutisme diffici<strong>le</strong> à percer, tandis que <strong>le</strong>s proches ne parviennent pas tota<strong>le</strong>ment à intégrer ou à<br />
comprendre <strong>le</strong> traumatisme que représente la vie et la survie à l'Holocauste -à moins d'un sacrifice d'une part<br />
d'eux-mêmes. Ainsi ce fils qui perce enfin <strong>le</strong> secret de son père, et se confie au <strong>le</strong>cteur : « Moi qui voulais tant<br />
partager <strong>le</strong>s événements qu'il taisait, à présent, je m'avouais qu'ils étaient trop lourds <strong>pour</strong> mes épau<strong>le</strong>s encore<br />
fragi<strong>le</strong>s » [25].<br />
<strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong> est conscient que nous en apprenons plus par la représentation artistique de la Shoah que par sa<br />
description brute. Mais <strong>Wiesel</strong>, qui décrit dans ses romans l'impossibilité de communiquer, est lui-même frappé par<br />
l'incommunicabilité de l'expérience concentrationnaire. « Les sujets que j'essaie de traiter [...] sont au-delà du<br />
langage, aussi j'ai eu à trouver un nouveau langage. L'histoire défie l'imagination, aussi ai-je inventé un nouveau<br />
type d'imagination » [26].<br />
Si l'auteur essaie de communiquer certains mots de cette période, son défi consiste à transmettre <strong>le</strong> si<strong>le</strong>nce de<br />
l'Holocauste. Comme <strong>le</strong> père du Cinquième Fils, <strong>Wiesel</strong> affirme que « rien ne vaut <strong>le</strong> si<strong>le</strong>nce » mais « il est possib<strong>le</strong><br />
d'en abuser » car « c'est une chose fragi<strong>le</strong>, <strong>le</strong> si<strong>le</strong>nce » [27]. Le si<strong>le</strong>nce ne doit pas être trop épais. Du si<strong>le</strong>nce, doit<br />
surgir <strong>le</strong> sens. Imprégné des thèses du mysticisme juif, <strong>Wiesel</strong> insiste sur ce qui se trouve entre <strong>le</strong>s mots plutôt que<br />
sur ce qui se trouve dans chacun des mots. « Le si<strong>le</strong>nce qui sépare <strong>le</strong>s mots est ce qui m'excite et me fascine » [28],<br />
confie-t-il.<br />
Influencé par <strong>le</strong> concept talmudique de condensation, <strong>Wiesel</strong> a « en<strong>le</strong>vé, éliminé des mots, <strong>pour</strong> dire de moins en<br />
moins, toujours de moins en moins ». Paradoxa<strong>le</strong>ment aidé par sa connaissance du français en tant que langue<br />
étrangère (mais on retrouvera <strong>le</strong> même effet chez Samuel Becket), <strong>Wiesel</strong> peut al<strong>le</strong>r à l'essentiel, et développer ainsi<br />
un sty<strong>le</strong> dépouillé et percutant. Un sty<strong>le</strong> propice à l'évocation d'images troublantes et si<strong>le</strong>ncieuses.<br />
Le français donne ainsi à <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong> <strong>le</strong>s moyens du si<strong>le</strong>nce entre <strong>le</strong>s mots. Il peut entourer la Shoah d'une barrière<br />
de kedoushah, de sacré, et développer une oeuvre qui se veut un sanctuaire où <strong>le</strong>s mots respectent <strong>le</strong>s morts, où <strong>le</strong><br />
si<strong>le</strong>nce invoque des images qui savent transcender <strong>le</strong>s mots [29]. « L'art doit être <strong>le</strong> résultat d'un si<strong>le</strong>nce cumulatif » [<br />
30], nous dit <strong>Wiesel</strong>. Et l'emploi du français ce qui permet de faire surgir ce si<strong>le</strong>nce sémantique, et décrire par<br />
l'absence de mot toute l'étrangéité indicib<strong>le</strong> de l'expérience concentrationnaire.<br />
Conclusion<br />
Une langue ne cesse de s'inventer, ses mots de s'épaissir de sens. L'histoire d'une langue est intimement liée à<br />
l'imaginaire qu'el<strong>le</strong> véhicu<strong>le</strong>, qu'el<strong>le</strong> intègre, qu'el<strong>le</strong> développe.<br />
Copyright © Institut d'Etude des Faits Religieux Page 6/8
<strong>Choisir</strong> <strong>le</strong> français <strong>pour</strong> <strong>exprimer</strong> l'indicib<strong>le</strong>. <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong><br />
Pour autant, une langue peut-el<strong>le</strong> tout <strong>exprimer</strong> ? Peut-el<strong>le</strong> <strong>exprimer</strong> l'obscurité et <strong>le</strong> si<strong>le</strong>nce qui caractérisent la nuit<br />
de l'humanité, une nuit que seu<strong>le</strong> éclaire la lumière pâ<strong>le</strong> et imprécise de six millions de morts ? Six millions de morts<br />
qui ne peuvent témoigner que par ceux qui <strong>le</strong>ur ont survécus. « Les étoi<strong>le</strong>s n'étaient que <strong>le</strong>s étincel<strong>le</strong>s du grand feu<br />
qui nous dévorait. Que ce feu vienne à s'éteindre un jour, il n'y aurait plus rien au ciel, il n'y aurait que des étoi<strong>le</strong>s<br />
éteintes, des yeux morts », nous dit <strong>Wiesel</strong> dans La nuit [31]. La Shoah couvre d'une chape de si<strong>le</strong>nce et d'obscurité<br />
<strong>le</strong> langage qui tente de l'invoquer. Et <strong>le</strong> Monde était si<strong>le</strong>ncieux. Et <strong>le</strong> monde était La nuit. Comment invoquer des<br />
représentations littéraires, qui puissent rendre compte de l'obscurité et du si<strong>le</strong>nce d'une période ?<br />
L'étrangéité de l'expérience concentrationnaire est impossib<strong>le</strong> à percer. El<strong>le</strong> s'insère entre l'auteur et <strong>le</strong> <strong>le</strong>cteur, mais<br />
aussi entre l'auteur et lui-même, entre l'auteur et son propre langage. El<strong>le</strong> pose la question de la verbalisation du<br />
vécu. Ou plus exactement : du sur-vécu, du trop vécu, du trop éprouvé. El<strong>le</strong> en appel<strong>le</strong> d'el<strong>le</strong>-même au choix d'une<br />
langue nouvel<strong>le</strong>, afin de créer la distance, la distanciation nécessaire <strong>pour</strong> que la paro<strong>le</strong> puisse reprendre ses droits.<br />
Pour <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong>, cette langue nouvel<strong>le</strong> fut aussi une langue étrangère : la langue française.<br />
Langue cartésienne, nous dit-il ? Nous ne pouvons en juger. Comme l'a rappelé encore récemment Henri<br />
Meschonnic, « ce sont <strong>le</strong>s oeuvres qui font de la langue, de toute langue, ce qu'el<strong>le</strong> est » [32]. Gageons que la<br />
contribution d'<strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong> à la langue française a été une source d'enrichissement. Un enrichissement qui enfante,<br />
dans <strong>le</strong> si<strong>le</strong>nce des mots, un imaginaire douloureux et nécessaire : l'imaginaire de l'indicib<strong>le</strong>.<br />
Olivier Rota<br />
[1] Sur la particularité de la Shoah en Roumanie, voir l'édifiant livre de Radu Ioanid : La Roumanie et la Shoah. Destruction et survie des Juifs et<br />
des Tsiganes sous <strong>le</strong> régime Antonescu 1940-1944, Paris, Maison des sciences de l'homme, 2002, 383p<br />
[2] <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong>, Tous <strong>le</strong>s f<strong>le</strong>uves vont à la mer, Mémoires I, Paris, Seuil, Points, 1994, p.166.<br />
[3] E. <strong>Wiesel</strong> dans Tous <strong>le</strong>s f<strong>le</strong>uves vont à la mer, Mémoires I, p.407.<br />
[4] Ibidem.<br />
[5] Toute l'émotion de cette première rencontre est rapportée dans E. <strong>Wiesel</strong>, Un Juif aujourd'hui, Paris, Seuil, 1977, pp.27-31. Voir aussi : He<strong>le</strong>na<br />
Schillony, « Mauriac et <strong>le</strong>s Juifs : histoire et imaginaire », paru dans "Cahiers de Malagar" VIII, automne 1994, pp.45-56.<br />
[6] Voir : Joseph Sungolowsky, Holocauste et Autobiographie : <strong>Wiesel</strong> - Friedländer - Pisar, paru dans "Tsafon", n°41, printemps-été 2001,<br />
pp.61-81<br />
[7] E. <strong>Wiesel</strong> dans Tous <strong>le</strong>s f<strong>le</strong>uves vont à la mer, Mémoires I, p.407. Voir aussi <strong>le</strong>s commentaires que nous ne reprenons pas : « Ecrits en Yiddish<br />
», paru dans Michaël de Saint-Cheron, Autour de <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong>. Une Paro<strong>le</strong> <strong>pour</strong> l'Avenir, Colloque de Cerisy du 3 au 10 juil<strong>le</strong>t 1995, Odi<strong>le</strong> Jacob,<br />
1996, p.22.<br />
[8] Voir tout particulièrement : Miriam Weinstein, Yiddish. Mots d'un peup<strong>le</strong>, peup<strong>le</strong> de mots, Paris, autrement, Frontières, 2003, 263p.<br />
[9] E. <strong>Wiesel</strong>, Le Cinquième Fils, p.9.<br />
[10] Harold F<strong>le</strong>nder, Conversation with <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong>, "Women's American ORT Reporter", mars-avril 1970.<br />
[11] Voir à ce sujet : Joyce Block Lazarus, Strangers and Sojourners. Jewish Identity in Contemporary Francophone Fiction, New York, Peter<br />
Lang, 1999, 141p.<br />
[12] Ion Mihai<strong>le</strong>anu, Entretien avec <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong>, "Le Point", 10 janvier 2003.<br />
[13] E. <strong>Wiesel</strong>, La nuit, L'aube, Le jour, Paris, Seuil (édition en un volume), 1969, p.48.<br />
[14] Robert Jouanny, Singularités francophones, Paris, puf, Ecriture, 2000, p.142.<br />
[15] E. <strong>Wiesel</strong>, La nuit, L'aube, Le jour, p.133.<br />
Copyright © Institut d'Etude des Faits Religieux Page 7/8
<strong>Choisir</strong> <strong>le</strong> français <strong>pour</strong> <strong>exprimer</strong> l'indicib<strong>le</strong>. <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong><br />
[16] Voir notamment : Albert Camus, avec la contribution de Jacqueline Levi-Va<strong>le</strong>nsi, Antoine Garapon et Denis Salas, Réf<strong>le</strong>xion sur <strong>le</strong> terrorisme,<br />
Paris, Nicolas Philippe, 2002, 250p.<br />
[17] Reproduit dans : Antoine de Rivarol, L'Universalité de la langue française, Paris, Arléa, 1998, 124p.<br />
[18] Ion Mihai<strong>le</strong>anu, Entretien avec <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong>, "Le Point", 10 janvier 2003.<br />
[19] Lily Edelman, A Conversation with <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong>, "National Jewish Monthly", novembre 1973.<br />
[20] E. <strong>Wiesel</strong>, Le Cinquième Fils, p.10.<br />
[21] E. <strong>Wiesel</strong>, Un Juif aujourd'hui, p.26.<br />
[22] Jean-Claude Milner, Les penchants criminels de l'Europe démocratique, Paris, Verdier, Le séminaire de Jérusa<strong>le</strong>m, 2003, p.55.<br />
[23] Introduction à Robert Antelme, L'espèce humaine, 1947.<br />
[24] Jorge Semprun, <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong>, Se taire est impossib<strong>le</strong>, Paris, Mil<strong>le</strong> et une Nuits, 1995, pp.15, 17, 36-37.<br />
[25] E. <strong>Wiesel</strong>, Le Cinquième Fils, p.51.<br />
[26] Robert Franciosi, Brian Shaffer, An Interview with <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong>, "Contemporary Literature", n°3, 1987.<br />
[27] E. <strong>Wiesel</strong>, Le Cinquième Fils, p.44.<br />
[28] R. Franciosi, B. Shaffer, op.cit.<br />
[29] Voir notamment ce que peut en dire : Rosette C. Lamont, <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong> : In Serach of a Tongue, paru dans Alvin H. Rosenfelf, Irving Greenberg<br />
(dir.), "Confronting the Holocaust. The Impact of <strong>Elie</strong> <strong>Wiesel</strong>, Bloomington", Indiana University Press, pp.80-98.<br />
[30] Joseph Wershba, An Author Asks Why the World Let Hit<strong>le</strong>r Do It, "The New York Post", 2 octobre 1961.<br />
[31] E. <strong>Wiesel</strong>, La nuit, L'aube, Le jour, p.33.<br />
[32] Henri Meschonnic, L'ennemi des langues, c'est la langue, "Le Monde", 3 juil<strong>le</strong>t 1999.<br />
Copyright © Institut d'Etude des Faits Religieux Page 8/8