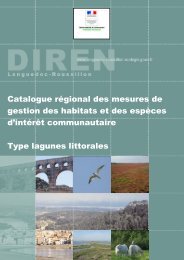Le phytoplancton toxique des lagunes méditerranéennes
Le phytoplancton toxique des lagunes méditerranéennes
Le phytoplancton toxique des lagunes méditerranéennes
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
plusieurs semaines en 2002, et le phénomène s’est reproduit en 2004. <strong>Le</strong>s conchyliculteurs ont<br />
sollicité leurs partenaires scientifiques et techniques pour trouver <strong>des</strong> solutions à ce phénomène.<br />
<strong>Le</strong>s étangs corses d’Urbino et de Diane ont également été touchés par <strong>des</strong> efflorescences <strong>toxique</strong>s<br />
de Dinophysis de 1992 à 1995 et en 1999.<br />
- D’autres microalgues à surveiller<br />
Bien que les espèces <strong>des</strong> genres Alexandrium et Dinophysis<br />
donnent les efflorescences <strong>toxique</strong>s les plus problématiques<br />
dans nos <strong>lagunes</strong> méditerranéennes, il n’en reste pas moins que<br />
d’autres espèces potentiellement <strong>toxique</strong>s pour la<br />
consommation humaine (par exemple, le genre Pseudonitzschia)<br />
ou pour la faune pourraient faire leur apparition dans<br />
Gymnodinium mikimotoi les zones de pêche et sont à surveiller de près.<br />
D’autre part, un laboratoire espagnol suit régulièrement<br />
l’évolution de Gyrodinium corsicum et Gymnodinium sp. sur les côtes méditerranéennes<br />
espagnoles. Ces deux dinoflagellés rencontrés sur les côtes catalanes sont très <strong>toxique</strong>s pour les<br />
poissons et ont engendré plusieurs épiso<strong>des</strong> de mortalité dans les élevages aquacoles en Espagne<br />
mais aussi à l’étang de Diane (Corse). De même, Prorocentrum minimum, espèce responsable<br />
d’une mortalité de poissons dans l’étang de Berre (PACA) en 1987, a été observée sur la côte<br />
espagnole et reste potentiellement une menace pour nos <strong>lagunes</strong> méditerranéennes. <strong>Le</strong><br />
développement d'outils moléculaires et de cytométrie en flux (biodétection, puces à ADN,<br />
marquage immunofluorescent) est primordial pour l’identification précoce et le suivi <strong>des</strong> espèces<br />
pouvant potentiellement être à l’origine d’efflorescences <strong>toxique</strong>s.<br />
Des connaissances à approfondir sur les dinoflagellés<br />
La présence <strong>des</strong> dinoflagellés en lagune a soulevé plusieurs questions : d’où viennent-ils et<br />
pourquoi ne se développent-ils qu’à certaines pério<strong>des</strong> de l’année ?<br />
Concernant leur origine en milieu lagunaire, leur dissémination accidentelle par les eaux de<br />
ballasts <strong>des</strong> bateaux a souvent été accusée comme principale source d’ensemencement. Une autre<br />
hypothèse a été évoquée et concerne une introduction de dinoflagellés contenus dans <strong>des</strong><br />
coquillages transférés d’un site contaminé par le <strong>phytoplancton</strong> <strong>toxique</strong> vers la lagune.<br />
Une étude portant plus particulièrement sur la phylogénie <strong>des</strong> dinoflagellés <strong>toxique</strong>s du genre<br />
Alexandrium, a révélé de fortes similitu<strong>des</strong> entre l’espèce présente dans l’étang de Thau et <strong>des</strong><br />
souches japonaises (Lily et al., 2002). Ces résultats viendraient renforcer cette hypothèse<br />
d’introduction de ces dinoflagellés par les eaux de ballasts de bateaux venant de sites<br />
vraisemblablement contaminés.<br />
<strong>Le</strong>s dinoflagellés peuvent résister à un voyage suffisamment<br />
long en s’enkystant. Il s’agit d’une phase de leur cycle de vie<br />
qui leur permet de résister à <strong>des</strong> conditions<br />
environnementales défavorables à leur développement.<br />
Ce cycle de vie a fait l’objet de nombreuses étu<strong>des</strong> dans le<br />
monde. Lorsque les conditions environnementales sont<br />
favorables à son développement, les kystes peuvent germer<br />
Kystes d’Alexandrium. Photo Y. Fukuyo<br />
pour donner <strong>des</strong> cellules mobiles qui peuvent se déplacer<br />
dans la colonne d’eau en direction <strong>des</strong> zones les plus<br />
nutritives. Celles-ci sont capables de se multiplier très vite et leur concentration peut atteindre<br />
6000 à 8000 cellules par litre en une semaine. Lors <strong>des</strong> épiso<strong>des</strong> <strong>toxique</strong>s les plus importants, les




![[PDF] : grainelr.org - Le GRAINE LR](https://img.yumpu.com/43844933/1/184x260/pdf-grainelrorg-le-graine-lr.jpg?quality=85)