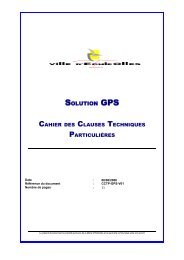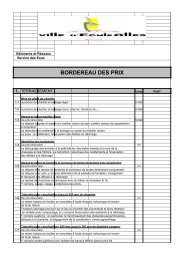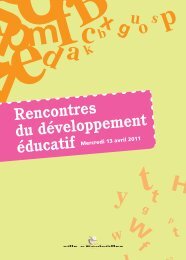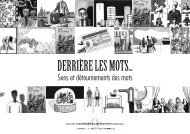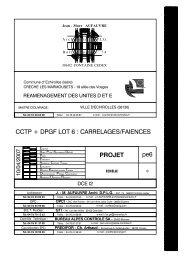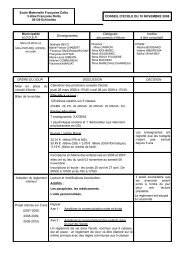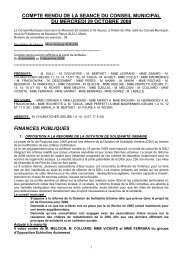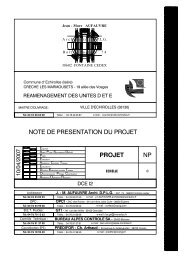HISTOIRE D'ÃCHIROLLES - Echirolles
HISTOIRE D'ÃCHIROLLES - Echirolles
HISTOIRE D'ÃCHIROLLES - Echirolles
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>HISTOIRE</strong> D’ÉCHIROLLES<br />
74
PREMIÈRE PARTIE : UN NOUVEL ÉLAN POUR ÉCHIROLLES (1939-1958)<br />
Chapitre 4<br />
La croissance urbaine des années 1950<br />
Si la Viscose connaît des difficultés au début des années 1950, l’activité industrielle<br />
de la région grenobloise tend au contraire à se développer et les<br />
besoins en main-d’œuvre à fortement progresser. L’agglomération se trouve<br />
ainsi plus que jamais confrontée à un grave problème de logement et plus<br />
particulièrement de logements sociaux. Désireux d’aider les ouvriers, les<br />
élus échirollois s’engagent résolument dans la construction d’immeubles HLM (habitation<br />
à loyer modéré) et de lotissements destinés à favoriser l’accession à la propriété.<br />
Parallèlement, elle autorise des initiatives privées, quitte à conforter la ville dans son<br />
rôle de commune-dortoir. La population échirolloise recommence donc à augmenter<br />
au rythme de la livraison de ces nouvelles habitations, tant municipales que privées.<br />
D’abord relativement modérée entre 1946 et 1954, période durant laquelle le nombre<br />
d’habitants passe de 2 825 à 3 762, la croissance s’accélère à la fin des années 1950 où<br />
la barre des 5 000 habitants est franchie. Échirolles reste toutefois une petite commune<br />
en comparaison de Grenoble, qui compte 116 000 habitants au recensement de<br />
1954, et même des autres villes ouvrières de l’agglomération comme Fontaine et Saint-<br />
Martin-d’Hères qui en accueillent respectivement au même moment 8 817 et 6 839.<br />
Cette croissance de la population ne fait qu’accentuer les problèmes d’infrastructures<br />
qui étaient loin d’être résolus avant-guerre. L’ouverture de classes et la construction<br />
d’établissements scolaires mobilisent ainsi d’année en année une grande partie de<br />
l’énergie et des ressources de la municipalité. Ressurgissent également les questions<br />
d’eau potable, de voirie et d’électricité, autant de réseaux qu’il faut redimensionner<br />
et financer. Il faut également fournir aux habitants tous les services que les citoyens<br />
attendent désormais d’une ville. Même si la commune conserve en grande partie sa<br />
ruralité, l’essor urbain d’Échirolles est bel et bien amorcé et ne fait que s’accélérer au<br />
cours des années 1950, malgré des budgets particulièrement serrés.<br />
Des logements pour accueillir de nouveaux habitants<br />
Au sortir de la guerre, le nombre d’habitations sur le territoire échirollois évolue relativement<br />
peu. En moyenne, seuls trois logements sont bâtis chaque année entre 1945<br />
et 1949, une période peu favorable à la construction en raison des multiples problèmes<br />
d’approvisionnement. Le mouvement s’accélère vraiment à partir de l’année 1954,<br />
durant laquelle 123 logements sont livrés. Il s’agit encore essentiellement de pavillons<br />
individuels et d’immeubles de petite taille, la construction de grands ensembles ne<br />
débutera qu’à la fin des années 1950.<br />
Page de gauche :<br />
Deux jeunes mamans et<br />
leurs enfants devant une<br />
des maisons de la cité de la Viscose,<br />
années 1950, coll. privée.<br />
75
<strong>HISTOIRE</strong> D’ÉCHIROLLES<br />
L’augmentation de la population échirolloise est ainsi relativement limitée entre 1946<br />
et 1954, même si elle progresse malgré tout de 937 habitants en huit ans. L’ensemble<br />
de la commune est concernée par cette croissance démographique, mais c’est surtout<br />
la partie ouest et plus particulièrement les secteurs de La Ponatière, du Rondeau et<br />
de La Quinzaine qui se développent avec la création de zones pavillonnaires. La cité<br />
de la Viscose continue, avec ses 1 566 habitants en 1954, d’occuper une place de premier<br />
plan, mais sa progression est proportionnellement moins importante que celle<br />
des quartiers environnants, voire de celle du village. Entre 1936 et 1954, le Bourg et<br />
ses hameaux gagnent plus de 300 habitants.<br />
« Mes parents sont venus habiter au Rondeau. Le logement était confortable pour l’époque :<br />
quatre pièces, pas de salle de bains ça n’existait pas à l’époque… Il y avait la contre-allée, un canal<br />
qui longeait le cours Jean-Jaurès et le tramway. Autour du rond-point du Rondeau, il y avait quatre<br />
grands champs. C’était notre terrain de jeu, d’ailleurs les cirques, la transhumance et<br />
les gitans s’arrêtaient là. Les gitans se mettaient à jouer de la musique, et nous, petits,<br />
on était émerveillés de tout ça. Dans ces champs, il y avait des fêtes aussi, des soirées dansantes. »<br />
Pierrine Gaillard<br />
La composition de la population échirolloise connaît de sensibles évolutions au cours<br />
de ces années. Le nombre d’étrangers diminue pour ne plus représenter qu’un cinquième<br />
des habitants. En 1954, les Italiens forment toujours la communauté la plus<br />
importante avec 327 personnes. Les autres nationalités sont nettement moins nombreuses<br />
: 57 Polonais, 44 Hongrois, 34 Espagnols et 23 Russes. Quelques Allemands,<br />
Autrichiens, Arméniens, Grecs, Portugais, Roumains,<br />
Syriens, Tchèques et Yougoslaves continuent d’habiter<br />
Échirolles et plus particulièrement la cité de<br />
la Viscose. Une autre évolution notable concerne la<br />
1936 1954 Croissance<br />
baisse progressive du nombre d’agriculteurs. Seules<br />
114 personnes déclarent vivre de l’agriculture en 1954,<br />
soit 7 % de la population active, alors qu’elles étaient<br />
encore 238 au recensement de 1946. Le nombre<br />
d’habitants travaillant dans l’industrie continue en<br />
revanche de progresser : 1 015 personnes en 1954, soit<br />
62 % de la population active, une des proportions les<br />
plus importantes de l’histoire d’Échirolles.<br />
L’accroissement de la population s’accélère nettement<br />
entre 1954 et 1958. En seulement quatre ans,<br />
elle augmente de 1 677 habitants pour atteindre<br />
5 439 personnes. Cette hausse résulte de la mise en<br />
chantier de plusieurs projets. Entre le Bourg et les<br />
Glaires, la société chimique Progil, installée à Pont-de-<br />
Claix, érige un lotissement pour loger son personnel.<br />
Un peu plus à l’est, sur le site encore vierge de La<br />
Commanderie, la construction d’un autre lotisse-<br />
Évolution de la population par quartier entre<br />
les recensements de 1936 et 1954<br />
Village 618 946 53 %<br />
Chef-lieu/Bourg 296 439 48 %<br />
Les Glaires 191 231 21 %<br />
Les Granges/La Buclée 71 76 7 %<br />
La Petite Quinzaine 64<br />
Badareau 25 45 80 %<br />
Gringallet 14 22 57 %<br />
Château-Gaillard 21 69 229 %<br />
Ouest 662 1 250 89 %<br />
Le Rondeau 221 392 77 %<br />
La Ponatière 181 469 159 %<br />
La Quinzaine 159 259 63 %<br />
Villancourt 101 130 29 %<br />
La Viscose 1 240 1 566 26 %<br />
Total 2 520 3 762 49 %<br />
76
PREMIÈRE PARTIE : UN NOUVEL ÉLAN POUR ÉCHIROLLES (1939-1958)<br />
ment pavillonnaire est amorcée par la société immobilière « Un logement pour tous ».<br />
Plus ambitieux, ce projet concerne à l’origine la réalisation de 116 maisons. Toutefois,<br />
seule une première tranche de 75 logements est livrée entre 1954 et 1957, le promoteur<br />
rencontrant des difficultés à réaliser l’ensemble de son programme. Année après<br />
année, d’autres constructions individuelles sortent de terre dans le village, autour<br />
des rues Pierre-Sémard, Paul-Langevin et Stalingrad. Le hameau de Château-Gaillard<br />
continue son développement avec l’édification d’un nouveau lotissement. La zone<br />
ouest poursuit sa propre évolution avec la construction de pavillons à La Quinzaine,<br />
à La Ponatière, à Villancourt et en bordure du cours Jean-Jaurès. Le Rondeau accueille<br />
lui aussi de nouveaux habitants grâce à la construction de maisons, mais également<br />
d’immeubles dans lesquels investissent les établissements Neyrpic qui cherchent,<br />
comme Progil, des logements à proposer à leur personnel. Dans les années 1950, le<br />
développement de l’industrie grenobloise attire en effet une main-d’œuvre nombreuse<br />
qui cherche à se loger dans les communes de l’agglomération. Outre ceux de la Viscose,<br />
Échirolles accueille beaucoup d’ouvriers de Neyrpic et des sociétés de Pont-de-Claix :<br />
Progil et Metafram.<br />
Le Rondeau<br />
GRENOBLE<br />
La Quinzaine<br />
Rocade Sud<br />
Grand Place<br />
SEYSSINS<br />
La cité de la Viscose<br />
La Ponatière<br />
Espace<br />
Comboire<br />
A480<br />
Cours Jean-Jaurès<br />
Hôtel<br />
de ville<br />
Rocade Sud<br />
Hôpital Sud<br />
EYBENS<br />
La Commanderie<br />
BRESSON<br />
PONT-DE-CLAIX<br />
Villancourt<br />
Le Bourg - Le Village<br />
Les Glaires<br />
En 1955, constatant une grave pénurie de logements et une hausse du prix des terrains<br />
en raison de la spéculation, le maire d’Échirolles et son conseil décident d’intervenir<br />
directement dans le développement immobilier de la commune avec la construction<br />
de « lotissements municipaux ». Le projet consiste à acheter des terrains pour réaliser<br />
de petits immeubles HLM et pour proposer à des particuliers des parcelles viabilisées<br />
leur permettant de faire construire leur propre maison sans subir les surcoûts<br />
77
<strong>HISTOIRE</strong> D’ÉCHIROLLES<br />
Le village d’Échirolles, le lotissement<br />
Progil, carte postale, 1957, coll. AME.<br />
Le lotissement de La Commanderie,<br />
vers 1957, coll. AME.<br />
La Ponatière, au fond le groupe<br />
scolaire Paul-Vaillant-Couturier,<br />
1958, coll. AME.<br />
engendrés par la spéculation des promoteurs privés.<br />
Utilisant la procédure des Logécos (logements économiques<br />
et familiaux), le conseil réussit à trouver des<br />
terrains que les propriétaires acceptent de vendre à des<br />
prix « tout à fait raisonnables » et peut ainsi programmer<br />
la réalisation de deux ensembles immobiliers, l’un<br />
dans le quartier de La Ponatière et l’autre à proximité<br />
du terrain de football du village. En mars 1956, après<br />
avoir obtenu les autorisations nécessaires, la municipalité<br />
lance donc la construction de cinq immeubles<br />
de 16 logements à La Ponatière. Financée par plusieurs<br />
emprunts, l’opération est évaluée à 157 millions<br />
de francs, ce qui représente un investissement considérable pour une commune dont<br />
le total des recettes ordinaires s’élève à environ 24 millions en 1956. Livrés à partir de<br />
l’année 1958, ces logements accueillent immédiatement de nouvelles familles. L’autre<br />
ensemble, le lotissement des Sports, qui comprenait à l’origine, comme à La Ponatière,<br />
quatre immeubles, est finalement intégralement converti en parcelles individuelles<br />
suite à l’augmentation du nombre des demandes.<br />
L’accession à la propriété connaît un engouement croissant<br />
avec la reprise du développement économique du<br />
pays. Le plein emploi, les opportunités professionnelles<br />
liées à l’essor des entreprises, l’amélioration progressive<br />
des salaires et la généralisation des systèmes de<br />
protection sociale créent un environnement favorable<br />
qui permet à certains ouvriers et employés de se lancer<br />
dans un projet immobilier. En revendant des parcelles<br />
viabilisées sans réaliser de plus-values, la municipalité<br />
échirolloise entend clairement encourager les ménages<br />
modestes à devenir propriétaires de leur logement. Les parents d’Yves Castella bénéficient<br />
de cette initiative : « M. Kioulou venait souvent à la maison et il parlait du futur<br />
lotissement de la rue Delaune. C’est comme ça que l’on a pu construire. On est arrivés<br />
en août 1958. » La famille Moussy décide également de quitter la cité de la Viscose pour<br />
s’installer dans le nouveau lotissement des Sports : Mme Moussy raconte : « Je suis<br />
allée m’inscrire à la mairie en me disant on verra bien si le terrain nous est attribué.<br />
Finalement, ça c’est très bien passé. » Afin de réduire au<br />
maximum les coûts, la municipalité propose son aide<br />
à ceux qui la demandent pour établir les plans de leur<br />
maison : « On les achetait à la mairie 10 000 francs. Un<br />
architecte c’était dans les 100 000 ou 200 000 francs.<br />
Nos maisons sont à peu près toutes dans le même style,<br />
des F4 et des F5. » À une époque où le crédit bancaire<br />
aux particuliers est réservé aux plus aisés, il arrive que<br />
les entreprises soutiennent les projets immobiliers de<br />
leurs salariés en accordant des prêts d’honneur ou en<br />
78
PREMIÈRE PARTIE : UN NOUVEL ÉLAN POUR ÉCHIROLLES (1939-1958)<br />
les autorisant à utiliser les équipements de la société sur leur chantier. Faute de moyens<br />
financiers suffisants, beaucoup de personnes mettent en effet à profit leurs compétences<br />
professionnelles et celles de leur entourage pour construire eux-mêmes leur<br />
résidence. Ceux qui parviennent à économiser suffisamment réussissent ainsi, par<br />
l’accès à la propriété, à améliorer sensiblement leur situation matérielle et à sortir<br />
pas à pas du prolétariat.<br />
« À La Ponatière, c’était la campagne. Les deux premiers Logécos venaient de se construire et<br />
il n’y avait rien derrière. Il y avait l’école et puis des champs, des champs.<br />
Quelques petites villas se construisaient, notamment la villa de Georges Kioulou…<br />
C’était vraiment l’idéal d’avoir une salle de bains, d’avoir une chambre supplémentaire,<br />
voire deux pour certaines grandes familles qui arrivaient. » Joëlle Chorier<br />
« Mme Dimier, qui était dans le même immeuble que nous, avait acheté au lotissement de La Ponatière et<br />
elle nous a dit : pourquoi vous restez à la cité ? Essayez de vous mettre chez vous.<br />
Il n’y a plus de terrains à La Ponatière, mais je crois qu’il va y en avoir au village. » Simone Moussy<br />
« Sur le cours Jean-Jaurès, c’était surtout des maisons individuelles<br />
que des gens de la Viscose commençaient à acquérir…<br />
Bien souvent, ça a été des chefs qui ont réussi à construire leur maison individuelle<br />
alors qu’auparavant ils étaient dans un milieu cité. » Daniel Wojkowiak<br />
Cette première étape de l’essor urbain échirollois n’affecte guère le caractère rural<br />
de la commune et par beaucoup d’aspects les modes de vie restent assez proches de<br />
ceux d’avant-guerre. Les nouveaux lotissements ne forment encore que des îlots au<br />
milieu des champs, comme le rappelle Pierrine Gaillard qui emménage dans celui de<br />
La Ponatière à la fin des années 1950 : « Je me souviens d’un matin, quand j’ai ouvert<br />
ma porte, j’avais des vaches dans ma cour parce que ce n’était pas clôturé. Elles sortaient<br />
du pré et venaient se balader dans le quartier. » Dans le village,<br />
se souvient la famille Alberto, les mariages continuent de regrouper<br />
de nombreux voisins : « C’était joyeux, tout le monde se connaissait et<br />
quand on s’est mariés, c’était la fête. Il y a eu un grand apéritif et tout<br />
le monde a eu des dragées. La veille du mariage, les villageois tiraient<br />
des coups de fusil, c’était en 1959, après ça a été interdit. » Les champs<br />
constituent toujours le terrain de jeux privilégié des enfants de la commune<br />
qui vont jouer au foot et faire des barrages dans les ruisseaux.<br />
« On s’en faisait souvent sortir parce qu’on écrasait l’herbe et le garde<br />
champêtre d’Échirolles nous faisait un peu la chasse » se souvient Yves<br />
Castella. Comme lui, le dimanche, Daniel Wojkowiak accompagne ses<br />
parents à l’aérodrome pour voir les parachutistes et les courriers qui<br />
atterrissaient. Pour les jeunes de la cité de la Viscose, le Drac et les<br />
étangs offrent toujours autant de distractions. « On a tous appris à<br />
nager dans le Drac » déclare Daniel Wojkowiak qui le traverse alors<br />
« pour aller à la maraude à Seyssins, car il y avait des cerisiers ».<br />
Mariés et leur cortège, entre<br />
la mairie et l’église Saint-Jacques,<br />
cliché Givet, 1961, coll. privée.<br />
79