Mignet F. (2010) â PBilan des résultats du suivi radio-télémétrique ...
Mignet F. (2010) â PBilan des résultats du suivi radio-télémétrique ...
Mignet F. (2010) â PBilan des résultats du suivi radio-télémétrique ...
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
température interne variable (poïkilothermie) et dépendante <strong>des</strong> conditions extérieures (notiond’ectothermie). Toutefois, la température interne ne doit pas s’élever au-delà d’un certainseuil (Température maximale critique), au risque de provoquer une hyperthermie létale.Dans les régions tempérées, toutes les tortues hibernent (Gibbons et al. 1990 ; Parde etal. 2000) sous l’eau (nos résultats). La plupart <strong>des</strong> indivi<strong>du</strong>s ont passé la période hivernale2009/<strong>2010</strong> au sud de l’étang dans les zones d’eau libre présentant un couvert végétalimportant (phragmitaies sèches essentiellement). Une étude réalisée sur les populationssauvages de l’Isle Crémieu en Isère souligne également une préférence marquée pour ce typede végétation (Thienpont, 2005). Selon Parde et al (2000), les sites d’hivernation sont engrande partie encombrés par la végétation (bois mort, plantes aquatiques, accumulation defeuilles mortes…), offrant <strong>des</strong> conditions thermiques stables et une certaine tranquillité. EnEurope, les étu<strong>des</strong> de terrain montrent que les tortues passent l’hiver principalement dansl’eau (Novotný et al. 2004 ; Cadi et al. 2008 ; cette étude). Elles sont néanmoins capables <strong>des</strong>urvivre aux conditions hivernales en utilisant le milieu terrestre, mais la plupart <strong>des</strong> donnéesdisponibles se réfèrent à <strong>des</strong> indivi<strong>du</strong>s en captivité (cf. Ultsch, 2006). Pour les populationsnaturelles, Mitrus (<strong>2010</strong>) évoque la nécessité de données pertinentes sur ce sujet et émetl’hypothèse selon laquelle l’utilisation de l’habitat terrestre pendant la phase léthargiqued’hivernation est liée à une période d’estivation sur ce type de milieu. Nos résultatspermettent de confirmer cette hypothèse. Cependant, le manque d’informations sur lesfacteurs motivationnels ne permet pas, à l’heure actuelle, d’expliquer précisément lapréférence observée pour l’habitat terrestre pendant l’hivernation 2008/2009. Les mêmesobservations ont été faites pour les populations corses (Destandau com. pers.). L’entrée enhivernation a débuté en novembre, à cette période le niveau d’eau était encore négatif. Dansce cas, cette tendance con<strong>du</strong>it à l’hypothèse que les facteurs de perturbation liés aux variations<strong>du</strong> milieu (assèchement…) in<strong>du</strong>isent <strong>des</strong> comportements adaptatifs. L’hivernation est unphénomène complexe impliquant une multitude de paramètres endogènes et exogènes:rythmes biologiques, facteurs chimiques, facteurs climatiques variés (température, insolation,rayonnement global…), facteurs environnementaux. Néanmoins, ces observations requièrent<strong>des</strong> recherches approfondies pour expliquer les processus physiologiques nécessaires à lasurvie de la Cistude dans de telles conditions. En dépit <strong>du</strong> nombre important de donnéesdisponibles, plusieurs points restent en suspens sur les mécanismes de l’hivernation.- 17 -




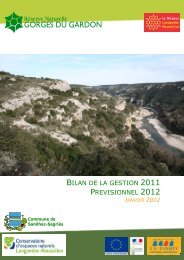

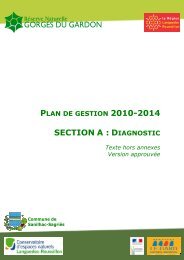
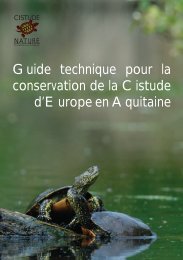
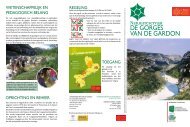
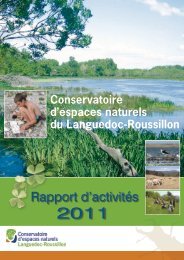
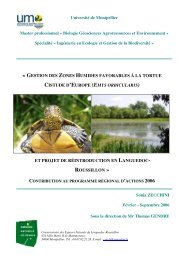

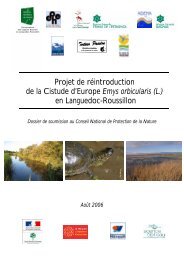
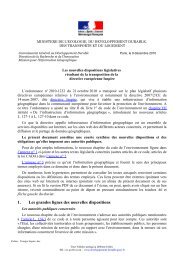
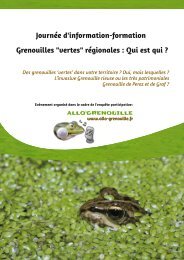

![Fiche de reconnaissance et contact pour le signalement [1,7Mo]](https://img.yumpu.com/28720302/1/182x260/fiche-de-reconnaissance-et-contact-pour-le-signalement-17mo.jpg?quality=85)