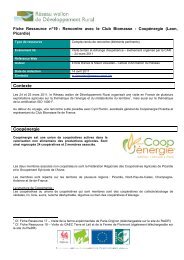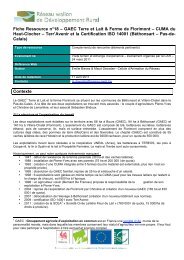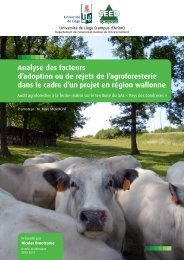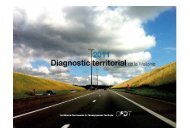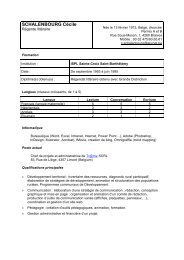PROSPECTIVE - Réseau wallon de Développement rural
PROSPECTIVE - Réseau wallon de Développement rural
PROSPECTIVE - Réseau wallon de Développement rural
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
7Energie : une pressionaccrue sur le budget <strong>de</strong>sménagesAlors que l’augmentation <strong>de</strong>s coûts et lararéfaction <strong>de</strong> l’énergie fossile <strong>de</strong>vraient apriori susciter une diminution <strong>de</strong>s déplacementsmotorisés, la croissance démographiqueet le vieillissement <strong>de</strong> la population<strong>de</strong>vraient au contraire générer davantage<strong>de</strong> déplacements. Une part importante <strong>de</strong> laconsommation énergétique, due aux déplacementsdomicile-travail, est notammentliée à l’offre <strong>de</strong> logements. Dans ce cadre,les ménages <strong>de</strong>s communes <strong>rural</strong>es les pluséloignés <strong>de</strong>s bassins d’emploi seront lesplus touchés en raison <strong>de</strong> trajets plus longset <strong>de</strong> logements plus énergivores. Dans cecontexte, les perspectives d’augmentationdu prix <strong>de</strong> l’énergie vont engendrer unepression sur le budget <strong>de</strong>s ménages, unepression déjà perceptible aujourd’hui.Aujourd’hui, la consommation énergétiquemoyenne <strong>de</strong>s bâtiments <strong>wallon</strong>s reste trèsélevée. La production électrique renouvelable,elle, <strong>de</strong>vrait augmenter <strong>de</strong> 40% d’ici à2020.Dans ce domaine, les communes <strong>rural</strong>es ontl’avantage <strong>de</strong> la disponibilité d’espace et <strong>de</strong>la proximité <strong>de</strong>s ressources (coproduits agricoles,site venteux et ensoleillés,...), caractéristiquesfavorables au développement <strong>de</strong>sénergies renouvelables.Mobilité et transports :développer les services etfavoriser <strong>de</strong>s alternatives àla voitureLes territoires ruraux sont largement dépendants<strong>de</strong> l’automobile. Près <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux tiers<strong>de</strong>s déplacements quotidiens s’y font envoiture. La limitation <strong>de</strong> la consommationd’énergie, avec, en corollaire, la diminution<strong>de</strong>s émissions <strong>de</strong> CO 2, constitue un véritabledéfi pour les habitants <strong>de</strong>s zones <strong>rural</strong>es.Aujourd’hui, la structure territoriale <strong>wallon</strong>neet les difficultés pour adapter l’offre<strong>de</strong> transports en commun impliquent uneforte dépendance à la voiture et une vulnérabilité<strong>de</strong>s communes éloignées <strong>de</strong>scentres d’emploi. Dans l’hypothèse où la localisation<strong>de</strong> l’emploi reste dans les gran<strong>de</strong>slignes inchangées, les communes <strong>rural</strong>es lesplus éloignées <strong>de</strong>s centres d’emploi serontsans doute pénalisées. Dans ces communes,l’absence <strong>de</strong> véhicule personnel, qui toucheprincipalement les jeunes, les personnesâgées en perte d’autonomie et certainespersonnes en parcours d’insertion professionnelle,contribue à créer localement <strong>de</strong>ssituations d’isolement, voire d’exclusion.Par ailleurs, et au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la nécessité <strong>de</strong> proposerune offre <strong>de</strong> déplacement pour tous,la mobilité peut permettre <strong>de</strong> renforcer ou<strong>de</strong> maintenir l’attractivité <strong>de</strong>s territoiresruraux. La mobilité <strong>de</strong>s personnes est alorspensée dans une approche globale, commeune condition pour développer l’attractivitédu territoire. Pour répondre à ces enjeux, lesinitiatives locales agissent aussi bien sur lamobilité <strong>de</strong>s services (mutualisation, permanences,services ambulants) que sur leurdématérialisation. La proximité <strong>de</strong>s noyauxd’habitat avec les équipements et servicescomplémentaires (loisirs y compris) <strong>de</strong>vraêtre favorisée, ainsi que la <strong>de</strong>sserte <strong>de</strong> cesservices par un mo<strong>de</strong> alternatif à la voiture.Changements climatiques :<strong>de</strong>s risques d’inondationsaccrusSelon les travaux <strong>de</strong> l’Agence Air-Climat, lestendances qui se <strong>de</strong>ssinent en matière <strong>de</strong>changement climatique en Wallonie fontenvisager pour l’avenir un climat plus chaudmais pas forcément moins pluvieux. L’élévation<strong>de</strong>s températures moyennes estgénéralisée, mais les projections peinent às’accor<strong>de</strong>r sur le changement du volume <strong>de</strong>précipitations annuelles. Cependant, l’agenceconstate une tendance à l’augmentationdu nombre <strong>de</strong> jours annuels <strong>de</strong> très fortesprécipitations. Les différences régionalesseront plus marquées.Si les hivers seront moins froids, les précipitationshivernales connaitront une augmentationprogressive et forte selon les projectionsmoyennes. De leur côté, les étés seront pluschauds et secs avec une baisse généralisée<strong>de</strong>s précipitations estivales.Enfin, les saisons intermédiaires seront plusdouces, avec une augmentation généralisée<strong>de</strong>s températures au printemps et enautomne, puis, à partir <strong>de</strong> 2050, une augmentationdu nombre <strong>de</strong> jours <strong>de</strong> caniculesestivales. Ce <strong>de</strong>rnier phénomène pourraitavoir <strong>de</strong>s conséquences sanitaires liées notammentau vieillissement <strong>de</strong> la population.Par un effet d’amplification du phénomèned’îlot <strong>de</strong> chaleur urbain, ces conséquencesseront plus directes sur les villes.L’urbanisation du territoire provoque l’imperméabilisationcroissante <strong>de</strong>s sols. Les fortesprobabilités d’augmentation du volume <strong>de</strong>précipitations et <strong>de</strong> l’intensité <strong>de</strong>s pluies hivernales<strong>de</strong>vraient renforcer le risque d’inondations.L’adaptation mérite d’être pensée icisur le long terme notamment au niveau <strong>de</strong>la planification urbaine (limitation <strong>de</strong> l’étalement).Les augmentations projetées <strong>de</strong> lafréquence et <strong>de</strong> l’intensité <strong>de</strong>s précipitationsen hiver accentueront l’érosion hydrique etdonc la vulnérabilité du secteur agricole. Demême, la hausse attendue <strong>de</strong> la durée <strong>de</strong>ssècheresses est susceptible d’influer sur l’érosionet la fragilité <strong>de</strong>s sols. Les cultures sarcléeset les sols nus seront particulièrementvulnérables. Cela <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ra, <strong>de</strong> la part dumon<strong>de</strong> agricole, une adaptation <strong>de</strong>s pratiquesculturales et du savoir-faire en matière<strong>de</strong> couverture <strong>de</strong> sol.Environnement : une netteérosion <strong>de</strong> la biodiversitéAujourd’hui, l’érosion globale <strong>de</strong> la biodiversitéest importante 2 , et il n’existe aucunsigne <strong>de</strong> ralentissement du processus. Parallèlementà la modification <strong>de</strong>s biotopes, la<strong>de</strong>struction <strong>de</strong>s habitats naturels est conséquenteet conduit à la <strong>de</strong>struction du maillageécologique. Les habitats situés au norddu sillon Sambre-et-Meuse sont uniformémentet <strong>de</strong>nsément fragmentés. Les zonesles moins fragmentées du sud sont les zonesboisées à caractère acci<strong>de</strong>nté et les zonesagroforestières à caractère extensif. De leurcôté, les pratiques agricoles favorables à labiodiversité occupent seulement 7,1 % <strong>de</strong>la surface agricole utile (SAU) tandis quel’expansion d’espèces invasives concurrenceles espèces indigènes, modifiant les écosystèmeset induisant une perte <strong>de</strong> diversitégénétique.Du côté <strong>de</strong>s forêts <strong>wallon</strong>nes, le <strong>de</strong>gré <strong>de</strong>naturalité moyen est faible. Les forêts <strong>de</strong>feuillus sont mieux cotées que les forêtsmonospécifiques <strong>de</strong> résineux exotiques(épicéa) et <strong>de</strong> hêtres, où le grand gibier estmaintenu artificiellement pour la chasse.Enfin, même si <strong>de</strong> nombreux sites naturelsdisposent d’une protection efficace, cetteévolution est largement insuffisante pourcontrer l’érosion <strong>de</strong> la biodiversité au sein <strong>de</strong>paysages en voie <strong>de</strong> banalisation.Ruralités – Magazine n°15 – 3 e trimestre 2012