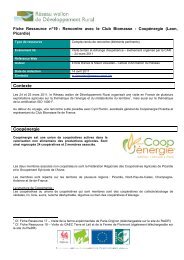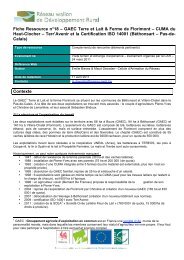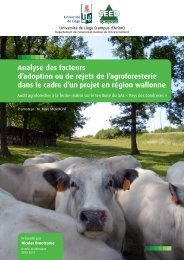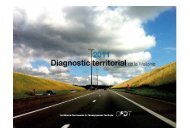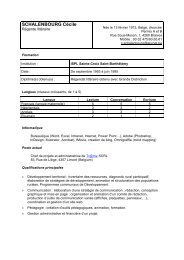PROSPECTIVE - Réseau wallon de Développement rural
PROSPECTIVE - Réseau wallon de Développement rural
PROSPECTIVE - Réseau wallon de Développement rural
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
9Anticiper le futur par unedémarche prospectiveLe <strong>Réseau</strong> <strong>wallon</strong> <strong>de</strong> <strong>Développement</strong><strong>rural</strong> n’a pas pour volonté <strong>de</strong> jouer àMadame Irma ! L’exercice <strong>de</strong> prospectiveemmène les membres du groupe du travailvers l’analyse <strong>de</strong>s futurs possibles, laproduction <strong>de</strong>s scénarios réalistes pourse donner les moyens d’agir, et, en suivantune métho<strong>de</strong> spécifique, les invite àconfronter <strong>de</strong>s visions différentes quantà l’avenir, sans pour autant obtenir leconsensus sur UNE vision d’avenir. Le défipour les participants est d’entrer dans unapprentissage qui aiguise la compréhension<strong>de</strong>s enjeux et décuple le potentield’action.©SPW-Guy FocantPour élaborer une démarche prospective,les ressources à mobiliser sont <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxordres. D’un côté, il s’agit <strong>de</strong> mobiliser<strong>de</strong>s informations expertes (statistiques,avis d’experts, résultats d’étu<strong>de</strong>s) et <strong>de</strong>s’appuyer sur <strong>de</strong>s connaissances établies.De l’autre, l’animateur recourt largementà l’imagination <strong>de</strong>s participants et au dialogue<strong>de</strong> manière à stimuler la réflexion etenvisager différents points <strong>de</strong> vue.Déterminer le champ <strong>de</strong>l’exercice prospectifLa première phase du travail consisteà définir l’objet <strong>de</strong> l’exercice prospectif.Dans le cas qui occupe le <strong>Réseau</strong>, ce sontles espaces ruraux, leurs composantes, lesparamètres qui pèsent sur leur futur etsur lesquels on peut agir. Il faut avant toutinventorier tous les facteurs qui peuventinfluencer ce <strong>de</strong>venir : évolution démographique,mutation <strong>de</strong> l’économie, changementclimatique,… (lire l’article pages 5 à 9).Concrètement, l’animateur du groupe <strong>de</strong>travail propose aux participants d’envisagerl’avenir <strong>de</strong>s espaces ruraux en défendant<strong>de</strong>s positions variées (responsablecommunal, agriculteur, citoyen lambda,…).Une fois le champ d’analyse déterminé, lesparticipants construisent une base d’informations.Ils peuvent, en fonction <strong>de</strong>s besoins,activer <strong>de</strong>s experts et recourir à <strong>de</strong> ladocumentation.I<strong>de</strong>ntifier <strong>de</strong>s sous-systèmesVient ensuite l’exercice <strong>de</strong> prospective proprementdit, en <strong>de</strong>ux temps.Premièrement, le groupe i<strong>de</strong>ntifie les soussystèmes,les phénomènes importants.Ils peuvent être interdépendants tout enrestant relativement autonomes les uns<strong>de</strong>s autres. Par exemple, l’agriculture etles transports sont <strong>de</strong>ux sous-systèmesdistincts d’un ensemble plus grand queconstitue l’économie locale : ils font chacunleur petit bonhomme <strong>de</strong> chemin, bienqu’ils soient tous les <strong>de</strong>ux tributaires d’unmême facteur comme le prix <strong>de</strong> l’énergie,par exemple. L’intérêt <strong>de</strong> la démarche rési<strong>de</strong>dans le fait qu’on ne se noie pas dansune vision globale mais que l’on envisagechaque sous-système tour à tour.Deuxièmement, le groupe, ayant pris soin<strong>de</strong> caractériser chaque sous-système,construit <strong>de</strong>s micro scénarios. Pour chacund’eux, on se pose les questions suivantes :quels sont les facteurs qui vont l’influencerdans le futur ? De quelle manière va-t-ilévoluer ? Par exemple, dans son analysedu sous-système « mobilité », le groupe se<strong>de</strong>man<strong>de</strong> : va-t-on renforcer les moyens<strong>de</strong> transport en commun ou les réduire ?Quels impacts cela aura-t-il sur la mobilité<strong>de</strong>s ruraux et l’accessibilité <strong>de</strong>s zones<strong>rural</strong>es ?Le groupe <strong>de</strong>vra d’abord classer les tendances: celles qui continuent dans lesens actuel et celles qui s’infléchissentou s’inversent. Deux catégories <strong>de</strong> tendancesexistent : les tendances lour<strong>de</strong>s,contraintes sur lesquelles on ne peut agir(le prix <strong>de</strong> l’énergie, par exemple) et lesfacteurs d’évolution sur lesquels il est possibled’avoir prise (habitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s gens, parexemple). Le groupe <strong>de</strong>vra aussi qualifierles <strong>de</strong>grés d’évolution <strong>de</strong> chaque tendance(le prix <strong>de</strong> l’énergie va-t-il augmenter <strong>de</strong>manière modérée ou très vite, très fort ?).Une fois quelques variables choisies, legroupe dispose du matériel nécessairepour commencer à « jouer ». Cette phase<strong>de</strong> micro scénarios est très importante. Elledoit permettre d’i<strong>de</strong>ntifier <strong>de</strong>s scénariosdont seulement certains seront retenusdans la phase suivante. Il importe <strong>de</strong> développerautant <strong>de</strong> micro scénarios qu’il y a<strong>de</strong> domaines d’évolution pertinents pour legroupe. Et également d’argumenter sur lechoix <strong>de</strong>s différentes variables et les effetsqu’elles produisent sur les scénarios.Ruralités – Magazine n°15 – 3 e trimestre 2012