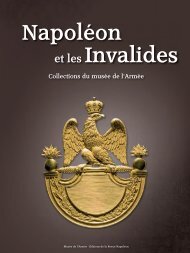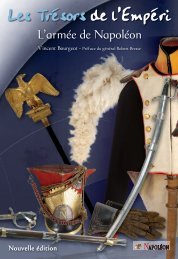You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Textes :<br />
Bernard Dat<br />
Michel Piquet<br />
Stéphane Ceccaldi<br />
et François Rognon<br />
Photographies :<br />
Jean-Michel Gaillard<br />
La Peau,<br />
l’Or et la Soie<br />
Les décors maçonniques du 18 e au 21 e siècle<br />
Préfaces de<br />
Hubert Greven<br />
et Alain Graesel<br />
Co-édition<br />
Passeurs de Lune & Grande Loge de France
La Peau,<br />
l’Or et la Soie<br />
Les décors maçonniques du 18 e au 21 e siècle
Le R.E.A.A. en France<br />
50 50
Les trois<br />
premiers degrés
Les trois premiers degrés > Les tabliers<br />
Historique<br />
Le tablier, avec les gants, est l’un des attributs vestimentaires<br />
distinctifs les plus signifi catifs du Franc-Maçon : remis solennellement<br />
lors de la cérémonie d’Initiation, il ne cessera d’être porté en toute<br />
occasion lors de la pratique rituelle des trois premiers degrés, tous<br />
rites confondus. Sa remise est comme une sorte d’investiture et<br />
demeure un insigne démonstratif de l’engagement du Franc-Maçon<br />
dans la voie du perfectionnement. Le tablier et les gants sont<br />
couramment nommés décors mais ils sont en réalité de véritables<br />
insignes maçonniques, à la différence des cordons qui ne sont que<br />
des ornements.<br />
Si aucune codification de taille ou de forme n’est fixée avant le<br />
19 e siècle, la présence du tablier est déjà attestée (avec les gants)<br />
dans les registres de la Loge d’Aberdeen en 1670 pour les impétrants<br />
non opératifs (les opératifs ayant probablement leurs propres tabliers<br />
de travail) et on le retrouve aussi porté sur le bras avant remise sur<br />
le frontispice des Constitutions d’Anderson de 1723.<br />
Gravure dite de Gabanon illustrant la cérémonie d’Initiation - France, 18 e s.<br />
PA.002.1251<br />
Frontispice des Constitutions d’Anderson, 1723 - Collection particulière<br />
<br />
52 53
Les trois premiers degrés > Les tabliers<br />
Le tablier blanc<br />
Originellement en peau d’agneau, le tablier est censé évoquer<br />
celui porté anciennement par les tailleurs de pierre et<br />
ses dimensions ont pu au 18 e siècle être beaucoup plus<br />
importantes qu’elles ne le sont de nos jours car il était destiné<br />
à se plaquer sur le devant du corps depuis les genoux jusqu’à<br />
la poitrine pour rappeler la protection qu’il apportait au Maître<br />
Ouvrier Opératif.<br />
La couleur du tablier est toujours intégralement blanche<br />
aux grades d’Apprenti et de Compagnon, symbole de pureté,<br />
d’innocence et d’un état de virginité virtuellement recouvré<br />
par le nouvel Initié. La forme en est normalement rectangulaire<br />
avec une bavette triangulaire sur le dessus – relevée au<br />
grade d’Apprenti pour évoquer une protection plus grande à<br />
apporter aux « nouveaux » et parfois tournée vers son porteur<br />
pour souligner le travail d’introspection à faire sur soi même,<br />
et rabaissée sur le tablier au grade de Compagnon – mais<br />
il arrive que quelques modèles anciens soient entièrement<br />
triangulaires.<br />
<br />
Tablier d'Apprenti en peau<br />
Tablier de Compagnon en peau<br />
Tablier d'Apprenti en peau - TT.002.366<br />
<br />
54 54 55
Les trois premiers degrés > Les tabliers<br />
Le Maître<br />
<br />
Le tablier de Maître du Rite Écossais Ancien et Accepté est invariablement à fond blanc bordé<br />
d’une bande de moire rouge surpiquée pour les modèles standards.<br />
Sa forme est comme pour les deux premiers degrés – Apprenti et Compagnon – taillée dans<br />
une pièce de soie ou de peau rectangulaire mais la partie basse peut parfois être arrondie<br />
aux angles et la bavette est généralement triangulaire et de nos jours cousue directement sur<br />
la masse du tablier. La partie arrière est aujourd’hui neutre mais elle était encore récemment<br />
de couleur noire et ornée d’un crâne et de larmes pour la pratique des cérémonies funèbres<br />
(le tablier était alors retourné et porté à l’envers, comme c’est toujours le cas pour les<br />
cordons dans de telles cérémonies).<br />
L’alliance des couleurs blanches et rouges apparaît dès le 18 e siècle mais ne sera généralisée<br />
puis imposée pour la pratique du Rite Écossais Ancien et Accepté que dans les années<br />
1830-1850. En dehors du fond blanc, les couleurs distinctives des décors ont été aux débuts<br />
de la maçonnerie spéculative en grande partie inspirées des ordres nobiliaires prestigieux. Le<br />
rouge dit « Crimson » a put être repris de celui porté sur les décorations de l’Ordre anglais du<br />
Bain mais il peut aussi faire référence à la couleur impériale en raison d’une symbolique du<br />
Rite Écossais Ancien et Accepté en partie inspirée de celle du Saint-Empire.<br />
Les Grands Stewarts de la Grande Loge d’Angleterre ont porté des tabliers blancs bordés de<br />
rouge dès la Saint Jean d’été 1735 et les Stuarts, qui ont porté ce titre, ont peut être apporté<br />
ce type de décors dès le 18 e siècle en France durant leur exil.<br />
L’instauration offi cielle du Rite Écossais Ancien et Accepté par le Suprême Conseil de France<br />
en 1804 et la nécessité de se distinguer des autres puissances maçonniques ont achevé à la<br />
fi n du premier tiers du 19 e siècle la fi xation du code couleur des décors de ce rite.<br />
La tendance moderne tend à une simplifi cation, voire à une disparition, des motifs représentés<br />
sur le tablier mais on peut encore régulièrement retrouver sur la bavette la lettre G dans une<br />
étoile flamboyante ainsi que les lettres M et B – en clair ou en alphabet maçonnique – et enfi n<br />
des branchages d’acacia qui sont distinctifs du grade de Maître.<br />
<br />
Tablier en peau et textile, bijou en métal - TT.002.412<br />
Tablier en soie brodée et canetille - TT.002.453<br />
Tablier en soie brodée et canetille - TT.002.413<br />
56 56 57
Atypisme et personnalisations<br />
Certains modèles de tabliers de Maître<br />
peuvent représenter des ornementations<br />
atypiques, même si aujourd’hui l’uniformisation<br />
est de mise – notamment en raison de<br />
l’industrialisation des confections de décors.<br />
Les couleurs restent toujours invariablement<br />
blanches pour le fond et rouges pour les<br />
bordures, mais les motifs brodés ou peints<br />
peuvent être personnalisés ou faire référence<br />
à des pratiques anciennes ou extérieures au<br />
Rite Écossais Ancien et Accepté<br />
La présence de rosettes constituées de la<br />
même moire que la bordure est un archaïsme,<br />
décrit comme étant la norme dans le Précis du<br />
Rite de 1813 alors que les lettres M et B ont été<br />
préférées ensuite dans l’ouvrage de Vuillaume<br />
et imposées après 1830. Leur remplacement<br />
par des tau est en revanche une mauvaise<br />
assimilation de pratiques des Rites Écossais<br />
Rectifi é ou Émulation qui les sollicitent pour un<br />
Maître devenu Vénérable par la suite.<br />
On peut également rencontrer des personnalisations<br />
faisant référence à l’iconographie<br />
précise d’une Loge et certains Maîtres<br />
n’hésitent pas de nos jours encore à faire<br />
confectionner des décors avec des rappels<br />
de modèles anciens, tant par la forme que<br />
par les motifs pour tenter de retrouver des<br />
valeurs iconographiques originelles.<br />
<br />
<br />
Tablier de Maître en peau brodée - TT.002.418<br />
Tablier de Maître personnalisé en textile gros<br />
grain - TT.002.416<br />
Tablier de Maître en peau - TT.002.4<br />
Tablier de Maître en peau peinte - TT.002.411<br />
Tablier moderne brodé
Les trois premiers degrés > Les tabliers<br />
Couleurs et rites<br />
Les motifs et les codes couleurs permettent aujourd’hui de distinguer<br />
clairement les rites auxquels les décors portés sont affi liés mais<br />
cette facilité d’attribution n’est en fait possible que depuis la<br />
deuxième moitié du 19 e siècle, après la fi xation des divers rituels.<br />
Les premiers temps de la maçonnerie spéculative représentent une<br />
période de gestation dont les décors maçonniques sont les témoins<br />
manifestes. La codifi cation des symboles se met progressivement en<br />
place et il n’est pas rare de retrouver jusqu’au début du 19 e siècle<br />
des motifs similaires ordonnés selon des codes couleurs différents.<br />
C’est ainsi que les bordures peuvent varier d’un tablier à l’autre sans<br />
pour autant indiquer la pratique d’un rite précis. La légende d’Hiram<br />
et le Temple restent les sujets principaux de l’iconographie des trois<br />
premiers degrés – Apprenti, Compagnon et Maître – mais la mise en<br />
place des couleurs peut différer selon les tabliers car les motifs<br />
imprimés à partir d’un choix fait sur catalogue sont coloriés à la main<br />
selon la volonté du commanditaire du décor.<br />
Les deux tabliers à l’iconographie similaire conservés dans les<br />
collections du M.A.B. illustrent parfaitement cette problématique. L'un<br />
() est bordé de bleu, l'autre () de rouge. Ils représentent tous<br />
deux sur la bavette les deux colonnes J et B précédant un espace<br />
sacralisé constitué d’un pavé mosaïque surplombé d’un temple<br />
(alors que cet espace est d’ordinaire réservé à la lettre G dans une<br />
étoile flamboyante). La partie basse pour sa part comporte un dais<br />
mortuaire encadré d’une corde à nœuds et surmonté aux angles<br />
de branches d’acacia, et au centre duquel est disposé un cercueil<br />
dominé par un plateau de Vénérable Maître. Parfois faussement<br />
qualifi és de tabliers de grade de vengeance en raison du dais que<br />
l’on retrouve sur des tabliers de ce degré, ces deux pièces de<br />
peau peinte sont en fait réellement deux décors de Maître reprenant<br />
l’iconographie classique et non équivoque de la légende d’Hiram et de<br />
l’intérieur d’une loge au troisième degré.<br />
<br />
Tablier en peau peinte - Début du 19 e s. - TT.002.181<br />
Détail d'un tablier en peau peinte - Début du 19 e s. - TT.002.180<br />
60 61
Les trois premiers degrés > Les tabliers<br />
Bordures, motifs et attribution<br />
<br />
La bordure du tablier n’a que peu d’importance sur les pièces les<br />
plus anciennes sur lesquelles on retrouve en fait essentiellement la<br />
représentation du Temple et de nombreux symboles. Les rituels ne<br />
fi xent pas encore précisément l’iconographie et les commanditaires<br />
décident souvent eux-mêmes de l’agencement fi nal des motifs ainsi<br />
que les sujets représentés. C’est la qualité ainsi que la complexité du<br />
travail de broderie qui font des décors primitifs de véritables pièces<br />
uniques inspirées par les légendes maçonniques.<br />
Chaque commanditaire indique au fabricant ses propres désirs<br />
selon son vécu et son inspiration personnelle. Le cas du « tablier<br />
à la pagode chinoise » qui date de la fi n du 18 e siècle, est à ce titre<br />
unique par la présence de fleurs ou d’étoiles stylisées, de colonnes<br />
mosaïquées et encore plus par la forme arrondie en toit de pagode<br />
asiatique pour la couverture du Temple : le commanditaire était<br />
peut-être un Européen en relation ou vivant en Asie.<br />
Les autres broderies de cette époque sont toujours d’une grande<br />
qualité et allient différentes techniques : seuls les arrangements des<br />
motifs les différencient.<br />
<br />
Tablier en soie brodée et canetille - Début du 19 e s. - TT.002.460<br />
Tablier en soie brodée et canetille - Début du 19 e s. - TT.002.459<br />
Tablier en soie brodée et canetille - Fin du 18 e s. - TT.002.581<br />
62 62 63
Les trois premiers degrés > Les tabliers<br />
Les tabliers archaïques<br />
<br />
Le 18 e siècle est la période de création et de fi xation de la maçonnerie<br />
spéculative moderne. L’ensemble des symboles qui se trouvent utilisés<br />
jusqu’à nos jours est déjà présent mais leur mise en place hésitante et<br />
foisonnante sur les décors témoigne des réflexions nombreuses qui s’y<br />
rapportent. Les matières, techniques d’application des motifs – broderie<br />
ou peinture – et la forme des tabliers sont d’une telle diversité que le<br />
18 e siècle, prolongé jusqu’au premier tiers du 19 e , peut être considéré<br />
comme l’âge d’or du décor maçonnique.<br />
Certains tabliers, comme c’est le cas du modèle brodé archaïque d’une<br />
étonnante fraîcheur, sont totalement artisanaux et intégralement faits<br />
main par leurs propriétaires. La forme générale est approximative<br />
en raison d’une découpe hésitante et le tissage est aussi parfois<br />
asymétrique. Les symboles sont cependant déjà les colonnes J et B,<br />
la lune et le soleil, les pierres brutes et cubiques, le pavé mosaïque,<br />
le compas entrecroisé avec l’équerre, l’acacia, la lettre G dans l’étoile<br />
flamboyante, le delta rayonnant ainsi que la corde à nœuds et la<br />
mention Sagesse – Force et Beauté, soient tous les basiques d’une<br />
Franc-Maçonnerie intemporelle.<br />
On peut également rencontrer des tabliers peints sur soie ou peau,<br />
avec décors architecturaux ou symboles en nombre. Même si les mises<br />
en place peuvent sembler désordonnées au premier coup d’œil, comme<br />
c’est le cas sur le grand tablier de soie aux symboles imprimés (), les<br />
arrangements spatiaux semblent déjà se préciser de part et d’autre des<br />
colonnes J et B et aucun symbole n’est disposé sans arrière pensée.<br />
Certains motifs n’appartiennent cependant pas à un corpus reproduit<br />
par la suite, comme on peut le voir sur le modèle en peau peinte à<br />
la forme découpée évoquant la forme originelle de la peau animale sur<br />
lequel sont visibles les représentations d’un temple et de verdures<br />
qui sont des motifs uniques : l’architecture du bâtiment avec son toit<br />
en pointe et le fronton crénelé est clairement atypique et fait plutôt<br />
penser à un tombeau – celui d’Hiram – qu’à un temple. Les traditionnelles<br />
colonnes J et B ainsi que le classique pavé mosaïque sont absents.<br />
<br />
Tablier en peau peinte - TT.007.1705<br />
Tablier en soie peinte - TT.002.457<br />
Tablier en soie brodée - TT.002.183<br />
64 64 65
Les trois premiers degrés<br />
> Les tabliers<br />
Modèle compas équerre<br />
<br />
Le compas et l’équerre représentent deux<br />
des symboles les plus manifestes de la<br />
Franc-Maçonnerie et on les retrouve déjà<br />
chez les maçons opératifs au travers d’une<br />
inscription irlandaise de 1507 gravée sur un<br />
pont : « Je m’efforcerai de vivre avec amour<br />
et attention sur le niveau et par l’équerre ».<br />
Dans la Franc-Maçonnerie spéculative, les<br />
deux font référence à l’art de bâtir et il est<br />
donc normal de les retrouver sur les décors<br />
maçonniques portés par des hommes<br />
aspirant à la construction d’une société<br />
idéale.<br />
La position des deux symboles, l'un vis à<br />
vis de l'autre, est de nos jours parfaitement<br />
codifi ée selon le grade pratiqué – Apprenti,<br />
Compagnon, Maître – mais les débuts de la<br />
maçonnerie furent moins précis sur ce sujet.<br />
Le compas et l’équerre sont jusqu’à la fi n du<br />
19 e siècle presque toujours entrecroisés et<br />
non superposés comme aujourd’hui, et les<br />
deux outils peuvent même être enlacés par<br />
un cordage : l’allusion au grade de Maître<br />
est cependant indiscutable en raison de la<br />
présence de branches d’acacia et parfois<br />
des lettres M et B (le cas d’un tablier ()<br />
portant mention de ces lettres sur les deux<br />
colonnes étant plus rare).<br />
Tablier en soie brodée et canetille<br />
Début du 19 e s. (bordure moderne) - TT.002.559<br />
Tablier en soie brodée et canetille<br />
Début du 19 e s. - Dépôt du Musée Masséna de Nice<br />
(fonds Cappati)<br />
66 66 67
Les trois premiers degrés > Les tabliers<br />
Modèles temples brodés<br />
Le temple est le lieu géographique et mythique de réunion<br />
des Francs-Maçons et il est notoire de remarquer que le mot<br />
s’applique aujourd’hui par substitution à celui de loge qui était<br />
primitivement employé pour désigner ce même lieu. On peut<br />
aussi souligner que le temple maçonnique est une référence<br />
incontournable à celui érigé sur l’ordre de Salomon et dont<br />
l’architecture extérieure et intérieure inspire depuis ses débuts<br />
la maçonnerie spéculative dans la pratique de ses rituels. C’est<br />
pourquoi sa représentation depuis le 18 e siècle a entraîné la<br />
création d’un iconographie spécifi que et abondante.<br />
Les tabliers les plus simples se contentent d’une vue faciale<br />
géométrisante et schématique du temple formé d’un carré à deux<br />
colonnes surmontées d’un fronton triangulaire. Le nombre des<br />
marches du podium qui soutiennent l’édifi ce importe peu – trois,<br />
cinq ou sept – car les branches coupées d’acacia ou les arbres<br />
plantés de cette même espèce attestent du grade de Maître,<br />
tout comme la lettre G disposée dans l’étoile flamboyante qui fait<br />
référence à l’art de la géométrie.<br />
> Tablier en soie brodée et canetille - 19 e s. - TT.002.454<br />
68 68 69
Modèles temples brodés (suite)<br />
Les modèles de tabliers brodés au temple plus élaborés peuvent<br />
représenter des édifi ces à plusieurs colonnes et un nombre de portes<br />
variant de un à deux (et plus exceptionnellement trois). La forme même<br />
du temple semble alors être en rotonde et l’appellation de « modèle au<br />
kiosque » est couramment appliquée à ce type de décors.<br />
Les créations les plus luxueuses enfi n, peuvent allier les broderies<br />
métalliques et textiles vivement colorées et chatoyantes, tant pour les<br />
symboles que pour les parties architecturales et florales.<br />
La présence de deux colonnes évoquant celles qui se trouvaient<br />
sur le devant du Temple de Salomon est fréquente et délimite, même<br />
stylisé, un espace au sein duquel le bâtiment principal est situé. Leur<br />
représentation torsadée et surmontée de chapiteaux à enroulements<br />
est la plus artistiquement développée et typique du tout début<br />
du 19 e siècle. La présence d’une guirlande fl eurie tout autour des<br />
bordures est en revanche rare au grade de Maître.<br />
Tablier en soie brodée et canetille - Début du 19 e s. (bordure rapportée) - TT.002.455<br />
Tablier en soie brodée et canetille - 19 e s. - TT.002.452<br />
Tablier en soie brodée et canetille - Début du 19 e s. - TT.002.451<br />
70 70 71
Les trois premiers<br />
degrés > Les tabliers<br />
Modèles temples peints<br />
<br />
La construction du Temple de<br />
Salomon est évoquée dans<br />
le Livre des Rois et dans le<br />
Deuxième Livre des Chroniques,<br />
et Jean-Baptiste Willermoz<br />
écrit en 1780 à ce sujet : « La<br />
Franc-Maçonnerie symbolique<br />
a pour base fondamentale le<br />
Temple élevé à Jérusalem par<br />
le Roi Salomon… ». Les tabliers<br />
sur peau reprennent cette<br />
thématique et les modèles<br />
produits jusqu’au début du<br />
19 e siècle sont toujours d’un<br />
haut niveau de réalisation<br />
artistique. Si les tabliers brodés<br />
sont souvent schématiques<br />
en raison des techniques de<br />
fabrication, ceux qui sont peints<br />
offrent une grande abondance<br />
de détails et des coloris<br />
innombrables.<br />
Les modèles de la fi n du 18 e siècle<br />
représentent souvent des temples<br />
en forme de rotondes inspirés des<br />
constructions de Charles de Wailly<br />
ou de Nicolas Ledoux, comme<br />
on peut encore en voir au Parc<br />
Monceau à Paris. Les édifices<br />
sont toujours surélevés sur<br />
un ensemble de marches<br />
elles-mêmes disposées sur un<br />
pavé mosaïque et les colonnes J<br />
et B sont placées en avant pour<br />
délimiter l’espace sacré (qui<br />
est parfois souligné par une<br />
72 72 73
alustrade). Les outils habituels<br />
sont disposés au sol ou sur<br />
les colonnes et les coloris sont<br />
d’un grand raffi nement.<br />
La lettre G dans l’étoile flamboyante<br />
est fréquente sur la<br />
bavette mais elle peut parfois<br />
être remplacée par une ruche<br />
d’abeilles symbolisant le travail<br />
et l’union. Le beau tablier sur<br />
peau du MAB qui illustre cet<br />
exemple ( ) comporte aussi<br />
une banderole avec la devise<br />
« Labor omnia Vincit » inscrite<br />
en lettres maçonniques et<br />
les symboles de la partie<br />
basse du tablier sont répartis<br />
selon les grades d’Apprenti<br />
– Compagnon – Maître et selon<br />
les rituels de part et d’autre<br />
des colonnes B et J.<br />
<br />
Tablier en peau peinte<br />
Fin du 18 e –début du 19 e s. -<br />
TT.002.166<br />
Tablier en peau peinte<br />
Fin du 18 e –début du 19 e s. -<br />
TT.989.176<br />
Tablier en peau peinte<br />
Fin du 18 e –début du 19 e s. -<br />
TT.002.533
74 74 75
Modèles temples peints (suite)<br />
La période de l’Empire connaît le même type de représentation<br />
symbolique mais les bâtiments illustrés dénotent l’influence<br />
architecturale du moment : le style Retour d’Egypte par exemple se<br />
développe après la campagne napoléonienne au Moyen Orient avec la<br />
présence de colonnes isiaques ou tout simplement égyptisantes ainsi<br />
que de nombreux bâtiments annexes d’influence pharaonique dans le<br />
paysage, comme des pyramides ou des obélisques. Les tabliers de<br />
cette période sont toujours très élaborés et ne laissent aucune place<br />
au vide, y compris dans les fonds, et certaines bordures peuvent<br />
atteindre un luxe décoratif sans précédent qui n’existera plus par la<br />
suite.<br />
Les motifs sont souvent imprimés dans les ateliers des maisons<br />
Brun et Guérin choisis à partir de catalogues et seules les couleurs<br />
offrent une possibilité de variante : le modèle à bordure fleurie est par<br />
exemple également connu dans une autre version en camaïeu bleu.<br />
<br />
Tablier en peau peinte - Époque Empire - TT.004.1596.01/37<br />
Tablier en peau peinte - Époque Empire - TT.002.535<br />
Détails du tablier en peau peinte ( ) - Époque Empire - TT.002.535
Les trois premiers degrés > Les tabliers<br />
Les tabliers brodés<br />
Les tabliers des 18 e et début du 19 e siècles sont réputés pour le haut degré technique de<br />
leur réalisation. Ils représentent, avec l’ensemble des autres textiles identitaires de cette<br />
époque, l’âge d’or du décor maçonnique. Le développement de la Franc-Maçonnerie au Siècle<br />
des Lumières et l’adhésion rapide des plus hautes classes sociales ont automatiquement<br />
entraîné de nombreuses commandes ayant abouti pour certaines à la création de modèles<br />
exceptionnels dont ceux qui sont brodés excellent par leur richesse décorative et leur très<br />
grande qualité de réalisation.<br />
La broderie est d’ordinaire pratiquée pour l’agrémentation des plus beaux vêtements et il<br />
est normal de la retrouver comme l’une des principales techniques de mise en œuvre des<br />
décorations de tabliers. Spécialité habituellement réservée aux femmes, il est probable que<br />
les premiers modèles aient été réalisés par des hommes qui étaient alors seuls à pouvoir<br />
être initiés et par conséquent être à même d’appréhender pleinement la mise en forme des<br />
symboles maçonniques.<br />
Le support des tabliers brodés est toujours en textile, normalement de la soie, pour rendre<br />
aisé le passage de l’aiguille et du fi l destiné à fi xer les éléments décoratifs, ce que la peau<br />
animale ne permet pas ou diffi cilement en raison de son épaisseur.<br />
Les techniques peuvent être nombreuses pour la réalisation des décors qui sont dans un<br />
premier temps dessinés à même le textile. On peut trouver de simples broderies en fi ls de<br />
couleurs qui représentent essentiellement les éléments végétaux et les sols, et plus rarement<br />
les motifs architecturaux et les outils symboliques. On peut également rencontrer la technique<br />
de la canetille qui est largement utilisée pour la réalisation des symboles et de certains<br />
outils : désignée ainsi par dérivation de mots latins canna – le roseau, et espagnol canuto – le<br />
tuyau, la canetille est exécutée à partir de petits bouts de fi ls dorés découpés et fi xés par<br />
une aiguillée de fi l de coton.<br />
Les paillettes métalliques dorées sont pour leur part utilisées pour souligner les contours<br />
architecturaux (murs, colonnes, marches, …) et toutes sortes de motifs linéaires (contours,<br />
cordages, rayons lumineux, …).<br />
Les appliqués de tissus enfi n permettent d’affi rmer les contrastes et certains détails.<br />
Cette dernière technique est employée essentiellement pour évoquer les fonds de motifs<br />
architecturaux et les autres techniques pour permettre une meilleure compréhension de<br />
certains éléments précis, qu’ils soient architecturaux comme les portes du Temple ou<br />
symboliques comme la lune et le soleil.<br />
Tablier sur soie brodée, canetille et applications - Fin du 18 e - début du 19 e s. - TT.002.456<br />
(voir double-page suivante) Tablier sur soie brodée et canetille - 19 e s. - TT.002.447<br />
76 77
Pages de droite : photo pleine page. Desriptif du décor. Époque. Rite.
Les trois premiers degrés<br />
> Les tabliers<br />
Les tabliers brodés (suite)<br />
<br />
Les sujets évoqués sur les tabliers brodés, y<br />
compris sur les modèles techniquement les plus<br />
aboutis, sont souvent limités aux seuls motifs<br />
des symboles essentiels, des colonnes J et B, du<br />
Temple, et des compas – équerre entrecroisés.<br />
La complexité technique de la broderie et les<br />
limites de représentation des motifs induites par<br />
les matériaux employés ne permettent pas la<br />
richesse iconographique atteinte par les tabliers<br />
peints. Les tabliers brodés cependant offrent une<br />
variété quasi infi nie de mise en page et une liberté<br />
de choix dans ce domaine qui permet vraiment à<br />
chaque commanditaire de préciser ses propres<br />
désirs : les symboles sont individuellement choisis<br />
et diffèrent d’un tablier à l’autre. L’archaïsme est<br />
parfois de mise, comme avec l’évocation de l’Être<br />
Suprême par des lettre hébraïques au centre du<br />
Delta Rayonnant remplacé ensuite par le fameux<br />
œil du Grand Architecte de l’Univers dans ce même<br />
delta (afi n d’éviter toute confusion avec la religion).<br />
Certains modèles de la fi n du 18 e siècle et du tout<br />
début du 19 e , comme celui conservé dans les<br />
collections du Suprême Conseil de France (),<br />
atteignent les plus hauts niveaux de réalisation,<br />
mêlant toutes les techniques possibles en<br />
permettant la représentation d’un nombre quasi<br />
maximal de symboles et motifs architecturaux sur<br />
une surface de textile aussi réduite.<br />
<br />
Tablier sur soie brodée et canetille. Début du<br />
19 e s. Collection du Suprême Conseil de France<br />
Tablier sur soie brodée et canetille. Début du<br />
19 e s. - TT.002.449<br />
Tablier sur soie brodée et applications diverses.<br />
Fin du 18 e – début du 19 e s. - TT.002.450<br />
80 80 81
Les trois premiers degrés > Les tabliers<br />
Voir agrandissements double-page suivante<br />
<br />
<br />
Les tabliers peints (suite)<br />
Il est probable que certains tabliers peints anciens aient été réalisés non seulement au pochoir mais aussi au<br />
tampon avant la mise en place des couleurs et on peut aussi rappeler une fois de plus que les plus beaux<br />
modèles appartenant à l’âge d’or du décor maçonnique ont été créés à la fi n du 18 e siècle ou au début du 19 e<br />
et que l’Empire est une période où les tabliers sont les plus aboutis en matière iconographique et technique.<br />
Le M.A.B. possède depuis peu un superbe exemplaire du modèle dit de David d’Angers () – en raison de<br />
l’appartenance d’un même tablier au célèbre sculpteur – qui illustre le haut degré qualitatif alors atteint.<br />
Les classiques symboles ont presque tous disparu et sont seulement évoqués sur une véritable création<br />
picturale sur laquelle l’aspect narratif est clairement mis en avant. C’est encore la légende de l’architecte<br />
Hiram et de sa mort qui sont la source d’inspiration mais l’évocation est cette fois totalement mise en scène.<br />
Le sarcophage du Maître des Maîtres est placé au centre du tablier et d’un paysage qui comporte un chemin<br />
d’accès représenté par un escalier tournant – celui-là même que l’on retrouve dans le Temple de Salomon.<br />
L’acacia est toujours présent ainsi que le delta rayonnant qui ne comporte aucune mention intérieure mais<br />
le temple est repoussé dans un coin et non plus placé au centre de la composition, et on retrouve enfi n<br />
selon une imagerie inhabituelle les mentions du ternaire symbolique Sagesse–Force–Beauté peu représenté<br />
sur les tabliers et placées dans des bijoux suspendus. Ce modèle a bien été réalisé sous l’Empire, comme en<br />
témoignent le remplissage total de la partie peinte, les bâtiments égyptisants et la mention « Modèle déposé à<br />
la Bibliothèque Impériale » imprimée sous la bavette.<br />
D’autres modèles peuvent aussi être totalement artisanaux et intégralement peints à main levée sans<br />
poncif pré-établi, y compris ceux qui atteignent un bon niveau qualitatif et le M.A.B. possède deux beaux<br />
exemples de ce type. On peut voir sur le premier () un autel encadré d’acacias plantés et surmonté<br />
d’un dais : les motifs sont dans ce cas précis inédits et directement choisis par le commanditaire du<br />
tablier qui a pu réaliser lui-même son tablier ou faire appel à un professionnel en raison d’une très belle<br />
qualité technique de réalisation. Le second tablier () est pour sa part totalement artisanal en raison de la<br />
« gaucherie » d’exécution mais son iconographie est particulièrement étonnante car on peut y voir sur un<br />
sol en pavé mosaïque les deux colonnes entre lesquelles est placé un podium où est assise la déesse<br />
Athéna accompagnée de sa chouette et encadrée d’outils, d’une sphère céleste et d’éléments d’architecture.<br />
Les représentations des symboles répartis aux cotés des colonnes J et B sont reprises des inspirations<br />
anciennes avec les deux ensembles d’outils accompagnant les pierres brutes et cubiques disposées sur<br />
des montées respectivement de trois et cinq marches mais ces deux tabliers sont des cas atypiques des<br />
productions peintes en raison de leur spontanéité créative.<br />
Les traditions des tabliers peints se transmettent au cours des générations et les symboles perdurent,<br />
s’adaptant dans leurs représentations aux mentalités et aux modes de leur époque.<br />
Tablier peint sur soie dit modèle David d’Angers. Début du 19 e s. - TT.006.1682<br />
Tablier peint sur peau. Fin du 19 e s. - TT.002.5<br />
Tablier peint sur soie. 19 e s. - TT.002.518<br />
84 84 85
Les trois premiers degrés > Les tabliers<br />
Les motifs classiques<br />
Comme pour les tabliers du Rite Écossais Ancien et Accepté, les<br />
supports des tabliers du Rite Français peuvent être de soie ou<br />
de cuir et le fond est ici aussi de couleur blanche. La bordure<br />
est en revanche bleue depuis au moins les années 1850, couleur<br />
de référence du rite inspirée une fois encore des grands ordres<br />
nobiliaires du 18 e siècle – ici probablement celui de la Jarretière.<br />
Les techniques des décors sont à nouveau la broderie et/ou la<br />
peinture et les symboles quasi identiques à ceux du Rite Écossais<br />
Ancien et Accepté, du moins pour les périodes les plus anciennes. On<br />
retrouve la lettre G dans l’Étoile Flamboyante, les colonnes associées<br />
aux lettres B et J, les rameaux d’acacia, la lune et le soleil, …<br />
Les thématiques équerre-compas entrecroisés et du Temple se<br />
retrouvent telles qu’au Rite Écossais Ancien et Accepté avec ici aussi<br />
quelques variantes ordonnées par les commanditaires, comme on<br />
peut le voir avec la très belle représentation faciale du temple placé<br />
sur un haut podium sous le porche duquel est rendu visible le voile<br />
du Temple, grâce à un effet de perspective quasi unique dans son<br />
genre.<br />
<br />
Tablier sur soie brodé, canetille et applications - TT.002.444<br />
Tablier sur soie brodé, canetille et applications - TT.002.545<br />
90 90 91
Pages de droite : photo pleine page. Desriptif du décor. Époque. Rite.
Les trois premiers degrés > Les cordons<br />
Cordon de Maître Maçon du Rite Écossais Ancien et Accepté<br />
2 e moitié du XX e siècle.<br />
Dés l’origine de la Franc-Maçonnerie Française (1728-1732) les Francs-Maçons portent des « décors » pendant leurs travaux rituels : tablier,<br />
cordon et sautoir. Le sautoir est souvent le support de la représentation d’un offi ce ou d’une dignité, le tablier d’un degré. Le cordon quelquefois<br />
utilisé dans certains hauts grades, notamment ceux qui comportent une arme blanche, épée ou glaive, dans leur panoplie symbolique, indique la<br />
plupart du temps le Rite auquel appartient le maçon qui le porte.<br />
Symbole d’égalité au XVIII e siècle (le cordon suppose qu'une épée peut y être accrochée). Le port du cordon a toujours été en usage, peut être<br />
parfois « oublié » depuis la deuxième moitié du XX e siècle, lorsque le port du tablier est redevenu obligatoire.<br />
Le tablier est remis solennellement au nouveau Franc-maçon. Les rituels ne font quasiment jamais mention du cordon, uniquement cité dans les<br />
tuileurs 1 qui décrivent les décors des différents rites et des différents grades.<br />
L’une des premières divulgations 2 (« L’ordre des Francs-Maçon trahi et le secret de Mopses révélé » de l’abbé Perau, 1742) décrit l’attribution<br />
solennelle du tablier à la réception du nouveau Franc-Maçon.<br />
L’Astronome Jérôme Lalande, Vénérable Maître de la loge Les Neuf Sœurs a remis à Voltaire, lors de son initiation, le 7 avril 1778 le tablier qu’avait<br />
porté Helvétius.<br />
1. Tuileur : lorsque les rites se fi xent défi nitivement au début du XIX e siècle, les descriptions des mots, des gestes, de la décoration de la loge et l’habillement de chaque<br />
degré dans chaque rite, sont scrupuleusement consignés dans des ouvrages imprimés exclusivement réservés à cet effet. Les plus connus ont été écrits par Vuillaume<br />
(1815-1830) Delaunaye (1821) et Tessier (1860).<br />
2. Divulgations : ce terme désigne les premiers textes maçonniques imprimés. Jusqu’à la fi n du XVIII e siècle, fi dèles à leurs serments, les Franc-maçons, n’imprimaient<br />
pas les rituels qu’ils pratiquaient. Ceux-ci étaient recopiés à la main. Le prétexte de « révéler les secrets des Francs-maçons » permettaient aux rituels en vigueur de<br />
circuler.<br />
< Inv. TC.002.378
Cordon de Maître Maçon du Rite Écossais<br />
Ancien et Accepté<br />
XX e siècle.<br />
Dépouillé à l’extrême, ce cordon s’oppose au précédent (p. 96).<br />
Le choix du modèle tient peut-être simplement à son coût, peut-être<br />
aussi est-il l’expression d’un sentiment plus ou moins marqué de<br />
modestie ou de fi erté de l’appartenance.<br />
Jusqu’au début du XIX e siècle, le cordon était de couleur bleue unie.<br />
Le liseré rouge apparaît vers les années 1820 selon les tuileurs<br />
de l’époque (Vuillaume, Delaunaye, Tessier) sur les cordons du Rite<br />
Écossais Ancien et Accepté (voir le texte de Bernard DAT page 14).<br />
Est-ce pour rappeler le rouge des chapitres du Rose Croix, les<br />
couleurs propres du Rite Écossais Philosophique de Thory 1 , ou l’Orient<br />
des loges bleues, tendu de rouge ?<br />
1. Claude Antoine Thory (1757-1827), Avocat au parlement, maire adjoint du<br />
1 er arrondissement, botaniste distingué : on peut le considérer comme le premier<br />
historien de la Franc-Maçonnerie française. Il fut dignitaire de plusieurs systèmes<br />
maçonniques.<br />
<br />
Inv. TC.002.368
Cordon de Maître Maçon du Rite Écossais<br />
Ancien et Accepté<br />
Fin XIX e .<br />
Le rameau d’acacia est plus élaboré. Le compas s’écrase un peu sur<br />
l’équerre, il n’y a pas de lettre M. Les trois étoiles remplacent les trois<br />
points ou les trois rosettes mais n’ont plus le sens symbolique de<br />
l’étoile fl amboyante du cordon précédent (p. 98) qui portait en son<br />
centre la lettre G.<br />
Le compas « écrasé » : faible épaisseur par rapport à l’équerre,<br />
ouverture plus grande que sur les autres modèles, n’est représenté<br />
de cette façon que par souci esthétique, de composition de l’objet<br />
fi guré et non en vue de proposer une réflexion symbolique abstraite.<br />
Les lettres J et B sont inversées par rapport aux autres cordons.<br />
L’attribution des lettres J et B sur les deux colonnes de l’entrée<br />
du temple maçonnique a toujours été, depuis le XVIII e siècle, une<br />
référence au rite pratiqué. On peut dire, succinctement qu’au Rite<br />
Écossais Ancien et Accepté, lorsque l’on entre dans le temple et que<br />
l’on regarde l’Orient, la lettre B se trouve sur la colonne de gauche<br />
et la lettre J sur la colonne de droite. Le liseré rouge précise bien<br />
qu’il s’agit d’un cordon du Rite Écossais Ancien et Accepté. Erreur<br />
du fabricant ou vision intérieure des deux colonnes de l’Orient vers<br />
l’Occident ?<br />
<br />
Inv. TC.002.462
Les trois premiers degrés > Les cordons<br />
Cordon de Lowton<br />
Rite Écossais Ancien et Accepté<br />
Début XX e .<br />
Plus court et plus étroit que les cordons de Maître mais de même<br />
couleur : bleu moiré bordé de rouge, ce cordon était porté par les<br />
Lowtons lors de leur présentation à la loge. Le terme de Lowton est<br />
généralement traduit par Louveteau ou Louveton (d’où la lettre « L »<br />
sur le cordon). Il désigne au début du XX e siècle, en France, un<br />
fi ls de maçon, présenté à la loge lors d’une cérémonie particulière,<br />
à qui sont enseignés les rudiments moraux et symboliques de la<br />
Franc-Maçonnerie.<br />
Alors que la majorité requise, à l’époque était de 21 ans, un Lowton<br />
pouvait être initié à 18 ans selon un rituel adapté.<br />
Collection Suprême Conseil de France. ><br />
106 106 107
Le R.E.A.A. en France
Loges de<br />
perfection
Loges de perfection<br />
> Les tabliers<br />
Tablier de Maître<br />
Secret, 4 e degré du<br />
Rite Écossais Ancien<br />
et Accepté<br />
Canetille sur tissu (ottoman ?,<br />
coton ?). Bavette arrondie début<br />
XX e .<br />
La bordure noire rappelle l’attitude<br />
de deuil spécifi que au grade.<br />
Certains exégètes symboliques<br />
rapprochent la lettre Z du<br />
« trait de Jupiter », technique<br />
de charpentier pour assembler<br />
des pièces de bois et attribuent<br />
au 4 e et 5 e degrés, Maître Secret<br />
et Maître Parfait une origine<br />
opérative. Les représentations<br />
végétales de laurier et d’olivier,<br />
sont elles aussi directement<br />
issues du rituel.<br />
Tablier de Maître<br />
Secret<br />
Canetille sur soie. Bavette en<br />
triangle. Fin XX e .<br />
Les branches de laurier et<br />
d’olivier sont beaucoup plus<br />
finement et plus explicitement<br />
représentées.<br />
<br />
Inv. TT.002.363<br />
Inv. TT.002.362<br />
110 110 111
Loges de perfection<br />
> Les tabliers<br />
Tablier blanc bordé de noir avec trois<br />
larmes noires. Il s’agit d’un tablier artisanal<br />
soit primitif, soit plus vraisemblablement un<br />
travail de ponton (prisonnier de guerres<br />
napoléoniennes), de Maître Élu des Neuf<br />
(9 e degré du Rite Écossais Ancien et Accepté).<br />
Sur ce tablier en peau blanche brodé de<br />
soie noire sont peints différents symboles<br />
concernant les petits élus.<br />
En bas une tour (ou un mausolée) flanquée de<br />
deux squelettes, au-dessus une caverne avec<br />
trois animaux sauvages : tigre, lion et ours.<br />
Autour du tablier, à l’intérieur d’une chaîne<br />
d’union à deux lacs d'amour dans laquelle<br />
sont une plume et une branche d’acacia,<br />
cinq groupes de symboles sont représentés.<br />
Au milieu, liés par un ruban bleu, un compas,<br />
une équerre, un maillet, un Volume de la<br />
Loi Sacrée et un diplôme. De part et d’autre<br />
une colonne accompagnée à gauche d’une<br />
règle et d’un levier, à droite d’une règle et<br />
d’une épée. En dessous et respectivement,<br />
une lance (ou flèche) avec un crâne, un<br />
chandelier à trois étoiles et un sabre modèle<br />
« briquet » et à droite une balance avec<br />
deux clefs entrecroisées. Sur la bavette, une<br />
étoile flamboyante avec la lettre G. Tous ces<br />
matériaux évoquent le grade de Maître Élu des<br />
Quinze, futur 10 e degré du Rite Écossais Ancien<br />
et Accepté.<br />
Fin du XVIII e siècle.<br />
<br />
Peau avec applications de satin, 19 e s. -<br />
Inv. TT.002.364<br />
Peau peinte - Inv. TT.002.156<br />
112 112 113
Tablier en peau blanche peinte, bordé de soie noire. (Musée de la<br />
Grande Loge de France, XVIII e siècle).<br />
La légende d’Illustre Élu des Quinze précise que les deux autres<br />
assassins d’Hiram, une fois découverts et présentés à Salomon furent<br />
attachés pieds et poings liés à deux poteaux, ici disposés en croix de<br />
Saint André, leurs corps ouverts du pubis à la poitrine. Le manuscrit<br />
Francken (1783) précise : « les mouches venimeuses et les insectes<br />
dévorants suçant le sang de leurs entrailles ».<br />
Illustration très libre de la légende qui indique que les têtes<br />
des meurtriers furent exposées aux portes de la ville, ainsi que le<br />
représente avec plus d’exactitude le tablier actuel du grade. Ici, il s’agit<br />
peut-être de la tête d’Abiram, le premier meurtrier, dont le manuscrit<br />
Francken nous précise qu’elle fut placée à la porte de l’Orient de<br />
Jérusalem. Rappelons que c’est à la porte orientale du Temple<br />
qu’Abiram s’était posté et avait frappé Hiram.<br />
Les trois squelettes nous rappellent leur forfait. Ils portent les<br />
trois outils avec lesquels les meurtriers ont perpétué leur crime : le<br />
levier, le maillet et la règle.<br />
<br />
Inv. TT.002.155
Loges de perfection<br />
> Les tabliers<br />
Ces deux tabliers sont<br />
d’Écossais (ou Maître Écossais)<br />
ancêtre du grade qui s’est<br />
fi xé au Rite Écossais Ancien et<br />
Accepté sous le nom de Grand<br />
Élu Parfait et Sublime Maçon.<br />
Ce grade est très important car<br />
il clos une suite de développements<br />
de divers aspects de la<br />
légende d’Hiram. Il est considéré<br />
comme le dernier de la série<br />
concernant l’édification du<br />
Temple de Salomon.<br />
Sa bordure rouge, caractéristique,<br />
permettait à ses porteurs de<br />
se distinguer dans les ateliers<br />
« bleus » (bordure bleue). Et<br />
dans les systèmes primitifs du<br />
Rite Écossais, ce grade avait un<br />
devoir de surveillance vis-à-vis<br />
des loges symboliques.<br />
Ici le symbole primitif du grade :<br />
un triple triangle entrelacé au<br />
sein duquel est la lettre J. Sur<br />
la bavette l’étoile flamboyante<br />
avec la lettre G. Dans le 2 e ordre<br />
(5 e grade) du Rite Français<br />
Moderne, le bijou est un triple<br />
triangle « non entrelacé mais<br />
par graduation l’un dans l’autre ».<br />
<br />
Tablier du 6 e degré en peau peinte,<br />
début du 19 e s. - Inv. TT.002.558<br />
Tablier du 6 e degré en peau<br />
imprimée et peinte, époque<br />
Empire - Inv. TT.007.1711<br />
116 116 117
Loges de perfection > Les décors modernes<br />
Sautoir de Maître Secret<br />
4 e degré du Rite Écossais Ancien et Accepté, premier des « Hauts Grades » du Rite.<br />
La lettre Z et la clé d’ivoire sont des allusions directes au rituel. Le bord noir rappelle le deuil<br />
dans lequel est plongé le Maître Secret après la mort de l’Architecte Hiram.<br />
Lors de l’élaboration du Rite Écossais Ancien et Accepté, le Maître secret fut un moment placé<br />
au 5 e degré, après le Maître Parfait. L’inversion s’est pratiquée au début du XIX e siècle.<br />
L’iconographie de ces degrés est assez riche (tuileurs, rituels illustrés…) mais les pièces<br />
fabriquées sont quasiment inexistantes.<br />
Le Suprême Conseil de France instaura la pratique rituelle du Maître Secret à la fin du<br />
XIX e siècle.<br />
En 1904, le Suprême Conseil compte 10 Aréopages (30 e ), 25 chapitres (18 e ) et seulement 4 loges<br />
de perfection (4-14 e ).<br />
Canetille sur ottoman, bijou en ivoire, 20 e s. - Inv. TS.002.308 ><br />
120 120 121
Loges de perfection > Les décors modernes<br />
<br />
<br />
<br />
Sautoir de Grand Élu Parfait et Sublime Maçon (14 e degré)<br />
Sautoir de Président d'une Loge de Perfection<br />
Bijou de Grand Élu Parfait et Sublime Maçon (14 e degré)<br />
Tablier de Grand Élu Parfait et Sublime Maçon (14 e degré)<br />
Avec l'aimable autorisation de la maison Detrad.<br />
124 124 125
Le R.E.A.A. en France<br />
126 126
Chapitres
130 130 131
Ce cordon de Chevalier d'Orient dont la couleur<br />
originale était vert porte, cousu sur sa face<br />
extérieure, un morceau d’étoffe peint représentant<br />
un pont sous lequel coule un cours d’eau. Sur les<br />
arcs sont inscrits les lettres L.D.P., abréviations de<br />
la formule « Liberté de passer ».<br />
Ce tablier reprend sur un seul plan le déroulé<br />
de la légende du grade. Les scènes se lisent de<br />
gauche à droite. Dans son palais de Babylone, sous<br />
un dais et près de son trône, Cyrus, roi des Perses<br />
et des Mèdes, s’entretient avec Zorobabel, prince de<br />
Judée. Au milieu de la composition, le pont enjambant<br />
le fleuve Starbuzanaï sur lequel se livre une bataille,<br />
et une tour en flammes. En haut à droite une<br />
représentation allégorique du Temple de Jérusalem.<br />
Sur la bavette le bijou du grade : triple triangle avec<br />
deux épées en sautoir et une chaîne composée<br />
d’anneaux triangulaires rappelant la captivité.<br />
<br />
Cordon en soie avec application d'une scène peinte sur<br />
soie ajoutée - Collection Suprême Conseil de France<br />
Peau imprimée et peinte, début 19 e s. - Inv. TT.002.590
Chapitres<br />
> Les tabliers<br />
Décors de Chevalier<br />
Rose Croix<br />
<br />
Les décors de Chevalier Rose<br />
Croix (tabliers et sautoirs) sont<br />
réversibles. Jadis il y avait deux<br />
types de tabliers et de sautoirs,<br />
mais cette pratique fut rare car il<br />
n’existe que peu d’exemplaires des<br />
décors noirs. Ce que l’on trouve de<br />
façon usuelle, ce sont les tabliers<br />
blancs bordés de rouge avec<br />
sautoirs rouge vermillon et dont<br />
le revers constitue des tabliers et<br />
sautoirs noirs. Ces formes noires<br />
sont extrêmement sobres, ne sont<br />
pas bordées et portent comme<br />
seul symbole une croix rouge.<br />
La thématique des différents<br />
symboles que l’on retrouve<br />
sur les tabliers de Rose Croix<br />
rouge provient principalement<br />
de la Passion de Jésus, mais<br />
aussi du bijou de Rose Croix<br />
ou encore de la personne même<br />
de Jésus.<br />
Principal degré du Rite Écossais<br />
Ancien et Accepté de 1804 à 1890<br />
puisque l’on accédait directement<br />
du 3 e au 18 e degré puis au 31 e , 32 e ,<br />
33 e degré, il fut aussi le grade<br />
terminal des Ordres de Sagesse<br />
du Rite Français Moderne pendant<br />
la courte période où il fut pratiqué,<br />
mais à ce titre il se para de la<br />
titulature de « Nec Plus Ultra »,<br />
ce qui est fautif au Rite Écossais<br />
Ancien et Accepté.<br />
132 132 133
Sur ce sujet :<br />
Guillaume (Pierre) : « Sur les instruments de la Passion du Christ ornant d’anciens<br />
tabliers de Rose Croix » Renaissance Traditionnelle - n° 105 - Paris 1996<br />
Piquet (Michel) : « Les décors du Chevalier de Rose Croix » Catalogue de l’exposition<br />
« Le Franc-Maçon en habit de Lumière » - Tours - 1997<br />
Riche sautoir abondamment brodé de fi ls d’or et d’argent. Les décors<br />
comprennent comme motif central un pélican éployé nourrissant<br />
ses enfants devant une croix latine. De part et d’autre une bordure<br />
comprenant trois roses d’argent et un épi de blé. Le bijou est fautif et<br />
ne correspond pas à ce degré maçonnique.<br />
Le tablier comprend le même motif central du pélican nourrissant<br />
ses enfants au pied d’une croix latine. On remarque la différence<br />
de proportion entre la croix et le volatile de ce tablier et du sautoir<br />
précédent. La Croix fait partie d’un ensemble de trois croix dont deux,<br />
latérales, sortent de deux cornes d’abondance, et rappellent le mont<br />
Calvaire. En inscription dite « hiéroglyphique » les mots PAX VOBIS. Sur la<br />
bavette le delta divin rayonnant avec le tétragramme sacré.<br />
Dans cette composition le pélican, toujours sur une croix latine,<br />
repose sur un arc en quart de cercle duquel s’échappent de part et<br />
d’autre des feuillages (acacia, laurier, olivier ?). Le sujet central est<br />
surmonté d’un voile en dais suspendu à ce qui semble un joug sur<br />
lequel sont trois vases (rosiers ?). De part et d’autre deux motifs :<br />
à gauche une couronne d’épines au-dessus de PAX, à droite une<br />
branche entre une équerre et un compas entrecroisés inscrits dans un<br />
ouroboros au-dessus de VOBIS.<br />
Sur la bavette une étoile flamboyante à cinq branches.<br />
Ensemble sautoir et tablier présenté ici sur un costume d'Époque Empire.<br />
Sautoir en ottoman moiré, broderie et canetille, bijou en verre églomisé<br />
et strass, 19 e s. (TS.002.272) - Tablier en soie brodée et canetille, 19 e s.<br />
(TT.002.536) - Avec l'aimable autorisation de M. Guinhut, costumier.<br />
Soie brodée de fi ls métalliques et textiles, 19 e s. - Collection Suprême Conseil de<br />
France
Chapitres<br />
> Les tabliers<br />
Sur ce modèle comme sur le<br />
précédant, la bordure est doublée<br />
à l’intérieur d’un fil d’or ondulé<br />
dans les ventres duquel sont<br />
fi xées des canetilles et paillettes<br />
donnant ainsi l’impression de<br />
roses placées dans ces creux.<br />
On retrouve le pélican nourrissant<br />
ici cinq enfants (ce nombre varie<br />
entre trois, cinq et sept selon<br />
les compositions) posé sur un<br />
tumulus reposant sur l’ébauche<br />
d’un arc de cercle (qui ici ne fait<br />
pas un quart de cercle ce qui<br />
est fautif). La croix est excentrée<br />
et apparaît à gauche avec une<br />
branche d’acacia, suggérant une<br />
analogie entre Hiram et Jésus ;<br />
à droite une rose. Le tout sous<br />
un dais flanqué de la même<br />
inscription.<br />
Sur la bavette une couronne d’épine<br />
avec en son centre un calice.<br />
Motif central d’un tablier inachevé,<br />
ce pélican est remarquable par<br />
sa qualité de broderie et les<br />
nuances des couleurs. Très sobre<br />
il nourrit trois enfants et n’est mis<br />
en valeur que par deux branches<br />
de verdure. Il est impossible de<br />
prévoir ce qu'aurait été le tablier<br />
fi ni.<br />
Soie brodée, 19 e s. - Collection<br />
Suprême Conseil de France<br />
Collection Suprême Conseil de France<br />
<br />
134 134 135
Tablier du Rite Français<br />
Tablier imprimé représentant une<br />
scène de la légende du grade<br />
d’Élu des Neuf. Au centre de la<br />
composition un justicier arrive<br />
les bras écartés, poignard en<br />
main droite. Il est à l’air libre,<br />
vêtu de rouge et en contre-haut<br />
par rapport à sa future victime<br />
qui est dans une caverne, bras<br />
droit replié sur son cœur, vêtue<br />
de bleu et en contre bas.<br />
La présence du chien, de<br />
l’inscription « Vincere aut mori »<br />
sur la bavette ainsi que le<br />
poignard entouré de quinze<br />
(fantaisie du fabricant !) flammes<br />
rouges font attribuer ce tablier<br />
au quatrième grade (1 er ordre<br />
de sagesse) du Rite Français<br />
Moderne.<br />
< Tablier de la maison Guérin – fi n<br />
du XVIII e siècle, peau imprimée et<br />
peinte - Inv. TT.002.36
Le Rite Français et le G.O.D.F. > Les tabliers<br />
Tablier en peau imprimé, bordé de soie rouge, de la Maison Guérin. Les décors sont ceux d’un<br />
temple décoré au grade d’Écossais (2 e ordre du Rite Français Moderne) ou Grand Élu de la<br />
Voûte Sacrée (14 e degré du Rite Écossais Ancien et Accepté).<br />
La composition centrale offre de haut en bas : sur un autel lui-même posé sur une estrade<br />
de sept marches, un parallélépipède d’or surmonté de deux chérubins. L’artiste a dû vouloir<br />
représenter l’Arche d’Alliance mais il lui manque les anneaux et les bâtons de Sétim. La<br />
présence sur sa face antérieure d’un agneau reposant sur un livre à sept sceaux veut<br />
représenter la Shekinah. Devant cette arche sur le même autel un Volume de la Loi Sacrée<br />
ouvert. Au milieu du tablier un chandelier à sept branches, avec en dessous l’autel des<br />
sacrifi ces sur lequel brûle le Buisson Ardent que le récipiendaire ne peut regarder sans se<br />
protéger en rétrécissant son champ de vision à un triangle formé par les mains à la hauteur<br />
du front. Ce signe triangulaire rappelle que le triangle de la triple unité est le symbole central<br />
des Écossais, représenté sur le bijou, entouré d’un cercle rayonnant entre les branches d’un<br />
compas ouvert sur un quart de cercle (c.f. bavette).<br />
À gauche et en haut la table des pains de propositions puis, en dessous la « mer d’airain »,<br />
bassin soutenu par quatre groupes de trois bœufs, et sur laquelle est posée une auge<br />
contenant le « ciment mystique ».<br />
À droite et en haut, l’autel des parfums où brûle l’encens dans une cassolette puis en<br />
dessous la pierre cubique à pointe donnant en particulier, dans un carré des mots de<br />
81 lettres, les différents mots du grade.<br />
Pour l’essentiel, les décors de ce tablier sont conformes aux descriptions du « Recueil<br />
précieux de la Maçonnerie adhonhiramite » (1787) à l’exception de quelques déplacements<br />
spatiaux des symboles. Toutefois la présence, au tout premier plan en bas, d’un relevé<br />
du temple suggère qu’il s’agit d’un tablier du 2 e ordre (5 e grade) du Rite Français Moderne<br />
qui, comme on le voit rassemble les contenus symboliques de ce qui constitue les 12 e , 13 e<br />
et 14 e degrés du Rite Écossais Ancien et Accepté Cette hypothèse semble confi rmée par<br />
le contenu des mots de la pierre cubique qui commence par les mots d’Apprenti puis de<br />
Compagnon du Rite Français Moderne.<br />
Fin XVIII e - début XIX e siècle (G.L.D.F)<br />
> Inv. TT.002.212<br />
222 223
Le Suprême Conseil de France et<br />
la Grande Loge de France sont<br />
héritiers de près de trois siècles<br />
d’histoire et de culture, et les<br />
décors maçonniques, qu’ils soient<br />
d’hier ou d’aujourd’hui, portent<br />
témoignage de cette patiente<br />
construction. De la peau des<br />
tabliers des tailleurs de pierre, à<br />
la soie tissée d’or des sautoirs<br />
de grands dignitaires, toute la<br />
puissance symbolique de la<br />
Tradition maçonnique s’est exprimée<br />
à travers l’élaboration des décors<br />
propres aux rituels, selon les<br />
époques, les grades, les fonctions<br />
de ceux qui les ont portés.<br />
Pour la première fois, une recherche<br />
historique et symbolique fouillée<br />
éclaire la connaissance de la<br />
création du Rite Écossais Ancien<br />
et Accepté en s’appuyant sur un<br />
important travail muséographique<br />
réalisé à partir des documents<br />
et des objets conservés par<br />
l’obédience.<br />
Co-édition :<br />
Passeurs de Lune<br />
Grande Loge de France