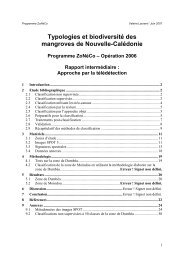Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
les dépôts volcanogènes et calcaires du flysch. Les zones hautes de l'île, telles que la chaîne Centrale et<br />
le paléoseuil de Moindou - Saint Vincent ont été transgressés (on lap) à partir des bassins remplis par les<br />
dépôts du flysch. Le haut structural de Moindou - Saint Vincent, orienté NW-SE, était bordé au nordouest<br />
par le bassin de Bourail et au sud-est par le bassin de Saint Vincent - Nouméa. Les dépôts du<br />
flysch, en partie syn-tectoniques, représentent la dernière phase d’activité des bassins avant l'orogène<br />
alpin. Ce dernier, synchrone du charriage de la nappe des péridotites sur le bâti calédonien, est<br />
responsable de la morphostructure actuelle de l'île. Le paléoseuil de Moindou Saint Vincent, constitué de<br />
greywackes d'âge Jurassico-Triasique, se comporte au cours de l'Eocène terminal-Oligocène, comme un<br />
bloc rigide qui se plisse sous les contraintes compressives. Ces plissements sont à l'origine des<br />
plongements, de l'anticlinal de Gouaro vers le nord-est dans le bassin de Bourail, et de l'anticlinal de<br />
l'Anse Longue vers le sud-est dans le bassin de Saint Vincent - Nouméa.<br />
III.3.2 L'anticlinal de Gouaro<br />
L'anticlinal de Gouaro orienté NW-SE se développe à la terminaison nord-ouest du paléorelief de<br />
Moindou-Saint Vincent, le long de la Côte Ouest de la Nouvelle-Calédonie, à proximité de la commune de<br />
Bourail. Cette structure est unanimement reconnue comme la plus favorable du point de vue des<br />
potentialités en hydrocarbures. Elle a donc fait l'objet de deux sondages de reconnaissance réalisés de<br />
Mars 1954 à Avril 1955 par la "Société de Recherches et d'Exploitation Pétrolière en Nouvelle-Calédonie"<br />
(SREPNC). Les forages Gouaro1 (608m) et Gouaro2 (441m) ont révèles des indices d'huile et de gaz (à<br />
partir de 355 m à Gouaro 1 et de 153 m à Gouaro 2) (Fig. 4). L'origine de l'anticlinal de Gouaro a été et reste<br />
controversée malgré les récents travaux de terrain menés par Vially et Mascle (1994) et Blake (1995) dont<br />
nous détaillerons les résultats Chapitre V.2. La controverse porte sur l'origine (allochtone ou<br />
autochtone) de la "formation des basaltes" qui a des conséquences directes sur le potentiel pétrolier de<br />
l'anticlinal de Gouaro. Gonord (1977), d’après des données structurales et de chimisme des séries<br />
volcaniques de la "nappe" des basaltes, considère que cette dernière est intimement liée à la nappe des<br />
péridotites, qu'elle en constitue la couverture originelle diverticulée lors de la structuration Eocène. Sa<br />
position structurale serait donc, dans cette hypothèse, allochtone et son origine, de même que celle de la<br />
nappe des péridotites, serait à rechercher au nord-ouest. Dans cette hypothèse d'allochtonie importante<br />
de la nappe des basaltes, il est probable que le Sénonien à charbons (roche-mère potentielle), soit<br />
présent sous ces unités allochtones, augmentant le potentiel pétrolier de l'ensemble de la côte Ouest.<br />
Paris (1981) réfute en partie les arguments sur le chimisme océanique des basaltes. Dans son hypothèse<br />
d'autochtonie relative de la formation des basaltes, celle-ci serait l'équivalent latéral, localisé au sein d'un<br />
petit bassin subsident, de la formation du Sénonien à charbons (bassins de Bourail, Moindou et de<br />
Nouméa). Lors de la structuration Eocène, ce petit bassin aurait été inversé et se trouverait en position<br />
"para-autochtone" par rapport aux unités autochtones de la côte Ouest (môle de Moindou). L'extension<br />
des charbons Sénoniens qui constituent la meilleure roche-mère potentielle serait donc réduite aux<br />
bordures de ce bassin.<br />
III.3.3 Les bassins offshores<br />
Les données géophysiques recueillies dans la zone économique de Nouvelle-Calédonie, vaste de 1 400<br />
000 km², révèlent l'existence de bassins (Lord Howe, Fairway, Nouvelle-Calédonie, Loyauté) comblés par<br />
d'épaisses séries sédimentaires. En raison de la méconnaissance de la nature et de l'âge de ces séries<br />
sédimentaires faute de forages profonds, les roches-mères potentielles de cet environnement à priori<br />
propice à la génération d'hydrocarbures demeurent inconnues. Trop peu exploré, le potentiel pétrolier de<br />
ce domaine offshore qui couvre une superficie d'environ 1 000 000 km² n'a jamais pu être évalué.<br />
Coleman (1993) souligne les similarités du régime tectonique ayant structuré les bassins de Nouvelle-<br />
Calédonie et de Los Angeles, respectivement formés sous contraintes décrochantes au Paléogène et au<br />
Néogène (Biddle, 1991). Selon Coleman, le bassin de Los Angeles serait le plus riche au monde en terme<br />
d'hydrocarbures contenus par volume de sédiment. Le bassin de Nouvelle-Calédonie présente<br />
d'importantes séries sédimentaires, une roche-mère probable identique aux bassins de la côte Ouest et de<br />
nombreux réservoirs potentiels. Seul l'âge plus ancien du bassin de Nouvelle-Calédonie pourrait avoir<br />
entraîné la destruction des réservoirs.<br />
Selon Colletant (1993), dans le domaine offshore peu profond, les récifs coralliens probablement<br />
développés en Nouvelle-Calédonie dès le Trias-Jurassique et certainement durant le Crétacé supérieur,<br />
l'Eocène et le Miocène, représenteraient des réservoirs potentiels d'hydrocarbures. Selon cet auteur, la<br />
roche-mère potentielle consisterait en des argiles noires charbonneuses d'âge Jurassique (Chaîne<br />
13