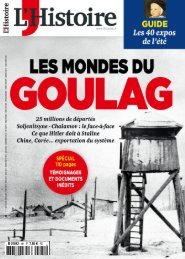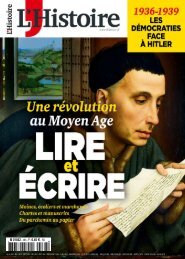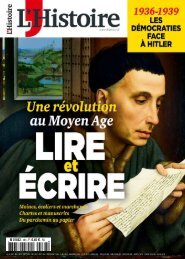La chute du Mur, et après ? - Magazine L'Histoire
1989 : les pays d’Europe de l’Est se libèrent les uns après les autres du communisme. Mais la transition démocratique n’est pas sans heurts. La thérapie économique de choc adoptée s’accompagne de forts taux de chômage. L’entrée dans l’Union européenne est lente à aboutir et les anciens citoyens de l’Est continuent parfois à se sentir méprisés. Aujourd’hui, en Hongrie et en Pologne, les dirigeants remettent en cause la démocratie libérale. Pas si facile de sortir du communisme. Avec Roman Krakovsky, Catherine Gousseff, Paul Gradvohl, Bernard Guetta, Nicolas Offenstadt.
1989 : les pays d’Europe de l’Est se libèrent les uns après les autres du communisme. Mais la transition démocratique n’est pas sans heurts.
La thérapie économique de choc adoptée s’accompagne de forts taux de chômage. L’entrée dans l’Union européenne est lente à aboutir et les anciens citoyens de l’Est continuent parfois à se sentir méprisés. Aujourd’hui, en Hongrie et en Pologne, les dirigeants remettent en cause la démocratie libérale. Pas si facile de sortir du communisme.
Avec Roman Krakovsky, Catherine Gousseff, Paul Gradvohl, Bernard Guetta, Nicolas Offenstadt.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Événement<br />
/ 13<br />
« LA RÉPUBLIQUE,<br />
C’EST LE CONFLIT ! »<br />
Pour nous, république <strong>et</strong> démocratie sont intimement liées. Ce couple ne va pourtant pas<br />
de soi à Rome, là où le concept de res publica s’est lentement forgé. <strong>La</strong> république<br />
n’y désigne pas un régime politique mais la communauté des citoyens en action. Mais,<br />
dans ce régime oligarchique, quel était vraiment le pouvoir <strong>du</strong> peuple ?<br />
Entr<strong>et</strong>ien avec Claudia Moatti<br />
BRIDGEMAN IMAGES – FRÉDÉRIC SCHEIBER /HANS LUCAS/AFP – MANUEL COHEN<br />
L’Histoire : Le mot<br />
« république » vient<br />
de la Rome antique.<br />
Mais qu’est-ce que<br />
la res publica pour<br />
un Romain ?<br />
Claudia Moatti : République<br />
vient en eff<strong>et</strong> <strong>du</strong> latin res publica,<br />
l’un des termes par lesquels les<br />
Romains désignaient leur communauté<br />
politique, à côté de populus<br />
<strong>et</strong> de civitas. Mais tra<strong>du</strong>ire<br />
res publica par « république »<br />
est une facilité qui n’éclaire ni<br />
la société antique ni la notion<br />
elle-même. <strong>La</strong> forme latine de<br />
celle-ci est d’ailleurs fluctuante.<br />
Elle s’écrit en deux mots séparés,<br />
que l’on rencontre dans un<br />
ordre variable (res publica ou<br />
publica res) <strong>et</strong> qui, jusqu’à la fin<br />
de l’Antiquité, se trouvent parfois<br />
ré<strong>du</strong>its au premier, res, la<br />
« chose ». Or une « chose » n’a<br />
pas de référent précis.<br />
Les Romains parlent des<br />
« choses divines <strong>et</strong> humaines »<br />
pour évoquer la totalité <strong>du</strong><br />
monde humain. Dans c<strong>et</strong>te formule,<br />
les « choses » n’existent<br />
qu’en tant qu’il y a des hommes<br />
pour j<strong>et</strong>er un regard sur elles ou<br />
pour en débattre. Les « choses<br />
divines », par exemple, sont l’ensemble<br />
des formes inventées par<br />
les hommes pour honorer les<br />
dieux, sans qu’il soit nécessaire<br />
d’en préciser le contenu.<br />
Mais au plus haut que nous<br />
puissions remonter res appartient<br />
d’abord au langage judiciaire. En<br />
témoigne la loi des Douze Tables,<br />
qui date <strong>du</strong> v e siècle av. J.-C. Dans<br />
un de ses vers<strong>et</strong>s, res, qui désigne<br />
l’affaire juridique, y est en relation<br />
avec deux autres termes :<br />
causa (la définition juridique de<br />
c<strong>et</strong>te affaire) <strong>et</strong> lis (le procès). <strong>La</strong><br />
notion de res renvoie ainsi à une<br />
pluralité d’acteurs, à des affaires<br />
qu’ils ont en partage <strong>et</strong> même qui<br />
sont l’obj<strong>et</strong> d’un litige.<br />
Si l’on étend ces considérations<br />
à la notion de res publica,<br />
que l’on peut donc rendre par la<br />
« chose publique » ou la « cause<br />
publique », plusieurs remarques<br />
s’imposent. Res publica est une<br />
catégorie générale qui exprime<br />
l’idée d’une totalité indéterminée,<br />
ouverte, inachevée : c’est<br />
l’ensemble des affaires qui<br />
concernent les citoyens. Ces<br />
affaires ne sont incluses dans<br />
la chose qu’en tant que les citoyens<br />
les ont en commun. C’est<br />
ce qui distingue res publica de civitas,<br />
qui désigne le territoire de<br />
la cité ou le droit de cité, ainsi<br />
que de populus (l’ensemble<br />
L’AUTEURE<br />
Professeure<br />
d’histoire romaine<br />
à l’université<br />
Paris-VIII <strong>et</strong><br />
à l’University<br />
of Southern<br />
California,<br />
Claudia Moatti a<br />
récemment publié<br />
Res publica.<br />
Histoire romaine<br />
de la chose<br />
publique<br />
(Fayard, 2018).<br />
des citoyens). <strong>La</strong> res publica est<br />
donc d’abord la communauté<br />
vivante des citoyens en action<br />
<strong>et</strong> de leurs affaires, <strong>et</strong> non le patrimoine<br />
de la cité.<br />
Remarquons au passage qu’il<br />
n’y a dans sa définition aucune<br />
référence au divin. Les dieux<br />
font certes partie des affaires publiques,<br />
mais ce sont les citoyens<br />
qui font la res publica, <strong>et</strong> c’est en<br />
ce sens qu’elle est la « chose <strong>du</strong><br />
peuple » (res populi).<br />
Autre point crucial : la pluralité,<br />
le conflit <strong>et</strong> le débat apparaissent<br />
comme des éléments<br />
fondamentaux de socialisation<br />
<strong>et</strong> de structuration. Les<br />
Romains pensent ainsi que les<br />
conflits entre patriciens <strong>et</strong> plébéiens<br />
ont contribué au développement<br />
de la liberté <strong>et</strong> de<br />
l’égalité. Ce n’est qu’à partir <strong>du</strong><br />
ii e siècle av. J.-C. que s’impose<br />
une idéologie <strong>du</strong> consensus<br />
comme fondement de la cité.<br />
Aujourd’hui le terme<br />
république désigne un<br />
régime politique non<br />
monarchique… <strong>et</strong> même le<br />
meilleur régime politique.<br />
Ce que ne recouvre<br />
donc pas la notion de<br />
res publica ?<br />
L’HISTOIRE / N°464 / OCTOBRE 2019